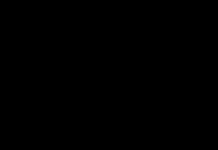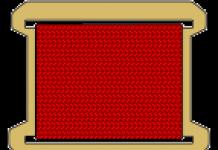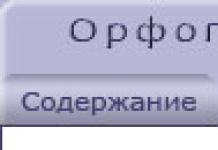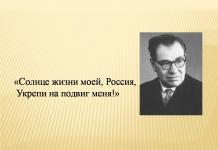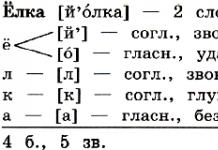agression comportement sociométrique interpersonnel
Introduction
Chapitre 1. La notion d'« agression »
2.2 Approche éthologique - théorie de K. Lorenz
2.3 A. La théorie de l’agression de Basse
2.8 Théories cognitives
Chapitre 3. Agression dans la vie humaine
3.1.1 Relations familiales
3.5 Déterminants individuels de l'agression
Chapitre 4. Recherche empirique
4.1 Méthodes de recherche
4.1.1 « Diagnostic de la tendance à l'agressivité (BPAQ-24) » A. Bass, M. Perry
4.1.2 « Diagnostic des relations interpersonnelles et intergroupes (« Sociométrie ») par J. Moreno
4.2 Résultats de la recherche
4.3 Analyse et discussion de l'étude
Conclusion
Bibliographie
INTRODUCTION
recherche en psychologie de l'agressivité
Dans ce travail, je voudrais montrer l'état actuel et la méthodologie de recherche sur le problème comportement agressif personne. Ce problème attire depuis longtemps l'attention de nombreux scientifiques de nombreux pays du monde. De nombreux ouvrages ont déjà été écrits sur ce sujet, et avec l'augmentation de l'agressivité humaine dans le monde, l'étude de ce problème devient plus globale.
En raison de la situation instable actuelle dans le pays et crise économique Le niveau de vie de la population a fortement chuté. Les gens ont beaucoup de problèmes liés au travail : les salaires ne sont pas payés, ils sont fortement réduits, il n'y a aucune incitation à travailler. De nombreuses personnes n’ont pas la possibilité de gagner de l’argent pour vivre et les prix ne cessent d’augmenter. Les gens n’ont tout simplement rien pour survivre.
Tout cela affecte naturellement la population et ses relations. Les gens sont devenus irritables et agressifs. En raison de problèmes au travail, ils « s'en prennent » à leurs proches, ce qui entraîne des scandales familiaux, des relations tendues et des divorces.
Toutes les sources médiatiques rapportent constamment divers actes d’agression ou de violence. Les statistiques montrent que la violence est endémique dans le monde. Le nombre de terroristes dans le monde augmente chaque année. Des guerres éclatent dans divers pays. Actuellement, de nombreux États ont différentes sortes des armes qui peuvent éliminer toute vie de la surface de la Terre. Tout cela pourrait conduire à une catastrophe mondiale.
À la lumière de ces tendances, il est impossible de ne pas reconnaître que la violence et les conflits comptent parmi les défis les plus graves auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée.
Objet d'étude : comportement humain agressif
Sujet de recherche : étude des modèles et des mécanismes du comportement humain agressif
Objectif de l'étude : identifier les modèles et mécanismes généraux de comportement humain agressif.
Cette étude avance une hypothèse : l'agressivité générale dans un groupe dépend directement du niveau de statut sociométrique du groupe. Plus le niveau de statut sociométrique dans un groupe est élevé, plus les relations sont positives, moins ce groupe est agressif.
Objectifs de recherche:
1) Étude théorique du problème basée sur les œuvres littéraires de S. Freud, K. Lorenz, D. Dollard, A. Bandura, L. Berkowitz et autres.
2) Identifier les principales caractéristiques d'un comportement agressif
3) Considérez les caractéristiques du comportement agressif
4) Analyser les relations des étudiants dans le groupe
5) Étudier la relation entre le comportement agressif et le statut sociométrique dans le groupe
Méthodes de recherche:
Étude et analyse de la littérature scientifique sur la problématique de recherche ;
Méthode de diagnostic de propension à l'agressivité (BPAQ-24) par A. Bass, M. Perry ;
Méthodologie de diagnostic des relations interpersonnelles et intergroupes (« Sociométrie ») J. Moreno.
Caractéristiques de l'échantillon de recherche : l'étude empirique a été menée à Moscou en 2009, 11 étudiants à temps plein de 4e année de la Faculté aérospatiale de l'Institut d'aviation de Moscou, âgés de 22 à 26 ans, ont participé à l'étude.
Et aussi 15 étudiants à temps plein de 4e année de la Faculté de biotechnologie alimentaire de l'Université d'État de biotechnologie appliquée de Moscou, âgés de 22 à 26 ans.
Chapitre 1. La notion d'« agression »
Agression traduit du latin (« aggressio ») signifie « attaque ». Actuellement, le terme « agression » est extrêmement largement utilisé. Ce phénomène est également associé à émotions négatives(par exemple, la colère), et avec des motifs négatifs (par exemple, le désir de faire du mal), ainsi qu'avec attitudes négatives(par exemple les préjugés raciaux) et les actions destructrices.
En psychologie, l'agressivité est comprise comme une tendance (désir), qui se manifeste dans un comportement réel ou dans un fantasme, dans le but de subjuguer les autres ou de les dominer. L’agression peut être soit positive, servant des intérêts vitaux et la survie, soit négative, axée sur la satisfaction de la pulsion agressive en elle-même.
Le but de l'agression peut être soit d'infliger une souffrance (un préjudice) à la victime (agression hostile), soit de recourir à l'agression comme moyen d'atteindre un autre objectif (agression instrumentale). L'agressivité peut être dirigée contre des objets extérieurs (personnes ou objets) ou contre soi-même (corps ou personnalité). L'agression dirigée contre autrui constitue un danger particulier pour la société.
Il existe quatre formes principales d'agression : l'agression réactive, l'agression hostile, l'agression instrumentale et l'auto-agression.
La première forme d'agression - réactive - apparaît en réaction à la frustration et s'accompagne d'états émotionnels de colère, d'hostilité, de haine, etc. Cette forme d'agression comprend également l'agression affective, impulsive et expressive.
L'agressivité expressive est un comportement agressif intimidant objectif principal qui consiste à exprimer et à indiquer leurs intentions potentiellement agressives, à intimider les opposants. Cela n’entraîne pas toujours et n’entraîne pas nécessairement des actions destructrices. Les exemples classiques d'agression expressive sont les danses rituelles, les défilés militaires et divers types de processions de masse.
L'agression impulsive est généralement provoquée par l'action d'un facteur, apparaissant instantanément et passant assez rapidement par un comportement agressif. Une telle agression peut être de nature intermittente (« impulsive »), apparaissant comme par « vagues », sous la forme d'une sorte de « flux et reflux » de comportement agressif.
L'agressivité affective est un phénomène émotionnel, presque totalement dépourvu de composante efficace. L'agression affective est généralement le type d'agression le plus impressionnant, mais aussi le plus insensé. Par exemple, dans un état d'agression affective, des foules de rebelles attaquants peuvent se briser contre la défense bien organisée des autorités et seront vouées à la défaite. C’est ce qu’on appelle parfois « l’excitation agressive » – un état spécial qui nécessite des sacrifices et une destruction immédiate, à tout prix. En règle générale, les sacrifices dans de tels cas dépassent les résultats obtenus.
La deuxième forme d’agression est hostile – un comportement agressif de nature intentionnelle, avec une démonstration claire de la position de l’ennemi et le désir de causer un préjudice intentionnel.
La troisième forme d’agression est instrumentale : un comportement agressif n’est pas l’expression d’états émotionnels ; le but de cette agression est neutre et l’agression n’est utilisée que comme moyen pour atteindre ce but. Parfois, l'agression instrumentale est interprétée comme un comportement agressif visant à obtenir un résultat positif.
La quatrième forme d'agression est l'auto-agression ou l'auto-agression - les comportements et les actions agressifs sont dirigés contre soi-même. Se manifeste par l'auto-accusation, l'auto-humiliation, l'automutilation et un comportement suicidaire.
Les manifestations courantes d'agression comprennent les conflits, la calomnie, la pression, la coercition, l'évaluation négative, les menaces ou le recours à la force physique. Les formes cachées d'agression s'expriment par l'évitement des contacts, l'inaction dans l'intention de nuire à quelqu'un, l'automutilation et le suicide.
L’un des effets agressifs les plus intenses et les plus complexes est sans aucun doute la haine. L'objectif le plus important d'une personne capturée par la haine est la destruction de l'objet de l'agression. Dans certaines conditions, la haine et le désir de vengeance peuvent augmenter de manière inappropriée.
Essayons de clarifier la nature de la relation entre agression et comportement agressif. Il est évident que l'expérience de l'agression par une personne ne conduit pas sans ambiguïté à des actions destructrices. D’un autre côté, lorsqu’elle commet des violences, une personne peut se trouver dans un état d’excitation émotionnelle extrême ou dans un calme total. De plus, l’agresseur ne doit pas nécessairement détester sa victime. Beaucoup de gens font souffrir leurs proches, ceux auxquels ils sont attachés et qu'ils aiment sincèrement.
Les principaux signes d'un comportement agressif peuvent être considérés comme des manifestations telles que :
Désir exprimé de dominer les gens et de les utiliser à ses propres fins ;
Tendance à la destruction ;
Intention de nuire à autrui ;
Tendance à la violence (infliger de la douleur).
En résumant tous les signes énumérés, nous pouvons dire que le comportement agressif d'un individu implique toute action ayant un motif de domination prononcé. Et la violence (physique, émotionnelle) est la manifestation la plus grave et la conséquence indésirable d'un comportement agressif.
Chapitre 2. Approches théoriques de base du problème de l'agression
L’homme était, est et sera peut-être agressif pendant longtemps. Cela semble clair et indéniable. Mais pourquoi est-il agressif ? Qu'est-ce qui te fait être comme ça ? Ils ont toujours essayé de trouver une réponse à cette question. Des opinions opposées, parfois mutuellement exclusives, ont été exprimées concernant les causes de son apparition, sa nature et les facteurs contribuant à sa formation et à sa manifestation. Aujourd'hui, les théories du comportement agressif et les formes identifiées d'activité comportementale chez les animaux et les humains sont diverses. Parmi les théories, il convient naturellement de souligner les théories de S. Freud, K. Lorenz, E. Fromm, J. Dollard, L. Berkowitz, A. Bandura, A. Bas et d'autres.
Toutes les théories de l'agression actuellement existantes, dans toute leur diversité, peuvent être divisées en quatre catégories principales, considérant l'agression comme :
· impulsion ou inclination innée - théories de l'attraction (S. Freud, K. Lorenz) ;
· besoin activé par des stimuli externes - théories de la frustration (J. Dollard, L. Berkowitz) ;
· processus cognitifs et émotionnels - théories cognitives (L. Berkowitz, Zillmann) ;
· manifestation réelle de la théorie sociale apprentissage social(A. Bandura).
La première catégorie de théories, malgré la variété des approches, part du fait que l'agressivité est considérée par ses partisans comme une forme de comportement instinctif inné. En d’autres termes, l’agressivité se manifeste parce qu’elle est génétiquement programmée. Par conséquent, aucun changement, même le plus positif, dans l'environnement social ne peut empêcher sa manifestation. Tout au plus peut-être l’affaiblir. Et il y a sans aucun doute une part de vérité là-dedans.
La deuxième catégorie de théories est l’agressivité comme besoin activé par des stimuli externes, l’agressivité comme impulsion. Les partisans de ces théories attribuent l'agression elle-même aux manifestations de l'influence et de l'influence de l'environnement et des conditions externes (frustration, événements excitants et aversifs). Ainsi, ils croient qu’il est possible non seulement d’affaiblir, mais aussi d’éradiquer complètement l’agression.
Le troisième groupe de théories prend en compte des aspects de l'expérience humaine tels que l'activité cognitive et émotionnelle. Les partisans de ces théories soutiennent qu’il est possible de gérer l’agressivité et de contrôler les comportements en apprenant « simplement » aux gens à imaginer de manière réaliste les dangers potentiels et à évaluer correctement les situations menaçantes.
Enfin, selon le quatrième groupe de théories (théories de l'apprentissage social), l'agressivité est un modèle de comportement social acquis au cours du processus d'apprentissage. Les réactions agressives s'apprennent et s'entretiennent par la participation directe à des situations d'agression, ainsi que par l'observation passive. manifestations agressives.
2.1 L'agression comme instinct opportun - la théorie de S. Freud
Freud a accordé relativement peu d'attention au phénomène de l'agressivité, considérant la sexualité (libido) et l'instinct de conservation comme les forces principales et prédominantes chez l'homme. Dans ce contexte, l’agressivité était considérée simplement comme une réaction au blocage ou à la destruction des pulsions libidinales. L'agression en tant que telle n'était interprétée ni comme faisant partie intégrante, ni comme une partie constante et inévitable de la vie.
Cependant, dans les années 20. il abandonne complètement cette notion. Déjà dans l'œuvre « I and It », ainsi que dans toutes les œuvres ultérieures, il met en avant un nouveau couple dichotomique : l'attirance pour la vie (eros) et l'attirance pour la mort (thanatos). Il a soutenu que tout comportement humain est le résultat d’une interaction complexe entre cet instinct et l’éros et qu’il existe une tension constante entre eux.
La pulsion de mort est dirigée contre l'organisme vivant lui-même et est donc une pulsion soit d'autodestruction, soit de destruction d'un autre individu (si elle est dirigée vers l'extérieur). Si la pulsion de mort s'avère être associée à la sexualité, elle s'exprime alors sous des formes de sadisme ou de masochisme. Et bien que Freud ait souligné à plusieurs reprises que l'intensité de cet instinct peut être réduite, sa principale prémisse théorique dit : une personne est obsédée par une seule passion - le désir de se détruire ou de détruire les autres, et il est peu probable qu'elle puisse l'éviter. alternative tragique.
De l'hypothèse de la pulsion de mort découle que l'agressivité n'est pas par essence une réaction à l'irritation, mais une sorte d'impulsion en mouvement constamment présente dans le corps, conditionnée par la constitution même de l'être humain, la nature même de l'homme. . 1
Freud a fait un pas en avant très important depuis la physiologie mécanique vers une vision biologique de l'organisme dans son ensemble et vers une analyse des conditions biologiques préalables aux phénomènes d'amour et de haine. Cependant, sa théorie souffre d’un sérieux défaut : elle repose sur un raisonnement spéculatif purement abstrait et manque de preuves empiriques convaincantes. C’est donc l’une des théories les plus controversées de la psychanalyse. Cette idée a en fait été rejetée par de nombreux étudiants de Freud qui partageaient ses vues sur d'autres questions. Cependant, l'affirmation de S. Freud, « Moi et cela », maison d'édition « FOLIO » Kharkov, 2003, selon laquelle l'agressivité provient de forces innées et instinctives, a généralement trouvé un soutien même parmi ces critiques.
2.2.Approche éthologique - théorie de K. Lorenz
L'approche évolutive du développement de l'agressivité humaine repose tout d'abord sur la théorie de K. Lorenz, développée à la suite de l'étude du comportement animal. Les vues de K. Lorenz sont assez proches de celles de S. Freud. Selon le concept de K. Lorenz, l'agressivité naît de l'instinct inné de lutte pour la survie. Cet instinct s'est développé au cours de l'évolution et remplit trois fonctions importantes :
Les combats dispersent les représentants des espèces sur une vaste zone géographique,
L'agression contribue à améliorer le fonds génétique de l'espèce car seuls les plus forts et les plus énergiques laissent une progéniture.
Les animaux forts se défendent mieux et assurent la survie de leur progéniture. K. Lorenz Agression / M., "Progrès", 1994
L'énergie d'agression est générée dans le corps de manière spontanée, continue, à un rythme constant, s'accumulant régulièrement dans le temps. Plus la quantité d’énergie agressive disponible à ce moment est grande, moins il faut de force pour que l’agression « éclabousse » vers l’extérieur. Il s’agit du « modèle psychohydraulique » d’agression, créé sur la base de recherches sur l’agression animale. Les personnes et les animaux trouvent généralement un agent causal d'irritation afin d'éliminer le mal et ainsi de se libérer des tensions énergétiques. Ils n’ont pas besoin d’attendre passivement un stimulus approprié : ils le recherchent eux-mêmes et créent même des situations appropriées.
La théorie de K. Lorenz explique le fait que les humains, contrairement à la plupart des autres êtres vivants, subissent une violence généralisée contre les membres de leur propre espèce. Tous les êtres vivants, notamment les animaux prédateurs, ont la capacité de réprimer leurs aspirations. Cela les empêche d'attaquer les membres de leur propre espèce. Les gens, étant des créatures moins dangereuses d'un point de vue biologique, ont un principe de retenue beaucoup plus faible. Aux premiers stades de l’humanité, cela n’était pas très dangereux, car la possibilité de causer de graves dommages était plutôt faible. Cependant, les progrès technologiques ont conduit à une augmentation incroyable de la capacité de l’humanité à causer des « dommages graves » et ont menacé la survie même de l’homme en tant qu’espèce et de l’humanité tout entière.
Pour Lorenz, l’agressivité n’est pas une réaction à des stimuli externes, mais représente sa propre tension interne, qui nécessite une décharge et trouve son expression, qu’il existe ou non un stimulus externe approprié.
On peut aussi dire que la théorie de Lorenz repose sur deux prémisses fondamentales : la première est un modèle hydraulique de l’agression, qui indique le mécanisme d’apparition de l’agression. La seconde est l’idée selon laquelle l’agressivité sert la cause même de la vie, contribue à la survie de l’individu et de l’espèce entière. En général, Lorenz part de l’hypothèse que l’agression intraspécifique (l’agression envers les membres de sa propre espèce) est une fonction qui sert la survie de l’espèce elle-même. Lorenz soutient que l'agression joue justement un tel rôle, en répartissant les représentants individuels de la même espèce dans l'espace de vie approprié, en assurant la sélection des « meilleurs producteurs » et la protection des individus maternels, et en établissant également une certaine hiérarchie sociale. De plus, l'agressivité peut remplir avec beaucoup plus de succès la fonction de préservation de l'espèce que l'intimidation de l'ennemi, qui, au cours du processus d'évolution, s'est transformée en une sorte de comportement constitué de menaces « symboliques et rituelles » qui n'effrayent personne et ne font pas peur. causer le moindre dommage à l’espèce. K. Lorenz Agression / M., "Progrès", 1994
2.3 A. La théorie de l’agression de Basse
Selon la théorie de A. Bass, l'agression est tout comportement qui menace ou cause du tort à autrui.
De l’idée selon laquelle l’agression implique soit un préjudice, soit une insulte à la victime, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’infliger des lésions corporelles à la personne qui la reçoit. L'agression se produit si le résultat des actions entraîne des conséquences négatives. Ainsi, outre les insultes par l'action, des comportements tels que donner une mauvaise image de quelqu'un, dénigrer ou ridiculiser publiquement, priver quelqu'un de quelque chose de nécessaire, et même refuser de l'amour et de l'affection, peuvent, dans certaines circonstances, être qualifiés d'agressifs.
Selon A. Bass, les actions agressives peuvent être décrites sur la base de trois échelles : physique - verbale, active - passive, directe - indirecte.
Leur combinaison donne huit catégories possibles dans lesquelles appartiennent les actions les plus agressives.
· Physique - actif - direct.
Frapper une autre personne avec une arme blanche, battre ou blesser avec une arme à feu.
· Physique - actif - indirect.
Complot avec un assassin pour détruire un ennemi.
· Physique - passif - direct.
Le désir d’empêcher physiquement une autre personne d’atteindre un objectif souhaité ou de s’engager dans une activité souhaitée.
· Physique - passif - indirect.
Refus d'accomplir les tâches nécessaires.
· Verbal - actif - direct.
Insulter ou humilier verbalement une autre personne.
· Verbal - actif - indirect.
Répandre des calomnies ou des ragots malveillants sur une autre personne.
· Verbal - passif - direct.
Refus de parler à une autre personne.
· Verbal - passif - indirect.
Refus de donner certaines explications ou explications verbales. Baron R., Richardson D. Agression. -- Saint-Pétersbourg : Peter, 2001
Les gens frappent souvent divers objets inanimés, par exemple des meubles, de la vaisselle ; un tel comportement ne peut être considéré comme agressif que lorsqu'un être vivant est blessé. On ne peut parler d'agression que lorsque le destinataire ou la victime cherche à éviter un tel traitement. Parfois, les victimes d'insultes ou d'actes douloureux ne cherchent pas à éviter des conséquences désagréables pour elles-mêmes (certaines formes de jeux amoureux à caractère sadomasochiste). Le suicide n'est pas non plus une agression, puisqu'ici l'agresseur agit comme sa propre victime. De tels actes ne peuvent donc pas être qualifiés d’agression. Même si le but du suicide n’est pas la mort, mais un appel désespéré à l’aide, le suicidé cherche toujours à se faire du mal.
2.4 L'agression comme mal - la théorie d'E. Fromm
Dans son ouvrage majeur « The Anatomy of Human Destructiveness », Erich Fromm (1994) a présenté une analyse généralisée de toutes sortes de recherches sur l’agressivité humaine. Il a repensé tout ce qui est destructeur chez l'homme d'un point de vue phylogénétique et ontogène comme le problème fondamental du mal au niveau de l'individu et de la société.
Le phénomène d'agression, du point de vue d'E. Fromm, est une réaction humaine à la destruction des conditions de vie normales. L’agression est une « qualité acquise » et l’homme n’est pas par nature un destructeur. Il est victime de son histoire, victime de sa liberté, ce par quoi il entend « une mesure de responsabilité ». Erich Fromm « Anatomie de la destructivité humaine », M., République, 1994.
E. Fromm ne réduit pas entièrement le comportement humain à des mécanismes neuropsychologiques innés - les stimuli. Le comportement humain est la réalisation de sa liberté. Mais la liberté est réservée à quelques-uns. La grande majorité des gens ne sont pas capables d’agir, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas réaliser le pouvoir de leur esprit et de leur volonté, en raison de leur absence de visage. La plupart des gens vivent exclusivement selon des modèles et des normes. Mise en œuvre liberté humaine accompagné de destructivité. En même temps, E. Fromm part toujours de la thèse de la primauté processus mentaux, qui déterminent en grande partie la structure phénomènes sociaux dans l'histoire de l'humanité.
Il considère le problème de la destructivité d'un point de vue biosocial. Il part du fait que le type et la constitution de la personnalité s'inscrivent dans un contexte social spécifique qui influence l'individu et développe les caractères sociaux.
Dans le problème de l'agressivité et de la destructivité, E. Fromm combine deux points de vue apparemment diamétralement opposés sur le problème de l'agressivité : l'instinctivisme et le behaviorisme. Le premier point de vue - l'instinctivisme - explique tout ce qui est destructeur chez une personne et le réduit à son essence animale. Le deuxième point de vue – le behaviorisme – fait dériver le caractère destructeur d’une personne exclusivement de son comportement. nature sociale. Il semblerait qu'une combinaison apparemment acceptable de deux positions extrêmes bénéficie de la méthodologie qui a permis à Fromm de diviser l'agressivité en bénigne et maligne. De plus, le premier remonte aux instincts, à la nature animale, le second se fonde sur le caractère, sur les passions humaines, derrière lesquelles se cachent des pulsions existentielles (amour, haine, peur, foi, intérêt personnel, soif de pouvoir, envie, etc. , etc.).
L’interaction des instincts et des passions humaines exprime la tentative d’une personne de surmonter une existence banale dans le temps et d’accéder à un être transcendant. Tout obstacle à la réalisation de ses besoins conduit à la destruction. relations sociales, déformations des mécanismes psychologiques. E. Fromm en identifie plusieurs types : masochistes, sadiques, destructeurs et conformistes.
2.5 Théorie de l'agression frustration par J. Dollard et N. Miller
La frustration est un état mental d'échec, causé par l'incapacité de satisfaire des besoins, survenant en présence d'obstacles insurmontables réels ou imaginaires sur le chemin d'un certain objectif. Peut être considéré comme l'une des formes stress psychologique. Elle se manifeste par des sentiments de déception, d’anxiété, d’irritabilité et enfin de désespoir. Dans le même temps, l’efficacité des opérations diminue fortement. La frustration s’accompagne d’une série d’émotions pour la plupart négatives : colère, irritation, culpabilité, etc.
D. Dollard a défini l'agressivité comme « une prédisposition à la colère ; l’indignation et la suppression violente de tout obstacle ou obstacle qui gêne le libre exercice de toute autre tendance.
L'essence de la théorie de J. Dollard est assez simple et réside dans le fait que la frustration mène toujours à une agression sous une forme ou une autre et que l'agression est toujours le résultat de la frustration. Cette théorie repose sur deux principes :
· l'agression est toujours le résultat et la conséquence de la frustration ;
La frustration entraîne toujours une agression. Baron R., Richardson D. Agression. -- Saint-Pétersbourg : Peter, 2001
On suppose que la frustration, définie comme le blocage ou l'interférence avec tout comportement visant un objectif, provoque une agression (induit une agression), ce qui, d'une part, montre clairement que les individus frustrés ont recours à des attaques verbales ou physiques contre les autres. Au contraire, ils démontrent toute la gamme des réactions à la frustration : de la résignation et du découragement aux tentatives actives pour surmonter les obstacles sur leur chemin.
Des recherches empiriques montrent que même si la frustration contribue parfois à l’agressivité, cela n’arrive pas si souvent.
La plupart des psychologues estiment que le lien entre l'agressivité et la frustration est beaucoup moins strict que ce que J. Dollard et N. Miller pensaient autrefois.
Miller, qui fut l'un des premiers à formuler la théorie de la frustration et de l'agression, a modifié la première position : la frustration donne naissance à divers modèles de comportement, et l'agressivité n'est que l'un d'entre eux.
L’hypothèse selon laquelle l’agressivité est toujours motivée par la frustration va également trop loin. Il ne fait aucun doute que l’agressivité résulte de nombreux facteurs autres que la frustration.
J. Dollard et N. Miller pensaient que plus le sujet anticipe le plaisir, plus l'obstacle est fort et plus les réponses sont bloquées, plus l'impulsion au comportement agressif est forte. Ils ont également conclu que « le degré de retardement de tout acte d'agression varie en proportion directe avec la sévérité perçue de la punition qui peut suivre cet acte ».
Si un individu est averti de ne pas attaquer quelqu'un qui l'a frustré, après avoir été menacé d'une sorte de punition, il aura toujours tendance à agir de manière agressive. En conséquence, des actions agressives peuvent survenir à l'encontre d'une personne complètement différente, l'attaquant étant associé à moins de punition.
Miller a proposé un modèle spécial pour expliquer l'émergence de l'agression déplacée, c'est-à-dire les cas où des individus font preuve d'agressivité non pas envers leurs frustrants, mais envers des personnes complètement différentes. L'auteur a suggéré que dans de tels cas, le choix de la victime par l'agresseur est déterminé par trois facteurs :
· la force d'incitation à l'agression ;
· la force des facteurs inhibant ce comportement ;
· la similarité du stimulus de chaque victime potentielle avec le facteur frustrant.
Miller pensait que les obstacles à l'agression disparaissaient plus rapidement que les incitations à adopter un tel comportement, à mesure que la similitude avec l'agent frustrant augmentait.
Le facteur le plus important pour prédire les conséquences de la frustration et leur intensité est le caractère de l'individu. Par exemple, un glouton s'indignera s'il ne reçoit pas assez de nourriture, une personne avide deviendra agressive si elle ne peut pas négocier quelque chose et l'acheter à bas prix. La personnalité narcissique éprouve de la frustration si elle ne reçoit pas les éloges, la reconnaissance et l’admiration attendus. Cela dépend donc du caractère d'une personne, d'une part, de ce qui provoque la frustration en elle et, d'autre part, de l'intensité avec laquelle elle réagira à la frustration.
2.6 Théorie des messages à l'agression par L. Berkowitz
L. Berkowitz a apporté les modifications les plus importantes à la théorie de la frustration-agression. Il a fait valoir que la frustration est l'un des nombreux stimuli aversifs différents qui ne peuvent que provoquer des réactions agressives, mais ne conduisent pas directement à un comportement agressif, mais créent plutôt une volonté d'agir de manière agressive. Un tel comportement ne se produit que lorsqu'il existe des signaux correspondants d'agression - des stimuli environnementaux associés à des facteurs actuels ou antérieurs provoquant la colère, ou à l'agression en général.
Riz. 2. Modèle de la théorie des pulsions d'agression par L. Berkowitz
Selon L. Berkowitz, les stimuli acquièrent la propriété de provoquer une agression, semblable au développement classique de réflexes conditionnés. Un stimulus peut acquérir une signification agressive s'il est associé à une agression positivement renforcée ou s'il est associé à un inconfort et une douleur déjà ressentis. Berkowitz L. Agression. Causes, conséquences et contrôle. Saint-Pétersbourg-M., 2001.
Berkowitz a soutenu que chez les individus très frustrés, la pulsion agressive ne peut être affaiblie qu'en causant du tort à la personne frustrée. Seules les attaques réussies, accompagnées de dommages à l'objet de l'agression, sont capables d'affaiblir ou d'éliminer complètement l'impulsion agressive.
2.7 A. La théorie de Bandura sur l’apprentissage social
La théorie de l'apprentissage social proposée par A. Bandura est unique : l'agressivité est considérée ici comme un comportement social spécifique qui s'apprend et s'entretient fondamentalement de la même manière que de nombreuses autres formes de comportement social.
Selon Bandura, l’analyse des comportements agressifs nécessite de considérer trois points :
1. les moyens de maîtriser de telles actions ;
2. les facteurs provoquant leur apparition ;
3. les conditions dans lesquelles ils sont fixés.
La théorie de l’apprentissage social considère l’agression comme un comportement social qui implique des actions « sous lesquelles se trouvent des compétences complexes qui nécessitent un apprentissage approfondi ». A. Bandura, « Principes de modification du comportement », Sofia, 1999.
L'agressivité s'acquiert par des facteurs biologiques et par l'apprentissage (observation, expérience directe).
Facteurs biologiques.
La commission d'une action agressive dépend de mécanismes neurophysiologiques de base. Tout simplement, système nerveux participe à toute action, y compris agressive. Cependant, l’influence de ces structures et processus de base est limitée, les mécanismes neuropsychologiques sont activés en fonction de la stimulation appropriée et sont contrôlés par la conscience.
Apprentissage
Observation. Les enfants et les adultes adoptent facilement des réactions agressives nouvelles pour eux, auxquelles ils n'étaient pas prédisposés auparavant, simplement en observant le comportement des autres. Ce qui est encore plus significatif, c'est lorsque les gens observent des exemples d'agressions accueillies avec approbation ou restant impunies - cela inspire souvent un comportement similaire.
Expérience directe.
Un des moyens importants l'assimilation par une personne d'un large éventail de réactions agressives est un encouragement direct à un tel comportement. Recevoir du renfort pour des actions agressives augmente la probabilité que de telles actions se reproduisent à l'avenir.
La preuve de cet effet a été obtenue dans de nombreuses expérimentations animales. Dans ces études, les animaux ont reçu différents types de renforçateurs pour comportement agressif (eau, nourriture, etc.). Les animaux renforcés ont rapidement acquis une tendance prononcée au comportement agressif. Cependant, dans de nombreux cas d'apprentissage humain, par rapport à l'apprentissage chez différentes espèces animales, les facteurs positifs qui conduisent à une augmentation notable de la tendance au comportement agressif chez les adultes et les enfants comprennent l'obtention de récompenses matérielles (argent, objets, jouets), l'approbation sociale ou un statut plus élevé, ainsi qu'un bon traitement de la part des autres.
Selon cette théorie, l'agression est provoquée par l'influence de modèles (excitation, attention), de traitements inacceptables (attaques, frustrations), d'incitations (argent, admiration), d'instructions (ordres), de croyances excentriques (idées paranoïaques).
A. Bandura a identifié trois types de récompenses et de punitions qui régulent les comportements agressifs.
· récompenses et punitions externes : par exemple, récompenses et punitions matérielles, éloges ou reproches publics et/ou affaiblissement ou augmentation des attitudes négatives des autres ;
· expérience indirecte : par exemple, en offrant la possibilité d'observer comment les autres sont récompensés ou punis ;
· Mécanisme d'autorégulation : par exemple, une personne peut s'attribuer des récompenses et des punitions.
2.8 Théories cognitives
2.8.1 Théorie cognitive D.Zilmann
Malgré l’interprétation plus préférable de l’excitation et des processus cognitifs comme influençant indépendamment le comportement agressif, Zillmann a soutenu que « la cognition et l’excitation sont étroitement liées ; ils s’influencent mutuellement tout au long du processus d’expériences et de comportements pénibles.
Ainsi, il a très clairement pointé la spécificité du rôle des processus cognitifs dans le renforcement et l'affaiblissement des réactions émotionnelles agressives et le rôle de l'éveil dans la médiation cognitive du comportement. Il a souligné que quel que soit le moment de sa survenue (avant ou après l'apparition de la tension nerveuse), la compréhension de l'événement peut probablement influencer le degré d'éveil. Si l'esprit d'une personne lui dit que le danger est réel, ou si l'individu devient obsédé par la menace et envisage sa vengeance ultérieure, alors il maintiendra un niveau élevé d'excitation. En revanche, l'extinction de l'éveil est la conséquence la plus probable du fait qu'après avoir analysé la situation, la personne a découvert des circonstances atténuantes ou a ressenti une diminution du danger.
De même, l’excitation peut influencer la cognition. D. Zillmann a soutenu qu'à des niveaux d'éveil très élevés, une diminution de la capacité de fonctionner cognitivement peut conduire à un comportement impulsif. Dans le cas d'une agression, l'action impulsive sera agressive car la désintégration du processus cognitif interférera avec l'inhibition de l'agressivité. Ainsi, lorsque des perturbations se produisent dans le processus cognitif qui permet de supprimer l'agressivité, la personne est susceptible de réagir de manière impulsive (c'est-à-dire agressive). Dans ce que Zillmann décrit comme une « plage plutôt étroite » d’excitation modérée, les processus cognitifs complexes susmentionnés se dérouleront dans le sens d’une réduction des réponses agressives.
Riz. 3. Le modèle de comportement agressif de D. Zillmann. Baron R., Richardson D. Agression. -- Saint-Pétersbourg : Peter, 2001
2.8.2 Modèle de formation de nouvelles connexions cognitives par L. Berkowitz
Dans ses travaux ultérieurs, L. Berkowitz a révisé sa théorie originale, déplaçant l'accent des messages sur l'agression vers les émotions et les émotions. les processus cognitifs et soulignant ainsi que ce sont ces dernières qui sous-tendent la relation entre frustration et agression.
Selon son modèle de formation de nouvelles connexions cognitives, la frustration ou d'autres stimuli aversifs (par exemple, douleur, odeurs désagréables, chaleur) provoquent des réactions agressives par la formation d'un affect négatif.
L. Berkowitz a soutenu que « les obstacles ne provoquent l’agression que dans la mesure où ils créent un affect négatif ». Bloquer la réalisation d’un objectif n’encouragera donc pas l’agressivité à moins qu’elle ne soit vécue comme un événement désagréable. À son tour, la façon dont l’individu interprète lui-même l’impact négatif détermine sa réaction à cet impact.
Telle qu'amendée en 1989, la théorie de Berkowitz affirme que les messages d'agression ne sont en aucun cas une condition préalable à l'apparition d'une réaction agressive. Au contraire, ils ne font qu’« intensifier la réaction agressive face à la présence d’un obstacle empêchant la réalisation de l’objectif ». Il a également fourni la preuve qu'un individu qui a été incité à l'agressivité (c'est-à-dire qu'il explique ses sentiments négatifs par de la colère) peut devenir plus réceptif et plus susceptible de répondre aux messages d'agression. Ainsi, même si l’agressivité peut survenir en l’absence de facteurs situationnels qui la stimulent, une personne frustrée sera toujours plus souvent attentive à ces stimuli, et ils sont susceptibles d’augmenter sa réponse agressive.
Chapitre 3. Agression dans la vie humaine
3.1 Développement de comportements agressifs
Les enfants acquièrent des connaissances sur les comportements agressifs à partir de trois sources principales :
· Famille – peut à la fois démontrer des modèles de comportement agressif et le renforcer.
· Pairs - apprenez l'agressivité en interagissant avec eux, en apprenant les avantages d'un comportement agressif pendant les jeux.
· Médias - découvrez les réactions agressives à partir d'exemples symboliques des médias.
3.1.2 Relations familiales
C'est au sein de la famille que l'enfant subit la première socialisation. À l'aide de l'exemple des relations entre les membres de la famille, il apprend à interagir avec d'autres personnes, apprend des comportements et des formes de relations qui lui resteront à l'adolescence et à l'âge adulte. Les réactions des parents face au comportement incorrect de l'enfant, la nature de la relation entre parents et enfants, le niveau d'harmonie ou de discorde familiale, la nature des relations avec les frères et sœurs - tels sont les facteurs qui peuvent prédéterminer le comportement agressif de l'enfant dans la famille et à l'extérieur. cela, ainsi qu'influencer ses relations avec ceux qui vous entourent à l'âge adulte.
Les relations négatives au sein du couple parent-enfant ont un fort impact. Si les enfants ont de mauvaises relations avec l’un ou les deux parents, s’ils se sentent considérés comme sans valeur ou ne ressentent pas le soutien de leurs parents, ils s’en prendront aux autres enfants ; les pairs ne les accepteront pas ; se comporteront de manière agressive envers leurs parents.
La relation de l'enfant avec son frère ou sa sœur est fondamentale pour l'apprentissage des comportements agressifs.
Les enfants font preuve de plus d’agressivité physique ou verbale contre un frère ou une sœur que contre tous les autres enfants avec lesquels ils interagissent.
Les recherches sur la relation entre les pratiques de leadership familial et le comportement agressif des enfants se sont concentrées sur la nature et la sévérité des punitions, ainsi que sur le contrôle parental sur le comportement des enfants. En général, il a été constaté que les punitions sévères sont associées à des niveaux d'agressivité relativement élevés chez les enfants, et qu'une surveillance et un encadrement insuffisants des enfants sont en corrélation avec des niveaux élevés d'antisocialité, souvent accompagnés d'un comportement agressif.
Eron et al. ont constaté que les enfants exposés à des punitions sévères étaient jugés plus agressifs par leurs pairs.
Patterson et ses collègues ont découvert que deux dimensions du leadership familial – le contrôle (le degré auquel on est protecteur et conscient de ses enfants) et la cohérence (cohérence dans les exigences et les méthodes de discipline) – sont associées à l'évaluation personnelle de son propre style de vie dans rapport aux normes sociales. Dans ce cas, les parents du fils qui ne surveillaient pas leur comportement et étaient cohérents dans leurs punitions avaient tendance à se comporter de manière antisociale.
L'agressivité des enfants est associée à :
· le négativisme de la mère - hostilité, aliénation, indifférence de l'enfant ;
· l'attitude tolérante de la mère à l'égard des manifestations d'agressivité de l'enfant envers ses pairs ou les membres de sa famille ;
· recours à des méthodes disciplinaires énergiques par les parents – châtiments corporels, menaces, scandales ;
· le tempérament de l'enfant - niveau d'activité et tempérament.
Le recours aux châtiments corporels comme moyen d'élever des enfants dans le processus de socialisation cache un certain nombre de « dangers » spécifiques. Premièrement, les parents qui punissent leurs enfants peuvent en fait être pour eux un exemple d’agressivité. Dans de tels cas, la punition peut provoquer une agression ultérieure. L'enfant apprendra que l'agression physique est un moyen d'influencer les gens et de nous contrôler, et y aura recours lorsqu'il communiquera avec d'autres enfants.
Deuxièmement, les enfants qui sont trop souvent punis auront tendance à éviter ou à résister à leurs parents.
Troisièmement, si la punition excite et dérange trop les enfants, ils risquent d’oublier la raison de leurs actes. Autrement dit, l'enfant ne se souviendra que de la douleur qui lui a été infligée, et non de l'apprentissage des règles de comportement acceptables.
3.1.2 Relations avec les pairs
Jouer avec ses pairs donne aux enfants l'occasion d'apprendre des réactions agressives (par exemple, utiliser les poings ou les insultes).
Il existe des preuves que les enfants qui fréquentaient établissements préscolaires régulièrement, plus agressifs que les enfants qui le faisaient moins souvent.
Les pairs n’aiment pas les enfants agressifs et les qualifient souvent de « les plus désagréables ». Ces enfants démontrent un comportement social, tel que verbal (menaces, malédictions), physique (coups, coups de pied), provoquant l'hostilité.
Les chercheurs ont découvert que les étudiants présentant des niveaux d’agressivité élevés étaient désignés par le même nombre de pairs comme des étudiants moins agressifs que leurs meilleurs amis. Comme prévu, les enfants agressifs ont tendance à faire équipe avec des pairs tout aussi agressifs.
Une des découvertes classiques la psychologie sociale- le fait que les gens sont souvent fortement influencés par les actions ou les paroles des autres. Un tel comportement d’apprentissage joue un rôle important dans l’explication des effets d’exemples de comportement violent.
Un individu qui observe les actions agressives des autres peut souvent reconsidérer radicalement les restrictions qu'il a lui-même fixées auparavant sur un tel comportement, estimant que si d'autres font preuve d'agressivité en toute impunité, alors la même chose est autorisée pour lui. Cet effet de désinhibition peut augmenter la probabilité d'un comportement agressif de la part de l'observateur ; de plus, une exposition constante à des scènes de violence contribue à la perte progressive de la sensibilité émotionnelle à l'agression et aux signes de douleur d'autrui.
Les personnes qui sont fréquemment témoins de violences ont tendance à s’y attendre et à les percevoir le monde aussi hostiles à leur égard.
Les expériences conduisent à la même conclusion : les enfants qui observent une agression chez les adultes ont tendance à se comporter de manière agressive dans leurs relations avec les autres.
3.1.3 Modèles d'agression dans les médias
Une étude portant sur des programmes télévisés populaires a révélé que deux programmes sur trois contiennent un contenu violent (« actes de coercition physique accompagnés de menaces de coups ou de meurtre »). Où cela mène-t-il ? Lorsqu’un enfant termine ses études secondaires, il a vu à la télévision environ 8 000 scènes de meurtre et 100 000 autres actes de violence.
Depuis le début de l’ère télévisuelle, le nombre de crimes violents a augmenté plusieurs fois plus vite que la population. Les défenseurs soutiennent que l’épidémie de violence est le résultat de nombreux facteurs. Le débat se poursuit encore aujourd’hui.
Plus il y a de violence dans le programme, plus l'enfant est agressif. Cette relation est modérée, mais elle se dessine progressivement dans différents pays.
Dans une étude menée auprès de garçons, les chercheurs ont conclu que, contrairement à ceux qui regardaient une petite quantité de contenu violent, ceux qui regardaient du contenu plus violent avaient commis presque deux fois plus de crimes violents au cours des six derniers mois. Cela a donné des raisons de croire que parmi les « invétérés », des déviations de comportement se produisent en réalité à cause de la télévision.
Iron et Huisman ont découvert que des hommes de trente ans qui enfance regardaient beaucoup d’émissions de télévision « cool », étaient plus susceptibles de commettre des crimes graves.
La conclusion de certains chercheurs est la suivante : regarder des films contenant des scènes antisociales est étroitement associé à un comportement antisocial. Cette influence n'est pas très forte ; en fait, elle est parfois si légère que certains critiques doutent de son existence. De plus, l'agressivité dans les expériences est plus probable au niveau du fait de se pousser les uns les autres, de faire des remarques offensantes. Mais force est de constater que le fait de regarder des scènes de violence augmente niveau général violence. Le fait est plutôt que la télévision est l’une des raisons.
Des enquêtes auprès d'adolescents et d'adultes ont montré que les gros téléspectateurs (quatre heures par jour ou plus) étaient plus susceptibles que les téléspectateurs occasionnels (deux heures ou moins) d'exagérer le degré de violence dans le monde qui les entoure et de craindre d'être complètement attaqués.
3.2 Facteurs biologiques d'agression
Influences génétiques.
Les personnes ayant des caractéristiques biologiques similaires se comportent de la même manière. Autrement dit, si les gens ont les mêmes gènes et présentent les mêmes caractéristiques de comportement, un tel comportement peut être considéré comme héréditaire.
L'hérédité affecte la sensibilité du système nerveux aux agents d'agression. Notre tempérament - notre réceptivité et notre réactivité - nous est en partie donné à la naissance et dépend de la réactivité de notre système nerveux sympathique.
Système nerveux
L'agression est un complexe comportemental complexe et il est donc impossible de parler de l'existence d'un « centre d'agression » clairement localisé dans le cerveau humain. Cependant, chez les animaux comme chez les humains, les scientifiques ont découvert des zones du système nerveux responsables de la manifestation de l'agressivité. Lorsque ces structures cérébrales sont activées, l’hostilité augmente ; les désactiver entraîne une diminution de l’hostilité. Par conséquent, même les animaux les plus doux peuvent être enragés et les plus féroces peuvent être apprivoisés.
Facteurs biochimiques
La chimie du sang est un autre facteur qui influence la sensibilité du système nerveux à la stimulation de l’agressivité. Des expériences en laboratoire montrent que les personnes en état d'ébriété alcoolique sont beaucoup plus faciles à inciter à un comportement agressif. Les personnes qui commettent souvent des violences :
1) abuser de l'alcool ;
2) devenir agressif après une intoxication.
Dans le monde réel, près de la moitié des crimes violents, y compris les violences sexuelles, sont commis sous l’influence de l’alcool.
L'agressivité est également influencée par la testostérone, une hormone sexuelle masculine. Les médicaments qui abaissent les niveaux de testostérone chez les hommes violents réduisent leurs tendances agressives. Après 25 ans, le taux de testostérone dans le sang d’un homme diminue, et avec lui le nombre de crimes « violents » chez les hommes du même âge.
D’autres sources de comportement agressif incluent de faibles niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur, qui est également déficient chez les personnes souffrant de dépression. Chez les humains et les primates, de faibles niveaux de sérotonine se retrouvent chez les individus sujets à la violence. De plus, la baisse artificielle des niveaux de sérotonine lors d’expériences en laboratoire amène les sujets à être plus agressifs en réponse aux événements provoquants (en particulier, ils sont plus disposés à « punir » un autre sujet avec un choc électrique).
Il est important de garder à l’esprit qu’il existe une relation bidirectionnelle entre les niveaux de testostérone et de sérotonine et le comportement. Par exemple, des niveaux élevés de testostérone contribuent au développement de traits de personnalité tels que la dominance et l’agressivité. En revanche, en cas de comportement agressif, les niveaux de testostérone augmentent. Les personnes dont la position dans la société s’est soudainement détériorée ont des niveaux de sérotonine plus faibles.
3.3 Déterminants externes de l'agression
Les chercheurs ont découvert que les individus d'une grande variété d'animaux exposés à la douleur sont plus cruels les uns envers les autres que la douleur qui leur est infligée. Chez l’homme également, la douleur augmente l’agressivité. Berkowitz a conclu que la stimulation aversive plutôt que la frustration est le principal déclencheur d'une agression hostile. Tout événement aversif, qu'il s'agisse d'attentes non satisfaites, d'insulte personnelle ou de douleur physique, peut conduire à une explosion émotionnelle. Berkowitz L. Agression. Causes, conséquences et contrôle. Saint-Pétersbourg-M., 2001.
Le changement climatique peut influencer les comportements. Odeurs nauséabondes, fumée de tabac, pollution de l’air : tout cela peut être lié à un comportement agressif. Mais le plus étudié est la chaleur.
Les émeutes ont eu lieu les jours plus chauds que les jours plus froids. Naï grande quantité Les crimes liés à la violence sont commis non seulement lors des journées chaudes, mais également pendant la saison chaude, en particulier les années où l'été est particulièrement chaud. Les conducteurs de voitures sans climatisation sont plus susceptibles de klaxonner lorsque les voitures ralentissent.
Comportement d'attaque
Le comportement agressif d'une autre personne, comme infliger délibérément de la douleur ou être offensant, est un déclencheur d'agression particulièrement puissant. Le principe le plus courant est « œil pour œil, dent pour dent ».
Un sentiment subjectif d’étroitesse, de manque d’espace est également un facteur de stress.
L’état de stress vécu par les animaux dans un espace confiné surpeuplé augmente le niveau d’agressivité. De même, les habitants des grandes villes densément peuplées sont confrontés à davantage de criminalité et à une plus grande détresse émotionnelle.
Excitation
La recherche montre de manière concluante que l’excitation renforce les émotions.
L’excitation sexuelle et d’autres types d’excitation, comme la colère, peuvent se renforcer mutuellement. Sur la base d'expériences en laboratoire, il a été constaté que les stimuli érotiques ont un effet plus excitant sur les personnes qui viennent de ressentir une frayeur.
La frustration, la chaleur, la foule et les insultes augmentent l’excitation. Dans ce cas, l'excitation combinée à des pensées et des sentiments hostiles peut conduire à l'émergence d'un comportement agressif.
3.4 Déterminants sociaux de l'agression
Il existe des déterminants sociaux tels que la frustration ; provocations physiques et verbales d'autrui; moments d'incitation des autres
Frustration
Le niveau et le caractère imprévu de la frustration donnent lieu à des émotions négatives dont L. Berkowitz considère la présence comme nécessaire à l'émergence d'intentions agressives. Les messages d'agression peuvent renforcer (ou supprimer) l'impulsion d'agression. Le fait que la frustration conduise ou non à l'agression dépend de l'interprétation que fait l'individu d'une variété de facteurs situationnels (tels que l'intensité de la frustration et des stimulants liés à l'agression) et de sa réponse émotionnelle à ceux-ci.
Provocations physiques et verbales d'autrui
Attaques provocatrices : La provocation directe, verbale ou physique, provoque souvent une réponse agressive. Selon une étude d'O'Leary et Denjerink, les gens répondent de la même manière aux provocations extérieures : presque tous les sujets adhéraient au principe « œil pour œil, dent pour dent », même un peu, sans céder aux leur adversaire.
Le sexe de l'agresseur influence également la manifestation de l'agressivité. Des expériences ont montré que les femmes sont moins souvent agressées physiquement que les hommes. Richardson, Vandenberg et Humphreys ont mené une expérience dont les résultats ont révélé que les femmes provoquent moins d'agressivité parce qu'elles sont perçues comme moins menaçantes que les hommes. Dans une expérience visant à identifier les facteurs qui augmentent la probabilité que les hommes soient agressifs envers les femmes, Richardson, Leonard, Taylor et Hammock ont montré qu'il n'y a aucune raison de croire que les femmes sont moins susceptibles d'être agressives que les hommes. La peur est l’un des nombreux facteurs qui l’emportent sur la dissuasion perçue de ne pas faire de mal à une femme.
Documents similaires
Le concept de statut socio-psychologique, d'agressivité et de comportement agressif. Caractéristiques psychologiques du comportement agressif à l'adolescence et ses causes. La signification du statut pour un adolescent et son impact sur les relations avec les pairs.
travail de cours, ajouté le 18/02/2011
Aspects théoriques de l'étude des caractéristiques du comportement agressif des adolescents en psychologie nationale et étrangère. Définition et essence du comportement agressif. Formation et assimilation d'un comportement agressif par un individu. Analyse des résultats obtenus.
travail de cours, ajouté le 01/08/2010
Le problème du comportement agressif d'un adolescent dans la psychologie moderne. Le concept d'agressivité, de tempérament. Facteurs influençant le comportement agressif chez les adolescents. Une étude empirique de la relation entre le comportement agressif et le tempérament. Méthodes de recherche.
travail de laboratoire, ajouté le 14/10/2008
Théories de l'émergence des comportements agressifs. Définition de l'agressivité et de l'agressivité, classification des types de comportements agressifs. Causes d'agressivité dans l'enfance. Le rôle de la famille dans l’émergence du comportement agressif de l’enfant, la prévention de sa manifestation.
travail de cours, ajouté le 16/08/2011
Concept et types d'agression. Les causes du comportement agressif et l'influence de l'éducation sur sa formation. Étude empirique des caractéristiques de genre des comportements agressifs des étudiants en situations de conflit: caractéristiques de l'échantillon, conception et méthodes de recherche.
travail de cours, ajouté le 30/01/2013
Caractéristiques essentielles de l'agressivité : concept, théories, types. Spécificités du comportement agressif chez les enfants. Caractéristiques psychologiques et pédagogiques du statut d'élève d'un orphelinat. Une étude empirique des déterminants du comportement agressif chez les enfants.
thèse, ajoutée le 26/06/2011
Analyse de l'aspect psychologique des comportements agressifs chez les enfants. Les principales caractéristiques du début de l'adolescence et leur influence sur l'émergence de comportements agressifs. Etude expérimentale de l'agressivité des étudiants en stage.
thèse, ajoutée le 20/05/2015
Le phénomène de l'agressivité en psychologie. Le rôle de la famille dans la formation de comportements agressifs chez les enfants. Caractéristiques des enfants issus de familles monoparentales. Etude des comportements agressifs collégiens. Théorie de l'apprentissage social. Modèles cognitifs de comportement agressif.
travail de cours, ajouté le 31/08/2010
Pertinence du problème de l'agressivité des enfants. Le concept de « comportement agressif ». Spécificités de la manifestation d'un comportement agressif à l'âge préscolaire moyen. Analyse des programmes existants visant à corriger les comportements agressifs des enfants d'âge préscolaire.
travail de cours, ajouté le 09/03/2011
Le problème de l'agression dans le monde moderne. Aspects théoriques de la prévention socio-psychologique des comportements agressifs chez les adolescents. Analyse des caractéristiques psychologiques de l'adolescence. Concept, méthodes et formes de correction des comportements agressifs.
Envoyer votre bon travail dans la base de connaissances est simple. Utilisez le formulaire ci-dessous
Les étudiants, étudiants diplômés, jeunes scientifiques qui utilisent la base de connaissances dans leurs études et leur travail vous seront très reconnaissants.
Le problème du comportement agressif
Le problème du comportement agressif reste d'actualité tout au long de l'existence de l'humanité en raison de sa prévalence et de son influence déstabilisatrice. Certains pensent que l'agression est d'origine purement biologique et qu'elle est également associée principalement à des problèmes d'éducation et de culture (10).
L'agression est représentée par plusieurs termes dans le langage courant. L'agression « bénigne » (persistance, assurance, colère sportive, courage, audace, bravoure, bravoure, volonté, ambition), l'agression « maligne » (violence, cruauté, arrogance, grossièreté, impudence, méchanceté) et le type même d'agressivité et de destruction. agression ( selon Fromm).
L'agression destructrice a toujours été associée à un concept philosophique et moral tel que le mal. Les discussions sur la question de savoir si le mal est immanent à l’homme ou s’il est intrinsèquement bon se sont poursuivies tout au long de l’histoire séculaire de l’humanité. Déjà là philosophie ancienne Il existe des points de vue polaires sur cette question. Le philosophe chinois Xiong Tzu croyait que l’homme avait une « nature mauvaise ». Un autre philosophe chinois, Mencius, a proclamé l'idée que tous les gens naissent bons ou au moins moralement neutres, et qu'ensuite, l'exposition à des facteurs sociaux vicieux peut conduire une personne à devenir mauvaise. Le philosophe était convaincu que puisque l’homme est bon par nature, le forcer à commettre le mal signifie le forcer à commettre ce qui n’est pas naturel.
Une idée similaire a été exprimée et poursuivie 19 siècles plus tard par Jean-Jacques Rousseau (10).
Selon Lewis DO, contrairement à certaines espèces, telles que les rongeurs agressifs spécialement élevés, aucun groupe ethnique, racial ou religieux ne s'est révélé intrinsèquement plus agressif que d'autres (bien qu'au cours de l'histoire, les habitants d'un pays donné se soient périodiquement révélés différents). Les sciences sociales et biologiques sont parvenues à la conclusion que l'influence la plus importante sur la formation et le développement d'un comportement agressif est exercée par des facteurs environnementaux, parmi lesquels l'éducation vicieuse, y compris les châtiments corporels, l'humiliation morale, les comportements sociaux et sensoriels. isolement, tabou manifestations émotionnelles, ainsi que des mégafacteurs tels que la surpopulation (une augmentation sans précédent de la densité de population). La nature de l'agression humaine est difficile à analyser. Le comportement de Jack l'Éventreur et de John D. Rockefeller peut être considéré comme agressif, cependant, la différence entre eux est énorme (11).
K. Lorenz estime qu'entre les différentes populations humaines, il existe encore des différences dans leur degré d'agressivité initial (inné), qui s'est développé en conséquence sélection naturelle. Comme exemple de peuple extrêmement agressif, il cite la tribu indienne de l'Utah. Selon Lorenz, une personne est agressive parce que... descendent des primates. Ces derniers étant herbivores, ils sont totalement dépourvus de « l’instinct de tueur » inhérent aux prédateurs. Pour que les prédateurs puissent préserver l'espèce, à la suite de l'évolution, un mécanisme a dû apparaître qui inhibe l'agression intraspécifique, car un « instinct de tueur » dirigé contre les siens conduirait à l’extinction complète de l’espèce. Les hominidés n'avaient pas besoin d'un tel mécanisme (la nature ne pouvait pas prévoir qu'une arme mortelle apparaîtrait entre les mains d'un « singe nu ») (3). K. Lorenz, dans ses travaux sur l'agression, l'interprète comme la force motrice de la lutte pour la survie, et cette lutte se déroule principalement au sein d’une seule espèce (3).
R. Dawkins considérait l'individu comme une machine égoïste, programmée pour subvenir au mieux à ses gènes dans leur ensemble, c'est-à-dire comme une machine de survie. De cette manière, les machines de survie d’une espèce attaquent plus directement la vie d’une autre. L'une des raisons en est que les représentants d'une même espèce, très semblables les uns aux autres, sont obligés de rivaliser pour toutes les ressources dont ils ont besoin. Les partenaires de mariage constituent une ressource importante. La compétition se produit généralement entre les hommes et les femmes. Cela signifie qu'un mâle peut assurer la survie de ses gènes s'il cause des dommages à un autre mâle avec lequel il est en compétition. La ligne de conduite logique est de tuer vos rivaux puis de les manger. Mais le cannibalisme et le meurtre sont extrêmement rares. En effet, la caractéristique la plus remarquable des combats entre animaux est qu'il s'agit de compétitions formelles, comme la boxe ou l'escrime, strictement respectées. Si l'ennemi admet sa défaite par son comportement, alors le vainqueur s'abstient de porter un coup ou une morsure fatale. Dans ce cas, il s'avère que seul HOMO SAPIENS est la seule espèce qui tue les siens, en tant que seul héritier du sceau de Caïn (4).
Selon G. Marcuse, la civilisation a un besoin permanent de sublimation et de désexualisation, ce qui affaiblit l'Éros qui la crée, libérant son homologue destructeur (Thanatos), c'est-à-dire le agression. Cela menace la culture de désintégration des pulsions, et l'attirance pour la mort (destruction, destruction, le plus souvent irrationnelle) tend à prendre le pas sur les pulsions de vie (création) (8).
Le fondateur de la psychanalyse, S. Freud, a formulé pour la première fois sa compréhension de l'agressivité dans son ouvrage « Au-delà du principe de plaisir » (1912). Il y considérait l'agression comme une combinaison d'Eros (libido, principe créateur) et de Thanatos (mortido, principe destructeur), avec la prédominance de ce dernier, c'est-à-dire comme une fusion de l'instinct sexuel et de l'instinct de mort avec la domination de ce dernier. Freud croyait que l'agressivité chez une personne est une manifestation et une preuve de l'instinct de mort biologique. Il a soutenu (1933) que Thanatos est opposé à Eros et que son objectif est un retour à l'état inorganique. Mais comment, alors, une personne peut-elle vivre assez longtemps, ayant un instinct inné de mort ? Freud croyait qu'il existe un mécanisme permettant de neutraliser l'agressivité interne, qui est la fonction principale du moi. Mais l’Ego n’apparaît pas à la naissance d’un enfant, mais se forme au cours de son développement. Parallèlement à sa formation, le mécanisme de neutralisation de l'agression commence à se développer.
Le Dr H. Parens, qui a consacré sa activité scientifiqueétudiant l'agressivité chez les enfants, considère qu'il est inconditionnel que les enfants naissent déjà avec différents niveaux d'agressivité. Certes, il identifie pratiquement l'agressivité avec l'activité, estimant qu'avec le développement normal de la personnalité, l'agressivité se transforme en activité. Freud, comme nous le savons, a également initialement utilisé les termes « agressif » et « actif » comme synonymes (1909), bien que plus tard, dans son ouvrage « Nouvelles conférences d'introduction » (1933), il ait utilisé le mot « actif » non pas comme synonyme. pour l'agressivité, mais comme la caractéristique la plus importante de cet instinct. H. Parens note également que l'agression peut se manifester sous différentes formes, cependant, toutes ces formes ont une chose en commun : elles représentent une tentative des sujets de contrôler, d'influencer et de faire face à eux-mêmes et au monde qui les entoure.
Atteindre n'importe quel objectif nécessite de prendre le contrôle de tous les facteurs rencontrés sur le chemin vers l'objectif (facilitant ou entravant sa réalisation). Le but, dans le langage de la thermodynamique de l’information, est le désir de combattre le chaos (entropie) vers un état structuré (ordre). Cela nécessite de l’énergie. Appelons cela une activité dans ce cas. Ensuite, l'agression est une énergie modulée visant à éliminer les obstacles menant au but.
En même temps, Freud attachait moins grande importance le phénomène d'agression, considérant la libido et l'instinct de conservation comme les forces dominantes chez l'homme. Son élève Adler en 1908, en tant que principe unissant les phénomènes psychologiques et biologiques, a introduit le concept de stimulus agressif en tant qu'instinct universel (« de base »). Ainsi, toutes les pulsions primitives, quelle que soit la manière dont elles se manifestent, se révèlent subordonnées à ce stimulus principal (agressif). L'instinct agressif est devenu l'équivalent de l'énergie psychique, servant à compenser (par des moyens agressifs) les déficiences organiques inhérentes à un individu particulier ; "...instable équilibre psychologique est restauré par la satisfaction d'une pulsion primitive par l'excitation et la manifestation d'une impulsion agressive. " Dans le cas de la manifestation simultanée des instincts sexuels et agressifs, ces derniers (selon Adler) dominent toujours. Par la suite, Adler est arrivé à la conclusion que l'instinct agressif (impulsion) est un moyen de surmonter ( obstacles, obstacles sur le chemin du but, besoins vitaux) et, par conséquent, d'adaptation. (2) G. Marcuse, utilisant les enseignements de Freud, soutient que la civilisation commence avec le introduction d'interdictions sur les pulsions primaires. Deux manières principales d'organiser les pulsions peuvent être identifiées : a) la restriction de la sexualité, qui se forme dans des relations de groupe à long terme et en expansion, b) la restriction des pulsions de destruction, conduisant à la domination des hommes et de la nature. , ainsi que la moralité individuelle et sociale.
A mesure que l'union de ces deux forces réussit de plus en plus à préserver la vie de groupes élargis, Eros prend le pas sur Thanatos : l'usage social contraint la pulsion de mort à servir les pulsions de vie. Cependant, le processus de civilisation lui-même augmente le volume de sublimation et d’agression contrôlée ; dans les deux cas, il y a un affaiblissement d’Eros, libérant la destructivité. Cela suggère que le progrès est associé à une tendance régressive dans la structure des instincts et que la croissance de la civilisation est confrontée à une impulsion constante (bien que réprimée) vers la satisfaction ultime des besoins et l’atteinte de la paix. Max Scheller a souligné que « l'impulsion ou la volonté consciente ou inconsciente de pouvoir sur la nature est le motif principal de la relation de l'homme moderne à l'existence, qui précède structurellement la science et la technologie modernes en tant que début « antérieur et logique » de la pensée et de l'intuition scientifiques. L'organisme "a priori" expérimente la nature comme luttant pour la domination et donc soumise à la maîtrise et au contrôle. Et, par conséquent, le travail se transforme en force et en provocation visant à combattre la nature, à vaincre la résistance. Avec une telle attitude envers le travail, les images de l'objectif Le monde apparaît comme des « symboles de direction de l'agression », l'action apparaît comme l'exercice d'une domination et la réalité comme une résistance (8).
Fromm distingue deux types d'agression. Le premier type est commun aux humains et aux animaux - il s'agit d'une impulsion phylogénétiquement inhérente à attaquer ou à fuir, selon la situation dans laquelle survient une menace pour la vie. Cette agression défensive et « bénigne » sert à la survie de l'individu ou de l'espèce ; elle a des formes de manifestation biologiques et s'efface dès que le danger disparaît. Un autre type est représenté par l'agression « maligne » - le caractère destructeur ou la cruauté, caractéristique uniquement des humains et pratiquement absente chez les autres mammifères ; il n'a pas de programme phylogénétique, ne sert pas à l'adaptation biologique et n'a donc pas de finalité spécifique. Fromm comprend la relation entre l'agression défensive bénigne et l'agression destructrice maligne comme un instinct de caractère, c'est-à-dire Cela suppose la nécessité de distinguer entre les pulsions naturelles, enracinées dans les besoins physiologiques, et les passions humaines spécifiques, qui trouvent leur source dans le caractère humain. L'instinct est une réponse aux besoins physiologiques humains, et les passions sont une réponse aux besoins existentiels, et donc ces derniers sont exclusivement humains (1).
Les adeptes des théories comportementales croient qu'une personne ressent, pense et agit comme elle le juge correct pour atteindre l'objectif immédiat souhaité. Ainsi, l'agressivité, comme d'autres formes de comportement, est acquise (c'est-à-dire la stratégie la plus rentable et la plus efficace pour atteindre les objectifs) et est déterminée par le fait qu'une personne (par des moyens agressifs) obtient l'avantage maximum (ibid.).
L'une des théories qui prétend expliquer le phénomène de l'agression est la théorie de la frustration de John Dollard, selon laquelle un comportement agressif survient en réaction à la frustration et, par conséquent, la frustration est toujours accompagnée d'agressivité (ibid.).
Fromm identifie un certain nombre d'actions qu'il appelle pseudo-agression, y compris des types tels que non intentionnels (par exemple, blesser accidentellement une personne), ludiques (nécessaires à l'entraînement pour l'habileté, la dextérité et la rapidité des réactions), et également sans aucun but destructeur ou motivation négative (colère, haine). L'escrime, le tir à l'arc et divers types de lutte se sont développés à partir de la nécessité de vaincre l'ennemi, mais ont ensuite complètement perdu leur fonction d'origine et se sont transformés en sports. Le concept d'agressivité en tant qu'affirmation de soi est étayé par le lien d'observation entre l'exposition aux hormones sexuelles mâles et le comportement agressif (ibid.).
L'agressivité défensive est un facteur d'adaptation biologique. Le cerveau de l'animal est programmé pour mobiliser toutes les impulsions offensives et défensives si les intérêts vitaux de l'animal sont menacés, par exemple dans les cas où l'animal est privé espace vital ou limiter son accès à la nourriture, au sexe ou lorsque sa progéniture est en danger. De toute évidence, le but de l’agression défensive est de préserver la vie et non de la détruire. L'homme est également programmé phylogénétiquement : il réagit à une menace qui pèse sur ses intérêts vitaux soit par une attaque, soit par la fuite. Bien que cette tendance innée chez l’homme soit moins prononcée que chez l’animal, de nombreux faits nous convainquent que l’homme a aussi une tendance à l’agressivité défensive. Elle se manifeste lorsqu'il existe une menace pour la vie, la santé, la liberté ou la propriété (cette dernière est pertinente lorsque le sujet vit dans une société où la propriété privée constitue une valeur importante). Bien entendu, une réaction agressive peut être due aux croyances morales et religieuses, à l’éducation, etc. ; dans la pratique, cela se produit également chez la plupart des individus et même dans des groupes entiers. L’instinct défensif peut probablement expliquer la plupart des manifestations guerrières de l’homme (ibid.).
Cependant, malgré le fait que les schémas neurophysiologiques chez les humains et les animaux soient assez similaires, la formation et la mise en œuvre de comportements agressifs chez les humains et les animaux sont différentes.
Dans ce cas, nous parlons de ce qui suit : 1. Un animal ne perçoit comme une menace qu'un danger évident, tandis qu'une personne, dotée du don de prévoyance et d'imagination, réagit non seulement à une menace immédiate, mais aussi à un éventuel danger dans le futur, à son idée de la probabilité d'une menace. En d’autres termes, le mécanisme d’agression défensive est mobilisé non seulement lorsqu’une personne ressent un danger immédiat, mais également lorsqu’il n’existe pas encore de menace évidente. Il s'avère que l'individu réagit de manière agressive à ses propres prévisions.
2. Une personne a non seulement la capacité de prévoir un danger réel dans le futur, mais se laisse également persuader, se laisse manipuler, conduire, convaincre. Il est prêt à voir le danger là où il n'y en a pas. C’est ainsi que Fromm explique le début de la plupart des guerres modernes.
3. Une augmentation supplémentaire de l'agressivité défensive chez les humains (par rapport aux animaux) est due aux spécificités de l'existence humaine. Une personne, comme un animal, se défend lorsque quelque chose menace ses intérêts vitaux. Cependant, la sphère des intérêts vitaux d'une personne est bien plus large que celle d'un animal. Pour survivre, une personne a besoin non seulement de conditions physiques, mais aussi mentales. Il doit maintenir un certain équilibre mental (homéostasie mentale) afin de conserver sa capacité à remplir ses fonctions. Pour une personne, tout ce qui contribue au confort mental est tout aussi important dans le sens de la vie que ce qui sert au confort physique. Et l’intérêt vital le plus important est de préserver son système de coordonnées, orientation vers la valeur. La capacité d’agir et, in fine, la conscience de soi en tant qu’individu en dépendent (ibid.).
Fromm interprète ainsi la réaction à une menace vitale : la peur mobilise généralement soit une réaction d'attaque, soit une tendance à la fuite. La dernière option est souvent trouvée lorsqu’une personne cherche un moyen de « sauver la face ». Si les conditions sont si dures qu’il est impossible d’éviter la honte ou l’effondrement, alors une réaction d’attaque est la plus susceptible de se produire. La peur, comme la douleur, sont des sentiments très chargés négativement et une personne s’efforce de s’en débarrasser à tout prix. Souvent, pour échapper à la peur et à la douleur, une personne recourt à des moyens tels que le sexe, le sommeil ou la communication avec d'autres personnes. Mais le moyen le plus efficace reste l’agressivité. Si une personne trouve la force d'un état passif de peur pour passer à l'attaque (à l'agression, au comportement destructeur), le sentiment douloureux de peur disparaît immédiatement (ibid.).
Un type d'adaptation biologique est l'agression instrumentale, qui poursuit un objectif spécifique : fournir ce qui est nécessaire ou souhaitable. La destruction (destruction) en soi n'est pas un but, elle ne sert qu'à auxiliaire pour atteindre le véritable objectif. En ce sens, ce type d'agression est similaire à la défensive, cependant, il diffère de cette dernière par un certain nombre d'autres aspects. Parmi les mammifères, seuls les prédateurs, pour qui l'agressivité sert de moyen de subsistance, possèdent des connexions neuronales innées qui motivent l'attaque de leurs proies. Dans le cas des hominidés et des humains, l’agressivité est basée sur l’apprentissage et n’a pas de programme phylogénétique. Pour analyser ce phénomène, Fromm utilise les notions de « nécessaire » et de « souhaitable ». La nécessité est un besoin physiologique inconditionnel, par exemple celui de satisfaire la faim (ou le besoin sexuel). Lorsqu'une personne commet un vol parce qu'elle ne dispose pas des moyens minimaux de base pour se nourrir et nourrir sa famille, une telle agression peut être qualifiée d'action ayant une motivation physiologique. Par désirable, nous pouvons entendre ce qui est souhaité. Les gens (contrairement aux animaux) veulent avoir non seulement ce dont ils ont besoin pour survivre, ni seulement ce qui constitue la base matérielle d'une vie humaine décente ; la plupart des gens sont caractérisés par la cupidité : thésaurisation, excès de nourriture, de boissons et de sexe, soif de pouvoir. , gloire. En même temps, n’importe lequel des domaines énumérés devient une passion pour quelqu’un (ibid.).
L’agression biologiquement adaptative sert le but de la vie. Cependant, seule une personne est sujette au désir de torturer et de tuer et en même temps d'éprouver du plaisir. C'est la seule créature vivante capable de détruire les siens sans aucun bénéfice ni gain pour elle-même (ibid.).
Fromm considère la dépression névrotique chronique (dysthymie, diminution de la vitalité) et, comme conséquences, l'ennui (mélancolie) comme l'un des facteurs fondamentaux de la formation d'une agression maligne.
À la suite de l’évolution, l’homme a acquis des propriétés mentales que l’on retrouve uniquement chez lui et qui n’ont pas d’analogue chez d’autres espèces. Ceux-ci incluent la conscience, la raison et l'imagination. Ces dernières ne peuvent exister dans le vide et nécessitent pour leur existence et leur fonctionnement une description du monde, une sorte de structure, une carte du monde. La description du monde peut être primitive, comme c'est le cas des tribus sauvages, ou extrêmement complexe, comme dans une société civilisée. Au sein de cette structure, une sorte de système de coordonnées est défini, à l'aide duquel une personne peut réguler son comportement et recevoir des lignes directrices de valeurs, à savoir : ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut éviter. Une personne a vitalement besoin d’un objectif, ainsi que d’un objet de vénération. L'objet de vénération peut être n'importe quoi - des idoles les plus simples des tribus sauvages à Dieu dans les religions monothéistes les plus complexes.
Le cerveau humain a besoin non seulement d’un minimum de repos, mais également d’une certaine quantité d’excitation (stimuli émotionnellement significatifs). G. Selye décrit cet état comme un état d'eustress. On sait que le déficit de stimuli émotionnellement significatifs, notamment chez jeune âge (privation sensorielle) conduit particulièrement souvent à la formation de la personnalité d'un agresseur, et l'importance de ce facteur dans la formation de l'agressivité est d'un ordre de grandeur supérieur aux châtiments corporels et à d'autres facteurs pédagogiquement nocifs. On sait que dans des conditions d'isolement sensoriel, une personne commence à ressentir une peur croissante, pouvant aller jusqu'à la panique et aux hallucinations (comme en témoignent des études expérimentales). Fromm cite la présence d'un sentiment d'unité comme l'une des conditions les plus importantes pour la maturation d'un individu. E. Erikson, qui a soigneusement développé ce sujet et en est le fondateur, rend compte de la nécessité pour une personne de s'identifier à d'autres personnes (groupe de référence), à une nation, etc., c'est-à-dire lorsqu'elle peut dire « Je suis comme eux, ils sont comme ça. " Tout comme moi. " Il est préférable qu’une personne s’identifie à des sous-cultures telles que les hippies ou les toxicomanes plutôt que de ne pas s’identifier du tout (1).
2) Les personnes qui ont constamment besoin d'une stimulation supplémentaire, ainsi que d'un changement constant de stimuli ; Ces personnes sont vouées à l’ennui chronique, mais comme elles le compensent, elles l’ignorent pratiquement.
3) Les personnes qui ne peuvent pas être mises dans un état d'excitation par un stimulus normal (pour la plupart des gens). Ces personnes sont malades et sont souvent conscientes de leur infériorité. Dans le troisième cas, selon Fromm, les personnes souffrant de dépression chronique prédominent, ce qui s'accompagne donc d'un ennui chronique. Les conséquences particulièrement dangereuses de « l’ennui non compensé » sont la violence et l’agressivité. Le plus souvent, cela se manifeste sous une forme passive, lorsque, par exemple, une personne aime regarder des scènes cruelles et sanglantes, notamment à la télévision. Et du plaisir passif face aux scènes cruelles et à la violence, il n'y a qu'un pas vers de nombreuses formes d'excitation active, qui s'obtiennent au prix d'un comportement sadique et destructeur. En raison de la dépression névrotique chronique (dysthymie) et de l'ennui qui l'accompagne, Fromm décrit un manque d'intérêt pour la communication avec les autres et des difficultés dans cette communication. Toutes les émotions de ces individus sont figées : ils n'éprouvent pas de joie, mais ils ne connaissent ni la douleur ni le chagrin.
Fromm écrit ensuite sur l'importance de la structure du caractère dans la formation du sadisme. L'homme, encore moins déterminé par ses instincts que les chimpanzés, a développé des capacités compensatoires qui remplissent la fonction d'instincts. Un tel rôle compensatoire chez une personne est joué par le caractère, qui est une structure spécifique qui organise l'énergie humaine visant à atteindre un objectif, et détermine également le modèle de comportement. Fromm identifie un caractère sadique-exploiteur spécial, dont l'essence est l'exploitation d'autres personnes que le propriétaire d'un tel personnage dépersonnalise, c'est-à-dire il les traite comme du « matériel humain » ou comme un moyen d’atteindre un objectif, un rouage de sa propre machine (rappelez-vous que parmi les idéologues du fascisme, il existait un concept de « matériel humain »). A propos, mentionnons la pensée bien connue de I. Kant selon laquelle une personne ne peut en aucun cas être un moyen, elle est toujours une fin). La dépersonnification est essentiellement le processus de transformation d'un sujet en objet, ou en d'autres termes, d'une personne en chose. Fromm considère que le désir principal d’une personne productive est la soif d’aimer, de donner et de partager avec les autres.
Ces attirances, conditionnées par le caractère, sont si fortes qu'elles semblent absolument naturelles au propriétaire d'un tel personnage. Une personne au caractère sadique et exploiteur peut se comporter comme un super-altruiste, mais derrière cela se cache toujours un manque de sincérité (ibid.).
Fromm introduit le concept de « caractère social », par lequel il entend la transcendance de l'humain (immanent à lui comme espèce biologique) l'énergie sous une forme spécifique nécessaire au fonctionnement d'une société particulière. La catégorie « caractère » est introduite par Fromm comme l'une des plus importantes pour expliquer le phénomène d'agression maligne, car la passion pour la destruction et le sadisme sont généralement enracinés dans la structure du caractère. Ainsi, chez une personne aux penchants sadiques, cette passion en volume et en intensité devient la composante dominante de la structure de la personnalité.
Fromm introduit des concepts tels que « biophilie » et « nécrophilie », comprenant par le premier le désir de tout ce qui vit et grandit, et par le second, le désir de tout ce qui est mort et mécanique. La nécrophilie au sens caractérologique est définie par Fromm comme une attirance passionnée pour tout ce qui est mort, malade, putride, pourrissant ; un désir passionné de transformer tout ce qui est vivant en non-vivant, une passion pour la destruction pour le plaisir de détruire, un intérêt pour tout ce qui est purement mécanique (non biologique) et, en outre, une passion pour la rupture violente des connexions biologiques naturelles. L’attirance pour les morts se manifeste le plus souvent dans les rêves des nécrophiles. Un caractère nécrophile peut aussi se manifester par la conviction qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre les problèmes : la violence. Un nécrophile se caractérise par la conviction que la violence est « la capacité de transformer une personne en cadavre ». Ces personnes réagissent aux problèmes de la vie de manière généralement destructrice et n'essaient jamais d'aider les autres à trouver une manière constructive de résoudre leurs problèmes. La nécrophilie trouve une représentation moins évidente dans son intérêt particulier pour la maladie sous toutes ses formes (hypocondrie), ainsi que dans le thème de la mort (ibid.).
Une caractéristique insaisissable du caractère nécrophile est l'absence de vie (absence ou diminution de la capacité d'empathie, ainsi que de subtiles différenciations émotionnelles). Un nécrophile intelligent et instruit peut parler de choses qui en elles-mêmes pourraient être intéressantes, mais il les présente avec sérieux, froidement, avec indifférence, avec pédantisme, sans vie et formellement. Le type de personnage opposé - le biophile, au contraire, peut parler d'expériences qui en elles-mêmes ne sont pas très intéressantes, mais il les présente avec un tel intérêt et une telle vivacité qu'il infecte les autres avec sa bonne humeur. Fromm cite Hitler comme exemple frappant de personnage nécrophile, analysant l’évolution de sa personnalité tout au long de sa vie (1).
Pour survivre, une personne doit recevoir la satisfaction de ses besoins physiques et ses instincts la forcent à agir dans la direction requise pour la survie. Cependant, satisfaire à lui seul les besoins physiologiques ne rend pas une personne heureuse et ne garantit pas son bien-être.
Selon la vision du sadisme de Freud, même les désirs sadiques qui ne sont pas extérieurement liés à la sexualité sont toujours motivés sexuellement.
Soif de pouvoir, cupidité ou narcissisme - toutes ces passions se manifestent d'une certaine manière dans le comportement sexuel. Il n’existe aucun domaine d’activité dans lequel le caractère d’une personne se manifeste plus clairement que dans les rapports sexuels : précisément parce que c’est ici que l’on peut le moins parler de « comportement appris », de stéréotype ou d’imitation.
A. Gehlen a noté que les institutions spirituelles canalisent radicalement les revendications du sujet, ses idées et ses réflexions. Il critique également une époque qui condamne l’homme à perdre contact avec le monde, le rendant captif du fantasme. Il considère le fantasme comme une déficience, une illusion, une tromperie, une déréalisation. Mais en même temps, la théorie fantastique de Gehlen est à plusieurs niveaux : il considère l’homme comme une « créature fantasmante ».
Une caractéristique essentielle qui distingue les humains des animaux est l’égocentrisme. L'animal se familiarise avec le monde extérieur, mais ne peut devenir un objet de connaissance pour lui-même (9).
Comme un animal, une personne est entourée de choses et d'autres êtres, mais ne s'y dissout pas, comme un animal, mais peut s'en isoler en approfondissant en elle-même (ibid.).
Être dans la réalité avec un faible degré de réflexion n'est possible qu'avec un fond affectif basal suffisamment élevé, qui s'accompagne d'une intensité de perception suffisamment forte et de la capacité de concentration de l'attention. Sinon, il plongera en lui-même avec une réflexion ultérieure et celle-ci obéira aux lois du monde intérieur - la sphère idéationnelle (fantasmes et réflexion), celle-là même qui « donne naissance aux monstres ». Ce niveau d’être, au sens de Gehlen, s’apparente au sommeil, à la déréalisation (ibid.).
Selon G. Marcuse, tout au long de l'existence de la société, non seulement son état social, mais aussi son état biologique, non seulement les aspects individuels de l'existence humaine, mais la structure même de ses instincts ont été soumis à une suppression culturelle. Or, c’est précisément cette coercition qui constituait la principale condition préalable au progrès. Puisque l’instinct sexuel incontrôlable (non réprimé) et son homologue, l’instinct agressif, sont destructeurs. Le pouvoir destructeur des deux instincts découle du désir impératif d’obtenir un maximum de plaisir – la satisfaction comme fin en soi. Je me souviens de l'exemple d'une souris qui avait des électrodes insérées dans la zone de plaisir de son cerveau et qui se stimulait jusqu'à mourir d'épuisement. D'où la nécessité de détourner les instincts de leur but en leur imposant des interdits. Le garant de ces interdictions est généralement le gouvernement, qui les justifie à l'aide de diverses lois et normes morales et sociales, ainsi que de dogmes religieux. La civilisation commence par la répression, la régulation et la modification des instincts. L'énergie ainsi sublimée est consacrée à la fois au travail créatif et au travail routinier dont le but est de maintenir la civilisation. La maîtrise des instincts est soutenue par des structures de pouvoir, ainsi que par des sanctions positives et négatives. Un animal humanoïde ne devient humain que lorsqu’une transformation radicale de sa nature se produit, affectant non seulement les buts de ses instincts, mais aussi leurs « valeurs », c’est-à-dire principes régissant la réalisation des objectifs. Freud a décrit ce changement comme la transformation du principe de plaisir en principe de réalité. L'inconscient chez l'homme ne s'efforce que d'atteindre le plaisir ; activité mentale de toute action susceptible de provoquer des expériences désagréables (douloureuses) » (8).
Cependant, le principe du plaisir effréné conduit nécessairement à un conflit avec l’environnement naturel et humain. L'individu arrive à la conclusion qu'une satisfaction complète et indolore de tous ses besoins est impossible. La crise qui a suivi conduit à un nouveau principe-réalité. En conséquence, une personne acquiert la capacité de refuser un plaisir instantané, incertain et dangereux au profit d’une satisfaction différée, contenue, mais « garantie » (ibid.).
Avec le renforcement du principe de réalité, le petit homme, qui n'était rien de plus qu'un ensemble d'instincts animaux, s'est transformé en un « je » organisé, luttant pour quoi, « ce qui est utile » et ce qui peut être obtenu sans se nuire. et son environnement de vie. Sous l'influence du principe de réalité, une personne développe la fonction de la raison et la capacité qui en résulte de penser, d'analyser et de synthétiser, d'attention, de mémoire et de jugement. Il devient un sujet conscient, pensant, animé par la rationalité qui lui est imposée de l'extérieur. Et une seule forme d’activité mentale « se démarque » du pouvoir du principe de réalité : la fantaisie, qui reste attachée au principe de plaisir (ibid.).
Selon les psychologues Gestalt (F. Perls), l'agression et la destruction (de l'ensemble) (en tant qu'éléments de perception) sont nécessaires à la perception profonde (compréhension) ultérieure. Le processus qui suit la destruction est la reconstruction. La destruction et la reconstruction ne font pas littéralement référence à l’objet physique, mais à notre comportement envers l’objet. Ainsi, toute relation de confiance entre les personnes n'est possible que si certaines barrières sont détruites, afin que les gens commencent à se comprendre (K. Lorenz en a également parlé). Cette compréhension suppose qu’une personne examine un partenaire, tout comme nous examinons une image (« la disséquant »), de sorte que ses « parties » soient associées à ses propres besoins, qui précisément grâce à ce contact se manifestent. En d’autres termes, si l’expérience n’est pas déstructurée, mais est « avalée » dans son ensemble (introjectée), elle ne peut pas être assimilée (intériorisée) et est donc perçue comme une forme plutôt que comme un contenu. Le non-intériorisé perçoit le sujet comme un objet, c'est-à-dire le dépersonnalise. Les contacts interpersonnels ne peuvent exister qu'avec une capacité suffisante de destruction et de reconstruction ultérieure, et ces deux processus sont des dérivés de l'interaction émotionnelle-volontaire et sphères intellectuelles(que se passera-t-il s’ils sont violés ?) (5).
Klerasbo a également noté que pour la formation de personnalités agressives (personnes ayant un comportement destructeur), il existe une sphère idéationnelle (fantasmes agressifs-sadiques. Souvent, un sadique n'a besoin que d'un seul fantasme pour atteindre l'excitation sexuelle. Le fantasme est le processus de programmation de l'avenir possible. actions ou un indicateur de l’existence et du fonctionnement d’un tel programme.
La plupart des patients psychotiques, même lorsqu'ils laissent libre cours à leurs fantasmes et, par le biais d'hallucinations et de délires, déforment la réalité au profit de leurs besoins émotionnels, conservent néanmoins une certaine idée réelle de la possibilité d'une transition vers un autre monde. Dans une certaine mesure, ils ont une double existence. En retenant quelques idées sur le monde réel, ils s'en protègent et vivent comme le reflet de celui-ci dans le monde qu'ils ont eux-mêmes créé, le monde de leurs fantasmes (6).
Fantaisie (sphère idéalisée), la capacité d'imagination est la composante principale de la pensée ; dans la psychose, cette faculté d'imagination est utilisée non pas pour maîtriser la réalité, mais pour y échapper. Les fantasmes positifs et négatifs, selon l’attitude du sujet à leur égard, peuvent être égosyntoniques ou égodystoniques.
Ainsi, la fantaisie fait partie intégrante de la pensée, voire un type spécifique de celle-ci. Le type de pensée (absolutiste-dichotomique, etc.) dépend presque directement proportionnellement de la sphère affective d'une personne, qui est un dérivé du type d'activité cérébrale et peut changer sous l'influence de perturbations exogènes. Un exemple serait la pensée d’une personne en état de dépression et la pensée opposée d’une personne en état d’excitation maniaque.
La cruauté est un type de manifestation d’agressivité et de comportement destructeur.
La cruauté (au sens juridique) est une manière particulièrement brutale de commettre des crimes, pour désigner certaines propriétés de la nature du crime. La cruauté peut être intentionnelle et involontaire, réalisée dans certaines actions, comportements verbaux (infliger la torture avec des mots) ou dans l'imagination-fantasme, opérant avec des images de torture, de tourment de personnes ou d'animaux. La cruauté peut être consciente et inconsciente, la question se pose donc de sa corrélation avec l'ego et l'inconscient. La cruauté peut se manifester à l'égard des personnes et des animaux, et les cas de division, de coexistence de cruauté envers les personnes et de sentimentalité envers les animaux sont largement connus. La cruauté donne une certaine couleur au viol, au hooliganisme, aux coups et blessures graves, à l'incitation au suicide, à la mise en danger, etc. Paradoxale est la combinaison de la prévalence et de la persistance de la cruauté avec sa désapprobation par la majorité de la population, même si elle se manifeste dans le cadre d’actions formellement sanctionnées. La cruauté en tant que trait personnel doit être comprise comme le désir de causer de la souffrance, du tourment à des personnes ou à des animaux, exprimé par des actions, de l'inaction, des paroles, ainsi que des fantasmes de contenu correspondant.
L’attirance pour la cruauté est si répandue qu’elle est presque considérée comme normale. Nietzsche considérait précisément cela comme la norme et croyait que les orgies de cruauté constituaient un facteur fondamental dans l'histoire de l'ensemble de la race humaine. Ce type de désirs pervers associés à la sphère sexuelle est connu sous le nom de sadisme et de masochisme. Mais la froideur sexuelle (frigidité) est aussi associée à une attirance pour la souffrance, à une soif de pouvoir et de puissance, qui se manifeste sous la forme du plaisir de la torture. Le moralisme (pensée absolutiste et dichotomique) est aussi souvent une manifestation de la soif de pouvoir et de puissance, qui se manifeste sous la forme du plaisir de la torture. La moralisation est aussi souvent une manifestation de la soif de pouvoir et du désir de tourmenter.
L'agression maligne et le comportement destructeur sont des composants d'un comportement asocial ou antisocial. Selon K. Jaspers, un type d'asocialité complètement différent se développe comme une incapacité à communiquer avec les autres et à s'adapter aux situations (en raison d'une capacité réduite à faire preuve d'empathie). Subjectivement, cette incapacité est ressentie comme quelque chose de très douloureux. Tout contact devient une torture, et donc une personne cherche à les éviter, préférant la solitude. C’est la cause de la souffrance de l’individu parce que... supprimant ses instincts sociaux, il éprouve un désir de communication et d'amour. Son asocialité devient perceptible auprès de son entourage, qu'il agace par sa maladresse. La timidité alterne en lui avec l'absence de cérémonie, toutes ses manifestations extérieures sont immodérées, son comportement contredit les normes acceptées. Il ressent la réaction des autres et se retire donc de plus en plus (6).
La capacité de communiquer de manière interpersonnelle nécessite avant tout de l’empathie.
L'empathie est un concept qui dénote la capacité d'analogue, médiée par la fonction du système limbique, de traiter les informations provenant de l'extérieur de sa division et d'établir un retour d'information, de prévoir les événements ultérieurs et de développer des stratégies et des tactiques de comportement pour obtenir le plus grand bénéfice. L'empathie n'est pas quelque chose de figé, mais un processus à la suite duquel des contacts interpersonnels se produisent, grâce auquel une personne est capable de satisfaire (dans le cadre de la société ses besoins vitaux et autres, y compris les plus élevés. Grâce à la communication , des changements se produisent dans l'état neurochimique de chaque partie communicante. Si la fonction du système limbique est altérée, la capacité d'empathie est automatiquement altérée. Un cercle vicieux en résulte. Plus la capacité d'empathie d'une personne est élevée, plus elle s'efforcera de communiquer , et ainsi ces capacités deviendront encore plus grandes, et vice versa. Une personne avec de faibles capacités empathiques évitera la communication, ce qui aura pour conséquence que le processus d'identification en souffrira et que ses besoins vitaux ne seront donc pas satisfaits. Ces personnes sont sujettes à l'introspection. et, en règle générale, ont tendance à moraliser une réflexion personnelle et un sentiment douloureux, comme l'appellent un certain nombre d'auteurs, une diminution du sentiment de confiance en soi, un sentiment de vide intérieur, de mort, de figé et de raisonnement, et ont également un faible niveau affectif. fond (dysthymie). On sait à quoi conduit la privation sensorielle et émotionnelle – souvent à la psychose. De tels sujets sont rationnels, puisque leur pensée est privée d'un soutien émotionnel suffisant. Parfois, sous l'influence de circonstances extérieures de nature stressante, ils passent à un autre niveau d'existence supérieur. Après quoi, ils développent un sentiment de leur propre infériorité, parce que... ils ont connu un autre niveau existentiel plus élevé.
Puis, comme ce rat qui appuie sur le levier, ils s’efforcent de remonter leur niveau le plus bas. niveau émotionnel en prenant des pilules psychotropes, en participant à diverses activités dangereuses, risquées, etc. etc.
Dans son ouvrage « Notes sur la relation entre le complexe d'infériorité et le complexe de culpabilité » (1938), Alexander fait la distinction entre la psychologie des sentiments de culpabilité et la psychologie des sentiments d'infériorité, c'est-à-dire honte. Dans la littérature psychanalytique de l’époque, les termes culpabilité et honte étaient utilisés de manière interchangeable ; Alexander a cependant montré qu’ils ont un contenu émotionnel différent et des résultats fonctionnels complètement opposés. La culpabilité est une réaction à une mauvaise action commise ou destinée à autrui, qui suscite le désir de recevoir une punition. Le coupable cherche donc à être puni ; De plus, sa culpabilité, inhibant toute agressivité accrue, a un effet paralysant. Cette réaction est plus clairement visible chez les patients déprimés, inhibés et attardés qui s'accusent de péché. La honte, en revanche, est une réaction à des sentiments de faiblesse, d’ineptie ou d’humiliation par rapport aux autres. La réaction psychologique face à la honte est à l’opposé de la réaction face à la culpabilité : elle stimule l’agressivité. Pour se débarrasser de la honte, un individu doit prouver qu'il n'est pas faible, qu'il peut vaincre celui qui lui a fait honte. La honte est une réaction si primitive qu’elle se manifeste même chez les animaux ; mais le sentiment de culpabilité ne peut surgir que lorsque l'individu a une conscience développée, c'est-à-dire - sinon - lorsqu'il prend conscience et accepte les valeurs morales de son entourage. Les impulsions hostiles, agressives et aliénées provoquent des sentiments de culpabilité ; cela supprime à son tour la capacité d'une personne à s'établir en compétition avec les autres. L'incapacité à s'affirmer inhibe une compétition réussie avec les autres, paralyse l'agressivité et l'hostilité, qui seront ensuite également réprimées par des sentiments de culpabilité. De cette manière se crée un cercle vicieux qui est à la base de nombreux troubles névrotiques (2).
Ainsi, le Japon est un pays fondé sur une culture de la honte, tandis que les États-Unis sont un représentant typique d’une culture de la culpabilité. À titre d'illustration, en 1980, il y a eu 10 728 meurtres aux États-Unis (220 millions d'habitants), tandis qu'au Japon, il y a eu 48 cas (120 millions d'habitants). Le risque d’être violemment attaqué à New York est 200 fois plus élevé qu’à Tokyo. Eibl-Eibesfeld interprète ces faits comme l’existence d’un soi-disant « corset culturel » (10).
Nous pouvons conclure que certaines caractéristiques de l'interaction étroite entre les facteurs biologiques et socio-environnementaux peuvent conduire à la formation de comportements agressifs destructeurs.
Bibliographie
1) Alexander F., Selesnik S. L'homme et son âme. --M., 1995
2) Antonyan Yu. M., Guldan V. V. Pathopsychologie criminelle. -- M., 1991
3) Dawkins R. Le gène égoïste. -- M. : Paix.
4) Lorenz K. Agression. --M., 1994
5) Marcuse G. Eros et la civilisation. -- Kyiv, 1995
6) Perls F. Expériences en psychologie de la connaissance de soi. --M., 1993
7) Fromm E. Anatomie de la destructivité humaine. -- M., 1994
8) Il s'agit d'une personne (anthropologie philosophique). --M., 1995
9) Jaspers K. Psychopathologie générale. --M., 1997
10) La violence de F. A. Elliot : un produit d'interactions biosociales. Le Bulletin de l'American Academy Of Ps.
11) Lewis DO, Moy E, Jackson LD : Caractéristiques biopsychologiques des enfants qui assassinent plus tard. Suis J. de Psych.
12) Psychiatrie et droit. V16.1988.
Documents similaires
Le concept d'agression et d'agressivité. Caractéristiques du comportement agressif chez les enfants d'âge préscolaire (6-7 ans). Classification des styles d'éducation familiale. Méthodes de travail psychologique et pédagogique pour vaincre les comportements agressifs chez les enfants d'âge préscolaire.
thèse, ajoutée le 18/12/2012
Le problème de l'agressivité en psychologie, facteurs influençant son développement. Caractéristiques psychologiques du comportement agressif chez les adolescents. L'influence de l'éducation familiale sur le développement de l'agressivité chez les enfants. Méthodes de recherche et programme de correction de l'agressivité.
travail de cours, ajouté le 23/09/2013
L'essence de l'agression humaine du point de vue de la philosophie, de la psychologie, de la biologie, de la religion. Facteurs contribuant à l'agressivité. Caractéristiques psychologiques du comportement agressif chez les adolescents. Types d'agression selon Fromm et Bass. Manifestations spontanées d'agressivité.
travail de cours, ajouté le 27/11/2010
Caractéristiques psychologiques de la manifestation d'un comportement agressif chez les personnes. Conduite agressive : frustration et agressivité. Raisons influençant la survenue d'une agression. Méthodes utilisées pour étudier les comportements agressifs. Test de manifestation d'agressivité.
test, ajouté le 29/11/2010
L'essence du comportement agressif chez les jeunes. Les causes et le mécanisme d'action de l'agression. L'ambiance au sein de la famille et entre pairs. Caractéristiques caractéristiques de l'agressivité chez les garçons et les filles. Prévention et correction des comportements agressifs chez les adolescents.
travail de cours, ajouté le 11/01/2014
Le concept d'agression, ses formes et ses types. Les causes et le mécanisme de son action chez les enfants. Prévention des comportements agressifs. Caractéristiques psychologiques de l'adolescence. Etude empirique du niveau d'agressivité des adolescents modernes.
travail de cours, ajouté le 10/03/2015
Concept et types d'agression. Motifs du comportement agressif chez les enfants. Formulaires et méthodes travail correctionnel pour le réduire. Une étude du niveau d'agressivité chez les enfants d'âge préscolaire, dont le processus de formation a une orientation motivationnelle différente.
thèse, ajoutée le 20/08/2017
Le concept du terme agression, les types et les spécificités de l'agression. Influence de la famille sur le développement de l'agressivité des enfants et des adolescents. Comportements déviants des enfants et adolescents. Différences sexuelles dans l'expression de l'agressivité. Prévention et correction des comportements agressifs.
travail de cours, ajouté le 20/02/2009
Idées théoriques sur le phénomène de l'agressivité. La structure de l'agression adolescente, les facteurs sociaux dans son développement. Détermination génétique de l'agressivité. Les principales causes des comportements agressifs chez les adolescents, leurs prérequis psychophysiologiques.
thèse, ajoutée le 27/05/2013
Le concept d'agression, les théories et les concepts qui expliquent le mécanisme de son apparition. Spécificités du comportement agressif. Contenu et critères d'évaluation des méthodes de recherche. La relation entre le niveau d'agressivité des étudiants et le climat psychologique de leur équipe.
Le problème des comportements agressifs attire depuis longtemps l'attention des scientifiques de nombreux pays du monde. Des conférences internationales, des colloques et des séminaires sur cette question sont régulièrement organisés en Europe et en Amérique. L’étude généralisée de ce problème constitue une réponse à l’augmentation sans précédent des agressions et de la violence au XXe siècle. DANS psychologie domestique V Dernièrement Il y a eu une augmentation significative du nombre de travaux liés au développement des aspects théoriques de l'étude de l'agressivité dans le domaine de l'étude de l'agressivité des enfants. Les domaines qui étudient les spécificités du comportement agressif de divers groupes sociaux en Russie et les facteurs qui l'influencent, notamment sociaux, ne sont pratiquement pas abordés.
Bien entendu, l’agressivité n’est pas étudiée uniquement en psychologie : elle est étudiée par des biologistes, des éthologues, des sociologues et des juristes, en utilisant leurs propres méthodes et approches. Le problème de l'agressivité se reflète dans les travaux de nombreux philosophes et penseurs, tels que Satyr, Schopenhauer, Kierkeger, Nietzsche et d'autres.
En sciences sociales, le terme « agression » est plus souvent utilisé, considérant la violence soit comme synonyme d'agression, soit comme l'une des manifestations de l'agression. Le terme « agression » désigne un comportement assertif, dominant et nuisible, combinant des actes de comportement de diverses formes et résultats, tels que des blagues cruelles, des commérages, des actions hostiles, causant des dommages physiques, y compris le meurtre et le suicide. Ainsi, en psychologie, il existe une grande variété de points de vue sur la définition du terme « agression », ainsi que sur les approches de son explication et de son étude. La définition suivante peut être considérée comme la plus adéquate : « L’agression est toute forme de comportement visant à insulter ou à nuire à un autre être vivant qui ne souhaite pas un tel traitement. » DANS cette définition Les caractéristiques suivantes du comportement humain agressif sont abordées :
L'agression en tant que forme de comportement social impliquant une interaction directe ou indirecte d'au moins deux personnes ;
Les émotions, motivations et attitudes négatives n’accompagnent pas toujours les actes d’agression ;
Le critère motivationnel et le critère des séquelles sont également utilisés.
Les éléments suivants se démarquent : approches théoriques: 1) éthologique, 2) psychanalytique, 3) frustration, 4) behavioriste.
Approche éthologique
Le fondateur de cette théorie est K. Lorenz, qui a soutenu que l'instinct agressif compte beaucoup dans le processus d'évolution, d'adaptation et de survie humaine. Mais le développement rapide de la pensée et des progrès scientifiques et techniques a dépassé la maturation biologique et psychologique naturelle d'une personne et a conduit à un ralentissement du développement des mécanismes inhibiteurs de l'agressivité, ce qui entraîne inévitablement une expression externe périodique de l'agressivité, sinon des « tensions » internes. va s'accumuler et créer une pression à l'intérieur du corps jusqu'à ce qu'elle conduise à une explosion de comportement incontrôlé - un modèle psychohydraulique. Ce modèle repose sur le transfert injustifié des résultats de la recherche obtenue sur les animaux au comportement humain. Quant aux moyens de gérer l'agressivité, on pense qu'une personne ne sera jamais en mesure de faire face à son agressivité, il faut certainement y répondre sous forme de compétition, de compétitions diverses et d'exercices physiques.
Théorie des pulsions (modèle psychoénergétique)
L'un des fondateurs de cette théorie est S. Freud. Il croyait qu'il existe deux pulsions les plus fausses chez l'homme : la pulsion sexuelle (libido) et la pulsion de mort. Le premier est considéré comme les aspirations associées aux tendances créatrices du comportement humain : amour, soins, intimité. Le second porte l’énergie de destruction. C'est de la colère, de la haine, de l'agressivité. Freud associe l'émergence et le développement ultérieur de l'agressivité aux étapes du développement de l'enfance. La fixation à un certain stade de développement peut conduire à la formation de traits de caractère qui contribuent à la manifestation de l'agressivité. De nombreux psychanalystes se sont éloignés du concept freudien et ont commencé à considérer non seulement la biologie, mais aussi la forme sociale agressivité. Par exemple, selon A. Adler, l'agressivité est une qualité intégrale de la conscience qui organise son activité. Adler examine diverses manifestations de comportement agressif. Un autre représentant de la psychanalyse, E. Frott, envisageait deux types d'agression complètement différents. Il s’agit d’une agression défensive « bénigne » qui sert la cause de la survie humaine. Un autre type est l'agression « maligne » - il s'agit de la destructivité et de la cruauté, qui sont propres aux humains et sont déterminées par divers facteurs psychologiques et sociaux. Horney et Sapiven pensent que l'agressivité est une mesure de protection contre le monde extérieur, ce qui entraîne un inconfort.
Théorie de la frustration (modèle mathématique)
Dans le cadre de cette théorie, le comportement agressif est considéré comme un processus situationnel. Le fondateur de cette théorie est considéré comme J. Doppard.
Selon lui, l'agressivité n'est pas un instinct qui surgit automatiquement dans le corps humain, mais une réaction à la frustration. Au fil du temps, ce point de vue a subi quelques changements : l'agressivité est considérée comme l'une des formes de comportement possibles en cas de frustration, au même titre que la régression, les stéréotypes et les comportements négativistes. Dans une situation difficile, une personne est plus souvent encline à faire ce qu'elle sait bien, à recourir à des comportements familiers. Des changements importants par rapport au schéma original ont été apportés par L. Berkowitz : 1) la frustration ne se traduit pas nécessairement par des actions agressives, mais elle stimule la préparation à celles-ci ; 2) même dans un état de préparation, l'agression ne survient pas sans conditions appropriées ; 3) la sortie de la frustration à l'aide de l'agression inculque à l'individu une habitude. Les stimuli associés à l’agressivité l’augmentent. Berkowitz introduit une nouvelle expérience supplémentaire caractérisant les expériences possibles : la colère et l'excitation émotionnelle en réponse à la frustration. Dans le cadre de cette théorie, il y avait une approche différente. Dans les années 30, S. Rosenzweig identifiait trois types de raisons à l'origine de la frustration :
1) privation - manque de moyens nécessaires pour atteindre un objectif ;
2) pertes - perte d'articles qui répondaient auparavant aux besoins ;
3) conflit - l'existence simultanée de motifs incompatibles les uns avec les autres.
La frustration est plus susceptible de provoquer une agression lorsqu’elle est relativement intense, lorsque des « signaux d’agression » sont présents, lorsque la frustration semble soudaine ou est perçue comme arbitraire, ou lorsqu’elle est cognitivement liée à l’agression.
Théorie de l'apprentissage social (modèle comportemental)
L'agression est un comportement appris à travers le processus de socialisation par l'observation de modes d'action et de comportements sociaux appropriés. Une attention particulière est portée ici à l'influence des principaux médiateurs de la socialisation ; facteur de renforcement social. Cette approche examine l'effet de la punition sur l'agression (Bass, Bandura). L'efficacité de la punition comme moyen d'éliminer les comportements agressifs dépend de la place de l'agression dans la hiérarchie des réactions comportementales, de l'intensité et de la durée de la punition, etc. L'observation et le renforcement de l'agressivité au fil du temps développent le degré élevé d'agressivité d'une personne en tant que trait de personnalité. De même, observer et renforcer un comportement non agressif développe de faibles niveaux d’agressivité.
Lors de la préparation de ce travail, des matériaux du site http://www.studentu.ru ont été utilisés
h) je n’arrive pas à dormir.
Il est important que le jouet puisse faire face à toutes les situations difficiles ;
3) résultat : les enfants partagent leurs impressions sur les cours et disent ce dont ils se souviennent le plus.
L'utilisation de ce programme à l'école primaire contribue à augmenter les capacités d'adaptation des enfants, puisque de nombreuses situations alarmantes qui interfèrent avec la pleine adaptation sont résolues. De plus, les enfants sont initiés à toute une gamme de comportements constructifs.
stratégies de jour. Ici, les compétences d’interaction sociale se forment, la motivation à réussir se développe et la confiance en soi de l’enfant grandit. Bien entendu, la participation au programme en elle-même ne garantit pas le comportement socialement compétent d'un enfant dans la société, cependant, la mise en œuvre combinée de toutes les mesures présentées permet de lui fournir une aide efficace dans l'acquisition de compétences sociales et de travailler délibérément au développement social. compétence.
I.Yu. GURSKAÏA
Université d'État de Saratov, Département de psychologie [email protégé]
Problèmes méthodologiques dans l'étude de la manifestation de comportements agressifs
L'article discute des aspects théoriques et base méthodologiqueétudier le phénomène de l'agression comme problème réel la société moderne. Les principales approches des auteurs nationaux et étrangers pour comprendre le comportement agressif d'un individu sont décrites. Les problèmes méthodologiques d'identification et d'étude des indicateurs et caractéristiques de l'agressivité sont analysés, ainsi que la « multifacette » théorique des approches dans l'étude de ce phénomène.
Mots clés : comportement agressif, stimuli aversifs, réactions agressives, instinct, processus cognitifs, fiabilité et validité de la méthodologie du test, « affect négatif », apprentissage social, frustration.
i.Y GURSKAYA Problèmes méthodologiques la recherche des comportements agressifs
Cet article traite de l'étude de l'agression dans la société moderne et expose les principales entités scientifiques théoriques sur les mécanismes et les facteurs du comportement agressif d'une personne. Les problèmes méthodologiques des indicateurs d'étude et les caractéristiques générales de l'agression sont analysés.
Mots clés : comportement agressif, stimulus provoquant une agression, réactions agressives, instinct, processus informatifs, « affect négatif », compétences sociales, blocage des exigences.
Le problème du comportement personnel agressif est de plus en plus abordé dans le contexte de l'étude de la psychologie de la société moderne. Dans des conditions d’inégalité sociale et de politique de « l’individualisme », on assiste à une augmentation constante des tensions et des conflits entre les gens. Cependant, ni la satisfaction de tous les besoins matériels, ni l'élimination de l'injustice sociale, ni d'autres changements positifs dans la structure de la société humaine ne pourront empêcher l'émergence et la manifestation de pulsions agressives. Le mieux que l'on puisse faire est d'empêcher temporairement
manifestations similaires ou réduire leur intensité. La raison de l'échec de la recherche de moyens de lutter contre les manifestations agressives du comportement humain reste l'absence de réponse à la question de la nature de leur apparition. Il n’existe aucune preuve claire que l’agressivité soit une qualité innée ou acquise. Les résultats de la recherche penchent dans un sens ou dans l’autre. Par exemple, les résultats d'une enquête auprès d'enfants abandonnés par des parents biologiques menant une vie antisociale ou criminelle et élevés dans des familles d'accueil normales, indiquent que la génétique
© I.Yu. Gourskaïa, 2008
joue un certain rôle dans l'agression humaine (R.A. Prentky). Cependant, RL. Dugdale, à travers une étude généalogique de la famille Djoukov, a montré que la criminalité dans cette famille n'est pas le produit d'une longue chaîne de mauvais gènes, mais de l'environnement.
Ainsi, de nouveaux modèles de comportement agressif sont acquis principalement à travers des modèles d’imitation ; ces mêmes modèles peuvent servir d’incitations significatives à une agression ouverte. Cependant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas abandonner l'idée de l'innéité, la prédisposition génotypique d'un individu particulier à un comportement agressif.
Il n’existe toujours pas de consensus sur la compréhension du phénomène de l’agression. Dans le cadre de la psychanalyse classique, on supposait que l'agressivité trouve son origine dans l'instinct de mort inné dirigé contre son propre porteur (Thanatos) ; en fait, l'agressivité est le même instinct, uniquement projeté vers l'extérieur et dirigé vers des objets extérieurs.
A. Adler s'intéressait également au problème du comportement agressif des personnes. C'est lui qui a reconnu le sentiment d'infériorité chez les névrosés, ainsi que le problème de l'agressivité humaine. Il corrèle l'agressivité avec le désir de pouvoir (protestation masculine). Adler a avancé l'idée des pulsions agressives comme complément aux pulsions sexuelles qui étaient au cœur de la théorie de Freud. Bien que Freud ait rejeté l’idée d’Adler, il a ensuite incorporé le concept d’instincts agressifs dans la théorie psychanalytique.
L'agression, selon E. Fromm, doit être comprise comme toute action qui provoque ou implique une intention de causer des dommages à une autre personne, un groupe de personnes ou un animal, ainsi que de causer des dommages à tout objet inanimé en général.
A. Bandura, fondateur de la thérapie comportementale, a développé la théorie de l'apprentissage social de l'agression, selon laquelle l'agression est un comportement appris dans le processus de socialisation par l'observation du plan d'action approprié et le renforcement social, c'est-à-dire il existe une étude du comportement humain orienté modèle. Du point de vue de Bandura, l'analyse des comportements agressifs nécessite de prendre en compte trois points : les manières dont de tels comportements sont appris ; facteurs,
provoquer leur manifestation; conditions dans lesquelles ils sont fixés.
Même si la théorie de l’apprentissage social met l’accent sur le rôle de l’observation et de l’expérience directe dans l’apprentissage de l’agressivité, la contribution des facteurs biologiques n’est pas niée. Comme pour toute activité motrice, la commission d’une action agressive dépend de mécanismes neurophysiologiques de base. En termes simples, le système nerveux est impliqué dans toute action, y compris les actions agressives. Toutefois, l’influence de ces structures et processus sous-jacents est limitée.
Selon la théorie de la frustration, une personne qui a vécu de la frustration ressent un besoin d’agressivité. Cette théorie, proposée par D. Dollard et ses collègues, contraste avec les deux décrites ci-dessus. Ici, le comportement agressif est considéré comme un processus situationnel plutôt qu’évolutif. Les principales dispositions de cette théorie sont les suivantes : la frustration conduit toujours à une agression sous une forme ou une autre ; l'agressivité est toujours le résultat d'une frustration.
V. Kline estime que l'agressivité possède certains traits sains qui sont simplement nécessaires à une vie active. C'est la persévérance, l'initiative, la persévérance pour atteindre un objectif, surmonter les obstacles. Ces qualités sont inhérentes aux leaders.
R.S. Homans estime que l'agression peut être provoquée par une situation liée au désir de justice.
L'approche des AA Neana, K. Buettner considère certains cas de manifestation agressive comme une propriété adaptative associée à l'élimination de la frustration et de l'anxiété.
Ainsi, il n'existe pas de théories sans ambiguïté sur la nature de l'agression et du comportement agressif. Il est évident qu’ils ont tous le droit d’exister et nous ne pouvons leur refuser aucun. Cela pose le problème de l’étude du phénomène d’agression. Il n'y a pas encore d'image complète dans la description des mécanismes d'assimilation et de consolidation de l'agressivité, de ses déterminants, des caractéristiques individuelles et de genre du comportement agressif. Ce problème est pertinent pour la psychologie depuis de nombreuses années, car il peut contribuer au développement de techniques permettant de réduire le niveau d'agressivité dans la société moderne.
Certaines caractéristiques liées à l'agressivité ont été identifiées. Dans de nombreux cas, les déterminants puissants de l'agressivité peuvent être certaines caractéristiques stables des agresseurs potentiels - ces traits de personnalité, attitudes et inclinations individuelles qui restent inchangés quelle que soit la situation. Quant à l’agressivité des individus « normaux » (c’est-à-dire ceux qui ne souffrent pas de psychopathologie évidente), les caractéristiques psychologiques qui affectent le comportement agressif sont généralement considérées comme incluant des traits de personnalité tels que la peur de la désapprobation du public, l’irritabilité et la tendance à percevoir de l’hostilité chez les individus. les actions des autres (biais d’attribution d’hostilité), la conviction de l’individu qu’il reste maître de son propre destin dans n’importe quelle situation et la tendance à éprouver des sentiments de honte plutôt que de culpabilité dans de nombreuses situations.
A. Nalchadzhyan estime qu’une analyse adéquate du comportement agressif et de sa motivation est possible à condition de prendre en compte les éléments suivants : l’agressivité est l’état mental d’une personne. C'est ce sens que l'on entend lorsqu'une personne est dans un état agressif. Il s'agit d'une condition temporaire qui comprend un certain nombre de expériences émotionnelles, - la colère, l'hostilité, ainsi que le désir ou la tendance à nuire à la personne qui a contribué à ce que l'individu se trouve dans une telle situation état mental. De plus, l'agressivité peut être considérée comme un trait de personnalité, ou plus précisément, un complexe de traits et de tendances qui constituent une stratégie comportementale stable. Et la troisième option est l'agression en tant que certain type de comportement, d'action ou d'ensemble d'actions visant d'autres objets.
Yu.B. Zillmann a soutenu que « la cognition et l’éveil sont étroitement liés ; ils s’influencent mutuellement tout au long du processus d’expérience, d’expérience et de comportement pénibles. Ainsi, il a très clairement pointé la spécificité du rôle des processus cognitifs dans le renforcement et l'affaiblissement des réactions émotionnelles agressives et le rôle de l'éveil dans la médiation cognitive du comportement. Il a souligné que, quel que soit le moment de son apparition (avant ou après l'apparition de la tension nerveuse), la compréhension
les événements sont susceptibles d’influencer le degré d’éveil. Si l'esprit d'une personne lui dit que le danger est réel, ou si l'individu devient obsédé par la menace et envisage sa vengeance ultérieure, alors il maintiendra un niveau élevé d'excitation. En revanche, l'extinction de l'éveil est la conséquence la plus probable du fait qu'après avoir analysé la situation, la personne a découvert des circonstances atténuantes ou a ressenti une diminution du danger.
De même, l’excitation peut influencer la cognition. À des niveaux d’éveil très élevés, une diminution des capacités cognitives peut conduire à un comportement impulsif. Dans le cas d'une agression, l'action impulsive sera agressive car la désintégration du processus cognitif interférera avec l'inhibition de l'agressivité. Ainsi, lorsque des perturbations surviennent dans le processus cognitif qui permet de supprimer l’agressivité, la personne est susceptible de réagir de manière impulsive (c’est-à-dire agressive). Dans ce que Zillmann décrit comme une « plage plutôt étroite » d’excitation modérée, les processus cognitifs complexes susmentionnés se dérouleront dans le sens d’une réduction des réponses agressives.
L. Berkowitz a également proposé son modèle cognitif du comportement agressif. Sa théorie originale a été révisée - dans ses travaux ultérieurs, Berkowitz a déplacé l'accent des messages sur l'agression vers les processus émotionnels et cognitifs, soulignant ainsi que ce sont ces derniers qui sous-tendent la relation entre frustration et agression. Selon son modèle de formation de nouvelles connexions cognitives, la frustration ou d'autres stimuli aversifs (par exemple, douleur, odeurs désagréables, chaleur) provoquent des réactions agressives par la formation d'un affect négatif. Berkowitz soutenait que « les obstacles ne provoquent l’agression que dans la mesure où ils créent un affect négatif ». Bloquer la réalisation d’un objectif n’encouragera donc pas l’agressivité à moins qu’elle ne soit vécue comme un événement désagréable. À son tour, la façon dont l’individu interprète lui-même l’impact négatif détermine sa réaction à cet impact.
Il existe un certain ensemble de méthodes qui permettent d'identifier la nature de l'agriculture.
Recherche théorique
manifestations agressives chez l'homme, facteurs qui y contribuent, caractéristiques d'un tel comportement, etc. Mais une analyse théorique de la littérature scientifique a montré qu'aucune des théories de l'agression n'a été pleinement prouvée ; les expériences décrites dans la littérature pour étudier ce phénomène ont des résultats contradictoires. Cela témoigne à la fois de la complexité du sujet de recherche et des difficultés liées au choix des méthodes pour l’étudier. Aucune propriété psychologique ne peut être mesurée directement ; seule sa manifestation prévue dans le comportement peut être mesurée.
Approche expérimentale l'étude du phénomène de l'agression permet au chercheur de contrôler des variables indépendantes et ainsi de tirer des conclusions sur les causes et les effets. Les techniques non expérimentales consistent à enregistrer les incidents naturels ; L'utilisation de ces techniques est particulièrement appropriée dans les cas où il est impossible, pour des raisons pratiques ou éthiques, de manipuler les variables indépendantes intéressant le chercheur.
Une propriété telle que l'agressivité ne peut être jugée qu'indirectement - par le degré de sa manifestation ou de sa reconnaissance par l'individu, en la mesurant à l'aide d'une échelle spéciale ou d'un autre instrument ou technique psychologique conçu pour déterminer divers degrés d'agressivité sous la forme telle qu'elle est définie. et compris par les développeurs de l'appareil de mesure. En cas d'utilisation questionnaires de personnalité Le chercheur demande aux répondants de répondre à des questions pour savoir si une personne a une tendance persistante à un comportement agressif ou d'évaluer le niveau général d'hostilité d'une personne. Les questionnaires de ce type les plus connus sont « Méthodologie de diagnostic des indicateurs et des formes d'agression » (V.M. Bass, M.E. Darkie) et « Anger Orientation Scale » (C.D. Spielberger, J. Johnson, etc.). À techniques projectives qui sont utilisés dans l'étude de l'agressivité comprennent : TAT, test de Rorschach, « Hand-Test » et « Dessin d'un animal inexistant ».
Aussi, pour étudier les comportements agressifs, la méthode d'observation sur le terrain ou recherche en laboratoire. Le principal avantage de la recherche sur le terrain est le caractère naturel des réactions du sujet.
il peut y avoir une plus grande objectivité. Une expérience en laboratoire nécessite moins de temps (il n'est pas nécessaire de la passer à attendre une agression « naturelle » émanant du sujet), permet un meilleur contrôle des variables indépendantes et l'observation d'événements comportementaux se produisant au même moment (variables dépendantes), tout en contrôler ou éliminer l’influence de tout autre facteur externe sur ces variables. Le contrôle des variables est réalisé à l'aide d'un plan expérimental ou de méthodes statistiques.
Les indicateurs de fiabilité et de validité des tests utilisés dans l'étude des manifestations agressives de la personnalité n'ont pas été entièrement étudiés, bien que des tentatives soient faites pour résoudre ce problème. Ainsi, en 2007, une étude a été menée sur la problématique de la validation des méthodes « Nonexistent Animal » et « Hand-Test » par rapport aux méthodes d'enquête : mesurer le niveau d'anxiété (S.E. Taylor), diagnostiquer l'estime de soi (C.D. Spielberger, Yu.L. Khanin) et diagnostics d'indicateurs et de formes d'agression (V.M. Bass, M.E. Darki). À la suite de l'étude, il a été démontré que le « Hand-Test » a un niveau de validité élevé et moyen sur les échelles « Directivité », « Peur », « Communication », « Dépendance », « Exhibitionnisme » et « Passif ». Impersonnel"; dans le test « Dessin d’un animal inexistant », cette échelle s’est avérée être l’échelle « Anxiété ». Ainsi, les échelles listées ci-dessus peuvent être des indicateurs d’agressivité lors de l’utilisation de ces tests. En général, l'étude a montré que lors de l'étude de l'agressivité, il est plus efficace d'utiliser le Hand-Test.
Cependant, lorsqu'il utilise la psychométrie, le chercheur est confronté à au moins deux problèmes sérieux : a) la grossièreté des instruments disponibles, même les plus sophistiqués et les plus fiables, pour mesurer les variables indépendantes et dépendantes et b) le fait que toute mesure psychologique n'est pas directe, mais indirect.
Une conclusion générale peut être tirée selon laquelle ni les théories ni les potentiel de recherche dans l'étude du problème des comportements agressifs est loin d'être épuisé. Des recherches plus approfondies sur ce phénomène sont nécessaires afin d'éliminer les contradictions et d'apporter des compléments aux positions théoriques déjà avancées. Avancer avec succès une hypothèse ou
L.E. Tarasova. Influence activités d'évaluation professeurs d'université
les hypothèses méritent d’être étudiées. La plupart des théories psychologiques reposent sur des tests empiriques d'hypothèses,
mais il n’existe aujourd’hui aucune théorie psychologique qui puisse atteindre le niveau d’une loi scientifique.
Bibliographie
1. Rean AA Agression et agressivité de la personnalité // Psychol. revue 1996. T. 17. N° 5. P. 3-18.
2. Fromm E. Anatomie de la destructivité humaine. M., 1998.
3. Bandura A., Walters R. Agression chez les adolescentes. Étudier l’influence de l’éducation et Relations familiales. M., 2000.
4. Baron R., Richardson D. Agression. Saint-Pétersbourg, 2001.
5. Rumiantseva T.G. Le concept d'agressivité dans la psychologie étrangère moderne // Enjeux. psychologie. 1991. N° 1. P. 81-88.
6. Naltchadjian A.A. Agressivité humaine. Saint-Pétersbourg, 2007.
7. Berkowitz L. Qu'est-ce que l'agression ? M., 2002.
8. Berkowitz L. Agression. Causes, conséquences et contrôle. Saint-Pétersbourg, 2001.
9. BasseA. Diagnostic d'agressivité // Fondements du psychodiagnostic. M., 1996.
CDU 159.9:37.015.3
L.E. TARASOVA
Institut pédagogique de l'Université d'État de Saratov, Département de psychopédagogie [email protégé]
L’influence des activités d’évaluation des professeurs d’université sur la formation de l’estime de soi des étudiants
Le sujet de réflexion dans cet article est le problème de la recherche et de la mise en œuvre de méthodes innovantes d’activités d’évaluation dans la pratique des enseignants universitaires, qui ont un impact positif sur la formation d’une estime de soi adéquate du travail éducatif des étudiants.
Mots clés : fonction d'évaluation de l'enseignant, contenu de l'acte d'évaluation, mécanismes de l'acte d'évaluation, critères d'évaluation, technologie de différenciation multi-niveaux, estime de soi.
Ininfluence de l'activité estimée des enseignants du secondaire sur la formation d'une auto-estimation des élèves
Le sujet de réflexion dans cet article est le problème de la recherche et de la mise en œuvre de méthodes innovantes d'évaluation de l'activité dans la pratique des enseignants du secondaire, influençant positivement la formation d'une auto-estimation adéquate du travail éducatif des étudiants.
Mots clés : fonction estimée de l'enseignant, maintien du certificat estimé, mécanismes du certificat estimé, critères d'une estimation, technologie de différenciation, auto-estimation.
Tout enseignant, y compris lycée, confronté à la nécessité de résoudre toute une gamme de problèmes pédagogiques : analytique-réflexif, constructif-pronostique, organisationnel-actif, évaluatif-informationnel, correctionnel-réglementaire.
À toutes les étapes du développement de l’école, avec le renforcement des principes démocratiques dans son organisation, la question de trouver des moyens efficaces de mettre en œuvre la fonction évaluative de l’enseignant a été mise au premier plan, car celle-ci est l’une des
les aspects les plus importants du travail d'enseignement, nécessitant une solution prioritaire lors de l'offre d'un apprentissage orienté vers l'individu.
Il est impossible d'organiser une activité, y compris éducative et cognitive, sans évaluation, puisqu'elle est l'une des composantes de l'activité, son régulateur et un indicateur d'efficacité. Mais il est également évident que le maintien de l'ancien système d'évaluation du travail éducatif, au sein duquel il n'y a pratiquement aucune comptabilité
© L.E. Tarasova, 2008
Le phénomène de l'agression est largement étudié en psychologie et en sociologie - aujourd'hui, l'étude du problème du comportement humain agressif est peut-être devenue le domaine d'activité de recherche le plus populaire des psychologues du monde entier. Distinguons les notions d'« agression » et d'« agressivité ». Le premier (du latin agressio - attaque, menace) est un nom général désignant toutes les actions destructrices et destructrices visant à causer du tort. L'agressivité est une intention, un état qui précède une action agressive. Et l'action agressive elle-même est un comportement visant à nuire à autrui. L’État agressif s’accompagne état émotionnel colère, hostilité, haine. L'action s'exprime par un acte agressif direct consistant à causer du tort à autrui : insultes, brimades, bagarres, coups.
Dans la littérature, divers auteurs ont proposé de nombreuses définitions de l’agressivité. L'agression est comprise comme « une activité forte, un désir d'affirmation de soi, des actes d'hostilité, d'attaque, de destruction, c'est-à-dire des actions qui nuisent à une autre personne ou à un autre objet ». L'agression humaine est une réponse comportementale caractérisée par la manifestation de force dans le but de causer du tort ou des dommages à un individu ou à une société. De nombreux auteurs considèrent l’agression comme une réaction d’hostilité à la frustration créée par autrui, peu importe à quel point cette frustration a des intentions hostiles.
Citons quelques définitions données par Baron R. et Richardson D. dans leur monographie « Aggression » :
l'agression est tout comportement qui menace ou cause du mal à autrui - Bass ;
pour que certains actes soient qualifiés d'agression, ils doivent inclure l'intention d'offenser ou d'insulter, et ne pas simplement conduire à de telles conséquences, - Berdkowitz ;
L'agression est une tentative d'infliger des dommages corporels ou physiques à autrui - Zillmann.
Malgré des désaccords considérables sur les définitions de l’agression, de nombreux spécialistes des sciences sociales sont enclins à accepter une définition proche de la seconde ci-dessus. Cette définition inclut à la fois la catégorie de l’intention et le fait de causer réellement une offense ou un préjudice à autrui.
L'agression en tant que comportement - la définition suggère que l'agression doit être considérée comme un modèle de comportement et non comme une émotion, un motif ou une attitude. Cette déclaration importante a créé beaucoup de confusion. Le terme agression est souvent associé à des émotions négatives telles que la colère, à des motivations telles que le désir d'offenser ou de nuire, et même à des attitudes négatives telles que des préjugés raciaux ou ethniques. Même si tous ces facteurs jouent sans aucun doute un rôle important dans les comportements préjudiciables, leur présence n’est pas une condition nécessaire à une telle action.
Agression et intention - définition Le terme agression implique des actions par lesquelles l'agresseur cause intentionnellement un préjudice à sa victime. Malheureusement, l'introduction du critère de la cause intentionnelle du dommage soulève de nombreuses et sérieuses difficultés. Premièrement, la question est de savoir ce que nous entendons lorsque nous disons qu’une personne a l’intention de nuire à une autre. Deuxièmement, comme le soutiennent de nombreux scientifiques célèbres, les intentions sont des plans personnels et cachés inaccessibles à l’observation directe. Ils peuvent être jugés d’après les conditions qui ont précédé ou suivi les actes d’agression en question. Des conclusions similaires peuvent être tirées à la fois par les participants à une interaction agressive et par des observateurs extérieurs, qui influencent de toute façon l'explication de cette intention. L'inclusion de la catégorie d'intention dans la définition de l'agression introduit une instabilité et une incohérence dans la compréhension de savoir si une action particulière est un acte d'agression. Cependant, l'intention de nuire est parfois établie tout simplement : les agresseurs admettent souvent eux-mêmes leur désir de nuire à leurs victimes et regrettent souvent que leurs attaques aient été inefficaces. Et le contexte social dans lequel se déroulent les comportements agressifs fournit souvent des preuves évidentes de telles intentions.
De l’idée selon laquelle l’agression implique soit un préjudice, soit une insulte à la victime, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’infliger des lésions corporelles à la personne qui la reçoit. L'agression se produit si le résultat des actions entraîne des conséquences négatives. Étant donné que les manifestations d'agression chez les personnes sont infinies et diverses, il s'avère très utile de limiter l'étude de ce comportement.
Considérons le schéma conceptuel du type d'agression de Bass :
Physique - actif - direct
Physique - actif - indirect
Physique - passif - direct
Physique - passif - indirect
Verbal - actif - direct
Verbal - actif - indirect
Verbal - passif - direct
Verbal - passif - indirect
Selon lui, les actions agressives peuvent être décrites sur la base de trois échelles : physique - verbale, active - passive et directe - indirecte. Leur combinaison donne huit catégories possibles dans lesquelles appartiennent la plupart des actes agressifs.
Il faut également distinguer l'agression hostile de l'agression instrumentale : l'agression hostile se manifeste lorsque l'objectif principal de l'agresseur est de faire souffrir la victime. Les personnes qui se livrent à une agression hostile cherchent simplement à causer du tort ou à nuire à ceux qu’elles attaquent.
L'agression instrumentale se caractérise lorsque les agresseurs attaquent d'autres personnes dans la poursuite d'objectifs sans rapport avec le fait de causer du tort. En d’autres termes, pour les individus qui font preuve d’agressivité instrumentale, causer du tort à autrui n’est pas une fin en soi. Au contraire, ils utilisent des actions agressives comme un outil pour réaliser divers désirs.
Les recherches de Dodge et Coya ont fourni des preuves empiriques de l'existence de deux types distincts d'agression. Quel que soit le choix du terme pour désigner ces différents types d’agressions, il est clair : il existe deux types d’agressions, motivées par des objectifs différents. Bien que de nombreuses justifications théoriques contradictoires aient été avancées dans la littérature scientifique, la plupart d’entre elles entrent dans l’une des quatre catégories suivantes. L'agression fait principalement référence à :
impulsions ou inclinations innées ;
besoins activés par des stimuli externes ;
processus cognitifs et émotionnels ;
conditions sociales actuelles en combinaison avec les apprentissages antérieurs.
Au cours de ce processus, plusieurs groupes de théories ont été avancés sur l'origine et l'essence du comportement agressif : théorie de l'agression instinctive, évolutionniste, de la frustration, théorie de l'apprentissage social et théorie du transfert d'excitation.
Direction psychanalytique
L’école psychanalytique considère le comportement agressif avant tout comme instinctif. Selon ce concept, « l’agression se produit parce que les êtres humains sont génétiquement ou constitutionnellement programmés pour agir de telle manière ». L'instinct de base est le thanatos - l'attirance vers la mort, dont l'énergie vise la destruction et la cessation de la vie. Freud a soutenu que tout comportement humain est le résultat d’une interaction complexe entre cet instinct et l’éros et qu’il existe une tension constante entre les deux. Parce qu'il existe un conflit aigu entre la préservation de la vie (c'est-à-dire l'eros) et sa destruction (thanatos), d'autres mécanismes (tels que le déplacement) servent à diriger l'énergie du thanatos vers l'extérieur, loin du Soi.
Approche évolutive
L’approche évolutionniste est proche de l’approche instinctiviste de la prise en compte des comportements agressifs. Le représentant de cette direction théorique est le célèbre éthologue Konrad Lorenz.
K. Lorenz pensait que le comportement agressif provenait de l'instinct de lutte pour la survie, présent chez l'homme comme chez les autres créatures. La présence d'une identification entre « ami » et « étranger » joue un rôle important dans la formation des impulsions agressives. Au cours de l'évolution des comportements sociaux, des groupes sociaux consolidés intérieurement et aliénés par rapport à leurs voisins émergent. Les stéréotypes permettent de reconnaître rapidement ami et ennemi, camarade de groupe et étranger, sur la base de quelques critères décisifs, ils simplifient le monde et créent un sentiment de confiance. K. Lorenz, dans ses travaux sur l'agression, l'interprète comme une force motrice dans la lutte pour la survie, et cette lutte se déroule principalement au sein d'une même espèce.
Théorie de la frustration
Selon la théorie de la frustration créée par Dollard, l’agressivité n’est pas un instinct qui surgit automatiquement dans les profondeurs du corps, mais une conséquence de la frustration, c’est-à-dire des obstacles qui surgissent sur le chemin des actions intentionnelles du sujet. Cette théorie affirme que, d’une part, l’agression est toujours une conséquence de la frustration et, d’autre part, la frustration entraîne toujours une agression. Cependant, les individus frustrés n’ont pas toujours recours à des attaques verbales ou physiques contre les autres. Au contraire, ils démontrent toute la gamme des réactions à la frustration : de la résignation et du découragement aux tentatives actives pour surmonter les obstacles sur leur chemin. Dans leurs écrits, Dollard et ses co-auteurs suggèrent que l'influence des frustrations successives peut être cumulative et que cela provoquera des réactions agressives plus fortes que chacune d'elles individuellement. Il résulte de ce qui précède que l’influence des événements frustrants persiste dans le temps, hypothèse importante pour certains aspects de la théorie.
Lorsqu'il est devenu clair que les individus ne réagissent pas toujours avec agressivité à la frustration, ils sont arrivés à la conclusion que ce comportement ne s'exprime pas en même temps, principalement en raison de la menace de punition. Miller a expliqué cela par l'émergence d'une agression déplacée, c'est-à-dire les cas où des individus font preuve d'agressivité non pas envers leurs frustrants, mais envers des personnes complètement différentes. L'auteur suggère que dans de tels cas, le choix de la victime par l'agresseur est largement déterminé par trois facteurs :
force de motivation à l'agression,
la force des facteurs inhibant ce comportement et la similitude du stimulus de chaque victime potentielle avec le facteur frustrant.
Théorie de l'apprentissage social
Contrairement à d’autres, cette théorie affirme que l’agressivité est un comportement appris à travers le processus de socialisation par l’observation d’un comportement approprié et le renforcement social. Ceux. Il existe une étude du comportement humain orienté modèle. Cette théorie a été proposée par A. Bandura et expliquait l'acquisition, la provocation et la régulation des comportements agressifs. De son point de vue, l’analyse des comportements agressifs nécessite de prendre en compte trois points :
Moyens de maîtriser de telles actions ;
Facteurs qui provoquent leur apparition ;
Les conditions dans lesquelles ils sont fixés.
Les partisans de la théorie de l'apprentissage social estiment que plus une personne commet des actions agressives, plus ces actions deviennent partie intégrante de son comportement.
Théorie du transfert d'excitation
Le point de vue moderne sur l’origine du comportement agressif est associé à la théorie de l’apprentissage cognitif. Dans ce document, les actions agressives sont considérées non seulement comme le résultat de la frustration, mais aussi comme une conséquence de l'apprentissage et de l'imitation des autres. Cette direction est représentée par Zillmann, qui soutient que « la cognition et l'éveil sont étroitement liés ; ils s’influencent mutuellement tout au long du processus d’expérience, d’expérience et de comportement pénibles.
Dans ce concept, le comportement agressif est interprété comme le résultat des processus cognitifs et autres suivants :
L'évaluation par le sujet des conséquences de son comportement agressif est positive.
La présence de frustration.
La présence d'une surexcitation émotionnelle telle que l'affect ou le stress, accompagnée de tensions internes dont une personne veut se débarrasser.
La présence d'un objet approprié de comportement agressif qui peut soulager les tensions et éliminer la frustration.
Dans cette section, nous avons essayé de distinguer des concepts tels que l'agression, l'agressivité, l'action agressive, et avons donné une définition au concept central d'agression. Nous avons examiné les principales théories sur l'origine et l'essence de l'agression.
En révélant l'essence du problème de l'agression et en l'analysant, nous nous attarderons sur une question telle que les facteurs influençant l'assimilation d'un comportement agressif par un individu. De nombreuses formes d’agression sont communes à la plupart des adolescents. Cependant, on sait que dans une certaine catégorie d'adolescents, l'agressivité en tant que forme de comportement stable non seulement persiste, mais se développe également, se transformant en une qualité de personnalité stable. En effet, c'est à l'adolescence que se produit non seulement une restructuration radicale des structures psychologiques, mais de nouvelles formations apparaissent, les bases d'un comportement conscient sont posées, orientation générale dans la formation d'idées morales et d'attitudes sociales.
Il nous paraît évident que dans à cet âge, les connaissances sur les modèles de comportement agressif proviennent de trois sources principales :
famille - peut simultanément démontrer des modèles de comportement agressif et fournir son renforcement. La probabilité que les adolescents adoptent un comportement agressif dépend du fait qu'ils soient ou non victimes d'agression à la maison ;
Ils apprennent également l'agressivité grâce à l'interaction avec leurs pairs, découvrant souvent les avantages d'un comportement agressif pendant les jeux ;
On note également le fait que les adolescents apprennent les réactions agressives non seulement à partir d'exemples réels (le comportement de leurs pairs et des membres de leur famille), mais aussi à partir d'exemples symboliques proposés dans les médias.
Par conséquent, le développement d'un comportement agressif est un processus complexe et multiforme dans lequel de nombreux facteurs interviennent ; le comportement agressif est déterminé par l'influence de la famille, des pairs et des médias. Les adolescents apprennent les comportements agressifs grâce au renforcement direct ainsi qu’en observant des actes agressifs. En ce qui concerne la famille, le développement de comportements agressifs est influencé par le degré de cohésion familiale, la proximité entre parents et enfant, la nature des relations entre frères et sœurs et le style de leadership familial. Les enfants en proie à de fortes discordes familiales, dont les parents sont distants et froids, sont comparativement plus sujets à des comportements agressifs. Les réactions des parents face aux relations violentes entre frères et sœurs fournissent également une leçon sur ce à quoi un enfant peut s'en tirer. En fait, en essayant de mettre fin aux interactions négatives entre leurs enfants, les parents peuvent involontairement encourager le comportement qu’ils souhaitent éliminer. La nature du leadership familial a une influence directe sur le développement et la consolidation des comportements agressifs. Les parents qui emploient des punitions extrêmement sévères et ne surveillent pas les activités de leurs enfants risquent de les trouver agressifs et désobéissants. Bien que les punitions soient souvent inefficaces, lorsqu’elles sont utilisées correctement, elles peuvent avoir un impact positif puissant sur le comportement.
Un adolescent reçoit également des informations sur l'agression grâce à la communication avec ses pairs. Les enfants apprennent à se comporter de manière agressive en observant le comportement des autres enfants. Cependant, ceux qui sont extrêmement agressifs risquent de se retrouver rejetés par la majorité de leur tranche d’âge. D’un autre côté, ces enfants agressifs sont susceptibles de trouver des amis parmi d’autres pairs agressifs. Bien entendu, cela crée des problèmes supplémentaires, car dans une entreprise agressive, l'agressivité de ses membres se renforce mutuellement.
Pour les adolescents, l’un des principaux moyens d’apprendre un comportement agressif est d’observer l’agressivité des autres. Les adolescents qui subissent de la violence à la maison et qui en deviennent eux-mêmes victimes sont sujets à des comportements agressifs. Mais l’une des sources les plus controversées de l’agressivité pédagogique réside dans les médias. Après de nombreuses années de recherche utilisant une grande variété de méthodes et de techniques, l’étendue de l’influence des médias sur les comportements agressifs reste encore floue. Il semble que les médias aient une certaine influence. Cependant, sa force reste inconnue.
Tout ce qui précède nous permet de conclure qu'en analysant les travaux de psychologues étrangers et nationaux, il n'existe pas d'interprétation unique de la définition, des origines, des causes d'apparition et de la manifestation de l'agression. Fondamentalement, le phénomène étudié est interprété dans le contexte des théories du développement de la personnalité de nombreux psychologues. En outre, la plupart des auteurs considèrent l'agression comme une réaction d'hostilité à la frustration créée par autrui, peu importe à quel point cette frustration a des intentions hostiles.
Ainsi, la définition suivante est actuellement acceptée par la majorité, à laquelle nous adhérons également :
L'agression est toute forme de comportement visant à insulter ou à nuire à un autre être vivant qui ne souhaite pas un tel traitement. Nous avons identifié les principaux facteurs qui, sous certaines conditions, ont un impact direct sur la manifestation d'agressivité de la part des adolescents. Par conséquent, les facteurs négatifs provenant de la famille, des pairs et des médias réduisent le potentiel productif de l’enfant, les possibilités de communication complète sont réduites et son développement personnel est déformé. Et vice versa, la proximité entre les parents et l'enfant, la nature de la relation de respect et d'amour entre les membres de la famille, le fait que l'adolescent se trouve dans un environnement sain du point de vue des normes morales, éthiques et culturelles, présupposent la formation d'un personnalité moralement stable avec un haut niveau de développement de l'empathie. En résumé, notons que lors de l'analyse du matériel scientifique et théorique, il convient de comparer les concepts de base du cours et les facteurs influençant le phénomène étudié. Ainsi, la notion d'agressivité doit être corrélée à des facteurs tels que la violence domestique, hostile et négative. attitude interpersonnelle entre pairs, des exemples médiatiques démontrant des schémas de comportement clairement destructeurs. Et, avec le concept d'empathie - cohésion familiale, relations respectueuses et amicales dans la société environnante. Nous en concluons qu’en éliminant les causes des influences morales et psychologiques négatives sur la personnalité d’un adolescent, il est possible de réduire son degré d’agressivité. Par conséquent, nous avons théoriquement confirmé notre hypothèse.
Avant de passer à une étude expérimentale du phénomène étudié, nous examinerons dans la section suivante le problème de l'empathie dans divers concepts théoriques. Il nous semble prometteur de résoudre efficacement le problème en considérant la question du développement de l'empathie comme une condition permettant d'abaisser le niveau d'agressivité et de réduire la fréquence de ses manifestations.