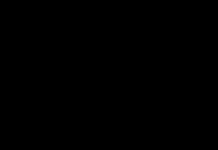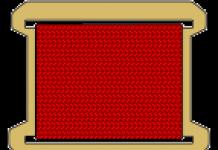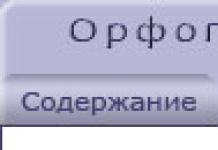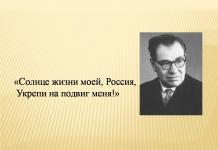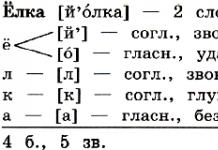Ministère de l'Éducation de la République de Biélorussie
Établissement d'enseignement
"Biélorusse Université d'État l'informatique
et électronique radio"
Département psychologie de l'ingénieur et ergonomie
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Boîte à outils
pour les étudiants de spécialité 1 –
"Ingénierie et accompagnement psychologique des technologies de l'information"
cours par correspondance
Minsk BSUIR 2011
Introduction…………………………………………………………………………………………
Thème 1. La cellule est la principale unité structurelle du système nerveux……..….
Thème 2. Transmission des impulsions synaptiques.…………………………………..
Thème 3. Structure et fonctions du cerveau……..…………………….…..
Thème 4. Structure et fonctions de la moelle épinière……………………………………………………
Thème 5. Télencéphale, structure et fonctions………………………………...
Thème 6. Centres moteurs……………………………………………………………………..
Thème 7. Végétatif système nerveux…………………………………………
Thème 8. Système neuroendocrinien…………..……………………………..
Littérature……………………………………………………………………….
INTRODUCTION
Étudier la discipline « Anatomie et physiologie du système nerveux central » − élément important formation de base ingénieurs systèmes spécialisés. L'objectif de l'enseignement de cette discipline est d'acquérir des connaissances sur la formation du système d'information du cerveau, la transmission de l'information aux parties centrales du système nerveux via des voies afférentes, ainsi que sa transmission et son accès à la « périphérie » via voies efférentes. Par conséquent, dans ce manuel méthodologique donne une idée de l'activité du système nerveux central (SNC) comme base morphofonctionnelle des processus neuropsychologiques ; la structure et les fonctions du système nerveux central, qui est responsable de la collecte, du traitement des informations et de leur transmission aux parties supérieures du cortex cérébral pour prendre des décisions de gestion ; − les mécanismes de base assurant la vie humaine (métabolisme, thermorégulation, régulation neurohumorale, systégenèse) qui sont responsables du fonctionnement fiable de ses systèmes sont pris en compte. Après chaque sujet abordé, il est indiqué Questions de contrôle pour la consolidation et la maîtrise de soi des connaissances par les étudiants. À la fin du manuel, vous trouverez une liste de tâches à effectuer travail d'essai. La littérature fournit une liste de sources avec un riche matériel illustratif.
Les connaissances acquises serviront ensuite de base à l'étude de disciplines ultérieures des sciences naturelles (psychophysiologie, psychologie, etc.).
Thème 1. LA CELLULE EST L'UNITÉ STRUCTURELLE DE BASE DU SYSTÈME NERVEUX
L'ensemble du système nerveux est divisé en central et périphérique. Le système nerveux central (SNC) comprend le cerveau et moelle épinière. À partir d'eux, les fibres nerveuses se propagent dans tout le corps − système nerveux périphérique. Il relie le cerveau aux sens et aux organes exécutifs − muscles et glandes.
L'anatomie du système nerveux central étudie la structure de ses composants. La physiologie étudie les mécanismes de leur travail commun.
Tous les organismes vivants ont la capacité de réagir aux changements physiques et chimiques de environnement. Les stimuli de l'environnement extérieur (lumière, son, odeur, toucher, etc.) sont convertis par des cellules sensibles spéciales (récepteurs) en influx nerveux − une série de changements électriques et chimiques dans une fibre nerveuse. L'influx nerveux est transmis par sensible (afférent) fibres nerveuses de la moelle épinière et du cerveau. Ici, les impulsions de commande correspondantes sont générées et transmises via moteur (efférent) fibres nerveuses vers les organes exécutifs (muscles, glandes). Ces organes exécutifs sont appelés effecteurs.
Fonction de base du système nerveux − intégration des influences extérieures avec la réaction adaptative correspondante du corps.
Le système nerveux central est constitué de deux types de cellules nerveuses : neurones et cellules gliales, ou névroglie. Le cerveau humain est le système le plus complexe de l’Univers connu par la science. Pesant environ 1 250 g, le cerveau contient 100 milliards de neurones nerveux connectés dans un réseau incroyablement complexe. Les neurones sont entourés d'un nombre encore plus grand de cellules gliales, qui constituent une base de soutien et de nutrition pour les neurones - gliales (en grec « glia » − colle), qui remplit de nombreuses autres fonctions qui n'ont pas encore été entièrement étudiées. L'espace entre les cellules nerveuses (espace intercellulaire) est rempli d'eau contenant des sels, des glucides, des protéines et des graisses dissous. Les plus petits vaisseaux sanguins − capillaires − situé dans un réseau entre les cellules nerveuses.
Des lignes directrices
Les fonctions des neurones incluent le traitement de l’information, c’est-à-dire sa perception, sa transmission à d’autres cellules et son codage. Le neurone réalise toutes ces opérations grâce à sa structure particulière.
Malgré une certaine diversité dans la forme des neurones, la plupart d'entre eux ont plus une grande partie appelée corps (soma), et plusieurs tournages. Il existe généralement un processus plus long appelé axone, et plusieurs processus plus fins et plus courts, mais ramifiés appelés dendrites. La taille du corps des neurones est comprise entre 5 et 100 micromètres. La longueur de l'axone peut être plusieurs fois supérieure à la taille du corps et atteindre 1 mètre.
Les fonctions d'un neurone pour le traitement de l'information sont réparties entre ses parties comme suit. Les dendrites et le corps cellulaire perçoivent les signaux d'entrée. Le corps cellulaire les résume, les moyenne, les combine et « prend une décision » : transmettre ou non ces signaux, c'est-à-dire qu'il forme une réponse. L'axone transmettra des signaux de sortie à ses terminaisons (terminaux). Les terminaux axonaux transmettent des informations à d'autres neurones, généralement via des sites de contact spécialisés appelés synapses. Les signaux transmis par les neurones sont de nature électrique.
En fonction de l'équilibre des impulsions reçues par les dendrites d'un neurone individuel, la cellule est activée (ou non) et transmet l'impulsion le long de son axone aux dendrites d'une autre cellule nerveuse avec laquelle son axone est connecté. De cette façon, chacune des 100 milliards de cellules peut se connecter à 100 000 autres cellules nerveuses.
Les corps de cellules nerveuses étroitement adjacents les uns aux autres sont perçus à l'œil nu comme de la « matière grise ». Les cellules forment des feuilles pliées, comme le cortex cérébral, et les organisent en groupes appelés noyaux et structures en forme de réseau. Au microscope, les schémas structurels des différentes zones du cortex cérébral peuvent être clairement distingués. les axones, ou « matière blanche », forment les troncs principaux, ou « faisceaux fibreux », reliant les corps cellulaires. La taille des cellules nerveuses varie de 20 à 100 microns (1 micron équivaut à un millionième de mètre).
Les cellules gliales comprennent les cellules étoilées (astrocytes), les très grosses cellules (oligodendrocytes) et les très petites cellules (microglies). Les cellules étoilées servent de support aux neurones, d'intermédiaire entre le neurone et le capillaire pour le transfert des nutriments, et de matériel de réserve pour « réparer » les neurones endommagés. Forme d'oligodendrocytes myéline − une substance qui recouvre les axones et favorise une transmission plus rapide du signal. Les microglies sont nécessaires lorsque et là où le système nerveux est endommagé. Les cellules microgliales migrent vers les zones endommagées et, se transformant en macrophages, comme les cellules sanguines protectrices, détruisent les déchets. La myéline est formée d'une cellule gliale enroulée autour de l'axone.
Questions de contrôle :
1. Qu'étudie l'anatomie du système nerveux central ?
2. Qu'étudie la physiologie du système nerveux central ?
3. Qu'est-ce qui est classé comme système nerveux central et périphérique ?
4. Quelle est la fonction principale du système nerveux ?
5. Nommez les types de cellules nerveuses et indiquez leur rapport dans le système nerveux central.
6. Quelles sont la structure et les fonctions d’un neurone ?
7. Nommez les types et les fonctions des cellules gliales.
8. Que sont la « matière grise » et la « matière blanche » ?
Sujet 2. TRANSMISSION D'IMPULSIONS SYNAPTIQUES
Les synapses d'un neurone typique du cerveau sont soit passionnant, ou frein, selon le type de médiateur qui y est libéré. Les synapses peuvent également être classées selon leur emplacement à la surface du neurone récepteur : sur le corps cellulaire, sur la tige ou « colonne vertébrale » de la dendrite, ou sur l'axone. Selon le mode de transmission, on distingue les synapses chimiques, électriques et mixtes.
Des lignes directrices
Le processus de transmission chimique passe par plusieurs étapes : synthèse du médiateur, son accumulation, libération, interaction avec le récepteur et cessation de l'action du médiateur. Chacune de ces étapes a été caractérisée en détail et des médicaments ont été découverts qui améliorent ou bloquent sélectivement une étape spécifique.
Neurotransmetteur(neurotransmetteur, neurotransmetteur) est une substance synthétisée dans un neurone, contenue dans des terminaisons présynaptiques, libérée dans la fente synaptique en réponse à une impulsion nerveuse et agissant sur des zones particulières de la cellule post-synaptique, provoquant des modifications du potentiel membranaire et du métabolisme cellulaire . Pendant longtemps on croyait que la fonction du neurotransmetteur était uniquement d'ouvrir (ou même de fermer) les canaux ioniques dans la membrane postsynaptique. On savait également que la même substance peut toujours être libérée par la terminaison d’un axone. Plus tard, de nouvelles substances ont été découvertes qui apparaissent dans la zone synapse au moment de la transmission de l'excitation. Ils étaient appelés neuromodulateurs. L'étude de la structure chimique de tous les médiateurs et neuromodulateurs découverts a clarifié la situation. Toutes les substances étudiées liées à la transmission synaptique de l'excitation ont été divisées en trois groupes : acides aminés, monoamines et peptides. Toutes ces substances sont désormais appelées médiateurs.
Il existe des « neuromodulateurs » qui n'ont pas d'effet physiologique indépendant, mais modifient l'effet des neurotransmetteurs. L'action des neuromodulateurs est de nature tonique - développement lent et longue durée d'action. Son origine n'est pas nécessairement neuronale ; par exemple, la glie peut synthétiser un certain nombre de neuromodulateurs. L'action n'est pas initiée par un influx nerveux et n'est pas toujours associée à l'effet d'un médiateur. Les cibles d'influence ne sont pas seulement les récepteurs de la membrane postsynaptique, mais également différentes parties du neurone, y compris les parties intracellulaires.
Derrière dernières années, après la découverte d'une nouvelle classe dans le cerveau composants chimiques– les neuropeptides, le nombre de systèmes de messagers chimiques connus dans le cerveau a considérablement augmenté. Neuropeptides représentent des chaînes de résidus d’acides aminés. Beaucoup d’entre eux sont localisés dans les terminaisons axonales. Les neuropeptides diffèrent des médiateurs précédemment identifiés dans la mesure où ils organisent des phénomènes aussi complexes que la mémoire, la soif, le désir sexuel, etc.
Questions de contrôle :
1. Qu'est-ce qu'une synapse ?
2. Nommez les types de synapses.
3. Quelle est la caractéristique de la transmission synaptique électrique ?
4. Quelle est la caractéristique de la transmission du signal chimique ?
5. Définissez un neurotransmetteur. En quels groupes sont-ils répartis ? émetteurs synaptiques par structure chimique ?
6. Que sont les neuromodulateurs ? Quelle est leur origine et leur action ?
7. Que sont les neuropeptides ?
Thème 3. STRUCTURE ET FONCTIONS DU CERVEAU
Sur Latin cerveau désigné par le mot "cérébrit", et en grec ancien - "céphale". Le cerveau est situé dans la cavité crânienne et a une forme qui correspond généralement aux contours internes de la cavité crânienne.
Le cerveau est composé de trois grandes parties : hémisphères grand cerveau , ou hémisphères, cervelet Et tronc cérébral.
La plus grande partie de l'ensemble du cerveau est occupée par les hémisphères cérébraux, suivis par le cervelet en taille, et le reste est le tronc cérébral. Les deux hémisphères, gauche et droit, sont séparés l'un de l'autre par une fissure. Dans ses profondeurs, les hémisphères sont reliés entre eux par une grande commissure - le corps calleux. Il existe également deux commissures moins massives, dont la commissure dite antérieure.
Depuis la surface inférieure du cerveau, non seulement la face inférieure des hémisphères cérébraux et du cervelet est visible, mais également toute la surface inférieure du tronc cérébral, ainsi que les nerfs crâniens s'étendant du cerveau. De côté, c'est principalement le cortex cérébral qui est visible.
Des lignes directrices
Les processus vitaux s'arrêtent si un centre vital du cerveau est détruit : cardiovasculaire ou respiratoire. Si nous comparons hiérarchiquement ces centres avec leurs correspondants supérieurs et inférieurs (dans la moelle épinière), ils peuvent alors être appelés les principaux organisateurs de la circulation sanguine et de la respiration. La moelle épinière, c’est-à-dire ses motoneurones allant directement aux muscles, est l’interprète. Et dans le rôle d'initiateur et de modulateur se trouvent l'hypothalamus (diencéphale) et le cortex cérébral (cerveau terminal).
Situé dans la moelle oblongate centre cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire comprend les noyaux du nerf vague, qui ont des effets parasympathiques sur le cœur, et le centre vasomoteur, qui a des effets sympathiques sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Dans le centre vasomoteur, on distingue deux zones : pressive (contracte les vaisseaux sanguins) et dépressive (dilate les vaisseaux sanguins), qui sont en relation réciproque. La zone pressive est « activée » par les chimiorécepteurs (réagissant à la composition du sang) et les extérocepteurs, et la zone dépressive est activée par les barorécepteurs (réagissant à la pression subie par les parois des vaisseaux sanguins). Le centre hiérarchiquement le plus élevé d’innervation parasympathique et sympathique est l’hypothalamus. Il détermine les effets qui se produiront sur le système cardiovasculaire. L'hypothalamus le détermine en fonction des besoins actuels de tout l'organisme à un moment donné.
Centre respiratoire en partie situé dans le pont du cerveau postérieur et en partie dans la moelle oblongate. On peut dire qu'il existe un centre d'inspiration séparé (dans le pont) et un centre d'expiration (dans la moelle allongée). Ces centres entretiennent une relation de réciprocité. L'inspiration se produit lorsque les muscles intercostaux externes se contractent et l'expiration se produit lorsque les muscles intercostaux internes se contractent. Les commandes aux muscles proviennent des motoneurones de la moelle épinière. La moelle épinière reçoit les commandes des centres d'inspiration et d'expiration. Le centre d'inspiration se caractérise par une activité impulsionnelle constante. Mais il est interrompu par des informations provenant des récepteurs d'étirement, situés dans les parois des poumons. L'expansion des poumons lors de l'inspiration déclenche l'expiration. La fréquence respiratoire peut être modulée par le nerf vague et les centres supérieurs : l'hypothalamus et le cortex cérébral. Par exemple, lorsque nous parlons, nous pouvons réguler consciemment la durée de l'inspiration et de l'expiration, puisque nous sommes obligés de prononcer des sons de durées différentes.
De plus, la moelle oblongue contient les noyaux de plusieurs nerfs crâniens. Au total, les humains possèdent 12 paires de nerfs crâniens, dont quatre paires sont situées dans la moelle allongée. Il s’agit du nerf hypoglosse (XII), accessoire (XI), vague (X) et glossopharyngé (IX). Grâce aux noyaux du nerf glossopharyngé, des mouvements des muscles du pharynx se produisent, ce qui signifie que plusieurs réflexes importants pour le corps sont réalisés : toux, éternuements, déglutition, vomissements et phonation se produisent également - prononcer sons de parole. À cet égard, on pense que les centres correspondants sont situés dans la moelle allongée : éternuements, toux, vomissements.
De plus, la moelle allongée contient les noyaux vestibulaires, qui régulent la fonction de l'équilibre.
À cerveau postérieur inclure le pont et le cervelet. La cavité du cerveau postérieur est le quatrième ventricule cérébral (comme un canal rachidien continu et en expansion). Le pont Varoliev est formé de puissantes voies conductrices. Le cervelet est un centre moteur doté de nombreuses connexions avec d’autres parties du cerveau. Les fibres liantes sont rassemblées en faisceaux et forment trois paires de pattes. Les jambes inférieures assurent la communication avec le bulbe rachidien, celles du milieu assurent la communication avec le pont, et à travers lui avec le cortex, et les jambes supérieures avec le mésencéphale.
Le cervelet ne représente que 10 % de la masse du cerveau, mais contient plus de la moitié de tous les neurones du système nerveux central. Les fonctions motrices du cervelet comprennent la régulation du tonus musculaire, de la posture du corps et de l'équilibre. L'ancien cervelet en est responsable . Le cervelet coordonne la posture et les mouvements ciblés. L'ancien et le nouveau cervelet en sont responsables . Le cervelet est également impliqué dans la programmation de divers mouvements dirigés vers un but, notamment les mouvements balistiques, les mouvements sportifs, comme lancer une balle, jouer instruments de musique, méthode de saisie « aveugle », etc. L'hypothèse de la participation du cervelet aux processus de pensée est étudiée : la présence de systèmes neuronaux communs pour contrôler le mouvement et la pensée est discutée.
Au bas du ventricule cérébral, qui a une forme rhomboïde (également appelée fosse rhomboïde), se trouvent les noyaux des nerfs crâniens vestibulocochléaire (VIII), facial (VII), abducens (VI) et partiellement trijumeau (V).
Mésencéphale est une partie du cerveau très constante et à faible variable évolutive. Ses structures nucléaires sont associées à la régulation des mouvements posturaux (noyau rouge), à la participation à l'activité du système moteur extrapyramidal (substantia nigra et noyau rouge), à des réactions indicatives aux signaux visuels et sonores (quadrigéminal). Le colliculus supérieur est le principal centre visuel et le colliculus inférieur est le principal centre auditif.
Le soi-disant aqueduc de Sylvius traverse le mésencéphale, reliant les 4e et 3e ventricules cérébraux. Voici également les noyaux du 3ème (oculomoteur), du 4ème (trochléaire) et un des noyaux du 5ème (trijumeau) nerfs crâniens. Les 3ème et 4ème nerfs crâniens régulent les mouvements oculaires. Étant donné que le colliculus supérieur, qui reçoit les informations des récepteurs visuels, se trouve également ici, le mésencéphale peut être considéré comme l'endroit où se concentrent les fonctions visuo-oculomotrices.
Diencéphale représenté par une formation - le thalamus. Le thalamus a une forme ronde et ovoïde. Nom historique thalamus - butte visuelle ou butte sensorielle. Il a reçu ce nom en raison de sa fonction principale, établie il y a longtemps. Le thalamus est le collecteur de toutes les informations sensorielles. Cela signifie qu'il reçoit des informations de tous types de récepteurs, de tous les sens (vision, ouïe, goût, odorat, toucher), propriocepteurs, interorécepteurs, vestibulorecepteurs.
Au lieu du nom « diencéphale », le nom « thalamus » est souvent utilisé. Thalamus occupe partie centrale diencéphale. Il forme le plancher et les parois du 3ème ventricule cérébral. Anatomiquement, le thalamus possède des appendices : appendice supérieur (épithalamus) , appendice inférieur (hypothalamus) , partie postérieure (métathalamus) , et chiasma optique. ou chiasma visuel.
Épithalamus se compose de plusieurs formations. Le plus gros est glande pinéale, ou glande pinéale (glande pinéale). C'est une glande endocrine qui sécrète de la mélatonine. La noradrénaline, l'histamine et la sérotonine se trouvent également dans la glande pinéale. La participation de ces substances à la régulation des rythmes circadiens (rythmes quotidiens d'activité associés à l'éclairage) est prouvée.
Métathalamus se compose des corps géniculés latéraux (centres visuels secondaires) et des corps géniculés médiaux (centre auditif secondaire).
Hypothalamus est à la fois le centre le plus élevé du système nerveux autonome, un « analyseur chimique » de la composition du sang et du liquide céphalo-rachidien et une glande endocrine. Cela fait partie du système limbique du cerveau. Une partie de l'hypothalamus est pituitaire- formation de la taille d'un pois. L'hypophyse est une glande endocrine importante : ses hormones régulent l'activité de toutes les autres glandes.
Étant donné que l'hypothalamus possède ses propres osmo et chimiorécepteurs, il peut déterminer la suffisance de la concentration de diverses substances dans les fluides corporels traversant le tissu hypothalamique - sang et liquide céphalo-rachidien. Conformément au résultat de l'analyse, il peut améliorer ou affaiblir divers processus métaboliques à la fois en envoyant des impulsions nerveuses à tous les centres autonomes et en libérant des substances biologiquement actives - les libérines et les statines. Ainsi, l'hypothalamus est le plus haut régulateur des comportements alimentaires, sexuels, agressifs et défensifs, c'est-à-dire les principales motivations biologiques.
L'hypothalamus faisant partie intégrante du système limbique, il est également le centre d'intégration des fonctions somatiques (liées aux réactions motrices conformément aux données des organes sensoriels) et autonomes, à savoir : il assure les fonctions somatiques en fonction des besoins de l'ensemble de l'organisme. Par exemple, si pour un organisme à l'heure actuelle biologiquement tâche importante est un comportement défensif, qui dépend avant tout du fonctionnement efficace des muscles squelettiques et des organes sensoriels (voir, entendre, bouger). Mais travail efficace les muscles, à leur tour, dépendent non seulement de la vitesse de l'influx nerveux, mais aussi de l'approvisionnement des muscles et des nerfs en ressources énergétiques et en oxygène, etc. Par conséquent, nous pouvons dire que l'hypothalamus fournit un soutien « interne » au comportement « externe » .
Les noyaux du thalamus sont divisés fonctionnellement en trois groupes : relais (commutation), associatif (intégratif) et non spécifique (modulateur).
Changer les cœurs- Il s'agit d'un maillon intermédiaire de longues voies conductrices (voies afférentes) provenant de tous les récepteurs du tronc, des membres et de la tête. Ces signaux afférents sont ensuite transmis aux zones analyseuses correspondantes du cortex cérébral. C'est cette partie du thalamus qui est le « tubercule sensible ». Cela inclut fonctionnellement à la fois les corps géniculés latéral et médial, puisque les informations sont transmises respectivement au cortex occipital et temporal.
Les noyaux associatifs du thalamus relient entre eux différents noyaux au sein du thalamus lui-même, ainsi que le thalamus lui-même avec les zones associatives du cortex cérébral. Grâce à ces connexions, par exemple, il est possible de former un « diagramme corporel » et de permettre à différents types de processus gnostiques (cognitifs) de se produire lorsqu'un mot et une image visuelle sont connectés ensemble.
Les noyaux non spécifiques du thalamus forment la partie la plus ancienne du thalamus sur le plan évolutif. Ce noyaux de la formation réticulaire. Ils reçoivent des informations sensorielles de toutes les voies ascendantes et des centres moteurs du mésencéphale. Les cellules de la formation réticulaire ne sont pas capables de distinguer selon quelle modalité le signal est reçu. Mais c'est exactement ainsi qu'il entre dans un état d'excitation, comme s'il était « infecté » par de l'énergie et, à son tour, a un effet modulateur sur le cortex cérébral, à savoir l'activation de l'attention. C'est pourquoi ils l'appellent système d'activation réticulaire du cerveau.
Le nerf optique, ou 2ème nerf crânien, traverse le diencéphale, à partir des récepteurs de la rétine. Ici, dans le « territoire » du diencéphale, le nerf optique effectue une décussation partielle puis se poursuit comme un conduit visuel menant aux centres visuels primaires et secondaires, puis au cortex visuel du cerveau.
Questions de contrôle :
1. Nommez les principales parties du cerveau.
2. Où se trouve la moelle oblongue et qu'est-ce que c'est ?
3. Nommez les fonctions de la moelle allongée.
4. Qu'est-ce que le cerveau postérieur et quelles sont ses fonctions ?
5. Qu’est-ce que le mésencéphale et quelles sont ses fonctions ?
6. Qu'est-ce que le diencéphale ?
7. Quelle est la structure et le but de l'épithalamus ?
8. Quelle est la structure et le but du métathalamus ?
9. Quelle est la structure et le but de l'hypothalamus ?
10.Donner une description de chacun des trois groupes de noyaux thalamiques.
Thème 4. STRUCTURE ET FONCTIONS DE LA MOELLE ÉPINIÈRE
La moelle épinière est située dans le canal rachidien. Sa forme est approximativement cylindrique. Son extrémité supérieure passe dans la moelle oblongate et l'extrémité inférieure dans le filum terminale (cauda equina).
Chez l'adulte, la moelle épinière commence au bord supérieur de la première vertèbre cervicale et se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. La moelle épinière a une structure segmentaire. Il comporte 31 segments : 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 coccygien. (Parfois, ils disent qu'il y a 31 à 33 segments au total, et dans la région coccygienne, il y en a 1 à 3. Le fait est que les vertèbres coccygiennes sont fusionnées en une seule).
Chaque segment est désigné par la vertèbre près de laquelle émergent ses racines. Mais cela ne signifie pas que chaque segment est situé exactement en face de la vertèbre correspondante. À l’état embryonnaire, la longueur de la moelle épinière est approximativement égale à la longueur de la colonne vertébrale. Mais dans le processus de développement individuel, la colonne vertébrale se développe plus vite que le cerveau. En conséquence, la moelle épinière est plus courte que la colonne vertébrale. Ainsi, dans les parties supérieures de la moelle épinière, les segments correspondent aux vertèbres, et leurs racines y sortent, horizontalement. Dans les parties inférieures, le canal rachidien ne contient plus de matière cérébrale et les segments correspondant aux vertèbres sont situés plus haut. Ainsi, en bas, les racines en forme de faisceau (cauda equina) descendent jusqu'aux foramens intervertébraux puis sortent de la colonne vertébrale.
Des lignes directrices
La moelle épinière est recouverte de trois membranes. Les méninges externes sont appelées dur. La coque du milieu s'appelle arachnoïde. L'espace entre ces coquilles est appelé sous-dural. La coque intérieure s'appelle vasculaire. L'espace entre l'arachnoïde et la choroïde s'appelle sous-arachnoïdien ou sous-arachnoïdien. La choroïde et la membrane arachnoïdienne forment la pie-mère du cerveau. Les espaces entre les membranes sont remplis de liquide céphalo-rachidien (LCR). Les synonymes du LCR sont les noms « liquide céphalo-rachidien » et « liquide céphalo-rachidien ». .
La moelle épinière et le cerveau ont les mêmes membranes et les mêmes espaces de communication entre les membranes. De plus, le canal central de la moelle épinière se poursuit jusqu’au cerveau. En expansion, il forme les ventricules du cerveau - des cavités également remplies de liquide céphalo-rachidien.
Les méninges et le liquide céphalo-rachidien protègent la moelle épinière des dommages mécaniques. Le liquide céphalo-rachidien sert également à protéger chimiquement les tissus cérébraux des effets de substances nocives. Le LCR est formé par filtration du sang artériel dans le plexus choroïde du 4e ventricule et des ventricules latéraux du cerveau, et son écoulement se produit dans le sang veineux dans la région du 4e ventricule. Diverses substances qui passent facilement du tube digestif au sang ne peuvent pas pénétrer aussi facilement dans le liquide céphalo-rachidien, en raison de barrière hémato-encéphalique, qui fonctionne comme un filtre, sélectionnant les substances bénéfiques et « rejetant » les substances nocives pour le système nerveux central.
Questions de contrôle :
1. Décrire la structure longitudinale de la moelle épinière et son emplacement.
2. Quelles membranes entourent la moelle épinière, quelles sont leurs fonctions ?
3. Qu'est-ce que le liquide céphalo-rachidien, où se trouve-t-il et quelles sont ses fonctions ?
4. Quelle est la fonction de la barrière hémato-encéphalique ?
Sujet 5. LE CERVEAU FINAL, LA STRUCTURE ET LA FONCTION
Le télencéphale est anatomiquement constitué de deux hémisphères reliés entre eux par le corps calleux. , arc et commissure antérieure. Chaque hémisphère est fonctionnellement et anatomiquement constitué du cortex et des noyaux sous-corticaux (basaux). Dans l'épaisseur des hémisphères cérébraux se trouvent les cavités des 1er et 2e ventricules cérébraux, qui ont une configuration complexe. Ces ventricules sont également appelés ventricules antérieur (1er) et postérieur (2e) du télencéphale.
Les noyaux sous-corticaux du télencéphale comprennent d'abord trois formations appariées qui font partie du système striopallidal, important dans la régulation des mouvements : le noyau caudé, le globus pallidus , clôture . Le système striopallidal fait partie du système moteur extrapyramidal.
Deuxièmement, le « sous-cortex » comprend le noyau amygdalien et les noyaux du septum pellucidum et d'autres formations. Les fonctions de ces noyaux sont associées à la régulation de formes complexes de comportement et de fonctions mentales, telles que les instincts, les émotions, la motivation, la mémoire.
Le plus souvent, les noyaux sous-corticaux ci-dessus, ou noyaux basaux, c'est-à-dire situés à la base du cortex, comme les fondations d'une maison, sont simplement appelés « sous-cortex ». Mais parfois, le sous-cortex est appelé tout ce qui se trouve en dessous du cortex, mais au-dessus du tronc cérébral, puis le thalamus avec ses appendices y est également inclus.
En général, les structures sous-corticales remplissent des fonctions intégratives.
Dans le cerveau, comme dans la moelle épinière, il existe trois types de substances : gris, blanc Et engrener. En conséquence, le premier est formé par les corps des neurones, le second par les processus myélinisés des neurones rassemblés en faisceaux ordonnés et le troisième par les corps et les processus intercalés s'exécutant dans des directions différentes.
La substance réticulaire, ou formation réticulaire, est située plus au centre. Les corps cellulaires des neurones (matière grise) sont disposés en amas appelés noyaux. Parfois, au lieu du mot « noyaux », le mot nœud ou ganglion est utilisé. Des faisceaux de fibres myélinisées, tout comme dans la moelle épinière, forment des chemins : courts et longs. Il existe deux types de raccourcis : commissuraux et associatifs.
Des lignes directrices
Les nerfs crâniens sont des analogues des nerfs spinaux. Chez l'homme, il existe 12 paires de nerfs crâniens. Ils sont généralement désignés par des chiffres romains et chacun a son propre nom et sa propre fonction.
La fonction des nerfs spinaux est de transmettre les informations des récepteurs situés dans diverses parties du corps au système nerveux central (via les racines dorsales de la moelle épinière) et de transmettre les informations du système nerveux central aux muscles qui effectuent les mouvements du corps. , muscles des organes internes et des glandes (via les racines antérieures de la moelle épinière). Semblables aux nerfs spinaux, les nerfs crâniens transmettent les informations des récepteurs situés dans la tête (organes sensoriels) au tronc cérébral et transmettent les informations des centres cérébraux aux muscles et glandes situés dans la tête.
Il existe une autre analogie. Les nerfs spinaux qui contrôlent les muscles squelettiques du corps sont influencés par les centres moteurs supérieurs du cerveau. De la même manière, les nerfs crâniens qui contrôlent les muscles squelettiques de la tête sont soumis à l'influence des zones motrices corticales, grâce auxquelles sont possibles des mouvements volontaires de la langue, du nez, des oreilles, des yeux, des paupières, etc.
Ainsi, les nerfs crâniens sont des nerfs périphériques non liés au système nerveux central. Cela semble incroyable, mais c’est exactement comme ça. C’est juste que dans la région de la tête, tout – le centre (cerveau) et la périphérie (récepteurs et nerfs crâniens) sont géographiquement proches les uns des autres. C'est pour cette raison que la segmentation claire observée dans les nerfs spinaux est perturbée lorsque les racines sensorielles des nerfs sont situées strictement sur la surface postérieure et que les racines motrices se trouvent sur la surface antérieure de la moelle épinière. De plus, certains nerfs crâniens possèdent généralement soit uniquement une branche sensorielle (nerf optique), soit uniquement une branche motrice (nerf oculomoteur).
Vers les organes (muscles, glandes) situés à l'extérieur du crâne, ainsi qu'aux récepteurs situés à l'extérieur du crâne, les nerfs crâniens traversent certaines ouvertures du crâne : ouvertures jugulaire, occipitale, temporale et ethmoïde.
Formation réticulaire(RF) – la substance réticulaire est un ensemble de cellules nerveuses qui forment un réseau de processus densément entrelacés s’étendant dans différentes directions. La formation réticulaire est située dans la partie centrale du tronc cérébral et dans des inclusions distinctes du diencéphale. Les cellules RF ne sont pas directement connectées aux voies ascendantes allant des récepteurs au cortex. Mais toutes les voies sensorielles montant vers le cortex envoient leurs branches vers le RF. Cela signifie que le RF reçoit le même nombre d'impulsions que les centres de niveau supérieur, même s'il ne les distingue pas « par origine ». Mais grâce à eux, un niveau d’excitation constamment élevé dans les cellules RF est maintenu. De plus, l’excitation du RF dépend de la concentration de produits chimiques (facteurs humoraux) dans le LCR. Ainsi, le RF sert d’accumulateur d’énergie, qu’il dirige principalement vers l’augmentation de l’activité, c’est-à-dire le niveau d’éveil, du cortex. Cependant, les RF ont également un effet activateur dans le sens descendant : contrôlant les réflexes de la moelle épinière à travers les voies réticulospinales, modifiant l'activité des motoneurones alpha et gamma de la moelle épinière.
Questions de contrôle :
1. Décrire la structure et l'emplacement du télencéphale.
2. Nommez trois types de substances qui composent le cerveau.
3. Décrire la structure et l'emplacement de la formation réticulaire.
4. Quelles sont les fonctions de la formation réticulaire ?
Thème 6. CENTRES AUTOMOBILES
Toutes les fonctions motrices (ou simplement les mouvements) peuvent être divisées en deux types : intentionnelles et posnotoniques.
Mouvements ciblés– ce sont des mouvements visant un objectif associé au mouvement dans l'espace ; ce sont des mouvements de travail associés au besoin de prendre, soulever, tenir, lâcher quelque chose, etc. Ce sont aussi divers mouvements manipulateurs qu'une personne apprend tout au long de sa vie. Il s'agit essentiellement de mouvements bénévoles. Bien que le réflexe de flexion protecteur puisse également être appelé dirigé vers un but, puisqu'il vise à interrompre le contact avec un stimulus douloureux.
Mouvements postnotoniques, ou posturales, fournissent une position dans l'espace habituelle pour un organisme donné, c'est-à-dire dans le champ gravitationnel de la Terre. Pour les humains, il s'agit d'une position verticale. Les mouvements posturaux sont basés sur des réactions réflexes innées. Le nom « postural » vient de mot anglais "posture" ce qui signifie « pose, figure ».
Les structures du système nerveux central responsables de la régulation nerveuse des fonctions motrices sont appelées centres moteurs. Ils sont localisés dans diverses parties du système nerveux central.
Les centres moteurs qui régulent les mouvements posturaux sont concentrés dans les structures du tronc cérébral. Les centres moteurs qui contrôlent les mouvements ciblés sont situés plus niveaux élevés cerveau - dans les hémisphères cérébraux : centres sous-corticaux et corticaux.
Des lignes directrices
Le tronc cérébral comprend la moelle allongée, une partie du cerveau postérieur et le mésencéphale. Au niveau de la moelle allongée se trouvent les centres moteurs suivants : noyaux vestibulaires et formation réticulaire. Noyaux vestibulaires recevoir des informations des récepteurs d’équilibre situés dans le vestibule de l’oreille interne , et conformément à cela, des signaux excitateurs sont envoyés à la moelle épinière le long du tractus vestibulospinal. Les impulsions sont destinées aux muscles extenseurs du torse et des membres, grâce au travail desquels une personne qui a glissé ou trébuché est capable de réagir immédiatement : se redresser, retrouver un appui, c'est-à-dire retrouver son équilibre. Depuis formation réticulaire La moelle oblongate commence également le tractus réticulospinal latéral, qui innerve les muscles fléchisseurs situés au maximum du tronc et des membres.
Fonction motrice principale de la moelle allongée–maintenir l'équilibre automatiquement, sans la participation de la conscience.
Le pont du cerveau postérieur contient les noyaux du tractus réticulospinal, qui excite les motoneurones des extenseurs. Cela signifie que ces centres et les centres vestibulospinaux agissent « en même temps ».
Dans le mésencéphale, plusieurs centres nerveux sont liés à la régulation des mouvements : le noyau rouge, le toit du cerveau, ou encore le quadrijumeau, la substance noire. , ainsi que la formation réticulaire.
Depuis noyau rouge le tractus rubrospinal commence. Grâce aux impulsions transmises le long de ce chemin, la posture du corps est régulée, pour laquelle le noyau rouge est crédité du rôle de principal mécanisme anti-gravité. Le noyau rouge augmente le tonus des fléchisseurs des membres supérieurs et assure la coordination des différents groupes musculaires (c'est ce qu'on appelle la synergie) lors de la marche, du saut et de l'escalade. Cependant, le noyau rouge lui-même est constamment sous le contrôle de centres plus élevés par rapport à lui - les noyaux sous-corticaux ou basaux.
Quatre collines se compose des colliculi supérieur et inférieur, qui sont à la fois non seulement des centres moteurs, mais aussi les centres primaires de la vision (colliculus supérieur) et de l'audition (colliculus inférieur). À partir d'eux commencent les voies tectospinales, le long desquelles, conformément aux informations visuelles et auditives, une commande est transmise pour tourner le cou ou les yeux et les oreilles en direction d'un stimulus perçu nouveau pour une situation donnée. Cette réaction est appelée réflexe d’orientation ou réflexe « qu’est-ce que c’est ? ».
Substance noire a des connexions synaptiques avec les noyaux sous-corticaux basaux. Le transmetteur au niveau de ces synapses est la dopamine. Avec son aide, la substance noire a un effet stimulant sur les noyaux gris centraux.
Voie réticulospinale, à partir de la formation réticulaire du mésencéphale, a un effet excitant sur les motoneurones gamma de tous les muscles du tronc et des membres proximaux.
Cervelet, comme les centres moteurs du tronc cérébral, assure le tonus des muscles squelettiques, la régulation des fonctions posturales, la coordination des mouvements posturaux avec des mouvements ciblés. Le cervelet a des connexions bilatérales avec le cortex cérébral et est donc un correcteur de tous types de mouvements. Il calcule l'amplitude et la trajectoire des mouvements.
À ganglions de la base, ou noyaux, comprennent plusieurs structures sous-corticales : le noyau caudé, la clôture et le globus pallidus. Un autre nom pour ce complexe est le système striopallidal. Ce système fait partie d’un système moteur encore plus complexe : l’extrapyramidal. Les noyaux gris centraux remplissent principalement les fonctions de contrôle des mouvements rythmiques et des automatismes anciens (marche, course, natation, saut). Ils fournissent également un arrière-plan qui facilite les mouvements spécialisés et fournit également des mouvements d'accompagnement.
Les centres moteurs supérieurs sont situés dans le néocortex des hémisphères cérébraux. Les centres moteurs du cortex ont une localisation spécifique : ce sont gyrus précétral, situé en avant de la fissure centrale de Rolland. Leur localisation a été établie expérimentalement par stimulation électrique de différents points de la zone motrice. Lorsque certains points étaient stimulés, des mouvements du membre controlatéral étaient obtenus. Selon idées modernes, dans le cortex, ce ne sont pas des muscles individuels qui sont représentés, mais des mouvements entiers exécutés par des muscles. regroupement autour d’une articulation spécifique. Le cortex moteur lui-même contient des motoneurones. ordre supérieur", ou neurones de commande, qui mettent en action différents muscles. Cette zone motrice est appelée zone motrice primaire. À côté se trouve la zone motrice secondaire, appelée prémoteur. Ses fonctions sont associées à la régulation des fonctions motrices, qui ont nature sociale, comme écrire et parler. C’est de là, de ces aires motrices, que proviennent les deux voies pyramidales descendantes.
Les centres moteurs supérieurs sont situés à côté des centres sensoriels supérieurs, qui sont situés dans gyrus postcentral. Espaces sensoriels(zones) reçoivent des informations des récepteurs cutanés et des propriocepteurs situés sur toutes les parties du corps. Ici, à l’instar des zones motrices, toutes les zones du corps et du visage sont représentées. Par conséquent, la région postcentrale du cortex est appelée somatosensoriel. Cependant, la taille des représentations ne dépend pas de la taille de la partie du corps elle-même, mais de l'importance des informations qui en proviennent. Ainsi, la représentation du torse et du membre inférieur est relativement petite, mais celle de la main est immense.
Il a été démontré que les zones motrices et sensorielles se chevauchent partiellement, c'est pourquoi les deux zones sont appelées le même mot - la zone sensorimotrice.
Questions de contrôle :
1. Comment les mouvements sont-ils classés ?
2. Nommez le tronc cérébral et les centres moteurs sous-corticaux.
3. Quelles sont les fonctions du noyau rouge ?
4. Quelles sont les fonctions de la région quadrijumeau ?
5. Quelles sont les fonctions de la substance noire ?
6. Quelles sont les fonctions des noyaux gris centraux ?
7. Indiquez l'emplacement et nommez les fonctions des centres sensorimoteurs.
Thème 7. SYSTÈME NERVEUX AUTONOMIQUE
Le système nerveux est généralement divisé en système somatique et autonome. Aux tâches système somatique comprend la réponse aux signaux externes et, conformément aux données des sens, la réalisation de réactions motrices. Par exemple, la tâche consistant à éviter la source d’influences désagréables et néfastes et à s’approcher des sources d’influences agréables et bénéfiques.
Le nom système nerveux somatique vient du mot « soma », qui signifie « corps » en latin. Non seulement la cellule, mais aussi notre micro-organisme a un corps - c'est toute notre membrane musculaire, constituée de muscles squelettiques (muscles striés), grâce à laquelle le corps est capable de produire des mouvements.
Des lignes directrices
Système nerveux autonome(système nerveux autonome, système nerveux viscéral) - une section du système nerveux qui régule l'activité des organes internes, des glandes endocrines et exocrines, des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le système nerveux autonome régule l'état de l'environnement interne du corps, contrôle le métabolisme et les fonctions associées de respiration, de circulation sanguine, de digestion, d'excrétion et de reproduction. L’activité du système nerveux autonome est principalement involontaire et n’est pas directement contrôlée par la conscience. Les principaux organes effecteurs du système autonome sont les muscles lisses des organes internes, les vaisseaux sanguins et les glandes.
Végétatif Et somatique certaines parties du système nerveux agissent de manière coopérative. Leurs structures neuronales ne peuvent pas être complètement séparées les unes des autres. Cette division est donc analytique, puisque les réactions du corps à divers stimuli impliquent simultanément et les muscles squelettiques, et les organes internes (ne serait-ce que parce qu’ils assurent la fonction musculaire).
Les systèmes végétatif et somatique présentent les différences suivantes : dans l'emplacement de leurs centres ; dans la structure de leurs parties périphériques ; dans les caractéristiques des fibres nerveuses ; en fonction de la conscience.
Il existe deux divisions fonctionnelles du système nerveux autonome : segmentaire-périphérique, assurant l'innervation autonome des segments individuels du corps et des organes internes associés, et central (suprasegmentaire), qui réalise l'intégration, l'unification de tous les appareils segmentaires, la subordination de leurs activités aux tâches fonctionnelles générales de l'organisme tout entier.
Au niveau segmentaire-périphérique du système nerveux autonome, il existe deux parties relativement indépendantes - sympathique et parasympathique, dont l'activité coordonnée assure une régulation fine des fonctions des organes internes et du métabolisme. Parfois, l'influence de ces parties ou systèmes sur un organe a un effet opposé, et une augmentation de l'activité d'un système s'accompagne d'une inhibition de l'activité d'un autre. Dans la régulation de certaines autres fonctions, les deux systèmes agissent de manière unidirectionnelle.
Sympathique Les centres spinaux segmentaires sont situés dans les cornes latérales de la moelle épinière thoracique et lombaire. Des cellules de ces centres naissent des fibres végétatives qui se dirigent vers les ganglions sympathiques ou ganglions autonomes (fibres préganglionnaires). Les ganglions sont situés en chaînes des deux côtés de la colonne vertébrale, constituant ce qu'on appelle les troncs sympathiques, dans lesquels se trouvent 2 à 3 nœuds cervicaux, 10 à 12 nœuds thoraciques, 4 à 5 nœuds lombaires et 4 à 5 nœuds sacrés. Les troncs droit et gauche au niveau de la première vertèbre coccygienne sont reliés et forment une boucle au milieu de laquelle se trouve un nœud coccygien non apparié. Les fibres postganglionnaires partent des nœuds et se dirigent vers les organes innervés. Certaines des fibres préganglionnaires, sans interruption dans les ganglions des troncs sympathiques, atteignent les plexus autonomes coeliaques et mésentériques inférieurs, à partir des cellules nerveuses desquelles les fibres postganglionnaires s'étendent jusqu'à l'organe innervé.
Parasympathique les centres nerveux sont situés dans les noyaux autonomes du tronc cérébral, ainsi que dans la partie sacrée de la moelle épinière, où commencent les fibres préganglionnaires parasympathiques ; ces fibres se terminent dans les nœuds végétatifs situés dans la paroi de l'organe de travail ou à proximité immédiate de celui-ci, et donc les fibres postganglionnaires de ce système sont extrêmement courtes. Les fibres parasympathiques passent des centres autonomes situés dans le tronc cérébral et font partie des nerfs oculomoteurs, faciaux, glossopharyngés et vagues. Ils innervent les muscles lisses de l'œil (à l'exception du muscle dilatateur, qui reçoit l'innervation de la partie sympathique du système nerveux autonome), les glandes lacrymales et salivaires, ainsi que les vaisseaux et organes internes des cavités thoracique et abdominale. Le centre parasympathique sacré assure l'innervation autonome segmentaire de la vessie, du côlon sigmoïde, du rectum et des organes génitaux.
L'activité accrue du système nerveux sympathique s'accompagne d'une dilatation de la pupille, d'une augmentation de la fréquence cardiaque et d'une augmentation de la pression artérielle, d'une dilatation des petites bronches, d'une diminution de la motilité intestinale et d'une contraction des sphincters de la vessie et du rectum. L'activité accrue du système parasympathique se caractérise par une constriction de la pupille, un ralentissement des contractions cardiaques, une diminution de la pression artérielle, des spasmes des petites bronches, une augmentation de la motilité intestinale et un relâchement des sphincters de la vessie et du rectum. La cohérence des influences physiologiques de ces systèmes garantit homéostasie– état physiologique harmonieux des organes et du corps dans son ensemble à un niveau optimal.
L'activité des formations segmentaires-périphériques sympathiques et parasympathiques est sous contrôle appareil autonome suprasegmentaire central, qui comprennent les centres souches respiratoires et vasomoteurs, la région hypothalamique et le système limbique du cerveau. En cas de défaite respiratoire Et centres de tiges vasomotrices des problèmes respiratoires et cardiaques surviennent. Noyaux région hypothalamique réguler l'activité cardiovasculaire, la température corporelle, le travail tube digestif, miction, fonction sexuelle, tous types de métabolisme, système endocrinien, sommeil, etc. Les noyaux de la région hypothalamique antérieure sont principalement associés à la fonction du système parasympathique, et celui postérieur à la fonction du système sympathique. Système limbique participe non seulement à la régulation de l'activité des fonctions autonomes, mais détermine en grande partie le « profil » autonome de l'individu, son contexte émotionnel et comportemental général, ses performances et sa mémoire, assurant une relation fonctionnelle étroite entre les systèmes somatiques et autonomes.
Limbique le système est une association fonctionnelle de structures cérébrales impliquées dans l'organisation du comportement émotionnel et motivationnel, tel que les instincts alimentaires, sexuels et défensifs. Ce système participe à l’organisation du cycle veille-sommeil.
Questions de contrôle :
1. Quelles sont les tâches du système nerveux somatique ?
2. Quelles sont les tâches du système nerveux autonome ?
3. Nommez les principales différences entre les parties somatiques et autonomes du système nerveux.
4. Qu'est-ce que le système nerveux simatique ?
5. Comment se manifeste l'augmentation de l'activité du système nerveux sympathique ?
6. Qu'est-ce que le système nerveux parasitaire ?
7. Comment se manifeste l'augmentation de l'activité du système nerveux parasympathique ?
8. Qu'est-ce que l'homéostasie ?
9. Quels centres contrôlent l'activité du système sympathique, et lesquels – le parasympathique ?
10. Est-il vrai que les parties somatiques et autonomes du système nerveux agissent de manière totalement indépendante les unes des autres ? Justifiez votre réponse.
Thème 8. SYSTÈME NEUROENDOCRINIEN
Endocrinien, ou selon les données modernes, système neuroendocrinien régule et coordonne l'activité de tous les organes et systèmes, assurant l'adaptation du corps aux facteurs en constante évolution de l'environnement externe et interne, ce qui entraîne la préservation de l'homéostasie, qui, comme on le sait, est nécessaire au maintien du fonctionnement normal du corps. Ces dernières années, il a été clairement démontré que le système neuroendocrinien remplit les fonctions énumérées en étroite interaction avec le système immunitaire.
Des lignes directrices
Le système endocrinien est représenté glandes endocrines, responsable de la formation et de la libération de diverses hormones dans le sang.
Il a été établi que le système nerveux central (SNC) participe à la régulation de la sécrétion d'hormones de toutes les glandes endocrines et que les hormones, à leur tour, influencent le fonctionnement du SNC, modifiant son activité et son état. La régulation nerveuse des fonctions endocriniennes de l’organisme s’effectue à la fois par des hormones hypophysiotropes (hypothalamiques) et par l’influence du système nerveux autonome (autonomique). D’ailleurs, dans divers domaines Le système nerveux central sécrète une quantité suffisante de monoamines et d'hormones peptidiques, dont beaucoup sont également sécrétées dans les cellules endocrines du tractus gastro-intestinal.
Fonction endocrinienne du corps fournir des systèmes qui comprennent : des glandes endocrines qui sécrètent des hormones ; les hormones et leurs voies de transport, les organes correspondants ou les tissus cibles qui répondent à l'action des hormones et sont fournis par des mécanismes récepteurs et post-récepteurs normaux.
Le système endocrinien du corps dans son ensemble maintient la constance de l'environnement interne nécessaire au déroulement normal des processus physiologiques. De plus, le système endocrinien, ainsi que les systèmes nerveux et immunitaire, assurent la fonction de reproduction, la croissance et le développement de l'organisme, la formation, l'utilisation et le stockage (« en réserve » sous forme de glycogène ou de tissu adipeux) de l'énergie.
Mécanisme d'action des hormones
Hormone- c'est biologique substance active. Il s’agit d’un signal informatif chimique qui peut provoquer des changements rapides dans la cellule. L'hormone, comme d'autres signaux informatifs, est liée aux récepteurs de la membrane cellulaire. Mais contrairement aux signaux qui ouvrent les canaux ioniques dans la membrane, l’hormone « active » la chaîne (cascade) réactions chimiques, qui commencent sur la surface supérieure de la membrane, se poursuivent sur sa surface interne et se terminent profondément à l'intérieur de la cellule. L'un des maillons de cette chaîne de réactions sont les soi-disant seconds messagers. Deuxièmes intermédiaires- Ce sont des « amplificateurs biologiques » des processus biochimiques. Dans tous les organismes vivants, des humains aux organismes unicellulaires, seuls deux seconds messagers sont connus : l’acide adénosine monophosphorique cyclique (CAMP) et l’inositol triphosphate (IF-3). Les seconds médiateurs incluent également le calcium (Ca). Ainsi, le deuxième messager est un intermédiaire dans la transmission d'un signal informatif de l'hormone à systèmes internes cellules. ( Les premiers intermédiaires- ce sont des médiateurs synaptiques que nous connaissons).
Dans la vie des animaux et des humains, une condition survient de temps en temps stress psycho-émotionnel. Elle surgit sous l'influence de trois facteurs : l'incertitude de la situation (il est difficile de déterminer la probabilité des événements, il est difficile de prendre une décision), le manque de temps, l'importance de la situation (pour satisfaire la faim ou sauver un vie?).
Stress psycho-émotionnel (stresser) s'accompagne à la fois d'expériences subjectives et de changements physiologiques dans tous les systèmes du corps : cardiovasculaire, musculaire, endocrinien.
Au début du stress, l'hypothalamus, par une voie de conduction nerveuse (système nerveux sympathique, influx nerveux), stimule la libération d'adrénaline (hormone de l'anxiété) par les glandes surrénales. L'adrénaline améliore la nutrition des muscles et du cerveau : transfert des dépôts graisseux vers le sang acide gras(pour nourrir les muscles) et du glycogène hépatique, il transfère le glucose dans le sang (pour nourrir le cerveau). Mais cela n'est énergétiquement pas bénéfique pour le corps lorsque stress à long terme, car le muscle peut « manger » du glucose sans le laisser au cerveau.
Par conséquent, au stade suivant du stress, l'hypophyse libère de l'ACTH (hormone adrénocorticotrope) et stimule la libération de cortisol par le cortex surrénalien. Le cortisol interfère avec l'absorption du glucose dans les tissus musculaires. De plus, le cortisol active la conversion des protéines en glucose. Ceci est important car les réserves de glycogène sont faibles. Mais d’où viennent les protéines ? (Rappelez-vous qu'en période de stress, tous les processus de digestion sont inhibés). Il y en a beaucoup dans le corps protéine structurelle- Toutes les cellules sont constituées de protéines. Mais si vous le transférez en « carburant », c’est-à-dire le transformez en glucose, vous pouvez alors détruire tout le corps. Par conséquent, les protéines proviennent des tissus du corps qui se renouvellent rapidement et dont on peut se passer temporairement. Ce tissu est constitué de lymphocytes, c'est-à-dire de cellules protectrices de l'organisme, dont les protéines sont transformées en glucose. Mais une telle évasion du stress a des effets secondaires négatifs, à savoir qu'après un stress prolongé, il est facile d'attraper des rhumes et maladies virales... Le cortisol inhibe l'activité des centres « sexuels » de l'hypothalamus. Par conséquent, en cas de stress prolongé (émotions négatives), les femmes subissent des irrégularités menstruelles et les hommes subissent une puissance sexuelle altérée.
Questions de contrôle :
1. De quels processus le système neuroendocrinien est-il responsable ?
2. De quoi est constitué le système neuroendocrinien ?
3. En quels groupes les glandes sont-elles divisées et sur quelle base ?
4. Définir le concept d'« hormone » et décrire le mécanisme d'action des hormones.
5. Nommer les facteurs contribuant à l'émergence d'un état de stress psycho-émotionnel.
6. Décrire le mécanisme hormonal du stress.
Travaux de test
1. Sujet et méthodes de recherche de l'enseignement supérieur activité nerveuse(VND). La doctrine des caractéristiques du RNB chez l'homme et l'animal.
2. Le cerveau humain en tant que système de systèmes. Types d'activité cérébrale. Les principales fonctions du cerveau humain dans le processus de sa phylogenèse.
3. Système nerveux, structure anatomique, sections et types, connexions nerveuses, sources de formation d'énergie pour la transmission de l'information.
4. Structure cérébrale, régions, parties du cerveau : thalamus, hypothalamus, diencéphale, leur topographie, connexions fonctionnelles.
5. Organisation du système nerveux. La structure des neurones, ses fonctions. Connexions neuronales dans la transmission de l'information. Systèmes d'assistance.
6. Le concept de « synapse », sa fonction et son rôle dans la transmission de l'information. Caractéristiques des synapses différents niveaux connexions nerveuses.
7. Cellules gliales au service des neurones, leur rôle et leurs fonctions au service de l'ensemble du système nerveux central. Formation de voies dans la transmission de l'information.
8. Classification des centres nerveux selon leur caractéristiques fonctionnelles. Sections afférentes et efférentes. Ils diffèrent par leurs fonctions de communication.
9. Activité intégrée de la colonne vertébrale et de la moelle allongée. Topographie, structure, fonctions.
10. Activité intégrée du mésencéphale, activité du cervelet. Structure, topographie, connexions neuronales.
11. Activité intégrée du cortex cérébral. Zones frontales, occipitales, pariétales, hémisphères droit et gauche, les principales différences dans leur traitement de l'information.
12. Propriétés physiologiques du système nerveux autonome. Sa participation aux réactions émotionnelles. Divisions sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome.
13. Formation réticulaire, sa topographie, son influence sur l'activité cérébrale, sa connexion avec d'autres zones du cerveau. Rôle de contrôle dans le transfert d’informations.
14. Conduite excitation nerveuse dans l'organisme. Les propriétés des fibres nerveuses dans la conduction et la transmission de l'information, l'organisation systémique des voies. Voies conductrices du cerveau et de la moelle épinière.
15. Caractéristiques et conditions qui forment la transmission synaptique de l'information, les étapes et les mécanismes de la transmission synaptique. Caractéristiques des connexions synaptiques du cerveau, de la moelle épinière et du système viscéral.
16. Principes fondamentaux de la théorie de l'activité réflexe. Réflexes conditionnés et inconditionnés (innés). Différence entre réflexes conditionnés et inconditionnés.
17. Traitement de l'information dans le système nerveux central. Le concept de « système sensoriel ». La structure des connexions qui forment les systèmes sensoriels.
18. Conversion et transmission des signaux au système sensoriel. Sensibilité du récepteur. Codage des stimuli dans le système sensoriel.
19. La structure de l'analyseur visuel, ses caractéristiques physiologiques. Voies de transmission des informations visuelles aux centres cérébraux.
20. Réflexes visuels : hébergement, photoréception. Caractéristiques de la structure de la rétine. Caractéristiques des photorécepteurs.
21. Voies visuelles centrales. Activité du cortex visuel. Technologie de formation et de transmission d'informations visuelles. Réaction du cortex au drainage visuel.
22. Anatomie et physiologie des organes auditifs. Système auditif. Voies auditives centrales. Caractéristiques des neurones qui forment les perceptions sonores.
23. Système vestibulaire (appareil d'équilibre). Caractéristiques des cellules ciliées dans l'appareil d'équilibre. Système conducteur et centres d’équilibre dans le cortex.
24. Principes généraux fonctionnement de l'organisme : corrélation, régulation, autorégulation, activité réflexe.
25. Systèmes fonctionnels. Théorie générale systèmes Les concepts de « systégenèse », de « quantification du système ». Développement de systèmes en phylogenèse.
26. Régulation nerveuse des fonctions des organes internes. Régulation hormonale des fonctions physiologiques. Causes des troubles de la régulation hormonale.
27. Physiologie de l'activité motrice. Concepts, définitions. Caractéristiques de l'activité motrice dans des conditions de facteurs irritants changeants. Le rôle des facteurs motivants dans la mise en œuvre de l'activité, le phénomène d'efférentation.
28. « Cortex moteur », ses fonctions, topographie. Classement des mouvements. Mouvements d’orientation et de manipulation. Voies nerveuses dans la formation des réactions motrices.
29. Mécanismes d'initiation des actes moteurs. Cerveau émotionnel et cognitif, rôle dans les réactions efférentes.
30. Thermorégulation du corps. Concepts de base. La réponse du corps à la température extérieure. L'influence de la température sur le corps humain. Régulateurs de réactions de température.
31. Mécanismes systémiques de régulation de la température corporelle. Caractéristiques individuelles des réactions aux conditions de température. Fluctuations quotidiennes de la température corporelle.
32. Localisation, caractéristiques, propriétés des thermostats. Génération de chaleur et transfert de chaleur dans diverses conditions du corps. Neurorégulation de la chaleur.
33. Fluides corporels. Fonctions de l'eau dans le corps humain. Fonctions biologiques de l'eau. Les principaux « dépôts d’eau » du corps.
34. Méthodes de détermination des milieux liquides dans le corps. Composition électrolytique des milieux liquides. Sources d'entrée et voies de libération de l'eau et des électrolytes.
35. Le sang comme principal milieu liquide. Organes hématopoïétiques et processus de destruction des éléments sanguins. Composition sanguine, principaux dépôts. Le volume sanguin « de travail » est normal.
36. Coagulation sanguine, mécanismes d'hémostase. Fibrinolyse (dissolution) du sang. Causes et ses conséquences.
37. Fluides transcellulaires (intercellulaires), composition, fonctions. Le rôle du liquide intercellulaire pour assurer une turgescence optimale du corps humain.
38. Pression osmotique des tissus et organes (osmolalité), tonicité des solutions. Causes des troubles de la pression osmotique, conséquences pour l'organisme.
39. Métabolisme et énergie dans le corps. Types de métabolisme, étapes, phénomènes d'anabolisme et de catabolisme. Troubles métaboliques et leurs conséquences sur l'organisme.
40. Métabolisme minéral dans le corps, composition ionique liquides. Le rôle physiologique du potassium, du calcium, du magnésium et d'autres éléments dans le métabolisme minéral. Conséquences des troubles du métabolisme minéral.
41. Métabolisme des graisses, leur rôle biologique, capacité thermique, participation au métabolisme. Valeur énergétique des graisses. Dépôts de graisse.
42. Métabolisme des glucides, mécanisme d'absorption, rôle dans le maintien de la vie, produits de l'oxydation des glucides, coût énergétique. Conséquences d'un dépôt excessif de glucides.
44. Thermodynamique des systèmes vivants. Facteurs influençant la formation, l'accumulation et la consommation d'énergie thermique. Efficacité d'une cellule vivante. Limites de chaleur dans divers tissus du corps.
45. Consommation de chaleur dans le corps. Métabolisme de base et dépense énergétique. L'influence des activités sur la dépense énergétique. Limites acceptables de surchauffe et d'hypothermie des tissus et des organes.
46. Asymétrie fonctionnelle du cerveau. Types d'asymétrie par nature de manifestation, asymétries fonctionnelles. Le rôle de l'asymétrie dans la formation des fonctions individuelles.
47. Asymétrie morphologique des hémisphères cérébraux. Formes d'activité conjointe des hémisphères : intégration de l'information, fonctions de contrôle, transfert interhémisphérique d'information.
48. Gaucher et droitier dans l'activité cérébrale. Origine de la gaucherie. Types de gauchers. Caractéristiques liées à l'âge de la formation de la gaucherie.
49. Blocs de traitement de l'information dans le système nerveux central. Formation des blocs, leurs structures, véritables centres nerveux, leurs connexions « supports » dans le traitement de l'information.
50. Les récepteurs comme principaux « récepteurs » d'informations provenant des environnements externe et interne. Systèmes de transmission d'informations qui reçoivent des récepteurs. Niveaux de réception par fonction.
51. La notion d'« analyseurs ». Leurs fonctions, spécificité. Connexions entre analyseurs. Le principe de « divergence » et de « convergence » pour soutenir l’adoption d’actions spécifiques en réponse à l’influence d’un stimulus.
52. Centres de niveau du cortex cérébral. Zone primaire, secondaire et tertiaire du cortex. Caractéristiques fonctionnelles de chacune de ces zones.
53. Blocage de la régulation du tonus et de l'éveil dans le cortex en tant que système de modélisation du cerveau. Les fonctions remplies par ce bloc, la connexion avec la formation réticulaire en tant que système de contrôle.
54. Bloc de programmation, de régulation et de contrôle des formes complexes d'activité. Fonctions de l'analyseur moteur, zones du cortex moteur. Réseau neuronal analyseurs de moteurs.
55. Organisation fonctionnelle du cortex moteur. Voies motrices du cerveau (voie pyramidale). Formation de programmes moteurs pour le transfert d'informations.
56. Structure de la colonne vertébrale. Départements, quantité et qualité des vertèbres. La taille transversale des différentes parties des vertèbres. « Coiffer » et protéger la moelle épinière des dommages.
57. Structures et fonctions de la moelle épinière : topographie, structure, dimensions. Noyaux nerveux de la moelle épinière, voies nerveuses afférentes et efférentes.
58. Matière blanche et grise de la moelle épinière. Fonctions de sections individuelles de la matière grise de la moelle épinière. Nerfs spinaux, leurs fonctions, topographie des troncs nerveux, leurs « aires de service ».
59. Médulla oblongate. Structure interne, fonctions. Caractéristiques et fonctions des noyaux et des nerfs sortants. La structure des informations qu’ils traitent.
60. Cerveau postérieur. Structure (pont, cervelet). Nerfs sortants, noyaux, leur rôle dans la perception et le traitement de l'information, « fonction de contrôle ».
61. Mésencéphale et diencéphale. Structure et fonctions du thalamus (thalamus visuel). Les neurones nucléaires comme centres de stockage et de traitement de l'information.
62. Télencéphale. Cortex cérébral, lobes corticaux, hémisphères droit et gauche, sillons. Le rôle du corps calleux dans l'activité fonctionnelle du cortex cérébral.
LITTÉRATURE
1. Anatomie. Physiologie. Psychologie humaine : un bref dictionnaire illustré / éd. acad. . – Saint-Pétersbourg. : Pierre, 2001. – 256 p.
2. Anatomie humaine. En 2 heures Partie 2 / éd. . – M. : Médecine, 1993. – 549 p.
3. Anokhin et la neurophysiologie du réflexe conditionné /. – M. : Médecine, 1968. – 547 p.
4. Danilova, : manuel. pour les universités/ . – M. : Aspect-Presse. 2002. – 373 p.
5. Pribram, K. Langages du cerveau / K. Pribram. – M. : Progrès, 1975. – 464 p.
6. Sokolov et le réflexe conditionné. Un nouveau look / . – M. : Institut Psychologique et Social de Moscou. 2003. – 287 p.
7. Physiologie. Fondamentaux et systèmes fonctionnels : un cours magistral / éd. . – M. : « Sciences », 2000. – 784 p.
Plan sacré 2011, pos. 19
Édition pédagogique
Parkhomenko Daria Alexandrovna
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Boîte à outils
pour les étudiants de spécialité 1 – « Ingénierie et accompagnement psychologique des technologies de l’information »
cours par correspondance
Éditeur
Correcteur
Signé pour l'impression Format 60x84 /16 Papier offset
Caractère "Times" Imprimé sur un risographe Cond. four l.
Éd. académique. l. 1.6 Tirage 100 Commande 48
Editeur et imprimeur :
Établissement d'enseignement
Système nerveux central (SNC)- la partie principale du système nerveux des animaux et des humains, constituée d'un ensemble de cellules nerveuses (neurones) et de leurs processus.
Le système nerveux central est constitué du cerveau et de la moelle épinière ainsi que de leurs membranes protectrices. La partie la plus externe est la dure-mère, en dessous se trouve l'arachnoïde (arachnoïde), puis la pie-mère, fusionnée avec la surface du cerveau. Entre la pie-mère et la membrane arachnoïdienne se trouve l'espace sous-arachnoïdien, qui contient le liquide céphalo-rachidien, dans lequel flottent littéralement le cerveau et la moelle épinière. L'action de la force de poussée du fluide fait que, par exemple, le cerveau adulte, qui a une masse moyenne de 1 500 g, pèse en réalité entre 50 et 100 g à l'intérieur du crâne. Les méninges et le liquide céphalo-rachidien jouent également le rôle d'amortisseurs, adoucissant toutes sortes de chocs et de chocs qui mettent à rude épreuve le corps et qui pourraient entraîner des dommages au système nerveux.
Le système nerveux central est constitué de matière grise et blanche. La matière grise est composée de corps cellulaires, de dendrites et d'axones non myélinisés, organisés en complexes comprenant d'innombrables synapses et servant de centres de traitement de l'information pour de nombreuses fonctions du système nerveux. La matière blanche est constituée d'axones myélinisés et non myélinisés qui agissent comme des conducteurs transmettant les impulsions d'un centre à un autre. La substance grise et blanche contient également des cellules gliales. Les neurones du système nerveux central forment de nombreux circuits qui remplissent deux fonctions principales : ils assurent une activité réflexe et traitement complexe informations dans des groupes de réflexion supérieurs. Ces centres supérieurs, tels que le cortex visuel (cortex visuel), reçoivent les informations entrantes, les traitent et transmettent un signal de réponse le long des axones.
Le résultat de l'activité du système nerveux est l'une ou l'autre activité basée sur la contraction ou le relâchement des muscles ou la sécrétion ou l'arrêt de la sécrétion des glandes. C'est au travail des muscles et des glandes que toute façon de nous exprimer est liée. Les informations sensorielles entrantes sont traitées à travers une séquence de centres reliés par de longs axones qui forment des voies spécifiques, par exemple douloureuses, visuelles, auditives. Les voies sensorielles (ascendantes) vont dans une direction ascendante vers les centres du cerveau. Les voies motrices (descendantes) relient le cerveau aux motoneurones des nerfs crâniens et spinaux. Les voies sont généralement organisées de telle manière que les informations (par exemple, douloureuses ou tactiles) provenant du côté droit du corps pénètrent dans le côté gauche du cerveau et vice versa. Cette règle s'applique également aux voies motrices descendantes : la moitié droite du cerveau contrôle les mouvements de la moitié gauche du corps, et la moitié gauche contrôle les mouvements de la droite. De ceci règle générale il existe cependant quelques exceptions.
Se compose de trois structures principales : les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral.
Les hémisphères cérébraux – la plus grande partie du cerveau – contiennent des centres nerveux supérieurs qui constituent la base de la conscience, de l’intelligence, de la personnalité, de la parole et de la compréhension. Dans chacun des hémisphères cérébraux, on distingue les formations suivantes : des accumulations isolées sous-jacentes (noyaux) de matière grise, qui contiennent de nombreux centres importants ; une grande masse de matière blanche située au-dessus d'eux ; recouvrant l’extérieur des hémisphères se trouve une épaisse couche de matière grise avec de nombreuses circonvolutions qui constitue le cortex cérébral.
Le cervelet est également constitué d'une matière grise sous-jacente, d'une masse intermédiaire de matière blanche et d'une couche externe épaisse de matière grise qui forme de nombreuses circonvolutions. Le cervelet assure principalement la coordination des mouvements.
Le tronc cérébral est formé d’une masse de matière grise et blanche qui n’est pas divisée en couches. Le tronc est étroitement lié aux hémisphères cérébraux, au cervelet et à la moelle épinière et contient de nombreux centres de voies sensorielles et motrices. Les deux premières paires de nerfs crâniens proviennent des hémisphères cérébraux, tandis que les dix paires restantes proviennent du tronc. Le tronc régule les fonctions vitales comme la respiration et la circulation sanguine.
Située à l’intérieur de la colonne vertébrale et protégée par son tissu osseux, la moelle épinière a une forme cylindrique et est recouverte de trois membranes. En coupe transversale, la matière grise a la forme d’une lettre H ou d’un papillon. La matière grise est entourée de matière blanche. Les fibres sensibles des nerfs spinaux se terminent dans les parties dorsales (postérieures) de la matière grise - les cornes dorsales (aux extrémités du H, face au dos). Les corps des motoneurones des nerfs spinaux sont situés dans les parties ventrales (antérieures) de la matière grise - les cornes antérieures (aux extrémités du H, éloignées de l'arrière). Dans la substance blanche, il existe des voies sensorielles ascendantes aboutissant à la matière grise de la moelle épinière, et des voies motrices descendantes venant de la matière grise. De plus, de nombreuses fibres de la substance blanche relient différentes parties de la matière grise de la moelle épinière.

Accueil et spécifique fonction du système nerveux central- mise en œuvre de réactions réflexives simples et complexes très différenciées, appelées réflexes. Chez les animaux supérieurs et les humains, les sections inférieures et moyennes du système nerveux central - la moelle épinière, le bulbe rachidien, le mésencéphale, le diencéphale et le cervelet - régulent l'activité des organes et systèmes individuels d'un organisme hautement développé, assurent la communication et l'interaction entre eux, assurent l'unité de l'organisme et l'intégrité de ses activités. La partie supérieure du système nerveux central - le cortex cérébral et les formations sous-corticales les plus proches - régule principalement la connexion et la relation du corps dans son ensemble avec l'environnement.
Principales caractéristiques et fonctions structurelles Le système nerveux central est connecté à tous les organes et tissus par le système nerveux périphérique, qui chez les vertébrés comprend les nerfs crâniens s'étendant du cerveau et les nerfs spinaux de la moelle épinière, les ganglions nerveux intervertébraux, ainsi que la partie périphérique du système nerveux autonome. système - ganglions nerveux, avec des fibres nerveuses qui s'en approchent (préganglionnaires) et s'étendent à partir d'eux (postganglionnaires).
Les fibres nerveuses adductrices sensibles ou afférentes transportent l'excitation vers le système nerveux central à partir des récepteurs périphériques ; le long des fibres nerveuses efférentes (motrices et autonomes), l'excitation du système nerveux central est dirigée vers les cellules de l'appareil de travail exécutif (muscles, glandes, vaisseaux sanguins, etc.). Dans toutes les parties du système nerveux central, il existe des neurones afférents qui perçoivent les stimuli provenant de la périphérie, et des neurones efférents qui envoient des impulsions nerveuses vers la périphérie vers divers organes effecteurs exécutifs.
Les cellules afférentes et efférentes avec leurs processus peuvent entrer en contact les unes avec les autres et former un arc réflexe à deux neurones qui réalise des réflexes élémentaires (par exemple, les réflexes tendineux de la moelle épinière). Mais, en règle générale, les cellules nerveuses intercalaires, ou interneurones, sont situées dans l'arc réflexe entre les neurones afférents et efférents. La communication entre les différentes parties du système nerveux central s'effectue également à l'aide de nombreux processus de neurones afférents, efférents et intercalaires de ces parties, formant des voies intracentrales courtes et longues. Le SNC comprend également des cellules neurogliales, qui y remplissent une fonction de soutien et participent également au métabolisme des cellules nerveuses.
Quels médecins contacter pour un examen du système nerveux central :
Neurologue
Neurochirurgien
La partie principale du système nerveux des vertébrés et des humains est le système nerveux central. Il est représenté par le cerveau et la moelle épinière et se compose de nombreux groupes de neurones et de leurs processus. Le système nerveux central remplit de nombreuses fonctions importantes, dont la principale est la mise en œuvre de divers réflexes.
Qu'est-ce que le SNC ?
Au fur et à mesure de notre évolution, la régulation et la coordination de tous les processus vitaux du corps ont commencé à se produire à un tout nouveau niveau. Des mécanismes améliorés ont commencé à fournir une réponse très rapide à tout changement dans l'environnement externe. De plus, ils ont commencé à se souvenir des effets sur le corps survenus dans le passé et, si nécessaire, à récupérer ces informations. Des mécanismes similaires ont formé le système nerveux apparu chez les humains et les vertébrés. Il est divisé en central et périphérique.
Alors, qu’est-ce que le SNC ? Il s'agit du département principal qui non seulement unit, mais coordonne également le travail de tous les organes et systèmes, assure également une interaction continue avec l'environnement extérieur et maintient une activité mentale normale.

Unité structurelle
Un chemin similaire comprend :
- Récepteur sensoriel;
- neurones afférents, associatifs et efférents;
- effecteur
Toutes les réactions sont divisées en 2 types :
- inconditionnel (inné);
- conditionnel (acquis).
Centres nerveux plus les réflexes sont situés dans le système nerveux central, mais les réactions sont généralement fermées en dehors de ses limites.

Activités de coordination
Il s'agit de la fonction la plus importante du système nerveux central, impliquant la régulation des processus d'inhibition et d'excitation dans les structures des neurones, ainsi que la mise en œuvre de réponses.
La coordination est nécessaire pour que le corps puisse effectuer des mouvements complexes faisant appel à de nombreux muscles. Exemples : effectuer des exercices de gymnastique ; discours accompagné d'articulation; le processus d’ingestion de nourriture.
Pathologies
Il convient de noter que le système nerveux central est un système dont le dysfonctionnement affecte négativement le fonctionnement de tout l'organisme. Toute panne présente un risque pour la santé. Par conséquent, dès l’apparition des premiers symptômes alarmants, vous devriez consulter un médecin.
Les principaux types de maladies du système nerveux central sont :
- vasculaire;
- chronique;
- héréditaire;
- infectieux;
- reçu à la suite de blessures.
Actuellement, environ 30 pathologies de ce système sont connues. Les maladies du système nerveux central les plus courantes comprennent :
- insomnie;
- La maladie d'Alzheimer;
- paralysie cérébrale;
- La maladie de Parkinson;
- migraine;
- lumbago;
- méningite;
- myasthénie grave;
- AVC ischémique;
- névralgie;
- sclérose en plaques;
- encéphalite.
Les pathologies du système nerveux central résultent de lésions dans l'un de ses départements. Chacune des maladies présente des symptômes uniques et nécessite une approche individuelle pour choisir une méthode de traitement.

Enfin
La tâche du système nerveux central est d'assurer le fonctionnement coordonné de chaque cellule du corps, ainsi que son interaction avec le monde extérieur. une brève description de SNC : il est représenté par le cerveau et la moelle épinière, son unité structurelle est le neurone et le principe principal de son activité est le réflexe. Toute perturbation du fonctionnement du système nerveux central entraîne inévitablement des perturbations dans le fonctionnement de l'ensemble du corps.
Le corps humain fonctionne dans son ensemble. La cohérence et l'interaction de tous les organes sont assurées par le système nerveux central. On le trouve chez tous les êtres vivants et est constitué de cellules nerveuses et de leurs processus.
Le système nerveux central chez les vertébrés est représenté par le cerveau et la moelle épinière, chez les invertébrés - par un système de ganglions nerveux. Le système nerveux central est protégé par les formations osseuses du squelette : le crâne et la colonne vertébrale.
Structure du système nerveux central
L'anatomie du système nerveux central étudie la structure du cerveau et de la moelle épinière, qui sont reliés à chaque organe par le système nerveux périphérique.
 Le système nerveux central est responsable de sentiments tels que :
Le système nerveux central est responsable de sentiments tels que :
- audience;
- vision;
- touche;
- émotions;
- mémoire;
- pensée.
La structure cérébrale du système nerveux central contient principalement des substances blanches et grises.
 Les gris sont des cellules nerveuses dotées de petits processus. Situé dans la moelle épinière, il occupe la partie centrale, encerclant le canal rachidien. Quant au cerveau de la tête, dans cet organe la matière grise constitue son cortex et présente des formations distinctes dans la matière blanche. La substance blanche est située sous le soufre. Sa structure contient des fibres nerveuses qui forment des faisceaux nerveux. Un certain nombre de ces « ligaments » constituent un nerf.
Les gris sont des cellules nerveuses dotées de petits processus. Situé dans la moelle épinière, il occupe la partie centrale, encerclant le canal rachidien. Quant au cerveau de la tête, dans cet organe la matière grise constitue son cortex et présente des formations distinctes dans la matière blanche. La substance blanche est située sous le soufre. Sa structure contient des fibres nerveuses qui forment des faisceaux nerveux. Un certain nombre de ces « ligaments » constituent un nerf.
Le cerveau et la moelle épinière sont entourés de trois membranes :
- Solide. C'est la coque extérieure. Il est situé dans la cavité interne du crâne et du canal rachidien.
- Arachnoïde. Cette housse se situe sous la partie dure. Dans sa structure, il possède des nerfs et des vaisseaux sanguins.
- Vasculaire. Cette membrane est directement reliée au cerveau. Elle va dans ses sillons. Formé à partir de nombreuses artères sanguines. L'arachnoïde est séparée de la choroïde par une cavité remplie de moelle.
La moelle épinière en tant que partie du système nerveux central
 Cette composante du système nerveux central est située dans le canal rachidien. Il s'étend de l'arrière de la tête jusqu'à la région lombaire. Le cerveau présente des rainures longitudinales des deux côtés et le canal rachidien au centre. Sur la face externe du cerveau, dans le dos, se trouve une substance blanche.
Cette composante du système nerveux central est située dans le canal rachidien. Il s'étend de l'arrière de la tête jusqu'à la région lombaire. Le cerveau présente des rainures longitudinales des deux côtés et le canal rachidien au centre. Sur la face externe du cerveau, dans le dos, se trouve une substance blanche.
L'élément gris est principalement constitué des zones cornées latérales, postérieures et antérieures. Les cornes antérieures contiennent des cellules nerveuses motrices, les postérieures ont des cellules intercalaires qui produisent le contact entre les cellules sensorielles (situées dans les sections nodales) et motrices. Les processus qui constituent les fibres sont attachés aux zones cornées antérieures des particules motrices. Les neurones qui créent les racines dorsales rejoignent les zones cornées postérieures.
Ces racines sont des intermédiaires entre le cerveau et le dos. L'excitation arrivant au cerveau pénètre dans l'interneurone, puis passe par l'axone jusqu'à l'organe souhaité. Atteignant l’ouverture entre les vertèbres, les cellules sensorielles se connectent à leurs homologues motrices. Après cela, ils sont divisés en branches postérieures et antérieures, qui sont également constituées de fibres motrices et sensorielles. 62 nerfs mixtes s'étendent de chaque vertèbre dans deux directions.
Cerveau de tête humaine
 Cet organe est situé dans la partie cérébrale du crâne. Classiquement, il comporte cinq sections et à l'intérieur se trouvent quatre cavités remplies de liquide céphalo-rachidien. La majorité de l'organe est constituée d'hémisphères (80 %). La deuxième plus grande part est occupée par le tronc.
Cet organe est situé dans la partie cérébrale du crâne. Classiquement, il comporte cinq sections et à l'intérieur se trouvent quatre cavités remplies de liquide céphalo-rachidien. La majorité de l'organe est constituée d'hémisphères (80 %). La deuxième plus grande part est occupée par le tronc.
Il comporte les sections structurelles suivantes :
- moyenne;
- cérébral;
- oblong;
- intermédiaire.
Régions du cerveau

- Moelle. Cette zone prolonge la moelle épinière et présente une structure similaire. Sa structure est formée de matière blanche avec des zones de substance grise à partir desquelles s'étendent les nerfs du crâne. La partie supérieure se termine par le pont et les pédoncules inférieurs sont reliés aux côtés du cervelet. Presque tout ce cerveau est recouvert par les hémisphères. Dans l'élément gris de cette partie du cerveau se trouvent des centres responsables du fonctionnement des poumons, de la fonction cardiaque, de la déglutition, de la toux, des larmes, de la salivation et de la formation du suc gastrique. Tout dommage à cette zone peut arrêter la respiration et l'activité cardiaque, c'est-à-dire entraîner la mort.
- Cerveau postérieur. Cette partie comprend le cervelet et le pont. Le pont Varoliev est une section partant de l'oblong et se terminant au sommet par des « pattes ». Ses parties latérales forment les pédoncules cérébelleux moyens. Le pont comprend les nerfs facial, trijumeau, abducens et auditif. Le cervelet est situé derrière le pont et la moelle allongée. Cette partie de l'organe est constituée d'un composant gris, qui est le cortex, et d'une substance blanche avec des zones grises. Le cervelet est constitué de deux hémisphères, de la partie médiane et de trois paires de pédoncules. C’est par ces jambes, constituées de fibres nerveuses, qu’il est relié aux autres zones du cerveau. Grâce au cervelet, une personne peut coordonner ses mouvements, maintenir son équilibre, garder ses muscles toniques et effectuer des mouvements clairs et fluides. Par les voies du système nerveux central, le cervelet transmet les impulsions aux tissus musculaires. Mais son travail est contrôlé par le cortex cérébral.
- Mésencéphale. Anatomiquement situé devant le pont. Se compose de quatre colliculi et pédoncules cérébraux. Au centre se trouve un canal reliant les troisième et quatrième ventricules. Ce conduit est encadré par un élément gris. Les pédoncules cérébraux contiennent des voies qui relient la moelle oblongate et le pont aux hémisphères. Grâce au mésencéphale, il est possible de maintenir le tonus et de mettre en œuvre les réflexes. Il vous permet d'effectuer des activités telles que rester debout et marcher. De plus, les noyaux sensoriels sont situés dans les tubercules quadrijumeaux, qui sont liés à la vision et à l'audition. Ils réalisent des réflexes lumineux et sonores.
- Intermédiaire. Il est situé devant les « jambes » du cerveau. Les divisions de cette partie du système nerveux central sont une paire de tubérosités visuelles, de corps géniculés, de régions supracubertales et subtuberculaires. La structure du diencéphale comprend de la substance blanche et des accumulations de substance grise. Ici se trouvent les principaux centres de sensibilité - les buttes visuelles. C’est là que les impulsions provenant de tout le corps entrent et sont ensuite envoyées au cortex cérébral. Sous la tubérosité se trouve l'hypothalamus, où le système autonome est représenté par le centre supérieur sous-cortical. Grâce à lui, le métabolisme et le transfert de chaleur se produisent. Ce centre maintient la stabilité de l'environnement interne. Les nerfs auditifs et optiques sont situés dans les corps géniculés.
- Cerveau antérieur. Sa structure est constituée d'hémisphères cérébraux avec une partie médiane de connexion. Ces hémisphères sont séparés par un « passage », au fond duquel se trouve le corps calleux. Il relie les deux parties aux processus des cellules nerveuses. Le sommet des hémisphères est le cortex cérébral, constitué de neurones et de processus. En dessous se trouve la matière blanche, qui fonctionne comme des voies. Il unit les centres de l'hémisphère en un tout. Cette substance est constituée de cellules nerveuses qui forment les noyaux sous-corticaux de l'élément gris. Le cortex cérébral a une structure assez complexe. Il se compose de plus de 14 milliards de particules nerveuses disposées en six boules. Ils ont différentes formes, tailles et connexions.
Le cortex cérébral de la tête présente des circonvolutions et des sillons.
Ceux-ci, à leur tour, divisent la surface en quatre sections :
- occipital;
- frontale;
- pariétal;
- temple.
 Les sillons centraux et temporaux sont parmi les plus profonds. Le premier traverse les hémisphères, le second sépare la région temporale du cerveau des autres. Dans la zone du lobe frontal, devant le sillon central, se trouve le gyrus antérieur central. Le gyrus central postérieur est situé derrière le sillon principal.
Les sillons centraux et temporaux sont parmi les plus profonds. Le premier traverse les hémisphères, le second sépare la région temporale du cerveau des autres. Dans la zone du lobe frontal, devant le sillon central, se trouve le gyrus antérieur central. Le gyrus central postérieur est situé derrière le sillon principal.
La base du cerveau est constituée de la zone inférieure des hémisphères et du tronc cérébral. Chaque partie du cortex cérébral correspond à sa propre partie du corps. Les centres de presque tous les systèmes sensibles se trouvent dans ce segment. L'analyse des informations entrantes a lieu dans le cortex cérébral. Les principales zones du cortex sont : olfactive, motrice, sensible, auditive, visuelle.
La structure du système nerveux central diffère entre les organismes vivants supérieurs et inférieurs. Le système des animaux inférieurs a une structure de type réseau, les organismes supérieurs (y compris les humains) ont une structure NS de type neurogène. Dans le premier cas, les impulsions peuvent être transmises de manière diffuse ; dans le second cas, chaque cellule fonctionne comme une unité distincte, bien qu'elle soit connectée à d'autres neurones. Le système nerveux afférent transmet les impulsions de tous les organes au système nerveux central.
Les points de connexion de ces particules sont appelés synapses. La zone située entre la cellule et son processus est remplie de cellules gliales. Il s’agit d’un ensemble de particules spéciales qui, contrairement aux neurones, sont capables de se diviser. Le type le plus courant de ces particules sont les astrocytes. Ils nettoient l'espace extracellulaire des ions et des médiateurs en excès, éliminant ainsi les problèmes chimiques qui interfèrent avec les réactions coordonnées à la surface des cellules nerveuses. De plus, les astrocytes fournissent du glucose aux cellules actives et modifient la direction du transfert d'oxygène.
Il se passe beaucoup de choses dans certaines parties du système nerveux central processus nerveux. Des réactions réflexives simples et complexes, hautement différenciées, sont réalisées grâce à ce système. Les fonctions du système nerveux central peuvent être caractérisées par deux objectifs : la communication et l'interaction d'un organisme vivant avec l'environnement externe et la régulation du fonctionnement des organes. C'est l'un des conditions nécessaires pour le fonctionnement normal du corps.
1. Structure du télencéphale.
Surfaces des hémisphères cérébraux.
Cortex.
Ganglions de la base et terminal de la substance blanche
2. Structure du diencéphale.
Hypothalamus.
III ventricule.
3. Les principales voies du cerveau.
Voies afférentes ascendantes.
Voies efférentes descendantes.
1. Structure du télencéphale.
Cerveau fini(télencéphale) est constitué de deux hémisphères cérébraux, séparés l'un de l'autre par une fissure longitudinale. Au fond de la brèche, il y a une connexion qui les relie corps calleux. En plus du corps calleux, les hémisphères relient également le dos et l'avant pointes Et commissure de la voûte. Chaque hémisphère possède trois pôles : frontal, occipital et temporal. Trois bords (supérieur, inférieur et médial) divisent les hémisphères en trois surfaces : supérolatérale, médiale et inférieure. Chaque hémisphère est divisé en lobes. Sillon central(Rolandova) sépare le lobe frontal du lobe pariétal, rainure latérale(Sylvienne) temporale du frontal et du pariétal, la fissure pariéto-occipitale sépare les lobes pariétaux et occipitaux. Le lobe insulaire est situé profondément dans le sillon latéral. Des rainures plus petites divisent les lobes en circonvolutions.
Surface supérolatérale de l'hémisphère cérébral. Lobe frontal, situé dans la partie antérieure de chaque hémisphère du cerveau, est limité en bas par la fissure latérale (sylvienne), et en arrière par le sillon central profond (rolandique), situé dans le plan frontal. En avant du sillon central, presque parallèle à lui, se trouve sillon précentral. Depuis le sillon précentral vers l'avant, presque parallèles les uns aux autres, ils sont dirigés haut Et sillon frontal inférieur, qui séparent la surface supérolatérale du lobe frontal du gyrus. Entre le sillon central en arrière et le sillon précentral en avant, il y a Gyrus précentral. Situé au-dessus du sillon frontal supérieur gyrus frontal supérieur occupe la partie supérieure du lobe frontal.
Entre les sillons frontaux supérieur et inférieur gyrus frontal moyen. Situé en dessous du sillon frontal inférieur gyrus frontal inférieur, dans lequel ils dépassent par derrière Ascendant Et branche antérieure du sillon latéral, divisant la partie inférieure du lobe frontal en petites circonvolutions. Partie tegmentale (opercule frontal), situé entre la branche ascendante et la partie inférieure du sillon latéral, recouvre le lobe insulaire situé profondément dans le sillon latéral. Partie orbitale se trouve en bas de la branche antérieure, continuant jusqu'à la surface inférieure du lobe frontal. À ce stade, la rainure latérale s'élargit et se transforme en fosse cérébrale latérale .
Lobe pariétal, situé en arrière du sillon central, séparé de l'occipital sillon pariéto-occipital, qui est situé sur la surface médiale de l'hémisphère, dépassant profondément dans son bord supérieur. Le sillon pariéto-occipital passe à la surface latérale, où la frontière entre les lobes pariétal et occipital est une ligne conventionnelle - la continuation de ce sillon vers le bas. Le bord inférieur du lobe pariétal est la branche postérieure du sillon latéral, le séparant du lobe temporal. Sillon postcentral s'étend derrière le sillon central, presque parallèlement à celui-ci.
Entre les sillons central et postcentral se trouve gyrus postcentral, qui passe en haut à la surface médiale de l'hémisphère cérébral, où il se connecte au gyrus précentral du lobe frontal, formant avec lui lobule précentral. Sur la surface latérale supérieure de l'hémisphère inférieur, le gyrus postcentral passe également dans le gyrus précentral, recouvrant le sillon central par le bas. Il s'étend en arrière du sillon postcentral sillon intrapariétal, parallèle au bord supérieur de l'hémisphère. Au-dessus du sillon intrapariétal se trouve un groupe de petites circonvolutions appelées lobule pariétal supérieur; situé en dessous lobule pariétal inférieur.
Le plus petit lobe occipital situé derrière sillon pariéto-occipital et sa continuation conditionnelle sur la surface supérolatérale de l'hémisphère. Le lobe occipital est divisé en plusieurs circonvolutions par des sillons, dont le plus constant est sillon occipital transversal .
Lobe temporal, occupant les parties inférolatérales de l'hémisphère, est séparé des lobes frontal et pariétal par le sillon latéral. Le lobe insulaire est recouvert par le bord du lobe temporal. Sur la surface latérale du lobe temporal, presque parallèle au sillon latéral, s'étend haut Et gyri temporal inférieur. Sur la face supérieure du gyrus temporal supérieur, plusieurs gyrus transversaux faiblement définis sont visibles ( Les circonvolutions de Heschl). Entre les sillons temporaux supérieur et inférieur se trouvent gyrus temporal moyen. Au-dessous du sillon temporal inférieur se trouve gyrus temporal inférieur .
Insula (îlot) situé dans les profondeurs du sillon latéral, recouvert d'un tegmentum formé de parties des lobes frontal, pariétal et temporal. Profond rainure circulaire de l'insula sépare l’insula des parties environnantes du cerveau. La partie inféro-antérieure de l'insula est dépourvue de sillons et présente un léger épaississement - seuil de l'île. A la surface de l'îlot il y a long Et circonvolutions courtes.
Surface médiale de l'hémisphère cérébral. Tous ses lobes, à l'exception du lobe insulaire, participent à la formation de la surface médiale de l'hémisphère cérébral. Sillon du corps calleux le contourne par le haut, séparant le corps calleux du gyrus lombaire, descend et avance et continue dans sillon hippocampique .
Passe au-dessus du gyrus cingulaire sillon cingulaire, qui commence en avant et en bas à partir du bec du corps calleux. En s'élevant, le sillon se retourne et s'étend parallèlement au sillon du corps calleux. Au niveau de sa crête, sa partie marginale s'étend vers le haut à partir du sillon cingulaire, et le sillon lui-même se poursuit dans le sillon sous-pariétal. La partie marginale du sillon cingulaire limite postérieurement lobule péricentral, et devant - précuneus, qui appartient au lobe pariétal. En bas et en arrière à travers l'isthme, le gyrus cingulaire passe dans gyrus parahippocampique qui se termine devant crocheter et délimité par le haut sillon hippocampique . Gyrus cingulaire, isthme Et gyrus parahippocampique uni sous le nom gyrus voûté. Situé au plus profond du sillon hippocampique gyrus denté. Au niveau du splénium du corps calleux, il se ramifie vers le haut à partir du sillon cingulaire partie marginale du sillon cingulaire .
Surface inférieure de l'hémisphère cérébral a le terrain le plus difficile. Devant se trouve la surface du lobe frontal, derrière elle se trouve le pôle temporal et la surface inférieure des lobes temporal et occipital, entre lesquels il n'y a pas de limites claires. Entre fente longitudinale hémisphères et sillon olfactif le lobe frontal est situé gyrus droit. Latéralement au sillon olfactif gyri orbital . Gyrus lingual le lobe occipital du côté latéral est limité par le lobe occipitotemporal (garantie) rainure. Ce sillon passe à la surface inférieure du lobe temporal, divisant parahippocampique Et gyrus occipitotemporal médial. En avant du sillon occipitotemporal se trouve rainure nasale, limitant l'extrémité antérieure du gyrus parahippocampique - crochet. Sillon occipitotemporal divise médian Et gyri occipitotemporal latéral.
Cortex , cortex cerveau, est la partie la plus différenciée du système nerveux.
Le cortex cérébral est constitué de énorme montant cellules qui, selon leurs caractéristiques morphologiques, peuvent être divisées en six couches :
1. couche zonale externe ou moléculaire, lame zonal ;
2. couche granulaire externe, lame granulaire externe ;
3. couche pyramidale, lame pyramidale ;
4. couche granulaire interne, lame granulaire interne ;
5. couche ganglionnaire, lame ganglionnaire ;
6. couche polymorphe, limbe multiforme .
La structure de chacune de ces couches du cortex dans différentes parties du cerveau a ses propres caractéristiques, exprimées par un changement dans le nombre de couches, en différents nombres, tailles, topographie et structure des cellules nerveuses qui le composent.
Basé sur une étude subtile de différentes parties du cortex cérébral, un grand nombre de champs y sont actuellement décrits (voir figure), dont chacun est caractérisé caractéristiques individuelles son architectonique, qui a permis de créer une carte des champs du cortex cérébral (cytoarchitectonique), ainsi que d'établir les caractéristiques de la répartition des fibres corticales (myéloarchitectonique).
Coupes corticales Chaque analyseur du cortex cérébral possède certaines zones où sont localisés leurs noyaux et, en outre, des groupes distincts de cellules nerveuses situés en dehors de ces zones. Les noyaux de l'analyseur moteur sont localisés dans le gyrus circoncentral, le gyrus précentral et la partie postérieure des gyrus frontaux moyen et inférieur.
Dans la partie supérieure Dans le gyrus précentral et le lobule péricentral, les sections corticales des analyseurs moteurs des muscles du membre inférieur sont localisées ; ci-dessous se trouvent les zones liées aux muscles du bassin, de la paroi abdominale, du tronc, des membres supérieurs, du cou et, enfin, dans la section la plus basse - la tête.
Dans la région postérieure gyrus frontal moyen La section corticale de l'analyseur moteur pour la rotation combinée de la tête et des yeux est localisée. L'analyseur de moteur se trouve également ici. en écrivant relatif à mouvements volontaires liés à l’écriture de lettres, de chiffres et d’autres caractères.
Partie postérieure du gyrus frontal inférieur est l'emplacement de l'analyseur de parole moteur.
Section corticale de l'analyseur olfactif(et le goût) est dans le crochet ; visuel - occupe les bords du sulcus de l'éperon de l'oiseau, auditif - dans la partie médiane du gyrus temporal supérieur, et jusqu'en arrière, dans la partie postérieure du gyrus temporal supérieur - l'analyseur auditif des signaux de parole (contrôle de son propre discours et la perception de celui d'autrui).