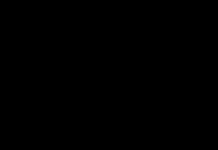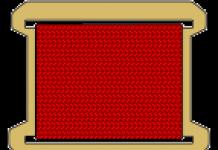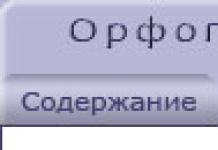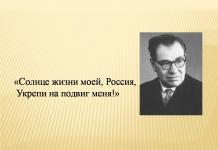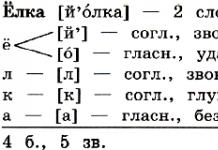Bien entendu, tous les auteurs soviétiques partent des principes fondamentaux du marxisme, tels que la reconnaissance de la primauté de la matière et de la nature secondaire de l'esprit, de la conscience et de la psyché ; de la position selon laquelle les sensations et les perceptions sont le reflet de la réalité objective et une fonction du cerveau. Mais nous parlons d'autre chose : de l'incarnation de ces dispositions dans leur contenu spécifique, dans la pratique du travail de recherche psychologique ; sur leur développement créatif dans la chair même, au sens figuré, de la recherche sur la perception. Et cela nécessite une transformation radicale de la formulation même du problème de la psychologie du nez et le rejet d'un certain nombre de postulats imaginaires préservés par l'inertie. La possibilité d'une telle transformation du problème de la perception en psychologie sera discutée.
Le point général que je vais essayer de défendre aujourd'hui est que le problème de la perception doit être posé et développé comme un problème de psychologie de l’image du monde.(Note: À propos, la théorie de la réflexion en allemand s'appelle Bildtheori, c'est-à-dire image.)
Cela signifie que tout est avant tout posé objectivement – dans les connexions objectives du monde objectif ; qu'elle se pose aussi secondairement dans la subjectivité, la sensualité humaine et la conscience humaine (dans ses formes idéales). C'est à partir de là qu'il faut partir dans l'étude psychologique de l'image, du processus de génération et de fonctionnement.
Les animaux et les humains vivent dans un monde objectif qui apparaît dès le début comme quadridimensionnel : un espace et un temps tridimensionnels (mouvement), qui représentent des « formes d’être objectivement réelles ».
Cette position ne doit en aucun cas rester pour la psychologie seulement une prémisse philosophique générale, qui n'affecterait pas directement l'étude psychologique spécifique de la perception et de la compréhension des mécanismes. Au contraire, cela vous fait voir beaucoup de choses différemment, pas comme cela s’est développé dans le cadre de la psychologie occidentale. Cela s’applique également à la compréhension du développement des organes sensoriels au cours de l’évolution biologique.
La vie des animaux Avec dès le début se déroule dans le monde objectif à quatre dimensions, l'adaptation des animaux se produit comme une adaptation aux connexions qui remplissent le monde des choses, leurs changements dans le temps, leur mouvement, que reflète, par conséquent, l'évolution des sens le développement de l'adaptation à la quadridimensionnalité du monde tel qu'il est, et non dans ses éléments individuels.
En ce qui concerne l'homme, la conscience de l'homme, je dois introduire un concept supplémentaire - le concept de cinquième quasi-dimension, dans lequel le monde objectif se révèle à l'homme. Ce - champ sémantique, système de significations.
L'introduction de ce concept nécessite une explication plus détaillée.
Le fait est que lorsque je perçois un objet, je le perçois non seulement dans ses dimensions spatiales et temporelles, mais aussi dans sa signification. Lorsque, par exemple, je regarde une montre-bracelet, alors, à proprement parler, je n’ai pas d’image des caractéristiques individuelles de cet objet, de leur somme, de leur « ensemble associatif ». C'est d'ailleurs la base de la critique des théories associatives de la perception. Il ne suffit pas non plus de dire que j’ai d’abord une image de leur forme, comme l’insistent les psychologues de la Gestalt. Je ne perçois pas la forme, mais un objet qui est une montre.
Bien sûr, s'il existe une tâche de perception appropriée, je peux isoler et réaliser leur forme, leurs caractéristiques individuelles, leurs éléments, leurs connexions. Sinon, bien que tout cela soit inclus dans facture image, dans son tissu sensuel, mais cette texture peut être recourbée, floutée, remplacée, sans détruire ni déformer l'objectivité de l'image.
La thèse que j'ai exprimée est prouvée par de nombreux faits, tant obtenus expérimentalement que connus de la vie quotidienne. Pour les psychologues préoccupés par la perception, il n’est pas nécessaire d’énumérer ces faits. Je noterai seulement qu'ils apparaissent particulièrement clairement dans les représentations-images.
L’interprétation traditionnelle consiste ici à attribuer à la perception elle-même des propriétés telles que le sens ou la catégorisation. Quant à l'explication de ces propriétés de la perception, elles, comme le dit justement R. Gregory (1), restent au mieux dans les limites de la théorie de Helmholtz. Permettez-moi de noter d’emblée que le danger profondément caché réside ici dans la nécessité logique de faire finalement appel à des catégories innées.
L'idée générale que je défends peut s'exprimer en deux propositions. La première est que les propriétés de signification et de catégorisation sont des caractéristiques de l’image consciente du monde, pas immanent à l'image elle-même, sa conscience. Eux, ces caractéristiques, expriment l'objectivité révélée par la pratique sociale totale, idéalisé dans un système de significations que chaque individu trouve comme "hors-il-existe"- perçu, assimilé - et donc identique à ce qui est inclus dans son image du monde.
Permettez-moi d'exprimer cela autrement : les significations n'apparaissent pas comme quelque chose qui se trouve devant les choses, mais comme quelque chose qui se trouve devant les choses. derrière l'apparence des choses- dans les connexions objectives connues du monde objectif, dans divers systèmes dans lesquels ils n'existent et ne révèlent que leurs propriétés. Les significations portent donc une dimensionnalité particulière. C'est une dimension connexions intrasystémiques du monde objectif objectif. Elle est sa cinquième quasi-dimension !
Résumons.
La thèse que je défends est qu'en psychologie le problème de la perception doit être posé comme le problème de la construction d’une image multidimensionnelle du monde, d’une image de la réalité, dans la conscience de l’individu. En d'autres termes, la psychologie de l'image (perception) est une connaissance scientifique concrète sur la manière dont, au cours de leurs activités, les individus construisent une image du monde - le monde dans lequel ils vivent, agissent, qu'ils refont eux-mêmes et partiellement créer; c'est aussi une connaissance du fonctionnement de l'image du monde, médiateur de leurs activités dans objectivement réel monde.
Ici, je dois m'interrompre avec quelques digressions illustratives. Je me souviens d'une dispute entre un de nos philosophes et J. Piaget lorsqu'il venait chez nous.
Il s’avère, dit ce philosophe en se tournant vers Piaget, que l’enfant, le sujet en général, construit le monde à l’aide d’un système d’opérations. Comment peut-on adopter un tel point de vue ? C'est de l'idéalisme.
"Je ne soutiens pas du tout ce point de vue", a répondu J. Piaget, "sur ce problème, mes vues coïncident avec le marxisme, et c'est complètement faux de me considérer comme un idéaliste !"
Mais comment, dans ce cas, affirmer que pour un enfant, le monde est tel que sa logique le construit ?
J. Piaget n'a jamais donné de réponse claire à cette question.
La réponse existe cependant et elle est très simple. Nous construisons réellement, non pas le Monde, mais l'Image, en la « détournant » activement, comme je le dis habituellement, de la réalité objective. Le processus de perception est le processus, le moyen de ce « ramassage », et l'essentiel n'est pas comment, à l'aide de quels moyens ce processus se produit, mais ce qui est obtenu à la suite de ce processus. Je réponds : l'image du monde objectif, la réalité objective. L'image est plus ou moins adéquate, plus complète ou moins complète... parfois même fausse...
Permettez-moi de faire encore une sorte de digression complètement différente.
Le fait est que la compréhension de la perception comme un processus par lequel se construit l’image du monde multidimensionnel, avec chaque lien, acte, moment, chaque mécanisme sensoriel, entre en conflit avec l’inévitable analytique de la recherche scientifique psychologique et psychophysiologique, avec la abstractions inévitables d’une expérience de laboratoire.
Nous isolons et étudions la perception de la distance, la discrimination des formes, la constance des couleurs, le mouvement apparent, etc., etc. Avec des expériences minutieuses et des mesures précises, nous semblons forer des puits profonds mais étroits qui pénètrent dans les profondeurs de la perception. Certes, nous ne parvenons pas souvent à établir des «passages de communication» entre eux, mais nous continuons et poursuivons ce forage de puits et en extrayons une énorme quantité d'informations - utiles, peu utiles et même totalement inutiles. En conséquence, des tas entiers de faits incompréhensibles se sont formés en psychologie, qui masquent le véritable soulagement scientifique des problèmes de perception.
Il va sans dire que je ne nie pas du tout par là la nécessité et même le caractère inévitable de l'étude analytique, de l'isolement de certains processus particuliers et même de phénomènes perceptuels individuels en vue de les étudier in vitro. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en passer ! Mon idée est complètement différente, à savoir qu'en isolant le processus étudié dans une expérience, nous avons affaire à une certaine abstraction, donc le problème du retour au sujet d'étude intégral dans sa nature réelle, son origine et son fonctionnement spécifique se pose immédiatement.
Par rapport à l’étude de la perception, il s’agit d’un retour à la construction d’une image dans la conscience de l’individu. monde multidimensionnel externe, paix tel qu'il est, dans lequel nous vivons, dans lequel nous agissons, mais dans lequel nos abstractions elles-mêmes « n'habitent pas », tout comme, par exemple, le « phi-motion » si minutieusement étudié et soigneusement mesuré n'y habite pas (2).
Là encore, je suis obligé de faire une digression.
Pendant de nombreuses décennies, les recherches en psychologie de la perception ont porté principalement sur la perception d'objets bidimensionnels - des lignes, des formes géométriques et généralement des images sur un plan. Sur cette base, la direction principale de la psychologie de l'image est née - la psychologie Gestalt.
Au début, il a été distingué comme une « qualité de forme » particulière ; puis dans l’intégrité de la forme ils ont vu la clé pour résoudre le problème de l’image. La loi de la « bonne forme », la loi de la grossesse et la loi de la figure et du fond ont été formulées.
Cette théorie psychologique, née de l’étude des images plates, s’est révélée être elle-même « plate ». Essentiellement, cela a fermé la possibilité du mouvement « monde réel – gestalt mentale », ainsi que du mouvement « gestalt psychique – cerveau ». Les processus significatifs se sont avérés être remplacés par des relations de projectivité et d'isomorphisme. V. Köhler publie le livre « Gestalts physiques » (il semble que K. Goldstein en ait parlé pour la première fois), et K. Koffka déclare déjà directement que la solution à la contradiction entre l'esprit et la matière, la psyché et le cerveau est que le le troisième est primaire et c'est le troisième qu'il y a une forme de quête. Une solution loin d’être la meilleure est proposée dans la version de Leipzig de la psychologie Gestalt : la forme est une catégorie subjective a priori.
Comment la perception des choses tridimensionnelles est-elle interprétée dans la psychologie Gestalt ? La réponse est simple : elle consiste à transférer les lois de la perception des projections sur un plan à la perception des choses tridimensionnelles. Les choses dans le monde tridimensionnel semblent ainsi fermées par des plans. La loi principale du champ de perception est la loi de « la figure et du fond ». Mais ce n'est pas du tout une loi de perception, mais un phénomène de perception d'une figure bidimensionnelle sur un fond bidimensionnel. Il ne fait pas référence à la perception des choses dans le monde tridimensionnel, mais à une certaine abstraction de celles-ci, qui en est leur contour*. Dans le monde réel, la certitude d'une chose intégrale apparaît à travers ses connexions avec d'autres choses, et non à travers son « esquisse »**.
En d’autres termes, avec ses abstractions, la théorie de la Gestalt a remplacé le concept d’objectif paix concept des champs.
Il a fallu des années en psychologie pour les séparer et les contraster expérimentalement. Il semble que ce soit J. Gibson qui ait trouvé le moyen de voir les objets environnants et l'environnement environnant comme constitué d'avions, mais cet environnement est ensuite devenu illusoire et a perdu sa réalité pour l'observateur. Il était possible de créer subjectivement précisément le « champ », mais il s'est avéré qu'il était habité par des fantômes. Ainsi, en psychologie de la perception, une distinction très importante est apparue : le « champ visible » et le « monde visible ».
Ces dernières années, notamment dans les études menées au Département de psychologie générale, cette distinction a fait l'objet d'une couverture théorique fondamentale, et l'écart entre l'image projetée et l'image objective a reçu une justification expérimentale assez convaincante (3).
J'ai opté pour la théorie Gestalt de la perception car elle montre particulièrement clairement les résultats de la réduction de l'image du monde objectif à des phénomènes individuels, des relations, des caractéristiques, abstraits du processus réel de sa génération dans l'esprit humain, processus pris dans son intégralité. . Il est donc nécessaire de revenir sur ce processus dont la nécessité réside dans la vie d'une personne, dans le développement de son activité dans un monde objectivement multidimensionnel. Le point de départ doit être le monde lui-même et non les phénomènes subjectifs qu'il provoque.
J’arrive ici au point le plus difficile, pourrait-on dire, le plus critique de la réflexion que je suis en train d’expérimenter.
Je veux immédiatement exprimer ce point sous la forme d’une thèse catégorique, en omettant délibérément toutes les réserves nécessaires.
Cette thèse est que le monde dans sa distance au sujet est amodal. Nous parlons bien sûr du sens du terme « modalité », qu'il a en psychophysique, psychophysiologie et psychologie, lorsque nous parlons par exemple de la forme d'un objet donnée en modalité visuelle ou tactile ou en modalités ensemble. .
En avançant cette thèse, je pars d’une distinction très simple et, à mon avis, tout à fait justifiée entre des propriétés de deux sortes.
L’une concerne les propriétés des choses inanimées qui se révèlent dans les interactions avec les choses (avec les « autres »), c’est-à-dire dans l’interaction « objet-objet ». Certaines propriétés se révèlent dans l'interaction avec des choses d'un type particulier - avec des organismes vivants et sensibles, c'est-à-dire dans l'interaction « objet - sujet ». On les retrouve dans des effets spécifiques selon les propriétés des organes récepteurs du sujet. En ce sens, ils sont modaux, c’est-à-dire subjectifs.
La douceur de la surface d'un objet dans l'interaction « objet-objet » se révèle, par exemple, dans le phénomène physique de réduction du frottement. À la palpation avec la main, le phénomène modal est une sensation tactile de douceur. La même propriété de la surface apparaît dans la modalité visuelle.
Ainsi, le fait est qu'une seule et même propriété - dans ce cas, la propriété physique du corps - provoque, lorsqu'elle influence une personne, des impressions de modalités complètement différentes. Après tout, « brillance » n’est pas comme « douceur » et « matité » n’est pas comme « rugosité ».
Par conséquent, les modalités sensorielles ne peuvent pas recevoir un « enregistrement permanent » dans le monde objectif externe. J'insiste externe, parce que l'homme, avec toutes ses sensations, appartient aussi au monde objectif, il y a aussi une chose parmi les choses.
Dans ses expériences, on montrait aux sujets un carré de plastique dur à travers une lentille réductrice. «Le sujet a pris le carré avec ses doigts par le bas, à travers un morceau de tissu, de manière à ne pas voir sa main, sinon il pourrait comprendre qu'il regardait à travers une lentille réductrice. Nous lui avons demandé de rapporter son impression sur la taille du carré... Nous avons demandé à certains sujets de dessiner le plus précisément possible un carré de taille appropriée, ce qui nécessite la participation à la fois de la vision et du toucher. D'autres devaient choisir un carré de taille égale parmi une série de carrés présentés uniquement visuellement, et d'autres encore devaient choisir parmi une série de carrés dont la taille ne pouvait être déterminée que par le toucher...
Les sujets avaient une certaine impression holistique de la taille du carré. La taille perçue du carré était à peu près la même que dans l’expérience témoin avec perception visuelle seule » (4).
Ainsi, le monde objectif, considéré comme un système de connexions uniquement « objet-objet » (c’est-à-dire le monde sans animaux, avant les animaux et les humains), est amodal. Ce n’est qu’avec l’émergence de connexions et d’interactions sujet-objet que des modalités multivariées et, de plus, changeant d’espèce en espèce (c’est-à-dire d’espèce zoologique) apparaissent.
C’est pourquoi, dès que nous faisons abstraction des interactions sujet-objet, les modalités sensorielles disparaissent de nos descriptions de la réalité.
De la dualité des connexions, des interactions « O-O » et « O-S », à condition qu'elles coexistent, naît la dualité bien connue des caractéristiques : par exemple, telle ou telle partie du spectre des ondes électromagnétiques et, disons, la lumière rouge. En même temps, il ne faut pas oublier que les deux caractéristiques expriment « la relation physique entre les choses physiques ».
Ici, je dois répéter mon idée principale : en psychologie, elle doit être résolue comme un problème de développement phylogénétique de l'image du monde, car :
A) une « base directrice » pour le comportement est nécessaire, et c'est une image ;
B) tel ou tel mode de vie crée le besoin d'une image correspondante d'orientation, de contrôle et de médiation dans le monde objectif.
En bref. Il ne faut pas partir de l'anatomie et de la physiologie comparées, mais de écologie dans sa relation avec la morphologie des organes des sens, etc. Engels écrit : « Ce qui est lumière et ce qui ne l'est pas dépend si l'animal est nocturne ou diurne » 13 .
La question des « combinaisons » est particulièrement importante.
1. La combinaison (des modalités) devient, mais par rapport aux sentiments, image ; elle est sa condition. (Tout comme un objet est un « nœud de propriétés », une image est un « nœud de sensations modales ».)
2. La compatibilité exprime spatialité les choses comme forme de leur existence).
3. Mais elle exprime aussi leur existence dans le temps, c'est pourquoi l'image est fondamentalement le produit non seulement du simultané, mais aussi du succession regroupement, fusion**. Le phénomène le plus caractéristique de la combinaison des points de vue, ce sont les dessins d'enfants !
Conclusion générale : toute influence réelle s’inscrit dans l’image du monde, c’est-à-dire dans un « tout » 14 .
Quand je dis que toute propriété réelle, c'est-à-dire influençant actuellement les systèmes de perception, « s'inscrit » dans l'image du monde, alors ce n'est pas une affirmation vide de sens, mais une affirmation très significative ; cela signifie que:
(1) la frontière de l'objet est établie sur l'objet, c'est-à-dire que sa séparation se produit non pas au niveau sensoriel, mais aux intersections des axes visuels. Par conséquent, lors de l’utilisation d’une sonde, un changement de sensibilité se produit. Cela veut dire qu'il n'existe pas objectivation des sensations et des perceptions ! Derrière la critique de « l’objectivation », c’est-à-dire de l’attribution de caractéristiques secondaires au monde réel, se cache une critique des concepts idéalistes subjectifs. En d'autres termes, je maintiens le fait que Ce n'est pas la perception qui se pose dans l'objet, mais l'objet- à travers des activités- se met à l'image. La perception est sa « position subjective ».(Position pour le sujet !) ;
(2) l'insertion dans l'image du monde exprime aussi le fait que l'objet n'est pas constitué de « faces » ; il agit pour nous comme unique continu ; la discontinuité n'est que son moment. Le phénomène du « noyau » de l’objet apparaît. Ce phénomène exprime objectivité perception. Les processus perceptuels obéissent à ce noyau. Preuve psychologique : a) dans la brillante observation de G. Helmholtz : « tout ce qui est donné dans la sensation n'est pas inclus dans « l'image de la représentation » (équivalent à la chute de l'idéalisme subjectif à la manière de Johannes Muller) ; b) dans le phénomène d'additions à l'image pseudoscopique (je vois des bords provenant d'un plan suspendu dans l'espace) et dans les expériences d'inversion, avec adaptation à un monde optiquement déformé.
Jusqu’à présent, j’ai évoqué les caractéristiques de l’image du monde qui sont communes aux animaux et aux humains. Mais le processus de génération d'une image du monde, comme l'image du monde elle-même, ses caractéristiques changent qualitativement lorsque nous passons à l'homme.
Chez les humains le monde acquiert une cinquième quasi-dimension à son image. En aucun cas cela n’est subjectivement attribué au monde ! C'est une transition à travers la sensualité au-delà des frontières de la sensualité, à travers les modalités sensorielles jusqu'au monde amodal. Le monde objectif apparaît dans le sens, c'est-à-dire l'image du monde est remplie de significations.
L'approfondissement des connaissances nécessite la suppression des modalités et consiste en une telle suppression, donc la science ne parle pas le langage des modalités, ce langage en est expulsé.
L'image du monde comprend les propriétés invisibles des objets : a) amodal- découvert par l'industrie, l'expérimentation, la réflexion ; b) "supersensible"- des propriétés fonctionnelles, des qualités, telles que la « valeur », qui ne sont pas contenues dans le substrat de l'objet. Ils sont représentés en significations !
Ici, il est particulièrement important de souligner que la nature du sens non seulement ne réside pas dans le corps du signe, mais aussi dans les opérations formelles du signe, ni dans les opérations de sens. Elle - dans l'ensemble de la pratique humaine, qui, sous ses formes idéalisées, est incluse dans l'image du monde.
Autrement, on peut dire ainsi : la connaissance et la pensée ne sont pas séparées du processus de formation d'une image sensorielle du monde, mais y entrent, y ajoutant de la sensualité. [La connaissance est incluse, la science ne l'est pas !]
Quelques conclusions générales
1. La formation de l’image du monde d’une personne est sa transition au-delà des limites de « l’image directement sensorielle ». Une image n'est pas une image !
2. La sensualité, les modalités sensorielles deviennent de plus en plus « indifférentes ». L'image du monde d'une personne sourde-aveugle n'est pas différente de l'image du monde d'une personne voyante et entendante, mais est créée à partir d'un matériau de construction différent, du matériau d'autres modalités, tissé à partir d'un tissu sensoriel différent. Il conserve donc sa simultanéité, et c'est un problème pour la recherche !
3. La « dépersonnalisation » de la modalité n’est pas du tout la même chose que l’impersonnalité du signe par rapport au sens.
Les modalités sensorielles ne codent en aucun cas la réalité. Ils le portent en eux. C'est pourquoi la désintégration de la sensualité (sa perversion) donne naissance à l'irréalité psychologique du monde, au phénomène de sa « disparition ». C’est connu et prouvé.
4. Les modalités sensorielles constituent la texture obligatoire de l'image du monde. Mais la texture de l’image n’est pas équivalente à l’image elle-même. C’est ainsi qu’en peinture l’objet transparaît derrière les traits d’huile. Quand je regarde l’objet représenté, je ne vois pas de traits. La texture, la matière, est supprimée par l'image et non détruite dans celle-ci.
L'image, l'image du monde, n'inclut pas l'image, mais ce qui est représenté (la représentation, le reflet ne se révèle que par le reflet, et c'est important !).
Ainsi, l'inclusion des organismes vivants, des systèmes de processus de leurs organes, de leur cerveau dans le monde objectif, objectif-discret, conduit au fait que le système de ces processus est doté d'un contenu différent de leur propre contenu, contenu appartenant au monde objectif lui-même.
Le problème d’une telle « dotation » soulève le sujet de la science psychologique !
1. Gregory R. L'œil intelligent. M., 1972.
2. Gregory R. Oeil et cerveau. M., 1970, p. 124-125.
* Ou, si vous préférez, un avion.
**T. c'est-à-dire les opérations de sélection et de vision de la forme.
3. Logvinenko A.D., Stolin V.V. Etude de la perception dans des conditions d'inversion du zéro de la vision. - Ergonomie : Actes du VNIITE, 1973, vol. 6.
4. Rock I., Harris C. Vision et toucher. – Dans le livre : Perception. Mécanismes et modèles. M., 1974. pp. 276-279.
Suite à la maîtrise de la matière du chapitre, l'étudiant doit :
savoir
- la notion d'« image du monde » et pouvoir l'utiliser ;
- types de modèles de l'image du monde et être capable de les décrire ;
- les schémas fondamentaux de fonctionnement de l'image du monde et sa spécificité professionnelle ;
être capable de
- utiliser le concept d'« image du monde » pour généraliser et interpréter les résultats de l'utilisation des méthodes de psychologie de la sémantique subjective et de la psychosémantique ;
- utiliser ses connaissances sur les spécificités professionnelles de l'image du monde pour travailler avec différents types de professionnels ;
propre
- connaissance des composantes structurelles de l'image du monde pour la planification de la recherche ;
- ont décrit les programmes de recherche et la possibilité de leur utilisation dans leurs propres développements scientifiques et appliqués.
Le concept d'« image du monde »
L'image du monde comme système de significations
A. N. Leontiev a introduit le concept d'« image du monde » pour résoudre les problèmes de généralisation de l'énorme corpus de données empiriques accumulées dans les études sur la perception humaine. En faisant une analogie, on peut dire que de même que le concept d'« image » est un concept intégrateur pour une description systémique du processus de perception, prenant en compte la totalité de ses composantes actives et réactives, de même le concept d'« image de monde » est un concept intégrateur pour décrire l’ensemble de la phénoménologie de l’activité cognitive humaine. Aujourd'hui, ce concept a un très grand potentiel descriptif pour tous les domaines de la psychologie russe.
En supposant que le sujet de la réflexion mentale sont les relations de réalité qui sont importantes pour la régulation de l'activité (pour les animaux - la vie), A. N. Leontiev l'a prouvé dans une série de ses expériences sur le développement de la sensibilité non spécifique : des sujets, tout en accomplissant une tâche , a appris à distinguer la couleur de la peau du palmier ( Léontiev, 1981). Ces faits ont permis à A. N. Leontiev de développer des vues sur le rôle de l'activité dans la formation des sensations, sur la détermination des sensations par la réalité objective.
Résumant les résultats de nombreuses études sur la perception, A. N. Léontiev avance « l'hypothèse de l'assimilation » : l'essence du mécanisme d'assimilation sensorielle réside dans l'assimilation de la dynamique des actions perceptuelles aux propriétés de ce qui est réfléchi.
- 1. Une personne reconnaît un objet au toucher après que les mouvements de ses doigts et de sa paume décrivent un contour similaire à la forme de l'objet.
- 2. Une personne identifie visuellement un objet ou une image après que sa ligne de mire (fixée à l'aide d'une ventouse avec un microphone autour de la pupille, le faisceau de la lampe torche montre les mouvements du regard sur du papier photographique) décrit un contour similaire à l'objet ou à l'image.
- 3. Une personne reconnaît un son une fois que la fréquence de vibration du tympan devient similaire à la fréquence des vibrations sonores.
Des données expérimentales (sensibilité non spécifique, études auditives) ont permis à A. N. Leontiev de suggérer « que le processus d'assimilation, avec possibilité de contact pratique externe de l'organe moteur avec l'objet exclu, se produit en « comparant » les signaux au sein du système, c'est-à-dire dans le champ interne » (Leontyev, 1981, p. 191). Cette hypothèse est l’une des premières formulations de la thèse sur la multimodalité et l’éventuelle amodalité de l’image.
Résolvant le problème de l'émergence de la psyché, A. N. Leontiev a réduit les conditions (le monde) à l'objet du besoin et à ses propriétés. Résolvant le problème de l'apparition d'une image, il prouva au contraire la dépendance de la perception à l'égard de l'ensemble du monde objectif dans son ensemble : « Il s'avère que la condition d'adéquation de la perception d'un objet individuel est la adéquation perception du monde objectif dans son ensemble et de la pertinence de l'objet par rapport à ce monde » (ibid., p. 149) .
A. N. Leontiev a particulièrement souligné : « a) la nature prédéterminée de ce monde objectif désigné et significatif pour chaque acte spécifique de perception, la nécessité « d'inclure » cet acte dans une image toute faite du monde ; b) cette image de le monde agit comme l'unité de l'expérience individuelle et sociale » (Leontiev, 1983, p. 36).
Le rôle de l'expérience humaine et le rôle des systèmes de significations socialement développés dans la prise de conscience de cette expérience, la non-identité de l'image du monde avec une image visuelle ou toute autre image, toute combinaison d'images sont soulignés. La « récupération » d'une image subjective du monde décrite par A. N. Leontyev est interprétée par E. Yu. Artemyeva (Artemyeva, 1999) comme le premier modèle proposé de fusion du processus, de l'image et de la réalité en un seul acte mental. Dans le brouillon mentionné ci-dessus (Leontiev, 1983, pp. 37-38) du livre non écrit de A. N. Leontiev (probablement « L'image du monde »), le développement de la présentation du temps en expansion se termine par une perspective socio-historique, et d'expansion de l'espace dans une perspective cosmique (« Ce n'est plus le mien, mais l'humain »).
L'image du monde, en plus des quatre dimensions de l'espace-temps, possède également une cinquième « quasi-dimension » [signification] : « C'est une transition par la sensualité, au-delà des frontières de la sensualité, à travers des modalités sensorielles vers l'amodal. monde ! Le monde objectif apparaît dans le sens, c'est-à-dire l'image du monde est remplie de sens » (Leontyev, 1983, vol. 2, p. 260). L'introduction de la cinquième dimension souligne le fait que l'image du monde est déterminée non seulement par les caractéristiques spatio-temporelles de la réalité (modèle quadridimensionnel de l'espace-temps), mais aussi par la signification pour le sujet de ce qui y est réfléchi. : « …Les significations n'apparaissent pas comme ce qui se trouve devant les choses, mais comme ce qui se trouve derrière l'apparence des choses - dans les connexions objectives connues du monde objectif, dans divers systèmes dans lesquels ils n'existent et ne révèlent que leur propriétés » (ibid., p. 154). La signification subjective des événements, des objets et des actions qui les accompagnent structure l'image du monde d'une manière complètement différente de la structuration des espaces métriques, elle « contracte et étire » affectivement l'espace et le temps, place des accents de signification, perturbe leur séquence et, ainsi, met en doute (ou ne met pas en doute) toutes sortes de connexions logiques, faisant partie de l'irrationnel. « L'image du monde » est un concept qui décrit un modèle subjectif et biaisé du monde, incluant le rationnel et l'irrationnel, se développant sur la base d'un système d'activités dans lequel une personne est incluse (Artemyeva, Strelkov, Serkin, 1983 ).
L'ouvrage de A. N. Leontiev « Image du monde » (Leontiev, 1983, vol. 2) permet de reconstruire de manière probabiliste le modèle à cinq dimensions de la phénoménologie décrit par le concept d'« image du monde » : quatre dimensions de l'espace-temps sont « imprégnés » par la cinquième dimension - valeur, comme une autre coordonnée de chaque point de l'espace-temps à quatre dimensions. En interprétant, nous pouvons dire que tout comme deux points éloignés l'un de l'autre sur une figure géométrique plate peuvent se toucher si vous pliez une feuille dans un espace tridimensionnel, des objets, des événements et des actions éloignés en termes de coordonnées temporelles et spatiales peuvent se toucher en termes de sens. et s'avèrent être « avant », bien qu'ils se soient produits « après » selon les coordonnées temporelles et spatiales de l'espace-temps à quatre dimensions. Cela n’est possible que parce que « l’espace et le temps de l’image du monde » sont subjectifs. Si l'on prend en compte le concept de représentation des sens et des significations pour l'avenir, alors le « cercle » du temps subjectif de l'image du monde, son « avance » et son « retard » par rapport à la réalité conventionnelle deviennent compréhensibles.
En utilisant un tel modèle, nous abandonnons les modèles uniformes d’espace immuable rempli d’objets et le modèle uniforme de temps rempli d’événements avec des objets dans l’espace. En toute logique strictement parlant, lors de la formulation du concept d'« image du monde », nous ne devrions plus utiliser les structures de description du monde matériel, mais les structures de descriptions de phénomènes idéaux tels que le concept, le sens, la représentation, l'idée, la pensée, etc. C'est exactement ce que voulait dire A. N. Leontyev, parlant de l'image du monde comme système de significations. Ne pas l'accepter constitue une impasse méthodologique pour de nombreux chercheurs qui proposent des modèles d'espace ou de temps subjectivement uniformes, qui permettent, avec beaucoup de réserve (ou, pour le dire crûment, « avec ajustement »), de décrire les faits obtenus dans l'expérience, mais sont impuissants à prédire les structures subjectives de l'espace et du temps. Le problème du temps de l'image du monde dans son évolution nécessite une solution radicale aux problèmes encore peu développés de synchronisation des processus des mondes « interne » et « externe » et de « requalification » des données expérimentales sur tous les aspects cognitifs. les processus (en particulier la mémoire) construits non seulement « en résultat », mais avant tout « pour » l’activité.
Sur la base du raisonnement ci-dessus, formulons les définitions de travail suivantes.
Définition 1.« L'image du monde » est un concept introduit par A. N. Leontiev pour décrire le système intégral des significations humaines. L'image du monde se construit à partir de l'identification de ce qui est significatif (essentiel, fonctionnel) pour le système d'expériences réalisées par le sujet (signes, impressions, sentiments, idées, normes, etc.). L’image du monde, présentant les connexions connues du monde objectif, détermine à son tour la perception du monde.
Les images du monde de différentes personnes sont différentes en raison des différentes conditions culturelles et historiques de leur formation (culture, langue, nationalité, société) et des différences de modes de vie individuels (personnels, professionnels, d'âge, quotidiens, géographiques, etc.).
Un exemple de division fonctionnelle d'un système est la division de la conscience effectuée par A. N. Leontyev en ses composants (sous-systèmes fonctionnels) : sens, sens personnel et tissu sensoriel de conscience (pour plus de détails, voir le sous-paragraphe 2.1.1). Les fonctions du sens et du sens personnel en tant que composantes de la conscience consistent à structurer, transformer des images sensorielles de la conscience conformément à la pratique socio-historique (description culturelle) et conformément à l'expérience (être pour soi, histoire personnelle des activités) de l'objet. Quel est le produit d’une telle transformation ?
Définition 2.« Image du monde » est un concept introduit par A. N. Leontiev pour décrire le produit idéal intégral du processus de conscience, obtenu grâce à la transformation constante du tissu sensoriel de la conscience en significations (« signification », objectivation). L'image du monde peut être considérée comme un processus dans la mesure où l'on change le produit intégral idéal du travail de la conscience.
Le concept de « conscience » n'est pas identique au concept d'« image du monde », puisque le sensoriel (« tissu sensoriel », selon A. N. Leontiev) n'est pas une composante de l'image idéale. Les facteurs déterminants dans la transformation des images sensorielles de la conscience en significations sont les lois d'existence de l'image du monde et l'ensemble des activités mises en œuvre par le sujet.
L'activité exercée par le sujet est le moteur du changement (développement) de l'image du monde. Considérant l'image du monde comme un système dynamique établi, il faut tenir compte du fait que ce système a sa propre structure stable qui préserve le système de la destruction (et, parfois, du développement), ce qui donne à l'image du monde un certain conservatisme. Il est possible que l'équilibre entre conservatisme et variabilité soit l'une des caractéristiques de l'image du monde, ce qui permet d'introduire une typologie des « images du monde » (par exemple, par âge) et des algorithmes de description des individus. images du monde.
- Il est à noter que les sujets ne pouvaient pas décrire clairement leurs sensations, mais pouvaient nommer la couleur, c'est-à-dire ici, peut-être, il est plus correct de parler du développement de la perception non spécifique plutôt que de la sensibilité.
- Pourtant, nous n’avons pas le droit d’affirmer catégoriquement que A. N. Léontiev a précisément créé un tel modèle de phénoménologie psychologique, décrit par le concept d’« image du monde ».
- Ce modèle nous permet de décrire et d'interpréter les schémas psychologiques fondamentaux, par exemple les lois de la formation des associations, bien mieux et avec plus de précision que les modèles précédents.
- A. N. Leontiev n'introduirait même pas un nouveau concept totalement identique à celui déjà largement utilisé.
- Un tel conservatisme peut expliquer les mécanismes de l’attitude, de l’aperception et des illusions de perception.
Le concept d'« image du monde » a été introduit par A.N. Léontiev, considérant les problèmes de perception. Selon lui, la perception n'est pas seulement le reflet de la réalité ; elle comprend non seulement une image du monde, mais aussi des concepts dans lesquels les objets de la réalité peuvent être décrits. Autrement dit, dans le processus de construction d'une image d'un objet ou d'une situation, l'importance principale n'est pas les impressions sensorielles individuelles, mais l'image du monde dans son ensemble.
Développement du concept d'« image du monde » par A.N. Léontiev est associé à sa théorie psychologique générale de l'activité. Selon A.V. Petrovsky, la formation de l'image du monde se produit dans le processus d'interaction du sujet avec le monde, c'est-à-dire par l'activité.
Psychologie de l'image, au sens d'A.N. Léontiev, il s'agit spécifiquement d'une connaissance scientifique sur la manière dont, au cours de leurs activités, les individus construisent une image du monde - le monde dans lequel ils vivent, agissent, qu'ils refont eux-mêmes et dont ils ont en partie conscience ; c'est aussi une connaissance du fonctionnement de l'image du monde, médiatisant leurs activités dans le monde réel objectif. Il a noté que l'image du monde, en plus des quatre dimensions de la réalité de l'espace-temps, a également une cinquième quasi-dimension - la signification de ce qui se reflète pour le sujet dans les connexions intra-systémiques objectives connues du monde objectif. .
UN. Léontiev, parlant de « l'image du monde », a voulu souligner la différence entre les concepts de « monde des images » et d'« image du monde », s'adressant aux chercheurs en perception. Si nous considérons d’autres formes de réflexion émotionnelle du monde, nous pourrions alors utiliser d’autres termes, comme par exemple « le monde des expériences » (ou des sentiments) et « l’expérience (le sentiment) du monde ». le processus de représentation pour décrire ce concept, nous pouvons alors utiliser le concept de « représentation du monde ».
Une discussion plus approfondie du problème de « l'image du monde » a conduit à l'émergence de deux positions théoriques. La première position inclut le concept selon lequel chaque phénomène ou processus mental a son propre porteur, sujet. Autrement dit, une personne perçoit et expérimente le monde comme un être mental intégral. Lors de la modélisation même d'aspects individuels du fonctionnement des processus cognitifs privés, les processus cognitifs sont pris en compte. La deuxième disposition complète la première. Selon lui, toute activité humaine est médiatisée par sa vision individuelle du monde et sa place dans ce monde.
V.V. Petukhov estime que la perception de tout objet ou situation, d'une personne spécifique ou d'une idée abstraite est déterminée par une image holistique du monde et par l'ensemble de l'expérience de la vie d'une personne dans le monde, sa pratique sociale. Ainsi, l’image (ou la représentation) du monde reflète ce contexte historique spécifique – écologique, social, culturel – dans lequel (ou au sein duquel) se déroule toute l’activité mentale humaine. À partir de cette position, l'activité est décrite du point de vue des exigences qui, lors de son exécution, sont posées à la perception, à l'attention, à la mémoire, à la pensée, etc.
Selon S.D. Smirnov, le monde réel se reflète dans la conscience comme une image du monde sous la forme d'un système à plusieurs niveaux d'idées d'une personne sur le monde, les autres, lui-même et ses activités. L’image du monde est « une forme universelle d’organisation des connaissances qui détermine les possibilités de gestion cognitive et comportementale ».
Les AA Léontiev identifie deux formes d'image du monde :
1. situationnel (ou fragmentaire) - c'est-à-dire une image du monde qui n'est pas incluse dans la perception du monde, mais qui est totalement réflexive, éloignée de notre action dans le monde, notamment de la perception (comme par exemple lors du travail de mémoire ou d'imagination) ;
2. non situationnel (ou global) - c'est-à-dire une image d'un monde intégral, une sorte de schéma (image) de l'univers.
De ce point de vue, l’image du monde est réflexion, c’est-à-dire compréhension. L'image de la vision du monde d'A.N. Léontiev la considère comme une éducation liée à l'activité humaine. Et l'image du monde comme composante du sens personnel, comme sous-système de conscience. De plus, selon E.Yu. Artemyeva, l'image du monde naît simultanément dans la conscience et dans l'inconscient.
L'image du monde agit comme une source de certitude subjective, permettant de percevoir sans ambiguïté des situations objectivement ambiguës. Le système d'attentes aperceptives qui naît sur la base de l'image du monde dans une situation spécifique influence le contenu des perceptions et des idées, générant des illusions et des erreurs de perception, ainsi que déterminant la nature de la perception de stimuli ambigus dans une telle situation. manière dont le contenu réellement perçu ou représenté correspond à l'image holistique du monde, aux structures sémantiques qui la structurent et aux interprétations, attributions et prédictions qui en résultent concernant une situation donnée, ainsi qu'aux attitudes sémantiques actuelles.
Dans les travaux d'E.Yu. L'image du monde d'Artemyev est comprise comme un « intégrateur » de traces d'interaction humaine avec la réalité objective. » Du point de vue de la psychologie moderne, l'image du monde est définie comme un système intégral à plusieurs niveaux d'idées d'une personne sur le monde. , les autres, sur lui-même et ses activités, un système « qui médiatise, réfracte à travers lui-même toute influence extérieure ». L'image du monde est générée par tous les processus cognitifs, étant en ce sens leur caractéristique intégrale.
Le concept d'« image du monde » se retrouve dans de nombreux ouvrages de psychologues étrangers, parmi lesquels le fondateur de la psychologie analytique, K.G. Garçon de cabine. Dans son concept, l’image du monde apparaît comme une formation dynamique : elle peut changer à tout moment, tout comme l’opinion d’une personne sur elle-même. Chaque découverte, chaque nouvelle pensée donne à l'image du monde de nouveaux contours.
DAKOTA DU SUD. Smirnov en déduit les principales qualités inhérentes à l'image du monde : l'intégrité et la cohérence, ainsi qu'une dynamique hiérarchique complexe. DAKOTA DU SUD. Smirnov propose de distinguer les structures nucléaires et superficielles de l'image du monde. Il croit que l’image du monde est une formation nucléaire par rapport à ce qui apparaît en surface comme une image du monde formée de manière sensuelle (modale). »
Le concept d'« image du monde » est souvent remplacé par un certain nombre de termes - « image du monde », « schéma de réalité », « modèle de l'univers », « carte cognitive ». Dans les recherches des psychologues, les concepts suivants sont corrélés : « image du monde », « modèle du monde », « image du monde », « modèle informationnel de la réalité », « modèle conceptuel ».
L’image du monde comprend une composante historique, la vision du monde et l’attitude d’une personne, un contenu spirituel holistique et l’attitude émotionnelle d’une personne envers le monde. L'image reflète non seulement la composante personnelle, vision du monde et émotionnelle de la personnalité, mais également une composante particulière - l'état spirituel de l'époque, l'idéologie.
L'image du monde se forme comme une idée du monde, de sa structure externe et interne. L'image du monde, contrairement à la vision du monde, est un ensemble de connaissances idéologiques sur le monde, un ensemble de connaissances sur les objets et les phénomènes de la réalité. Pour comprendre la structure de l'image du monde, il est nécessaire de comprendre les voies de sa formation et de son développement.
GÉORGIE. Berulaeva note que dans l'image consciente du monde, il y a 3 couches de conscience : son tissu sensoriel (images sensorielles) ; des significations dont les porteurs sont des systèmes de signes formés sur la base de l'intériorisation de significations objectives et opérationnelles ; signification personnelle.
La première couche est le tissu sensoriel de la conscience – ce sont des expériences sensorielles.
La deuxième couche de conscience est constituée de significations. Les porteurs de sens sont des objets de culture matérielle et spirituelle, des normes et des comportements inscrits dans les rituels et les traditions, les systèmes de signes et, surtout, le langage. Le sens enregistre des manières socialement développées d'agir avec la réalité et dans la réalité. L'intériorisation des significations opérationnelles et subjectives fondées sur des systèmes de signes conduit à l'émergence de concepts (significations verbales).
La troisième couche de conscience est formée par les significations personnelles. Contenu objectif porté par des événements, phénomènes ou concepts spécifiques, c'est-à-dire ce qu'ils signifient pour la société dans son ensemble et pour le psychologue en particulier peut différer considérablement de ce que l'individu découvre en eux. Une personne reflète non seulement le contenu objectif de certains événements et phénomènes, mais enregistre en même temps son attitude à leur égard, vécue sous forme d'intérêt et d'émotion. Le concept de sens n'est pas associé au contexte, mais au sous-texte, faisant appel à la sphère affective-volontaire. Le système de significations change et se développe constamment, déterminant finalement le sens de toute activité individuelle et de la vie en général, tandis que la science se préoccupe principalement de la production de significations.
Ainsi, l'image du monde est comprise comme un certain système global ou ordonné à plusieurs niveaux de la connaissance d'une personne sur le monde, sur elle-même, sur les autres, qui médiatise et réfracte à travers elle toute influence extérieure.
L'image du monde est une attitude holistique personnellement conditionnée, initialement non réfléchie, du sujet envers lui-même et envers le monde qui l'entoure, portant en lui les attitudes irrationnelles d'une personne.
L'image mentale contient une signification personnelle cachée, la signification personnelle des informations qui y sont imprimées.
L'image du monde est en grande partie mythologique, c'est-à-dire qu'elle n'est réelle que pour la personne dont elle est l'image.
Une étude prescriptive des processus cognitifs d’un individu dans le contexte de son image subjective du monde, tels qu’ils se développent chez cet individu au cours du développement de l’activité cognitive. C'est une image multidimensionnelle du monde, une image de la réalité.
Littérature.
Léontiev A.N. Psychologie de l'image // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 14. Psychologie. 1979, N 2, p. 3 à 13.
Dictionnaire psychologique. 2000 .
Voyez ce qu'est « Image du monde » dans d'autres dictionnaires :
image du monde- un système holistique et à plusieurs niveaux des idées d'une personne sur le monde, les autres, elle-même et ses activités. Le concept d'O. M. incarne l'idée d'intégrité et de continuité dans l'origine, le développement et le fonctionnement de la sphère cognitive de l'individu. O.m...
IMAGE DU MONDE- un système holistique et à plusieurs niveaux des idées d'une personne sur le monde, les autres, elle-même et ses activités. La nature active d'O. m. se manifeste dans la présence, ainsi que dans les coordonnées spatiales et temporelles caractéristiques du monde physique... ... Psychomotricité : dictionnaire-ouvrage de référence
IMAGE DU MONDE- un système holistique à plusieurs niveaux des idées d'une personne sur le monde, les autres, elle-même et ses activités, un système plus ou moins conscient des idées d'une personne sur elle-même... Dictionnaire d'orientation professionnelle et de soutien psychologique
Un concept psychologique, un modèle abstrait stable qui décrit les caractéristiques et les visions communes du monde de différentes personnes et qui est caractéristique de ces individus. L'image invariante du monde est directement corrélée aux significations et autres supports socialement développés... Wikipédia
L’image subjective du monde d’un enfant- le système d'idées d'un enfant sur la réalité environnante, naturelle et sociale, sur sa place dans celle-ci. Donc. m inclut également l’attitude envers cette réalité et envers soi-même et détermine ainsi la position de l’enfant. Donc. m., qui... ... Dictionnaire encyclopédique de psychologie et de pédagogie
1. Énoncé de la question. 2. O. en tant que phénomène d'idéologie de classe. 3. Individualisation de la réalité en O.. 4. Typification de la réalité en O. 5. Fiction en O. 6. O. et imagerie ; système O. 7. Contenu O. 8. Social... ... Encyclopédie littéraire
image- une image subjective du monde ou de ses fragments, incluant le sujet lui-même, d'autres personnes, l'environnement spatial et la séquence temporelle des événements. En psychologie, le concept d'O. est utilisé dans plusieurs sens. Parallèlement à l'agrandissement... ... Grande encyclopédie psychologique
1. IMAGE, une ; PL. images; m. 1. Apparence, apparence ; apparence, apparence. Dieu a créé l'homme à sa propre image et ressemblance. Je me souviens souvent de son doux Père. O. du jeune Tchekhov est capturé en photographie. C'était un véritable diable sous la forme de... ... Dictionnaire encyclopédique
Image- IMAGE (en poésie). La question de la nature de l’image poétique fait partie des questions les plus complexes de la poétique, car elle recoupe plusieurs problèmes d’esthétique jusqu’à présent non résolus. Tout d’abord, ceux étroits et superficiels… Dictionnaire des termes littéraires
Sociologique philosophique. une catégorie qui couvre l'ensemble des types typiques d'activité de vie d'un individu, d'un groupe social et de la société dans son ensemble, qui est prise en unité avec les conditions de vie. Offre la possibilité de manière globale, en interconnexion... ... Encyclopédie philosophique
Livres
- L'image du monde - le monde des images, Rashid Dominov. L'album proposé est à ce jour la représentation la plus complète de l'œuvre du célèbre artiste pétersbourgeois Rashid Dominov. Le livre, compilé par l'auteur lui-même, comprend ses...
- Image du monde. Textes, voix, mémoire. À l'occasion du 80e anniversaire de la naissance de N. L. Leiderman (1939-2010), Leiderman Naum Lazarevich. Le livre de Naum Lazarevich Leiderman (1939-2010), critique littéraire exceptionnel et fondateur de l'école scientifique de philologie de l'Oural, comprend une collection de ses articles sélectionnés sur la théorie et l'histoire...
1.2 L'essence du concept d'« image du monde » en psychologie
Le concept d'« image du monde » a été introduit par A.N. Léontiev, considérant les problèmes de perception. Selon lui, la perception n'est pas seulement le reflet de la réalité ; elle comprend non seulement une image du monde, mais aussi des concepts dans lesquels les objets de la réalité peuvent être décrits. Autrement dit, dans le processus de construction d'une image d'un objet ou d'une situation, l'importance principale n'est pas les impressions sensorielles individuelles, mais l'image du monde dans son ensemble.
Développement du concept d'« image du monde » par A.N. Léontiev est associé à sa théorie psychologique générale de l'activité. Selon A.V. Petrovsky, la formation de l'image du monde se produit dans le processus d'interaction du sujet avec le monde, c'est-à-dire par l'activité.
Psychologie de l'image, au sens d'A.N. Léontiev, il s'agit spécifiquement d'une connaissance scientifique sur la manière dont, au cours de leurs activités, les individus construisent une image du monde - le monde dans lequel ils vivent, agissent, qu'ils refont eux-mêmes et dont ils ont en partie conscience ; c'est aussi une connaissance du fonctionnement de l'image du monde, médiatisant leurs activités dans le monde réel objectif. Il a noté que l'image du monde, en plus des quatre dimensions de la réalité de l'espace-temps, a également une cinquième quasi-dimension - la signification de ce qui se reflète pour le sujet dans les connexions intra-systémiques objectives connues du monde objectif. .
UN. Léontiev, parlant de « l'image du monde », a voulu souligner la différence entre les concepts de « monde des images » et d'« image du monde », s'adressant aux chercheurs en perception. Si nous considérons d’autres formes de réflexion émotionnelle du monde, nous pourrions alors utiliser d’autres termes, comme par exemple « le monde des expériences » (ou des sentiments) et « l’expérience (le sentiment) du monde ». le processus de représentation pour décrire ce concept, nous pouvons alors utiliser le concept de « représentation du monde ».
Une discussion plus approfondie du problème de « l'image du monde » a conduit à l'émergence de deux positions théoriques. La première position inclut le concept selon lequel chaque phénomène ou processus mental a son propre porteur, sujet. Autrement dit, une personne perçoit et expérimente le monde comme un être mental intégral. Lors de la modélisation même d'aspects individuels du fonctionnement des processus cognitifs privés, les processus cognitifs sont pris en compte. La deuxième disposition complète la première. Selon lui, toute activité humaine est médiatisée par sa vision individuelle du monde et sa place dans ce monde.
V.V. Petukhov estime que la perception de tout objet ou situation, d'une personne spécifique ou d'une idée abstraite est déterminée par une image holistique du monde et par l'ensemble de l'expérience de la vie d'une personne dans le monde, sa pratique sociale. Ainsi, l’image (ou la représentation) du monde reflète ce contexte historique spécifique – écologique, social, culturel – dans lequel (ou au sein duquel) se déroule toute l’activité mentale humaine. À partir de cette position, l'activité est décrite du point de vue des exigences qui, lors de son exécution, sont posées à la perception, à l'attention, à la mémoire, à la pensée, etc.
Selon S.D. Smirnov, le monde réel se reflète dans la conscience comme une image du monde sous la forme d'un système à plusieurs niveaux d'idées d'une personne sur le monde, les autres, lui-même et ses activités. L’image du monde est « une forme universelle d’organisation des connaissances qui détermine les possibilités de gestion cognitive et comportementale ».
Les AA Léontiev identifie deux formes d'image du monde :
1. situationnel (ou fragmentaire) - c'est-à-dire une image du monde qui n'est pas incluse dans la perception du monde, mais qui est totalement réflexive, éloignée de notre action dans le monde, notamment de la perception (comme par exemple lors du travail de mémoire ou d'imagination) ;
2. non situationnel (ou global) - c'est-à-dire une image d'un monde intégral, une sorte de schéma (image) de l'univers.
De ce point de vue, l’image du monde est réflexion, c’est-à-dire compréhension. L'image de la vision du monde d'A.N. Léontiev la considère comme une éducation liée à l'activité humaine. Et l'image du monde comme composante du sens personnel, comme sous-système de conscience. De plus, selon E.Yu. Artemyeva, l'image du monde naît simultanément dans la conscience et dans l'inconscient.
L'image du monde agit comme une source de certitude subjective, permettant de percevoir sans ambiguïté des situations objectivement ambiguës. Le système d'attentes aperceptives qui naît sur la base de l'image du monde dans une situation spécifique influence le contenu des perceptions et des idées, générant des illusions et des erreurs de perception, ainsi que déterminant la nature de la perception de stimuli ambigus dans une telle situation. manière dont le contenu réellement perçu ou représenté correspond à l'image holistique du monde, aux structures sémantiques qui la structurent et aux interprétations, attributions et prédictions qui en résultent concernant une situation donnée, ainsi qu'aux attitudes sémantiques actuelles.
Dans les travaux d'E.Yu. L'image du monde d'Artemyev est comprise comme un « intégrateur » de traces d'interaction humaine avec la réalité objective. » Du point de vue de la psychologie moderne, l'image du monde est définie comme un système intégral à plusieurs niveaux d'idées d'une personne sur le monde. , les autres, sur lui-même et ses activités, un système « qui médiatise, réfracte à travers lui-même toute influence extérieure ». L'image du monde est générée par tous les processus cognitifs, étant en ce sens leur caractéristique intégrale.
Le concept d'« image du monde » se retrouve dans de nombreux ouvrages de psychologues étrangers, parmi lesquels le fondateur de la psychologie analytique, K.G. Garçon de cabine. Dans son concept, l’image du monde apparaît comme une formation dynamique : elle peut changer à tout moment, tout comme l’opinion d’une personne sur elle-même. Chaque découverte, chaque nouvelle pensée donne à l'image du monde de nouveaux contours.
DAKOTA DU SUD. Smirnov en déduit les principales qualités inhérentes à l'image du monde : l'intégrité et la cohérence, ainsi qu'une dynamique hiérarchique complexe. DAKOTA DU SUD. Smirnov propose de distinguer les structures nucléaires et superficielles de l'image du monde. Il croit que l’image du monde est une formation nucléaire par rapport à ce qui apparaît en surface comme une image du monde formée de manière sensuelle (modale). »
Le concept d'« image du monde » est souvent remplacé par un certain nombre de termes - « image du monde », « schéma de réalité », « modèle de l'univers », « carte cognitive ». Dans les recherches des psychologues, les concepts suivants sont corrélés : « image du monde », « modèle du monde », « image du monde », « modèle informationnel de la réalité », « modèle conceptuel ».
L’image du monde comprend une composante historique, la vision du monde et l’attitude d’une personne, un contenu spirituel holistique et l’attitude émotionnelle d’une personne envers le monde. L'image reflète non seulement la composante personnelle, vision du monde et émotionnelle de la personnalité, mais également une composante particulière - l'état spirituel de l'époque, l'idéologie.
L'image du monde se forme comme une idée du monde, de sa structure externe et interne. L'image du monde, contrairement à la vision du monde, est un ensemble de connaissances idéologiques sur le monde, un ensemble de connaissances sur les objets et les phénomènes de la réalité. Pour comprendre la structure de l'image du monde, il est nécessaire de comprendre les voies de sa formation et de son développement.
GÉORGIE. Berulaeva note que dans l'image consciente du monde, il y a 3 couches de conscience : son tissu sensoriel (images sensorielles) ; des significations dont les porteurs sont des systèmes de signes formés sur la base de l'intériorisation de significations objectives et opérationnelles ; signification personnelle.
La première couche est le tissu sensoriel de la conscience – ce sont des expériences sensorielles.
La deuxième couche de conscience est constituée de significations. Les porteurs de sens sont des objets de culture matérielle et spirituelle, des normes et des comportements inscrits dans les rituels et les traditions, les systèmes de signes et, surtout, le langage. Le sens enregistre des manières socialement développées d'agir avec la réalité et dans la réalité. L'intériorisation des significations opérationnelles et subjectives fondées sur des systèmes de signes conduit à l'émergence de concepts (significations verbales).
La troisième couche de conscience est formée par les significations personnelles. Contenu objectif porté par des événements, phénomènes ou concepts spécifiques, c'est-à-dire ce qu'ils signifient pour la société dans son ensemble et pour le psychologue en particulier peut différer considérablement de ce que l'individu découvre en eux. Une personne reflète non seulement le contenu objectif de certains événements et phénomènes, mais enregistre en même temps son attitude à leur égard, vécue sous forme d'intérêt et d'émotion. Le concept de sens n'est pas associé au contexte, mais au sous-texte, faisant appel à la sphère affective-volontaire. Le système de significations change et se développe constamment, déterminant finalement le sens de toute activité individuelle et de la vie en général, tandis que la science se préoccupe principalement de la production de significations.
Ainsi, l'image du monde est comprise comme un certain système global ou ordonné à plusieurs niveaux de la connaissance d'une personne sur le monde, sur elle-même, sur les autres, qui médiatise et réfracte à travers elle toute influence extérieure.
L'image du monde est une attitude holistique personnellement conditionnée, initialement non réfléchie, du sujet envers lui-même et envers le monde qui l'entoure, portant en lui les attitudes irrationnelles d'une personne.
L'image mentale contient une signification personnelle cachée, la signification personnelle des informations qui y sont imprimées.
L'image du monde est en grande partie mythologique, c'est-à-dire qu'elle n'est réelle que pour la personne dont elle est l'image.
Caractéristiques biorythmiques du travail d'un adolescent
Chaque personne est caractérisée par un certain niveau d'anxiété - il s'agit d'une caractéristique naturelle et obligatoire de l'activité humaine active. Le dictionnaire psychologique donne la définition suivante du terme « anxiété ». 1...
La relation entre les types de motivation éducative et cognitive et l'anxiété chez les lycéens
Le problème de l'anxiété n'intéresse pas moins les psychologues que le problème de la motivation. Ainsi, dans la littérature psychologique, on peut trouver différentes définitions du concept d'« anxiété »...
L'influence de l'image de la famille parentale sur les spécificités des relations familiales dans le mariage
Le premier chapitre examine les concepts d'image du monde et d'image de la famille dans les travaux de psychologues étrangers et nationaux ; les traits de la structure de l'image familiale sont révélés ; critères de détermination. Le concept du mariage est décrit...
Recherche sur la personnalité en psychologie sociale
Le concept de « personnalité » fait référence à la plupart des concepts les plus vagues et les plus controversés de la science psychologique. Autant il existe de théories sur la personnalité, autant il existe de définitions et d'opinions de psychologues à ce sujet...
L'image du monde des jeunes et des retraités. Analyse comparative
L’image d’un enseignant professionnel dans l’esprit des lycéens
Caractéristiques du leadership chez les jeunes délinquants
Le problème du leadership est envisagé par les psychologues nationaux et étrangers. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’ont donné une définition unique de ce phénomène psychologique…
Caractéristiques de l'estime de soi d'une personnalité narcissique
Dans le concept de psychiatrie dynamique, le narcissisme est considéré comme l'une des fonctions centrales du soi, qui joue dans un premier temps un rôle constructif, en tant que régulateur des processus d'échange énergie-information entre le soi isolé et la société...
La représentation comme phénomène psychologique
Un siècle après Kant, une autre transformation du concept d’image se prépare. Freud a commencé son exploration des recoins de l’esprit humain par l’analyse d’images mentales. Rêves...
Le problème du développement en psychologie et en philosophie
Le principe du développement est de la plus haute importance pour la construction de la psychologie en tant que science axée sur l'étude des modèles objectifs de la personnalité humaine et de son psychisme.
Déterminants psychologiques de la solitude chez les personnes âgées
« La solitude est un sentiment douloureux d'écart croissant avec les autres, la peur des conséquences d'un mode de vie solitaire, une expérience difficile associée à la perte des valeurs de la vie ou des proches, un sentiment constant d'abandon...
Représentation de l'image de la famille dans l'esprit des enfants
Le développement de la personnalité d’un enfant d’âge préscolaire est déterminé par l’influence de la famille en tant que microenvironnement social important pour l’enfant. La situation dans la famille, que les adultes évaluent comme favorable et défavorable...
Comparaison de la vision du monde des personnes qui pratiquent et ne pratiquent pas le rêve lucide
L’image du monde est « un système holistique à plusieurs niveaux d’idées d’une personne sur le monde, les autres, elle-même et ses activités ». Ce terme a été introduit par A.N. Léontiev Léontiev A.N. 1983 à 1979. Dans le travail du V.P....
Formation d'une attitude envers un mode de vie sain chez les adolescents dans le cadre d'un travail éducatif parascolaire
La santé est le facteur le plus important dans la mise en œuvre du programme de vie d’un individu. Un mode de vie sain est une manière intégrale d'être d'un individu dans le monde externe et interne, ainsi qu'un système de relations entre une personne et elle-même et des facteurs environnementaux...