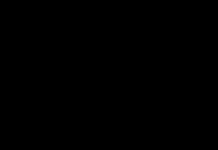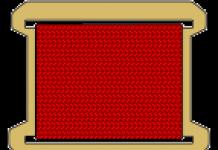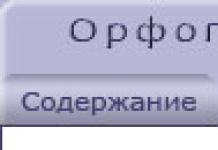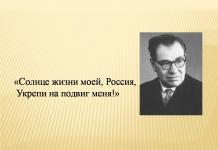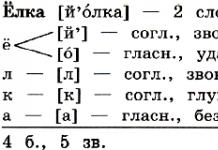Pensée - cognition indirecte et généralisée
le monde environnant.
Pensée et parole.
Formes de base de la pensée.
Opérations mentales.
Les concepts et leur formation.
Résoudre les problèmes mentaux.
Types de pensée.
Qualités de l'esprit.
Quelques caractéristiques de la pensée des jeunes
les écoliers.
Une personne non seulement perçoit le monde qui l'entoure, mais veut également le comprendre. Comprendre signifie pénétrer dans l'essence des objets et des phénomènes, en connaître les choses les plus importantes et les plus essentielles. La compréhension est assurée par le processus mental cognitif le plus complexe appelé pensée.
6.1. Pensée - connaissance indirecte et généralisée du monde environnant
Les sensations et les perceptions permettent de percevoir directement des objets et des phénomènes individuels. monde réel. Avec l'aide de nos sens, nous percevons directement la réalité. Par exemple, nous regardons un mur et voyons sa couleur ; nous déterminons la taille de deux crayons différents posés devant nous ; nous percevons cette figure comme un triangle. Nous pouvons déterminer directement quel temps il fait aujourd'hui : nous sommes sortis ou sur le balcon et avons découvert s'il faisait froid ou chaud. Mais vous pouvez déterminer la météo sans quitter la maison, indirectement, en utilisant un thermomètre prévu à cet effet. En voyant dans quelle division se trouve le mercure, nous déterminerons s'il fait chaud ou froid dehors maintenant. Dans ce cas, on suppose qu’il existe une relation entre la hauteur de la colonne de mercure et la température de l’air (il n’y a aucun lien entre la hauteur d’un crayon, par exemple, et la température de l’air). Ainsi, le thermomètre est un outil qui permet de répondre à la question : quel temps fait-il ? Et nous avons appris la température de l'air non pas directement par le biais de sensations et de perceptions, mais indirectement. Le baromètre nous aide à connaître la pression atmosphérique car il existe une relation entre la pression atmosphérique et la lecture de l'aiguille du baromètre. Ce type de cognition n'est pas une indication directe de nos analyseurs, mais est une cognition indirecte.
Si dans les sensations la réalité se reflète par ses aspects individuels, qualités, signes et dans la perception - dans la totalité de toutes ces qualités et signes, alors à travers la pensée, on réalise le reflet de telles caractéristiques, propriétés, signes et phénomènes qui ne peuvent généralement pas être connu uniquement à l’aide des sens. ~
Encore un exemple. Pouvez-vous mesurer la hauteur d’un arbre ? C’est possible, mais mesurer directement sa hauteur avec une règle est à la fois difficile et prend du temps. Ensuite, une personne, à l'heure où la longueur de son ombre est égale à sa taille, mesure l'ombre de l'arbre et apprend ainsi, grâce à la longueur de l'ombre, la hauteur de l'arbre, c'est-à-dire apprend indirectement. Et la connaissance ainsi obtenue est une connaissance médiatisée, et le processus d'acquisition de cette connaissance, qui est un processus de pensée, s'avère être médiatisé par la connaissance de la réalité.
La vie pose constamment des problèmes qui ne peuvent être résolus en s'appuyant uniquement sur la perception des objets et des phénomènes environnants ou sur le souvenir de ce qui a déjà été perçu auparavant. De nombreuses questions doivent recevoir une réponse indirecte, en tirant des conclusions à partir d'objets, de phénomènes et de faits individuels similaires déjà existants.
Une réflexion (cognition) généralisée de la réalité est la caractéristique la plus importante de la pensée. L’expérience d’une personne ne fournit pas toujours suffisamment d’éléments pour généraliser. Dans leurs activités, les gens s'appuient constamment sur une expérience commune apprise des autres, généralisée et inscrite dans le langage. Les généralisations reflètent les propriétés générales et donc les plus essentielles des objets et des phénomènes, leurs connexions générales et donc naturelles. En généralisant, on comprend l’essence du sujet. Ce n'est qu'avec l'aide de la pensée que nous reconnaissons ce qui est commun aux objets et aux phénomènes, ces connexions naturelles et essentielles entre eux qui sont directement inaccessibles à la sensation et à la perception et qui constituent l'essence, le modèle de la réalité objective. Par conséquent, nous pouvons dire que la pensée est le reflet de connexions naturelles et essentielles.
Donc, la pensée est un processus de cognition (réflexion) indirecte et généralisée du monde environnant.
6.2. Pensée Etdiscours
Une caractéristique extrêmement importante de la pensée est lien inextricable avec la parole. En soulignant quelque chose de commun dans les objets et les phénomènes du monde environnant, une personne le désigne avec des mots. Grâce à la parole, une personne apprend pour la première fois quelque chose qu'elle n'a pas encore vu (et qu'elle ne verra peut-être jamais !)
Dans le merveilleux livre « Un mot sur les mots », L. Uspensky écrit : « De la petite enfance à un âge très avancé, la vie entière d'une personne est inextricablement liée au langage. L'enfant n'a pas encore appris à parler correctement, mais son audition claire capte déjà le murmure des contes de fées de grand-mère... Un adolescent va à l'école. Un jeune homme va au collège ou à l’université. Toute une mer de mots, un océan bruyant de paroles, l'attrape là, derrière les larges portes. À travers les conversations animées des professeurs, à travers les pages de centaines de livres, il voit pour la première fois un univers immensément complexe reflété dans les mots... Une nouvelle personne se lie aux pensées anciennes, à celles qui se sont formées dans la tête de milliers de personnes. des années avant sa naissance. Il a lui-même l'occasion de s'adresser à ses arrière-petits-enfants qui vivront des siècles après sa mort. Et tout cela n’est possible que grâce au langage.
Dans le système linguistique, chaque mot se voit historiquement attribuer un certain signification. Le sens d'un mot est toujours une généralisation. Une personne pense à l'aide du langage, en utilisant des mots. Il y a un discours formulaire pensée. Les pensées prennent toujours la forme de discours. Chacun peut être convaincu du lien étroit entre la parole et la pensée s’il se pose la question : dans quelle langue parle-t-on ?
La parole n’est pas seulement une forme, mais aussi un outil de réflexion. En exprimant nos pensées sous forme verbale détaillée, nous contribuons au succès de l'activité mentale. La parole vous aide à réfléchir. Le besoin exprimera !, une pensée en mots, la communiquer à un autre nécessite souvent une réflexion supplémentaire et approfondie. Dans ces cas-là, nous remarquons qu’une partie de ce que nous pensions déjà clair et compréhensible nécessite des éclaircissements, une réflexion plus profonde et plus approfondie. Le choix des mots et des expressions nécessaires à un message nous incite à réfléchir dans les détails de la pensée, parfois même dans les nuances les plus subtiles de son contenu. Parler immédiatement de quelque chose à une autre personne est le meilleur moyen de comprendre votre propre pensée et de réfléchir à son contenu jusqu'au bout. Le lien indissociable entre la pensée et la parole ne signifie pas pour autant que la pensée se réduit à la parole. La pensée et la parole, la pensée et la parole ne sont pas identiques. La même pensée peut être exprimée dans différentes langues. Le même mot peut exprimer différents concepts - ce sont des homonymes, par exemple clé, tresse, stylo, etc. Et un concept peut être exprimé par différents mots - ce sont des synonymes ; par exemple, chemin - route, tyran - tyran, frontière - limite, etc.
Comme tout processus mentaux, la pensée est une activité du cerveau. Il s'agit d'une activité analytique et synthétique complexe réalisée par le travail conjoint des deux systèmes de signalisation. De plus, puisque la pensée est le reflet de la réalité généralisée à l'aide de mots, le rôle principal dans cette activité est joué par le deuxième système de signalisation. Son interaction constante et étroite avec le premier s/s détermine le lien inextricable entre le reflet généralisé de la réalité, qu'est la pensée, et la connaissance sensorielle du monde objectif à travers les sensations, les perceptions et les idées.
Les mécanismes physiologiques de la parole elle-même constituent l'activité de deuxième signal du cortex, qui est un travail complexe et coordonné de nombreux groupes de cellules nerveuses du cortex cérébral. 6.3. Formes de base de la pensée
N'importe lequel processus de réflexion réalisé sous la forme jugements qui sont toujours exprimés en mots, même si les mots ne sont pas prononcés à voix haute.
Jugement- c'est une déclaration de quelque chose à propos de quelque chose, une affirmation ou un déni de toute relation entre 1 entre des objets ou des phénomènes, entre certains signes d'eux.
En d’autres termes, le jugement est une forme de pensée dans laquelle quelque chose est affirmé ou nié. Par exemple, la proposition « Après l’éclair vient le tonnerre » affirme l’existence d’une certaine connexion temporelle entre deux phénomènes de la nature. Une proposition peut être vraie ou fausse. Par exemple, la proposition « Toutes les planètes tournent autour du soleil » est vraie, mais la proposition « Vous réussirez tous à l’examen de psychologie » est problématique. Chaque jugement prétend être vrai, mais aucun n’est une vérité absolue. Une vérification mentale et pratique du jugement est donc nécessaire. Toute hypothèse est un exemple clair de la nécessité de tester et de prouver le jugement exprimé. Le travail de réflexion sur un jugement, visant à établir et à vérifier sa vérité, s'appelle raisonnement.
À Nous arrivons à des jugements à la fois directement, lorsqu'ils expriment ce qui est perçu (« Le public est assez bruyant », « Toutes les routes sont couvertes de neige », etc.), et indirectement - par des déductions.
Jugement direct : « Le garçon mange une pomme. » Rétrécissement indirect : « Un chien est un animal. »
Les jugements peuvent ou non correspondre à la réalité, c'est pourquoi une distinction est faite entre les jugements vrais, faux (erronés) et conjecturaux.
De vrais jugements sur n'importe quel sujet, il existe des connaissances sur ce sujet. Par exemple, « Le mercure est un conducteur d'électricité », « Moscou est la capitale de la Russie ».
Jugements faux ou erronés exprimer son ignorance : « Deux fois trois font huit. »
Présomptif sont appelées propositions qui peuvent être vraies ou fausses, c'est-à-dire ils peuvent être vrais ou non. Par exemple : « Peut-être qu'il pleuvra demain. »
Avoir un jugement, c'est affirmer ou nier quelque chose : « Cette table est en bois. » connaissance. À travers les pensées, une personne connaît indirectement les propriétés générales, c'est-à-dire grâce à d’autres connaissances acquises antérieurement. C’est à ce stade qu’il devient possible de comprendre ce qu’une personne elle-même ne peut pas voir, entendre, ressentir, ressentir et imaginer. Par exemple, un médecin pose un diagnostic sur la base des symptômes d’une maladie. Il en tire des conclusions conformément aux connaissances acquises auparavant.
Ainsi, la recherche d'une réponse, qui ne peut être obtenue directement à partir de perceptions ou par le rappel de faits précis, mais nécessite des conclusions à partir de connaissances acquises, est une activité mentale. Et la caractéristique la plus essentielle des processus de pensée est qu'une personne va au-delà de l’expérience immédiate. La nature indirecte de la pensée nous donne la possibilité d'élargir considérablement notre connaissance de la réalité. La portée de ce que nous pensons est plus large que ce que nous percevons. Basé sur la perception, mais en dépassant ses limites, nous apprenons en pensant au passé lointain de la terre, à l'évolution de la flore et de la faune, à l'histoire de l'humanité, nous découvrons de nouvelles lois, etc. Grâce à tout cela raisonnements, nous pouvons maintenant dire que pensée - Ce cognition indirecte(ou reflet) de la réalité.
Mais la pensée n'est pas seulement médiatisée, mais aussi cognition généralisée(reflet) du monde environnant.
Les sensations et les perceptions nous donnent une connaissance de l'individu - des objets et phénomènes individuels (ou de leurs aspects, propriétés, qualités) du monde réel. Une telle connaissance ne peut en aucun cas être suffisante. La vie et la pratique nécessitent la capacité de prévoir les résultats de nos actions, les conséquences des divers phénomènes et événements que nous percevons. La connaissance d’un individu ne constitue pas une base suffisante pour la prévoyance. Chaque conclusion, même la plus simple, nécessite une certaine sorte de connaissances et de généralisations faites au préalable. La propriété générale s’applique également à ce cas. Voici par exemple une feuille de papier. Que deviendra-t-il s’il est jeté au feu ? Cela va brûler. Pourquoi savons-nous cela, parce que nous n'avons pas jeté cette feuille au feu. Mais nous avons vu du papier brûler à plusieurs reprises. Nous avons résumé ces faits et maintenant nous le savons. Et s’ils nous montraient une feuille de matière inconnue ? Nous ne répondrions pas avec autant de confiance. Par conséquent, pour prévoir, il est nécessaire de généraliser des objets, des phénomènes, des faits individuels et, sur la base de ces généralisations, de tirer des conclusions concernant Inférence- une forme de pensée qui permet à une personne de tirer une nouvelle conclusion à partir d'une série de jugements. En d’autres termes, sur la base de l’analyse et de la comparaison des jugements existants, un nouveau jugement est rendu.
Il existe deux principaux types d’inférences : inductives et déductives, ou induction et déduction.
Induction est une inférence à partir de cas particuliers situation générale. L'induction commence par l'accumulation de connaissances diverses sur des objets et des phénomènes homogènes, ce qui permet d'y trouver ce qui est essentiellement similaire et essentiellement différent et d'omettre ce qui est sans importance et secondaire. Résumant les caractéristiques similaires de ces objets et phénomènes, ils constituent une nouvelle conclusion générale, ou conclusion, établit une règle ou une loi générale. Par exemple, on sait que l'or, le cuivre, le fer et la fonte sont fondus. Par conséquent, de ces jugements nous pouvons déduire une nouvelle proposition générale : « Tous les métaux en fusion ».
Déduction- une telle inférence dans laquelle la conclusion va d'un jugement général à un jugement individuel ou d'une position générale à un cas particulier. Par exemple, deux propositions : « Tous les corps se dilatent lorsqu'ils sont chauffés » et « L'air est un corps ». D’où la conclusion (nouveau jugement) : « Par conséquent, l’air se dilate lorsqu’il est chauffé. »
Les deux types d’inférences – l’induction et la déduction – sont étroitement liées l’une à l’autre. Les processus de raisonnement complexes représentent toujours une chaîne d’inférences dans laquelle les deux types de conclusions sont entrelacées et interagissent.
Avec l'aide de nos sens, nous percevons directement la réalité. Par exemple, nous regardons un mur et voyons sa couleur ; nous déterminons la taille de deux crayons différents posés devant nous ; nous percevons cette figure comme un triangle. Nous pouvons déterminer directement quel temps il fait aujourd'hui : nous sommes sortis ou sur le balcon et avons découvert s'il faisait froid ou chaud. Mais vous pouvez déterminer la météo sans quitter la maison, indirectement, en utilisant un thermomètre prévu à cet effet. En voyant dans quelle division se trouve le mercure, nous déterminerons s'il fait chaud ou froid dehors maintenant. Dans ce cas, on suppose qu’il existe une relation entre la hauteur de la colonne de mercure et la température de l’air (il n’y a aucun lien entre la hauteur d’un crayon, par exemple, et la température de l’air).Les sensations et les perceptions permettent de percevoir directement des objets individuels et des phénomènes du monde réel.
Ainsi, le thermomètre est un outil qui permet de répondre à la question : quel temps fait-il ? Et nous avons appris la température de l'air non pas directement par le biais de sensations et de perceptions, mais indirectement. Le baromètre nous aide à connaître la pression atmosphérique car il existe une relation entre la pression atmosphérique et la lecture de l'aiguille du baromètre. Ce type de cognition n'est pas une indication directe de nos analyseurs, mais est une cognition indirecte.
Si dans les sensations la réalité se reflète par ses aspects individuels, qualités, signes et dans la perception - dans la totalité de toutes ces qualités et signes, alors à travers la pensée, on réalise le reflet de telles caractéristiques, propriétés, signes et phénomènes qui ne peuvent généralement pas être connu uniquement à l’aide des sens.
Encore un exemple. Pouvez-vous mesurer la hauteur d’un arbre ? C’est possible, mais mesurer directement sa hauteur avec une règle est à la fois difficile et prend du temps. Ensuite, une personne, à l'heure où la longueur de son ombre est égale à sa taille, mesure l'ombre de l'arbre et apprend ainsi, grâce à la longueur de l'ombre, la hauteur de l'arbre, c'est-à-dire apprend indirectement. Et la connaissance ainsi obtenue est une connaissance médiatisée, et le processus d'acquisition de cette connaissance, qui est un processus de pensée, s'avère être médiatisé par la connaissance de la réalité.
La vie pose constamment des problèmes qui ne peuvent être résolus en s'appuyant uniquement sur la perception des objets et des phénomènes environnants ou sur le souvenir de ce qui a déjà été perçu auparavant. De nombreuses questions doivent recevoir une réponse indirecte, en tirant des conclusions à partir des connaissances existantes. À travers les pensées, une personne connaît indirectement les propriétés générales, c'est-à-dire grâce à d’autres connaissances acquises antérieurement. C’est à ce stade qu’il devient possible de comprendre ce qu’une personne elle-même ne peut pas voir, entendre, ressentir, ressentir et imaginer. Par exemple, un médecin pose un diagnostic sur la base des symptômes d’une maladie. Il en tire des conclusions conformément aux connaissances acquises auparavant.
Ainsi, la recherche d'une réponse qui ne peut être obtenue directement à partir de perceptions ou en rappelant des faits spécifiques, mais nécessite des déductions à partir de connaissances acquises, est activité mentale. Et la caractéristique la plus essentielle des processus de pensée est qu'une personne va au-delà de l'expérience immédiate . La nature indirecte de la pensée nous donne la possibilité d'élargir considérablement notre connaissance de la réalité. La portée de ce que nous pensons est plus large que ce que nous percevons. Basé sur la perception, mais en dépassant ses limites, grâce à la pensée nous apprenons le passé lointain de la terre, l'évolution de la flore et de la faune, l'histoire de l'humanité, découvrons de nouvelles lois, etc. Grâce à tous ces raisonnements , nous pouvons maintenant dire que penser est cognition indirecte(ou reflet) de la réalité.
Mais la pensée n'est pas seulement médiatisée, mais aussi cognition généralisée(reflet) du monde environnant.
Les sensations et les perceptions nous donnent une connaissance de l'individu - des objets et phénomènes individuels (ou de leurs aspects, propriétés, qualités) du monde réel. Une telle connaissance ne peut en aucun cas être suffisante. La vie et la pratique nécessitent la capacité de prévoir les résultats de nos actions, les conséquences des divers phénomènes et événements que nous percevons. La connaissance d’un individu ne constitue pas une base suffisante pour la prévoyance. Chaque conclusion, même la plus simple, nécessite une certaine sorte de connaissances et de généralisations faites au préalable. Propriété générale s'applique également à ce cas. Voici par exemple une feuille de papier. Que deviendra-t-il s’il est jeté au feu ? Cela va brûler. Pourquoi savons-nous cela, parce que nous n'avons pas jeté cette feuille au feu. Mais nous avons vu du papier brûler à plusieurs reprises. Nous avons résumé ces faits et maintenant nous le savons. Et s’ils nous montraient une feuille de matière inconnue ? Nous ne répondrions pas avec autant de confiance. Par conséquent, pour prévoir, il est nécessaire de généraliser des objets, phénomènes, faits individuels et, sur la base de ces généralisations, tirer des conclusions concernant d'autres objets, phénomènes et faits individuels similaires.
Une réflexion (cognition) généralisée de la réalité est la caractéristique la plus importante de la pensée.
L’expérience d’une personne ne fournit pas toujours suffisamment d’éléments pour généraliser. Dans leurs activités, les gens s'appuient constamment sur une expérience commune apprise des autres, généralisée et inscrite dans le langage. Les généralisations reflètent les propriétés générales et donc les plus essentielles des objets et des phénomènes, leurs connexions générales et donc naturelles. En généralisant, on comprend l’essence du sujet. Ce n'est qu'avec l'aide de la pensée que nous reconnaissons ce qui est commun aux objets et aux phénomènes, ces connexions naturelles et essentielles entre eux qui sont directement inaccessibles à la sensation et à la perception et qui constituent l'essence, le modèle de la réalité objective. Par conséquent, nous pouvons dire que la pensée est le reflet de connexions naturelles et essentielles.
Donc, pensée est un processus de cognition (réflexion) indirecte et généralisée du monde environnant.
Dubrovina I. V. Psychologie : Manuel pour étudiants. moy. péd. écoles, institutions / I. V. Dubrovina, E. E. Danilova, A. M. Prikhozhan ; Éd. I. V. Dubrovina. - M. : Centre d'édition « Académie », 2004. - 464 p. p. 170-173.
La médiocrité de la pensée présente des caractéristiques spécifiques. La pensée est médiatisée par l'activité pratique humaine visant à maîtriser la réalité, la communication et la parole. Initialement, la connaissance de propriétés inaccessibles à la réflexion sensorielle est le résultat direct d'une activité visant des objectifs pratiques. Au fil du temps, les actions cognitives acquièrent un statut indépendant, des actions et activités internes (mentales) se forment visant à résoudre des problèmes cognitifs. Ceci est grandement facilité par la forme linguistique d'expression et la consolidation des informations reçues, ainsi que par l'échange d'expériences entre les personnes.
Au cours du développement ultérieur, l'activité mentale est séparée de l'activité pratique et devient le mode d'existence des individus.
La complexité croissante de l'activité cognitive pose une nouvelle tâche à une personne : l'étude de sa propre pensée. Le dialogue commence à être utilisé consciemment non seulement comme méthode de cognition, mais aussi de connaissance de soi. Un système de pensée correcte et disciplinée est en cours de développement, avec lequel commence le développement de la science logique.
La pensée a de profondes racines socio-historiques. Le rôle principal dans le développement de la pensée appartient au langage et à la parole scientifiques naturels. Comme le disait L.S. Vygotsky, non seulement les processus mentaux individuels, mais toute la conscience dans son ensemble doivent leur origine au mot.
La conscience, selon Vygotsky, a une structure systémique et sémantique. D’une part, c’est un système de fonctions mentales, d’autre part, un système de significations.
Dans les premiers stades du développement de ce système, la place centrale y est occupée par la perception, plus tard par la mémoire et même plus tard par la pensée. Chacun des processus mentaux tout au long du développement de la conscience a un effet inverse sur les fonctions mentales précédemment établies, les élevant à un niveau supérieur ; de plus, ces fonctions mentales transformées encouragent le développement ultérieur des processus qui ont contribué à leur transformation.
Pour un enfant d'âge préscolaire, écrit Vygotsky, penser signifie se souvenir, et pour un écolier, se souvenir signifie penser. La perception et la mémoire remplissent la pensée de contenu sensoriel. L'influence de la mémoire sur la perception se manifeste dans ses propriétés telles que la projectivité et l'aperception. La pensée donne du sens à la perception ; par conséquent, le sensoriel devient rationnel.
La pensée, comme tous les processus mentaux, est médiatisée par l'ensemble des produits de l'expérience culturelle et historique de l'humanité, y compris les méthodes de réalisation des activités qui sont apprises, appropriées et utilisées par l'individu dans sa vie.
Les moyens de pensée peuvent être et sont des structures d'ingénierie (instruments de mesure, dispositifs de suivi, ordinateurs), des conceptions graphiques (dessins, diagrammes, diagrammes, modèles), des intermédiaires signe-symbolique : des mots du langage naturel au discours étendu, des termes scientifiques individuels à des constructions théoriques détaillées, depuis des symboles logiques-mathématiques ou physiques individuels jusqu'à des formules reflétant les lois de connexions et de transformations d'éléments d'objets pertinents.
Tout ce qui est un but dans la pensée, une fois atteint, devient un moyen. Déterminer ce qu’est une fin et ce qu’est un moyen dépend de la nature des problèmes à résoudre. Sur cette base, toutes les formes de réflexion sensorielle de la réalité devraient être incluses dans la catégorie des moyens de pensée. La pensée se produit dans des situations de déficit d'expérience sensorielle, mais comprendre une situation complexe et découvrir des moyens de la résoudre n'est pas toujours le cas, mais se produit souvent par analogie avec ce qui est ressenti. La question suivante concerne les spécificités de la pensée en tant que processus. La réponse à cette question nous ramène au début, là où commence la réflexion.
L’ancien philosophe Platon a vu ce début avec émerveillement. Son élève Aristote - dans des raisons a priori : cibles, formelles, matérielles et motrices - prédéterminant la direction de l'action et sa conception sous forme de pensée pratique ou verbale. Parallèlement à cela, un autre type de pensée est introduit, qui ne doit pas son origine au corps (cause matérielle), qui n'est pas caractéristique de tout le monde, mais seulement de quelques privilégiés, et qui est appelée théorique, c'est-à-dire avoir une vision divine. nature.
Selon les enseignements du philosophe anglais du XVIIe siècle J. Locke, la pensée commence par des idées simples - des sensations dont la combinaison, médiée par des opérations, conduit à la formation d'idées complexes - des concepts.
Dans les enseignements du philosophe français R. Descartes, le point de départ de la pensée n'est pas la sensation ou la perception, mais le doute sur la vérité de la connaissance sensorielle. L'expérience sensorielle de maîtrise du réel, selon R. Descartes, est assurée par des mécanismes réflexifs communs aux humains et aux animaux. Les sentiments de doute sont propres aux humains. La conscience du fait même du doute donne lieu à un mouvement dans une direction perpendiculaire au sensoriel. C'est le début d'une réflexion.
Les enseignements des philosophes explorant la question des débuts de la pensée à partir de différentes positions théoriques, mais utilisant à ces fins la seule méthode d'introspection disponible à l'époque, ont eu une grande influence sur la psychologie du XXe siècle et des siècles présents. En psychologie moderne, on pense que la pensée surgit dans une situation problématique. Le premier signe, plus ou moins objectif, d'une situation problématique est l'arrêt d'un processus en cours (mouvement ou action) et la question posée au tout début. Forme générale, comme : qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, comment ? Les signes subjectifs d'une situation problématique sont : un état d'incertitude, de non-divulgation, d'incompréhensibilité des relations objectives qui s'y trouvent, un sentiment de confusion, de confusion ou de surprise. La question contient ces états et les exprime.
Une situation dans laquelle 2 déterminants principaux de l'action sont identifiés ou esquissés - l'objectif et la nécessité de l'atteindre, mais il n'existe aucun moyen prêt à l'emploi et actuellement établi pour atteindre l'objectif et satisfaire le besoin - est appelée problématique.
Dans la nature, les situations problématiques n'existent pas ; elles surviennent uniquement dans la vie ou l'activité humaine. Société humaine, ce qui incite à la recherche de nouveaux moyens et façons de satisfaire les besoins. F. Perls a qualifié de telles situations d'impasse et les a associées à des états de conscience vide, à l'absence de toute image ou idée dans l'esprit humain. Des situations problématiques ou similaires marquent une transition de ce qui est à ce qui n'est pas, mais ne sera que, de la reproduction de l'expérience passée de l'activité humaine à la construction d'idées nouvelles.
L'état d'incertitude et la conscience de l'existence d'une situation problématique, contenus dans des questions de type général, agissent comme un début de réflexion motivant. Ensuite, des processus analytiques-synthétiques entrent en jeu, grâce auxquels le sujet de la pensée sépare ce qui lui est donné dans cette situation de ce qui est inconnu et qu'il faut trouver. En conséquence, le sujet est défini dans une situation problème et la situation se transforme en tâche. Ceci met fin à la première phase de la réflexion en tant que processus.
La formulation même du problème, comme l’écrit S.L. Rubinstein, est un acte de réflexion. Formuler une question signifie s'élever à une compréhension connue, et comprendre une tâche ou un problème signifie trouver un moyen, c'est-à-dire une méthode pour le résoudre.
De la prise de conscience du problème, le sujet passe à sa résolution immédiate. Cette démarche s'effectue sous la forme de tests pratiques d'une situation problématique ou de formulation et de test d'hypothèses. Dans les formes de pensée les plus développées, ce processus se réalise sous la forme d'une activité hypothético-déductive consciente.
Choisir l'idée la plus réussie ou développer (inventer) une manière adéquate de résoudre un problème signifie passer à la dernière phase - la formulation du produit de la réflexion sous la forme de jugements, de conclusions ou de transformations pratiques de la situation problématique dans le sens de sa résolution et résolution. Dans la dernière et dernière phase de la réflexion, les conditions sont créées pour que le sujet revienne au processus interrompu par la situation problématique et rétablisse le processus en cours, à moins, bien sûr, que les facteurs qui le motivent n'aient perdu leur pertinence.
Les phases sont des unités de pensée assez larges, tout à fait accessibles à l'observation externe ou à l'introspection (auto-observation), si le sujet en possède une telle capacité. La dynamique des phases reflète la cyclicité, l'intégrité structurelle et l'exhaustivité de la pensée en tant que processus de résolution de problèmes. Une question logique se pose : quels moyens spécifiques sont utilisés pour mettre en œuvre chacune des phases et l'ensemble du cycle dans son ensemble ?
En expérimental et psychologie pratique contient une réponse assez précise à cette question - à l'aide d'opérations. La pensée est un processus opérationnel. Les opérations de pensée les plus étudiées sont : l'analyse et la synthèse, la comparaison, l'abstraction, la généralisation et la concrétisation. Considérons chacun d'eux séparément.
Analyser signifie diviser un tout en parties ; synthèse - la réunification des parties et la formation de nouveaux touts. La fonction analytique est la plus caractéristique des processus sensoriels, tandis que la fonction synthétique est caractéristique des processus perceptuels. Les racines génétiques de ces opérations remontent à des actions pratiques extérieures. À l’avenir, chacune d’entre elles pourra se transformer en un type d’activité plus ou moins indépendant.
On sait que certaines personnes sont plus enclines aux activités analytiques. On les appelle analystes ou critiques. D'autres sont plus capables de synthétiser et de générer des idées. Le processus créatif dans son ensemble s'effectue dans un dialogue entre analystes et synthétiseurs. L'analyse et la synthèse en tant qu'opérations de pensée sont interdépendantes et cohérentes entre elles de telle sorte qu'elles forment ensemble une seule activité analytique-synthétique se déployant dans deux directions : l'analyse par synthèse ou, à l'inverse, la synthèse par analyse.
Comparer signifie comparer des choses, des propriétés, des phénomènes, des idées et identifier des relations de similitude ou de différence entre eux. La comparaison sous-tend la comparaison, la reconnaissance et la reconnaissance non seulement d'objets matériels, mais aussi d'objets graphiques, symboliques ou idéaux. Cette opération fait partie à la fois des actes élémentaires de pensée et des formes complexes d’activité mentale.
La comparaison est l'une des principales opérations dans les premiers stades du développement de l'activité cognitive. En comparant des objets selon des caractéristiques sensorielles perceptibles, en y identifiant des traits communs et distinctifs, les enfants maîtrisent les méthodes de construction de classes empiriques. Techniques de base créativité littéraire- analogie, métaphore, synecdoque - contiennent des opérations de comparaison.
L’abstraction et la concrétisation sont une autre dyade d’opérations mutuellement convenues. L'abstraction signifie mettre en évidence, isoler, extraire ou isoler des propriétés individuelles, des aspects, des phénomènes, des méthodes d'action ou d'activité. Il est d'usage de distinguer l'abstraction sensorielle, empirique et théorique. Le sensuel s'exprime dans l'abstraction de certains aspects de la réalité directement perçue par rapport à d'autres. C'est typique pour les enfants âge préscolaire, qui répond à la question « Qu'est-ce qu'un chien ? » - ils répondent : "le chien aboie, il a un ventre, une queue, des pattes et des oreilles."
L'abstraction empirique constitue la base substantielle des concepts et des classifications construits à partir d'observations et de comparaisons de nombreuses images spécifiques. Un exemple est la classification des plantes ou des animaux en biologie. Les critères des concepts et classifications biologiques contiennent, en règle générale, des connaissances empiriques concernant les caractéristiques sensorielles perceptibles.
L’abstraction théorique sous-tend des concepts qui n’ont pas d’analogue sensoriel dans la réalité objective. Il existe de nombreux concepts de ce type en algèbre analytique, en géométrie, ainsi qu'en philosophie et en psychologie, par exemple « inconscient » ou « pensée ».
La concrétisation comme opération de réflexion consiste à sélectionner des exemples lors de la maîtrise des concepts et à remplir les concepts d'un contenu concret et sensoriel. La concrétisation est incluse dans tous les types d'activités et acquiert une importance particulière dans la créativité littéraire et artistique.
La mesure du rapport entre concrétisation et abstraction est réglée par les concepts : norme, déviation, originalité, pathologie. Une spécification excessive sans abstraction est l'un des signes de la démence, et un degré élevé d'abstraction sans spécification est un trait caractéristique de certains types de schizophrénie. La dynamique de la relation entre concrétisation et abstraction est similaire à celle entre les opérations d’analyse et de synthèse. Les transitions mutuelles d'opérations appariées de l'une à l'autre sont une condition de la flexibilité de la pensée.
La dernière des opérations de réflexion ci-dessus est une généralisation qui, d'une part, est le résultat de l'interaction de toutes les opérations ci-dessus et, d'autre part, a une signification indépendante. La généralisation signifie combiner des propriétés, des objets, des idées ou des connaissances en un seul groupe, auquel on donne un nom. Le développement des généralisations est associé à l'émergence des premiers mots et au développement de la parole. Le niveau de généralisation détermine le type de concepts qui sont formés en tant que produit de la pensée, fonctionnant comme un moyen de pensée et représentant des aspects significatifs de la pensée.
En termes génétiques, la source des généralisations est intersubjective, y compris les interactions pratiques, communicatives et cognitives (cognitives). La pratique, la communication et la connaissance sont les trois composantes principales de l'existence humaine. Le rôle de chacune de ces composantes est différent selon les stades de développement de l'individu et de la société.
Aux premiers stades du processus historico-génétique, prédomine l'activité pratique, qui s'effectue à l'aide d'actions pratiques dans l'espace directement ouvert à l'expérience sensorielle. Cette méthode de maîtrise de la réalité inclut la communication et la cognition. La communication est alors autonomisée et séparée en une activité indépendante. À ce stade, la cognition devient un mode d'existence pour des groupes individuels de personnes. Vient ensuite une étape où la connaissance devient une condition de la réussite dans la vie de la majorité. A ce stade, commence l'éducation de masse, le nombre de niveaux de formation augmente, des ordinateurs personnels et des moyens de communication électroniques apparaissent. La communication prend de nouvelles formes.
La pensée à cette échelle d'époque se développe de la pensée sous forme d'action à la pensée sous forme d'image et à partir de celle-ci, sans rompre le lien avec les formes antérieures, à la pensée sous forme de Parole. Dès le début, la Parole, puis la parole, et plus tard, avec les langues naturelles, les langues artificielles deviennent les principaux moyens de développement pratique, de communication et cognitif d'une personne. Les aspects culturels et historiques du développement de la pensée sont une autre caractéristique de ce processus.
La forme initiale de la pensée humaine est l’action objective externe. La dynamique de la relation entre action et activité est telle que l'action incluse dans une activité visant à satisfaire des besoins peut être transformée en activité. Dans ce cas, le but devient le motif. À son tour, l'activité peut être transformée en action comme condition de la mise en œuvre de nouveaux types d'activités.
Les opérations sont par leur origine transformées et les actions automatisées incluses dans d'autres actions plus complexes. En cas de difficultés, l'opération peut se transformer en action, changer ce processus et se transformer en une nouvelle opération.
Atteindre l'objectif, c'est-à-dire surmonter la distance entre ce qui est et ce qui n'est pas encore, mais qui ne sera que, nécessite, dans une certaine mesure, l'effort de toutes les forces et se dépasser, en d'autres termes, signifie dépasser les limites de l'expérience subjective réelle. En ce sens, l’action remplit une fonction transcendantale.
D'un point de vue génétique, l'action se développe dans le sens d'actions externes, visant un objectif externe, vers des actions internes, mentales et ciblées, dont la composition opérationnelle est effondrée, réduite et non présentée à la conscience. C’est la voie de l’intériorisation. La transition des actions et opérations internes et mentales de leur forme caractéristique effondrée et abrégée à une forme externe élargie est la voie de l’extériorisation. Sur ce chemin, la pensée se formalise et se réalise sur le plan extérieur (se matérialise).
Toute l'histoire du développement de la pensée, comment phénomène social, donc capacité individuelle d'un individu montre que ce processus est le plus directement lié à l'émergence et au développement des mots, du langage et de la parole. Un mot est un signe universel qui peut être corrélé à tout phénomène extérieur au sujet du monde et à tout état subjectif. Un mot, comme tout signe, a deux faces : externe (échelle sonore) et interne (signification). Le côté externe – sensoriel-perceptible des mots et de la parole en général crée la possibilité de communication sans interruption d’une interaction pratique directe entre les personnes. En acceptant un message d'une autre, une personne modifie ses actions, les corrige et, dans ce processus coordonné, une activité collective ciblée se développe. Le premier mot est un message adressé à une autre personne. L’universalité d’un message verbal réside dans le fait que, étant un moyen d’influencer autrui, le mot devient un moyen de s’influencer soi-même et, ainsi, un moyen de contrôler ses propres actions et pensées.
Dans la genèse de la parole, on observe un changement dans les formes de l'activité de la parole, à la suite de laquelle la parole externe se transforme en parole interne. Dans ce processus, le son d’un mot ou d’un message est réduit et non enregistré de manière introspective, tout comme les enfants d’âge préscolaire ne sont pas conscients du côté sonore de leur propre discours. Le degré auquel la parole intérieure participe à la pensée ne peut être déterminé qu'à l'aide de méthodes instrumentales. Ce type de recherche a été réalisé par A.N Sokolov.
Les matrices progressives de Ravenna du test de D. Ravenna, les tâches arithmétiques et linguistiques présentées visuellement ou auditivement ont été utilisées comme matériel de stimulation dans cette étude. Dans une série d'études, les micromouvements de la langue et l'activité électrique des muscles de la parole ont été enregistrés comme indicateurs objectifs de la participation de la parole à la résolution de problèmes. Dans une autre série - dans des expériences avec interférence centrale de la parole - il a été demandé aux sujets de résoudre silencieusement des problèmes tout en récitant simultanément de la poésie, des syllabes dénuées de sens ou des nombres (séries naturelles) à haute voix.
Selon une étude de l'excitabilité motrice et de l'activité électrique des muscles de la parole, il a été constaté que l'intensité et la durée de la parole interne :
Augmente avec l'augmentation du degré de complexité et de nouveauté des problèmes à résoudre ;
Plus prononcé lors de la présentation auditive du matériel de stimulation ;
Plus souvent observé chez les enfants que chez les adultes.
Des expériences d'inhibition centrale ont montré que les interférences de la parole lors de tâches linguistiques provoquent quelque chose comme une « aphasie sensorielle », dans laquelle les sujets, percevant des mots individuels, ne comprenaient pas le sens des phrases et des phrases. Sur cette base, il a été conclu que la verbalisation cachée est directement liée au traitement sémantique de l'information perçue.
QUESTIONS D'AUTO-TEST
AU MODULE « SPÉCIFICITÉ DE LA PENSÉE PAR RAPPORT À D'AUTRES PROCESSUS MENTAUX »
1.Quelles sont les différences fonctionnelles entre les formes sensorielles de réflexion et de pensée ?
2.Quelles sont les caractéristiques structurelles de la pensée par rapport aux formes sensorielles de réflexion ?
3.Quelle est l'essence de la loi de la conscience formulée par E. Claparède ?
4. A quelle étape de la vie la fonction symbolique apparaît-elle ?
5. Qu'est-ce qu'un signe objectif de différenciation entre le signifié et le signifié ?
6.Quelles sont les manières de représenter des événements réels selon J. Bruner ?
7. Donnez des exemples d’informations allant au-delà de l’information immédiate.
8.Quelles sont les conditions d’émergence de la pensée ?
9. Quel est le rôle des mots dans le développement des fonctions mentales supérieures ?
Médiocrité de la pensée- c'est une propriété de la pensée dont l'essence réside dans la possibilité de dépasser l'expérience immédiate. Parfois, vous devez franchir des étapes intermédiaires qui semblent aller dans la direction opposée à l'objectif, comme résoudre un problème en utilisant des détours ou des chemins indirects.
- 1. Trois récipients sont donnés : 30, 12 et 3 litres. Comment mesurer 15 litres ? (Ce problème peut être résolu par addition : 12 + 3= 15.)
- 2. Trois récipients sont donnés : 37, 21 et 3 litres. Comment mesurer exactement 10 litres d’eau ? (Peut être résolu en soustrayant les deux nombres les plus petits du plus grand : 37 - 21 - 3 - 3 = 10.)
- 3. Comment faire reposer une allumette au fond d'un tuyau de deux mètres enfoui dans le sol ?
Si des difficultés importantes sont rencontrées lors de la résolution d'un problème, une telle tâche peut être divisée en plusieurs tâches ou sous-tâches plus petites.
Pensée rétrospective- la capacité de procéder à une analyse approfondie de ce qui se passe et de tirer les conclusions appropriées.
Le sage se crée plus d’occasions que le hasard ne lui en offre ; le sage crée une arme à partir de tout ce qui lui tombe sous la main ; le sage transformera le hasard en chance – en d’autres termes, une analyse rétrospective de la décision, revenant sur le résultat déjà obtenu, est une étape importante dans le processus de professionnalisation de la pensée du spécialiste.
Analyse rétrospective du conflit- il s'agit d'une tentative d'évaluer la situation quelque temps après la résolution ou la fin du conflit, lorsque ses participants occupent des positions légèrement différentes dans l'équipe. Au fil du temps, certains des moments de comportement les plus significatifs situation de conflit peut être reproduit de manière plus nette. Et comme il n'y a pas de besoin particulier protection psychologique, faciliter expériences émotionnelles, ce qui conduit souvent à une distorsion de l'événement, au désir de le transmettre sous une forme idéalisée, les données peuvent être obtenues de manière plus fiable.
- 1. Cinq creuseurs creusent un fossé de 5 m en cinq heures. Combien de creuseurs creuseront 100 m de fossé en 100 heures ?
- 2. Trois chevaux ont couru 24 km en une heure. Combien de kilomètres par heure chaque cheval a-t-il parcouru ?
- 3. Kolya a demandé :
- - J'ai 10 points, et toi, Sasha ?
Sacha a répondu :
J'ai autant de timbres que vous, et la moitié de tous mes timbres.
Combien de timbres Sasha possède-t-elle ?
- 1. Celui qui ne réfléchit pas encore ne peut pas penser correctement. Les secondes réflexions sont les meilleures.
- 2. Homme intelligent ne s'offusque pas, mais tire des conclusions.
- 3. Après avoir analysé le processus et le résultat de la situation résolue, il est conseillé de répondre par vous-même aux questions suivantes.
Qu'ai-je appris de nouveau ?
Qu'est-ce qui m'a le plus surpris, qui m'a plu, qui m'a bouleversé ?
Qu’ai-je appris en étant dans cette situation ?
Quelles conclusions puis-je tirer pour l’avenir ?
Curiosité d'esprit- la capacité d'être surpris par tout ce qui est nouveau ; intérêt cognitif; « jouer » avec une idée ; ouverture aux situations inachevées et incertaines ; la nécessité de rechercher la question : que ferais-je différemment ?
Les gens curieux réfléchissent aux causes de l'incident. Là où il n’y a plus de matière à voir et à entendre pour les curieux, le travail pour les curieux ne fait que commencer. C'est le travail de la pensée, réveillé par un fait précis, aléatoire, mais derrière lequel la pensée cherche un certain modèle. Curiosité- préservation d'un rapport direct au monde (ils s'agitent, se précipitent, admirent, haletent et gémissent). Cependant, il n’y a pas d’évolution dans ce type de personnalité.
N.V. Gogol l'a noté avec précision : la curiosité est sans visage, ses manifestations sont les mêmes, et la curiosité donne naissance à des individus uniques, car le chemin vers les profondeurs de la vérité est unique.
Dans le cas de la curiosité, l’impulsion vient de la personne elle-même, ce qui change radicalement la nature de l’intérêt. Et, surtout, cela ne s'efface pas avec la fin de telle ou telle situation, mais, au contraire, s'enflamme encore plus, le capture entièrement, l'obligeant à plonger de plus en plus profondément dans l'activité qui l'intéresse. La pensée d’une personne revient sans cesse à ce qui reste flou jusqu’à la fin. La curiosité signifie la capacité de se dépasser.
Curiosité- il s’agit d’un intérêt superficiel, situationnel, réactif, épisodique, associé à l’expérience de sa relation cognitive avec le sujet du moment. Cet intérêt est fragile, instable et disparaît rapidement, ne laissant souvent presque aucune trace dans la vie de l'individu. Pour un professionnel intéressé par la croissance personnelle et la collaboration, il est important d’apprendre à sélectionner quelque chose de personnel et d’excitant dans le flux d’informations.
Des expériences menées sur des rats ont montré qu'environ un rat sur mille entre occasionnellement dans la partie de la cage où il reçoit un choc électrique.
- 1. Grand-mère doit faire frire six escalopes, mais seules quatre escalopes rentrent dans la poêle. Chaque côtelette doit être frite pendant 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre. Combien de temps faudra-t-il pour faire frire six escalopes dans cette poêle ? Comment pouvez-vous faire cela en 15 minutes ?
- 2. Donnez une réponse motivée à la question : « Se mêler des affaires des autres - bonne ou mauvaise ?
- 1. La curiosité favorise toujours l'ingéniosité (S. Zweig).
- 2. Plus la glace est fine, plus tout le monde veut voir si elle tiendra le coup (G.W. Shaw).
La pensée ne se forme pas immédiatement chez une personne. Il est absent chez les nouveau-nés, des réflexes conditionnés se forment chez les nourrissons. Cela signifie que son cerveau peut connecter de manière flexible deux stimuli entre eux et y répondre de manière adéquate. Par exemple, un bébé sourit à sa mère et pleure quand il voit étranger. Ce n’est que vers la fin de la première année de vie que les premiers éléments de réflexion commencent à apparaître chez l’enfant.
Selon le psychologue suisse Jean Piaget, il existe 4 étapes de développement de la pensée :
- Stade d'intelligence sensorimotrice (à l'âge de 1 à 2 ans) – la capacité de percevoir et de connaître des objets du monde réel se développe ; l'enfant commence à se distinguer du monde qui l'entoure.
- Stade de la pensée opérationnelle (à l'âge de 2-7 ans) – la parole se développe, l'égocentrisme de la pensée se développe.
- Le stade des opérations concrètes (de 7-8 à 11-12 ans) - se développe la capacité de fournir des explications logiques à ses actions, de passer d'un point de vue à un autre et la capacité de combiner des objets en classes.
- Étape des opérations formelles (à partir de 12-15 ans) – la capacité d’effectuer des opérations dans l’esprit en utilisant un raisonnement logique et des concepts abstraits.
Qu'est-ce que penser ?
À partir de ce qui précède, nous pouvons définir la pensée.
Pensée- c'est compliqué processus cognitif, qui est la forme la plus élevée de réflexion par le cerveau du monde environnant.
Pensée en substance, il s'agit toujours d'une recherche et d'une découverte de quelque chose de nouveau. La réflexion commence là où une situation problématique surgit.
Signes de base de la pensée :
Médiocrité.
La pensée d'un individu est médiatisée par le développement de la pensée de toute l'humanité. La pensée est une sorte de « modèle de l’univers en nous ». Il se forme dans un environnement unique, où il est possible d'absorber expérience sociale les autres, d'être en interaction constante avec eux.
Généralité.
La pensée est une cognition généralisée propriétés essentielles et les phénomènes de la réalité environnante, ainsi que les connexions et les relations qui existent entre eux. Les objets peuvent être généralisés sur la base d'une fonctionnalité (généralisations simples) ou sur la base de plusieurs fonctionnalités (généralisations complexes). Par exemple, lorsque nous prononçons le mot « avion », nous combinons (généralisons) dans cette classe de nombreux objets volants qui diffèrent par leur taille, leur forme, leur portée de vol, leur objectif, etc.
Détermination et caractère aléatoire.
La réflexion est toujours associée à la solution d'un problème et s'accompagne d'un certain effort volontaire de la part de la personne. L'absence de situation problématique rapproche le processus de pensée d'un comportement stéréotypé.
La pensée est toujours dirigée vers le but. Par exemple, la nécessité de changer l'intérieur de votre appartement donne lieu à l'objectif de réagencer les meubles, de déplacer certaines cloisons murales, etc. Une solution mentale a été trouvée. Ensuite, la volonté doit se connecter, car Sans volonté, réfléchir conduit très rarement à atteindre un objectif. Penser, c’est agir.
La pensée en tant qu’activité théorique cognitive est étroitement liée à l’action. Une personne connaît la réalité en l'influenceant, comprend le monde en le changeant. L'action est la première forme d'existence de la pensée.
Le processus de réflexion vise toujours à résoudre un problème et se distingue 4 étapes ou phases principales :
1. Conscience de la situation problématique commence par un sentiment de surprise provoqué par la situation. Et puis vient la formulation de la question, du problème, de la tâche. La formulation du problème lui-même est un acte de réflexion qui nécessite souvent un travail mental important et complexe. Formuler la question signifie déjà parvenir à une certaine compréhension, et comprendre une tâche ou un problème signifie, sinon la résoudre, du moins trouver un moyen, c'est-à-dire une méthode, pour le résoudre. Par conséquent, le premier signe d’une personne réfléchie est la capacité de voir les problèmes là où ils existent.
L’émergence de questions est le premier signe d’un début de travail de pensée et d’une compréhension naissante. La situation de « clarté initiale », exprimée par l’absence de questions, est un indicateur de l’absence de pensée.
2. Résoudre le problème est en train d'être fait différentes façons selon la nature de la tâche elle-même. Ce processus nécessite l'implication de connaissances théoriques. La première étape de la réflexion dans ce cas consiste à attribuer la question ou le problème émergent à un domaine de connaissances.
3. Proposer et trier des hypothèses. Certains problèmes particulièrement complexes sont résolus sur la base d’hypothèses. Plus la pratique est riche, plus l'expérience est large et plus organisé le système de connaissances dans lequel cette pratique et cette expérience sont généralisées, plus gros montant La pensée dispose de points de contrôle pour tester et critiquer ses hypothèses.
Le degré de criticité de l'esprit varie considérablement selon personnes différentes. Criticité - fonctionnalité essentielle esprit mature. L’esprit critique pèse soigneusement tous les arguments pour et contre ses hypothèses et les soumet à des tests approfondis.
4. Développer un jugement sur cette question. Ensuite, le résultat du travail mental descend directement dans la pratique. Il le soumet à un test décisif et fixe de nouvelles tâches de réflexion - développement, clarification, correction ou changement dans un premier temps décision prise Problèmes.
Irina Bazan
Littérature:
Yu.V. Chtcherbatykh " Psychologie générale»
S.L. Rubinstein « Fondements de la psychologie générale »
UN V. Karpov « Psychologie générale »
V.M. Kozubovsky « Psychologie générale »