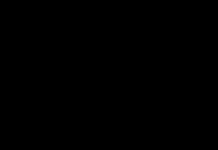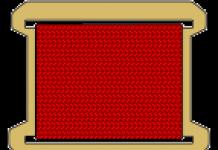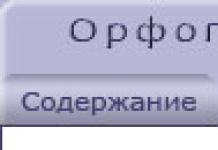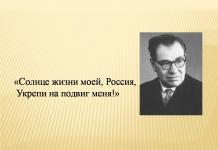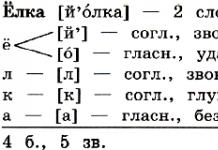Et cela est lié à sa compréhension de l’art comme imitation de la vie. La métaphore d'Aristote, en substance, est presque impossible à distinguer de l'hyperbole (exagération), de la synecdoque, de la simple comparaison ou de la personnification et de l'assimilation. Dans tous les cas, il y a transfert de sens d’un mot à un autre.
- Un message indirect sous la forme d'une histoire ou d'une expression figurative utilisant une comparaison.
- Une figure de style consistant en l'utilisation de mots et d'expressions au sens figuré basé sur une sorte d'analogie, de similitude, de comparaison.
Il y a 4 « éléments » dans une métaphore :
- Catégorie ou contexte,
- Un objet au sein d'une catégorie spécifique,
- Le processus par lequel cet objet remplit une fonction,
- Applications de ce procédé à des situations réelles, ou à leurs intersections.
- Une métaphore pointue est une métaphore qui rassemble des concepts très éloignés les uns des autres. Modèle : remplir la déclaration.
- Une métaphore effacée est une métaphore généralement admise dont le caractère figuratif ne se fait plus sentir. Modèle : pied de chaise.
- Une métaphore de formule est proche d'une métaphore effacée, mais s'en distingue par un stéréotype encore plus grand et parfois par l'impossibilité de transformation en une construction non figurative. Modèle : ver du doute.
- Une métaphore étendue est une métaphore qui est systématiquement mise en œuvre dans un grand fragment d'un message ou dans l'ensemble du message. Modèle : La faim de livres ne disparaît pas : les produits du marché du livre s'avèrent de plus en plus périmés - il faut les jeter sans même essayer.
- Une métaphore réalisée implique d'opérer avec une expression métaphorique sans tenir compte de son caractère figuratif, c'est-à-dire comme si la métaphore avait un sens direct. Le résultat de la mise en œuvre d’une métaphore est souvent comique. Modèle : J'ai perdu mon sang-froid et je suis monté dans le bus.
Théories
Entre autres tropes, la métaphore occupe une place centrale, car elle permet de créer des images volumineuses basées sur des associations vives et inattendues. Les métaphores peuvent être basées sur la similitude des éléments les plus divers signes objets : couleur, forme, volume, fonction, position, etc.
Selon la classification proposée par N.D. Arutyunova, les métaphores sont divisées en
- nominatif, consistant à remplacer un sens descriptif par un autre et servant de source d'homonymie ;
- des métaphores figuratives qui servent au développement de significations figuratives et de moyens de langage synonymes ;
- les métaphores cognitives qui résultent d'un changement dans la compatibilité des mots prédicats (transfert de sens) et créent une polysémie ;
- généraliser les métaphores (comme résultat final d'une métaphore cognitive), effacer les frontières entre les ordres logiques dans le sens lexical d'un mot et stimuler l'émergence d'une polysémie logique.
Examinons de plus près les métaphores qui aident à créer des images, ou figuratives.
Au sens large, le terme « image » désigne un reflet du monde extérieur dans la conscience. Dans une œuvre d’art, les images sont l’incarnation de la pensée de l’auteur, de sa vision unique et une image vivante de l’image du monde. Création image lumineuse basé sur l'utilisation de similitudes entre deux objets éloignés l'un de l'autre, presque sur une sorte de contraste. Pour qu'une comparaison d'objets ou de phénomènes soit inattendue, ils doivent être très différents les uns des autres, et parfois la similitude peut être tout à fait insignifiante, imperceptible, donnant matière à réflexion, ou peut être complètement absente.
Les limites et la structure de l'image peuvent être presque n'importe quoi : l'image peut être véhiculée par un mot, une phrase, une phrase, une unité de super-phrase, peut occuper un chapitre entier ou couvrir la composition d'un roman entier.
Cependant, il existe d'autres points de vue sur la classification des métaphores. Par exemple, J. Lakoff et M. Johnson identifient deux types de métaphores considérées par rapport au temps et à l'espace : ontologiques, c'est-à-dire les métaphores qui permettent de voir les événements, les actions, les émotions, les idées, etc. l'esprit est une entité, l'esprit est une chose fragile), et orientés, ou orientationnels, c'est-à-dire des métaphores qui ne définissent pas un concept par rapport à un autre, mais organisent l'ensemble du système de concepts les uns par rapport aux autres ( le bonheur est en haut, le triste est en bas ; la conscience est en haut, l'inconscient est en bas).
George Lakoff dans son ouvrage « La théorie contemporaine de la métaphore » parle des manières de créer une métaphore et de la composition de ce moyen d'expression artistique. Une métaphore, selon Lakoff, est une prose ou une expression poétique où un mot (ou plusieurs mots) qui est un concept est utilisé dans un sens indirect pour exprimer un concept similaire à celui donné. Lakoff écrit que dans la prose ou le discours poétique, la métaphore se situe en dehors du langage, dans la pensée, dans l'imagination, se référant à Michael Reddy, son œuvre « The Conduit Metaphor », dans lequel Reddy note que la métaphore se trouve dans le langage lui-même, dans le discours quotidien, et pas seulement en poésie ou en prose. Reddy déclare également que « le locuteur met des idées (des objets) en mots et les envoie à l'auditeur, qui extrait les idées/objets des mots ». Cette idée se reflète également dans l’étude de J. Lakoff et M. Johnson « Metaphors We Live By ». Les concepts métaphoriques sont systémiques, « la métaphore ne se limite pas à la seule sphère du langage, c'est-à-dire à la sphère des mots : les processus de la pensée humaine eux-mêmes sont largement métaphoriques. Les métaphores en tant qu'expressions linguistiques deviennent possibles précisément parce que les métaphores existent dans le système conceptuel humain.
La métaphore est souvent considérée comme l’un des moyens de refléter artistiquement avec précision la réalité. Cependant, I. R. Galperin affirme que « cette notion d’exactitude est très relative. C'est une métaphore qui crée une image spécifique concept abstrait, permet différentes interprétations de messages réels.
Dans le vocabulaire, les principaux moyens d'expression sont les sentiers(traduit du grec - tourner, tourner, image) - des moyens de langage figuratifs et expressifs spéciaux, basés sur l'utilisation de mots au sens figuré.
Les principaux types de tropes comprennent : l'épithète, la comparaison, la métaphore, la personnification, la métonymie, la synecdoque, la périphrase (périphrase), l'hyperbole, les litotes, l'ironie.
Moyens lexicaux spéciaux figuratifs et expressifs du langage (tropes)
Épithète(traduit du grec - demande, ajout) est une définition figurative qui marque une caractéristique essentielle pour un contexte donné dans le phénomène représenté.
Une épithète diffère d'une simple définition expression artistique et des images. L'épithète est basée sur une comparaison cachée.
Les épithètes incluent toutes les définitions « colorées », qui sont le plus souvent exprimées par des adjectifs.
Par exemple: triste et orphelin Terre(F.I. Tioutchev), brouillard gris, lumière citronnée, paix silencieuse(I.A. Bounine).
Les épithètes peuvent également être exprimées :
- noms , agissant comme des applications ou des prédicats, donnant un caractère figuratif au sujet.
Par exemple: sorcière - hiver; la mère est la terre humide ; Le poète est une lyre, et pas seulement la nounou de son âme(M. Gorki) ;
- les adverbes , agissant comme des circonstances.
Par exemple: Dans le nord sauvage, il est seul....(M. Yu. Lermontov) ; Les feuilles étaient tendues par le vent(K.G. Paustovsky) ;
- participes .
Par exemple: les vagues se précipitent, tonitruantes et étincelantes ;
- pronoms , exprimant le degré superlatif d’un état particulier de l’âme humaine.
Par exemple: Après tout, il y a eu des combats, oui, disent-ils, encore !(M. Yu. Lermontov) ;
- participes Et phrases participatives .
Par exemple: Les rossignols annoncent les limites de la forêt avec leurs paroles tonitruantes(B.L. Pasternak) ; J'admets aussi l'apparition de... écrivains lévriers qui ne peuvent prouver où ils ont passé la nuit d'hier, et qui n'ont pas d'autres mots dans leur langue que les mots je ne me souviens pas de la parenté (M. E. Saltykov-Shchedrin).
La création d'épithètes figuratives est généralement associée à l'utilisation de mots au sens figuré.
Du point de vue du type de sens figuré du mot faisant office d'épithète, toutes les épithètes sont divisées en :
métaphorique (ils reposent sur un sens figuré métaphorique.
Par exemple: un nuage doré, un ciel sans fond, un brouillard lilas, un nuage ambulant et un arbre debout.
Épithètes métaphoriques– un signe frappant du style de l’auteur :
Tu es mon mot bleu bleuet,
Je t'aime pour toujours.
Comment vit notre vache maintenant ?
Tirez-vous sur la paille de la tristesse ?
(S.A. Yesenin. « Je n'en ai pas vu d'aussi belles ? ») ;
Comme le monde de l'âme est avide la nuit
Entend l'histoire de sa bien-aimée !
(Tioutchev. « Pourquoi hurles-tu, vent de la nuit ? »).
métonymique (ils sont basés sur un sens figuré métonymique.
Par exemple: démarche en daim(V.V. Nabokov) ; aspect rêche(M. Gorki) ; bouleau joyeux langue(S. A. Yesenin).
D'un point de vue génétique les épithètes sont divisées en :
- langage général (silence de mort, vagues de plomb),
- folk-poétique (permanent) ( soleil rouge, vent sauvage, bon gars).
Dans le folklore poétique, une épithète qui, avec le mot qu'elle définit, constitue une phrase stable, servait, en plus de son contenu, à fonction mnémonique (gr. mnémo nicon- l'art de la mémorisation).
Des épithètes constantes ont permis au chanteur et au narrateur d'interpréter plus facilement l'œuvre. Tout texte folklorique regorge de telles épithètes, pour la plupart « décoratives ».
« Dans le folklore, écrit le critique littéraire V.P. Anikin, la fille est toujours belle, le garçon est gentil, le père est cher, les enfants sont petits, le garçon est audacieux, le corps est blanc, les mains sont blanches, les larmes sont inflammables, la voix est forte, l'arc est bas, la table est le chêne, le vin est vert, la vodka est douce, l'aigle est gris, la fleur est écarlate, la pierre est inflammable, le sable est meuble, la nuit est sombre, la forêt est stagnante, les montagnes sont escarpées, les forêts - dense, nuage - menaçant , les vents sont violents, le champ est propre, le soleil est rouge, l'arc est serré, la taverne est Tsarev, le sabre est tranchant, le loup est gris, etc.»
Selon le genre, le choix des épithètes variait quelque peu. La recréation du style, ou la stylisation des genres folkloriques, implique l'utilisation généralisée d'épithètes constantes. Alors, ils abondent" Une chanson sur le tsar Ivan Vasilyevich, un jeune oprichnik et l'audacieux marchand Kalachnikov» Lermontov : soleil rouge, nuages bleus, couronne d'or, roi redoutable, combattant audacieux, pensée forte, pensée noire, coeur chaud, épaules héroïques, sabre tranchant etc.
Une épithète peut incorporer les propriétés de plusieurs tropes . Basé sur métaphore ou à métonymie , il peut aussi être combiné avec la personnification... un azur brumeux et calme au-dessus triste et orphelin Terre(F.I. Tioutchev), hyperbole (L'automne sait déjà qu'une paix aussi profonde et silencieuse est annonciatrice de longues intempéries(I.A. Bunin) et d'autres chemins et figures.
Le rôle des épithètes dans le texte
Toutes les épithètes en tant que définitions lumineuses et « éclairantes » visent à renforcer l'expressivité des images d'objets ou de phénomènes représentés, à mettre en valeur leurs aspects les plus importants. caractéristiques essentielles.
De plus, les épithètes peuvent :
Renforcez, soulignez toutes les caractéristiques des objets.
Par exemple: Errant entre les rochers, un rayon jaune s'est glissé dans la grotte sauvage et a éclairé le crâne lisse...(M. Yu. Lermontov) ;
Clarifier les caractéristiques distinctives d'un objet (forme, couleur, taille, qualité) :.
Par exemple: La forêt, comme une tour peinte, Lilas, doré, cramoisi, Un mur gai et bigarré Se dresse au dessus d'une clairière lumineuse(I.A. Bounine) ;
Créez des combinaisons de mots dont le sens est contrasté et servent de base à la création d'un oxymore : luxe misérable(L.N. Tolstoï), ombre brillante(E.A. Baratynsky) ;
Transmettre l’attitude de l’auteur envers le représenté, exprimer l’appréciation et la perception de l’auteur du phénomène : ... Les mots morts sentent mauvais(N.S. Goumilyov) ; Et nous valorisons la parole prophétique, et nous honorons la parole russe, et nous ne changerons pas le pouvoir de la parole(S. N. Sergueïev-Tsensky) ; Que signifie ce sourire ? bénédiction le paradis, cette terre heureuse et reposante ?(I. S. Tourgueniev)
Épithètes figuratives mettre en évidence les aspects essentiels de ce qui est représenté sans introduire une appréciation directe (« dans le brouillard bleu de la mer», « dans le ciel mort" et ainsi de suite.).
En expressif (lyrique) épithètes , au contraire, l'attitude envers le phénomène représenté est clairement exprimée (« des images de fous clignotent», « une histoire de nuit langoureuse»).
Il convient de garder à l'esprit que cette division est plutôt arbitraire, puisque les épithètes figuratives ont également une signification émotionnelle et évaluative.
Les épithètes sont largement utilisées dans les styles de discours artistiques et journalistiques, ainsi que dans les styles de discours scientifiques familiers et populaires.
Comparaison est une technique visuelle basée sur la comparaison d'un phénomène ou d'un concept avec un autre.
Contrairement à la métaphore la comparaison est toujours binomiale : il nomme les deux objets comparés (phénomènes, signes, actions).
Par exemple: Les villages brûlent, ils n'ont aucune protection. Les fils de la patrie sont vaincus par l'ennemi, Et la lueur, comme un météore éternel, Jouant dans les nuages, effraie l'œil.(M. Yu. Lermontov)
Les comparaisons s'expriment de différentes manières :
Forme du cas instrumental des noms.
Par exemple: La jeunesse passait comme un rossignol volant, la joie s'éteignait comme une vague par mauvais temps.(A.V. Koltsov) La lune glisse comme une crêpe à la crème sure.(B. Pasternak) Les feuilles volaient comme des étoiles.(D. Samoilov) La pluie volante scintille d'or au soleil.(V. Nabokov) Les glaçons pendent comme des franges de verre.(I. Shmelev) Un arc-en-ciel est suspendu à un bouleau avec une serviette propre à motifs.(N. Rubtsov)
Forme comparative d'un adjectif ou d'un adverbe.
Par exemple: Ces yeux sont plus verts que la mer et nos cyprès sont plus foncés.(A. Akhmatova) Les yeux d'une fille sont plus brillants que les roses.(A.S. Pouchkine) Mais les yeux sont plus bleus que le jour.(S. Yesenin) Les buissons de Rowan sont plus brumeux que les profondeurs.(S. Yesenin) La jeunesse est plus libre.(A.S. Pouchkine) La vérité a plus de valeur que l'or.(Proverbe) La salle du trône est plus lumineuse que le soleil. M. Tsvétaeva)
Turnover comparé avec les syndicats comme si, comme si, comme si et etc.
Par exemple: Comme une bête prédatrice, le vainqueur fait irruption dans l'humble monastère à coups de baïonnette...(M. Yu. Lermontov) April regarde le vol des oiseaux avec des yeux bleus comme la glace.(D. Samoilov) Chaque village ici est si aimant, Comme s'il contenait la beauté de l'univers entier. (A. Yashin) Et ils se tiennent derrière des filets de chêne Comme les mauvais esprits de la forêt, chanvre.(S. Yesenin) Comme un oiseau en cage, Mon cœur fait un bond.(M. Yu. Lermontov) À mes poèmes comme des vins précieux, Votre tour viendra.(M. I. Tsvetaeva) Il est presque midi. La chaleur est torride. Comme un laboureur, la bataille repose. (A.S. Pouchkine) Le passé, comme le fond de la mer, s’étend comme un motif au loin.(V. Brioussov)
Au-delà de la rivière en paix
Le cerisier a fleuri
Comme la neige sur la rivière
Le point était inondé.
Comme de légères tempêtes de neige
Ils se précipitèrent à toute vitesse,
C'était comme si des cygnes volaient,
Ils ont laissé tomber les peluches.(A. Prokofiev)
Avec des mots semblable, semblable, ceci.
Par exemple: Tes yeux sont comme les yeux d'un chat prudent(A. Akhmatova) ;
Utiliser des clauses comparatives.
Par exemple: Des feuilles dorées tourbillonnaient dans l'eau rosée de l'étang, Comme une légère volée de papillons, il vole à bout de souffle vers une étoile. (S.A. Yesenin) La pluie sème, sème, sème, Il pleut depuis minuit, Suspendu comme un rideau de mousseline devant les fenêtres. (V. Touchnova) De fortes chutes de neige, tournoyantes, couvraient les Sunless Heights, C'était comme si des centaines d'ailes blanches volaient silencieusement. (V. Touchnova) Comme un arbre qui perd silencieusement ses feuilles, Alors je laisse tomber les mots tristes.(S. Yesenin) Comment le roi aimait les riches palais, Alors je suis tombé amoureux des routes anciennes Et des yeux bleus de l'éternité !(N. Rubtsov)
Les comparaisons peuvent être directes Etnégatif
Les comparaisons négatives sont particulièrement caractéristiques de la poésie populaire orale et peuvent servir à styliser le texte.
Par exemple: Ce n'est pas une toupie de cheval, ni une rumeur humaine... (A.S. Pouchkine)
Un type particulier de comparaison est constitué par les comparaisons détaillées, à l'aide desquelles des textes entiers peuvent être construits.
Par exemple, le poème de F. I. Tyutchev « Comme sur des cendres chaudes...»:
Comme sur des cendres brûlantes
Le parchemin fume et brûle
Et le feu est caché et terne
Dévore les mots et les lignes -
Ma vie se meurt si tristement
Et chaque jour ça part en fumée,
Alors je m'efface progressivement
Dans une monotonie insupportable !..
Oh mon Dieu, ne serait-ce qu'une fois
Cette flamme s'est développée à volonté -
Et, sans languir, sans plus souffrir,
Je brillerais - et je sortirais !
Le rôle des comparaisons dans le texte
Les comparaisons, comme les épithètes, sont utilisées dans le texte afin d'améliorer son caractère figuratif et ses images, de créer des images plus vives et plus expressives et de mettre en valeur, en soulignant toutes les caractéristiques significatives des objets ou phénomènes représentés, ainsi que dans le but d'exprimer les évaluations de l'auteur. et les émotions.
Par exemple:
J'aime ça, mon ami,
Quand le mot fond
Et quand ça chante
La ligne est couverte de chaleur,
Pour que les mots brillent des mots,
Pour que lorsqu'ils prennent leur envol,
Ils se sont tordus et se sont battus pour chanter,
A manger comme du miel.
(A.A. Prokofiev) ;
Dans chaque âme, il semble vivre, brûler, briller, comme une étoile dans le ciel, et, comme une étoile, s'éteint quand elle a fini son Le chemin de la vie, vole de nos lèvres... Il arrive qu'une étoile éteinte pour nous, les gens sur terre, brûle encore mille ans. (M.M. Prishvin)
Les comparaisons comme moyen d'expression linguistique peuvent être utilisées non seulement dans textes littéraires, mais aussi journalistique, conversationnel, scientifique.
Métaphore(traduit du grec - transfert) est un mot ou une expression utilisé dans un sens figuré basé sur la similitude de deux objets ou phénomènes pour une raison quelconque. On dit parfois qu'une métaphore est une comparaison cachée.
Par exemple, la métaphore Un feu de sorbier rouge brûle dans le jardin (S. Yesenin) contient une comparaison des brosses de sorbier avec la flamme d'un feu.
De nombreuses métaphores sont devenues monnaie courante dans l’usage quotidien et n’attirent donc pas l’attention et ont perdu leur imagerie dans notre perception.
Par exemple: la banque a éclaté, le dollar marche, j'ai la tête qui tourne et etc.
Contrairement à une comparaison, qui contient à la fois ce qui est comparé et ce avec quoi on compare, une métaphore ne contient que le second, ce qui crée de la compacité et du figuratif dans l'utilisation du mot.
Une métaphore peut être basée sur la similitude d'objets en forme, couleur, volume, fonction, sensations, etc.
Par exemple: une cascade d'étoiles, une avalanche de lettres, un mur de feu, un abîme de chagrin, une perle de poésie, une étincelle d'amour et etc.
Toutes les métaphores sont divisées en deux groupes :
1) langage général ("effacé")
Par exemple: mains d'or, tempête dans une tasse de thé, montagnes en mouvement, cordes sensibles, amour fané ;
2) artistique (auteur individuel, poétique)
Par exemple: Et les étoiles disparaissent frisson de diamant dans le froid indolore de l'aube (M. Volochine) ; Verre transparent ciel vide(A. Akhmatova) ; ET les yeux bleus et sans fond fleurissent sur rive lointaine . (A.A. Blok)
Métaphores de Sergueï Yesenin : feu du sorbier des oiseleurs, langue de bouleau joyeuse du bosquet, chintz du ciel;
ou larmes sanglantes de septembre, gouttes de pluie envahies par la végétation, petits pains lanternes et beignets de toit
chez Boris Pasternak
La métaphore est paraphrasée en comparaison à l'aide de mots auxiliaires comme si, comme, comme si et ainsi de suite.
Il existe plusieurs types de métaphores : effacé, élargi, réalisé.
Effacé - une métaphore généralement acceptée dont le sens figuré ne se fait plus sentir.
Par exemple: pied de chaise, tête de lit, feuille de papier, aiguille d'horloge et ainsi de suite.
Une œuvre entière ou un large extrait peut être construite sur une métaphore. Une telle métaphore est appelée « élargie », dans laquelle l'image est « développée », c'est-à-dire révélée en détail.
Ainsi, le poème de A.S. Pouchkine « Prophète" est un exemple de métaphore étendue. Transformation du héros lyrique en héraut de la volonté du Seigneur - un poète-prophète, le satisfaisant" soif spirituelle», c’est-à-dire le désir de connaître le sens de l’existence et de trouver sa vocation, est dépeint progressivement par le poète : « séraphin à six ailes", le messager de Dieu, a transformé le héros avec son " main droite» - main droite, qui était une allégorie de la force et du pouvoir. Par l'autorité de Dieu héros lyrique reçu une vision différente, une audition différente, des capacités mentales et spirituelles différentes. Il pourrait " conscient», c'est-à-dire comprendre les valeurs sublimes, célestes et l'existence terrestre et matérielle, ressentir la beauté du monde et ses souffrances. Pouchkine dépeint ce processus beau et douloureux : « cordage"d'une métaphore à l'autre : les yeux du héros acquièrent une vigilance d'aigle, ses oreilles se remplissent de" bruit et sonnerie"de la vie, la langue cesse d'être "oisive et rusée", véhiculant la sagesse reçue en don", coeur tremblant" se transforme en " charbon brûlant avec le feu" La chaîne de métaphores est maintenue par l'idée générale de l'œuvre : le poète, tel que Pouchkine le voulait, doit être un héraut de l'avenir et un révélateur des vices humains, inspirant les gens avec ses paroles, les encourageant à la bonté et la vérité.
Des exemples de métaphore élargie se trouvent souvent dans la poésie et la prose (l'essentiel de la métaphore est indiqué en italique, son « développement » est souligné) :
... disons au revoir ensemble,
Ô ma jeunesse facile !
Merci pour les plaisirs
Pour la tristesse, pour le doux tourment,
Pour le bruit, pour les tempêtes, pour les fêtes,
Pour tout, pour tous vos cadeaux...
A.S. Pouchkine " Eugène Onéguine"
Nous buvons à la coupe de l'existence
Les yeux fermés...
Lermontov "La Coupe de la Vie"
... un garçon tombé amoureux
À une fille enveloppée de soie...
N. Goumilev " Aigle de Sinbad"
Le bosquet d'or dissuadé
Langue joyeuse du bouleau.
S. Yesenin " Le bosquet d'or dissuadé…"
Triste, et pleurant et riant,
Les flots de mes poèmes sonnent
À tes pieds
Et chaque verset
Cours, tisse un fil vivant,
Ne pas connaître nos propres rivages.
A. Bloc " Triste, et pleurant, et riant...."
Gardez mon discours pour toujours au goût du malheur et de la fumée...
O. Mandelstam " Sauve mon discours pour toujours…"
... bouillonnait, emportant les rois,
Rue courbe de juillet...
O. Mandelstam " Je prie pour la pitié et la miséricorde..."
Maintenant, le vent embrasse fortement les vagues et les jette avec une colère sauvage sur les falaises, brisant les masses d'émeraude en poussière et en éclaboussures.
M. Gorki " Chanson sur le pétrel"
La mer s'est réveillée. Il jouait avec les petites vagues, les faisait naître, les décorait d'une frange d'écume, les poussait les unes contre les autres et les brisait en fine poussière.
M. Gorki " Chelkash"
Réalisé - métaphore , ce qui prend à nouveau un sens direct. Le résultat de ce processus est niveau du ménage souvent comique :
Par exemple: J'ai perdu mon sang-froid et je suis monté dans le bus
L'examen n'aura pas lieu : tous les billets ont été vendus.
Si tu rentres en toi, ne reviens pas les mains vides et ainsi de suite.
Le farceur-fossoyeur simple d'esprit dans la tragédie de William Shakespeare " Hamlet" à la question du personnage principal sur " sur quelle base« Le jeune prince a perdu la tête, répond : « Dans notre danois" Il comprend le mot " le sol"littéralement - la couche supérieure de la terre, le territoire, tandis que Hamlet signifie au sens figuré - pour quelle raison, à la suite de quoi."
« Oh, tu es lourd, le chapeau de Monomakh! " - le tsar se plaint de la tragédie d'A.S. Pouchkine " Boris Godounov" Depuis l'époque de Vladimir Monomakh, la couronne des tsars russes a la forme d'un bonnet. Il était décoré de pierres précieuses, il était donc « lourd » au sens littéral du terme. Au sens figuré - " Le chapeau de Monomakh"personnifié" lourdeur", la responsabilité du pouvoir royal, les graves responsabilités d'un autocrate.
Dans le roman d'A.S. Pouchkine " Eugène Onéguine« L'image de la Muse, qui depuis l'Antiquité personnifie la source d'inspiration poétique, joue un rôle important. L'expression « le poète a reçu la visite d'une muse » a un sens figuré. Mais la Muse - l'amie et l'inspiratrice du poète - apparaît dans le roman sous la forme d'une femme vivante, jeune, belle, joyeuse. DANS " cellule d'étudiant"C'est la Muse" a ouvert une fête des jeunes idées- des farces et des disputes sérieuses sur la vie. C'est la seule " a chanté"tout ce pour quoi je m'efforçais jeune poète, - passions et désirs terrestres : amitié, fête joyeuse, joie irréfléchie - " le plaisir des enfants" Muse, " comment la bacchante gambadait", et le poète était fier de son " ami frivole».
Durant son exil dans le sud, Muse apparaît comme une héroïne romantique, victime de ses passions destructrices, déterminée, capable de rébellion téméraire. Son image a aidé le poète à créer une atmosphère de mystère et de mystère dans ses poèmes :
À quelle fréquence je demande à Muse
J'ai apprécié le chemin silencieux
La magie d'une histoire secrète!..
Au tournant de la quête créatrice de l’auteur, c’est elle
Elle est apparue comme une jeune femme du quartier,
Avec une triste pensée dans les yeux...
Tout au long de l'œuvre " Muse affectueuse"c'était vrai" petite amie"poète.
La mise en œuvre de la métaphore se retrouve souvent dans la poésie de V. Mayakovsky. Ainsi, dans le poème « Un nuage en pantalon"il met en œuvre l'expression populaire" les nerfs se sont dissipés" ou " je suis sur les nerfs»:
J'entends:
calme,
comme un malade qui sort du lit,
le nerf sursauta.
Ici, -
marché en premier
à peine,
puis il est entré en courant
excité,
clair.
Maintenant, lui et les deux nouveaux
se précipitant avec des claquettes désespérées...
Nerfs -
grand,
petit,
beaucoup, -
sautent follement,
et déjà
tes jambes tremblent de nervosité!
Il ne faut pas oublier que la frontière entre divers types les métaphores sont très conditionnelles, instables et il peut être difficile d’en déterminer avec précision le type.
Le rôle des métaphores dans le texte
La métaphore est l’un des moyens les plus frappants et les plus puissants pour créer de l’expressivité et des images dans un texte.
À travers le sens métaphorique des mots et des phrases, l'auteur du texte améliore non seulement la visibilité et la clarté de ce qui est représenté, mais transmet également le caractère unique et individuel des objets ou des phénomènes, tout en démontrant la profondeur et le caractère de son propre figuratif associatif. pensée, vision du monde, mesure du talent (« Le plus important est d'être habile en métaphores. Seulement cela ne s'apprend pas d'un autre - c'est un signe de talent » (Aristote).
Les métaphores constituent un moyen important d'exprimer les évaluations et les émotions de l'auteur, les caractéristiques de l'auteur concernant les objets et les phénomènes.
Par exemple: Je me sens étouffé dans cette ambiance ! Des cerfs-volants ! Le nid de chouette ! Des crocodiles !(A.P. Tchekhov)
Outre les styles artistiques et journalistiques, les métaphores sont caractéristiques des styles familiers et même scientifiques (« le trou dans la couche d'ozone », « Nuage d'électrons " et etc.).
Personnification- il s'agit d'un type de métaphore basée sur le transfert de signes d'un être vivant vers des phénomènes naturels, des objets et des concepts.
Plus souvent les personnifications sont utilisées pour décrire la nature.
Par exemple:
Roulant à travers des vallées endormies,
Les brumes endormies se sont installées,
Et seulement le bruit des chevaux,
Sonnant, il se perd au loin.
Le jour s'est éteint, pâlissant automne,
Enroulant les feuilles parfumées,
Goûtez au sommeil sans rêves
Fleurs à moitié fanées.
(M. Yu. Lermontov)
Moins souvent, les personnifications sont associées au monde objectif.
Par exemple:
N'est-ce pas vrai, plus jamais
Ne nous séparerons-nous pas ? Assez?..
ET le violon répondit Oui,
Mais le cœur du violon lui faisait mal.
L'arc a tout compris, il s'est tu,
Et dans le violon l'écho était toujours là...
Et c'était un tourment pour eux,
Ce que les gens pensaient, c'était de la musique.
(IF Annensky) ;
Il y avait quelque chose de bon enfant et en même temps de douillet les visages de cette maison. (D. N. Mamin-Sibiryak)
Personnifications- les chemins sont très anciens, leurs racines remontent à l'antiquité païenne et occupent donc une place si importante dans la mythologie et le folklore. Le renard et le loup, le lièvre et l'ours, l'épopée Serpent Gorynych et la Foul Idol - tous ces personnages et d'autres personnages fantastiques et zoologiques des contes de fées et des épopées nous sont familiers depuis la petite enfance.
L’un des genres littéraires les plus proches du folklore, la fable, repose sur la personnification.
Même aujourd'hui, il est impensable d'imaginer sans personnification œuvres d'art, sans eux, notre discours quotidien est impensable.
Le discours figuré ne représente pas seulement visuellement une idée. Son avantage est qu'il est plus court. Au lieu de décrire un objet en détail, on peut le comparer avec un objet déjà connu.
Il est impossible d'imaginer un discours poétique sans utiliser cette technique :
"La tempête couvre le ciel d'obscurité
Tourbillons de neige tourbillonnants
Alors, comme une bête, elle hurlera,
Elle pleurera comme une enfant. »(A.S. Pouchkine)
Le rôle des personnifications dans le texte
Les personnifications servent à créer des images lumineuses, expressives et imaginatives de quelque chose, améliorant ainsi les pensées et les sentiments véhiculés.
Personnification comme des moyens d'expression utilisé non seulement dans le style artistique, mais aussi dans le style journalistique et scientifique.
Par exemple: Les rayons X montrent, dit l'appareil, que l'air guérit, que quelque chose bouge dans l'économie.
Les métaphores les plus courantes sont formées selon le principe de personnification, lorsqu'un objet inanimé reçoit les propriétés d'un objet animé, comme s'il acquérait un visage.
1. Typiquement, les deux composantes d'une métaphore de personnification sont un sujet et un prédicat : " le blizzard était en colère», « le nuage doré a passé la nuit», « les vagues jouent».
« Se mettre en colère", c'est-à-dire que seule une personne peut ressentir une irritation, mais " tempête de neige", un blizzard, plongeant le monde dans le froid et l'obscurité, apporte aussi " mal". « Passer la nuit"Seuls les êtres vivants sont capables de dormir paisiblement la nuit", nuage" représente une jeune femme qui a trouvé un refuge inattendu. Marin " vagues"dans l'imagination du poète" jouer", comme des enfants.
On trouve souvent des exemples de métaphores de ce type dans la poésie de A.S. Pouchkine :
Les délices ne nous abandonneront pas soudainement...
Un rêve mortel le survole...
Mes journées ont passé à toute vitesse...
L'esprit de vie s'est réveillé en lui...
La Patrie t'a caressé...
La poésie s'éveille en moi...
2. De nombreuses métaphores de personnification sont construites selon la méthode de contrôle : « chant de lyre», « le discours des vagues», « mode chérie», « bonheur chérie" et etc.
Un instrument de musique est comme la voix humaine, et lui aussi" chante", et le clapotis des vagues ressemble à une conversation tranquille. " Préféré», « chéri"cela n'arrive pas seulement aux gens, mais aussi aux rebelles" mode"ou celui qui est inconstant" bonheur».
Par exemple: « menace hivernale », « la voix de l'abîme », « la joie de la tristesse », « le jour du découragement », « le fils de la paresse », « les fils... de plaisir », « frère dans la muse, selon destins", "victime de calomnie", "visages de cire des cathédrales", "un langage joyeux", "un fardeau de chagrin", "l'espoir des jeunes jours", "des pages de méchanceté et de vice", "une voix sainte", "par la volonté des passions".
Mais il existe des métaphores formées différemment. Le critère de différence ici est le principe d'animation et d'inanimité. Un objet inanimé ne reçoit PAS les propriétés d'un objet animé.
1). Sujet et prédicat : « le désir bout », « les yeux brûlent », « le cœur est vide ».
Le désir chez une personne peut se manifester à un degré élevé, bouillonner et « bouillir" Les yeux, montrant l’excitation, brillent et « brûlent" Un cœur et une âme qui ne sont pas réchauffés par les sentiments peuvent devenir « vide».
Par exemple: « J'ai appris très tôt le chagrin, j'ai été vaincu par la persécution », « notre jeunesse ne s'effacera pas d'un coup », « midi... brûlait », « la lune flotte », « les conversations coulent », « les histoires se répandent », « l'amour... s'est fané », « J'appelle l'ombre », « la vie est tombée ».
2). Les phrases construites selon la méthode de contrôle peuvent aussi, étant des métaphores, NE PAS être une personnification : « poignard de trahison», « tombeau de gloire», « chaîne de nuages" et etc.
Bras en acier - " dague" - tue une personne, mais " trahison« est comme un poignard et peut aussi détruire et briser la vie. " Tombeau«C'est une crypte, une tombe, mais non seulement les gens peuvent être enterrés, mais aussi la gloire, l'amour du monde. " Chaîne"constitué de maillons métalliques, mais" des nuages", finement entrelacés, formant une sorte de chaîne dans le ciel.
Par exemple: "flatterie d'un collier", "crépuscule de la liberté", "forêt... de voix", "nuages de flèches", "bruit de poésie", "cloche de fraternité", "incandescence de poésie", "feu... ". des yeux noirs", "le sel des griefs solennels", " la science de la séparation", " la flamme du sang du sud " .
De nombreuses métaphores de ce genre se forment selon le principe de réification, lorsque le mot défini reçoit les propriétés d'une substance ou d'un matériau : « fenêtres de cristal », « cheveux dorés » .
Par une journée ensoleillée, la fenêtre semble scintiller comme " cristal", et les cheveux prennent de la couleur " or" La comparaison cachée inhérente à la métaphore est ici particulièrement perceptible.
Par exemple: « dans le velours noir de la nuit soviétique, dans le velours du vide universel », « poèmes... viande de raisin », « cristal de notes aiguës », « poèmes comme des perles qui claquent ».
transférer les propriétés d'un objet à un autre sur la base du principe de leur similitude à certains égards ou contraste. Par exemple, « courant électrique », « arôme particules élémentaires», « cité du Soleil », « Royaume de Dieu », etc. Une métaphore est une comparaison cachée d'objets, de propriétés et de relations très lointaines, à première vue, dans laquelle les mots « comme si », « comme si », etc. omis mais implicites. Le pouvoir heuristique de la métaphore réside dans l'unification audacieuse de ce qui était auparavant considéré comme de qualités différentes et incompatibles (par exemple, « onde lumineuse », « pression lumineuse », « paradis terrestre », etc.). Cela permet de détruire les stéréotypes cognitifs habituels et de créer de nouvelles constructions mentales basées sur des éléments déjà connus (« machine à penser », « organisme social », etc.), ce qui conduit à une nouvelle vision du monde et change « l'horizon de la conscience ». ». (Voir comparaison, créativité scientifique, synthèse).
Excellente définition
MÉTAPHORE
du grec ??????? transfert) est un trope rhétorique dont l'essence est qu'au lieu d'un mot utilisé au sens littéral, un mot de sens similaire à celui-ci, utilisé au sens figuré, est utilisé. Par exemple · un rêve de vie, une pente vertigineuse, les jours passent, de l'esprit, des remords, etc., etc. ? Apparemment, le plus première théorie M. est une théorie de la substitution remontant à Aristote. Expliquer qu'« un nom inhabituel transféré... par analogie » implique une situation dans laquelle « le second est lié au premier comme le quatrième l'est au troisième, et donc l'écrivain peut dire le quatrième au lieu du deuxième ou le second à la place ». du quatrième », Aristote (« Poétique ») donne les exemples suivants de « métaphores proportionnelles » : la coupe (fiole) se rapporte à Dionysos comme le bouclier se rapporte à Arès, donc la coupe peut être appelée le « bouclier de Dionysos », et le bouclier la « coupe d'Arès » ; La vieillesse se rapporte à la vie comme le soir se rapporte au jour, c'est pourquoi la vieillesse peut être appelée « le soir de la vie » ou « le coucher du soleil de la vie », et le soir - « la vieillesse du jour ». Cette théorie des métaphores proportionnelles a été critiquée à plusieurs reprises et vivement. Ainsi, A. A. Potebnya (« À partir de notes sur la théorie de la littérature ») a noté qu'« un tel jeu de mouvement est un cas rare, possible uniquement par rapport à des métaphores toutes faites, » Ce cas rare ne peut donc pas être considéré comme un exemple de M. en général, qui, en règle générale, assume une proportion « avec une inconnue ». De la même manière, M. Beardsley critique Aristote pour le fait que le ce dernier considère la relation de transfert comme réciproque et, comme le croit Beardsley, remplace M. par une comparaison rationalisée.
Même dans les temps anciens, la théorie aristotélicienne de la substitution était concurrencée par la théorie de la comparaison, développée par Quintilien (« De l'éducation de l'orateur ») et Cicéron (« De l'orateur »). Contrairement à Aristote, qui croyait que la comparaison est simplement une métaphore étendue (voir sa « Rhétorique »), la théorie de la comparaison considère M. comme une comparaison abrégée, mettant ainsi l'accent sur la relation de similitude qui sous-tend M., et non sur l'action de substitution en tant que telle. . Bien que la théorie de la substitution et la théorie de la comparaison ne s’excluent pas mutuellement, elles présupposent compréhension différente relations entre M. et d'autres tropes. Suivant sa théorie de la substitution, Aristote définit M. d’une manière injustifiable et large ; sa définition nous oblige à considérer M comme « un nom inhabituel transféré de genre en espèce, ou d’espèce en genre, ou d’espèce en espèce, ou par analogie ». Pour Quintilien, Cicéron et d'autres partisans de la théorie de la comparaison, M. se limite uniquement au transfert par analogie, tandis que les transferts de genre à espèce et d'espèce à genre sont synecdoques, rétrécissants et généralisants, respectivement, et le transfert d'espèce à espèce est métonymie.
DANS théories modernes M. est plus souvent opposé à la métonymie à/ou à la synecdoque qu'identifié à elles. Dans la célèbre théorie de R. O. Yakobson (« Notes sur la prose du poète Pasternak »), M. s'oppose à la métonymie comme transfert par similarité - transfert par contiguïté. En effet, la métonymie (du grec ????????? - renommer) est un trope rhétorique dont l'essence est qu'un mot est remplacé par un autre, et la base du remplacement est (spatiale, temporelle ou causale ) contiguïté signifiait Par exemple : debout dans les têtes, côté midi, à un jet de pierre, etc., etc. Comme le notaient les rhéteurs liégeois du groupe dit "Mu" ("Rhétorique Générale"), la métonymie, contrairement à M. , représente la substitution d'un mot à un autre à travers un concept qui n'est pas une intersection (comme dans le cas de M), mais englobe les signifiés des mots remplacés et remplaçants. Ainsi, dans l’expression « s’habituer à la bouteille », le transfert de sens présuppose une unité spatiale qui unit la bouteille et son contenu. Jacobson a extrêmement largement utilisé l'opposition « contiguïté/similarité » comme moyen explicatif : non seulement pour expliquer la différence traditionnelle entre prose et poésie, mais aussi pour décrire les traits de la poésie slave ancienne, pour classer les types troubles de la parole pour la maladie mentale, etc. Cependant, l’opposition « contiguïté/similarité » ne peut pas devenir la base d’une taxonomie de tropes et de figures rhétoriques. De plus, comme le rapporte la Rhétorique générale du groupe Mu, Jakobson mélangeait souvent métonymie et synecdoque. La synecdoque (grec - reconnaissance) est un trope rhétorique dont l'essence est soit de remplacer un mot désignant une partie d'un tout par un mot désignant le tout lui-même (synecdoque généralisant), soit, à l'inverse, de remplacer un mot désignant un tout avec un mot désignant une partie de ce tout (synecdoque rétrécissante). Exemples de synecdoque généralisante : attraper du poisson, frapper du fer, des mortels (au lieu de personnes), etc., exemples de synecdoque rétrécissante : appeler une tasse de thé, l'œil du maître, prendre une langue, etc.
Le groupe « Mu » a proposé de considérer M. comme une juxtaposition de synecdoque rétrécissante et généralisante ; cette théorie permet d'expliquer la différence entre M. conceptuel et référentiel. La différence entre M. au niveau seme et M. au niveau images mentales causée par la nécessité de repenser le concept de similarité qui sous-tend toute définition de M. Le concept de « similarité de sens » (du mot remplacé et du mot remplaçant), quels que soient les critères par lesquels il est déterminé (généralement les critères d'analogie , la motivation et les propriétés générales), reste très ambigu. D’où la nécessité de développer une théorie qui considère M. non seulement comme une relation entre le mot remplacé (A. A. Richards dans sa « Philosophy of Rhetoric » appelle son contenu signifié (ténor) M.) et le mot de remplacement (Richards l’appelle la coquille). (véhicule) M.), mais aussi comme relation entre un mot utilisé au sens figuré et les mots environnants utilisés au sens littéral.
La théorie de l'interaction, développée par Richards et M. Black (« Models and Metaphors »), considère la métaphore comme une résolution de la tension entre un mot utilisé métaphoriquement et le contexte de son utilisation. Attirant l’attention sur le fait évident que la plupart des M. sont utilisés entourés de mots qui ne sont pas des M., Black identifie l’objectif et le cadre de M., c’est-à-dire M. en tant que tel et le contexte de son utilisation. La maîtrise des mathématiques implique la connaissance du système d'associations généralement acceptées, et donc la théorie de l'interaction met l'accent sur l'aspect pragmatique du transfert de sens. Puisque la maîtrise des mathématiques est associée à la transformation du contexte et, indirectement, de l'ensemble du système d'associations généralement acceptées, les mathématiques s'avèrent être un moyen important de cognition et de transformation de la société. Ce corollaire de la théorie de l'interaction a été développé par J. Lakoff et M. Johnson (« Metaphors We Live By ») en une théorie des « métaphores conceptuelles » qui régissent le discours et la pensée des gens ordinaires dans les situations quotidiennes. Habituellement, le processus de démétaphorisation, la transformation du sens figuré en sens direct, est associé à la catachrèse. La catachrèse (grec - abus) est un trope rhétorique dont l'essence est d'élargir le sens d'un mot, d'utiliser un mot dans un nouveau sens. Par exemple : un pied de table, une feuille de papier, un lever de soleil, etc. Les catachreses sont répandues dans le langage quotidien et scientifique : tous les termes de toute science sont des catachreses. J. Genette (« Figures ») a souligné l'importance pour la rhétorique en général et pour la théorie de M. en particulier d'une controverse sur la définition du concept de catachrèse. Le grand rhéteur français du XVIIIe siècle. S. S. Dumarce (« Traité des chemins ») adhère toujours à la définition traditionnelle de la catachrèse, estimant qu'elle représente une interprétation expansive du mot, pleine d'abus. Mais déjà dans début XIX V. P. Fontanier ("Manuel classique pour l'étude des tropes") a défini la catachrèse comme un M effacé ou exagéré. On pense traditionnellement qu'un trope diffère d'une figure en ce sens que sans tropes, la parole est généralement impossible, tandis que le concept de figure englobe non seulement des tropes, mais aussi des figures, servant simplement de décoration à un discours qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser. Dans la rhétorique de Fontanier, le critère d'une figure est sa traduisibilité. Puisque la catachrèse, contrairement à M., est intraduisible, c'est un trope, et, contrairement à la rhétorique traditionnelle (ce contraste est souligné par Genette), Fontanier estime que la catachrèse est un trope qui n'est pas en même temps une figure. Par conséquent, la définition de la catachrèse comme un type particulier de M. nous permet de voir dans M. un mécanisme de génération de nouveaux mots. Dans ce cas, la catachrèse peut être présentée comme une étape de démétaphorisation, au cours de laquelle elle est perdue, oubliée, supprimée du dictionnaire. langue moderne"contenu" M.
La théorie de Fontanier est étroitement liée au débat sur l'origine du langage qui a surgi dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Si J. Locke, W. Warburton, E.-B. de Condillac et d'autres ont développé des théories du langage comme expression de la conscience et imitation de la nature, puis J.-J. Rousseau (« Essai sur l'origine du langage ») a proposé une théorie du langage dont l'un des postulats était l'affirmation de la primauté du sens figuré. Un siècle plus tard, F. Nietzsche (« De la vérité et du mensonge dans le sens extramoral ») développa une théorie similaire, affirmant que les vérités sont des M., dont ils ont oublié ce qu'elles sont. Selon la théorie du langage de Rousseau (ou de Nietzsche) , non pas M., mourant, se transforme en catachrèse, mais, au contraire, la catachrèse est restituée à M., il n'y a pas de traduction du langage littéral au langage figuré (sans postuler une telle traduction, pas une seule théorie traditionnelle de M. n'est possible), mais, au contraire, la transformation du langage figuratif en quasi-littéral. La théorie de M. a été créée par J. Derrida (« Mythologie blanche : métaphore dans un texte philosophique »). La théorie de M., non liée à la considération de la relation de similarité, nous oblige à reconsidérer la question de l'iconicité de M. Il était une fois C. S. Peirce considérait M. comme iconique un métasigne qui représente le caractère représentatif du representamen en établissant son parallélisme avec quelque chose autre.
Selon W. Eco (« Parts of the Cinematic Code »), l’iconicité du cinéma n’est ni une vérité logique ni une réalité ontologique, mais dépend de codes culturels. Ainsi, contrairement aux idées traditionnelles sur M., la théorie de M. qui émerge aujourd'hui comprend ce trope comme un mécanisme de génération de noms, qui par son existence même affirme la primauté du sens figuré.
Le premier groupe de théories de M. le considère comme une formule permettant de remplacer un mot, un lexème, un concept, un nom (construction nominative) ou une « représentation » (construction d'une « expérience primaire ») par un autre ersatz de mot, lexème, concept, concept ou construction contextuelle contenant les désignations « expérience secondaire » ou des signes d'une autre sémiotique. ordre (« Richard Cœur de Lion », « lampe de la raison », yeux - « miroir de l'âme », « le pouvoir des mots » ; « et la parole de pierre tomba », « toi, siècles du passé, semailles décrépites », "Onéguine", la masse aérienne se dressait au-dessus de moi comme un nuage" (Akhmatova), "l'âge du chien-loup", "un profond évanouissement de lilas et des pas sonores de couleurs" (Mandelshtam). Une connexion explicite ou implicite de ces concepts dans un discours ou un acte mental (x comme y) se produit au cours du remplacement d'un cercle de significations (« cadre », « scénario », selon les mots de M. Minsky) par d'autres ou d'autres significations à travers des significations subjectives ou conventionnelles, situationnelles ou redéfinition contextuelle du contenu du concept (« représentation », « champ sémantique du mot »), réalisée tout en conservant le sens généralement admis (« objectif », « objectif ») d'un lexème, d'un concept ou d'un concept. L'objectivité » elle-même (objectivité du sens) ne peut être préservée que « translinguistiquement », par les conventions sociales du discours, les normes culturelles, et s'exprime, en règle générale, sous des formes substantielles. Ce groupe de théories met l'accent sur la sémantique. incomparabilité des éléments formant des relations de remplacement, « synopsis de concepts », « interférence » des concepts du sujet et définitions, qualifications, connexions de sémantique. fonctions d’image (« représentation ») et d’expression ou d’attrait de valeur. Il n’y a pas que les départements qui peuvent être remplacés. sémantique des éléments ou des concepts (au sein d'un système de significations ou de cadres de corrélation), mais des systèmes entiers de significations indexés en termes spécifiques. département « contexte discursif-rhétorique ». M.
Les théories de M. sont également regroupées autour de principes méthodologiques. idées de « sémantiquement anormales » ou de « prédication paradoxale ». M. dans ce cas est interprété comme une synthèse interactionnelle de « champs imaginatifs », « spirituels, analogisant l'acte de couplage mutuel de deux régions sémantiques » qui forment un spécifique. la qualité de l’évidence ou de l’imagerie. « Interaction » signifie ici subjective (libre de réglementations normatives), individuelle opérant (interprétation, modulation) avec des significations généralement acceptées (conventions sémantiques des connecteurs sujets ou existentiels, prédicats, significations sémantiques, valeurs de « l'existence » d'un objet). (« Un miroir rêve d'un miroir », « Je visite un souvenir », « Les ennuis nous manquent », « l'églantier était si parfumé qu'il s'est même transformé en un mot », « et maintenant j'écris, comme avant, sans taches, mes poèmes dans un cahier brûlé" ( Akhmatova), "Mais j'ai oublié ce que je veux dire, et la pensée désincarnée retournera au palais des ombres" (Mandelshtam), "dans la structure de l'air il y a le présence d'un diamant" (Zabolotsky). Cette interprétation de M. se concentre sur la pragmatique de la construction métaphorique, de la parole ou de l'action intellectuelle, souligne le sens fonctionnel de la convergence sémantique ou de la connexion de deux sens utilisés.
Les théories de la substitution résument l'expérience d'analyse de l'usage de la métaphore dans des espaces sémantiques relativement fermés (traditions rhétoriques ou littéraires et canons de groupe, contextes institutionnels), dans lesquels le sujet métaphorique lui-même est assez clairement défini. l'énoncé, son rôle et son destinataire, ainsi que les règles de la métaphore. substitution, en conséquence, des normes de compréhension de la métaphore. Avant l'ère moderne, il existait une tendance à un contrôle social strict sur les métaphores nouvellement introduites (fixées par la tradition orale, une corporation ou une classe de chanteurs et de poètes, ou codifiées dans le cadre d'une poétique normative de type classique, comme par exemple , Académie française des XVIIe-XVIIIe siècles), dont les résidus ont été conservés dans la poursuite de la hiérarchie. division du « haut », poétique. et tous les jours, prosaïque. langue. La situation des temps modernes (paroles subjectives, art moderne, science non classique) est caractérisée par une interprétation large de la musique en tant que processus d'interaction vocale. Pour les chercheurs qui partagent le paradigme prédicat ou interactionnel de la métaphore, l'attention se déplace de la liste ou du contenu des descriptions des métaphores elles-mêmes aux mécanismes de leur formation, aux règles et normes situationnelles (contextuelles) des métaphores subjectivement développées par le locuteur lui-même. . synthèse d'un sens nouveau et des limites de sa compréhension par autrui, la Crimée s'adresse à un énoncé constitué par une métaphore - à un partenaire, un lecteur, un correspondant. Cette approche augmente considérablement la thématique domaine d'étude de M., permettant d'analyser son rôle en dehors de la tradition. la rhétorique, considérée comme la principale. structure de l’innovation sémantique. À ce titre, les mathématiques deviennent l’un des domaines les plus prometteurs et les plus en développement dans l’étude du langage scientifique, de l’idéologie, de la philosophie et de la culture.
Du début du 19ème siècle. (A. Bizet, G. Feichinger) et à ce jour, cela signifie qu'une partie des recherches scientifiques de M. est consacrée à l'identification et à la description des types fonctionnels de M. dans divers types. discours. La division la plus simple est associée à la division des M effacés ("froids", "gelés") ou de routine - "goulot de bouteille", "pied de table", "aiguilles d'horloge", "le temps passe ou s'arrête", "temps d'or" , « poitrine enflammée », cela inclut également toute la métaphore de la lumière, du miroir, de l'organisme, de la naissance, de l'épanouissement et de la mort, etc.) et de l'individu M. Ainsi, dans le premier cas, des liens entre M et la mythologie sont tracés. ou traditionnel conscience, la sémantique se révèle. les racines de la signification de M. dans les rituels ou la magie. procédures (la méthodologie et les techniques cognitives des disciplines gravitant vers les études culturelles sont utilisées). Dans le second cas, l'accent est mis sur l'analyse du sens instrumental ou expressif de M. dans les systèmes d'explication et d'argumentation, suggestif et poétique. discours (œuvres d'érudits littéraires, de philosophes et de sociologues traitant des questions des fondements culturels de la science, de l'idéologie, des historiens et d'autres spécialistes). En même temps, on distingue les M. « nucléaires » (« racine »), définissant des M. axiomatiques – ontologiques. ou méthodique - un cadre d'explication qui incarne l'anthropopol. représentations dans la science en général ou en particulier. ses disciplines et paradigmes, dans les domaines de la culture, et des M. occasionnels ou contextuels, utilisés par le département. par les chercheurs à des fins et besoins explicatifs ou argumentatifs. La racine fondamentale M., dont le nombre est extrêmement limité, présente un intérêt particulier pour les chercheurs. L'apparition de nouveaux M. de ce genre signifie le début d'une spécialisation. différenciation scientifique, formation d'ontologies et de paradigmes « régionaux » (Husserl). Nuclear M. définit la sémantique générale. le cadre du « tableau du monde » disciplinaire (construction ontologique de la réalité), dont les éléments peuvent se déployer en départements. théorie conceptions et concepts. Ce sont les mathématiques fondamentales apparues lors de la formation de la science moderne - le « Livre de la nature », qui est « écrit dans le langage des mathématiques » (la métaphore de Galilée), « Dieu en tant qu'horloger » (respectivement, l'Univers est une horloge , une machine ou un système mécanique) etc. Chaque métaphore similaire. l’éducation fixe le cadre sémantique de la méthodologie. formalisation de théories privées, sémantique. des règles pour les concilier avec des contextes conceptuels plus généraux et paradigmes scientifiques, qui fournit à la science une rhétorique générale schéma d'interprétation empirique observations, explications de faits et de théories. preuve. Exemples de M. nucléaire - en économie, social et historique. sciences : la société en tant qu'organisme (le système biologique avec ses cycles, ses fonctions, ses organes), géol. structure (formations, couches), structure, bâtiments (pyramide, base, superstructure), machine (système mécanique), théâtre (rôles), comportement social sous forme de texte (ou de langue); équilibre des forces d'intérêts) et des actions de divers. auteurs, balance (balances); « main invisible » (A. Smith), révolution. Expansion du champ d'utilisation conventionnel de M., accompagné de mesures méthodologiques la codification des situations de son usage, fait de M. un modèle, concept scientifique ou un terme déf. volume de valeurs. Ce sont par exemple les principaux concepts en sciences naturelles sciences : particule, onde, forces, tension, champ, flèche du temps, primaire. explosion, attraction, essaim de photons, structure planétaire de l'atome, informer. bruit. boîte noire, etc. Chaque innovation conceptuelle affectant la structure d'une ontologie disciplinaire ou des méthodes de base. principes, s'exprime dans l'émergence d'un nouveau M. : le démon de Maxwell, le rasoir d'Occam. M. n'intègre pas simplement des spécialistes. sphères de la connaissance avec la sphère de la culture, mais sont également structures sémantiques, les setters contiennent. caractéristiques de la rationalité (sa formule sémantique) dans l'un ou l'autre domaine de l'humain. activités.
Lit. : Gusev S.S. Science et métaphore. L., 1984 ; Théorie de la métaphore : Sat. M., 1990 ; Goudkov L.D. Métaphore et rationalité comme problème d'épistémologie sociale M., 1994 ; Lieb H.H. Der Umfang des historischen Metaphernbegriffs. Cologne, 1964 ; Shibles W.A. Métaphore : une bibliographie et une histoire annotées. Eau vive (Wisconsin), 1971 ; Théorie du métaphore. Darmstadt, 1988 ; Kugler W. Zur Pragmatik der Metapher, Metaphernmodelle et histo-rische Paradigmen. Fr./M., 1984.
Excellente définition
Définition incomplète ↓
du grec métaphore - transfert, image) - l'utilisation d'un mot dans un sens figuré basé sur la similitude à tout égard de deux objets ou phénomènes ; remplacer une expression ordinaire par une expression figurative (par exemple, un automne doré, le bruit des vagues, une aile d'avion).
Excellente définition
Définition incomplète ↓
MÉTAPHORE
du grec métaphore - transfert) - un trope (voir tropes) d'un mot, qui consiste à transférer les propriétés d'un objet, d'un processus ou d'un phénomène à un autre sur la base de leur similitude à certains égards ou de leur contraste. Aristote dans « Poétique » a noté que M. est « un nom inhabituel, transféré de genre en espèce, ou d'espèce en genre, ou d'espèce en espèce, ou par analogie ». Parmi les quatre sortes de M., écrit Aristote, dans la Rhétorique, les M. fondés sur l'analogie méritent la plus grande attention, par exemple : « Périclès parlait de la jeunesse tuée à la guerre comme de la destruction du printemps parmi les saisons. » Aristote considère M. l'action comme particulièrement forte, c'est-à-dire celle où l'analogie est basée sur la représentation de l'inanimé comme animé, décrivant tout comme mobile et vivant. Et Aristote considère Homère comme un exemple d'utilisation de tels métaux : « La piqûre amère de la flèche... rebondissait sur le cuivre. Une flèche pointue s'est précipitée au milieu des ennemis, vers la victime avide prévue » (Iliade). Mais comment, avec l'aide de M., les actions de B.L. Pasternak crée l'image d'un nuage : « Lorsqu'un énorme nuage violet, debout au bord de la route, fit taire les sauterelles qui crépitaient de manière sensuelle dans l'herbe, et que les tambours des camps soupiraient et tremblaient, la terre s'assombrit dans le yeux et il n'y avait pas de vie dans le monde... Le nuage regarda les chaumes bas et cuits. Ils s'étendaient jusqu'à l'horizon. Le nuage se dressa facilement. Ils s'étendent plus loin, au-delà des camps. Le nuage s'est posé sur ses pattes avant et, traversant doucement la route, a rampé silencieusement le long du quatrième rail de la voie d'évitement » (Airways). Lors de la création de M., selon Quintilien (recueil « Douze livres d'instructions rhétoriques »), les plus typiques seront les quatre cas suivants : 1) remplacement (transfert de propriété) d'un objet animé par un autre animé (aujourd'hui on peut parler sur le transfert de propriété d'un vivant à un autre, car les Grecs et les Romains considéraient que seules les personnes étaient animées). Par exemple : « Il y avait des chevaux - pas des chevaux, des tigres » (E. Zamyatin. Rus') ; le morse «... s'enroule à nouveau sur la plate-forme, sur son corps gras et puissant apparaît la tête moustachue et hérissée de Nietzsche au front lisse» (V. Khlebnikov. Ménagerie) ; 2) un objet inanimé est remplacé (un transfert de propriété se produit) par un autre objet inanimé. Par exemple : « Une rivière tourbillonne dans le brouillard du désert » (A. Pouchkine. Fenêtre) ; « Au-dessus de lui se trouve un rayon de soleil doré » (M. Lermontov. Sail) ; « Une feuille rouillée est tombée des arbres » (F. Tyutchev. N.I. Krolyu) ; « La mer bouillante en dessous de nous » (chanson « Varyag »); 3) remplacement (transfert de propriétés) d'un objet inanimé par un objet animé. Par exemple : « La parole est la plus grande règle : elle paraît petite et imperceptible, mais elle fait des choses merveilleuses : elle peut arrêter la peur et détourner la tristesse, provoquer la joie et accroître la pitié » (Gorgias. Louange à Elena); « La nuit est calme, le désert écoute Dieu et l'étoile parle à l'étoile » (M. Lermontov. Je sors seul sur la route...) ; « Un verrou rouillé criera à la porte » (A. Bely. Jester) ; "Bright Kolomna, serrant ma sœur Ryazan dans ses bras, mouille mes pieds nus dans l'Oka taché de larmes" (N. Klyuev. Dévastation); « Les tilleuls étaient glacés jusqu'aux os » (N. Klyuev. Les tilleuls étaient glacés jusqu'aux os...) ; 4) remplacement (transfert de propriétés) d'un objet animé par un objet inanimé. Par exemple : « Cœur fort » (c'est-à-dire avare, cruel) - dit l'officier à propos du prêteur sur gages Sanjuelo (R. Lesage. Les Aventures de Gil Blas de San Tillana) ; « Les Sophistes sont des pousses venimeuses qui s'accrochent à des plantes saines, la pruche dans une forêt vierge » (V. Hugo. Les Misérables) ; « Les Sophistes sont des fleurs luxuriantes et magnifiques du riche esprit grec » (A. Herzen. Lettres sur l'étude de la nature). Aristote dans « Rhétorique » a souligné que M. « a un haut degré de clarté, d'agrément et un signe de nouveauté ». C'était M., croyait-il, avec les mots couramment utilisés langue maternelle , sont le seul matériel utile pour le style du discours en prose. M. est très proche de la comparaison, mais il y a aussi une différence entre eux. M. est un trope rhétorique, le transfert des propriétés d'un objet ou d'un phénomène à un autre basé sur le principe de leur similitude à certains égards, et la comparaison est une technique logique similaire à la définition d'un concept, une expression figurative dans laquelle le Le phénomène représenté est comparé à un autre. Habituellement, la comparaison est exprimée en utilisant les mots comme, comme, comme si. M., contrairement à la comparaison, a une plus grande expression. Les moyens du langage permettent de séparer assez strictement la comparaison et M.. Cela a été fait dans la Rhétorique d’Aristote. Voici les comparaisons de I. Annensky dans « Le Trèfle de la tentation » : « Une journée joyeuse brûle... Parmi les herbes fanées, tous les coquelicots sont tachetés - comme une impuissance avide, comme des lèvres pleines de tentation et de poison, comme des papillons écarlates avec les ailes déployées. » Ils peuvent facilement être transformés en métaphore : les coquelicots sont des papillons écarlates aux ailes déployées. Démétrius, dans son ouvrage « On Style », a examiné un autre aspect de la relation entre M. et la comparaison. Si M., écrit-il, semble trop dangereux, alors il est facile d'en faire une comparaison, en l'insérant pour ainsi dire, et alors l'impression de risque caractéristique de M. s'affaiblira. Dans les traités des rhéteurs, dans les travaux des spécialistes dans le domaine de la poétique et de la stylistique, la plus grande attention est accordée à M. Quintilien l'appelait le plus commun et le plus beau des tropes de la rhétorique. C'est, croyait le rhéteur romain, quelque chose d'inné et, même chez les ignorants complets, cela apparaît souvent de la manière la plus naturelle. Mais c'est bien plus agréable et plus beau quand M. est recherchée avec goût et brille de sa propre lumière dans un discours élevé. Il augmente la richesse de la langue en changeant ou en empruntant tout ce qui lui manque. M. sert à étonner l'esprit, à identifier plus fortement le sujet et à le présenter comme devant les yeux des auditeurs. Bien sûr, on ne peut pas exagérer son rôle. Quintilien a noté que l'excès de M. dérange l'attention de l'auditeur et transforme le discours en une allégorie et une énigme. Vous ne devez pas utiliser M. bas et indécent, ainsi que M. basé sur une fausse similitude. Aristote voyait l'une des raisons de l'emphase et de la froideur du discours d'un locuteur dans l'utilisation de mots inappropriés. Il croyait que trois types de mots ne devaient pas être utilisés : 1) avoir un sens amusant ; 2) dont le sens est trop solennel et tragique ; 3) emprunté de loin, et ayant donc un sens ou une apparence poétique peu claire. Depuis l’Antiquité, la question de savoir quelle quantité de métal peut être utilisée en même temps fait l’objet de discussions constantes. Déjà les théoriciens grecs de la rhétorique acceptaient comme « loi » l'utilisation simultanée de deux, maximum trois M. Ayant accepté, en principe, cette position, Pseudo-Longin, dans son traité « Du Sublime », estime toujours que la justification de la rhétorique grecque le grand nombre et le courage de M. sont « la passion appropriée de la parole et sa noble sublimité ». Il est naturel que la vague croissante de sentiments orageux entraîne tout avec elle. » Ce sont ces propriétés de M. qui ont été superbement démontrées par M.V. Lomonossov : « Le maître de nombreuses langues, la langue russe, non seulement par l'immensité des lieux où elle domine, mais aussi par son propre espace et son contentement, est grande devant tous en Europe... Charles Quint... si il maîtrisait la langue russe, alors... y trouverait la splendeur de l'espagnol, la vivacité du français, la force de l'allemand, la tendresse de l'italien, en plus de la richesse et de la forte brièveté des images du grec et du russe. langue latine"(M. Lomonossov. Grammaire russe). Description du bore par E.I. Zamyatin est donné grâce à l'utilisation de nombreux M. : « … Des journées d'hiver bleues, le bruissement des morceaux de neige - de haut en bas le long des branches, un crépitement glacial vigoureux, un martèlement de pic ; les jours d'été jaunes, les bougies de cire aux mains vertes noueuses, le miel transparent arrache les troncs solides et durcis, les coucous comptent les années. Mais ensuite les nuages se sont enflés dans l'étouffement, le ciel s'est divisé en une fissure cramoisie, une goutte de feu a commencé à s'allumer - et la forêt centenaire a commencé à fumer, et au matin des langues rouges bourdonnaient tout autour, une épine, un un sifflement, un crépitement, un hurlement, la moitié du ciel était en fumée, le soleil était à peine visible dans le sang » (E. Zamyatin. Rus'). Évaluer le rôle de M. dans fiction a accordé beaucoup d'attention à B.L. Pasternak : « L'art est réaliste en tant qu'activité et symbolique en tant que fait. Il est réaliste dans le sens où il n'a pas inventé M. lui-même, mais l'a trouvé dans la nature et l'a reproduit de manière sacrée » (B. Pasternak. Sauf-conduit). « La métaphorisme est une conséquence naturelle de la fragilité de l’homme et de l’énormité planifiée depuis longtemps de ses tâches. Face à cet écart, il est obligé de regarder les choses avec un œil aiguisé d'aigle et de s'expliquer avec des idées instantanées et immédiatement compréhensibles. C'est de la poésie. Le métaphorisme est un raccourci pour une grande personnalité, un raccourci pour son esprit » (B. Pasternak. Notes sur les traductions de Shakespeare). M. est le plus commun et le plus expressif de tous les tropes. Lit. : Théories anciennes du langage et du style. -M.; L., 1936. - P. 215-220 ; Aristote. Poétique // Aristote. Oeuvres : En 4 vol. - M., 1984. - T. 4. - P. 669-672 ; Aristote. Rhétorique // Rhétorique ancienne. - M., 1978. - P. 130-135, 145-148 ; Aroutyunova N.D. Métaphore//Dictionnaire encyclopédique linguistique. - M., 1990 ; Démétrius. À propos du style // Rhétorique ancienne. - M., 1978 ; Jol K.K. Pensée. Mot. Métaphore. - Kyiv, 1984 ; Quintilien. Douze livres d'instructions rhétoriques. En 2 parties. - Saint-Pétersbourg, 1834 ; Korolkov V.I. Sur les aspects extra-linguistiques et intra-linguistiques de l'étude de la métaphore // Uch. zapper. MGPIIYA. - M., 1971. - Numéro. 58 ; Lomonosov M.V. Un bref guide de l'éloquence : premier livre, qui contient de la rhétorique, montrant règles généralesà la fois éloquence, c'est-à-dire oratorio et poésie, composées pour le bénéfice de ceux qui aiment les sciences verbales // Anthologie de la rhétorique russe. - M., 1997. - P. 147-148 ; Lvov M.R. Rhétorique: Didacticiel pour les élèves de 10e à 11e années. - M., 1995 ; Panov M.I. La rhétorique de l'Antiquité à nos jours // Anthologie de la rhétorique russe. - M., 1997. - P. 31-32 ; Freidenberg O.M. Métaphore // Freidenberg O.M. Mythe et littérature de l'Antiquité. - M., 1978 ; Dictionnaire encyclopédique des jeunes critiques littéraires : pour les mercredis et les seniors. âge scolaire/ Comp. DANS ET. Novikov. - M., 1988. - P. 167-169. MI. Panov
La langue russe est vraiment riche et majestueuse. Pas un seul invité étranger ne peut nous comprendre, et parfois les Russes eux-mêmes ont du mal à se comprendre. C'est parce qu'il est infiniment grand non seulement lexique, mais aussi la couleur de la parole. Dans une conversation normale, vous
vous utilisez des chemins différents sans vous en rendre compte. Ici, par exemple, métaphore. Tout d’abord, essayez de vous souvenir de tout ce que vous savez d’elle. Si c'est la première fois que vous rencontrez ce terme, lisez les documents recommandés sur ce sujet ci-dessous.
Les expressions utilisées au sens figuré, transférant les signes d'un phénomène à un autre, similaire au premier, sont appelées métaphores. Le terme " métaphore" vient de la langue grecque.
En russe, il y a trois éléments de comparaison :
- Articles comparés ;
- Images avec lesquelles ils comparent ;
- Signes sur la base desquels la comparaison elle-même a lieu.
Dans le discours métaphore remplit ses fonctions particulières. La fonction d’évaluation vient en premier. Dans ce cas, la métaphore est utilisée pour évoquer des associations spécifiques sur l'objet en discussion et évaluer leur importance.
Par exemple, « l’homme est un loup ». Au niveau des associations, émerge l’image d’un prédateur, maléfique et cruel.
La deuxième sur la liste est la fonction émotive-évaluative. Dans ce cas métaphore utilisé pour obtenir un effet expressif.
Par exemple, «faim comme un loup» - une association apparaît selon laquelle cette personne a très, excessivement faim.
La fonction suivante montre clairement que la métaphore est également nécessaire pour créer un discours figuratif. Le plus souvent utilisé en littérature. Ici, elle est responsable non seulement de la comparaison, mais aussi de la création de nouvelles images. Vous dessinez une nouvelle image dans votre imagination, la dotez de capacités spécifiques puis la considérez comme déjà existante. Cette fonction est dite nominative.
À titre d'exemple, considérons la phrase suivante : « digérer les informations » - vous connaissez la signification du mot « digérer », c'est-à-dire faire bouillir, cuire dans une casserole. Aussi, l’information est digérée, ou en d’autres termes, repensée dans la tête.
Et enfin, la fonction cognitive. Sans aucun doute, merci métaphores vous remarquez les propriétés les plus importantes d’un objet ou d’un phénomène. Vous savez déjà lire, pour ainsi dire, entre les lignes, voir l'invisible.
Avec fonctions métaphores Nous l'avons compris, nous présentons maintenant à votre attention leurs variétés. Il y en a cinq en langue russe.
- Une métaphore qui relie des concepts distants s'appelle une métaphore.
- L'exact opposé de dur métaphores– effacé.
- Formule métaphore– il est très proche de l’effacement du sens et de l’expressivité, mais beaucoup plus stéréotypé.
- Métaphore, dont le sens se déploie tout au long de l'énoncé entier est appelé élargi.
- Mis en œuvre métaphore. Il est utilisé comme si sa signification était directe et non figurative, parfois cela semble drôle.