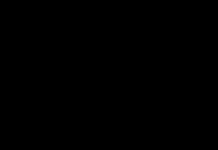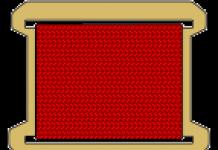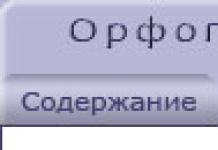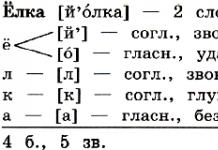Le roman d'Orwell "1984" résumé qui se trouve dans cet article est la fameuse dystopie de l’écrivain anglais. L'ouvrage a été publié pour la première fois en 1949. Aujourd'hui, son nom, ainsi que la terminologie utilisée par l'auteur, sont devenus des noms familiers. Ils sont souvent utilisés pour désigner une structure sociale qui ressemble à la société totalitaire décrite par l'auteur. Le roman a souvent été censuré, notamment en pays socialistes, et des critiques, le plus souvent émanant de mouvements de gauche en Occident.
Première partie
Le roman d'Orwell "1984", dont vous lisez actuellement un résumé, commence par les événements de Londres en 1984. Le pays appartient à la province d'Océanie. Le personnage principal est Winston Smith, 39 ans, sans prétention. Il travaille pour le ministère de la Vérité.
Au tout début du roman 1984 de George Orwell, résumé sur la page, il monte les escaliers jusqu'à son appartement. Il y a une affiche dans le hall montrant un visage énorme et robuste avec des sourcils noirs et broussailleux. La légende en dessous : « Big Brother vous regarde. » Il deviendra le refrain de tout le roman, sera souvent utilisé dans les œuvres et dans vie ordinaire après le succès du livre d'Orwell.
La chambre de Smith n'est pas différente du logement de la plupart des habitants de l'Angleterre à cette époque. Il y a un immense écran de télévision intégré au mur, qui ne peut pas être éteint ; il fonctionne 24 heures sur 24. Et tant pour la réception que pour la transmission. La police de la pensée, qui travaille scrupuleusement, peut écouter chaque mot, voir chaque mouvement de n'importe quel citoyen du pays.
Les fenêtres de l'appartement de Smith donnent directement sur la façade du ministère, également décorée d'affiches. Sur eux, vous pouvez voir des inscriptions paradoxales, même si personne ne doute de leur exactitude. "La guerre est la paix. L'ignorance est la force. La liberté est l'esclavage."
Journal de Smith

Au tout début du roman d'Orwell « 1984 », dont un résumé se trouve dans cet article, on apprend que personnage principal décide de tenir un journal. Il s’agissait à l’époque d’une entreprise meurtrière, qui pouvait entraîner la peine capitale ou l’exil dans des camps de travaux forcés. Mais c'est vital pour lui, Winston veut rassembler toutes ses pensées et les enregistrer.
En même temps, il ne se console pas en espérant que les générations futures connaîtront un jour l'existence du journal. Smith est convaincu que la police l'arrêtera tôt ou tard, car le délit de pensée est sévèrement puni. Mais même dans une telle situation, il décide de prendre des risques.
Ne sachant pas par où commencer, Smith se souvient d'une matinée au sein de son ministère qui commençait traditionnellement par deux minutes de haine. Comme toujours, le sujet des deux minutes était Goldstein. Il a été qualifié de profanateur de la pureté du parti et de principal traître.
Dans le roman 1984 de George Orwell, résumé ici, Winston rencontre une jolie fille aux taches de rousseur espiègles au cours d'une rencontre de deux minutes. Il ne l'aimait pas à première vue. Ces jolies jeunes filles se sont révélées le plus souvent être les adhérentes les plus fidèles et les plus fanatiques du parti au pouvoir. Ils lançaient volontiers des slogans lors des rassemblements et étaient des espions et des informateurs volontaires.
Le rêve du personnage principal

A ce moment, O'Brien apparut dans la salle. Il était un membre de haut rang du parti supervisant le ministère de la Vérité. Du roman "1984" de J. Orwell, dont vous pouvez lire un résumé si vous ne parvenez pas à maîtriser l'intégralité de l'œuvre, nous apprenons qu'il était lourd et emphatiquement maniéré. Dans le même temps, Winston et quelques autres soupçonnaient qu'en réalité il n'était pas aussi fidèle au parti qu'il essayait de le prouver.
Smith se souvient de plus en plus récemment de son vieux rêve, dans lequel, dans la voix d'O'Brien, un inconnu promet de le rencontrer bientôt dans un endroit où il n'y a pas d'obscurité.
Journal de vérité

Winston a décidé de tenir un journal lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se rappeler clairement quand son pays n'était pas en guerre. Dans le même temps, le Parti, selon des sources d'information officielles, a affirmé que l'Océanie n'avait jamais fait partie d'une alliance avec l'Eurasie. Bien que Smith lui-même se souvienne clairement que le syndicat n'existait qu'il y a quatre ans. Mais cette connaissance n'était stockée que dans sa mémoire ; il ne pouvait en aucun cas la documenter. Par conséquent, il remettait de plus en plus en question ce que le parti lui disait, soupçonnant que les mensonges, installés dans l’histoire, finissaient par se transformer en vérité.
Récemment, les gens ont beaucoup changé, note le héros du roman "1984" de George Orwell, dont un résumé ne peut remplacer l'œuvre elle-même. Les enfants dénoncent de plus en plus leurs parents. Par exemple, la progéniture de ses voisins a tenté de surprendre son père et sa mère incontinents idéologiquement.
L'œuvre de Wilson

De retour à son travail au ministère de la Vérité, Smith commence ses fonctions habituelles. Il modifie les articles des journaux publiés les années précédentes en fonction des réalités d'aujourd'hui. Les prévisions politiques erronées sont détruites, les erreurs de Big Brother sont effacées des pages de la presse. Les noms des personnes indésirables sont définitivement supprimés des articles et essais.
Pendant la pause déjeuner, Winston rencontre le philologue Syme, expert local en novlangue, dans la salle à manger. Dans le roman d'Orwell "1984" (un résumé chapitre par chapitre vous permettra de vous familiariser avec les points principaux de l'ouvrage) des techniques linguistiques particulières sont utilisées. Syme soutient que détruire les mots est une belle chose. Ainsi, les crimes de la pensée humaine deviennent impossibles. Il n’y a tout simplement plus de mots pour eux.
En même temps, Winston se dit que le philologue va définitivement être aspergé. Bien qu’on ne puisse pas dire de lui qu’il est infidèle, il y a une odeur constante de peu de respectabilité qui émane de lui.
La femme de Winston

À la toute fin du déjeuner, Smith remarque que la jeune fille aux cheveux noirs, qu'il avait aperçue le matin à Two Minutes of Hate, le surveille désormais de près.
En même temps, il se souvient de sa propre femme, avec laquelle il s'est séparé il y a environ 11 ans. Elle s'appelait Katherine. Smith comprend que même au tout début de leur vie commune, il s'est clairement rendu compte qu'il n'avait jamais rencontré une créature plus stupide et plus vide. Toutes les pensées dans sa tête étaient exclusivement des slogans.
En réfléchissant à qui est capable de détruire le Parti, Winston arrive à la conclusion que seuls les prolétaires en sont capables. Dans le roman « 1984 » de George Orwell (nous décrivons maintenant un résumé des chapitres), c'est le nom de la caste inférieure des habitants d'Océanie. De plus, ils représentent 85 % de la population totale. Lorsqu’il s’agit de trancher des questions morales, ils suivent les coutumes de leurs ancêtres, mais ils vivent si mal qu’il n’y a même pas d’écran de télévision dans leurs appartements.
Smith fait une entrée importante dans son journal. "La liberté est la capacité de dire que deux et deux font quatre."
Deuxième partie du roman

Le lendemain, au service, Smith rencontre à nouveau la fille aux taches de rousseur. Elle trébuche et tombe juste devant lui, et il se précipite à son secours. Pendant que Winston aide sa collègue à se relever, elle lui glisse tranquillement un mot dans la main. Il n’y a que trois mots dedans : « Je t’aime ». Ils conviennent d'une date.
Dans le livre d'Orwell de 1984, les personnages font une promenade romantique en dehors de la ville. Seulement là, on ne peut pas les entendre.
Il s'avère que le nom de la fille est Julia. Elle admet avoir eu des dizaines de relations avec des membres du Parti. Winston n'en est que ravi, car il comprend que seules une telle dépravation et une telle passion animale peuvent détruire le Parti de l'intérieur. George Orwell décrit leur étreinte amoureuse dans son livre « 1984 », dont un résumé permet de se faire une idée de la relation entre les personnages principaux comme d'un acte politique.
Julia
Julia n'a que 26 ans. Elle travaille au département littéraire sur une machine qui écrit des romans. Pour rencontrer sa petite amie, Smith loue une chambre sans écran de télévision au-dessus d'une brocante. Lors d'une de ces rencontres, ils aperçoivent un rat sortir d'un trou. Julia n'y attache aucune importance, mais Winston admet qu'il pense qu'il n'y a rien de pire au monde.
Chaque jour, Julia l'étonne de plus en plus. Un jour, alors qu'il commence à parler de la guerre avec l'Eurasie, elle déclare qu'elle pense qu'il n'y a pas de guerre du tout. Et le gouvernement lui-même peut larguer des missiles sur Londres pour maintenir la population dans une peur constante.
A cette époque, une conversation fatidique a lieu entre Smith et O'Brien. Ils organisent une réunion. Ce soir-là, Winston se souvient de sa pauvre enfance. Il ne se souvient pas de la façon dont son père a disparu ; il y avait très peu de nourriture. Et outre sa mère, sa sœur cadette vivait avec lui. Un jour, il a pris la part de chocolat de la jeune fille et s'est enfui de chez lui. Et à son retour, il ne retrouva plus ses proches. Il a été emmené dans un camp pour enfants sans abri, où il a grandi.
Relation entre Julia et Smith
La relation entre Julia et Smith se développe. La jeune fille veut sortir ensemble jusqu'à la toute fin, mais le héros la prévient que s'ils sont découverts, ils pourraient être torturés.
Les deux viennent voir O'Brien et admettent qu'ils sont des ennemis du Parti. Il répond en confirmant que l'organisation des Frères musulmans, qui s'oppose au Parti, existe. Il promet d'apporter bientôt à Winston le livre écrit par Goldstein.
À l’heure actuelle, d’autres changements se produisent dans les relations géopolitiques. Le gouvernement annonce qu'il n'a jamais combattu l'Eurasie, qu'il est son allié et que l'éternel ennemi est l'Estasia. Au cours des cinq jours suivants, Winston s'efforce de corriger le passé.
Les mêmes jours, il retrouve le livre de Goldstein. Il s’intitule « La théorie et la pratique du collectivisme oligarchique ». Il le lit avec Julia dans la pièce au-dessus de la brocante. A ce moment ils se révèlent, personnes inconnues Julia est emportée. Il s’avère qu’il y avait un écran de télévision caché dans la pièce. Le chiffonnier s'avère être un flic infiltré.
La troisième partie
Dans la troisième partie du roman 1984 d'Orwell, Winston est transporté dans un lieu inconnu. Il suppose qu'il s'agit du Ministère de l'Amour. Il est placé dans une chambre où la lumière est constamment allumée.
Parsons, qui dans un rêve appelait au renversement de Big Brother, lui est assigné. Sa propre fille l'a dénoncé.
Pour arracher des aveux à Smith, il est torturé et battu. Il s'avère qu'il a été surveillé pendant sept ans avant d'être arrêté. Quand O'Brien revient, Winston se rend compte qu'il a toujours été de leur côté. Lui rappelant une phrase de son journal selon laquelle la liberté est la capacité de dire que deux plus deux égale quatre, il ancien camarade lui montre quatre doigts et lui demande de lui dire combien il y en a.
Malgré la torture, Smith répond qu'il est 4. Ce n'est que lorsque la douleur du prisonnier s'intensifie qu'il admet qu'il est 5. Mais O'Brien note qu'il ment, car il croit toujours qu'il est quatre.
Le parti ne peut pas être renversé
Il est révélé qu'O'Brien est l'un des membres du parti qui a écrit le livre Brotherhood. Le parti lui-même incite des gens comme Winston à étouffer la protestation dans l’œuf. Chaque année, il y en a de moins en moins.
Smith n'est d'accord qu'avec le fait qu'il est tombé. Après tout, il n'a jamais trahi Julia. Mais cela arrive aussi. Winston est gardé dans une cellule. Dans le roman d'Orwell "1984", dont un résumé est devant vous, Winston avoue même en conclusion son amour pour une fille. Il est envoyé à la cellule numéro cent un. Là, une cage de rats dégoûtants lui est présentée en face. La principale chose dont Smith a peur dans cette vie. En désespoir de cause, il demande à leur donner Julia, mais pas lui. Alors il finit par sombrer, trahissant son dernier être cher.
La fin du roman
À la fin du roman, Smith passe du temps dans un café appelé « Sous le marronnier ». Il comprend tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps.
Après l'emprisonnement et la torture au Ministère de l'Amour, il rencontre Julia. Smith note qu'elle a beaucoup changé. Son visage est devenu jaunâtre et une cicatrice est apparue sur son front. Et quand il la serrait dans ses bras, elle lui paraissait aussi pierre qu'un cadavre. Tous deux ont admis s'être trahis sous la torture.
A cette époque, des fanfares cérémonielles se font entendre dans le café. On annonce que l'Océanie a gagné la guerre contre l'Eurasie. Winston admet qu'il s'est également vaincu et a vaincu Big Brother.
Analyse du roman
Le roman d'Orwell "1984", dont un résumé, dont l'analyse vous sera certainement utile, soulève de nombreuses questions importantes.
Il parle de la censure, qui se développe dans une société totalitaire, du nationalisme, qui devient la base politique intérieure au niveau de l’État, la surveillance, nécessaire au maintien des dirigeants au pouvoir.
Jusqu'à présent, une grande partie de ce qui est décrit dans le roman reste pertinente et discutée entre les habitants des quartiers les plus pauvres. différents pays. Partout où au moins les débuts de l'autoritarisme ou du totalitarisme apparaissent au pouvoir, ils commencent immédiatement à se souvenir de ce roman immortel de George Orwell, affirmant que tout ce que l'écrivain de science-fiction a écrit se réalise à nouveau.
George Orwell
Première partie
C'était une journée d'avril froide et claire et l'horloge sonna treize heures. Enfouissant son menton dans sa poitrine pour échapper au vent maléfique, Winston Smith se glissa précipitamment par la porte vitrée de l'immeuble Pobeda, tout en laissant entrer un tourbillon de poussière granuleuse.
Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. En face de l'entrée, sur le mur, était accrochée une affiche colorée, trop grande pour la pièce. L'affiche représentait un visage énorme, de plus d'un mètre de large, le visage d'un homme d'environ quarante-cinq ans, avec une épaisse moustache noire, rugueuse, mais masculinement attirante. Winston se dirigea vers les escaliers. Cela ne servait à rien d'aller à l'ascenseur. Il est même dedans des temps meilleurs fonctionnait rarement, et maintenant, pendant la journée, l'électricité était complètement coupée. Le régime économique était en vigueur : ils se préparaient pour la Semaine de la Haine. Winston dut franchir sept marches ; il avait la quarantaine, il avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville : il se levait lentement et s'arrêtait plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, le même visage regardait depuis le mur. Le portrait a été réalisé de telle manière que peu importe où vous alliez, vos yeux ne vous lâcheraient pas. GRAND FRÈRE VOUS REGARDE, - lire la signature.
Dans l'appartement, une voix riche a parlé de la production de fonte et a lu des chiffres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue encastrée dans le mur droit, semblable à un miroir trouble. Winston tourna le bouton, sa voix s'affaiblissait, mais le discours restait clair. Il était possible d'atténuer cet appareil (on l'appelait télécran), mais il était impossible de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre ; homme petit et frêle, il paraissait encore plus chétif dans l'uniforme bleu d'un membre du parti. Ses cheveux étaient complètement blonds et son visage rougeaud pèle à cause du mauvais savon, des lames émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer.
Le monde extérieur, derrière les fenêtres fermées, respirait le froid. Le vent faisait tourbillonner la poussière et les bouts de papier en spirales ; et même si le soleil brillait et le ciel était d'un bleu intense, tout dans la ville semblait incolore - à l'exception des affiches affichées partout. Le visage à moustache noire le regardait sous tous les angles visibles. De la maison d'en face aussi. GRAND FRÈRE VOUS REGARDE, - dit la signature, et des yeux sombres regardèrent ceux de Winston. En bas, au-dessus du trottoir, une affiche au coin déchiré claquait au vent, tantôt cachée, tantôt révélant un seul mot : ANGSOC. Au loin, un hélicoptère glissait entre les toits, planait un instant comme une mouche cadavre et s'envolait dans une courbe. C'était une patrouille de police qui regardait par les fenêtres des gens. Mais les patrouilles ne comptaient pas. Seule comptait la police de la pensée.
Derrière Winston, la voix du télécran parlait toujours de la fusion du fer et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télécran fonctionnait pour la réception et la transmission. Il captait chaque mot, s'il était prononcé dans un murmure pas trop silencieux ; De plus, tant que Winston restait dans le champ de vision de la plaque nuageuse, il était non seulement entendu, mais aussi vu. Bien entendu, personne ne savait s’il était surveillé ou non à ce moment-là. À quelle fréquence et à quel moment la police de la pensée se connecte-t-elle à votre câble - on ne peut que le deviner. Il est possible qu’ils surveillaient tout le monde – et ce 24 heures sur 24. De toute façon, ils pourraient se connecter à tout moment. Vous deviez vivre - et vous viviez par habitude, qui se transformait en instinct - en sachant que chacune de vos paroles était entendue et que chacun de vos mouvements, jusqu'à l'extinction des lumières, était surveillé.
Winston gardait le dos au téléécran. C'est plus sûr ainsi ; même si – il le savait – son dos cédait également. A un kilomètre de sa fenêtre, le bâtiment blanc du ministère de la Vérité, son lieu de travail, dominait la ville crasseuse. Voilà, pensa Winston avec un vague dégoût, voilà, Londres, ville principale Airstrip I, la troisième province la plus peuplée de l'État d'Océanie. Il se tourna vers son enfance et essaya de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Ces rangées de maisons délabrées du XIXe siècle, étayées par des rondins, aux fenêtres rapiécées avec du carton, aux toits en patchwork, aux murs ivres des jardins de devant, se sont-elles toujours étendues au loin ? Et ces clairières des bombardements, où la poussière d'albâtre s'enroulait et où l'épilobe grimpait sur des tas de décombres ; et de grands terrains vagues où les bombes ont fait place à toute une famille de champignons, de misérables cabanes en planches qui ressemblaient à des poulaillers ? Mais - en vain, il ne s'en souvenait pas ; de l'enfance il ne reste que des scènes fragmentaires, très éclairées, dépourvues de fond et le plus souvent incompréhensibles.
Le ministère de la Vérité – en novlangue MiniPrav – était remarquablement différent de tout ce qui existait. Ce gigantesque édifice pyramidal, brillant de béton blanc, s'élevait, corniche après corniche, jusqu'à une hauteur de trois cents mètres. Depuis sa fenêtre, Winston pouvait lire trois slogans du parti écrits en écriture élégante sur la façade blanche :
LA GUERRE EST LA PAIX
LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE
L'IGNORANCE EST LE POUVOIR
Selon les rumeurs, le Ministère de la Vérité contenait trois mille bureaux au-dessus de la surface de la terre et un système de racines correspondant dans les profondeurs. DANS différentes fins Il n'y avait que trois autres bâtiments de ce type et de cette taille à Londres. Ils dominaient si haut la ville que depuis le toit de l'immeuble résidentiel Pobeda, on pouvait les voir tous les quatre à la fois. Ils abritaient quatre ministères, soit l'ensemble de l'appareil d'État : le ministère de la Vérité, chargé de l'information, de l'éducation, des loisirs et des arts ; le ministère de la Paix, chargé de la guerre ; le ministère de l'Amour, chargé du maintien de l'ordre, et le ministère de l'Abondance, chargé de l'économie. En novlangue : miniprav, miniworld, minilove et minizo.
Le ministère de l’Amour inspirait la peur. Il n'y avait pas de fenêtres dans le bâtiment. Winston n'a jamais franchi son seuil, ne s'est jamais approché à moins d'un demi-kilomètre de lui. Il n'était possible d'y arriver que pour des raisons officielles, puis après avoir traversé tout un labyrinthe de barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses camouflés. Même les rues menant à l'anneau extérieur des clôtures étaient patrouillées par des gardes en uniforme noir, à visage de gorille, armés de matraques articulées.
Winston se tourna brusquement. Il donna à son visage une expression d'optimisme calme, plus appropriée devant un écran de télévision, et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, vers la petite kitchenette. Ayant quitté le ministère à cette heure-là, il a sacrifié le déjeuner dans la salle à manger, et il n'y avait pas de nourriture à la maison - à l'exception d'une miche de pain noir, qu'il fallait conserver jusqu'à demain matin. Il sortit sur l'étagère une bouteille de liquide incolore avec une simple étiquette blanche : « Victory Gin ». Le gin avait une odeur désagréable et grasse, comme celle de la vodka de riz chinoise. Winston versa une tasse presque pleine, rassembla son courage et l'avala comme un médicament.
Son visage est immédiatement devenu rouge et des larmes ont coulé de ses yeux. La boisson ressemblait à de l’acide nitrique ; De plus, après avoir bu une gorgée, on avait l'impression d'avoir été frappé dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Mais bientôt la brûlure dans l’estomac s’est calmée et le monde a commencé à paraître plus joyeux. Il a sorti une cigarette d'un paquet froissé étiqueté « Victory Cigarettes », en la tenant distraitement à la verticale, faisant tomber tout le tabac qu'elle contenait sur le sol. Winston fut plus prudent avec le suivant. Il retourna dans la pièce et s'assit à la table à gauche du télécran. Du tiroir du bureau, il sortit un stylo, une bouteille d'encre et un épais cahier au dos rouge et à la reliure marbrée.
Pour une raison inconnue, le télécran de la pièce n’a pas été installé comme d’habitude. Il n'était pas placé dans le mur du fond, d'où il pouvait dominer toute la pièce, mais dans le mur le plus long, en face de la fenêtre. Sur le côté se trouvait une niche peu profonde, probablement destinée aux étagères, où Winston était maintenant assis. S'y étant assis plus profondément, il s'est avéré inaccessible au téléécran, ou plutôt invisible. Bien sûr, ils pouvaient l’écouter, mais ils ne pouvaient pas le surveiller lorsqu’il était assis là. Cette disposition quelque peu inhabituelle de la pièce lui a peut-être donné l’idée de faire ce qu’il s’apprêtait à faire maintenant.
Mais en plus, le livre relié en marbre m'a inspiré. Le livre était incroyablement beau. Le papier crème lisse était légèrement jauni par le temps - un tel papier n'avait pas été produit depuis quarante ans, voire plus. Winston soupçonnait que le livre était encore plus ancien. Il l'a remarqué dans la vitrine d'un brocanteur d'un bidonville (là où exactement, il l'avait déjà oublié) et avait hâte de l'acheter. Les membres du parti n’étaient pas censés se rendre dans les magasins ordinaires (c’était ce qu’on appelait « acheter des marchandises sur le marché libre »), mais l’interdiction était souvent bafouée : de nombreuses choses, comme les lacets et les lames de rasoir, ne pouvaient être obtenues autrement. Winston regarda rapidement autour de lui, plongea dans le magasin et acheta un livre pour deux dollars cinquante. Pourquoi - lui-même ne le savait pas encore. Il l'a furtivement ramené à la maison dans une mallette. Même vide, il compromettait le propriétaire.
C'était une journée d'avril froide et claire et l'horloge sonna treize heures. Enfouissant son menton dans sa poitrine pour échapper au vent maléfique, Winston Smith se glissa précipitamment par la porte vitrée de l'immeuble Pobeda, tout en laissant entrer un tourbillon de poussière granuleuse.
Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. En face de l'entrée, sur le mur, était accrochée une affiche colorée, trop grande pour la pièce. L'affiche représentait un visage énorme, de plus d'un mètre de large - le visage d'un homme d'environ quarante-cinq ans, avec une épaisse moustache noire, rugueux, mais masculinement attrayant. Winston se dirigea vers les escaliers. Cela ne servait à rien d'aller à l'ascenseur. Même dans le meilleur des cas, cela fonctionnait rarement et maintenant, pendant la journée, l'électricité était complètement coupée. Un régime économique était en vigueur : ils se préparaient pour la Semaine de la Haine. Winston dut franchir sept marches ; il avait la quarantaine, il avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville ; il se leva lentement et s'arrêta plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, le même visage regardait depuis le mur. Le portrait a été réalisé de telle manière que peu importe où vous alliez, vos yeux ne vous lâcheraient pas. BIGGER BROTHER VOUS REGARDE – dit la légende.
Dans l'appartement, une voix riche a parlé de la production de fonte et a lu des chiffres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue encastrée dans le mur droit, semblable à un miroir trouble. Winston tourna le bouton, sa voix s'affaiblissait, mais le discours restait clair. Il était possible d'atténuer cet appareil (on l'appelait télécran), mais il était impossible de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre : un homme petit et frêle, il semblait encore plus frêle dans l'uniforme bleu d'un membre du parti. Ses cheveux étaient complètement blonds et son visage rougeaud pèle à cause du mauvais savon, des lames émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer.
Le monde extérieur, derrière les fenêtres fermées, respirait le froid. Le vent faisait tourbillonner la poussière et les bouts de papier en spirales ; et même si le soleil brillait et le ciel était d'un bleu vif, tout dans la ville semblait incolore - à l'exception des affiches affichées partout. Le visage à moustache noire le regardait sous tous les angles visibles. De la maison d’en face aussi. BIG BROTHER VOUS REGARDE - dit la légende, et des yeux sombres regardèrent ceux de Winston. En bas, au-dessus du trottoir, une affiche au coin déchiré claquait au vent, tantôt cachée, tantôt révélant un seul mot : ANGSOCI. Au loin, un hélicoptère glissait entre les toits, planait un instant comme une mouche cadavre et s'envolait dans une courbe. C'était une patrouille de police qui regardait par les fenêtres des gens. Mais les patrouilles ne comptaient pas. Seule comptait la police de la pensée.
Derrière Winston, la voix du télécran parlait toujours de la fusion du fer et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télécran fonctionnait pour la réception et la transmission. Il captait chaque mot, s'il était prononcé dans un murmure pas trop silencieux ; De plus, tant que Winston restait dans le champ de vision de la plaque nuageuse, il était non seulement entendu, mais aussi vu. Bien entendu, personne ne savait s’il était surveillé ou non à ce moment-là. À quelle fréquence et à quel moment la police de la pensée se connecte-t-elle à votre câble - on ne peut que deviner cela. Il est possible qu’ils surveillaient tout le monde – et ce 24 heures sur 24. De toute façon, ils pourraient se connecter à tout moment. Vous deviez vivre - et vous viviez par habitude, qui se transformait en instinct - en sachant que chacune de vos paroles était entendue et que chacun de vos mouvements, jusqu'à l'extinction des lumières, était surveillé.
Winston gardait le dos au téléécran. C'est plus sûr ainsi ; même si – il le savait – son dos cédait également. A un kilomètre de sa fenêtre, le bâtiment blanc du ministère de la Vérité, son lieu de travail, dominait la ville crasseuse. La voici, pensa Winston avec un vague dégoût, la voici, Londres, la ville principale d'Airstrip I, la troisième province la plus peuplée de l'État d'Océanie. Il se tourna vers son enfance et essaya de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Ces rangées de maisons délabrées du XIXe siècle, étayées par des rondins, aux fenêtres rapiécées avec du carton, aux toits en patchwork, aux murs ivres des jardins de devant, se sont-elles toujours étendues au loin ? Et ces clairières des bombardements, où la poussière d'albâtre s'enroulait et où l'épilobe grimpait sur des tas de décombres ; et de grands terrains vagues où les bombes ont fait place à toute une famille de champignons, de misérables cabanes en planches qui ressemblaient à des poulaillers ? Mais - en vain, il ne s'en souvenait pas ; de l'enfance il ne reste que des scènes fragmentaires, très éclairées, dépourvues de fond et le plus souvent incompréhensibles.
Le ministère de la Vérité – mini-droits en novlangue – était remarquablement différent de tout ce qui existait. Ce gigantesque édifice pyramidal, brillant de béton blanc, s'élevait, corniche après corniche, jusqu'à une hauteur de trois cents mètres. Depuis sa fenêtre, Winston pouvait lire trois slogans du parti écrits en écriture élégante sur la façade blanche :
LA GUERRE EST LA PAIX
LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE
L'IGNORANCE EST LE POUVOIR
Selon les rumeurs, le Ministère de la Vérité contenait trois mille bureaux au-dessus de la surface de la terre et un système de racines correspondant dans les profondeurs. Il n'y avait que trois autres bâtiments de ce type et de cette taille dans différents quartiers de Londres. Ils dominaient si haut la ville que depuis le toit de l'immeuble résidentiel Pobeda, on pouvait les voir tous les quatre à la fois. Ils abritaient quatre ministères, soit l'ensemble de l'appareil d'État : le ministère de la Vérité, chargé de l'information, de l'éducation, des loisirs et des arts ; le ministère de la Paix, chargé de la guerre ; le ministère de l'Amour, chargé du maintien de l'ordre, et le ministère de l'Abondance, chargé de l'économie. En novlangue : miniprav, miniworld, minilove et minizo.
Le ministère de l’Amour inspirait la peur. Il n'y avait pas de fenêtres dans le bâtiment. Winston n'a jamais franchi son seuil, ne s'est jamais approché à moins d'un demi-kilomètre de lui. Il n'était possible d'y arriver que pour des raisons officielles, puis après avoir traversé tout un labyrinthe de barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses camouflés. Même les rues menant à l’anneau extérieur des clôtures étaient patrouillées par des gardes en uniforme noir ressemblant à des gorilles et armés de matraques articulées.
Winston se tourna brusquement. Il donna à son visage une expression d'optimisme calme, plus appropriée devant un écran de télévision, et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, vers la petite kitchenette. Ayant quitté le ministère à cette heure-là, il a sacrifié le déjeuner dans la salle à manger, et il n'y avait pas de nourriture à la maison - à l'exception d'une miche de pain noir, qu'il fallait conserver jusqu'à demain matin. Il sortit sur l'étagère une bouteille de liquide incolore avec une simple étiquette blanche : « Victory Gin ». Le gin avait une odeur désagréable et grasse, comme celle de la vodka de riz chinoise. Winston versa une tasse presque pleine, rassembla son courage et l'avala comme un médicament.
Son visage est immédiatement devenu rouge et des larmes ont coulé de ses yeux. La boisson ressemblait à de l’acide nitrique ; De plus, après avoir bu une gorgée, on avait l'impression d'avoir été frappé dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Mais bientôt la brûlure dans l’estomac s’est calmée et le monde a commencé à paraître plus joyeux. Il a sorti une cigarette d'un paquet froissé étiqueté « Victory Cigarettes », en la tenant distraitement à la verticale, faisant tomber tout le tabac qu'elle contenait sur le sol. Winston fut plus prudent avec le suivant. Il retourna dans la pièce et s'assit à la table à gauche du télécran. Du tiroir du bureau, il sortit un stylo, une bouteille d'encre et un épais cahier au dos rouge et à la reliure marbrée.
Pour une raison inconnue, le télécran de la pièce n’a pas été installé comme d’habitude. Il n'était pas placé dans le mur du fond, d'où il pouvait dominer toute la pièce, mais dans le mur le plus long, en face de la fenêtre. Sur le côté se trouvait une niche peu profonde, probablement destinée aux étagères, où Winston était maintenant assis. S'y étant assis plus profondément, il s'est avéré inaccessible au téléécran, ou plutôt invisible. Ils pouvaient bien sûr l’écouter, mais ils ne pouvaient pas le surveiller lorsqu’il était assis là. Cette disposition quelque peu inhabituelle de la pièce lui a peut-être donné l’idée de faire ce qu’il s’apprêtait à faire maintenant.
Mais en plus, le livre relié en marbre m'a inspiré. Le livre était incroyablement beau. Le papier lisse et crème était légèrement jauni par le temps ; un tel papier n'avait pas été produit depuis quarante ans, voire plus. Winston soupçonnait que le livre était encore plus ancien. Il l'a remarqué dans la vitrine d'un brocanteur d'un bidonville (là où exactement, il l'avait déjà oublié) et avait hâte de l'acheter. Les membres du parti n’étaient pas censés se rendre dans les magasins ordinaires (c’était ce qu’on appelait « acheter des marchandises sur le marché libre »), mais l’interdiction était souvent bafouée : de nombreuses choses, comme les lacets et les lames de rasoir, ne pouvaient être obtenues autrement. Winston regarda rapidement autour de lui, plongea dans le magasin et acheta un livre pour deux dollars cinquante. Pourquoi - lui-même ne le savait pas encore. Il l'a furtivement ramené à la maison dans une mallette. Même vide, il compromettait le propriétaire.
je
C'était une journée d'avril froide et claire et l'horloge sonna treize heures. Enfouissant son menton dans sa poitrine pour échapper au vent maléfique, Winston Smith se glissa précipitamment par la porte vitrée de l'immeuble Pobeda, tout en laissant entrer un tourbillon de poussière granuleuse.
Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. En face de l'entrée, sur le mur, était accrochée une affiche colorée, trop grande pour la pièce. L'affiche représentait un visage énorme, de plus d'un mètre de large - le visage d'un homme d'environ quarante-cinq ans, avec une épaisse moustache noire, rugueux, mais masculinement attrayant. Winston se dirigea vers les escaliers. Cela ne servait à rien d'aller à l'ascenseur. Même dans le meilleur des cas, cela fonctionnait rarement et maintenant, pendant la journée, l'électricité était complètement coupée. Un régime économique était en vigueur : ils se préparaient pour la Semaine de la Haine. Winston dut franchir sept marches ; il avait la quarantaine, il avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville ; il se leva lentement et s'arrêta plusieurs fois pour se reposer. À chaque palier, le même visage regardait depuis le mur. Le portrait a été réalisé de telle manière que peu importe où vous alliez, vos yeux ne vous lâcheraient pas. BIGGER BROTHER VOUS REGARDE – dit la légende.
Dans l'appartement, une voix riche a parlé de la production de fonte et a lu des chiffres. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue encastrée dans le mur droit, semblable à un miroir trouble. Winston tourna le bouton, sa voix s'affaiblissait, mais le discours restait clair. Il était possible d'atténuer cet appareil (on l'appelait télécran), mais il était impossible de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre : un homme petit et frêle, il semblait encore plus frêle dans l'uniforme bleu d'un membre du parti. Ses cheveux étaient complètement blonds et son visage rougeaud pèle à cause du mauvais savon, des lames émoussées et du froid de l'hiver qui venait de se terminer.
Le monde extérieur, derrière les fenêtres fermées, respirait le froid. Le vent faisait tourbillonner la poussière et les bouts de papier en spirales ; et même si le soleil brillait et le ciel était d'un bleu vif, tout dans la ville semblait incolore - à l'exception des affiches affichées partout. Le visage à moustache noire le regardait sous tous les angles visibles. De la maison d’en face aussi. BIG BROTHER VOUS REGARDE - dit la légende, et des yeux sombres regardèrent ceux de Winston. En bas, au-dessus du trottoir, une affiche au coin déchiré claquait au vent, tantôt cachée, tantôt révélant un seul mot : ANGSOCI. Au loin, un hélicoptère glissait entre les toits, planait un instant comme une mouche cadavre et s'envolait dans une courbe. C'était une patrouille de police qui regardait par les fenêtres des gens. Mais les patrouilles ne comptaient pas. Seule comptait la police de la pensée.
Derrière Winston, la voix du télécran parlait toujours de la fusion du fer et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télécran fonctionnait pour la réception et la transmission. Il captait chaque mot, s'il était prononcé dans un murmure pas trop silencieux ; De plus, tant que Winston restait dans le champ de vision de la plaque nuageuse, il était non seulement entendu, mais aussi vu. Bien entendu, personne ne savait s’il était surveillé ou non à ce moment-là. À quelle fréquence et à quel moment la police de la pensée se connecte-t-elle à votre câble - on ne peut que deviner cela.
Il est possible qu’ils surveillaient tout le monde – et ce 24 heures sur 24. De toute façon, ils pourraient se connecter à tout moment. Vous deviez vivre - et vous viviez par habitude, qui se transformait en instinct - en sachant que chacune de vos paroles était entendue et que chacun de vos mouvements, jusqu'à l'extinction des lumières, était surveillé.
Winston gardait le dos au téléécran. C'est plus sûr ainsi ; même si – il le savait – son dos cédait également. A un kilomètre de sa fenêtre, le bâtiment blanc du ministère de la Vérité, son lieu de travail, dominait la ville crasseuse. La voici, pensa Winston avec un vague dégoût, la voici, Londres, la ville principale d'Airstrip I, la troisième province la plus peuplée de l'État d'Océanie. Il se tourna vers son enfance et essaya de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Ces rangées de maisons délabrées du XIXe siècle, étayées par des rondins, aux fenêtres rapiécées avec du carton, aux toits en patchwork, aux murs ivres des jardins de devant, se sont-elles toujours étendues au loin ? Et ces clairières des bombardements, où la poussière d'albâtre s'enroulait et où l'épilobe grimpait sur des tas de décombres ; et de grands terrains vagues où les bombes ont fait place à toute une famille de champignons, de misérables cabanes en planches qui ressemblaient à des poulaillers ? Mais - en vain, il ne s'en souvenait pas ; de l'enfance il ne reste que des scènes fragmentaires, très éclairées, dépourvues de fond et le plus souvent incompréhensibles.
Ministère de la Vérité - en novlangue 1
La novlangue est la langue officielle de l'Océanie. Pour sa structure, voir l'Annexe.
Droits mini - remarquablement différents de tout ce qui existe. Ce gigantesque édifice pyramidal, brillant de béton blanc, s'élevait, corniche après corniche, jusqu'à une hauteur de trois cents mètres. Depuis sa fenêtre, Winston pouvait lire trois slogans du parti écrits en écriture élégante sur la façade blanche :
LA GUERRE EST LA PAIX
LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE
L'IGNORANCE EST LE POUVOIR
Selon les rumeurs, le Ministère de la Vérité contenait trois mille bureaux au-dessus de la surface de la terre et un système de racines correspondant dans les profondeurs. Il n'y avait que trois autres bâtiments de ce type et de cette taille dans différents quartiers de Londres. Ils dominaient si haut la ville que depuis le toit de l'immeuble résidentiel Pobeda, on pouvait les voir tous les quatre à la fois. Ils abritaient quatre ministères, soit l'ensemble de l'appareil d'État : le ministère de la Vérité, chargé de l'information, de l'éducation, des loisirs et des arts ; le ministère de la Paix, chargé de la guerre ; le ministère de l'Amour, chargé du maintien de l'ordre, et le ministère de l'Abondance, chargé de l'économie. En novlangue : miniprav, miniworld, minilove et minizo.
Le ministère de l’Amour inspirait la peur. Il n'y avait pas de fenêtres dans le bâtiment. Winston n'a jamais franchi son seuil, ne s'est jamais approché à moins d'un demi-kilomètre de lui. Il n'était possible d'y arriver que pour des raisons officielles, puis après avoir traversé tout un labyrinthe de barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses camouflés. Même les rues menant à l’anneau extérieur des clôtures étaient patrouillées par des gardes en uniforme noir ressemblant à des gorilles et armés de matraques articulées.
Winston se tourna brusquement. Il donna à son visage une expression d'optimisme calme, plus appropriée devant un écran de télévision, et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, vers la petite kitchenette. Ayant quitté le ministère à cette heure-là, il a sacrifié le déjeuner dans la salle à manger, et il n'y avait pas de nourriture à la maison - à l'exception d'une miche de pain noir, qu'il fallait conserver jusqu'à demain matin. Il sortit sur l'étagère une bouteille de liquide incolore avec une simple étiquette blanche : « Victory Gin ». Le gin avait une odeur désagréable et grasse, comme celle de la vodka de riz chinoise. Winston versa une tasse presque pleine, rassembla son courage et l'avala comme un médicament.
Son visage est immédiatement devenu rouge et des larmes ont coulé de ses yeux. La boisson ressemblait à de l’acide nitrique ; De plus, après avoir bu une gorgée, on avait l'impression d'avoir été frappé dans le dos avec une matraque en caoutchouc. Mais bientôt la brûlure dans l’estomac s’est calmée et le monde a commencé à paraître plus joyeux. Il a sorti une cigarette d'un paquet froissé étiqueté « Victory Cigarettes », en la tenant distraitement à la verticale, faisant tomber tout le tabac qu'elle contenait sur le sol. Winston fut plus prudent avec le suivant. Il retourna dans la pièce et s'assit à la table à gauche du télécran. Du tiroir du bureau, il sortit un stylo, une bouteille d'encre et un épais cahier au dos rouge et à la reliure marbrée.
Pour une raison inconnue, le télécran de la pièce n’a pas été installé comme d’habitude. Il n'était pas placé dans le mur du fond, d'où il pouvait dominer toute la pièce, mais dans le mur le plus long, en face de la fenêtre. Sur le côté se trouvait une niche peu profonde, probablement destinée aux étagères, où Winston était maintenant assis. S'y étant assis plus profondément, il s'est avéré inaccessible au téléécran, ou plutôt invisible. Ils pouvaient bien sûr l’écouter, mais ils ne pouvaient pas le surveiller lorsqu’il était assis là. Cette disposition quelque peu inhabituelle de la pièce lui a peut-être donné l’idée de faire ce qu’il s’apprêtait à faire maintenant.
Mais en plus, le livre relié en marbre m'a inspiré. Le livre était incroyablement beau. Le papier lisse et crème était légèrement jauni par le temps ; un tel papier n'avait pas été produit depuis quarante ans, voire plus. Winston soupçonnait que le livre était encore plus ancien. Il l'a remarqué dans la vitrine d'un brocanteur d'un bidonville (là où exactement, il l'avait déjà oublié) et avait hâte de l'acheter. Les membres du parti n’étaient pas censés se rendre dans les magasins ordinaires (c’était ce qu’on appelait « acheter des marchandises sur le marché libre »), mais l’interdiction était souvent bafouée : de nombreuses choses, comme les lacets et les lames de rasoir, ne pouvaient être obtenues autrement. Winston regarda rapidement autour de lui, plongea dans le magasin et acheta un livre pour deux dollars cinquante. Pourquoi - lui-même ne le savait pas encore. Il l'a furtivement ramené à la maison dans une mallette. Même vide, il compromettait le propriétaire.
Il avait maintenant l'intention de tenir un journal. Ce n'était pas un acte illégal (il n'y avait rien d'illégal du tout, puisqu'il n'y avait plus de lois), mais si le journal était découvert, Winston risquait la mort ou, au mieux, vingt-cinq ans de camp de travaux forcés. Winston inséra la plume dans le stylo et la lécha pour enlever la graisse. La plume était un instrument archaïque, on ne s'en servait même que rarement pour signer, et Winston s'en procurait secrètement et non sans difficulté : ce beau papier crème, lui semblait-il, méritait d'être écrit avec de la vraie encre, et non gribouillé avec de la vraie encre. un crayon à encre. En fait, il n’a pas l’habitude d’écrire de la main. À l'exception des notes les plus courtes, il dictait tout dans un rédacteur de discours, mais ici, la dictée, bien sûr, ne convenait pas. Il trempa son stylo et hésita. Son ventre se serra. Toucher un stylo sur du papier est une étape irrévocable. Dans de petites lettres maladroites, il écrit :
Et il se pencha en arrière. Il était envahi par un sentiment d’impuissance totale. Tout d’abord, il ne savait pas s’il était vrai que nous étions en 1984. A propos de cela - sans aucun doute : il était presque sûr d'avoir 39 ans, et il était né en 1944 ou 45 ; mais il est désormais impossible de fixer une date avec plus de précision qu'avec une erreur d'un an ou deux.
Et pour qui, devint-il soudain perplexe, ce journal est-il écrit ? Pour l’avenir, pour ceux qui ne sont pas encore nés. Ses pensées tournèrent autour de la date douteuse inscrite sur la feuille et tombèrent soudain sur le mot novlangue double pensée. Et pour la première fois, l'ampleur de son entreprise lui apparut. Comment communiquer avec le futur ? C’est intrinsèquement impossible. Soit demain sera semblable à aujourd’hui et alors personne ne l’écoutera, soit ce sera différent et l’adversité de Winston ne lui dira rien.
Winston était assis, regardant fixement le journal. Une musique militaire âpre sortait du télécran. C’est curieux : non seulement il a perdu la capacité d’exprimer ses pensées, mais il a même oublié ce qu’il voulait dire. Depuis combien de semaines se préparait-il pour ce moment, et il ne lui était même jamais venu à l'esprit que cela nécessiterait plus que du courage. Écrivez-le simplement – quoi de plus simple ? Mettez sur papier l’interminable monologue anxieux qui résonne dans sa tête depuis des années et des années. Et même ce monologue s'est tari. Et l’ulcère au-dessus de ma cheville me démangeait insupportablement. Il avait peur de se gratter la jambe - cela provoquait toujours une inflammation. Les secondes passèrent. Seulement la blancheur du papier, les démangeaisons au-dessus de sa cheville, la musique retentissante et un léger bourdonnement dans sa tête, c'est tout ce que ses sens percevaient maintenant.
Et soudain, il s'est mis à écrire - simplement par panique, très vaguement conscient qu'il sortait de sous la plume. Des lignes perlées, mais d'une maladresse enfantine, rampaient de haut en bas de la feuille, perdant d'abord les majuscules, puis les points.
4 avril 1984. Hier au cinéma. Des films totalement de guerre. Un très bon exemple, quelque part dans la mer Méditerranée, un navire transportant des réfugiés est bombardé. Le public est amusé par les images d'un énorme homme gros essayant de s'enfuir à la nage et poursuivi par un hélicoptère. d'abord on le voit patauger dans l'eau comme un dauphin, puis on le voit depuis un hélicoptère à travers le viseur, puis il est tout plein de trous et la mer autour de lui est rose et coule immédiatement comme s'il avait pris de l'eau à travers les trous , quand il est allé au fond, le public a ri. Puis un bateau rempli d'enfants et un hélicoptère qui survole. là, assise sur la proue, se trouvait une femme d'âge moyen qui ressemblait à une juive, et dans ses bras se trouvait un garçon d'environ trois ans. Le garçon crie de peur et cache sa tête sur sa poitrine comme s'il voulait se foutre en elle, et elle le calme et le couvre avec ses mains, même si elle-même est devenue bleue de peur, tout le temps qu'elle essaie de le couvrir mieux avec ses mains, comme si elle pouvait le protéger des balles, puis un hélicoptère est tombé dessus. Une bombe de 20 kilogrammes a eu une terrible explosion et le bateau s'est brisé en morceaux, puis une merveilleuse photo de la main d'un enfant s'envolant, droit dans le ciel, cela a probablement été filmé depuis le nez de verre d'un hélicoptère et les rangs du parti ont applaudi bruyamment, mais là où étaient assis les prolétaires, une femme a soulevé un scandale et a crié qu'il ne fallait pas montrer cela devant des enfants, où est-ce que c'est bien où est-ce que c'est bien devant les enfants et a fait des histoires jusqu'à ce que la police la fasse sortir, ils ne l'ont pas fait sortir, il est peu probable qu'ils lui fassent quoi que ce soit, on ne sait jamais ce que disent les prolétaires, un typique réaction pro-amour, personne n'y prête attention...
Winston a arrêté d'écrire, en partie parce que sa main avait des crampes. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il avait écrit ces absurdités sur papier. Mais il est curieux que pendant qu'il bougeait sa plume, un incident complètement différent soit resté dans sa mémoire, à tel point que vous pouvez l'écrire maintenant. Il est devenu clair pour lui qu'à cause de cet incident, il a soudainement décidé de rentrer chez lui et de commencer un journal aujourd'hui.
Cela s'est produit le matin au ministère - si l'on peut dire "arrivé" à propos d'une telle nébuleuse.
Il était presque onze heures et, dans le service des archives où travaillait Winston, les employés sortaient des chaises de leurs bureaux et les plaçaient au milieu de la salle devant un grand écran télé - ils se rassemblaient pour deux minutes de haine. Winston se prépara à prendre place dans les rangées du milieu, puis deux autres personnes apparurent soudainement : des visages familiers, mais il n'eut pas besoin de leur parler. Il rencontrait souvent la jeune fille dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom, il savait seulement qu’elle travaillait au département de littérature. À en juger par le fait qu'il la voyait parfois avec une clé à molette et les mains huileuses, elle entretenait l'une des machines à écrire des romans. Elle avait des taches de rousseur, d'épais cheveux noirs, environ vingt-sept ans ; elle se comportait avec confiance et se déplaçait rapidement et athlétiquement. Une ceinture écarlate - l'emblème de la Youth Anti-Sex Union - était étroitement enroulée à plusieurs reprises autour de la taille de la combinaison, soulignant les hanches abruptes. Winston ne l'aimait pas à première vue. Et il savait pourquoi. Elle respirait l'esprit des terrains de hockey, des baignades froides, des sorties touristiques et de l'orthodoxie générale. Il n'aimait pas presque toutes les femmes, surtout les jeunes et jolies. Ce sont les femmes, et en premier lieu les jeunes, qui étaient les adhérents les plus fanatiques du parti, avaleurs de slogans, espions volontaires et renifleurs d'hérésie. Et celui-là lui paraissait encore plus dangereux que les autres. Un jour, elle l'a rencontré dans le couloir, a regardé de côté - comme si elle l'avait transpercé de son regard - et une peur noire s'est glissée dans son âme. Il soupçonnait même sournoisement qu'elle servait dans la Police de la Pensée. Cependant, cela était peu probable. Néanmoins, chaque fois qu'elle était proche, Winston éprouvait un sentiment de malaise, mêlé d'hostilité et de peur.
Au même moment que la femme, O'Brien, membre de l'Inner Party, qui occupait un poste si élevé et si éloigné que Winston n'avait que la plus vague idée de lui, entra. En voyant la combinaison noire du membre de l'Inner Party, les gens assis devant le télécran se turent un instant. O'Brien était un homme grand et trapu avec un cou épais et un visage rugueux et moqueur. Malgré son apparence menaçante, il n'était pas dénué de charme. Il avait l'habitude d'ajuster ses lunettes sur son nez, et dans ce geste caractéristique il y avait quelque chose d'étrangement désarmant, d'insaisissablement intelligent. Un noble du XVIIIe siècle offrant sa tabatière, voilà ce qui viendrait à l'esprit de quelqu'un qui était encore capable de penser à de telles comparaisons. En dix ans, Winston a probablement vu O'Brien une douzaine de fois. Il était attiré par O'Brien, mais pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre l'éducation et le physique du boxeur poids lourd. Au plus profond de son âme, Winston soupçonnait – ou peut-être ne soupçonnait pas, mais espérait seulement – qu’O’Brien n’était pas entièrement politiquement correct. Son visage suggérait de telles pensées. Mais encore une fois, il est possible que ce qui était écrit sur son visage ne soit pas un doute sur le dogme, mais simplement sur l'intelligence. D'une manière ou d'une autre, il donnait l'impression d'être un homme avec qui on pouvait parler - si l'on restait seul avec lui et caché du téléécran. Winston n'a jamais essayé de tester cette supposition ; et ce n'était pas en son pouvoir de le faire. O'Brien regarda sa montre, vit qu'il était presque 11 heures et décida de rester deux minutes de haine au service des archives. Il s'assit dans la même rangée que Winston, à deux sièges de lui. Entre eux se trouvait une petite femme rougeâtre qui travaillait à côté de Winston. La femme aux cheveux noirs s'assit juste derrière lui.
Et puis un hurlement dégoûtant et un grincement sont sortis du grand écran télé dans le mur - comme si une machine monstrueuse et non graissée avait été lancée. Le son me faisait dresser les cheveux et me faisait mal aux dents. La haine a commencé.
Comme toujours, l’ennemi public Emmanuel Goldstein est apparu à l’écran. Le public a hué. La petite femme aux cheveux roux poussa un cri de peur et de dégoût. Goldstein, apostat et renégat, fut autrefois, il y a longtemps (si longtemps que personne ne se souvenait même de quand), l'un des dirigeants du parti, presque égal à Big Brother lui-même, et prit ensuite la voie de la contre-révolution. et a été condamné à mort et s'est mystérieusement échappé et a disparu. Le programme de deux minutes changeait chaque jour, mais surtout acteur Il y avait toujours Goldstein dedans. Le premier traître, le principal profanateur de la pureté du parti. De ses théories sont nés tous les nouveaux crimes contre le parti, tous les sabotages, trahisons, hérésies, déviations. On ne sait pas où il vivait encore et fomentait la sédition : peut-être à l'étranger, sous la protection de ses maîtres étrangers, ou peut-être - selon de telles rumeurs - ici, en Océanie, sous terre.
Winston avait du mal à respirer. Le visage de Goldstein lui donnait toujours un sentiment complexe et douloureux. Un visage juif sec auréolé de cheveux gris clair, une barbichette - un visage intelligent et en même temps inexplicablement repoussant ; et il y avait quelque chose de sénile dans ce long nez cartilagineux à lunettes qui avait glissé presque jusqu'au bout. Il ressemblait à un mouton et il y avait un bêlement dans sa voix. Comme toujours, Goldstein attaqua violemment les doctrines du parti ; les attaques étaient si absurdes et absurdes qu'elles ne tromperaient pas un enfant, mais en même temps elles n'étaient pas sans conviction, et l'auditeur ne pouvait s'empêcher de craindre que d'autres personnes, moins sobres que lui, puissent croire Goldstein. Il a dénoncé Big Brother, il a dénoncé la dictature du parti. Il a exigé une paix immédiate avec l'Eurasie, a appelé à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté de réunion, à la liberté de pensée ; il a crié hystériquement que la révolution avait été trahie - et tout cela en crépitement, avec des mots composés, comme s'il parodiait le style des orateurs du parti, même avec des mots novlangue, et dans son discours ils apparaissaient plus souvent que dans le discours de n'importe quel membre du parti. Et tout le temps, pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui se cachait derrière les divagations hypocrites de Goldstein, d'interminables colonnes eurasiennes défilaient derrière son visage sur l'écran : ligne après ligne de soldats trapus aux visages asiatiques imperturbables flottaient des profondeurs jusqu'à la surface et se dissolvaient, cédant exactement la même chose. Le cliquetis sourd et mesuré des bottes des soldats accompagnait les bêlements de Goldstein.
La haine a commencé il y a une trentaine de secondes, et la moitié du public ne pouvait plus contenir ses exclamations furieuses. Il était insupportable de voir ce visage penaud et suffisant et derrière lui la puissance terrifiante des troupes eurasiennes ; de plus, à la vue de Goldstein et même à la pensée de lui, la peur et la colère surgissaient par réflexe. La haine à son égard était plus constante qu'à l'égard de l'Eurasie et de l'Estasia, car lorsque l'Océanie était en guerre contre l'une d'elles, elle faisait généralement la paix avec l'autre. Mais voici ce qui est surprenant : même si Goldstein était haï et méprisé de tous, même si chaque jour, mille fois par jour, son enseignement était réfuté, écrasé, détruit, ridiculisé comme une absurdité pathétique, son influence n’a pas diminué du tout. Tout le temps, il y avait de nouveaux dupes qui n'attendaient qu'il pour les séduire. Il ne se passait pas un jour sans que la police de la pensée ne dénonce les espions et les saboteurs qui agissaient sur ses ordres. Il commandait une immense armée clandestine, un réseau de conspirateurs cherchant à renverser le système. C'était censé s'appeler Brotherhood. On parlait aussi à voix basse d'un livre terrible, une compilation de toutes les hérésies - dont l'auteur était Goldstein et qui était distribué illégalement. Le livre n'avait pas de titre. Dans les conversations, ils la mentionnaient - s'ils la mentionnaient - simplement comme livre. Mais de telles choses n’étaient connues que par de vagues rumeurs. Le membre du parti a essayé autant que possible de ne parler ni des Frères musulmans, ni des livre.
Dès la deuxième minute, la haine s’est transformée en frénésie. Les gens se sont levés et ont crié à pleins poumons pour étouffer la voix insupportable et bêlante de Goldstein. La petite femme aux cheveux roux devint cramoisie et ouvrit la bouche comme un poisson sur terre. Le visage lourd d'O'Brien est également devenu violet. Il se redressa et sa poitrine puissante se soulevait et tremblait comme si les vagues la frappaient. La fille aux cheveux noirs derrière Winston a crié : « Scélérat ! Scélérat! Scélérat!" - puis elle a attrapé un lourd dictionnaire novlangue et l'a lancé sur le télécran. Le dictionnaire frappa Goldstein au nez et s'envola. Mais la voix était indestructible. Dans un moment de lucidité, Winston réalisa qu'il criait avec les autres et donnait furieusement des coups de pied dans la barre transversale de la chaise. Ce qui était terrible dans Two Minutes of Hate, ce n'était pas que vous deviez jouer le rôle, mais que vous ne pouviez tout simplement pas rester à l'écart. Seulement trente secondes - et vous n'avez plus besoin de faire semblant. Comme par une décharge électrique, de viles crampes de peur et de vindicte, un désir frénétique de tuer, de tourmenter et de briser des visages avec un marteau attaquaient toute l'assemblée : les gens grimaçaient et criaient, se transformant en fous. En même temps, la rage était abstraite et non dirigée ; elle pouvait être tournée dans n’importe quelle direction, comme la flamme d’un chalumeau. Et soudain, il s’est avéré que la haine de Winston n’était pas du tout dirigée contre Goldstein, mais au contraire contre Big Brother, contre la fête, contre la police de la pensée ; dans de tels moments, son cœur était avec cet hérétique solitaire et ridiculisé, le seul gardien de la raison et de la vérité dans un monde de mensonges. Et une seconde plus tard, il ne faisait déjà qu'un avec les autres, et tout ce qu'ils disaient sur Goldstein lui semblait vrai. Ensuite, le dégoût secret pour Big Brother s'est transformé en adoration, et Big Brother s'est élevé au-dessus de tout le monde - un défenseur invulnérable et intrépide, debout comme un rocher devant les hordes eurasiennes, et Goldstein, malgré son paria et son impuissance, malgré les doutes sur sa vie. , semblait être un sorcier sinistre, capable de détruire l'édifice de la civilisation par le simple pouvoir de sa voix.
Chapitre VII
S’il y a de l’espoir (écrit Winston), il est dans les prolétaires. S'il y a de l'espoir, alors il n'y a nulle part ailleurs où il peut se trouver : ce n'est que chez les prolétaires, dans cette masse tourbillonnante à la périphérie de l'État, qui représente quatre-vingt-cinq pour cent de la population de l'Océanie, qu'une force capable de détruire la fête naisse.
Le parti ne peut pas être renversé de l’intérieur. Ses ennemis – si elle a des ennemis – ne peuvent pas s’unir, ni même se reconnaître. Même s'il existe une Confrérie légendaire - et cela n'est pas exclu, il est impossible d'imaginer que ses membres se rassembleraient en groupes de plus de deux ou trois personnes. Leur rébellion est l'expression de leurs yeux, l'intonation de leur voix ; tout au plus - un mot prononcé à voix basse.
Et je le vendrai, s'ils pouvaient réaliser leur force, les complots ne servent à rien. Il leur suffit de se lever et de se secouer, comme un cheval secoue les mouches. Dès qu'ils le voudront, demain matin ils briseront les fêtes en morceaux. Tôt ou tard, ils le comprendront. Mais!... Il se souvint qu'un jour, alors qu'il marchait dans une rue bondée, un cri assourdissant de mille voix, un cri de femme, jaillit soudain de l'allée devant lui. Un cri puissant et menaçant de colère et de désespoir, un « ah-ah-ah ! » épais, qui sonne comme une cloche.
Son cœur se mit à battre. A commencé! - pensa-t-il, Mutinerie ! Enfin, ils se sont levés ! Il s'approcha et aperçut une foule : deux ou trois cents femmes se pressaient devant les étals du marché, et leurs visages étaient tragiques, comme ceux des passagers d'un bateau à vapeur en perdition. Sous ses yeux, la foule, unie dans le désespoir, semblait se désintégrer : fragmentée en îlots de querelles séparées. Apparemment, l'un des stands vendait des pots. Des boîtes de conserve pauvres et fragiles, mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à trouver. Et maintenant, les marchandises sont soudainement épuisées.
Les plus chanceux, escortés par des bousculades et des aiguillons, se faufilaient avec leurs pots, tandis que les malchanceux faisaient du bruit autour de l'étal et accusaient le marchand de trahir le copinage et de se cacher sous le comptoir. Un autre cri se fit entendre.
Deux grosses femmes, dont une aux cheveux dénoués, attrapèrent la casserole et la tirèrent dans des directions opposées. Les deux ont tiré, la poignée s'est détachée. Winston regardait avec dégoût, mais quelle puissance terrifiante résonnait dans le cri de seulement deux ou trois cents voix !
Eh bien, pourquoi ne crient-ils jamais comme ça à cause de quelque chose qui en vaut la peine ! Il a écrit : Ils ne se rebelleront jamais tant qu'ils ne deviendront pas conscients, et ils ne deviendront pas conscients tant qu'ils ne se rebelleront pas. Tout comme une phrase tirée d’un manuel de fête, pensa-t-il. Le Parti, bien sûr, prétendait avoir libéré les prolétaires de leurs chaînes.
Avant la révolution, ils étaient terriblement opprimés par les capitalistes, affamés et fouettés, les femmes étaient forcées de travailler dans les mines (d'ailleurs, elles y travaillent toujours), les enfants de six ans étaient vendus aux usines. Mais en même temps, conformément au principe de double pensée, le parti enseignait que les prolétaires sont par nature des êtres inférieurs et qu'ils doivent, comme les animaux, être tenus dans l'obéissance, guidés par quelques règles simples.
En substance, on savait très peu de choses sur ces méfaits. Il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Tant qu’ils travaillent et se multiplient, laissez-les faire ce qu’ils veulent. Livrés à eux-mêmes, comme le bétail dans les plaines d'Argentine, ils sont toujours revenus au mode de vie qui leur était naturel, en suivant les traces de leurs ancêtres.
Ils naissent, grandissent dans la terre, commencent à travailler à douze ans, connaissent une courte période d'épanouissement physique et de sexualité, se marient à vingt ans, ne sont plus jeunes à trente ans et meurent généralement à soixante ans. Un travail physique pénible, s'occuper de la maison et des enfants, de petites querelles avec les voisins, du cinéma, du football, de la bière et, surtout, du jeu - c'est tout ce qui correspond à leurs horizons. Il n'est pas difficile de les gérer : parmi eux tournent toujours des agents de la police de la pensée - ils identifient et éliminent ceux qui pourraient être dangereux : mais ils ne cherchent pas à les initier à l'idéologie du parti.
Il est considéré comme indésirable que les prolétaires s’intéressent beaucoup à la politique. Tout ce qu'on leur demande, c'est un patriotisme primitif : faire appel à lui lorsqu'il s'agit d'allonger la journée de travail ou de réduire les rations. Et si l'insatisfaction s'empare d'eux - cela s'est également produit, ce mécontentement ne mène à rien, car en raison du manque d'idées générales, il n'est dirigé que contre de petits problèmes spécifiques. Les gros problèmes échappaient invariablement à leur attention.
La grande majorité des prolétaires n’ont même pas de télécran dans leur appartement. La police régulière s'en occupe très peu. Il y a une criminalité énorme à Londres, tout un État dans un État ; voleurs, bandits, prostituées, trafiquants de drogue, extorsionnistes de tous bords ; mais comme il est isolé parmi les prolétaires, on ne lui prête aucune attention. En matière morale, ils sont autorisés à suivre les coutumes de leurs ancêtres.
Le puritanisme sexuel du parti ne s’est pas étendu aux prolétaires. Ils ne sont pas poursuivis pour débauche et le divorce est autorisé. En fait, la religion serait autorisée si les prolétaires manifestaient une inclination à son égard. Les prolos sont insoupçonnables. Comme le dit le slogan du parti : « Les proles et les animaux sont libres ».
Winston gratta doucement son ulcère variqueux. Les démangeaisons recommencèrent. Bon gré mal gré, vous revenez toujours à une question : à quoi ressemblait la vie avant la révolution ? Il prit sur la table le livre d'histoire de l'école, emprunté à Mme Parsons, et commença à le copier dans son journal. Autrefois, avant la glorieuse révolution, Londres n’était pas la belle ville que nous connaissons aujourd’hui.
C'était une ville sombre, sale et lugubre, et presque tout le monde vivait au jour le jour, et des centaines et des milliers de pauvres se promenaient sans chaussures ni toit au-dessus de leur tête. Les enfants de votre âge devaient travailler douze heures par jour pour des maîtres cruels : s'ils travaillaient lentement, ils étaient fouettés et ils mangeaient des croûtes et de l'eau rassis. Mais au milieu de cette terrible pauvreté, il y avait de grandes et belles maisons de riches, parfois desservies par jusqu'à trente domestiques.
Les riches étaient appelés capitalistes. C'étaient des gens gros et laids avec des visages méchants – comme celui de la page suivante. Comme vous pouvez le voir, il porte une longue veste noire, appelée frac, et un étrange chapeau en soie en forme de cheminée, appelé haut-de-forme. C’était l’uniforme des capitalistes et personne d’autre n’osait le porter. Les capitalistes possédaient tout dans le monde et le reste du peuple était leurs esclaves. Ils possédaient toutes les terres, toutes les maisons, toutes les usines et tout l’argent. Quiconque leur désobéissait était jeté en prison ou expulsé du travail et mourait de faim.
Lorsqu’un homme ordinaire parlait à un capitaliste, il devait se mettre à terre, s’incliner, enlever son chapeau et l’appeler « monsieur ». Le capitaliste le plus important s'appelait le roi et... Il connaissait cette liste par cœur. Il y aura des évêques avec des manches de batiste, des juges en robe garnie d'hermine, un pilori, des ceps, un tapis roulant, un fouet à neuf queues, un banquet chez le lord-maire, la coutume de baiser la chaussure du pape.
Il y avait aussi ce qu'on appelle le droit de la première nuit. mais c'est le cas dans un manuel pour enfants. probablement pas mentionné. Selon cette loi, le capitaliste avait le droit de coucher avec n'importe quel ouvrier de son usine. Comment savoir combien il y a de mensonges ? Peut-être que l’individu moyen vit mieux aujourd’hui qu’avant la révolution. La seule preuve contre cela est une protestation silencieuse dans vos tripes, un sentiment instinctif que les conditions de votre vie sont insupportables, qu’elles ont dû être différentes autrefois.
Il lui est venu à l’esprit que la chose la plus caractéristique de la vie d’aujourd’hui n’est pas sa cruauté ou son instabilité, mais simplement sa misère, sa monotonie et son apathie. Si vous regardez autour de vous, vous ne verrez rien de comparable ni aux mensonges diffusés sur les écrans de télévision, ni aux idéaux que défend le parti.
Même un membre du parti passe la majeure partie de sa vie en dehors de la politique, travaillant dur dans un travail ennuyeux, se battant pour une place dans un wagon de métro, raccommodant une chaussette trouée, mendiant un comprimé de saccharine, accumulant un mégot de cigarette.
L'idéal du parti est quelque chose de gigantesque, de menaçant, d'étincelant : un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terribles, un pays de guerriers et de fanatiques qui marchent en une seule formation, pensent une pensée, crient un slogan, travaillent sans relâche, se battent, triompher, punir - trois cents millions d'hommes et tout le monde se ressemble.
Dans la vie, il y a des bidonvilles, où se précipitent des gens non nourris en chaussures fines, des maisons délabrées du XIXe siècle, où règne toujours l'odeur du chou et des latrines.
Une vision de Londres lui apparut - une immense ville en ruines, une ville aux millions de poubelles - et superposée à celle-ci se trouvait l'image de Mme Parsons, une femme au visage ridé et aux cheveux fins, fouillant désespérément un tuyau d'égout bouché. . Il s'est encore gratté la cheville.
Jour et nuit, les écrans de télévision vous bombardent de statistiques, prouvant que les gens d'aujourd'hui ont plus de nourriture, plus de vêtements, de meilleures maisons, plus de plaisir, qu'ils vivent plus longtemps, travaillent moins et sont plus grands, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, plus éclairés que cinquante ans. il y a des années.
Pas un mot ici ne peut être prouvé ou réfuté. Le Parti, par exemple, affirme qu’aujourd’hui quarante pour cent des prolétaires adultes sont alphabétisés, alors qu’avant la révolution, seuls quinze pour cent l’étaient.
Le parti affirme que la mortalité infantile n'est aujourd'hui que de cent soixante pour mille, alors qu'avant la révolution elle était de trois cents... et ainsi de suite. C'est quelque chose comme une équation à deux inconnues. Cela se pourrait très bien. que littéralement chaque mot des livres d’histoire – même ceux que vous considérez comme allant de soi – est de la pure fiction. Qui sait, peut-être qu'il n'y a jamais eu de loi telle que le droit à la première nuit, ni de créature telle qu'un capitaliste, ni de coiffure telle qu'un haut-de-forme. Tout se brouille dans le brouillard.
Le passé a été nettoyé, l’effacement est oublié, le mensonge est devenu la vérité. Une seule fois dans sa vie, il a eu - après les événements, c'est ce qui est important - la preuve claire et sans équivoque qu'un faux avait été commis. Il l'a tenu dans ses mains pendant une demi-minute. C'était, semble-t-il, en 1973... en un mot, au moment où il rompit avec Katherine.
Mais nous parlions d’événements il y a sept ou huit ans. Cette histoire a commencé au milieu des années soixante, pendant la période des grandes purges, lorsque les véritables dirigeants de la révolution furent complètement exterminés. En 1970, il n’en restait plus un seul en vie, à l’exception de Big Brother. Tous ont été dénoncés comme traîtres et contre-révolutionnaires.
Goldstein s'est échappé et s'est caché dans un endroit inconnu, quelqu'un a tout simplement disparu, la plupart ont été exécutés après des procès bruyants, où chacun a avoué ses crimes. Parmi les derniers à subir ce sort se trouvaient trois Jones, Aronson et Rutherford. l'an soixante-cinq.
Comme d'habitude, ils ont disparu pendant un an ou un an avec de la nourriture, et personne ne savait s'ils étaient vivants ou non : mais ensuite ils ont été soudainement sortis pour que, comme d'habitude, ils se soient incriminés. Ils ont reconnu leurs relations avec l'ennemi (à l'époque l'ennemi était aussi l'Eurasie), le détournement de fonds publics, le meurtre de membres fidèles du parti, l'affaiblissement de la direction de Big Brother, qu'ils avaient commencé bien avant la révolution, à saboter des actes. qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes.
Ils ont avoué, ont été graciés, réintégrés dans le parti et ont obtenu des postes importants en soi, mais essentiellement des sinécues. Tous trois ont écrit de longs articles de pénitence dans le Times, où ils ont examiné les racines de leur trahison et ont promis d'expier leur culpabilité. Après leur libération, Winston a vu tout le trio au Chestnut Cafe.
Il les observait subrepticement, avec horreur, et ne pouvait les quitter des yeux. Ils étaient beaucoup plus âgés que lui, des reliques du monde antique, probablement les derniers personnages majeurs restant des premiers jours héroïques de la fête. L'esprit glorieux de la lutte clandestine et guerre civile planait toujours au-dessus d'eux. Il avait le sentiment - même si les faits et les dates étaient déjà assez flous - qu'il avait entendu leurs noms plusieurs années plus tôt que celui de Big Brother.
Mais ils étaient hors la loi – des ennemis, des parias, condamnés à disparaître d’ici un an ou deux. Il n’y avait pas de salut pour ceux qui étaient autrefois entre les mains de la police de la pensée. Ce sont des cadavres qui n’attendent que d’être envoyés au cimetière. Il n’y avait personne autour des tables autour d’eux ; il n’était même pas sage de paraître à proximité de telles personnes. Ils étaient assis en silence avec des verres de gin parfumé aux clous de girofle – la boisson signature de ce café. Rutherford a fait la plus grande impression sur Winston.
Autrefois dessinateur célèbre, il a grandement contribué à enflammer les passions publiques pendant la période des révolutions avec ses dessins maléfiques. Ses caricatures paraissaient encore occasionnellement dans le Times. C'était juste une imitation de ses manières précédentes, extrêmement sans vie et peu convaincantes.
Reprise de vieux thèmes : bidonvilles, cabanes, enfants affamés, combats de rue. Les capitalistes en haut-de-forme (il semble que même aux barricades, ils ne voulaient pas se séparer de leurs hauts-de-forme) sont des tentatives interminables et désespérées de retour vers le passé. Il était énorme et laid – une crinière de cheveux gris gras, un visage ridé et des lèvres gonflées et saillantes. Autrefois, il devait se distinguer par une force incroyable, mais maintenant son grand corps a enflé par endroits, s'est affaissé, s'est affaissé et a rétréci par endroits. Elle semblait se désintégrer sous nos yeux – une montagne en ruine.
Il était quinze heures, heure calme. Winston ne se rappelait plus comment il était arrivé là à une telle heure. Le café était presque vide. Musique entraînante diffusée sur les écrans télé. Les trois étaient assis dans leur coin, silencieusement et presque immobiles. Le serveur, sans attendre leur demande, apporta un autre verre de gin.
Sur leur table se trouvait un échiquier avec des pièces disposées, mais personne ne jouait. Soudain, quelque chose est arrivé aux écrans télé - et cela a duré une demi-minute. La mélodie a changé, l'ambiance de la musique a changé. Quelque chose d'autre a envahi... c'est difficile d'expliquer quoi. Un ton étrange, craquelé, aigu et moqueur – Winston l'appelait un ton jaune féroce. Puis une voix chanta :
Sous un châtaignier étalé
Vendu en plein jour -
Je toi et toi moi.
Sous un châtaignier étalé
Nous sommes allongés en plein jour -
Vous êtes à droite et je suis à gauche.
Les trois n'ont pas bougé. Mais lorsque Winston regarda à nouveau le visage ruiné de Rutherford, il s'avéra qu'il avait les larmes aux yeux. Et c'est seulement maintenant que Winston remarqua, avec un frisson intérieur – ne comprenant pas encore pourquoi il frissonnait – qu'Aronson et Rutherford avaient le nez cassé.
Un peu plus tard, tous trois furent de nouveau arrêtés. Il s'est avéré qu'immédiatement après leur libération, ils ont participé à de nouveaux complots. Lors du deuxième procès, ils ont de nouveau avoué tous les crimes antérieurs et plusieurs. Ils furent exécutés et leur acte fut immortalisé dans l'histoire du parti pour l'édification de la postérité.
Environ cinq ans plus tard, en 1973, alors qu'il déballait des matériaux qui venaient de tomber d'un tube pneumatique sur la table, Winston découvrit un morceau de papier au hasard. Il comprit le sens de la ferraille dès qu'il la redressa sur la table. C'était une demi-page arrachée du Times il y a environ dix ans, la moitié supérieure, donc le numéro était là, et dessus se trouvait une photographie des participants à une fête à New York.
Jones, Aronson et Rutherford se sont démarqués au centre du groupe. Il était impossible de ne pas les reconnaître et leurs noms figuraient dans la légende sous la photographie. Et lors des deux procès, tous trois ont témoigné que ce jour-là ils se trouvaient sur le territoire de l'Eurasie. Depuis un aérodrome secret au Canada, ils ont été emmenés quelque part en Sibérie pour rencontrer des employés de l'état-major eurasien, à qui ils ont révélé d'importants secrets militaires.
La date est restée dans la mémoire de Winston car c’était le solstice d’été : cependant, cette affaire est probablement décrite partout. Il n’y a qu’une seule conclusion possible : leurs aveux étaient des mensonges. Bien sûr, Dieu ne sait pas quelle découverte. Même alors, Winston n’admettait pas l’idée que les personnes tuées lors des purges étaient en réalité des criminels. Mais il y avait là une preuve précise, un fragment d’un passé effacé : tout comme un os fossile, trouvé dans la mauvaise couche de sédiment, détruit toute une théorie géologique.
Si ce fait pouvait être rendu public, sa signification pourrait être expliquée. lui seul aurait réduit la fête en mille morceaux. Winston s'est immédiatement mis au travail. Voyant la photographie et réalisant ce qu'elle signifiait, il la recouvrit d'un autre drap. Heureusement, le télécran la montrait à l'envers. Il posa le bloc-notes sur ses genoux et éloigna sa chaise du télécran.
Il est facile d’afficher un visage impénétrable, vous pouvez même respirer doucement si vous essayez, mais vous ne pouvez pas contrôler votre rythme cardiaque, et le téléécran est une chose sensible, il le remarquera. Il attendit, d'après ses calculs, dix minutes, tourmenté tout le temps par la crainte qu'un accident ne le trahisse - par exemple, un courant d'air soudain emporterait le journal. Puis, sans ouvrir la photo, il la plaça, avec les feuilles de papier inutiles, dans la fente mémoire.
Et en une minute, elle s'est probablement transformée en cendres. C'était il y a dix ou onze ans. Aujourd’hui, il aurait très probablement conservé cette photo. C’est curieux : même si la photographie et le fait qui y est reflété n’étaient qu’un souvenir, le fait même de l’avoir tenue entre ses mains l’a influencé jusqu’à ce jour. Est-il possible, se demandait-il, que le pouvoir du parti sur le passé se soit affaibli à cause de l’existence de preuves insignifiantes qui n’existent plus ?
Et aujourd’hui, s’il était possible de ressusciter la photographie, elle ne constituerait probablement pas une preuve. Après tout, lorsqu'il la vit, l'Océanie n'était plus en guerre avec l'Eurasie et les trois défunts auraient dû vendre leur patrie à des agents d'Eastasia. Et depuis, il y a eu d'autres tours - deux, trois, il ne se souvenait plus combien.
Il est probable que les aveux du défunt aient été réécrits et réécrits, de sorte que les faits et les dates originaux ne signifient plus rien. Le passé ne change pas seulement, il change continuellement. Le plus terrible pour lui était qu'il n'a jamais clairement compris quel but poursuivait cette grandiose tromperie. Les avantages immédiats de la contrefaçon du passé sont évidents, mais son objectif ultime est un mystère.
Il reprit la plume et écrivit : Je comprends COMMENT : je ne comprends pas POURQUOI. Il se demandait, comme il s'était demandé plus d'une fois, s'il était lui-même fou. Peut-être que le fou est celui qui est en minorité, au singulier.
Il était une fois une folie de penser que la Terre tournait autour du Soleil ; aujourd'hui - que le passé est immuable. Peut-être qu’il est le seul à avoir cette croyance, et s’il est le seul, cela veut dire qu’il est fou. Mais l'idée qu'il était fou ne le dérangeait pas beaucoup : ce serait terrible si, en plus, il se trompait.
Il prit un livre d'histoire pour enfants et regarda le frontispice avec un portrait de Big Brother. Il fut accueilli par un regard hypnotique. C'était comme si une force gigantesque pressait sur vous – pénétrant votre crâne, percutant votre cerveau, vous faisant perdre vos croyances par la peur, vous forçant à ne pas croire vos propres sens. En fin de compte, le parti annoncera que deux et deux font cinq, et il faudra y croire. Tôt ou tard, elle publiera un tel décret ; la logique de son pouvoir y conduit inévitablement.
Sa philosophie nie silencieusement non seulement l’exactitude de vos perceptions, mais aussi l’existence même du monde extérieur. L'hérésie des hérésies relève du bon sens. Et ce qui est terrible, ce n’est pas qu’ils vous tuent pour une opinion opposée, mais qu’ils aient peut-être une morale. En fait, comment sait-on que deux et deux font quatre ?
Ou que la gravité existe. Ou que le passé ne peut pas être changé. Si le passé et le monde extérieur n'existent que dans la conscience et que la conscience peut être contrôlée, alors quoi ? Non! Il ressentit un élan inattendu de courage. On ne sait pas exactement par quelle association le visage d’O’Brien est apparu dans son esprit. Maintenant, il savait encore plus fermement qu’O’Brien était de son côté.
Il écrit un journal pour O'Brien - O'Brien ; personne ne lira sa lettre interminable, mais elle est destinée à une personne précise et est colorée par celle-ci. Le Parti vous a dit de ne pas en croire vos yeux et vos oreilles. Et c’est sa dernière et la plus importante commande.
Son cœur se serra à l'idée de la force énorme qui s'était alignée contre lui, de la facilité avec laquelle n'importe quel idéologue de parti le battrait dans une dispute avec des arguments rusés qu'il, non seulement ne pouvait pas réfuter, mais qu'il ne serait pas capable de comprendre. Et pourtant il a raison ! Ils ont tort et il a raison. L’évidence, l’élémentaire, le vrai doivent être défendus. Un truisme vrai - et restez là !
Le monde existe fermement, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau est mouillée, un objet sans support s'élance vers le centre de la Terre. Ayant le sentiment de dire cela à O'Brien et de mettre en avant un axiome important, Winston écrit : La liberté est la capacité de dire que deux et deux font quatre. Si cela est autorisé, tout le reste suit.
Chapitre VIII
Quelque part au fond du passage, il y avait une odeur de café torréfié – du vrai café, pas du Pobeda. Winston s'arrêta involontairement. Pendant deux secondes, il retourna dans le monde à moitié oublié de l'enfance. Puis la porte a claqué et a coupé l'odeur comme le son. Il a parcouru plusieurs kilomètres dans les rues et l'ulcère au-dessus de ma cheville me piquait. C'était la deuxième fois en trois semaines qu'il manquait une soirée au centre communautaire – un acte irréfléchi ; les visites étaient probablement surveillées. En principe, un membre du parti n'a pas de temps libre et le seul moment où il est seul avec lui-même est au lit.
Lorsqu'il n'est pas occupé à travailler, à manger et à dormir, on attend de lui qu'il participe aux divertissements publics ; Tous. Ce qui peut être vu comme un amour de la solitude, même une promenade sans compagnon est suspect. À cette fin, en novlangue, il existe un mot samozhit qui signifie individualisme et excentricité. Mais ce soir, en sortant du ministère, il a été séduit par la tendresse de l'air d'avril.
Un ton bleu si doux dans le ciel est derrière L'année dernière Je ne l'ai jamais vu, la longue soirée bruyante au centre communautaire, les jeux ennuyeux et épuisants, les conférences, la camaraderie grinçante, quoique tachée de gin - tout cela lui semblait insupportable. Cédant à une impulsion soudaine, il s'est détourné de l'arrêt de bus et a erré dans le labyrinthe de Londres, d'abord vers le sud, puis vers l'est puis vers le nord, s'est perdu dans des rues inconnues et a marché sans but. "S'il y a de l'espoir", écrit-il dans son journal, alors il est dans les prolétaires.
Et cette phrase me trottait tout le temps dans la tête - une vérité mystique et une absurdité évidente. C'était dans un bidonville brun quelque part au nord-est de ce qui était autrefois la gare de St Pancras. Il marcha le long d'une rue pavée, passant devant des maisons à deux étages dont les portes délabrées ouvraient directement sur le trottoir et suggéraient pour une raison quelconque des trous à rats. Il y avait des flaques de boue ici et là sur les pavés.
Et dans les entrées sombres et les ruelles étroites des deux côtés, il y avait étonnamment beaucoup de monde - des filles mûres avec des bouches grossièrement peintes, des gars poursuivant des filles, de grosses femmes, à la vue desquelles il devenait clair ce que ces filles deviendraient dans dix ans, courbées des vieilles femmes traînant les pieds piétinés et des enfants en haillons, pieds nus, qui jouaient dans les flaques d'eau et se dispersaient sous les cris de leur mère. Probablement une fenêtre sur quatre était brisée et recouverte de planches. - Presque aucune attention n'a été portée à Winston, mais certaines personnes l'ont suivi avec un regard méfiant et curieux.
Devant la porte, les mains rouge brique croisées sur leur tablier, deux énormes femmes discutaient. Winston, s'approchant d'eux, entendit des bribes de conversation. Oui, dis-je, tout cela est très bien, dis-je. Mais si tu étais moi, tu ferais pareil. C'est facile, dis-je, de juger, mais si seulement tu pouvais en prendre une gorgée... - Oui, répondit l'autre, C'est tout. Exactement. Les voix dures se turent soudain.
En silence, les femmes le regardaient avec hostilité. Pourtant, même pas hostiles, plutôt méfiants, figés un instant, comme si un animal inconnu passait par là, la combinaison bleue d'un membre du parti ne brillait pas souvent dans ces rues. Cela ne valait pas la peine de se présenter dans de tels endroits sans rien faire. Si vous rencontrez une patrouille, elle pourrait vous arrêter.
"Camarade, vos documents. Que faites-vous ici ? À quelle heure avez-vous quitté le travail ? Rentrez-vous toujours de cette façon ?" Et ainsi de suite.
Il n’était pas interdit de prendre des itinéraires différents pour rentrer chez soi, mais si la police de la pensée le découvrait, cela suffisait pour vous repérer. Soudain, toute la rue se mit à bouger. Des cris d’avertissement ont été entendus de toutes parts. Les gens couraient chez eux comme des lapins. Une jeune femme a sauté par une porte non loin de Winston, a ramassé un petit enfant qui jouait dans une flaque d'eau, lui a jeté un tablier et s'est précipitée en arrière.
Au même moment, un homme vêtu d'un costume noir qui ressemblait à un accordéon est apparu de la ruelle et a couru vers Winston. pointant vers le ciel avec enthousiasme. - Locomotive à vapeur! - il cria. - Regardez, directeur ! Maintenant, c'est au-dessus de la tête ! Couchez-vous vite ! Pour une raison quelconque, les prolétaires appelaient la fusée une locomotive à vapeur.
Winston se jeta à terre. Dans de tels cas, les prolétaires ne commettaient presque jamais d’erreurs. C'était comme si leur instinct leur disait en quelques secondes qu'une fusée approchait, car on croyait que les fusées volaient plus vite que le son. Winston se couvrit la tête de ses mains. Il y eut un rugissement qui secoua le trottoir : des débris pleuvèrent sur son dos. Lorsqu'il s'est relevé, il a découvert qu'il était couvert d'éclats de vitres.
Il est parti. À environ deux cents mètres de là, la roquette a démoli plusieurs maisons. Il y avait une colonne de fumée noire dans l'air, et en dessous, dans un nuage de poussière d'albâtre, des gens se rassemblaient déjà autour des ruines. Il y avait un tas de plâtre devant nous et Winston aperçut une tache rouge vif dessus.
En s'approchant, il vit que c'était une main coupée. À l’exception du moignon ensanglanté, le pinceau était complètement blanc, comme un plâtre. Il l'a jetée dans les égouts, puis, pour contourner la foule, il a tourné à droite dans la ruelle.
Trois ou quatre minutes plus tard, il quittait la zone d'explosion, et ici la rue vivait sa misérable vie de fourmi comme si de rien n'était. Il était presque vingt heures et les débits de boissons des prolétaires étaient remplis de visiteurs. Leurs portes sales s'ouvraient continuellement, aspergeant la rue d'odeurs d'urine, de sciure et de bière aigre.
Dans le coin près de la maison en saillie, trois hommes se tenaient proches les uns des autres, celui du milieu tenant un journal plié et deux regardant par-dessus son épaule. De loin, Winston distinguait les expressions de leurs visages, mais leurs poses trahissaient leur enthousiasme.
Apparemment, ils lisaient un message important. Alors qu’ils furent à quelques pas, le groupe se sépara soudainement et les deux hommes se livrèrent à une violente querelle.
On aurait dit qu’elle était sur le point d’éclater dans une bagarre. - Écoute, espèce d'idiot, ce qu'ils te disent ! Avec un sept à la fin, aucun numéro n'avait gagné depuis quatorze mois. - Et je dis, j'ai gagné ! - Et je dis non. Chez moi, tout a été déchargé en deux ans. Je l'écris comme sur des roulettes. Je te le dis, pas un avec un sept... - Non, le sept a gagné ! Oui, je vais nommer presque tout le numéro. Terminé à quatre cent sept.
En février - la deuxième semaine de février. - Ta grand-mère en février ! Je l'ai en noir et blanc. Jamais, dis-je, à sept... - Tais-toi ! - un troisième est intervenu. Ils parlaient de la loterie. Après avoir marché une trentaine de mètres, Winston se retourna. Ils continuèrent à discuter avec animation et passion.
La loterie, avec ses fabuleux gains hebdomadaires, était le seul événement social qui excitait les prolétaires. Des millions de personnes y voyaient probablement la principale, sinon la seule chose pour laquelle il valait la peine de vivre. C'était leur délice, leur folie, leur détente, leur stimulant intellectuel. Ici, même ceux qui savaient à peine lire et écrire ont fait preuve de l'art des calculs complexes et de la mémoire surnaturelle. Il y avait tout un clan qui se nourrissait de la vente de systèmes, de prévisions et de talismans.
Winston n'avait rien à voir avec le travail de la loterie - elle était gérée par le ministère de l'Abondance, mais il savait (tout le monde dans le parti le savait) que les gains étaient pour la plupart imaginaires. En fait, seuls de petits montants ont été versés et les propriétaires des gains importants étaient des personnes fictives. En l’absence d’une véritable connexion entre les différentes parties de l’Océanie, cela n’a pas été difficile à réaliser, mais s’il y a de l’espoir, alors il est dans les prolétaires.
Il faut s'accrocher à cette idée. Quand on l’exprime avec des mots, cela semble raisonnable : quand on regarde ceux qui passent à côté de soi, y croire est de l’ascèse. Il tourna dans une rue en descente. L'endroit lui semblait vaguement familier : l'avenue principale se trouvait non loin.
Il y avait une agitation quelque part devant. La rue tournait brusquement et se terminait par un escalier menant à une ruelle où des vendeurs ambulants vendaient des légumes mous. Winston se souvenait de cet endroit. L'allée menait à la rue principale et au prochain tournant, à cinq minutes de là, se trouvait une brocante où il acheta un livre qui devint un journal intime. Un peu plus loin, dans une papeterie, il achète de l'encre et un stylo.
Il s'arrêta devant les escaliers. De l’autre côté de la ruelle se trouvait un pub délabré avec des fenêtres apparemment givrées, mais en réalité juste poussiéreuses. Un vieil homme âgé, courbé mais énergique, avec une moustache grise dressée comme un homard, ouvrit la porte et disparut dans le pub. Winston se rendit compte que ce vieil homme, qui avait maintenant au moins quatre-vingts ans, avait été témoin de la révolution en tant qu'homme adulte.
Lui et quelques autres comme lui constituent le dernier lien avec le monde disparu du capitalisme. Et il reste peu de gens dans le parti dont les opinions se sont formées avant la révolution. L’ancienne génération a été presque entièrement tuée lors des grandes purges des années cinquante et soixante, et ceux qui ont survécu ont été intimidés jusqu’à une capitulation mentale complète. Et s'il existe une personne vivante capable de dire la vérité sur le premier un demi siècle, alors il ne peut s'agir que d'une violation.
Winston se souvint soudain d'un passage d'un livre d'histoire pour enfants qu'il avait copié dans son journal et fut inspiré par une idée folle. Il entrera dans le pub, fera la connaissance du vieil homme et lui demandera : "Raconte-moi comment tu vivais quand tu étais enfant. Comment était la vie ? Est-ce mieux qu'aujourd'hui, ou pire ?" Le plus vite possible, pour ne pas avoir le temps d'avoir peur, il descendit les escaliers et traversa de l'autre côté de l'allée. Fou, bien sûr.
Bien entendu, parler avec les prolétaires et visiter leurs pubs n’était pas non plus interdit, mais une farce aussi étrange ne passerait pas inaperçue. Si une patrouille arrive, vous pouvez prétendre que vous vous sentez malade, mais il est peu probable qu'elle le croie. Il poussa la porte et l'acidité de la bière lui vint au nez. Lorsqu’il entra, le brouhaha dans le pub devint deux fois plus silencieux. Il sentit du dos que tous les regards étaient fixés sur sa salopette bleue.
Les gens qui lançaient des fléchettes sur la cible ont arrêté leur jeu pendant une bonne demi-minute. Le vieil homme qu'il venait chercher se disputait au bar avec le barman - un homme grand et costaud. un jeune homme, au nez crochu et aux bras épais.
Il y avait un groupe d’auditeurs debout avec leurs lunettes. "Ils vous demandent en tant que personne", le vieil homme pencha la tête et bomba la poitrine, "Es-tu en train de me dire qu'il n'y a pas de chope de pinte dans ta taverne ?" - Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pinte ? - objecta le barman en posant ses doigts sur le bar. - Non, tu as entendu ? On appelle le barman – il ne sait pas ce qu’est une pinte ! Une pinte équivaut à un demi-litre et quatre litres à un gallon.
Peut-être que je devrais t'apprendre l'alphabet ? "Je n'en ai jamais entendu parler, lance le barman. On sert un litre, on sert un demi-litre et c'est tout." Il y a de la vaisselle sur l'étagère. «Je veux une pinte», continua le vieil homme. Est-ce difficile de verser une pinte ? À mon époque, il n’y avait pas de litres de votre part.
« À votre époque, nous vivions tous sur des branches », répondit le barman en regardant le public. Il y eut de grands rires et la gêne provoquée par l'apparition de Winston disparut. Le visage du vieil homme devint rouge. Il se retourna en grommelant et tomba sur Winston. Winston lui prit poliment le bras. - Puis-je vous offrir une friandise ? - il a dit. « Un homme noble », répondit-il en gonflant à nouveau la poitrine.
Il semblait avoir remarqué Winston portant une salopette bleue. - Une pinte ! - ordonna-t-il au barman d'un ton belliqueux, - Pint poke. Le barman a rincé deux verres épais d'un demi-litre dans un fût avec une grille et a versé de la bière brune. Ces établissements ne servaient rien d'autre que de la bière.
Le gin n’était pas censé être vendu, mais ils l’ont obtenu sans trop de difficultés. Les lancers de fléchettes ont repris et les gens au comptoir ont commencé à parler de billets de loterie. Winston a été oublié pendant un moment. Il y avait une table en pin près de la fenêtre où l'on pouvait parler face à face avec le vieil homme. Le risque est terrible ; mais au moins il n'y a pas de télécran - Winston s'en est assuré dès son entrée. "Tu aurais pu me servir une pinte", grommela le vieil homme en s'asseyant avec un verre. Un demi-litre ne suffit pas - vous ne vous enivrerez pas.
Un litre, c'est beaucoup. Vous courez souvent. Sans oublier que c'est cher. "Vous avez probablement constaté beaucoup de changements depuis votre jeunesse", commença prudemment Winston. Avec des yeux bleus délavés, le vieil homme regarda le jeu de fléchettes, puis la cabine, puis la porte des toilettes pour hommes, comme s'il voulait retrouver ces changements ici, dans le pub. "La bière était meilleure", dit-il finalement. Et moins cher !
Quand j'étais jeune, la bière faible - appelée poke - coûtait quatre pence la pinte. Mais c’était bien sûr avant la guerre. - Jusqu'à quelle heure? - a demandé Winston. "Eh bien, il y a toujours la guerre", expliqua vaguement le vieil homme. Il prit le verre et gonfla à nouveau sa poitrine. "À tes souhaits !" La pomme d'Adam sur son cou maigre sauta étonnamment vite, et la bière disparut. Winston est allé au bar et a apporté deux autres verres.
Le vieil homme semblait avoir oublié ses préjugés contre le litre entier. "Tu es beaucoup plus âgé que moi", a déclaré Winston. "Je n'étais pas encore né et tu étais probablement déjà un adulte." Et vous vous souvenez de votre vie antérieure, avant la révolution. En fait, les gens de mon âge ne savent rien de cette époque. Vous ne pouvez le lire que dans les livres, mais qui sait si ce qu’ils écrivent dans les livres est vrai. J'aimerais avoir de vos nouvelles.
Les livres d’histoire disent que la vie avant la révolution n’était en rien ce qu’elle est aujourd’hui. Une oppression horrible, une injustice, une pauvreté – telles que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Ici à Londres, de nombreuses personnes, de leur naissance à leur mort, n’ont jamais eu assez à manger. La moitié marchait pieds nus. Ils travaillaient douze heures, quittaient l'école à neuf heures et dormaient dix personnes par chambre.
Dans le même temps, une minorité – quelques milliers, les soi-disant capitalistes – possédait richesse et pouvoir. Ils possédaient tout ce qui pouvait être possédé. Ils vivaient dans des maisons luxueuses, avaient trente domestiques, se déplaçaient en voiture et à quatre pattes, buvaient du champagne, portaient des hauts-de-forme...
Le vieil homme se redressa soudain. - Des cylindres ! - il a dit. - Comment tu t'en souviens ? Hier encore, j'y ai pensé. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup. Je ne pense pas avoir vu de haut-de-forme depuis de nombreuses années. Ils s'éloignèrent complètement.
Et la dernière fois que je l’ai porté, c’était pour les funérailles de ma belle-fille. Je ne vous dirai pas encore quand… il y a un an, mais il y a cinquante ans. Il a bien sûr été loué pour une telle occasion. "Les cylindres ne sont pas si importants", observa patiemment Winston. - L'essentiel est que les capitalistes... eux et les prêtres, avocats et autres qui se nourrissaient sous leurs ordres étaient propriétaires de la terre. Tout dans le monde était pour eux.
Vous, travailleurs ordinaires, étiez leurs esclaves. Ils pouvaient faire de vous ce qu'ils voulaient, ils pouvaient vous expédier au Canada comme du bétail. Couche avec tes filles si tu veux. Ordre d'être fouetté avec une sorte de fouet à neuf queues. Lorsque vous les avez rencontrés, vous avez enlevé votre chapeau. Chaque capitaliste marchait avec une meute de laquais... Le vieil homme reprit courage. - Des laquais ! Depuis combien d'années n'as-tu pas entendu ce mot, hein ? Des laquais.
Honnêtement, vous vous souvenez de votre jeunesse hétéro. Je me souviens... quand... j'allais à Hyde Park le dimanche pour écouter des discours. Il y avait tout le monde : l’Armée du Salut, les catholiques, les juifs et les hindous. Et il y avait une personne là-bas... Je ne me souviens plus de son nom maintenant, mais il a bien joué ! Oh, il les a éternué.
Des laquais, dit-il. Laquais de la bourgeoisie ! Hommes de main la classe dirigeante!
L'attitude envers vous est-elle plus humaine ? Autrefois, les gens riches, les gens au pouvoir... « La Chambre des Lords », intervint pensivement le vieil homme. - Chambre des Lords, si vous le souhaitez, je vous le demande, ces gens pourraient-ils vous traiter comme un inférieur simplement parce qu'ils sont riches et pauvres ?
Est-il vrai, par exemple, que vous deviez leur dire « monsieur » et retirer votre chapeau lorsque vous les rencontriez ? Le vieil homme réfléchit longuement. Et à peine répondit-il qu'il but un quart de verre. « Oui », dit-il. « Ils voulaient que vous touchiez la casquette. » On dirait qu'il a fait preuve de respect. À vrai dire, je n’ai pas aimé ça, mais je l’ai fait pour une bonne raison.
Vous pouvez dire où vous irez. - Et c'était une coutume - je raconte ce que je lis dans les livres d'histoire -. Était-il habituel que ces gens et leurs domestiques vous poussent du trottoir dans le caniveau ? "L'un d'eux m'a poussé une fois", répondit le vieil homme. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le soir après les courses de bateaux... ils étaient terriblement bruyants après ces courses... Je tombe sur un gars sur Shaftoebury Avenue. L'apparence est noble - un costume formel, un haut-de-forme et un manteau noir.
Il marche sur le trottoir, fait un écart et je le heurte accidentellement. Il dit : « Tu ne vois pas où tu vas ? - parle. Je dis : « Quoi, tu as acheté un trottoir ? Et lui : "Tu vas être impoli avec moi ? Je vais tourner la tête vers l'enfer."
Je dis : "Tu es ivre", dis-je. "Je te livre à la police, tu n'auras pas le temps de regarder en arrière." Et, le croiriez-vous, il me prend par la poitrine et me pousse si fort que j'ai failli me faire renverser par un bus. Eh bien, j'étais jeune à l'époque et je l'aurais prévenu, mais ensuite... Winston était désespéré. La mémoire du vieil homme n’était qu’un fouillis de petits détails. Vous pouvez l’interroger toute la journée et vous n’obtiendrez aucune information utile.
Ainsi, l’histoire du parti peut être vraie dans un certain sens, ou peut-être complètement vraie. Il fit une dernière tentative : « Je ne m’exprime probablement pas clairement », dit-il. C'est ce que je veux dire. Vous vivez dans le monde depuis très longtemps, vous avez vécu la moitié de votre vie avant la révolution.
Par exemple, en 1925, vous étiez déjà adulte. D’après vos souvenirs, pensez-vous que la vie était meilleure ou pire en 1925 qu’elle ne l’est aujourd’hui ? Si vous aviez le choix, préféreriez-vous vivre à ce moment-là ou maintenant ?
Le vieil homme regarda pensivement la cible. J'ai fini ma bière - assez lentement. Et finalement il répondit avec une réconciliation philosophique, comme si la bière l'avait adouci : « Je sais quels mots vous attendez de moi. » Pensez-vous que je dirai que je veux redevenir jeune ?
Demandez aux gens : la plupart vous diront qu’ils aimeraient être jeunes. Dans la jeunesse, la santé, la force, tout est avec vous. Quiconque a vécu jusqu’à mon âge est toujours malade. Et parfois, j’ai mal aux jambes même quand je pleure et ma vessie est pire que jamais. Vous courez six ou sept fois la nuit.
Mais la vieillesse a aussi ses joies. Il n'y a plus de soucis. Il n'est pas nécessaire de s'embêter avec les femmes - c'est une grosse affaire. Le croiriez-vous, je n’ai pas eu de femme depuis trente ans. Et à contrecœur, la bouche est ce qui compte le plus. Winston retomba sur le rebord de la fenêtre.
Cela ne servait à rien de continuer. Il était sur le point de prendre une autre bière, mais le vieil homme se leva soudainement et se dirigea rapidement vers la cabine malodorante contre le mur latéral. Le demi-litre supplémentaire a fait son effet. Winston regarda le verre vide pendant une minute ou deux, puis il ne remarqua même pas comment ses pieds l'emportaient dans la rue.
Vingt ans plus tard, il réfléchissait à la grande et simple question : « La vie était-elle meilleure avant la révolution ? deviendra finalement insoluble. Et même aujourd’hui, ce problème est, par essence, insoluble : les témoins occasionnels de l’ancien monde ne sont pas capables de comparer une époque à une autre.
Ils se souviennent de nombreux faits inutiles : une dispute avec un employé, la perte et la recherche d'une pompe à vélo, l'expression sur le visage d'une sœur décédée depuis longtemps, un tourbillon de poussière par un matin venteux il y a soixante-dix ans : mais ce qui est important, c'est au-delà de leurs horizons.
Ils sont comme une fourmi qui voit de petites choses et ne voit pas de grandes choses. Et lorsque la mémoire fait défaut et que les preuves écrites sont falsifiées, il faut alors être d’accord avec les affirmations du parti selon lesquelles il a amélioré la vie des gens – après tout, il existe et il n’y aura jamais de données initiales à vérifier. Ici, ses pensées furent interrompues. Il s'arrêta et leva les yeux.
Il se tenait dans une rue étroite où plusieurs magasins sombres étaient coincés entre des immeubles résidentiels. Au-dessus de sa tête sont suspendus trois boules de métal défraîchies, qui devaient avoir été autrefois dorées. Il semblait reconnaître cette rue. Oui bien sur! Devant lui se trouvait une brocante où il avait acheté le journal. La peur a frappé. Acheter le livre était un acte irréfléchi, et Winston a juré de ne pas s'approcher de cet endroit.
Mais dès qu'il y réfléchit, ses pieds l'amenèrent ici. Mais c’est pour cela qu’il a tenu un journal, pour se protéger de telles pulsions suicidaires. Le magasin était toujours ouvert, même s'il était presque vingt et un heures. Il pensa que flâner sur le trottoir attirerait plus l'attention que dans le magasin, et il entra. Ils me demanderont si je voulais acheter des lames.
Le propriétaire venait d'allumer une lampe à pétrole suspendue, qui dégageait une odeur sale mais en quelque sorte agréable. C'était un homme d'une soixantaine d'années, frêle, voûté, au nez long et amical, et ses yeux, derrière les verres épais de ses lunettes, semblaient grands et doux.
Ses cheveux étaient presque entièrement gris et ses sourcils étaient épais et toujours noirs. Des lunettes, une certaine agitation, une vieille veste en velours noir, tout cela lui donnait un air intelligent : soit un écrivain, soit un musicien. Il parlait d’une voix calme, apparemment éteinte, et ne déformait pas ses propos autant que la plupart des prolétaires. "Je t'ai reconnu sur le trottoir, dit-il aussitôt. C'est toi qui as acheté un album cadeau pour les filles."
Excellent papier, excellent. On l'appelait crème posée. Ils n’ont pas fabriqué de papier comme celui-ci, je pense… depuis cinquante ans. Il regarda Winston par-dessus ses lunettes. "As-tu besoin de quelque chose de spécifique ?" Ou vouliez-vous simplement voir des choses ? «Je passais par là», répondit évasivement Winston. J'ai décidé d'y jeter un oeil.
Je n'ai besoin de rien de spécifique. - Tant mieux - je serais difficilement en mesure de vous satisfaire. Comme pour s'excuser, il tourna sa douce paume vers le haut. Vous pouvez le constater par vous-même : on pourrait dire une boutique vide. Entre vous et moi, le commerce des antiquités est presque tari. Il n’y a aucune demande et il n’y a rien à offrir. Meubles, porcelaine, cristal, tout cela s'est peu à peu interrompu et brisé. Et la majeure partie du métal a fondu.
Je n'ai pas vu de chandelier en laiton depuis de nombreuses années. En fait, le magasin exigu était rempli de choses, mais elles n'avaient pas la moindre valeur. Il n'y avait presque plus d'espace libre - des cadres poussiéreux étaient empilés près de tous les murs.
Dans la vitrine se trouvent des plateaux remplis de boulons et d’écrous, de ciseaux aiguisés, de canifs cassés, de montres ébréchées qui ne prétendaient même pas être en bon état de fonctionnement, et d’autres détritus divers. Un certain intérêt ne pouvait être suscité que par la petite monnaie posée sur la table dans le coin, les tabatières laquées, les broches en agate, etc. Winston s'approcha de la table et son regard fut attiré par une chose ronde et lisse qui brillait faiblement à la lumière de la lampe ; il l'a pris.
C'était un lourd morceau de verre, plat d'un côté et convexe de l'autre – presque un hémisphère. Il y avait une douceur incompréhensible dans la couleur et la structure du verre - cela ressemblait à de l'eau de pluie. Et au centre, agrandi par un renflement, se trouvait un étrange objet rose avec une structure à motifs, rappelant une rose ou une anémone de mer. - Qu'est-ce que c'est? - demanda Winston enchanté. - Ce? "C'est du corail", répondit le vieil homme. - Il faut supposer qu'à partir de océan Indien. Auparavant, ils étaient parfois encastrés dans du verre. Fabriqué il y a au moins cent ans.
Apparemment encore plus tôt. "C'est une belle chose", a déclaré Winston. "C'est une belle chose", dit le brocanteur avec gratitude. "Mais de nos jours, peu de gens l'apprécieront." Il toussa. Si vous voulez soudainement l'acheter, cela coûte quatre dollars. Il fut un temps où ils donnaient huit livres pour une telle chose, et huit livres... eh bien, je ne peux pas le dire avec certitude maintenant - c'était beaucoup d'argent.
Mais qui a besoin d'antiquités authentiques de nos jours, même si si peu d'entre elles ont survécu ? Winston a immédiatement payé quatre dollars et a mis le jouet tant convoité dans sa poche. Il n'était pas tant séduit par la beauté de la chose que par l'arôme d'une époque complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il n'avait jamais vu de verre aussi doux que la pluie.
La chose la plus attrayante de cet objet était son inutilité, même si Winston devinait qu'il avait autrefois servi de presse-papier. Le verre tirait sur la poche, mais heureusement, il ne dépassait pas trop. Il s’agit d’un objet étrange, voire compromettant pour un membre du groupe. Tout ce qui était vieux, et d'ailleurs tout ce qui était beau, éveillait quelques soupçons.
Le propriétaire. Ayant reçu quatre dollars, il est devenu sensiblement plus heureux. Winston s'est rendu compte qu'il était possible de négocier trois, voire deux. " Si tu veux jeter un oeil, j'ai encore une chambre à l'étage, dit le vieil homme. Il n'y a rien de spécial là-bas. " Juste quelques éléments.
Si nous y allons, nous aurons besoin de lumière. Il alluma une autre lampe, puis, se penchant, monta lentement les marches usées et, à travers un petit couloir, conduisit Winston dans la pièce ; sa fenêtre ne donnait pas sur la rue, mais sur une cour pavée et un bosquet de cheminées à chapiteaux.
Winston a remarqué que les meubles ici étaient disposés comme dans un salon. Il y a un chemin au sol, deux ou trois tableaux aux murs, un fauteuil profond et négligé près de la cheminée. Une horloge en verre antique avec un cadran de douze heures sur la cheminée.
Sous la fenêtre, occupant près d'un quart de la pièce, se trouvait un immense lit avec un matelas. « Nous avons vécu ici jusqu'à la mort de ma femme », expliqua le vieil homme, comme pour s'excuser. Je vends petit à petit mes meubles. Voici un excellent lit en acajou... Autrement dit, ce serait excellent si vous en retiriez les punaises de lit. Cependant, vous trouvez probablement cela encombrant.
Il a levé la lampe au-dessus de sa tête pour éclairer toute la pièce et, dans la lumière chaude et tamisée, elle avait même l'air confortable. Mais il pourrait la louer pour quelques dollars par semaine, pensa Winston, s'il en avait le courage. C’était une pensée folle et absurde, et elle mourut aussi vite qu’elle était née ; mais la pièce éveillait en lui une sorte de nostalgie, une sorte de souvenir qui dormait dans son sang.
Il lui semblait qu'il connaissait bien ce sentiment quand on est assis dans une telle pièce, sur une chaise devant une cheminée allumée, les pieds sur la grille, sur le feu il y a une bouilloire, et tu es tout seul, en toute sécurité, personne ne vous regarde, aucune voix ne vous dérange, seule la bouilloire chante dans la cheminée et l'horloge sonne amicalement. Il n’y a pas de télécran ici », lâche-t-il.
"Oh, ça," répondit le vieil homme. Je n'ai jamais eu. Ils sont chers. Et vous savez, je n’en ai jamais ressenti le besoin. Mais dans le coin il y a une bonne table pliante. Cependant, pour pouvoir utiliser les parois latérales, vous devez remplacer les charnières.
Il y avait une étagère dans l'autre coin, et Winston était déjà attiré par elle. Il n’y avait que des détritus sur l’étagère. La chasse aux livres et la destruction des livres ont été menées aussi minutieusement dans les quartiers prolétaires qu'ailleurs. Il n’existait pratiquement pas un seul exemplaire d’un livre publié avant 1960 dans toute l’Océanie.
Un vieillard, une lampe à la main, se tenait devant un tableau dans un cadre en palissandre ; il était accroché de l'autre côté de la cheminée, en face du lit. D'ailleurs, si les gravures anciennes vous intéressent... commença-t-il délicatement. Winston s'est approché. Il s'agissait d'une gravure sur acier : un bâtiment avec un pignon ovale, des fenêtres rectangulaires et une tour en façade. Il y avait une clôture autour du bâtiment et à l'arrière se trouvait ce qui semblait être une statue.
Winston regarda de plus près. Le bâtiment lui semblait vaguement familier, mais il ne se souvenait pas de la statue. "Le cadre est vissé au mur", dit le vieil homme, "mais si tu veux, je te le préciserai." "Je connais ce bâtiment", dit finalement Winston, "il est détruit." Au milieu de la rue, derrière le Palais de Justice. - Droite. Derrière la Maison de Justice. Il a été bombardé... enfin, il y a de nombreuses années. C'était une église.
"Si j'allume quelques bougies, tu peux aller te coucher. Si je prends une épée tranchante, ta tête ne sera plus sur tes épaules." Le jeu était comme une danse. Ils se tenaient par la main, et vous marchiez sous leurs mains, et quand ils ont atteint le point « ici, je vais prendre une épée tranchante - et je vais vous enlever la tête de vos épaules », leurs mains sont tombées et vous ont attrapé.
Il n'y avait que des noms d'églises. Toutes les églises de Londres... C'est-à-dire les plus célèbres. Winston se demanda distraitement à quel siècle pouvait bien appartenir cette église. Il est toujours difficile de déterminer l'âge des maisons londoniennes. Toutes les maisons grandes, impressionnantes et d'apparence plus ou moins neuves ont bien sûr été considérées comme construites après la révolution, et tout ce qui était manifestement plus ancien a été attribué à une époque lointaine et floue appelée le Moyen-âge.
Ainsi, des siècles de capitalisme n’ont rien produit de valable. Il était tout aussi impossible d’étudier l’histoire à partir de l’architecture qu’à partir de livres. Statues, monuments, plaques, noms de rues, tout ce qui pouvait éclairer le passé a été systématiquement refait. "Je ne savais pas que c'était une église", a-t-il déclaré. En fait, il en reste beaucoup, dit le vieil homme, mais ils sont utilisés pour d'autres besoins. Comment est ce poème ? UN! Je me suis souvenu.
Les oranges sont comme le miel
La cloche de Saint-Clément sonne.
Et Saint Martin appelle :
Donnez-moi un sou !
Maintenant, je ne m'en souviens plus. Un sou était une petite pièce de cuivre, comme un centime. -Où est Saint-Martin ? - a demandé Winston... Saint-Martin ? Celui-ci est toujours debout. Sur la Place de la Victoire, à côté de la galerie d'art. Un bâtiment avec un portique et des colonnes, avec un large escalier. Winston connaissait bien ce bâtiment.
C'était un musée consacré à diverses expositions de propagande : maquettes de fusées et de forteresses flottantes, panoramas de cire illustrant les atrocités ennemies, etc. "On l'appelait Sainte-Marie dans les champs", ajouta le vieil homme, "même si je ne me souviens d'aucun champ dans cette région."
Winston n'a pas acheté la gravure. L’objet était encore plus inapproprié qu’un presse-papier en verre, et on ne pouvait même pas le ramener à la maison – à moins qu’il ne soit sans cadre. Mais il resta encore quelques minutes à discuter avec le vieil homme et découvrit que son nom de famille n'était pas Weeks, comme on pouvait le conclure d'après l'inscription sur le banc, mais Charrington. Il s'est avéré que M. Charrington avait soixante-trois ans, était veuf et vivait dans le magasin depuis trente ans.
Toutes ces années, il envisageait de changer l’enseigne, mais n’y est jamais parvenu. Pendant qu'ils parlaient, Winston ne cessait de se répéter le début de la comptine : "Les oranges sont comme le miel, Saint Clément sonne. Et Saint Martin sonne : donne-moi un sou !"
C’est curieux : lorsqu’il se récitait le poème, il lui semblait que les cloches elles-mêmes sonnaient – les cloches d’un Londres disparu qui existe encore quelque part, invisible et oublié. Et il les entendit sonner, l'un après l'autre, les clochers fantomatiques.
D’aussi loin qu’il se souvienne, il n’avait jamais entendu les cloches des églises. Il a dit au revoir à M. Charrington et est descendu seul les escaliers pour que le vieil homme ne le voie pas regarder autour de lui dans la rue avant de sortir. Il avait déjà décidé qu'après un temps d'attente d'au moins un mois, il risquerait de revenir au magasin. Ce n'est guère plus dangereux que de rater une soirée dans un centre communautaire. C'était une grande imprudence qu'après avoir acheté le livre, il revienne ici, ne sachant pas s'il pouvait faire confiance au propriétaire.
Et pourtant !.. Oui, se dit-il, il faudra qu'il revienne. Il achètera aux Danois une gravure de l'église Saint-Clément, la sortira du cadre et la rapportera chez lui sous sa salopette. Cela permettra à M. Charrington de se souvenir complètement de la rime. Et encore une fois, l'idée folle de louer la chambre haute surgit. Par plaisir, il a oublié la prudence pendant environ cinq secondes - il est sorti, se limitant à un rapide coup d'œil par la fenêtre.
Et il s'est même mis à fredonner un air fait maison :
Les oranges sont comme le miel
La cloche de Saint-Clément sonne.
Et Saint Martin appelle :
Donnez-moi un sou !
Soudain, son cœur manqua un battement de peur et son estomac se serra. À une dizaine de mètres, une silhouette en salopette bleue se dirige vers lui, c'était une fille du département de littérature, aux cheveux noirs. Il faisait déjà nuit, mais Winston la reconnut sans difficulté. Elle le regarda droit dans les yeux et continua son chemin comme si elle ne l'avait pas remarqué. Pendant plusieurs secondes, il ne pouvait plus bouger, comme si ses jambes étaient paralysées.
Puis il tourna à droite et marcha avec difficulté, sans se rendre compte qu'il allait dans la mauvaise direction. Une chose au moins est devenue claire. Il n'y avait aucun doute : la jeune fille l'espionnait. Elle l'a retrouvé - il est impossible de croire qu'elle s'est promenée, par pur hasard, le soir même dans la même rue miteuse, à quelques kilomètres du quartier où vivent les membres du parti. Trop de coïncidences.
Qu'elle serve dans la police de la pensée ou qu'il s'agisse d'une activité amateur n'a pas d'importance. Elle le surveille, ça suffit. Peut-être qu'elle l'a même vu entrer dans le pub. C'était difficile de marcher. Le poids en verre dans sa poche heurtait sa cuisse à chaque pas, et Winston était tenté de le jeter. Mais le pire, c’était la crampe au ventre. Pendant plusieurs minutes, il lui sembla que s'il trouvait maintenant des toilettes pour sa femme, il mourrait. Mais dans une telle zone, il ne pourrait pas y avoir de toilettes publiques.
Puis le spasme est passé, ne laissant qu'une douleur sourde. La rue s'est avérée être une impasse. Winston s'arrêta, resta là pendant quelques secondes, se demandant distraitement quoi faire, puis se retourna. Lorsqu'il se retourna, il lui vint à l'esprit que la fille lui avait manqué il y avait environ trois minutes. et si vous courez, vous pourrez la rattraper. Vous pouvez la suivre dans un endroit calme, puis lui briser le crâne avec un pavé.
Un presse-papier en verre fera également l’affaire. c'est lourd, mais il a immédiatement rejeté ce projet : même l'idée de faire un effort physique lui était insupportable. Il n'y a pas de force pour courir, pas de force pour frapper. De plus, la fille est jeune et forte, elle se défendra. Il a ensuite pensé qu'il devrait se rendre immédiatement au centre communautaire et y rester jusqu'à la fermeture - pour se donner au moins un alibi partiel. Mais cela est également impossible. Une léthargie mortelle s’empare de lui. Je ne voulais qu'une chose : rentrer dans mon appartement et ne rien faire.
Il n'est arrivé chez lui qu'à vingt-trois heures. L'alimentation électrique devait être coupée à vingt-trois heures trente. Il est allé à la cuisine et a bu presque une tasse entière de gin Victory. Puis il se dirigea vers la table de l'alcôve, s'assit et sortit un journal du tiroir. Mais il ne l’a pas ouvert tout de suite. La femme sur le télécran chantait une chanson patriotique d’une voix langoureuse. Winston regarda la reliure en marbre, essayant en vain de se distraire de cette voix.
Ils viennent te chercher la nuit, toujours la nuit. La chose la plus correcte est de se suicider avant qu'ils ne vous emmènent. Beaucoup de gens ont sûrement fait cela. De nombreuses disparitions étaient en réalité des suicides. Mais dans un pays où armes à feu, vous ne pouvez pas obtenir de poison fiable, vous avez besoin d'un courage désespéré pour vous suicider.
Il pensa avec surprise que la douleur et la peur étaient biologiquement inutiles et pensa à la trahison du corps humain, qui se fige au moment même où un effort particulier est requis. Il aurait pu se débarrasser de la jeune fille aux cheveux noirs s'il s'était mis au travail tout de suite, mais c'était précisément pour cela. que le danger était extrême, il perdit ses forces.
Il lui est venu à l'esprit que dans les moments critiques, une personne ne se bat pas avec un ennemi extérieur, mais toujours avec son propre corps. Même maintenant, malgré le gin, une douleur sourde au ventre ne lui permettait pas de penser de manière cohérente. Et c’est la même chose, réalisa-t-il. dans toutes les situations tragiques ou apparemment héroïques.
Sur le champ de bataille, dans une chambre de torture, dans un navire en perdition, ce pour quoi vous vous êtes battu est toujours oublié - votre corps grandit et remplit l'univers, et même lorsque vous n'êtes pas paralysé par la peur et que vous ne criez pas de douleur, la vie n'est qu'une minute. lutte minute par minute contre la faim ou le froid, contre l'insomnie, les brûlures d'estomac ou les maux de dents. Il ouvrit le journal. Il est important d'écrire quelque chose. La femme sur le télécran entonna une nouvelle chanson.
La voix lui transperça le cerveau comme des éclats de verre pointus. Il essaya de penser à O'Brien, pour qui - pour qui - le journal était écrit, mais au lieu de cela, il commença à penser à ce qui lui arriverait lorsque la police de la pensée l'arrêterait. S'ils le tuaient tout de suite, ce serait le cas. Ça ne va pas si mal, la mort est une fatalité.
Mais avant la mort (personne n'en parlait, mais tout le monde le savait), il y aurait une confession selon la routine avec ramper sur le sol implorant grâce, avec le craquement des os brisés, avec des dents cassées et des enchevêtrements sanglants dans les cheveux. Pourquoi devez-vous subir cela si le résultat est connu de toute façon ?
Pourquoi ne pouvons-nous pas raccourcir votre vie de quelques jours ou semaines ? Pas un seul n’a échappé à la révélation et tout le monde a avoué. Au moment où vous avez commis un crime dans vos pensées, vous avez déjà signé votre arrêt de mort. Alors pourquoi ces tourments vous attendent-ils dans le futur s’ils ne changent rien ?
Il a encore essayé d'évoquer l'image d'O'Brien, et voilà qu'il y est parvenu. Nous nous y retrouverons. où il n’y a pas d’obscurité », lui a dit O’Brien. Winston comprenait ses paroles – il lui semblait qu'il comprenait. Là où il n’y a pas d’obscurité se trouve un avenir imaginaire ; vous ne le verrez pas de votre vivant, mais, l'ayant prévu, vous pourrez communier mystiquement avec lui. La voix du télécran frappait mes oreilles et ne me permettait pas de réfléchir jusqu'au bout.
Winston a mis une cigarette dans sa bouche. La moitié du tabac s'est immédiatement répandue sur sa langue - vous ne tarderez pas à la recracher à cause de cette amertume. Devant lui, remplaçant O'Brien, le visage du frère aîné apparut. Tout comme il y a quelques jours, Winston sortit une pièce de monnaie de sa poche et regarda. Le visage le regardait lourdement, calmement, paternel, mais quel genre de sourire se cachait dans la moustache noire ? Plomb funéraire les mots vinrent résonner :
LE GUERRIER EST LE MONDE
LA LIBERTÉ EST L'ESCLAVAGE
L'IGNORANCE EST LE POUVOIR
* DEUXIÈME PARTIE *
C'était encore le matin : Winston partit de sa cabine pour aller aux toilettes. Un homme se dirigeait vers moi dans un couloir vide et bien éclairé. Il s’est avéré que c’était une fille aux cheveux noirs. Quatre jours se sont écoulés depuis cette rencontre à la brocante. En s'approchant, Winston vit que main droite elle l'a en écharpe ; De loin, il ne pouvait pas le voir, car le bandage était bleu, comme une combinaison. La jeune fille s’est probablement cassé le bras en tournant un grand kaléidoscope où étaient « esquissées » les intrigues des romans.
Une blessure courante dans le département de littérature. Alors qu'ils étaient déjà séparés par environ cinq marches, elle trébucha et tomba presque à plat. Un cri de douleur lui échappa. Apparemment, elle est tombée et s'est cassé le bras. Winston se figea. La jeune fille s'est agenouillée. Son visage est devenu jaune laiteux et sa bouche rouge y est apparue encore plus brillante ; elle a regardé Winston d'un air suppliant, et dans ses yeux il y avait plus de peur que de douleur.
Winston était envahi par des sentiments contradictoires. Devant lui se trouvait un ennemi qui essayait de le tuer ; en même temps, il y avait un homme devant lui – cet homme souffrait, il avait peut-être un os cassé. Sans hésitation, il lui vint en aide. Au moment où elle tomba sur sa main bandée, il sembla lui-même ressentir de la douleur. -Es-tu blessé? - C'est bon. Main.
Cela va passer maintenant. » Elle parlait comme si son cœur battait à tout rompre. Et son visage était complètement pâle. -Tu n'as rien cassé ? - Non. Tout est intact. Ça faisait mal et c'est parti. Elle tendit sa main valide à Winston et il l'aida à se relever.
Son visage est devenu un peu rose ; Apparemment, elle se sentait mieux. "C'est bon, répéta-t-elle. Je me suis un peu blessé au poignet, c'est tout." Merci camarade! Sur ces mots, elle continua son chemin, aussi joyeusement que si de rien n'était. Et toute cette scène a probablement duré moins d’une demi-minute.
L’habitude de ne pas montrer ses sentiments était si ancrée qu’elle devenait un instinct, et tout cela se passait juste devant le télécran. Et pourtant, Winston n'eut que bien du mal à contenir sa surprise : en seulement deux ou trois secondes, alors qu'il aidait la jeune fille à se relever, elle lui fourra quelque chose dans la main.
Il ne pouvait être question ici de hasard. Quelque chose de petit et de plat. En entrant dans les toilettes, Winston a mis cette chose dans sa poche et l'a sentie là. Un morceau de papier plié en carré. Devant l'urinoir, après quelques fouilles dans sa poche, il parvint à redresser le morceau de papier. Selon toute vraisemblance, il y a quelque chose d'écrit là-bas. Il fut tenté d'entrer immédiatement dans la cabine et de lire.
Mais ce serait bien sûr de la pure folie. Où d’autre qu’ici, les écrans de télévision sont constamment surveillés ! Il retourna dans sa chambre, s'assit, jeta nonchalamment le morceau de papier sur la table avec les autres papiers, mit ses lunettes et entama le discours. Cinq minutes, se dit-il, cinq minutes au moins !
Les battements de mon cœur dans ma poitrine étaient terriblement forts. Heureusement, le travail qui l’attendait était routinier – clarifier une longue colonne de chiffres – et ne nécessitait pas de concentration. Quoi que dise la note, c’est probablement politique. Winston pouvait imaginer deux options. Une, plus plausible : la femme est un agent de la police de la pensée, ce dont il avait peur. On ne sait pas pourquoi la police aurait recours à ce type de courrier, mais il y a apparemment des raisons à cela.
La note peut contenir une menace, un défi, un ordre de se suicider, un piège quelconque. Il y avait une autre hypothèse, folle, Winston le repoussa, mais elle s'insinua obstinément dans sa tête. La note ne vient pas du tout de la police de la pensée, mais d’une organisation clandestine. Peut être. La fraternité existe toujours ! Et la fille pourrait être de là-bas ! L’idée, bien sûr, était ridicule, mais elle surgit immédiatement dès qu’il toucha le morceau de papier. Une option plus plausible lui vint à l’esprit quelques minutes plus tard.
Et même maintenant, quand son esprit lui disait que la note pourrait signifier la mort, il ne voulait toujours pas y croire, l'espoir insensé ne s'en allait pas, son cœur tonnait et, dictant les chiffres, il pouvait à peine retenir le tremblement de sa voix. Il plia l'ouvrage fini et le mit dans le tube pneumatique. Huit minutes se sont écoulées. Il ajusta ses lunettes, soupira et tira vers lui une nouvelle pile de devoirs sur laquelle reposait ce morceau de papier. J'ai redressé le drap. D'une grande écriture instable, il était écrit : Je t'aime.
Il était tellement interloqué qu'il n'a même pas immédiatement mis l'évidence dans sa mémoire. Réalisant à quel point il était dangereux de montrer un intérêt excessif pour le morceau de papier, il n'a toujours pas pu résister à l'envie de le relire pour s'assurer qu'il ne l'avait pas imaginé. . C'était très dur de travailler avant la pause. Il ne pouvait pas se concentrer sur des tâches fastidieuses, mais le pire était qu'il devait cacher sa confusion devant le téléécran.
C'était comme si un feu brûlait dans son ventre. Le déjeuner dans la salle à manger étouffante, bondée et bruyante s'est avéré être une torture. Il s'attendait à être seul, mais, comme par hasard, l'idiot Parsons s'est laissé tomber à côté de lui, l'odeur âcre de la sueur recouvrant presque l'odeur métallique du ragoût, et a commencé à parler des préparatifs de la semaine de la haine.
Il admirait particulièrement l’énorme tête de Big Brother de deux mètres en papier mâché, que l’équipe de sa fille avait confectionnée pour les vacances. Le plus énervant était qu'à cause du vacarme, Winston avait du mal à entendre Parsons.
J'ai dû demander à nouveau et écouter deux fois la même bêtise. Au fond du couloir, il aperçut une femme aux cheveux noirs assise à une table avec deux autres filles. Elle ne semblait pas le remarquer et il ne regardait plus là. La seconde moitié de la journée s'est déroulée plus facilement. Immédiatement après la pause, on m'a confié une tâche délicate et difficile - de plusieurs heures - et toutes les pensées superflues ont dû être mises de côté.
Il fallait faire semblant rapports de production il y a deux ans, de manière à jeter une ombre sur une figure majeure du parti interne tombée en disgrâce. Winston a bien fait face à un tel travail et pendant plus de deux heures, il a réussi à oublier la femme aux cheveux noirs. Mais ensuite son visage réapparut devant ses yeux, et elle voulait désespérément, insupportablement, être seule.
Tant qu'il n'est pas laissé seul, il est impossible de penser à cet événement. Aujourd'hui, il était censé être présent au centre communautaire. Il a dévoré un dîner insipide à la cafétéria, a couru dans le centre-ville, a participé à une stupide « table ronde » cérémoniale, a joué deux parties de tennis de table, a bu quelques gins et a assisté à une conférence d'une demi-heure sur « Les échecs et leur relation avec l'Ingsoc ». ".
Son âme se tordait d'ennui, mais contrairement à son habitude, il ne voulait pas s'éloigner du centre. De la couche de « Je t'aime » est né le désir de prolonger ma vie, et maintenant même un petit risque semblait stupide. Ce n'est qu'à vingt-trois heures, lorsqu'il revint et se coucha - dans le noir, même un écran de télévision ne fait pas peur si on se tait - qu'il retrouva la capacité de penser.
Il fallait résoudre un problème technique : comment la contacter et fixer un rendez-vous. Il avait déjà rejeté l’hypothèse selon laquelle la femme lui tendait un piège. Il réalisa que non : elle était définitivement inquiète lorsqu'elle lui remit le mot.
Elle ne s'est pas souvenue d'elle-même par peur - et c'est tout à fait compréhensible. Il n’avait pas dans l’idée d’échapper à ses avances. Il y a à peine cinq jours, il envisageait de lui casser la tête avec un pavé, mais c’est déjà du passé.
Il la toucha mentalement, bougea son jeune corps - comme alors dans un rêve. Mais au début, il la considérait comme une idiote comme les autres – bourrée de mensonges et de haine, aux fesses gelées. A l'idée qu'il pourrait la perdre, qu'il n'aurait pas un jeune corps blanc.
Winston se sentait fiévreux. Mais la rencontrer a été incroyablement difficile. C'est comme faire un mouvement aux échecs lorsque vous êtes échec et mat. Où que vous vous tourniez, un écran télé vous regarde de partout. Tous moyens possibles l'idée d'organiser un rendez-vous lui est venue à l'esprit cinq minutes après avoir lu la note ; maintenant, quand il avait le temps de réfléchir, il commençait à les parcourir un par un - comme s'il disposait des outils sur la table.
Évidemment, une réunion comme celle d'aujourd'hui ne peut pas être répétée. Si la femme travaillait au département de documentation, cela serait plus ou moins simple, mais dans quelle partie du bâtiment se trouvait le département de littérature, il n'en avait aucune idée. et il n'y avait aucune raison d'y aller.
S'il avait su où elle habitait et à quelle heure elle finissait de travailler, il aurait pu l'intercepter sur le chemin du retour ; Ce n'est pas prudent de la suivre - vous devez rester près du ministère et ils le remarqueront probablement. Il est impossible d'envoyer une lettre par courrier. Après tout, ce n’est un secret pour personne que tous les courriers sont ouverts.
Aujourd’hui, presque personne n’écrit de lettres. Et si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, il existe des cartes postales sur lesquelles sont imprimées des phrases toutes faites, et vous rayez simplement celles qui sont inutiles. Oui, il ne connaît même pas son nom de famille, encore moins son adresse. Finalement, il a décidé que le meilleur endroit serait la salle à manger.
S'il pouvait s'asseoir avec elle quand elle était seule, et que la table était au milieu de la pièce, pas trop près des écrans de télévision, et que la pièce était suffisamment bruyante... s'ils étaient autorisés à être seuls pendant au moins trente secondes, alors peut-être qu'il pourrait la joindre en quelques mots.
Toute la semaine suivante, sa vie fut comme un rêve agité. Le lendemain, une femme apparut dans la salle à manger alors qu'il partait déjà après le coup de sifflet. Elle a probablement été transférée à un poste ultérieur. Ils se séparèrent sans se regarder. Le lendemain, elle déjeunait à heure habituelle, mais avec trois autres femmes et juste sous le télécran.
Ensuite, il y a eu trois jours terribles - elle n'est pas apparue du tout. Son esprit et son corps semblaient acquérir une sensibilité, une perméabilité insupportable, et chaque mouvement, chaque son, chaque contact, chaque mot entendu et prononcé se transformait en torture. Même au printemps, il ne pouvait pas se débarrasser de son image. Ces jours-ci, il ne touchait pas au journal. Seul le travail apportait un soulagement - grâce à lui, il pouvait parfois se perdre pendant dix minutes. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé.
Il n’y avait aucun endroit où demander. Peut-être qu'elle a été aspergée, peut-être qu'elle s'est suicidée, elle aurait pu être transférée de l'autre côté de l'Océanie : mais le plus probable et le pire est qu'elle a simplement changé d'avis et décidé de l'éviter. Le quatrième jour, elle apparut. Le bras n’était pas en écharpe, juste un bandage autour du poignet. Il se sentit tellement soulagé qu'il ne put s'empêcher de la regarder quelques secondes.
Le lendemain, il réussit presque à lui parler. Lorsqu'il entra dans la salle à manger, elle était assise seule et assez loin du mur. Il était tôt, la salle à manger n'était pas encore pleine. La file d'attente a avancé, Winston était presque au point de distribution, mais ensuite il est resté coincé pendant deux minutes : quelqu'un devant se plaignait de ne pas avoir reçu de comprimé de saccharine.
Cependant, lorsque Winston reçut son plateau et se dirigea vers elle, elle était toujours seule. Il marchait en regardant au-dessus de lui, comme s'il cherchait un espace libre derrière sa table. Elle est déjà à trois mètres, encore deux secondes et il atteint la cible. Derrière lui, quelqu'un a appelé : « Smith ! Il a fait semblant de ne pas entendre. "Forgeron!" - ils l'ont répété encore plus fort par derrière. Non, vous ne pouvez pas vous en sortir.
Il se retourna. Un jeune homme blond au visage stupide, du nom de famille Wilshere, qu'il connaissait à peine, sourit et invita une place libre à sa table. Il n’était pas prudent de refuser. Après avoir été reconnu, il ne pouvait plus s'asseoir avec une femme qui dînait seule.
Cela attirerait l'attention. Il s'assit avec un sourire amical. Le visage stupide rayonna en retour. Il s'imaginait le frapper avec une pioche, en plein milieu. Quelques minutes plus tard, la femme avait aussi un voisin, mais elle l'a probablement vu venir vers elle - et peut-être a-t-elle compris. Le lendemain, il essaya de venir plus tôt. Et en vain : elle était assise à peu près au même endroit et encore seule.
En ligne devant lui se tenait un petit homme agile, ressemblant à un scarabée, au visage plat et aux yeux méfiants. Lorsque Winston se détourna du comptoir avec le plateau, il vit la petite se diriger vers sa table. Son espoir s'est à nouveau évanoui. Il y avait une place libre à la table plus éloignée, mais l’attitude du petit indiquait qu’il veillerait à sa discrétion et choisirait la table avec le moins de monde.
Le cœur lourd, Winston se plaça derrière la nounou. Tant qu'il ne sera pas seul avec elle, rien ne fonctionnera. Puis il y eut un terrible rugissement. Le petit se tenait à quatre pattes, son plateau volait toujours et deux ruisseaux coulaient sur le sol - de la soupe et du café. Il se leva d'un bond et regarda autour de lui avec colère, soupçonnant apparemment que Winston l'avait fait trébucher.
Mais cela n'avait pas d'importance. Cinq secondes plus tard, Winston était assis à son bureau, le cœur battant. Il ne la regardait pas. Il vida le plateau et commença immédiatement à manger. Il était important de parler tout de suite : personne ne s'est approché du prêtre, mais Winston a été pris d'une peur sauvage.
Une semaine s'est écoulée depuis la première réunion. Elle pourrait changer d’avis, elle l’a probablement fait ! Rien ne sortira de cette histoire – cela n’arrive pas dans la vie. Peut-être n'aurait-il pas osé parler s'il n'avait pas vu Ampfort, le poète aux oreilles de laine, qui traînait avec un plateau, cherchant du regard une place libre. Ampleforth, distrait, était à sa manière attaché à Winston et, s'il l'avait remarqué, il serait probablement devenu accro.
Il ne restait plus qu'une minute pour tout. Winston et la femme ont travaillé dur. Ils ont mangé un mince ragoût – plus comme une soupe aux haricots. Winston parla à voix basse. Tous deux ne levèrent pas les yeux : ramassant avec mesure le ragoût et le mettant dans leur bouche, ils échangèrent tranquillement et sans aucune expression quelques mots nécessaires.
Quand est-ce que tu termines ton travail?
À dix-huit heures trente.
Où peut-on se rencontrer?
Sur la Place de la Victoire, près du monument.
Il y a des écrans télé partout.
Si vous êtes dans une foule, cela n'a pas d'importance.
Non. Ne venez pas avant de me voir au milieu des gens. Et pas
Regardez-moi. Soyez simplement à proximité.
À quelle heure?
A dix-neuf ans.
Ampleforth ne remarqua pas Winston et s'assit à une autre table. La femme termina rapidement son déjeuner et partit, laissant Winston fumer. Ils ne se parlaient plus et, dans la mesure du possible pour deux personnes assises face à face en face de la table, ne se regardaient pas. Winston est arrivé à Victory Square en avance. Il erra autour de la base d'une immense colonne rainurée, du haut de laquelle la statue de Big Brother regardait vers le sud du ciel, là où, dans la bataille pour la piste, il vainquit l'aviation eurasienne (quelques années il y a peu, c'était oriental). En face, dans la rue, se trouvait une statue équestre censée représenter Oliver Cromwell.
Cinq minutes se sont écoulées « après l'heure fixée, et la femme n'était toujours pas là. Une peur sauvage a de nouveau attaqué Winston. Elle n'y va pas, elle a changé d'avis ! Saint Martin, celui dont les cloches - quand il y en avait des cloches - on criait : "Donnez-moi un sou".
Puis j'ai vu une femme : elle se tenait sous le monument et lisait, ou faisait semblant de lire, une affiche enroulée en spirale autour de la colonne. Même si personne n'était rassemblé là-bas, il était risqué de s'approcher. Ils se tenaient autour du piédestal. téléécrans. Mais soudain, quelque part le long du sentier, des gens ont commencé à faire du bruit et le rugissement de machines lourdes s'est fait entendre. Tout le monde sur la place s’est précipité dans cette direction. La femme contourna rapidement les lions au pied de la colonne et courut également. Winston se précipita après lui. Alors qu'il courait, il réalisa aux cris qu'ils transportaient des Eurasiens capturés.
La partie sud de la place était déjà bondée. Winston, qui appartenait à cette race de personnes qui ont tendance à se retrouver à la limite dans n'importe quelle mêlée, coincé, pressé, s'est frayé un chemin jusqu'au cœur du peuple. La femme était déjà proche - on pouvait l'atteindre avec la main. - mais ici, avec un mur de viande vierge, son chemin était bloqué par une immense famille et une femme tout aussi immense - apparemment sa femme.
Winston se tourna et passa son épaule entre eux de toutes ses forces. Il lui semblait que deux côtés musclés allaient écraser ses entrailles en bouillie, mais néanmoins il s'en sortit en transpirant légèrement. Je me suis retrouvé à côté d'elle. Ils se tenaient côte à côte et regardaient devant eux, le regard immobile. Les camions formaient une longue file dans la rue et les mitrailleurs se tenaient à l'arrière aux quatre coins, le visage figé.
De petits personnages jaunes en uniformes verts en lambeaux étaient accroupis entre eux. Leurs visages mongols regardaient tristement et sans intérêt. Si le camion était projeté, il y avait un bruit de métal - les prisonniers étaient enchaînés aux jambes.
Les uns après les autres, des camions avec des gens tristes passaient. Winston les entendait conduire, mais ne les voyait qu'occasionnellement. L'épaule de la femme, sa main appuyée contre son épaule et son bras. La joue était si proche qu'il en sentait la chaleur. Elle a immédiatement pris les devants, comme en salle à manger. Elle parlait, remuant à peine les lèvres, de la même voix inexpressive qu'alors, et ce demi-murmure fut noyé dans le vacarme général et le grognement des camions.
Vous m'entendez?
Pouvez-vous venir dimanche ?
Alors écoutez attentivement. Vous devez vous rappeler.
Aller à la gare de Paddington... Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle décrivit l'itinéraire : Une demi-heure en train : depuis la gare - à gauche ; deux kilomètres le long de la route, un portail sans barre transversale : un chemin à travers un champ ; un chemin sous les arbres, envahi par l'herbe ; chemin dans la brousse : arbre moussu tombé. C'était comme si elle avait une carte en tête.
Vous souvenez-vous de tout ? - elle a finalement murmuré.
Tournez à gauche, puis à droite et encore à gauche. Et à la porte
pas de barre transversale.
Oui. Temps?
Une quinzaine environ. Vous devrez peut-être attendre. J'y arriverai par un autre itinéraire. Êtes-vous sûr de vous souvenir de tout ?
Alors partez vite.
Il n’y avait pas besoin de ces mots. Mais la foule ne nous a pas permis de nous disperser. La colonne a continué à avancer, les gens nous regardaient insatiablement. Au début, il y eut des cris des ismets, mais seuls les membres du parti firent du bruit, et bientôt ils se turent. Le sentiment dominant était la simple curiosité. Les étrangers – qu’ils viennent d’Eurasie ou d’Estasie – ressemblaient à d’étranges animaux. Vous ne les avez jamais vus – seulement comme prisonniers de guerre, et seulement brièvement.
Leur sort était également inconnu – à l’exception de ceux qui ont été pendus comme criminels de guerre ; le reste a tout simplement disparu – vraisemblablement dans des camps de travaux forcés. Les visages ronds des Mongols ont été remplacés par des visages plus européens, sales, mal rasés, épuisés.
Parfois, son visage envahi par la végétation fixait un regard inhabituellement intense sur Winston, et il passait immédiatement à autre chose. La colonne touchait à sa fin. Dans le dernier camion, Winston aperçut un homme âgé, couvert d'une barbe grise jusqu'aux yeux : il se tenait debout, les bras croisés devant le ventre, comme s'il était habitué à ce qu'ils soient enchaînés.
Il était temps de s'éloigner de la femme. Mais au dernier moment, alors que la foule les serrait encore, elle trouva sa main et la serra doucement. Cela dura moins de dix secondes, mais il lui sembla qu’ils se tenaient la main pendant très, très longtemps. Winston a réussi à étudier sa main dans les moindres détails. Il toucha les doigts longs, les ongles allongés, la paume durcie et calleuse, la peau délicate du poignet.
Il étudiait tellement cette main au toucher qu'il la reconnaîtrait désormais de vue. Il lui vint à l'esprit qu'il n'avait pas remarqué la couleur de ses yeux. Probablement brun, bien que les personnes aux cheveux noirs en aient aussi des bleues. Tourner la tête et la regarder serait une extrême imprudence.
Pressés l'un par l'autre par la foule, se tenant tranquillement la main, ils regardèrent droit devant eux, et non pas ses yeux, mais les yeux du vieux captif, fixant tristement Winston depuis le fourré de cheveux emmêlés.
Qu’est-ce que l’Afrique apporte au monde ? Seulement le SIDA. Auteur - Kevin Myers