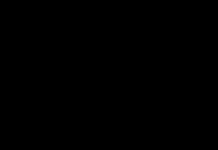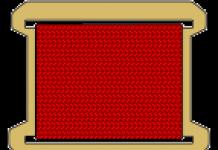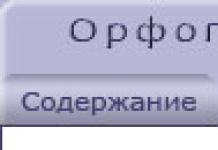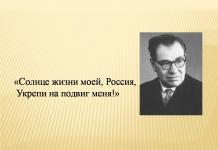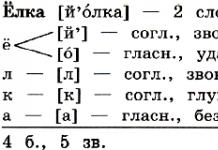"Poème sans héros" d'Anna Akhmatova
LA TÉLÉ. Tsivian
(quelques résultats de l'étude en lien avec le problème du « lecteur de texte »)
Donc, ce n'est pas la poésie qui est immobile, mais le lecteur ne suit pas le poète », a écrit Akhmatova dans l'article « L'invité de pierre » de Pouchkine, et, comme toujours, il faut voir ici une indication de sa propre relation avec le lecteur. La construction même de ce passage aphoristique contient ces "changements" d'Akhmatova, à première vue presque imperceptibles - dans le sens, la logique, la grammaire - qui s'avèrent presque un impératif pour une vision fondamentalement nouvelle de l'objet. Mais cela ne se révèle qu'avec une lecture et une interprétation attentives. L'opposition sous la forme sous laquelle elle est présentée par Akhmatova semble presque oxymoronique : non pas X n'est pas immobile, mais Y ne peut pas le rattraper, ou non X est immobile, mais Y est Le moyen le plus simple d'amener cette construction au niveau de la logique généralement admise est de supprimer deux négatifs dans la poésie (« la poésie n'est pas immobile ») : la poésie est mobile, et c'est précisément grâce à cette propriété que la différence en vitesse surgit à laquelle le lecteur se retrouve en retard.
Mais ce serait une solution trop facile, car elle supprime l'opposition poésie/poète et lecteur sur la base d'un mouvement ambivalent par rapport à la poésie. Par essence, la mobilité/immobilité de la poésie ne peut être définie sans ambiguïté : elle est comme un point à l'horizon, vers lequel le lecteur se précipite pour atteindre et qui, à mesure qu'il s'en approche, s'éloigne, restant finalement inaccessible. Une autre métaphore de ce « rapprochement mutuel » ou mouvement illusoire peut être donnée : la situation du pont (cf. l'importance de ce symbole pour Akhmatova, notamment à propos du « Poème sans héros ») : si vous vous tenez sur le pont «à contre-courant» et observez comment la rivière se déplace, puis très vite, on a le sentiment que la rivière est immobile et que le pont bouge (ou que toute la ville flotte le long de la Neva, ou à contre-courant). Ainsi, dans cette pensée d'Akhmatova, tant la complexité du concept de mouvement en lien avec sa relativité fondamentale que la projection de ce concept sur l'espace d'un texte poétique, dans lequel son auteur et son destinataire cohabitent dans un mouvement mutuel, peuvent être prises en compte. crypté.
La tâche du « lecteur akhmatovien » est, sinon de suivre le poète, du moins de suivre ses traces, les repères qu'il laisse. Il convient maintenant de résumer ce mouvement. Il convient de souligner que dans ce cas, nous ne parlons pas de résultats au sens étroit du terme, c'est-à-dire de ce qui a été mis en œuvre et de ce qui a été publié dans de nombreux (fin 1989, année « Akhmatov » et d'innombrables) monographies, articles, publications, commentaires, mémoires, etc. Aussi étrange que cela puisse paraître, ici les « résultats » se dispensent non seulement de bibliographie, mais aussi sans les noms de ceux qui ont contribué à Akhmatoviana - et cet anonymat est tout à fait conscient. Cela ne s'explique pas par une réticence à établir une hiérarchie et ainsi, volontairement ou involontairement, à donner des appréciations (ou plutôt, pas seulement). Pour nous, il était plus important de montrer que la formation du « lecteur-chercheur d'Akhmatova » s'est déroulée selon la « méthodologie » précisée par le texte d'Akhmatova, que le chemin a été tracé selon ses instructions, pour la plupart cachées, sous la forme d'indices, et même déroutants.
Nos propres études de poèmes remontent au début des années 1960 ; le nombre de personnes partageant les mêmes idées avec lesquelles étaient discutées les approches de ce que l'on appelle aujourd'hui le « déchiffrement » était alors faible. Mais plus tôt, et en même temps, et plus tard, d'autres se sont également tournés vers le « Poème » : celui-ci, comme dans un entonnoir, a attiré dans son étude, son interprétation, sa participation un cercle toujours plus large d'« adeptes » qui étaient unis par une chose : consciemment ou instinctivement, mais ils ont suivi le chemin tracé par Akhmatova spécifiquement pour le « Poème », c'est-à-dire qu'ils ont accompli les « tâches » fixées par elle (l'Auteur/Héroïne, le « Poème » lui-même). Malgré tous les écarts, ce chemin s’est finalement avéré être le même. Par conséquent, ce que nous savons maintenant du « Poème » (ou ce qu'il nous a appris), ce que nous continuons à apprendre, ce que nous apprenons encore dans le processus de recherche sans fin du « Poème » - tout cela est, pour ainsi dire, le résultat de la créativité commune de ses « étudiants ». Bien sûr, parmi eux il y avait et il y a encore « les premiers disciples ».
Il nous a semblé plus important de tenter de pénétrer le mécanisme autosuffisant du « Poème », qui active les possibilités de son chercheur. Nous essayons de reconstruire, dans les termes les plus généraux, l'histoire de la manière dont le Poème choisit son lecteur et l'éduque, tout en poursuivant ses propres objectifs. Ces objectifs ont maintenant émergé des résultats ; les résultats, à leur tour, appellent à une étude plus approfondie du « Poème », et l’ensemble du processus s’avère être perpétuellement mobile.
L'approche du « Poème » a commencé avec le fait que, avec beaucoup de questions, de perplexités et d'incertitudes, il est devenu immédiatement clair : « Un poème sans héros » est une expérience radicale de transformation du genre du poème, avec lequel il est peut-être difficile de comparer quoi que ce soit dans la poésie russe du siècle dernier. Il était évident que pour un texte aussi fondamentalement nouveau, il était nécessaire de développer une méthode d'analyse particulière, dont la clé, en fin de compte, était contenue (au sens littéral, c'est-à-dire exprimée verbalement, formulée) dans le « Poème » lui-même.
Le plus difficile, surtout pour les chercheurs « expérimentés », est probablement de restaurer les débuts - alors qu'ils n'avaient à leur disposition que des publications éparses de fragments individuels du « Poème » et quelques listes. Peu à peu, au fil des décennies, de plus en plus de listes, de strophes et de vers (et pas seulement « non censurés »), de notes d'auditeurs et de lecteurs et, enfin, presque le plus important - « Prose sur le poème », contenant son (et le Méta-description automatique de l'auteur. En fait, c'est cette prose - "Lettres", "Au lieu d'une préface", les critiques de lecteurs enregistrées par Akhmatova, l'histoire et la chronologie du "Poème", et enfin sa forme complète en prose (livret de ballet) - qui jouait le rôle d'un arbitre, vérifiant une grande partie de ce qui avait été « obtenu » plus tôt, et ayant ainsi testé la voie choisie.
En d’autres termes, ce qui était implicitement contenu dans le « Poème » (principalement dans sa partie poétique) était explicitement confirmé, ce qui signifiait que le lecteur attentif en avait correctement saisi les étapes.
L'approche la plus générale et la toute première du « Poème » a été de le considérer comme un texte d'un genre particulier, fondamentalement ouvert, ayant simultanément un début et une fin et ne les ayant pas (d'une part, Akhmatova indique précisément le jour où le « Poème » lui est venu », en revanche, il est difficile de déterminer le moment où il a commencé à résonner en elle ; plusieurs fois elle a déclaré le « Poème » terminé, y revenant à chaque fois), puisque ce texte était en processus de création continue. Ici, il est difficile de dire si le texte est intériorisé dans la vie, ou si la vie est intériorisée dans le texte, et les tentatives pour l'établir n'ont absolument aucun sens. Naturellement, ces traits caractérisent le « Poème » comme un texte à la structure particulièrement complexe, comparable notamment à la structure de la pensée archétypale (le bricolage, selon la terminologie de Lévi-Strauss, c'est-à-dire un chemin indirect, le déguisement), à la musique. des structures, etc En ce sens, le passage du « Poème » dans le livret du ballet est une illustration de la possibilité inhérente d'enregistrement, un phénomène dans diverses incarnations (représentations).
L'une des caractéristiques d'une telle structure est la focalisation sur le texte, c'est-à-dire la focalisation de l'auteur sur le texte et du texte sur le texte, qui se manifeste sous au moins deux aspects : l'intertextualité et le bricolage déjà évoqué. . L'intertextualité était frappante même s'il n'y avait pas d'instructions spéciales d'Akhmatova pour la citation (principalement des autocitations). Dans "Lettre à N.N." Akhmatova a souligné le poème "Contemporain" comme un signe avant-coureur envoyé par "Poème". Il n'y avait pas de poème avec ce titre, mais à partir des vers « Toujours le plus élégant de tous, le plus rose et le plus grand de tous », reflétés dans le « Poème » (« Le plus élégant de tous et le plus grand de tous »), le poème « Shadow » était facilement reconnaissable, épigraphe du poème Vs. "L'amour est passé..." de Knyazev l'a incité à se tourner vers un recueil de ses poèmes, où une "boucle fauve" a été trouvée. Les « signes » du manuel de Blok (« cette rose noire dans un verre ») obligeaient définitivement à se tourner vers la couche de citations du « Poème », qui grandissait comme une avalanche. Cette tâche a été formulée par Akhmatova dès le début, dans la « Première Initiation » ; la recherche de la parole de quelqu'un d'autre s'est avérée chronologiquement la première dans l'analyse du « Poème » et, comme lui-même, n'a pas de fin. Le concept de citation « conciliaire » ou « fluide » a été introduit, remontant non pas à une, mais simultanément à plusieurs sources ou désignant un certain archétype de citation. Cette instabilité et cette citation à plusieurs niveaux évitent les reproches (à la fois à l'auteur et surtout aux chercheurs) de vouloir transformer le « Poème » en un centon canonique, qu'Akhmatova a écrit « couvert de livres » (bien que son appel aux sources primaires ait été confirmé ensuite par les mémoires). Le sens du centon était d’attirer l’attention du lecteur sur un certain fond, une deuxième étape constamment audible.
La saturation du "Poème" avec la parole de quelqu'un d'autre, semble-t-il, sert d'indication à la recherche de héros prototypes, d'autant plus qu'Akhmatova répète avec insistance que l'intrigue est basée sur un événement réel, bien connu des contemporains. Cependant, une attention plus particulière révèle que la parole de quelqu’un d’autre ne mène pas tant à des prototypes qu’à la couche métapoétique du « Poème », qui prévaut presque sur l’intrigue. Dans un certain sens, la base du « Poème » est la manière simple d'écrire, une fois formulée par Mandelstam : « C'est effrayant de penser que notre vie est une histoire sans intrigue et sans héros, faite de vide et de verre, du bavardage chaud de quelques digressions, du délire grippal de Saint-Pétersbourg "1. Dans l'article «Attack», Mandelstam parle du rôle du lecteur (un lecteur qui comprend ce rôle et l'assume consciemment) dans la maîtrise de ce type de texte: «... l'écriture poétique représente dans une large mesure un grand écart, une absence béante de nombreux signes, icônes, indicateurs, implicites, qui seuls rendent le texte compréhensible et logique ; tous ces symboles sont placés par le lecteur poétiquement lettré tout seul, comme s'il les extrayait du texte lui-même" (mes italiques - T .Ts.)2.
Dans la poétique d’Akhmatova, ces déviations, excroissances, perforations et absentéisme deviennent les techniques constructives les plus importantes. Le « Poème » lui-même n'est-il pas une digression complète ? Il est assez difficile d'isoler l'intrigue elle-même (le triangle amoureux), et il s'avère que très peu d'espace texte lui est alloué. En général, dans le « Poème », tout semble tourner autour du pot : au lieu d'une préface. Trois dédicaces, Introduction, Interlude, Postface, Intermezzo, Épilogue, Notes, épigraphes nombreuses (et variées), strophes manquantes (errance), dates, notes de bas de page, remarques en prose, Prose sur le Poème remplissent son espace, dissolvant en elle-même ce qu'il y a dedans. d'autres traditions ne sont pas seulement la base, mais aussi une condition nécessaire de ce genre (et l'innovation d'Akhmatova se manifeste principalement en cela ; ou plutôt, cette technique est le début sur lequel s'enroulent bien d'autres choses, sortant le « Poème » du cadre du genre).
Les approches et les retraits, en particulier les digressions, se révèlent être le cadre méonal sur lequel repose, comme sur l'air, ce qui n'est pas déterminé essentiellement, non « matériellement », mais seulement par des configurations changeantes dans les parties auxiliaires du « Poème ». » Description directe est remplacé par zéro, apophatique, ombre, renversé (miroir), etc. Ceci est mieux (comme toujours) formulé par Akhmatova elle-même (à propos de son portrait par Modigliani) : « ... m'a dit quelque chose à propos de ce portrait que je ne peux « ni souviens-toi et n’oublie pas », comme disait un poète célèbre à propos de quelque chose de complètement différent. » Ou (dans « Prose sur le poème ») : « ...celui qui est mentionné dans son titre et que la police secrète stalinienne recherchait si avidement n'est vraiment pas dans le « Poème », mais beaucoup repose sur son absence. .»
L'un des résultats de ce type de description méonale est la création d'une incertitude sémantique, d'une ambivalence : des éléments d'un texte poétique flottent dans l'espace sémantique comme s'ils étaient suspendus, n'étant pas attachés à un point, c'est-à-dire n'ayant pas de caractéristique sémantique univoque. Entre les éléments du texte apparaît un espace sémantique clairsemé, dans lequel les connexions sémantiques habituelles et automatiques s'affaiblissent. L'auteur construit l'espace sémantique du texte avec le plus haut degré de liberté. C'est là que surgit la notion de double - non pas un double, mais des doubles, multipliant les réflexions sans fin - mais de qui ? ou quoi? Le point de départ est l’Auteur en tant que créateur du texte, en tant que démiurge au sens mythologique du terme, mais non en tant que modèle auquel les autres s’orientent (ou « ressemblent »). En ce sens, la question de la « similarité » des doubles est supprimée, et le but est vu dans autre chose : dans l’unification transcendantale de toute la diversité du monde. Le double de l’Auteur s’avère être non seulement l’Héroïne (« Tu es un de mes doubles »), mais aussi la Ville (« Notre séparation est imaginaire, / Je suis inséparable de toi ») ; "Où suis-je et où est seulement l'ombre" - c'est entre autres "Mon ombre sur vos murs..."
L'atmosphère d'incertitude qui règne dans le « Poème » est si enveloppante que la question ne peut que se poser : faut-il chercher des prototypes dans ce cas ? Comme si tout ce qui précède indiquait que cela était totalement inutile, qu’au contraire cela constituerait une violation de la technique. De plus, la recherche de prototypes ou de réalités dans la littérature, en particulier dans une œuvre poétique, va généralement au-delà de l'analyse directe du texte pour devenir un commentaire littéraire et historique (biographique) ; soulignant ainsi ["l'optionnalité". En effet, le pouvoir oeuvre d'art et la garantie de sa longue durée de vie dans le temps et dans l'espace est qu'elle reste significative, égale à elle-même, même lorsque ses réalités s'avèrent oubliées et irrécupérables. En fait, Akhmatova en parle aussi, refusant d'expliquer le "Poème" et se laissant guider par le bon exemple: "Il pisse, pisse".
Cependant, dans la sémantique complexe et « inversée » du « Poème », cette affirmation est réfutée par l'Auteur lui-même - et de telle manière qu'on peut y voir une incitation, une indication, et non une interdiction de chercher des secrets cachés. significations. Doutant de la perspicacité du lecteur ou réalisant que pour ce « Poème », le lecteur a besoin d'être instruit et « créé » (est-ce de là que vient l'accent mis sur l'aide-lutte constante du lecteur, c'est-à-dire sa coopération avec l'auteur ?), Akhmatova introduit une partie spéciale du « Poème » - « Queues » « qui est une sorte de guide », aide pédagogique" pour le lecteur : il contient à la fois des instructions pour surmonter les malentendus et des incitations persistantes à la recherche. Et là encore, il faut dire que les panneaux de signalisation ont été correctement identifiés - et pas seulement dans l'essentiel, mais aussi dans les détails. Il a déjà On a dit que lorsque les recherches ont commencé, elles ont commencé, selon raisons diverses, pratiquement à partir de zéro. Mais lorsque des fragments de « Prose sur le poème » sont devenus connus (disponibles), et surtout le livret du ballet, il s'est avéré que la collaboration entre l'auteur et le lecteur-chercheur était fructueuse.
Cependant, ce n’était que la première couche du « Poème ». Après que sa base réelle ait été restaurée (et établie), il s'est avéré que « en fait » tout n'était pas pareil ou pas, ou, en tout cas, pas tout à fait pareil et pas tout à fait vrai. Les « interdits » que nous venons de définir comme des instructions cachées ont acquis leur sens direct en mettant en garde contre le littéralisme. Un certain rôle dans la perception trop littérale du « Poème » a été joué par sa magie, entraînant le lecteur dans son tourbillon. À bien y réfléchir, était-il possible d’exiger de l’œuvre poétique la plus complexe qu’elle soit en même temps une chronique précise ? Comment a pu naître l’illusion que les réalités entrées dans le « Poème » n’ont pas été transformées par la volonté de l’Auteur ?
Alors, la recherche du chiffre (sous la direction d'Akhmatova) a-t-elle conduit au décryptage, notamment à l'établissement sans ambiguïté de prototypes ? Dans cette compréhension, il n’y a pas de décryptage. De plus, il s'est avéré que les chercheurs n'ont pas pu dépasser les limites fixées par Akhmatova : les chiffres qu'elle a jugé possible de nommer ont été confirmés ; d'autres sont restés méconnus - conjecturaux ou « conciliaires ». La persistance des nombres magiques - la deuxième marche, le double ou triple fond de la boîte, les troisième, septième et vingt-neuvième significations, etc. font comprendre qu'un jeu très complexe se joue avec le lecteur-élève, lecteur -chercheur. En particulier, les réfutations - il n'est pas nécessaire de chercher tel ou tel - sont essentiellement l'introduction de nouveaux noms, élargissant les limites du texte. Ce n'est pas seulement un "Poème sans héros", c'est un Poème sans héros, et en même temps il y a trop de non-héros de ce genre ! (la technique est loin d'être anodine). Ainsi, l'intentionnalité du « Poème » est absolue, tous les détails sont élaborés, tous s'adressent au lecteur. Ceci, bien entendu, ne réfute en rien la spontanéité du « Poème », qui a guidé l'Auteur et l'a sauvé, c'est-à-dire qu'il a joué le même rôle démiurgique par rapport à l'Auteur.
Ici, on ne peut s'empêcher de penser aux objectifs fixés par Akhmatova, en les formulant très clairement dans le même « Poème ». Ce sont avant tout des objectifs « littéraires », qui ont déjà été évoqués : percer dans le genre stagnant du poème russe, créer quelque chose de fondamentalement nouveau, souligner la dissemblance avec le précédent et la dissemblance avec soi-même, mais en même temps, « continuité de soi », c’est-à-dire identité avec soi-même. En ce sens, « je suis le plus silencieux, je suis simple » est une pure plaisanterie.
Avec Akhmatova, il faut être constamment sur ses gardes. Et les critiques de lecteurs qu'elle cite, et l'irritation face à leur incompréhension (cf. « La Deuxième Lettre », où l'on reproche au lecteur d'être trop crédule, de se laisser égarer par de fausses instructions) - tout conduit à la même chose : la recherche d'une intrigue, il est plus fiable de retracer des prototypes au moyen du texte lui-même (dans le cadre de l'intertextualité) que sur la base de mémoires - et pas seulement parce que par rapport aux mémoires le critère de fiabilité/ le manque de fiabilité est toujours pertinent. L’objectif d’Akhmatova n’était pas de décrire un certain événement survenu dans son entourage, mais de recréer le côté littéraire et artistique d’une certaine période historique avec ses réalités purement significatives et symboliques.
Akhmatova « obligée » de mener des recherches historiques, culturelles, littéraires, théâtrales, musicologiques et autres afin de restaurer le style hoffmannien de Saint-Pétersbourg et son rôle dans le contexte de la période tragique de l'histoire russe. Les détails dispersés dans le « Poème » se sont avérés être les fils qui ont tiré des couches entières. Qui sait, cette partie de la Hoffmaniana de Saint-Pétersbourg associée à "Stray Dog" aurait été révélée si Akhmatova ne l'avait pas rappelé ("Nous sommes dans "Le Chien""), en prenant soin de donner un commentaire explicatif à cette mention, puisqu'elle imaginait sobrement que les nouvelles générations de lecteurs avaient besoin de tels commentaires. Ainsi, on peut définir deux tâches du « Poème », qui sont plus que significatives : 1) réformer le genre du poème ; 2) restaurer le « Pétersbourg des années 10 ».
Cependant, malgré l'importance de ces tâches, Akhmatova ne pouvait s'y limiter. Laissant de côté l’expérimentation du genre, on pourrait dire qu’au-delà de ses frontières restait un voyage sentimental ou romantique, conçu sur des tons passistes. Nous ne devons pas oublier l'époque où cela a été écrit, les circonstances biographiques d'Akhmatova elle-même, la vie dans laquelle les principales catégories d'existence étaient la mémoire et la conscience, la seule chose qui pouvait résister au chaos et au royaume de Cham. Akhmatova a des déclarations poétiques directes sur cette époque, et surtout sur « Requiem ». « Poème » est un lien de connexion, une garantie de préserver l'Homme égal à lui-même et un interdit de l'oubli. «C'est moi, votre vieille conscience, / qui ai trouvé l'histoire brûlée» - les lignes représentent pour ainsi dire la devise du «Poème». Dès lors, son moralisme et, en particulier, ses polémiques avec celui qui, par des guillemets indirects, est identifié comme Kuzmin (mais ne s'identifie pas sans ambiguïté à lui), n'appartient pas au genre des polémiques littéraires. Le personnage devenu la personnification de la « mémoire », celui pour qui « rien n’était sacré », apporte en lui la destruction. La tâche du « Poème », et en même temps la plus importante, n’est pas seulement de résister à cette destruction, mais de devenir un médiastin, un lien et un espoir de restauration.
Et parallèlement à ces nobles objectifs, Akhmatova (ou le Poème) a créé son lecteur-chercheur, qui s'est révélé être un guide exemplaire de la structure du texte (ou un domaine exemplaire pour le développement et l'application du concept d'intertextualité). Quelle était la méthode d’enseignement, le niveau didactique du « Poème » ?
Il semble qu'il faille chercher la clé dans la combinaison des deux pôles du « Poème » : la spontanéité (« Poème » écrit sous dictée, l'Auteur est un appareil qui capte quelque chose) et l'intentionnalité. Dans ce dernier cas, on revient encore au bricolage, c'est-à-dire à la voie indirecte. Tout comme dans le modèle archétypal du monde, le bricolage est le moyen principal et le plus efficace d'enseigner l'orientation dans le monde, le développement humain dans l'espace et l'exploration humaine de l'espace, de même dans le « Poème », le bricolage s'avère être non seulement le principal une technique constructive (et, bien sûr, un moyen artistique), mais aussi la manière la plus efficace d'apprendre.
« Un poème sans héros » d'Anna Akhmatova est un exemple de la façon dont un texte éduque le lecteur, assume un chercheur en lecteur, l'oblige à travailler et en même temps lui fixe des limites, mais de telle manière qu'il s'efforce pour les dépasser. En nous tournant encore et encore vers le « Poème », nous restons simultanément au même endroit et suivons un chemin sans fin, en essayant de « suivre le rythme de l’auteur ».
Bibliographie
1. Mandelstam O. Timbre égyptien // Collection Mandelstam O.. cit. : En 4 volumes M., 1991. T. 2 : Prose. P. 40.
2. Idem. pp. 230-231.
Pour préparer ce travail, des matériaux ont été utilisés du site Web http://www.akhmatova.org/
Littérature Âge d'argentétait imprégné du sentiment douloureux d’une catastrophe imminente. Cela a été facilité par la frontière même de l'époque, marquée par des changements dans le sol social et moral. A. Akhmatova a rappelé plus tard qu'elle n'avait cessé d'entendre un certain « grondement souterrain » au cours de ces années-là. Les paroles d'Akhmatova transmettaient - indirectement, à travers les intrigues de drames personnels, mais de manière tout à fait adéquate - ce formidable « bruit du temps » (O. Mandelstam), qui accompagnait le glissement rapide dans l'abîme de tout le monde familier. Le sentiment d'extrême fragilité est resté à jamais dans l'esprit, la poésie et le comportement d'A. Akhmatova - beaucoup ont noté sa désormais célèbre démarche incertaine, qui contrastait tant avec la flexibilité presque acrobatique de la « belle de la treizième année ».
Nos experts peuvent vérifier votre dissertation selon les critères de l'examen d'État unifié
Experts du site Kritika24.ru
Enseignants d'écoles de premier plan et experts actuels du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie.
Le monde, ébranlé dans sa jeunesse et sa prime jeunesse, évoquait dans sa poésie une certaine imagerie, presque toujours tragique, et dans « Poème sans héros », un carnaval grotesque, une mascarade, sinistrement semblable à un carrousel, illuminé par des reflets infernaux et sonné soit par une mélodie funèbre ou par le grincement distinct des dames de nage dans les mains de Charon.
A. Akhmatova est revenue à sa patrie « historique » - comme on dit maintenant -, c'est-à-dire à l'âge d'argent, en mémoire et en paroles, près de trois décennies plus tard, afin de la recréer d'une manière nouvelle, depuis les hauteurs d'une autre époque. et déjà panoramiquement Témoin et Juge.
Naturellement, après avoir mis en scène la quasi-totalité du panthéon symboliste, ou, plus précisément, les figures caractéristiques et familières qui lui sont caractéristiques, A. Akhmatova a eu recours à des techniques et à un langage familiers à chacun des personnagesère. Elle décrit l'époque dans sa langue. Le paradoxe réside cependant dans le fait que ce langage n’appartient pas entièrement à l’auteur, qui est visiblement éloigné de la réunion fantomatique du cimetière et qui pourrait bien se retrouver dans le Staro-Fedoseev de Leonov. On sait cependant qu'A. Akhmatova aimait se séparer du symbolisme, affirmant dans sa vieillesse (et de manière démonstrative) qu'elle était acméiste. Et en effet, un trait clair et une objectivité solide sont clairement visibles dans la sphère fluide, scintillante et, semble-t-il, complètement symboliste du Poème.
« Un poème sans héros » est empreint d’une prémonition de la Fin et de motifs eschatologiques évidents. Cependant, on peut en dire autant des paroles de A. Akhmatova des années 10, qui a composé "Evening", "Rosary", "White Flock".
Une autre chose est que A. Akhmatova, parmi les gens qui l'entouraient, avait une volonté et un courage extraordinaires.
Une partie de l’intelligentsia littéraire du début du siècle dernier a ressenti et interprété son époque comme catastrophique. Ce sentiment était complètement inclus dans la poésie de l’époque d’A. Akhmatova, puis, trois décennies plus tard, il a été ressuscité dans « Poème sans héros », mais rétrospectivement, avec une compréhension de la signification historique de l’époque passée.
Cependant, à en juger par le poème et d'autres choses, en particulier le poème funéraire « Le chemin de toute la terre », « Requiem », « Shards » et les paroles ultérieures, cette époque s'est avérée être une époque qui n'avait pas non plus été surmontée psychologiquement. ou artistiquement. Au sens créatif, c'est-à-dire dans l'image, dans le mot, dans l'intonation, A. Akhmatova, apparemment, ne pouvait s'empêcher d'entendre des voix « d'un autre monde », apparemment « surmontées du symbolisme » depuis longtemps. A. Akhmatova a écrit le Poème au milieu du siècle et a donc pu aborder l'époque précédente de manière analytique. Elle agit désormais comme un témoin devant un tribunal de l’histoire et de la mémoire. Selon la remarque juste de K. Chukovsky, des éléments de « peinture historique » apparaissent dans son Poème, ce qui implique une certaine objectivité et une sorte d'équilibre épique. Le témoignage de A. Akhmatova est cependant loin du calme du chroniqueur des temps passés. Elle est non seulement témoin, mais aussi juge. C’est cet aspect du Poème, c’est-à-dire la condamnation de l’époque et de son ancien environnement, qui a provoqué un rejet catégorique de la part de ses pairs survivants de l’âge d’argent. On a accordé moins d'attention au fait qu'A. Akhmatova, tout en exposant ses contemporains, se juge avec eux.
La longue ombre oblique projetée par le début du siècle sur tout le siècle traverse également le poème. Dans Reshka et l'épilogue, A. Akhmatova se révèle être non seulement un témoin et un juge, mais aussi une victime tragique du présent, née dans les premières décennies du siècle. Dans une certaine mesure, il s’agit d’un sacrifice expiatoire. Par la mort de son mari, la prison de son fils et sa propre humiliation, elle a été rachetée, sortie de son ancienne appartenance à l'époque « épicée » et « masquée ». Dans les premières paroles et en partie dans le poème, une catastrophe signifiait l’effondrement de tout un monde social, entraînant avec lui toute l’ancienne Russie. Et pourtant cette catastrophe, bien qu’énorme, restait, à un coup d’œil ultérieur, relativement locale : elle ne concernait pas l’existence de l’humanité toute entière. C’est pourquoi A. Akhmatova le juge comme « localement », étant clairement déjà dans une autre dimension historique, non moins désastreuse, mais encore éloignée de cet abîme précédent pendant des décennies entières.
Akhmatova sans gloss Fokin Pavel Evgenievich
"Poème sans héros"
"Poème sans héros"
Anna Andreïevna Akhmatova :
Il est impossible de déterminer quand cela a commencé à résonner en moi. Soit cela s'est produit lorsque je me trouvais avec mon compagnon sur la Nevski (après la répétition générale de "Mascarade" le 25 février 1917) et que la cavalerie se précipitait sur le trottoir comme de la lave, soit... lorsque je me trouvais sans mon compagnon sur la Liteiny Pont, dans<то время>lorsqu'il fut brusquement séparé en plein jour (cas sans précédent) pour permettre aux destroyers de passer vers Smolny pour soutenir les bolcheviks (25 octobre 1917). Qui sait?!<…>
... J'ai tout de suite entendu et vu tout cela - ce que c'est aujourd'hui (sauf la guerre, bien sûr), mais il a fallu vingt ans pour que le poème entier se développe à partir de la première ébauche.
Pendant des mois, des années, elle s’est fermée hermétiquement, je l’ai oubliée, je ne l’aimais pas, j’ai lutté intérieurement avec elle. Travailler dessus (quand elle m'a laissé m'approcher d'elle) était comme développer un disque. Tout le monde était déjà là. Le Démon a toujours été Blok, Milestone le Poète en général, le Poète avec un P majuscule (quelque chose comme Maïakovski), etc. Les personnages se sont développés, ont changé, la vie a amené de nouveaux personnages. Quelqu'un partait. La lutte avec le lecteur a continué tout le temps. Aide aux lecteurs (surtout à Tachkent) également. Là, il m'a semblé que nous écrivions tout ensemble.
Parfois, elle se précipitait dans le ballet (à deux reprises), et puis rien ne l'arrêtait. Je pensais qu'elle y resterait pour toujours. J'ai écrit quelque chose comme un livret de ballet, mais ensuite elle est revenue et tout a continué comme avant. La première pousse (la première poussée), que je me suis cachée pendant des décennies, est bien sûr la note de Pouchkine : « Seul le premier amant fait une impression sur une femme, comme le premier tué à la guerre... » Vsevolod ( Kniazev. - Comp.) n'a pas été le premier à être tué et n'a jamais été mon amant, mais son suicide ressemblait tellement à une autre catastrophe... qu'ils se sont confondus à jamais pour moi. La deuxième photo, arrachée par le projecteur de la mémoire aux ténèbres du passé, est Olga et moi après les funérailles de Blok, à la recherche de la tombe de Vsevolod au cimetière de Smolensk (1913). "C'est quelque part près du mur", dit Olga, mais ils ne parvinrent pas à le trouver. Pour une raison quelconque, je me souviens de ce moment pour toujours.
Anatoly Genrikovich Naiman :
Akhmatova a commencé à écrire le Poème à l'âge de cinquante ans et l'a écrit jusqu'à la fin de sa vie. Dans tous les sens du terme, cette chose occupait une place centrale dans son œuvre, son destin et sa biographie. C'était son seul livre complet après les cinq premiers, c'est-à-dire après 1921, et pas à égalité avec eux, mais eux - comme tout ce qu'Akhmatova a écrit, y compris le poème lui-même - qui couvrait, incluait .
Anna Andreïevna Akhmatova :
Je l'ai commencé à Leningrad (dans mon année la plus féconde 1940), je l'ai continué à "Constantinople pour les pauvres", qui en fut un berceau magique, à Tachkent, puis à nouveau dans la dernière année de la guerre à la Maison de la Fontaine, parmi les ruines. de ma ville, à Moscou et entre les pins Komarov. A côté d'elle, si bigarré (malgré l'absence d'épithètes colorées) et noyé dans la musique, marchait le lugubre Requiem, dont le seul accompagnement ne peut être que le Silence et les rares sons lointains d'un glas. A Tachkent, elle avait un autre compagnon - la pièce "Enuma Elish" - à la fois clownesque et prophétique, dont il ne reste pas de cendres. Les paroles ne la dérangeaient pas et elle ne les interférait pas.
Galina Longinovna Kozlovskaïa :
Brisant le silence, elle dit soudain : « Veux-tu que je lise les derniers poèmes ? Et elle nous a lu le prologue du « Poème sans héros », qui commence par ces mots : « Depuis 1940, je regarde tout comme depuis une tour ».
L'impression du prologue reste pour toujours.
Et à partir de cette nuit a commencé l’un des événements les plus étonnants de notre vie. Le destin s'est contenté de nous accorder un miracle, nous rendant témoins de la façon dont le poème a grandi et a été créé au cours d'une période de deux ans.
Depuis cette soirée du Nouvel An, Anna Andreevna a commencé à venir souvent chez nous. Parfois, cela se produisait tous les jours, parfois tous les 2 ou 3 jours. Et nous savions qu'elle se précipitait vers nous pour lire ce qui était écrit et recevoir une réponse sincère de notre part.
Le poème a grandi et s’est développé comme un arbre, faisant germer de nouvelles pousses. Nous avons vu comment le poète brise une chose, la remplace par une autre, et le poème, grandissant, devient de plus en plus fantastique, mystérieux, attirant et invitant dans son énigmatisme.
Beaucoup de choses à ce sujet n’étaient pas claires. Parfois simplement parce que de nombreuses réalités étaient inconnues et ne pouvaient pas être connues de notre génération. L'autre est due au fait que l'auteur est entré dans des cachots de mémoire si sombres, où lui seul n'est pas allé au toucher.
Nous avons été stupéfaits par la tension créatrice inlassable, l'émergence et le perfectionnement de facettes et de formes toujours nouvelles. Les épigraphes à elles seules vous coupaient le souffle et vous donnaient le vertige. Partant du texte italien de Don Giovanni de Mozart - « Vous arrêterez de rire avant l'aube » - et se terminant par Hemingway - « Je suis sûr que le pire nous arrivera » - de « L'adieu aux armes ».
Au fil des années, ils sont devenus de plus en plus nombreux. Des centaines de réflexions sur les pensées de quelqu'un d'autre se sont développées dans le poème. Et il me semble que si nous rassemblions toute leur multitude, alors dans leur multitude ils deviendraient un poème à eux seuls.
Eduard Grigorievich Babaev :
J’ai copié « Poème sans héros » d’Anna Akhmatova dans un cahier que j’ai appelé « Mon anthologie ». Même maintenant, il me semble que la « version de Tachkent » du poème est plus parfaite et « propre » que sa version ultérieure, avec des ajouts et des explications. Un jour, j'en ai parlé à Anna Andreevna. Elle hocha la tête et répondit, me semblait-il, avec compréhension :
Tous mes amis de Tachkent le pensent...
Je ne peux pas dire que le poème lui-même était alors clair pour moi. Mais le vent qui faisait bouger les feuilles de lierre devant la fenêtre me semblait être le vent de l'histoire.
Nina Pushkarskaya, poétesse de Tachkent, entendant le début du poème :
Dès l'an quarante,
Comme depuis une tour, je regarde tout, -
C'est comme une sonnette d'alarme !
Anna Andreevna était d'accord. Dans certaines copies du poème, y compris dans mon cahier, le prologue s'intitule « Alarme ». Mais ce nom n’est pas resté.
Natalia Alexandrovna Roskina :
A cette époque (1945 - comp.) et d’ailleurs, jusqu’à la fin de ses jours, tous les intérêts d’Akhmatova, toutes les lignes de sa vie poétique personnelle étaient concentrés sur le poème. "Tomaszewski m'a dit qu'il pourrait écrire un livre sur mon poème." Tomashevsky - c'était beaucoup, beaucoup pour elle, elle appréciait extrêmement les Pouchkine et considérait comme un honneur pour elle de figurer parmi leur clan.
Sergueï Vassilievitch Shervinsky :
Un jour, au cours de notre longue connaissance, Anna Andreevna et moi avons eu un désaccord assez important. Elle m'a lu, dans une première version, son « Poème sans héros ». Je me suis perdu dans une imagerie débridée, inhabituelle pour Akhmatova. À la question d’Anna Andreevna sur la façon dont j’avais compris le poème, j’ai répondu par une construction vague et frontale, que j’étais prêt à abandonner immédiatement. Le poème « ne m’est pas parvenu ». Cela n'a pas empêché Anna Andreevna de me relire le poème, avec des inserts supplémentaires. J'ai alors émis un jugement qui ne concernait plus le dispositif poétique. J'ai dit à l'auteur, toujours attentif à mes commentaires, que le poème, issu d'un épisode tragique de sa vie personnelle, avait été écrit trop vite. Le sentiment, pas encore complètement poétisé, encore en ébullition, est donc vital et non traduit poétiquement. pensa Anna Andreïevna. Puis elle prononça, apparemment non sans amertume, quelques mots, d'où il ressortit que ma remarque, qui concernait l'essence même de l'ouvrage, n'échappait pas à sa sensibilité et à son intelligence. Par la suite, nous ne sommes jamais revenus sur "Poème sans héros", mais plus d'une fois, lors de ma rencontre, Anna Andreevna m'a dit avec désinvolture : "Tu n'aimes pas mon poème..." Je ne peux pas cacher le fait qu'elle a appelé moi « le meilleur auditeur ».
Isaïe Berlin :
Puis elle a lu le « Poème sans héros », qui n'était pas encore terminé à cette époque. Il existe des enregistrements sonores de ses lectures, et je ne tenterai pas de les décrire. Même alors, j'ai réalisé que j'écoutais une œuvre de génie. Je ne prétendrai pas qu'alors j'ai mieux compris ce poème aux multiples facettes et complètement magique avec ses allusions profondément personnelles que je ne le comprends maintenant. Akhmatova n'a pas caché le fait que le poème a été conçu comme une sorte de monument final à sa vie de poète, un monument au passé de sa ville - Saint-Pétersbourg, qui est devenue partie intégrante de sa personnalité, et - sous le l'apparence d'un cortège de carnaval de Noël composé de personnages masqués déguisés - un monument à ses amis, à leur vie et à leur destin, un monument à son propre destin, une sorte de « maintenant tu lâches prise » artistique prononcé avant la fin inévitable et déjà proche. Les lignes sur « l’Invité du futur » n’étaient pas encore écrites, ainsi que la troisième dédicace. C'est une chose mystérieuse, complète sens caché. Un tas de commentaires scientifiques s’accumule inexorablement au fil du poème. Bientôt, elle sera probablement complètement enterrée sous lui.<…>
Je lui ai demandé si elle accepterait un jour de commenter « Poème sans héros ». Ses nombreuses allusions peuvent rester incompréhensibles pour ceux qui ne connaissent pas la vie décrite dans le poème. Veut-elle vraiment que tout cela reste inconnu ? Elle a répondu que lorsque la décrépitude ou la mort frapperaient ceux qui connaissaient le monde sur lequel le poème était écrit, le poème devrait lui aussi mourir. Elle sera enterrée avec le poète et son âge. Il n’a pas été écrit pour l’éternité ni même pour la postérité. Pour un poète, seule compte le passé, et surtout l’enfance. Tous les poètes s'efforcent de reproduire et de revivre leur enfance. Le don prophétique, les odes à l'avenir, même le merveilleux message de Pouchkine à Tchaadaev - tout cela n'est que pure déclamation et rhétorique, une tentative de prendre une pose majestueuse, regardant vers un avenir à peine perceptible - une pose qu'elle méprisait.
Vladimir Grigorievich Admoni :
L’intégrité de la nature spirituelle à plusieurs niveaux d’Akhmatova n’avait d’égale que l’intégrité du développement de son monde spirituel. Ce développement était inhabituellement organique et marqué par une extrême durabilité. Il n’y avait rien de figé chez Akhmatova. Elle était extrêmement sensible à tout ce qui se passait dans le pays et dans le monde. La poésie d’Akhmatova était ouverte à toute l’expérience historique colossale du XXe siècle. Tant dans la vie que dans l’œuvre d’Akhmatova, plusieurs étapes sont clairement visibles. Mais il est extrêmement important que lors du passage d'une étape à une autre, l'étape précédente, la période écoulée vie intérieure Akhmatova ne s'est pas évanouie en elle, mais a continué à vivre. Les périodes particulièrement fortes et particulièrement stables de la vie d’Akhmatova furent celles qui se révélèrent les plus importantes et les plus décisives au cours de sa jeunesse.
Il s’agit tout d’abord de l’hiver 1913/1914, l’hiver qui a fait la renommée d’Akhmatova. Puis la fin des années 10 et le début des années 20 - une période où tant de nouveaux poèmes d'Akhmatova ont été créés, et la vie d'Akhmatova a été marquée par de sérieux tournants, lorsque Blok est mort et Gumilyov a été abattu. Et quand la vie d’Akhmatova est devenue extrêmement triste, pendant les années de son mariage avec V.K. Shileiko. Les évaluations d’Akhmatova sur les personnes et les phénomènes artistiques qui se sont développés au cours de ces années n’ont presque jamais changé au cours des décennies suivantes. Elle n’a révisé ces évaluations qu’occasionnellement et à contrecœur. Et elle a conservé avec persistance le souvenir de ces périodes qui l’ont essentiellement façonnée. En particulier, le thème du «dernier hiver avant la guerre», le thème de la veille de la Première Guerre mondiale, n'a jamais quitté Akhmatova. Ce thème a trouvé son incarnation la plus importante et la plus pétillante dans « Poème sans héros ». C'est précisément la plus grande naturalité de ce thème pour Akhmatova qui montre à la fois la facilité avec laquelle Akhmatova a écrit le poème (cette facilité qu'Akhmatova appelait parfois la sorcellerie), et le sentiment qui possédait Akhmatova que le poème lui-même lui venait et, pour ainsi dire , écrit lui-même, et des retours constants au poème, des ajouts et des suppressions, généralement des modifications pendant plus de vingt ans, de 1940 au début des années soixante. Comme l'a dit Akhmatova, le poème ne l'a pas quittée pendant tout ce temps, la forçant à s'y tourner encore et encore, bien qu'Akhmatova ait juré à plusieurs reprises et proclamé solennellement qu'elle ne toucherait plus jamais au poème.
Les gens de l'époque d'avant-guerre vivent dans le poème, ainsi que dans son atmosphère, en général, tout ce dont Akhmatova se souvenait si vivement à la veille du premier catastrophe mondiale XXe siècle. Et il semble logique qu'Akhmatova ait reçu l'impulsion décisive pour la création du poème à la veille d'un nouvel événement historique et tragique du XXe siècle, le Grand Guerre patriotique, à l'époque où la Seconde Guerre mondiale a déjà commencé. C'est une tâche difficile et ingrate que de trouver un prototype spécifique pour chaque personnage du poème. De plus, les signes de nombreux personnages changent d'une version à l'autre. Et ils ont sans doute une signification commune et typique. Mais j'oserai quand même affirmer que chez certains de ces personnages, et chez les plus importants d'entre eux, il y a des traits spécifiques et stables, en outre, ces traits qu'Akhmatova a perçus à l'époque décrite dans le poème. Parce que la caractérisation de ces personnes dans le poème correspond pleinement à la façon dont Akhmatova les a décrites dans nos conversations au cours des premières années de notre connaissance et à la façon dont elle les a représentées dans les conversations des années suivantes.
L'image de l'héroïne du poème, Olga Afanasyevna Glebova-Sudeikina, est particulièrement remarquable. Héroïnes, car dans « Un poème sans héros », il n’y a vraiment pas de héros, mais il y a une héroïne, ou plutôt même deux héroïnes. Une héroïne de l'intrigue est l'actrice Glebova-Sudeikina (dans la remarque introductive du deuxième chapitre, il est dit directement : « La chambre de l'héroïne »), l'autre, véritablement sémantique ou, plus simplement, généralement authentique, l'héroïne du poème est l'époque représenté dans le poème.
Glebova-Sudeikina, Olya, comme l'appelait Akhmatova, est représentée dans le poème, dans toutes ses variantes, à peine modifiée, exactement telle qu'elle a pris vie presque lors de notre première promenade d'avant-guerre. Nous avons marché le long de la Fontanka, et quand nous sommes arrivés à une maison (je ne me souviens plus laquelle), Akhmatova a dit : « Mais Olya et moi vivions ici », elle a nommé l'année ou les années où ils ont vécu ici (je ne me souviens pas la date non plus). Et j'ai été étonné de ne pas comprendre de quelle Olya nous parlions, et puis j'ai été encore plus surpris d'apprendre que je n'avais jamais entendu parler de Glebova-Sudeikina. Elle a commencé à me parler d'elle et j'ai été frappé par la combinaison d'admiration et d'implication profonde avec une certaine aliénation et amertume cachées, qu'Akhmatova elle-même n'a probablement même pas remarquées. Dans « Poème sans héros », une telle dualité dans l’attitude d’Akhmatova envers Glebova-Sudeikina est clairement présente. Et dans une certaine mesure, cette dualité reproduit la dualité qui colore le bilan de toute l'époque décrite dans le poème. En ce sens, les deux héroïnes du poème sont présentées sous le même angle, même si l’accent mis sur chacune d’elles est placé différemment.
Anna Andreïevna Akhmatova :
Autre propriété de celui-ci : cette boisson magique, versée dans un récipient, s'épaissit soudain et se transforme en ma biographie, comme si elle était vue par quelqu'un dans un rêve ou dans une série de miroirs (« Et je suis content ou pas content d'être je t'accompagne..."). Parfois je vois tout cela à travers, émettant une lumière incompréhensible (semblable à la lumière d'une nuit blanche, quand tout brille de l'intérieur), des galeries inattendues s'ouvrent qui ne mènent nulle part, le deuxième pas retentit, l'écho, se considérant comme le plus important, parle tout seul et ne répète pas celui de quelqu'un d'autre, les ombres prétendent être celles qui les projettent. Tout double et triple jusqu’au fond de la boîte.
Et soudain, cette Fata Morgana se termine. Il n'y a que des poèmes sur la table, assez élégants, habiles, audacieux. Pas de lumière mystérieuse, pas de second pas, pas d'écho rebelle, pas d'ombres données à une existence à part, et je commence alors à comprendre pourquoi elle laisse certains de ses lecteurs de marbre. Cela arrive principalement lorsque je le lis à quelqu'un à qui il n'atteint pas, et que, tel un boomerang (excusez la comparaison éculée), il me revient, mais sous quelle forme (!?) et me fait le plus mal.
Ignatiy Mikhaïlovitch Ivanovsky :
Elle a parlé de son « Poème sans héros » préféré, pensivement, en regardant à travers les murs et au-dessus des têtes :
Et dans ce mot on entendait comme une plainte lointaine, voire un écho de désespoir. Akhmatova était très constamment hantée par son poème.
Anna Andreïevna Akhmatova :
Le poème se double à nouveau. Le deuxième pas sonne tout le temps. Il y a quelque chose à proximité, un texte différent, et vous ne pouvez pas comprendre où est la voix, où est l'écho et quelle ombre est différente, c'est pourquoi elle est si vaste, pour ne pas dire sans fond. Jamais auparavant une torche jetée dedans n’en avait éclairé le fond. Comme la pluie, je vole dans les fissures les plus étroites, je les élargis - c'est ainsi que de nouvelles strophes apparaissent. Derrière les mots, j'imagine parfois la période pétersbourgeoise de l'histoire russe :
Que cet endroit soit vide, -
plus loin Souzdal, monastère de l'Intercession, Evdokia Fedorovna Lopukhina. Horreurs de Saint-Pétersbourg : mort de Pierre, Paul, duel de Pouchkine, inondation, blocus. Tout cela devrait résonner dans une musique qui n’existe pas encore. Nous sommes à nouveau en décembre, elle frappe à nouveau à ma porte et jure que c'est la dernière fois. Je la revois dans un miroir vide.
Lidia Korneevna Chukovskaya :
8 mai 1954.... À la hâte, sans les questions ni les pauses habituelles, elle a sorti de sa valise un exemplaire du « Poème » (dactylographié et relié) et a commencé à me lire de nouvelles parties. Elle n'a lu que les encarts - lignes, strophes - tournant rapidement les pages et indiquant brièvement où les nouveaux étaient insérés - et moi, de peur de ne pas comprendre et de me rappeler où, je n'ai rien entendu du tout et je ne me souvenais de rien. J'ai vérifié au retour, maintenant je vérifie - pas une ligne.
« 1913 » est devenu connu sous le nom de « Le conte de Saint-Pétersbourg ».
Depuis combien de temps ne t'a-t-elle pas laissé partir ? - J'ai dit.
Non, c'est différent. Maintenant, je ne la laisse pas partir. J'ai essayé de raconter tout ce que je vois derrière. Il s'avère que moi seul peux voir. Eh bien, peut-être que oui. Maintenant, que tout le monde voie... Sinon Lidin se promène et interprète Dieu sait comment. Qu'on lui dise maintenant : « Il n'y a rien de tel là-bas, il faut se faire soigner...
« Emma Grigorievna Gershtein :
L'intérêt accru pour le manuscrit du "Poème sans héros" - précisément pour le manuscrit - n'a pas quitté Akhmatova pendant de nombreuses années suivantes. Souffrant énormément de l'incapacité d'imprimer intégralement sa création bien-aimée, Anna Andreevna l'a reproduite dans de nombreuses copies dactylographiées. Elle a inventé une disposition graphique particulière de morceaux de texte individuels, établissant pendant longtemps un système de vignettes diverses, d'épigraphes et d'inscriptions manuscrites. Elle en a donné des exemplaires individuels non seulement à des amis et des connaissances, mais aussi à des étrangers dont elle aimerait connaître l'opinion sur le « Poème... ». Même les inscriptions dédicatoires sur ces copies étaient standardisées. "Remis à tel ou tel (initiales) tel ou tel jour de tel mois et telle année, Moscou ou Leningrad."
Viatcheslav Vsevolodovitch Ivanov :
À la fin des années cinquante, alors que « Poème sans héros » était constamment édité et complété, Akhmatova a demandé son avis à tous ceux qui le lisaient. Elle a ensuite raconté et comparé les évaluations critiques d’autres personnes.
Anna Andreïevna Akhmatova :
Les gens viennent de la rue et se plaignent d'être tourmentés par le poème. Et je me rends compte que quelqu'un me l'a vraiment dicté et a gardé les meilleures strophes pour la fin. J'en suis surtout convaincu par la facilité démoniaque avec laquelle j'ai écrit le Poème : les rimes les plus rares pendaient simplement sur la pointe d'un crayon, les tours les plus complexes dépassaient du papier lui-même.
Anatoly Genrikovich Naiman :
Akhmatova a recueilli des opinions sur le poème, a écrit à ce sujet elle-même, le sort futur du poème l'inquiétait, elle craignait que le texte soit trop hermétique ou le paraisse. Elle a raconté qu'un fan, qui récitait de la poésie sur scène, lui avait demandé : « On dit que tu as écrit un poème sans rien ? Je veux le lire." A deux ans d'intervalle, elle m'en a donné deux versions, chaque fois en me demandant en détail mes impressions. Cherchant une place pour de nouvelles strophes, les écrivant ou, au contraire, les ratant, elle vérifiait si sa solution était naturelle, convaincante ou inattendue. Après une de ces conversations, elle a suggéré de faire un article à partir de tout ce que j'avais dit à propos du poème. Il me semblait alors que l'article devait être fondamental, et mes notes étaient fragmentaires, mais pourtant, un an et demi plus tard, j'ai tout rassemblé et écrit quelque chose, ayant perdu de nouvelles idées et n'ayant pas réussi à être fondamental. En particulier, j'ai ensuite décrit la strophe du Poème : « Son premier vers, par exemple, attire l'attention et les intérêts ; le deuxième - captive complètement, le troisième - fait peur ; le quatrième - part devant l'abîme ; le cinquième confère le bonheur, et le sixième, épuisant toutes les possibilités restantes, conclut la strophe. Mais le suivant recommence, et c’est d’autant plus étonnant qu’Akhmatova est un maître reconnu du petit poème. Après sa mort, il s'est avéré qu'elle a écrit cette observation le jour même de notre conversation, et en ces mots : « En savoir plus sur le Poème. X-Ygrek a déclaré aujourd'hui que le plus caractéristique du poème est le suivant : le premier vers de la strophe évoque, disons, l'étonnement, le deuxième - un désir d'argumenter, le troisième - attire quelque part, le quatrième - fait peur, le cinquième - touche profondément, et le sixième - donne la paix finale , ou une douce satisfaction, le lecteur s'attend le moins à ce que dans la strophe suivante ce qui vient d'être énuméré lui soit à nouveau préparé. Je n'ai jamais entendu une telle chose à propos du poème. Cela ouvre une nouvelle facette d’elle.
Lidia Korneevna Chukovskaya :
16 juin J’ai raconté l’opinion de Shervinsky sur le « Poème », qui, à mon avis, est complètement erronée. Il ne s’agit apparemment pas d’un poème, mais d’une chaîne de poèmes lyriques individuels. Faux, il n’y a pas de poèmes séparés ici. Deuxièmement : c’est démodé, du Xe siècle. Ce n’est pas vrai, le matériel ici date seulement des dixièmes années, mais le « Poème » lui-même est d’une nouveauté assourdissante, si nouveau qu’on ne sait pas s’il s’agit d’un poème ; et est nouveau non seulement pour la poésie d'Anna Akhmatova, mais pour la poésie russe en général. (Peut-être pour rien au monde ; je ne peux pas juger, je suis trop ignorant.) Tout ici est une première : et la composition, qui crée un certain nouvel uniforme, et la strophe, et l'attitude même envers le mot : dans un mot acméiste - précis, concret, matériel, Akhmatova reproduit l'au-delà, le spirituel, l'abstrait, le mystérieux. Bien sûr, cette propriété a toujours été inhérente à la poésie d’Akhmatova, mais dans « Poème », elle a acquis une nouvelle qualité. Le sens aigu de l’histoire, toujours inhérent à la poésie d’Akhmatova, célèbre ici son triomphe. C'est une fête du souvenir, une fête du souvenir. Et que la mémoire d'un homme de notre époque soit remplie de morts est tout à fait naturel : la génération d'Akhmatova a vécu 1914, 1917, 1937, 1941, etc., etc. L'auteur a vécu l'histoire intimement, personnellement- c'est la principale force du « Poème ». Voici ceux qui sont morts en prévision de la mort - le suicide de Knyazev, par exemple (« Combien de morts sont arrivées au poète, / Garçon stupide, il a choisi ceci...<…>Pas dans les foutus marais de Mazurie, / Pas sur les hauteurs bleues des Carpates..."). Dans le « Poème », il ne s’agit pas du tout de morts – tués, torturés, abattus – mais son les morts, ceux qui lui ont donné vie, les héros de ses poèmes lyriques. Mais cela ne transforme pas du tout le « Poème » en une chaîne de poèmes lyriques, comme le croit Shervinsky. Cela ne fait qu'imprégner l'épopée de lyrisme, rend le « Poème » lyrique-épique, infiniment profond, captivant l'âme. « La boîte a un double fond » - quel genre de fond a la mémoire ? quadruple? Sept? Je ne sais pas, ma mémoire est sans fond, si tu regardes, tu vas tourner la tête.
Korney Ivanovitch Tchoukovski :
30 Juin 1955. Akhmatova est venue me voir le jour même de l'arrivée de Nehru en URSS. Comme la route de Mojaïsk était remplie de gens qui le rencontraient, tout mouvement vers Peredelkin a été arrêté. Un mur de policiers se dressait devant nous, répétant un seul mot : reculez. Pendant ce temps, une Akhmatova très fatiguée et épuisée est assise dans la voiture, que j'ai tellement envie de sortir de l'étouffement dans la nature...
Akhmatova était, comme toujours, très simple, bon enfant et en même temps royale. Je me suis vite rendu compte qu'elle n'était pas venue pour prendre l'air, mais uniquement à cause de son poème. Évidemment, dans sa vie tragique et douloureuse, le poème est la seule lumière, la seule illusion du bonheur. Elle est venue parler du poème, entendre des éloges pour le poème, vivre temporairement dans son poème. Elle est dégoûtée de penser que le contenu du poème échappe à de nombreux lecteurs ; elle défend le fait que le poème est tout à fait compréhensible, même si pour la majorité il s'agit d'un charabia... Akhmatova divise le monde en deux parties inégales : ceux qui comprennent le poème et ceux qui ne la comprennent pas.
Anatoly Genrikovich Naiman :
Le poème était pour Akhmatova, comme « Onéguine » pour Pouchkine, un ensemble de tous les thèmes, intrigues, principes et critères de sa poésie. En l'utilisant, comme un catalogue, vous pouvez rechercher presque ses poèmes individuels. Parti d'un retour sur ce qui a été vécu - et donc écrit - il a immédiatement assumé la fonction de grand livre comptable et de reporting - ou de mémoire électronique des ordinateurs modernes - où, recodés d'une certaine manière, « Requiem », « Vent de Guerre", "Rose Hip Blossoms" ont été "notés", "Poèmes de minuit", "Prologue", en un mot, tous les grands cycles et certaines des choses qui se démarquent, ainsi que toute l'Akhmatova Pushkiniana. En cours de route, Akhmatova a consciemment écrit le Poème dans l'esprit d'une chronique impartiale des événements, remplissant peut-être d'une manière si unique la mission Pouchkine-Karamzine du poète-historiographe.
RÉUNION. Poème 1. Tsarskoïe Selo Dans la lumière indistincte d'une lanterne, Verre et air argenté, Des flocons de neige s'enroulent. Très propre Le chemin a été nettoyé. Un banc et le pâle profil d'un écolier. Odi profanum... C'est moi. Je ne me souviens pas du premier rendez-vous, Mais je me souviens de ce silence, Oh, le premier rhume de l'univers, Oh, le réveil
I. « Un poème se compose en moi... » « Un poème se compose en moi » Au chœur bruyant des forêts et des eaux, Et tout ce qui frappait silencieusement sur ma poitrine, je sens qu'il trouvera une voix. Les rêves s'envolent comme des ailes, Depuis les mausolées et les tombeaux, Et toute l'âme est un seul effort Pour voler librement sans frontières. 3 février
Le poème « Pougatchev » De retour du Turkestan, S. Yesenin a continué à travailler sur le poème « Pougatchev », qu'il a lu en juin dans « Pegasus Stable ». Je devais non seulement lire le texte du poème, mais aussi exprimer mon point de vue aux réalisateurs, artistes et public présent.
Poème manuscrit de N.V. Gogol - S.T. Aksakov Rome, 28 décembre. 1840...Je prépare actuellement le premier volume pour une purification complète" Âmes mortes" Je change, re-nettoie, retravaille complètement beaucoup de choses et constate que leur impression ne peut se faire sans ma présence. Pendant ce temps, plus loin
IV POÈME SUR PIERRE Pouchkine a passé toute la période du procès de la « Gabriiliade » à Saint-Pétersbourg sans interruption. La défaite de la noblesse avancée et des associations libres en 1826 change complètement l'aspect de la capitale. Parmi les interlocuteurs de sa jeunesse, Pouchkine n'a trouvé ici presque personne :
1. Poème « Pain » Cette année a été riche en voyages, performances et expériences créatives. Alexeï Ivanovitch attendait l'approche de son quarantième anniversaire comme s'il s'agissait de quelque chose de mystique. Il a dit à ses amis qu'à quarante ans, il arrêterait de composer des chansons et n'écrirait que des poèmes. Et cet âge
Poème photocycle Le dernier poème de la vie de Voznesensky a été écrit en janvier 2010. "Au revoir Teddy Kennedy." Bien qu'il soit davantage dédié à Jacqueline qu'à Edward Kennedy et ses frères, le poème est un photocycle. Combien de motos ont traversé ses poèmes - maintenant
Les biographes de Maïakovski décrivent le nouveau poème de 1920 de différentes manières. Viktor Shklovsky, par exemple, a prêté attention à un événement quotidien plutôt mineur - le rasage, pour lequel Vladimir Vladimirovitch a pris un rasoir "gilet" à ses voisins : "Il va, appelle, se rase et revient. Mais les rasoirs
XV « Poème universitaire » Fin 1926, Nabokov écrivit « Poème universitaire » - 882 vers, 63 strophes de 14 vers chacune66. Le principal sujet d'étude du poème semble être la solitude, qu'elle soit celle d'un émigré, d'un étudiant ou d'une vieille fille. Violetta n'a que vingt-sept ans,
Si Lugovskoy et Tvardovsky, comprenant depuis les hauteurs du « milieu du siècle » les chemins de leur patrie et de leur peuple, chacun à sa manière s'efforçait d'atteindre l'intégralité possible de la reconstruction d'une grande époque historique, reflétée dans l'âme humaine, alors Akhmatova se caractérise avant tout par le fait de se tourner vers des moments tragiques et clés où se croisent les contradictions du temps ; pour elle, il est important de comprendre et de révéler leur essence profonde dans toute son unicité. Le "Poème sans héros" d'Akhmatova - unique et, avec "Requiem", peut-être l'œuvre la plus importante du milieu du siècle - a été créé environ un quart de siècle.
L'édition originale du "Poème sans héros" (1940-1942, Leningrad - Tachkent) a été publiée par fragments à partir de 1944. La publication la plus complète de toute une vie était sa première partie - "Neuf cent treizième année", publiée dans le recueil final. « The Running of Time » (1965), bien que les deux autres parties du poème n'aient pas été incluses. Et malgré le fait qu'au cours des décennies suivantes, ses trois parties aient été publiées dans des éditions différentes, le texte canonique final n'existe toujours pas.
Néanmoins, on sait qu'ils ont été publiés dans le 3e volume des Œuvres Collectives en 6 volumes, 4e édition (1943, 1946, 1956 et 1963), bien que le travail sur le « Poème... » se soit poursuivi littéralement jusqu'aux derniers jours. Quatrième édition intitulée « Poème sans héros. Triptyque. 1940-1965 », selon les experts, reflète le mieux la volonté de l'auteur.
En 1959, A. Akhmatova écrit : « Le poème s'est avéré plus vaste que je ne le pensais... Je le vois comme complètement unifié et entier. Néanmoins, deux ans plus tard, une nouvelle entrée apparaît : « Le poème se double à nouveau. ... c'est tellement vaste, pour ne pas dire sans fond.
Ces déclarations et le sous-titre « Triptyque », indiquant une structure en trois parties et faisant écho aux mots de l'auteur : « La boîte a un triple fond », parlent de l'étonnante profondeur, de la nature multicouche de l'œuvre et des particularités de sa structure libre.
La partie principale du poème s'intitule « L'an neuf cent treize » et est sous-titrée « Le conte de Saint-Pétersbourg ». Cette année-là, la dernière avant la guerre mondiale, la capitale Empire russe vécu en prévision des catastrophes et des changements futurs. L'auteur se tourne vers cette période de sa jeunesse d'une époque complètement différente, enrichie par l'expérience de la vision historique, regardant le passé depuis un certain sommet et anticipant en même temps de nouvelles épreuves. C’est exactement à cela que ressemble l’« Introduction », datée du « 25 août 1941. Leningrad assiégé ».
Le premier chapitre de cette partie est précédé de deux épigraphes poétiques qui déterminent le temps de l'action et adressent le lecteur aux sommets de la poésie russe des XIXe et XXe siècles. Après eux viennent la prose et le texte lourd - une sorte de mise en scène. Et puis dans l'imagination (ou le rêve) de l'auteur commence un carnaval (arlequinade) : une suite de personnages, de masques apparaît, une série d'épisodes, de scènes, d'interludes défilent - et tout cela se déroule précisément dans un monologue lyrique fantaisiste et intégral.
K.I. Chukovsky, qui a qualifié Anna Andreevna Akhmatova de « maître de la peinture historique » et a montré son excellente habileté, un véritable sens de l'histoire avec de nombreux exemples, a notamment remarqué qu'il y a un véritable héros dans « Un poème sans héros », et cela est le Temps. On peut bien sûr avoir des attitudes différentes à l’égard de ce jugement, mais je pense que cela ne diminue en rien le rôle et la place héros lyrique poème, et l'auteur, qui organise et détermine sa spécificité de genre, le rendant unifié et intégral.
Il est intéressant de comparer avec les mots ci-dessus de K. Chukovsky le témoignage d'A. Akhmatova elle-même tiré de ses « Notes » dans « Prose sur le poème » : « L'héroïne du poème (Colombina) n'est pas du tout un portrait d'O.A. Sudeikina. C'est plutôt un portrait de l'époque - ce sont les 10èmes objectifs, Saint-Pétersbourg et artistique..." Il est caractéristique que nous parlions ici, d’une part, d’héroïne et, d’autre part, d’une époque comme celle de Tchoukovski.
En appelant la première partie de son « Triptyque » « Le Conte de Saint-Pétersbourg », A. Akhmatova a non seulement indiqué le lieu de l'action et le rapport avec la tradition classique de Pouchkine, mais a également souligné les caractéristiques de sa construction. Il y a ici vraiment des signes du genre narratif et, surtout, le fait qu'au centre se trouve une histoire romantique d'amour et de suicide. jeune poète, "un garçon stupide", "un dragon Pierrot", qui a été emporté puis trompé par une "poupée pétersbourgeoise, un acteur", "Colombine des dixièmes".
Cette histoire, racontée en sections séparées, vagues et cryptées, se déroule sur fond de mascarade et de « bal blizzard », un réveillon « sans fond » qui dure sans fin. Le destin même des personnages (et derrière eux se trouvent de vrais prototypes : l'actrice Olga Glebova-Sudeikina, le poète Vsevolod Knyazev) est le miroir des expériences de l'auteur. Et l'héroïne - « miracle blond », « colombe, soleil, sœur » - est le double de son âme.
L’originalité de « l’histoire » d’Akhmatova réside dans le fait que son intrigue et son conflit sont des formes d’expression de l’expérience de l’auteur de l’époque. Ce n'est pas un hasard si les quatre chapitres principaux de cette partie, dans lesquels les souvenirs reviennent à l'auteur - «les ombres de la treizième année», sont entourés d'un «anneau» lyrique aussi dense, encadré par les dédicaces, l'introduction et la postface. Dans le même temps, le sentiment de l'époque, les caractéristiques et les signes d'événements imminents apparaissent dans des croquis caractéristiques.
Les « personnages » conventionnels (Vent, Silence), bien entendu, ne sont eux aussi que des doubles du « Je » lyrique de l’auteur. Mais leur apparition est symptomatique. Ils surviennent lorsqu’il est nécessaire de donner la description la plus complète d’une époque complexe et contradictoire et témoignent de la perspicacité et de la profondeur du sens du poète à l’époque et à l’histoire.
Et ainsi - du fantastique « bal du blizzard du Nouvel An », « l'arlequinade infernale », « la Hoffmanniana de minuit » et la « diablerie de Saint-Pétersbourg » avec ses premières victimes - jusqu'aux événements inquiétants, aux « tortures et exécutions » de la fin des années 30 et à la tragédie nationale. des années de guerre.
Du sentiment de malheur d’une génération au sentiment d’instabilité et de destruction du temps lui-même, tel est le mouvement de la pensée et de l’expérience. Au cours du travail sur l'œuvre, ses thèmes et son échelle se sont élargis et l'essence s'est approfondie. événements historiques, compréhension de l'enchaînement des temps (« Comme le futur mûrit dans le passé, / ainsi dans le futur le passé couve… »), compréhension de l'essence de l'époque, de tout le 20e siècle.
Dans la 2ème partie du poème - "Tails" - l'idée de l'époque est encore élargie et en même temps concrétisée, montrant comment le "Vrai XXe siècle" s'est avéré dans le destin du poète lui-même et de nombreuses personnes.
Il n'y a plus ici d'éléments narratifs - tout est subordonné à la voix lyrique de l'auteur, qui sonne avec la plus grande franchise, notamment dans les strophes auparavant omises et remplacées par des points pour des raisons de censure. Et le final de "Tails" est particulièrement impressionnant - un écho direct du "Requiem" dans les deux dernières strophes, précédé de la remarque de l'auteur : "(Les hurlements dans la cheminée s'apaisent...)".
Cette partie du poème (« Queues ») représente en grande partie une conversation avec divers interlocuteurs : avec un éditeur ennuyeux, avec un ami lecteur, et enfin, avec un personnage aussi conventionnel que « l'enchanteresse centenaire » - poème romantique XIXème siècle. C'est à ce dernier que s'adressent les strophes finales tragiques, révélant et soulignant avec une force particulière l'originalité de l'épopée lyrique d'Akhmatova en ligne avec et dans le contexte de la tradition nationale et mondiale (« Mad Hecuba / and Cassandra from Chukhloma »),
La troisième partie du poème est « l'Épilogue », adressé à sa ville natale. La remarque introductive représente Leningrad assiégée en ruines et en feu sous le rugissement des canons en juin 1942. L'auteur, situé à 7 000 kilomètres de là, à Tachkent, parcourt le pays tout entier avec son esprit et le voit dans son intégralité - depuis les lignes de front jusqu'aux lieux de détention reculés du Goulag.
Les dernières et dernières strophes de « l'Épilogue » décrivent la séparation avec la Ville, le chemin de l'évacuation, le « Poème... » se termine sur une note triste et tragique, qui souligne également son lien étroit avec le « Requiem », faisant du le lecteur les ressent comme deux parties d'un tout unique - portrait et monument d'une époque tragique.
Dans "Poème sans héros", surtout dans sa première partie, il y a une intrigue conventionnelle, des croquis de la vie quotidienne, des "digressions lyriques" spécialement désignées et des monologues et discours directs de l'auteur. Le principe musical y était clairement exprimé. A. Akhmatova partageait l'opinion de Mikhaïl Zenkevitch selon laquelle il s'agit d'une "symphonie tragique - elle n'a pas besoin de musique, car elle est contenue en elle-même". En même temps, sa construction ressemble à une œuvre dramatique (il y a même un « Interlude » - « Across the Playground »). Sans aucun doute, l'influence sur elle de la dramaturgie d'Alexandre Blok, de ses drames lyriques : « Balaganchik », « Strangers », poème dramatique"Chanson du destin"
Et bien que le principe lyrique du poème d’A. Akhmatova joue sans aucun doute le rôle principal, on aurait tort de ne pas remarquer son unité complexe et sa tendance à synthétiser des principes génériques et, plus largement, des arts divers. Le poème révèle une tendance générale vers la synthèse artistique, vers une compréhension approfondie de l'homme, du temps et du monde dans leur relation. Il convient de souligner en particulier l'étendue exceptionnelle de l'expérience et des traditions de la littérature et de l'art nationaux et mondiaux maîtrisés de manière créative dans "Requiem" et "Poème sans héros" - le recours au folklore, à la mythologie ancienne, à la Bible et au riche héritage des arts connexes. : théâtre, peinture, musique, opéra, ballet. ..
Dans le cadre d'un tissu poétique particulièrement dense qui a absorbé et concentré l'espace et le temps, les tragédies humaines et le cours de l'histoire du cycle de poèmes lyriques sur les épreuves cruelles de la fin des années 30 - « Requiem », dans le « Triptyque » sur les événements des années 10 et 30-40 - "Poème sans héros", ne se limitant pas à l'interaction étroite des paroles et de l'épopée, mais incluant également un début dramatique et tragique, basé sur une adaptation profondément personnelle à l'époque, ainsi que vision du monde véritablement épique, A. Akhmatova a créé des œuvres uniques présentant les caractéristiques d'une grande synthèse artistique.
Dans « Poème sans héros », Akhmatova rappelle l'apogée pré-révolutionnaire de la poésie russe et le carnaval décadent de l'âge d'argent : l'histoire privée du suicide d'un poète amoureux devient le point de départ de l'histoire tragique du « vrai vingtième siècle. »
commentaires : Valéry Chubinsky
De quoi parle ce livre?
Le poème est dédié aux pairs d’Anna Akhmatova, les gens de l’âge d’argent (Akhmatova fut l’une des premières à utiliser ce terme). Comme beaucoup d'autres œuvres d'Akhmatova des années 1930 et 1960, « Poème sans héros » est une tentative de repenser l'expérience culturelle du début du XXe siècle, en tenant compte du sort ultérieur de ses détenteurs et dans le contexte de trois siècles de Saint-Pétersbourg. Histoire de Saint-Pétersbourg. Les prototypes de nombreux personnages du poème sont des connaissances proches d’Akhmatova ; le poème contient des références à diverses circonstances (y compris assez intimes et inconnues du lecteur) de la biographie de l’auteur. Le particulier et l’historique global y sont intimement liés.
Anna Akhmatova. 1940
RIA Actualités"
Quand a-t-il été écrit ?
Les travaux sur le poème ont commencé le 27 décembre 1940 à Léningrad et se sont poursuivis à Léningrad et Tachkent À l'automne 1941, Akhmatova fut évacuée de Leningrad, d'abord vers Moscou, puis vers Chistopol, et de là vers Tachkent. Un recueil de ses poèmes a été publié à Tachkent. Au printemps 1944, la poétesse retourne à Léningrad. jusqu'en 1943. Ensuite, le poème a été révisé plusieurs fois. Bien que la dernière édition ait été achevée en 1963, Akhmatova a apporté des modifications et des ajouts au texte jusqu'en 1965. Dans le même temps, un livret de ballet basé sur l'intrigue du poème est créé (mais reste inachevé).
Sur la pointe de l'île Vassilievski. Extrait de l'album "Saint-Pétersbourg en 1912" de Nikolai Matveev
Pont Maly Konyushenny. Extrait de l'album "Saint-Pétersbourg en 1912" de Nikolai Matveev
Comment est-il écrit ?
Le poème est d’une structure très complexe. Sa première partie, « 1913 », se compose de trois (ou quatre – la catégorisation varie selon les éditions) chapitres et d'un « intermède ». Ils décrivent une sorte de carnaval métaphorique, se terminant par le suicide de l'un des personnages - le « cornet de dragon » (alias Pierrot). L'action se déroule simultanément à deux époques - 1940 et 1913. La deuxième partie, « Tails », est une réflexion sur le genre et les motivations de la première. Enfin, le poème se termine par un épilogue lyrique. Compte tenu de la complexité de la structure, le poème est entièrement écrit en un mètre (« anxieux » dolnik à trois TIC Dolnik avec trois lobes de soutien solides dans le pied. Le dolnik lui-même désigne un mètre poétique dans lequel le nombre de syllabes non accentuées entre les syllabes accentuées n'est pas constant, mais fluctue, créant un motif rythmique plus raffiné et en même temps naturel. basé sur anapest et amphibrachium) avec la rime aabccb. Ce n'est que dans la première dédicace qu'apparaît le pentamètre iambique et dans l'épilogue une courte insertion trochaïque (faisant référence au folklore). Les fragments poétiques sont précédés d'exposés en prose.
Manuscrit du « Poème sans héros ». 1940-1942. Léningrad - Tachkent
Qu'est-ce qui l'a influencée ?
De nombreuses images du poème (Pierrot, Arlequin, Colombine) sont empruntées au théâtre populaire italien - la commedia dell'arte, et Akhmatova fait référence à la perception de ces images dans la culture de l'âge d'argent (par exemple, dans l'œuvre de Blok "Balaganchik", écrit en 1906). Il y a aussi des allusions dans le poème aux expériences théâtrales de Meyerhold. Un sujet distinct et très complexe est le reflet dans le poème de l'œuvre de Mikhaïl Kuzmine, tiré de « Réseaux » (1905-1908), « Carillons d'amour » (1906), « La vie merveilleuse de Joseph Balsamo, comte Cagliostro » ( 1919) au poème « Trout Breaks the Ice » (1927). Le lien entre la strophe et le rythme du « Poème sans héros » avec l'un des fragments du poème de Kuzmin - « La deuxième frappe » - a déjà été noté par les contemporains (et ce lien devient le sujet de réflexion dans « Tails »).
Les chevaux se battent, ronflent de peur,
Kouzmine
Le ruban bleu est enroulé autour des arcs,
Loups, neige, cloches, coups de feu !
Quant au châtiment terrible comme la nuit ?
Vos Carpates trembleront-elles ?
Le miel durcira-t-il dans une vieille corne ?
Les bougies de mariage flottent,
Akhmatova
Embrasser les épaules sous le voile,
Le temple gronde : « Colombe, viens !.. »
Montagnes de violettes de Parme en avril
Et un rendez-vous dans la chapelle maltaise,
Comme du poison dans ta poitrine.
Dans le même temps, Blok, Meyerhold et Kuzmin sont eux-mêmes des personnages facilement reconnaissables dans le poème d’Akhmatov, et leur représentation (en particulier Kuzmin) est extrêmement subjective et biaisée.
En général, la recherche d'échos et d'emprunts dans « Poème sans héros » peut se poursuivre très longtemps. Ainsi, le motif de « Leta-Neva » est présent, comme le souligne Roman Timenchik, chez au moins deux poètes - dans Vsevolod Kurdyumova Vsevolod Valerianovich Kurdyumov (1892-1956) - poète. Diplômé de l'école Tenishev de Saint-Pétersbourg et de l'université de Munich. Il fait ses débuts en 1912, malgré les critiques défavorables de Gumilyov et Bryusov, l'année suivante, il est accepté à « l'Atelier des poètes » et publie plusieurs recueils à petit tirage. En 1922, il achève sa carrière poétique et, à partir des années 1930, il écrit pour le théâtre pour enfants. (et plus particulièrement dans le poème de 1913) et de Georgy Ivanov.
En parlant d'influences théâtrales, il convient de mentionner les pièces de théâtre Youri Belyaev Yuri Dmitrievich Belyaev (1876-1917) - journaliste, critique de théâtre, dramaturge. Il a dirigé le département de théâtre du journal de Saint-Pétersbourg Rossiya, puis a déménagé à Novoye Vremya. Il a publié plusieurs recueils d'articles critiques et de feuilletons. Depuis 1908, il a commencé à écrire des pièces de vaudeville pour le théâtre, parmi ses œuvres les plus remarquables figurent « Confusion ou 1840 », « Psisha », « La Dame de Torzhok » et « Courgettes rouges ». "Confusion, ou 1840" et "Psisha", dans lesquels brillait le personnage principal du poème d'Akhmatov - Olga Afanassievna Glebova-Sudeikina Olga Afanasyevna Glebova-Sudeikina (1885-1945) - actrice, traductrice. Elle a joué principalement des seconds rôles et des troisièmes rôles. En 1905-1906, elle était membre de la troupe du Théâtre Alexandrinsky (par exemple, elle jouait le rôle d'Anya dans « La Cerisaie » de Tchekhov). Elle a dansé sur la scène du Foundry Theatre et au café d'art « Stray Dog ». En 1907, elle épousa l'artiste Glebov et, après avoir divorcé, elle devint l'épouse de fait du compositeur Arthur Lurie. En 1924, elle émigre, traduit en France de la poésie française en russe et se consacre à la fabrication de poupées et de figurines. Dans « Poème sans héros », Akhmatova qualifie Glebova-Sudeikina d’« amie des poètes ». . Les 7 et 8 juin 1958, Akhmatova écrit : « Hier, ils m'ont apporté une pièce de théâtre<«Путаница»>, qui m'a frappé par sa misère. Je vous demande de ne pas le compter parmi les sources du poème... Vous vous souviendrez involontairement des mots Shileiko Vladimir Kazimirovich Shileiko (1891-1930) - orientaliste, poète, traducteur. Alors qu'il était encore à l'école, il apprit l'hébreu biblique, le grec ancien et le latin ; à l'université de Saint-Pétersbourg, il étudia l'assyriologie et traduisit des textes akkadiens et sumériens. Il était proche des Acméistes et de « l’Atelier des poètes ». Il a conseillé Gumilyov dans son travail sur la traduction du « Conte de Gilgamesh » (il a également fait sa propre traduction de l'épopée à partir de l'original akkadien). En 1918, il épousa Anna Akhmatova. La relation a pris fin au bout de cinq ans. Selon Anatoly Naiman, Akhmatova a parlé de son mariage avec Shileiko comme « d'un sombre malentendu, mais sans l'ombre d'une rancœur, plutôt gaiement et avec gratitude envers son ex-mari ». Après le divorce, Shileiko a épousé la critique d'art Vera Andreeva. Il est mort de tuberculose avant d'avoir 40 ans. : "Le domaine de la coïncidence est aussi vaste que celui de l'imitation et de l'emprunt." Je l'ai même, que Dieu me pardonne, l'ai confondu avec une autre pièce du même auteur, « Psisha », que je n'avais pas non plus lue. D’où le verset : « Es-tu, Confusion-Psyché… »
En même temps, la mention de la pièce « Psisha » ne peut être fortuite : elle est dédiée au sort de l'actrice serf Paracha Kovaleva-Zhemchugova Praskovya Ivanovna Kovaleva-Zhemchugova (1768-1803) - actrice, chanteuse. Elle est née dans la famille d'un forgeron serf de la famille Sheremetev. À l'âge de 7 ans, elle a été accueillie par la princesse Marfa Dolgorukova et à 11 ans, elle a commencé à jouer dans le théâtre des serfs. Elle a acquis une grande renommée - en remerciement pour le rôle d'Eliana dans l'opéra "Les Mariages Samnites" de Grétry, Catherine II a décerné à l'actrice une bague en diamant. En 1797, Kovaleva-Zhemchugova tomba malade de la tuberculose et perdit la voix. Nikolai Sheremetev lui a donné sa liberté et l'a épousée en 1801. Elle est décédée immédiatement après la naissance de son premier enfant. , devenue comtesse Sheremeteva. « La jeune maîtresse du palais » (c'est-à-dire la Maison de la Fontaine, le palais Cheremetev, dans l'une des ailes duquel Akhmatova vivait dans les années 1920-1940) est également mentionnée dans le poème d'Akhmatova. Sans aucun doute, même sans lire cette pièce, Akhmatova en connaissait l'existence et son intrigue.
Amusez-vous - amusez-vous
Anna Akhmatova
Comment cela a-t-il pu arriver
Que je suis le seul en vie ?
Ce n'est pas un hasard si les nombreuses épigraphes et notes de bas de page font référence (dans différentes éditions) à une variété d'auteurs - de Joukovski, Pouchkine, Byron, Keats à Khlebnikov et Eliot. Pour Akhmatova, à la fin de sa vie, il était extrêmement important que, malgré l'apparent « archaïsme » de nombreux éléments de sa poétique, elle existe dans le contexte de la culture moderniste du XXe siècle et que ses œuvres soient conçues pour être lues en prenant compte de l'expérience de cette culture. Ainsi, par exemple, Akhmatova mentionne Joyce et Kafka plus d'une ou deux fois dans des textes différents, d'où son intérêt (dans la période ultérieure) retenu et bienveillant pour les futuristes (anciens opposants) et même pour les Oberiuts. Eliot, l'un des réformateurs du genre du poème, est pour Akhmatova avant tout une pair, essayant dans « Quatre quatuors » d'appréhender, comme elle, l'expérience d'une génération face à l'histoire et à l'éternité (« Je suis née la même année que Charlie Chaplin, « La Sonate à Kreutzer », Tolstoï, la Tour Eiffel et, semble-t-il, Eliot » - d'après des notes de 1957 ; en fait, Eliot avait un an de plus qu'Akhmatova).
Une autre ligne d'influence importante est la hofmaniade russe et européenne et le segment correspondant. "Texte de Saint-Pétersbourg" Un ensemble de textes de la littérature russe dans lesquels les motifs de Saint-Pétersbourg jouent un rôle important. Les textes de Saint-Pétersbourg incluent « Le Cavalier de Bronze » et « Dame de pique"Pouchkine, "Contes de Saint-Pétersbourg" de Gogol, "Les pauvres", "Le double", "La maîtresse", "Notes du métro", "Crime et châtiment", "L'idiot" et "L'adolescent" de Dostoïevski. Le concept a été introduit par le linguiste Vladimir Toporov au début des années 1970. (de Gogol à Andrei Bely). Il peut même y avoir une similitude avec « Le Maître et Marguerite » de Mikhaïl Boulgakov, dont Akhmatova a pu entendre des fragments (y compris la description du « Bal de Satan ») dans la lecture de l'auteur (elle a lu l'intégralité du manuscrit du roman lors de l'évacuation à Tachkent ). Enfin, il existe un lien incontestable avec l’esthétique symboliste, qu’Akhmatova et ses amis ont rejeté à un moment donné. Victor Zhirmunsky (qui a écrit à un moment donné l'article « Surmonter le symbolisme » - sur les Acmeists), selon Akhmatova, a donné la définition suivante : « Un poème sans héros » est le rêve des symbolistes devenu réalité, c'est ce qu'ils ont prêché dans théorie, mais quand ils ont commencé à créer, cela n’a jamais pu être réalisé. »
Akhmatova elle-même souligne deux autres sources - Robert Browning Robert Browning (1812-1889) - poète et dramaturge anglais. Il était proche de Dickens, de Wordsworth et communiquait beaucoup avec Tennyson. Parmi ses œuvres les plus remarquables figurent la pièce Pippa Passes By et le recueil de poèmes Dramatic Lyrics. Browning a introduit le genre du monologue confessionnel dans la poésie anglaise. En 1833, le poète visite la Russie. En raison de la mauvaise santé de sa femme, la poète Elizabeth Barrett, Moulton vivait principalement en Italie. (« Dis aliter visum ») et Champs Valérie Paul Valéry (1871-1945) - poète et essayiste français. Proche du cercle du poète Stéphane Mallarmé, il commence à publier de la poésie au début des années 1890. Il est devenu célèbre grâce à son poème « Young Parka », publié en 1917. Grâce à son journalisme, il s'est forgé une réputation d'intellectuel influent. En 1925, il est élu membre de l'Académie française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Valéry était membre du Comité national des écrivains, l'un des centres de la Résistance antifasciste. («Le parapet des terrasses d'Elseneur»).
Constantin Somov. Arlequin et dame. 1921 Musée d'État russe
Des fragments du poème ont été publiés dans le magazine "Leningrad" Revue littéraire, publié deux fois par mois à Leningrad de 1940 à 1946. Outre Akhmatova, Mikhaïl Zoshchenko, Nikolai Tikhonov, Olga Berggolts et Lev Pumpyansky y ont publié des articles. Elle a été clôturée par une résolution du Comité central "Sur les magazines "Zvezda" et "Leningrad" - en raison de la mise à disposition de "ses pages pour les discours vulgaires et calomnieux de Zochtchenko, pour les poèmes vides et apolitiques d'Akhmatova". (1944, n° 10/11 - finale de « l'Épilogue », qui traitait de la guerre, de ses désastres, des réfugiés, de la « vengeance » sur l'ennemi), et dans « l'Almanach de Léningrad » de 1945 (un extrait du d’abord, les parties « principales »). Naturellement, depuis 1946, après La résolution de Jdanov Résolution du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union sur les revues « Zvezda » et « Leningrad » du 14 août 1946. À cause de lui, la composition du comité de rédaction de Zvezda a été modifiée, le magazine de Leningrad a été fermé et Akhmatova et Zoshchenko, qui y publiaient, ont été expulsés de l'Union des écrivains. Les 15 et 16 août, le secrétaire du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union, Andrei Zhdanov, a présenté un rapport sur Zochtchenko (dont les histoires sont « empoisonnées par le poison de l'hostilité zoologique envers le système soviétique ») et Akhmatova. (« la poésie d'une folle se précipitant entre le boudoir et la salle de prière »), le texte du reportage a ensuite été publié dans la Pravda. , les publications se sont arrêtées. Mais en 1957, un fragment de «l'Épilogue» précédemment publié a été réimprimé dans «l'Anthologie de la poésie soviétique russe» et un an plus tard, dans le livre «Poèmes» d'Akhmatova. Un autre fragment paraît en 1959 dans la revue « Moscou » (n°7).
Depuis le milieu des années 1950, le poème circule dans les listes. La première publication complète d'une des éditions intermédiaires (à l'insu de l'auteur) fut dans l'almanach « Air Routes » (n° 1, New York, 1960). Une autre édition figure dans le deuxième numéro du même almanach en 1961. En 1962, Akhmatova tenta de publier le poème dans le magazine New World. En 1965, la première partie du poème a été publiée dans le livre « The Flight of Time ». La version finale du poème a été publiée dans son intégralité (avec des exceptions de censure) dans le livre « Favoris » (M. ; Leningrad, 1974). Depuis 1987, les éditeurs s'efforcent de publier le poème dans la version d'auteur, mais cela soulève de nombreux problèmes textuels.
Comment a-t-elle été reçue ?
La réaction des premiers auditeurs du poème fut, selon Akhmatova, plutôt retenue : « Bizarrement, mes contemporains l'ont jugé le plus sévèrement, et leurs accusations ont été formulées à Tachkent par X. (critique d'art Abram Éfros Abram Markovich Efros (1888-1954) - critique d'art, poète, traducteur. Traduit en russe « Chant de Salomon », textes de Dante, Pétrarque, Michel-Ange. En 1922, il publie un recueil de poèmes, Sonnets érotiques. Il a agi comme essayiste et critique d’art – sa collection d’articles critiques sur les artistes « Profils » (1930) est célèbre. Il est co-auteur de Nikolaï Pounine, le conjoint de fait d’Akhmatova. Il a travaillé à la galerie Tretiakov, organisant des expositions. En 1937, il fut envoyé en exil à Nijni Novgorod, à son retour il enseigna l'histoire de l'art. . — V. Sh.), quand il disait que je réglais de vieux comptes avec l'époque (10) et des gens qui soit n'existent plus, soit qui ne peuvent pas me répondre. Pour ceux qui ne connaissent pas certaines des « circonstances de Saint-Pétersbourg », le poème sera incompréhensible et sans intérêt. D’autres, en particulier des femmes, pensaient que « Un poème sans héros » était une trahison d’un ancien « idéal » et, pire encore, une révélation de mes anciens poèmes. "Perles" Un recueil de poèmes d'Akhmatova, publié en 1914 par la maison d'édition Hyperborey. , qu’ils « aiment tellement ». Marina Tsvetaeva réagit très froidement aux fragments du poème qui lui sont lus en juin 1941 : « Il faut avoir beaucoup de courage pour écrire sur les Arlequins, les Colombines et les Pierrot en 1941. » Selon Akhmatova, Tsvetaeva a vu dans le poème "Monde de l'Art" stylisation" - "c'est-à-dire c’est peut-être ce avec quoi elle a lutté lors de l’émigration comme des conneries à l’ancienne. Comme Akhmatova l'a noté plus tard, "pour la première fois, au lieu d'un flot de mélasse, j'ai rencontré une sincère indignation de la part des lecteurs".
Les critiques enthousiastes du poème au cours de cette période proviennent principalement de lecteurs d'une génération et d'une expérience sociale différentes, y compris d'étrangers - Polonais. Joseph Czapski Józef Marian Franciszek Czapski (1896-1993) était un artiste et écrivain polonais. Il étudie à Saint-Pétersbourg et est proche du cercle poétique symboliste de Zinaida Gippius. Participé à la Première Guerre mondiale. Après la révolution, il part en Pologne et y étudie la peinture. En 1939, il fut enrôlé dans l'armée polonaise et combattit contre l'URSS, fut capturé, transporté dans un camp, mais libéré deux ans plus tard. En 1942, il rencontre Akhmatova à Tachkent. Après la fin de la guerre, il vit en France et participe à la publication des revues d'émigrés « Culture » et « Continent ». Il a écrit plusieurs mémoires sur le Goulag. et un Britannique d'origine russe Isaïe Berlin (tous deux ont joué un rôle important dans la vie d’Akhmatova). Berlin a décrit le poème comme « un requiem pour toute l'Europe ». DANS version finale Dans le poème, il en devient lui-même le personnage.
La première réponse imprimée de grande envergure au poème fut probablement l'article Boris Filippov (Filistinsky) Boris Andreevich Filippov (vrai nom - Filistinsky ; 1905-1991) - critique littéraire, publiciste, éditeur. Il est diplômé de l'Institut oriental de Leningrad : il s'est spécialisé dans les études mongoles et a étudié le bouddhisme et l'hindouisme. En 1927, il fut arrêté pour avoir participé au cercle religieux et philosophique de Sergueï Askoldov. Il fut de nouveau arrêté en 1936 et après cinq ans dans les camps, il s'installa à Novgorod. Pendant la guerre, il proposa volontairement sa coopération aux occupants allemands. Selon certaines informations, il aurait participé aux exécutions d'habitants de Novgorod. Il se rendit à l'Ouest avec les troupes allemandes en retraite. En 1950, il s'installe aux États-Unis, collabore avec la radio Voice of America et enseigne la littérature russe. Avec Gleb Struve, il a préparé des éditions des œuvres complètes d'Akhmatova, Pasternak, Gumilyov et Mandelstam. dans le deuxième numéro de « Routes aériennes » : « …Le héros du poème, le seul incarné jusqu'au bout, est l'époque elle-même, le temps de la désintégration des personnalités individuelles, de leur dépersonnalisation, mais en elle-même l'ère est très lumineux et caractéristique.<…>Six fois, cinq fois, au moins trois rimes et assonances Répéter les mêmes voyelles. - les rimes féminines sont ceintes, comprimées dans l'étreinte de fer des rimes masculines. Un pas clair et un rythme de fer, du tact, et les images se remplacent, se répètent, se croisent - tout est imprégné des brouillons de l'époque.
Marina Tsvetaeva. Vers 1941. Tsvetaeva, avec son amour général pour la poésie d'Akhmatova, a réagi froidement aux fragments du « Poème sans héros »
Joseph Czapski. 1950 L'écrivain et artiste polonais Czapski a laissé une réponse enthousiaste à propos du « Poème sans héros »
Durant la période du Dégel, le poème, encore en cours d'élaboration, devient le centre d'attention et est largement répertorié dans les listes. En 1963, Akhmatova écrit : « Le temps a travaillé pour « Poème sans héros ». Au cours des 20 dernières années, quelque chose d’extraordinaire s’est produit : une renaissance complète des années 10 se déroule sous nos yeux.<…>La jeunesse post-stalinienne et les érudits slaves étrangers sont également très intéressés par les années pré-révolutionnaires.<…>Je dis tout cela à propos de mon poème, car, tout en restant un poème historique, il est très proche du lecteur moderne... » C'est également à cette époque que remontent les éloges des pairs d'Akhmatova : « un chef-d'œuvre de la peinture historique » ( Chukovsky), « une tragédie de la conscience » (Shklovsky) .
Depuis les années 1970 (extrait du livre Viktor Jirmounski Viktor Maksimovich Zhirmunsky (1891-1971) - linguiste et critique littéraire. Il a enseigné à l'Université de Saint-Pétersbourg et, après la révolution, à l'Université de Léningrad. En 1933, 1935 et 1941, il fut arrêté, pendant la campagne contre le « cosmopolitisme », il fut renvoyé de l'Université d'État de Léningrad et retourna à l'université en 1956. Zhirmunsky est un spécialiste de la littérature allemande et anglaise, chercheur sur l'œuvre d'Akhmatova. Il a étudié les dialectes du yiddish et de l'allemand. «L'Œuvre d'Anna Akhmatova», 1973), le poème fait l'objet d'une étude et d'une analyse approfondies. Les articles de Roman Timenchik et le commentaire qu'il a préparé pour l'édition 1989 de « Poème sans héros » ont joué un rôle important ici. Natalia Kraineva a travaillé sur des questions complexes de critique textuelle du poème, en compilant un recueil de tous les manuscrits du poème avec commentaires et analyses (2009). De nouveaux articles sur « Poème sans héros » apparaissent constamment.
Anna Akhmatova. Fin des années 1930
Le poème est-il basé sur une histoire vraie ?
Le prototype du « cornet de dragon » qui se suicide dans le final de la première partie était le jeune officier Vsevolod Gavrilovich Knyazev (1891-1913). Knyazev a écrit des poèmes et les a apportés en 1909 à la rédaction du magazine "Apollon" Revue d'art, publiée à Saint-Pétersbourg de 1909 à 1917. L'initiateur de la création était Sergei Makovsky. La publication a attiré des symbolistes et des acméistes : Nikolai Gumilyov, Mikhail Kuzmin, Sergei Auslender ont collaboré avec le magazine, les couvertures ont été conçues par Mstislav Dobuzhinsky. . Bientôt, sa romance orageuse avec Mikhail Kuzmin commença. Sous son patronage, les poèmes de Knyazev furent publiés en 1910 dans "Un nouveau magazine pour tous" Revue littéraire et artistique publiée à Saint-Pétersbourg de 1908 à 1916. Akhmatova, Gumilyov, Blok, Balmont ont été publiés dans le magazine. Avec l'arrivée du critique d'art Sergueï Isakov au magazine en 1914, la publication s'éloigne de la littérature et devient l'un des centres de l'art de gauche. .
Kouzmine avait l'intention de publier ses poèmes dédiés à Knyazev et ses dédicaces réciproques dans un livre séparé intitulé "Un exemple pour les amoureux". Le livre a été conçu par l'ami de Kuzmin, l'artiste Sergei Yurievich Sudeikin. En 1912, Knyazev a servi dans le régiment de hussards d'Irkoutsk, stationné à Riga, et l'été, lorsqu'il est arrivé à Saint-Pétersbourg, il est resté avec les Sudeikins. Il entame une liaison avec l'épouse de l'artiste, l'actrice Olga Afanasyevna Sudeikina (1885-1945), née Glebova. Dans le même temps, les relations avec Kuzmin se poursuivent : en septembre, Kuzmin et Knyazev effectuent un voyage commun à Mitava Ville de Lettonie. Nom moderne- Jelgava. , cependant, à la fin du mois, il semble y avoir une pause. La liaison avec Sudeikina s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année. Les derniers poèmes qui lui sont consacrés datent de janvier 1913. Knyazev s'est suicidé (pour une raison inconnue) le 29 mars 1913 à Riga, est resté en vie, mais est décédé à l'hôpital le 5 avril.
Vision de l'âge d'or
Anna Akhmatova
Ou un crime noir
Dans le chaos menaçant des temps anciens ?
Bien que les proches de Knyazev pensaient que Sudeikina était responsable de la mort de leur fils (la mère de Vsevolod lui a dit directement lors de ses funérailles : « Dieu punira ceux qui l'ont fait souffrir »), il existe d'autres hypothèses. Comme le souligne Roman Timenchik, « le biographe d'O. A. Glebova-Sudeikina, le chercheur français E. Mock-Biker donne la version suivante du suicide : Knyazev a dû épouser une fille d'une famille de Riga, ses proches ont insisté sur ce point, se plaignant auprès de les autorités régimentaires. Knyazev a considéré cela comme un déshonneur pour lui-même et s'est suicidé.
L’intrigue de la première partie du poème ne ressemble que vaguement à cette histoire. Le "Hussard Cornet" se suicide sur le seuil du "Columbine", qui "rentre chez lui... pas seul", probablement du carnaval du Nouvel An. Ainsi, l'action n'est pas assignée à mars-avril, mais à janvier 1913. Dans le même temps, le lien entre le poème et l'intrigue « princière » est évident et a été confirmé à plusieurs reprises par Akhmatova.
Néanmoins, d'autres versions sont apparues. Par exemple, Filippov, à la surprise d’Akhmatova, a lu les initiales « V. À." comme "Vasily Komarovsky". En réalité la vie d'un poète Vassili Komarovsky Vasily Alekseevich Komarovsky (1881-1914) - poète. Il a étudié à l'Université de Saint-Pétersbourg et a vécu longtemps à l'étranger, où il a été soigné pour l'épilepsie. Il était proche des Acmeists. Les poèmes de Komarovsky ont été publiés pour la première fois dans le magazine Apollo en 1911 et le premier recueil de poèmes a été publié en 1913. Selon Nikolaï Pounine, le poète est mort au début de la Première Guerre mondiale d’une « paralysie cardiaque résultant d’un accès de folie violente ». , une connaissance de Goumilyov et d'Akhmatova à Tsarskoïe Selo, s'est terminée dans des circonstances dramatiques, mais n'a rien de commun avec l'intrigue du « Poème sans héros ».
Vsevolod Kniazev. Knyazev est devenu le prototype du « cornet de dragon » en se suicidant
Constantin Somov. Portrait de Mikhaïl Kuzmine. 1909 Galerie nationale Tretiakov. Le travail de Kuzmin a eu un fort impact sur "Poème sans héros"
Pourquoi Akhmatova s'est-elle tournée vers la longue histoire du suicide ?
Le suicide de Knyazev fait partie des histoires de suicide très médiatisées qui ont ébranlé la littérature russe à la veille et pendant la Première Guerre mondiale : des gens se sont suicidés Victor Goffman Victor Viktorovich Hoffman (1884-1911) - poète, critique littéraire, traducteur. Il a grandi à Moscou et était ami avec Vladislav Khodasevich au gymnase. Articles publiés dans les journaux « Russian Listok », « Moskvich », « Rul ». En 1905, il publie son premier recueil de poèmes et en 1909 son deuxième. En 1911, il part en voyage à l'étranger et se suicide avec un revolver à Paris. (13 août 1911), Nadejda Lvova Nadezhda Grigorievna Lvova (1891-1913) - poétesse. Alors qu'elle étudiait encore au gymnase, avec Ilya Ehrenburg et Nikolai Boukharine, elle a participé à l'organisation bolchevique clandestine. En 1911, elle commence à publier des poèmes dans la revue « Pensée russe ». Elle a rencontré Valery Bryusov, avec qui elle a commencé une liaison. En 1913, Lvova publie son premier recueil de poèmes. La même année, la poétesse, déprimée à cause d'une romance au point mort avec Bryusov, s'est suicidée. (7 décembre 1913), Ivan Ignatiev Ivan Vasilyevich Ignatiev (vrai nom - Kazansky ; 1892-1914) - poète. Il commença à étudier la poésie en 1911, en grande partie grâce à sa connaissance d'Igor Severyanin. Ignatiev a fondé sa maison d'édition «Petersburg Herald», qui est devenue le centre de l'égofuturisme de Saint-Pétersbourg. Dans cette maison d'édition, Ignatiev a publié trois livres de ses poèmes. En 1914, le deuxième jour après le mariage, Ignatiev se poignarda à mort avec un rasoir. (Kazanski) (2 février 1914), Bojidar Bozhidar (vrai nom - Bogdan Petrovich Gordeev ; 1894-1914) - poète. A vécu à Kharkov, était membre du groupe futuriste « Centrifuge ». En 1914, il cofonde les éditions Liren, où il publie son premier et unique recueil de poésie, « Tambourin ». Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il se pendit dans une forêt près de Kharkov. (Bogdan Gordeev) (7 septembre 1914), Lune Samuel Viktorovich Kissin (pseudonyme - Mooney ; 1885-1916) - poète. Il a commencé à publier de la poésie en 1906 et était un ami proche de Vladislav Khodasevich. En 1909, Kissin épousa Lydia, la sœur cadette de Bryusov. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il fut enrôlé dans l'armée ; en 1916, dans une crise de dépression, il se suicida avec un revolver. (Samuel Kissin) (4 avril 1916). Tous ces épisodes tragiques ont laissé leur marque dans la culture (rappelez-vous simplement les essais sur Nadya Lvova et Muni dans la « Nécropole » de Khodasevich). Le suicide de Knyazev a également été « mythifié » - la preuve en est, par exemple, le poème de Georgy Ivanov, écrit en 1926 :
Jour de janvier. Au bord de la Neva
Le vent s'engouffre, soufflant la destruction.
Où est Olechka Sudeikina, hélas,
Akhmatova, Pallas, Salomé ?
Tous ceux qui ont brillé la treizième année -
Seulement des fantômes sur la glace de Saint-Pétersbourg.
Une fois de plus les rossignols siffleront dans les peupliers,
Et au coucher du soleil, à Pavlovsk ou à Tsarskoïe,
Une autre dame en sable passera par là,
Un autre amant en manteau de hussard,
Mais Vsevolod Knyazev ils
Ils ne se souviendront pas de sa chère ombre.
Il n'y a aucune preuve directe de la connaissance d'Akhmatova avec ce poème, publié dans le livre d'Ivanov « Roses » (1931), mais sa présence même en tant qu'héroïne de la méta-intrigue (avec Sudeikina, ainsi que Salomé Andronikova Salomé Nikolaevna Andronikova (vrai nom - Andronikashvili ; 1888-1982) - philanthrope, mannequin. Née à Tiflis, elle épousa en 1906 le marchand Pavel Andreev et s'installa à Saint-Pétersbourg. Elle y organise un salon littéraire, s'entretient avec Akhmatova, Mandelstam, Sergei Prokofiev, Arthur Lurie. En 1917, elle s'installe en Crimée, puis à Tiflis pour vivre avec ses parents. Là, avec les poètes Sergei Gorodetsky et Sergei Rafalovich, elle publie le magazine « Orion ». Depuis 1920, elle vivait à Paris et épousa l'avocat Alexander Halpern. En exil Andronikov pendant longtemps a soutenu financièrement la famille Tsvetaeva. Elle a vécu avec son mari à New York, puis à Londres où elle a rencontré Akhmatova en 1965. , glorifiée par Mandelstam, et la « femme fatale » du Saint-Pétersbourg d’avant-guerre Pallada Bogdanova-Belskaïa Pallada Olympovna Bogdanova-Belskaya (1885-1968) - poétesse. Elle est diplômée du studio d'art dramatique de Nikolai Evreinov et était une habituée du café d'art « Stray Dog ». En 1915, elle publie un recueil de poèmes, Amulettes. On connaît ses relations avec le socialiste-révolutionnaire et terroriste Egor Sozonov, les poètes Vsevolod Knyazev et Leonid Kannegiser. Le premier mari de la poétesse était le socialiste-révolutionnaire Sergueï Bogdanov, le deuxième était le sculpteur Gleb Deryuzhinsky, le troisième était le critique d'art Vitaly Gross. ) est très typique.
Un an après Ivanov, dans l'introduction du poème « La truite brise la glace » (publié dans le livre du même nom en 1929 - Akhmatova, selon Lydia Chukovskaya, l'a relu à l'automne 1940), Kuzmin fait ressortir les fantômes de ses amis décédés :
Artiste noyé
Il piétine ses talons,
Derrière lui se trouve un garçon hussard
Avec un tir à travers la tempe...
"L'artiste noyé" - Nikolaï Sapounov Nikolai Nikolaevich Sapunov (1880-1912) - peintre, artiste de théâtre. Il a étudié à l'École de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou avec Konstantin Korovin, Valentin Serov et Isaac Levitan. Il était membre des associations artistiques « Scarlet Rose », « Blue Rose » et « World of Art ». Depuis le début des années 1900, il travaille sur les décors des représentations du Théâtre d'art de Moscou, du Théâtre de l'Ermitage, Théâtre Bolchoï, Théâtre Alexandrinsky. En tant qu'artiste, il a collaboré avec le magazine « Scales » et a travaillé sur l'intérieur du café d'art « Stray Dog ». Décédé lors d'une excursion en bateau. , un de ceux qui ont peint le cabaret "Chien sans abri" , également lié à l'intrigue du poème (il s'est noyé le 27 juin 1912 à Terijoki devant Kuzmin).
Akhmatova elle-même explique l'approche de l'intrigue comme suit :
"Le premier germe... que je me suis caché pendant des décennies est, bien sûr, la note de Pouchkine : "Seul le premier amant fait... une impression sur une femme, comme le premier tué à la guerre..." Vsevolod était ce n'est pas le premier tué et il n'a jamais été mon amant, mais son suicide ressemblait tellement à une autre catastrophe... qu'ils ont fusionné pour toujours pour moi. La deuxième photo, arrachée par le projecteur de la mémoire aux ténèbres du passé, est Olga et moi après les funérailles de Blok, à la recherche de la tombe de Vsevolod au cimetière de Smolensk (1913). "C'est quelque part près du mur", dit Olga, mais ils ne parvinrent pas à le trouver. Pour une raison quelconque, je me souviens de cette minute pour toujours. Par « autre catastrophe », nous entendons le suicide de Mikhaïl Lindeberg (1891-1911), amoureux d'Akhmatova. Une histoire ultérieure sert de masque à une histoire antérieure, personnellement proche de l’auteur – un exemple typique de la nature miroir du monde d’Akhmatova.
Une autre circonstance sans aucun doute importante et nécessaire à la compréhension du poème est l'amitié à long terme d'Akhmatova et d'Olga Sudeikina. Cette amitié était très chargée d’émotion : il y avait notamment une rivalité à propos du compositeur Arthur Lurie, objet de l’amour d’Akhmatova et partenaire de longue date de Sudeikina. « Colombine des dixièmes années », « un de mes doubles » devient un symbole de l'époque - tandis que la caractérisation qu'Akhmatova lui donne est aussi vivante que peu fiable dans les détails :
La maison du camion de comédie coloré,
Éplucher les cupidons
Ils gardent l'autel de Vénus.
Je n'ai pas mis les oiseaux chanteurs en cage,
Tu as nettoyé la chambre comme un belvédère,
La fille du village d'à côté
Le joyeux écuyer ne le reconnaîtra pas.
Glebova était la fille d'un fonctionnaire du Département des Mines et en aucun cas une « fille du village » ; ses ancêtres récents étaient des paysans, mais pas de Pskov (« skobars »), mais de Iaroslavl. Sa fascination pour les « oiseaux chanteurs » remonte aux dernières années de la vie de l’actrice (qui émigre en 1924 et meurt à Paris) ; cette strophe n’est apparue que dans des éditions ultérieures, écrites après la mort de Sudeikina.
Akhmatova mentionne deux poèmes dédiés à Sudeikina, qui contiennent une référence à l'histoire « princière ». Le premier est « Voice of Memory », fraîchement écrit en 1913, et il contient en fait des lignes assez transparentes :
Ou le vois-tu à genoux,
Qui a quitté la captivité pour ta mort blanche ?
Le second est « Tu prophétises, amer… » (1921). L'héroïne apparaît ici comme une séductrice fatale et souffrante :
...plus d'une abeille
Le sourire rose séduit
Et plus d’un papillon était confus.
L'ombre de Knyazev lui-même peut être vue dans la phrase : "...Est-ce un doux reproche pour les morts."
En partant à l'étranger, Sudeikina a laissé ses archives personnelles à Akhmatova. C'est probablement là qu'Akhmatova, « au cours du dernier hiver de Léningrad », a trouvé « des lettres et des poèmes que je n'avais pas encore lus » - c'est-à-dire, on peut le supposer, des lettres et des poèmes de Knyazev, ce qui l'a incitée à commencer à travailler sur le poème.
Olga Glebova-Sudeikina. 1921 Prototype de l'une des héroïnes principales du poème d'Akhmatova
Pourquoi Akhmatova fait-elle référence à l'action spécifiquement au réveillon du Nouvel An ?
Ici, Akhmatova fait peut-être référence à son propre poème « Nous sommes tous des papillons de nuit ici, des prostituées... », daté du 1er janvier 1913 et dédié aux célébrations du Nouvel An en "À un chien errant" L'un des centres de la vie culturelle de Saint-Pétersbourg dans les années 1910. Le café d'art a été inauguré le 31 décembre 1911 par le metteur en scène Boris Pronin. Il accueillait souvent des œuvres poétiques et soirées musicales, représentations théâtrales, conférences. Les habitués de « Stray Dog » étaient Akhmatova, Gumilyov, Mandelstam, Mayakovsky, Khlebnikov, Meyerhold. La raison officielle de la fermeture était une violation de la Prohibition. . Dans un tout autre langage et avec des techniques différentes, ce poème recrée la même atmosphère d'un « carnaval » brillant et désastreux.
Nous sommes tous des papillons ici, des prostituées,
Comme nous sommes tristes ensemble !
Fleurs et oiseaux sur les murs
Envie de nuages.Oh, comme mon cœur aspire !
Est-ce que j'attends l'heure de la mort ?
Et celui qui danse maintenant,
Ce sera certainement en enfer.
Les « invités » se célèbrent Nouvelle année(1913 ou 1914), mais apparaissent également à l'auteur le soir du Nouvel An (1941). Et voici une autre référence à la « Truite » de Kuzminsk, qui commence avec l’arrivée des invités du passé et se termine avec la célébration du Nouvel An.
L'emblème du café d'art « Stray Dog » de Mstislav Dobuzhinsky. 1912
Dans "Chien errant". 1912 "Stray Dog" - l'un des centres de la vie culturelle de Saint-Pétersbourg dans la première moitié des années 1910
Sergueï Sudeikin. Conception des costumes pour le spectacle de cabaret "Stray Dog". 1912
Quel texte de « Poème sans héros » est définitif et correct ?
Le poème existe en plusieurs éditions - selon diverses estimations, de quatre à neuf. Parallèlement, des éditions intermédiaires circulaient sous forme de listes, des fragments d'entre elles étaient publiés en URSS, texte intégral- À l'étranger. Au cours des travaux, de nombreuses strophes sont apparues et ont été supprimées et n'étaient pas incluses dans la version finale. Certains fragments de textes imprimés sont totalement absents des manuscrits. Parfois, les strophes étaient séparées du poème et devenaient des poèmes indépendants (« Pétersbourg en 1913 »).
Dans la première partie du poème, les différentes versions du texte des années 1960, qui se veut définitif, diffèrent par leur division en chapitres : la « Digression lyrique » entre le deuxième et le troisième chapitre devient, dans de nombreuses variantes, un troisième chapitre indépendant. chapitre, et le troisième chapitre devient le quatrième.
Les plus gros problèmes textuels surviennent avec la deuxième partie, « Tails ». Le texte « final » de l'auteur de 1963 compte 21 strophes, la neuvième et la moitié de la dixième strophe étant remplacées par des points. La note de l'auteur dit : « les strophes manquantes sont une imitation de Pouchkine » (c'est-à-dire les mêmes notes). Cependant, il y a de nombreuses raisons de supposer que les strophes ont été omises pour des raisons d'autocensure, puisqu'elles sont présentes dans les manuscrits originaux. Ils étaient en effet gênants pour la presse soviétique, et, non moins importants, ils sont essentiels pour comprendre d'autres fragments du poème :
Et avec moi est mon "Septième",
A moitié mort et muet
Sa bouche est fermée et ouverte,
Comme la bouche d'un masque tragique,
Mais il est recouvert de peinture noire
Et rempli de terre sèche.L'ennemi torturé : « Allez, dis-moi. »
Mais pas un mot, pas un gémissement, pas un cri
L'ennemi ne peut pas l'entendre.
<...>
Dans la version abandonnée (mais enregistrée dans les commentaires) de la finale, un autre "Septième" est mentionné - "le célèbre Leningrader", Symphonie de Chostakovitch Chostakovitch a écrit la Symphonie n°7 en 1941. La première eut lieu au printemps 1942 à Kuibyshev, où le compositeur fut évacué de Leningrad assiégée. À Léningrad même, elle a été jouée pour la première fois le 9 août, la représentation a été diffusée à la radio et sur des haut-parleurs - la symphonie exaltante a fait une énorme impression sur les habitants de la ville assiégée et est devenue un symbole de la résistance de Léningrad. . Cela peut être interprété de cette façon : Akhmatova, avec un sarcasme amer, oppose le sort de son propre « Septième Livre », qui a dû rester inédit pendant de nombreuses années, et la gloire de la symphonie.
Après la 15e strophe, Akhmatova a ajouté la strophe « 15a », qui, dans les éditions ultérieures, porte désormais un numéro. Encore plus de problèmes surviennent avec trois strophes, dans époque soviétique clairement politiquement « infranchissable ». Dans les ouvrages rassemblés en 1998, l'un d'eux est imprimé sous le numéro 11, deux sous le numéro 24-25. En conséquence, « Tails » se termine ainsi :
Lèvres bleues serrées,
Hécubes affolées
Et Kassandra de Chukhloma,
Nous tonnerons dans un chœur silencieux,
Nous sommes couronnés de honte :
"Nous sommes de l'autre côté de l'enfer" -
au lieu de l'habituel :
Lèvres bleues serrées,
Et ta gloire ambiguë,
Allongé dans un fossé pendant vingt ans,
Je ne servirai pas encore comme ça
Toi et moi allons encore nous régaler,
Et moi avec mon baiser royal
Je te récompenserai à minuit maléfique.
Cependant, Natalia Kraineva, dans sa reconstruction de 2009, place les trois strophes après la dixième restaurée. Tout cela affecte sans aucun doute l’interprétation et la compréhension du poème. L'« instabilité » du texte, en constante expansion, capturant des sujets toujours nouveaux (dans les brouillons, par exemple, Amedeo Modigliani est mentionné, l'affaire avec qui en 1911 a également joué un rôle important dans la vie d'Akhmatova), rend toute interprétation conditionnelle et peu concluante. .
Le dessin d'Amedeo Modigliani "Nu avec une bougie allumée", dans lequel il représente Akhmatova. 1911
Le dessin "Nu" d'Amedeo Modigliani, dans lequel il représente Akhmatova. 1911
À qui sont destinés les dédicaces du « Poème sans héros » ?
Le poème a plusieurs dédicaces. Dans certaines éditions, avant la première dédicace, il y a « V. À." ou le « Vs. » sans ambiguïté. À." - c'est-à-dire Vsevolod Knyazev. De quoi parle "Poème sans héros" vrai prototype son « héros » conventionnel semble tout à fait logique : après tout, la deuxième dédicace (1945) fait évidemment référence à un autre prototype – Olga Glebova-Sudeikina. Mais la date « 27 décembre 1940 » sous la dédicace indique un autre destinataire caché : il s’agit du deuxième anniversaire de la mort de Mandelstam. Les «cils sombres d'Antinous» peuvent également l'indiquer (de nombreuses personnes, dont Akhmatova, ont rappelé les cils luxuriants du jeune Mandelstam).
...et comme je n'avais pas assez de papier,
J'écris sur votre brouillon...
par lequel commence l'initiation, servent peut-être de clé. Sans aucun doute, Akhmatova aurait pu avoir des manuscrits de Knyazev (dans le cadre des archives de Sudeikina) et de Mandelstam, mais il est peu probable qu'elle les ait utilisés de cette manière. De toute évidence, le fait est qu’Akhmatova reprend le plan de quelqu’un d’autre, développe les motivations de quelqu’un d’autre.
Mandelstam possède l'une des épigraphes du troisième chapitre de la première partie (« À Saint-Pétersbourg, nous nous reverrons... » - le premier vers du poème de 1920). En commençant le poème avec l'apparition d'invités du passé, Akhmatova a également gardé à l'esprit les motifs du poème « Je suis retournée dans ma ville... » : « Et toute la nuit j'attends mes chers invités, / Déplace les chaînes des chaînes de porte... »
Le destinataire de la troisième initiation est plus clair. C'est un philosophe anglais d'origine juive russe Isaïe Berlin Isaiah Berlin (1909-1997) - philosophe et traducteur anglais. Il a passé son enfance à Riga et Petrograd ; après la révolution, la famille berlinoise a émigré en Grande-Bretagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut secrétaire de l'ambassade britannique en URSS, époque à laquelle il rencontra Akhmatova et Pasternak. Après la guerre, il enseigne la philosophie à l'Université d'Oxford. Il s'intéressait aux figures d'Herzen, Bakounine, Belinsky. Ce sont les articles de Berlin sur Herzen qui ont inspiré Tom Stoppard à écrire la trilogie dramatique La Côte de l'utopie. (1909-1997). En 1945, il était en URSS en tant que diplomate et rencontra Akhmatova à la Maison de la Fontaine. Les impressions de cette courte réunion ont eu une énorme influence sur le travail ultérieur d’Akhmatova. Pour elle, Berlin a aussi été un échec grand amour, et un messager d'un autre monde dans lequel sa vie aurait pu se dérouler, en un sens - un invité de espace parallèle. Par sa rencontre avec Berlin (qui aurait provoqué l'indignation particulière de Staline), Akhmatova a expliqué non seulement la disgrâce qui lui est tombée en 1946, mais aussi en partie la disgrâce qui a commencé la même année. guerre froide. Voici comment il faut comprendre les lignes :
Il ne deviendra pas mon cher mari,
Mais lui et moi le méritons,
Que le vingtième siècle sera embarrassé.
Berlin (à qui Akhmatova a lu la première partie de « Un poème sans héros » dans une première édition) devient finalement son personnage.
Ossip Mandelstam. années 1910. L’un des destinataires possibles du « Poème sans héros »
Isaïe Berlin. Bénéficiaire de la troisième initiation
Photo de Ramsey et Muspratt
Est-il important que l'histoire se déroule en 1913 ?
Sans aucun doute, la sémantique paneuropéenne de 1913 est aussi importante que l'année dernière Belle Epoque Une époque merveilleuse. — Le P. Indique la période Histoire européenne entre la dernière décennie du XIXe siècle et le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. , la période prospère et sophistiquée du tournant du siècle qui a précédé l’avènement du « vrai vingtième siècle ». N'oublions pas qu'en URSS, l'année 1913 était traditionnellement utilisée comme point de départ pour démontrer les succès économiques et éducatifs. Nous avons devant nous le début de la dernière année stable de la vieille Russie et de la vieille Europe, à la veille de grands bouleversements. C’est l’année de l’apogée de la culture moderniste exquise et l’année des terribles pressentiments qui approchent. L’année suivante, éclate la Première Guerre mondiale, qui tire un trait et rend irrévocable le passé prospère. Pour Akhmatova, 1913 fut l'apogée de l'acméisme, le début de la gloire (dont le sommet eut lieu dans les premiers mois de 1914, après la sortie du Rosaire) et une crise dans les relations avec Gumilyov.
Qui vient au carnaval dans « Un poème sans héros » ?
La plupart des participants sans visage au carnaval mystique et démoniaque portent des masques remplis de significations culturelles : Faust, Don Juan (images « éternelles » qui n'ont pas besoin de commentaires), Iokanaan (Jean-Baptiste, mais dans ce cas, avant tout une image d'Oscar "Salomé" de Wilde, Dapertutto (un personnage du conte d'Hoffmann "Les Aventures du Nouvel An", mais aussi le pseudonyme de Vsevolod Meyerhold, qui est directement mentionné dans le poème - et qui a été abattu dans ce même 1940). À côté de ces personnages, soit sublimement monumentaux, soit révélant une érudition extraordinaire et un goût raffiné chez le porteur du masque, apparaissent des images plus « communes » qui sont entrées dans la culture de masse du début du modernisme - Glan (le héros de Hamsun) et Dorian Gray de Wilde. Ces masques paraissent plus pâles et vont aux « plus modestes ».
Mais peu à peu, parmi les masques, des personnages plus spécifiques émergent. Voici la première:
La queue était cachée sous les pans du manteau...
Comme il est boiteux et gracieux...
Cependant
J'espère que le Seigneur des Ténèbres
Vous n'avez pas osé entrer ici ?
Est-ce un masque, un crâne ou un visage ?
Expression d'une douleur douloureuse,
Ce que seul Goya a osé transmettre.
Chéri et moqueur commun -
Devant lui se trouve le pécheur le plus puant -
La grâce incarnée...
Le fait que Kuzmin se cache derrière ce masque « satanique » est confirmé par les caractéristiques qui lui sont données dans l'édition finale de « Tails » :
Ne combattez pas les déchets hétéroclites,
C'est le vieux cinglé Cagliostro -
Le plus gracieux Satan lui-même,
Qui ne pleure pas avec moi sur les morts,
Qui ne sait pas ce que signifie la conscience ?
Et pourquoi existe-t-il ?
Comme déjà mentionné, Kuzmin est l'auteur de la biographie Cagliostro Alessandro Cagliostro (de son vrai nom Giuseppe Balsamo ; 1743-1795) - mystique et aventurier italien. Il a falsifié des documents, fabriqué de la drogue, vendu de fausses cartes contenant des trésors. En 1777, il vint à Londres sous les traits d'un magicien, astrologue et guérisseur. Il disait qu'il possédait le secret de la pierre philosophale et le secret de la vie éternelle. Après que les Londoniens aient découvert l'escroc, Cagliostro est parti pour la Russie. À Saint-Pétersbourg, il communiquait avec la noblesse de la cour, en particulier avec le prince Potemkine, - il pratiquait l'hypnose, « chassait les démons ». Catherine II l'a représenté dans sa propre pièce "Le Trompeur". Après son séjour en Russie, Cagliostro voyagea longtemps à travers l'Europe, pour finalement s'installer à Rome, où il fut condamné à la prison à vie. . On sait qu’il a réagi à la nouvelle de la mort de Knyazev avec un calme extérieur qui en a choqué beaucoup. Dans le même temps, dans le poème d’Akhmatova, la relation entre le « cornet » et « Cagliostro » n’est mentionnée d’aucune façon et on ne sait donc pas quelle responsabilité il porte dans la mort du jeune homme.
L’hostilité d’Akhmatova envers Kouzmine était avant tout de nature littéraire. L'auteur de « Réseaux » a eu une grande influence sur la formation de l'Acméisme (n'oublions pas qu'il est l'auteur de la préface du premier livre d'Akhmatova, « Soirée »), mais il a refusé de rejoindre le groupe des Acméistes et a ensuite parlé de c'est assez ironique. Dans les années 1920, le cercle de Kuzmin (qui comprenait Youri Yurkun Yuri Ivanovich Yurkun (vrai nom - Jozas Yurkunas ; 1895-1938) - écrivain, artiste. À l'âge de 17 ans, il rencontre le poète Mikhaïl Kuzmin, avec qui il entame une longue histoire d'amour. Avec le soutien de Kuzmin, il publie son premier roman « Gants suédois ». Il était membre du groupe artistique « Treize ». En 1921, Yurkun a commencé une relation avec Olga Hildebrandt-Arbenina, qu'il épousa plus tard - tous les trois vécurent longtemps avec Kuzmin. En 1918, Yurkun a été impliqué dans l'affaire du meurtre d'Uritsky, en 1931 le GPU a tenté de l'attirer comme informateur, en 1938 Yurkun a été arrêté et abattu. , Anna Radlova Anna Dmitrievna Radlova (nom de jeune fille Darmolatova ; 1891-1949) - poétesse et traductrice. En 1914, elle épousa le metteur en scène Sergueï Radlov. Elle a commencé à publier de la poésie en 1916 et était proche du cercle poétique de Kuzmin. Elle a organisé son propre salon littéraire à Petrograd. Depuis 1922, elle traduit des textes de Shakespeare, Balzac et Maupassant pour le théâtre. En 1926, elle divorça de Radlov et épousa l'ingénieur Cornelius Pokrovsky, alors que tous trois vivaient ensemble (en 1938, Pokrovsky se suicida). Pendant la guerre, les Radlov ont été évacués vers Piatigorsk, les Allemands ont transporté le couple à Berlin et à la fin de la guerre, ils se sont retrouvés en France. L'URSS les a invités à revenir ; à leur retour, ils ont été arrêtés et envoyés dans un camp. , en partie par Konstantin Vaginov) était perçu par Akhmatova comme hostile. Appréciant grandement la poésie de Kuzmin, Akhmatova, lors de conversations avec Lydia Chukovskaya, l'a décrit comme une personne « hostile et vindicative ». Le « salon » de Kuzmin, selon Akhmatova, « a eu une très mauvaise influence sur les jeunes : ils l'ont pris pour le summum de la pensée et de l'art, mais en fait c'était la dépravation de la pensée, car tout était reconnu comme un jouet, ils ont ri ou se moquer de tout. L’accent caractéristique de Kuzmin sur la vie privée, l’intimité, la spontanéité émotionnelle, un mélange de lyrisme et de grotesque était étranger à la vision du monde et aux recherches créatives d’Akhmatova dans ses dernières années.
Quant à « l’indifférence » de Kouzmine à l’égard de la tragédie de son jeune ami, elle est réfutée par l’apparition même de l’image de Knyazev dans les poèmes écrits 14 ans après sa mort. Le parti pris quotidien d’Akhmatova est ici évident.
Blok apparaît également comme une figure « démoniaque » dans « Poème sans héros », mais il s’agit d’un démonisme d’un type différent : sublime, masculin-aristocratique. Le « Démon »-Blok est l’un des personnages principaux, puisqu’il est l’amant de Columbine, et c’est par jalousie à son égard que le cornet-Pierrot se suicide. Dans le même temps, il n'y a aucune preuve d'une relation étroite entre Blok et Glebova-Sudeikina et, au contraire, la rumeur attribue sans fondement une telle relation avec le plus grand poète de l'époque à Akhmatova elle-même. La description de Blok (dans le deuxième chapitre) se compose essentiellement de citations et est conçue pour une reconnaissance instantanée :
Le démon lui-même avec le sourire de Tamara,
Mais de tels charmes se cachent
Dans ce terrible visage enfumé -
Chair qui est presque devenue esprit
Et une boucle antique au-dessus de l'oreille -
Tout est mystérieux chez l'extraterrestre.
C'est lui dans une salle bondée
J'ai envoyé cette rose noire dans un verre
Ou était-ce un rêve ?
Avec un cœur mort et un regard mort
A-t-il rencontré le commandant,
Se faufiler dans cette foutue maison ?
Enfin, le troisième personnage « poétique » est beaucoup plus difficile à identifier :
Le mile est habillé de rayures, -
Peint de manière colorée et grossière -
Toi…
du même âge que le chêne Mamré,
L'interlocuteur séculaire de la lune.
Les faux gémissements ne vous tromperont pas,
Vous écrivez des lois d'airain,
Hammourabi, Lycurgue, Solons
Nous devrions apprendre de vous.
Cette créature est d'un caractère étrange.
Il n'attend pas la goutte et la gloire
Ils l'ont fait asseoir précipitamment
Dans les fauteuils luxuriants de l'anniversaire,
Et emporte la bruyère en fleurs,
Les déserts ont leur propre fête.
Akhmatova, dans ses cahiers, explique d'abord qu'il s'agit de « quelque chose comme un jeune Maïakovski », puis préfère voir dans ce personnage « un poète en général, un poète avec un P majuscule ». Néanmoins, l’image même du poète, déguisé en bouffon, « peint de manière colorée et grossière », fait clairement référence aux rituels quotidiens de l’avant-garde russe à la veille de la Première Guerre mondiale. Relations entre acméistes et futuristes "Gilée" Association littéraire et artistique de futuristes qui existait dans les années 1910. Ses organisateurs étaient Velimir Khlebnikov et David Burliuk. Le groupe a publié les almanachs « A Slap in Face of Public Taste » et « Tank of Judges », « Dead Moon » et bien d'autres. En 1913, « Gileya » rejoint l'association « Union de la jeunesse », avec laquelle elle organise le théâtre « Budetlyanin ». Il y avait des relations d'hostilité et de rivalité. Mais les Acmeists étaient généralement loyaux et même amicaux envers Khlebnikov, dont le vers apparaît dans le poème en épigraphe. On ne peut pas en dire autant de Maïakovski, dont Gumilyov, rendant hommage à son talent, a qualifié les poèmes d'« anti-poésie ». Les déclarations publiques de Maïakovski sur les Acmeistes, y compris Akhmatova, sont impitoyablement grossières. Cependant, c’est à la fin des années 1930 qu’Akhmatova a pu apprendre auprès des Briks la véritable attitude de Maïakovski à l’égard de sa poésie (il suffit de dire qu’il connaissait par cœur de nombreux poèmes d’Akhmatova). Sa propre attitude à l'égard de la personnalité et de l'œuvre de Maïakovski l'intéressait probablement déjà dans les années 1910, mais à la fin des années 1930 (lorsque Maïakovski fut déclaré « le meilleur et le plus talentueux poète de l'ère soviétique »), elle n'hésitait pas à souligner cet intérêt. Dans son cas, il s’agissait là d’un des rares points de contact psychologiquement possibles avec l’administration. Un monument à ces sentiments est le poème « Maïakovski en 1913 » :
Tout ce que tu touchais semblait
Ce n'est plus la même chose qu'avant
Ce que tu as détruit a été détruit,
Chaque mot contenait une phrase.
On peut supposer que pour Akhmatova, le jeune Maïakovski incarnait le type de poète qui aborde les thèmes les plus profonds et les plus sérieux, parle au nom de ses contemporains « sans langue » (le rôle qu'Akhmatova elle-même a essayé dans « Requiem »), a la volonté et le pouvoir sur le monde - l'antipode du poète-dandy irresponsable (ce type était incarné par Kuzmin). Peu à peu, cependant, l’image d’un « pair » Chêne Mamvrien L'arbre sous lequel, selon la Bible, Dieu est apparu à Abraham. On pense que le chêne a survécu jusqu'à ce jour, il est situé sur le territoire du monastère russe de la Sainte Trinité à Hébron. "était en contradiction avec les quelques souvenirs réels qu'Akhmatova pouvait avoir à propos de Maïakovski.
Et enfin, la dernière image qui apparaît pendant le carnaval est « l’invité du futur », c’est-à-dire Isaiah Berlin.
et représenté monde des arts « World of Art » est une association artistique de la fin des années 1890, ainsi qu'une revue du même nom, publiée à Saint-Pétersbourg de 1898 à 1904. Le magazine était dirigé par Sergueï Diaghilev et Alexandre Benois. La publication et l'association sont entrées dans l'histoire en tant que pionnières du modernisme et du symbolisme dans l'art russe. , et la ville sombre, démoniaque et inquiétante de Dostoïevski, Gogol, Blok, Bely. Dans les premières paroles d’Akhmatova, ces deux images se chevauchent. « La ville sombre au bord de la rivière menaçante » est à la fois brillante, ordonnée et cruelle. Dans « Poème sans héros », le visage élancé de Saint-Pétersbourg est presque absent. Saint-Pétersbourg dans le poème est « assermenté par la reine Avdotia, / Dostoïevski et possédé » (en référence à la prophétie légendaire d'Evdokia Lopukhina, la première épouse de Pierre, « Pétersbourg sera vide »). Le carnaval délicieusement démoniaque n’est qu’une des manifestations de l’essence « sombre » de Saint-Pétersbourg, mais ses participants semblent n’en avoir aucune idée. Il est très important que le texte du poème (dans la « Digression lyrique » / troisième chapitre) inclue l'image d'une autre ville - le « Pierre » du peuple, mais il ne s'oppose pas à l'esthétique de Pétersbourg : ils ont une « malédiction » commune » et un destin commun.Dans la plupart des éditions, le poème se termine par la scène de l’évacuation de l’auteur (avec une foule d’autres réfugiés) « vers l’est » en 1941. Mais dans « Poèmes » (1958), la phrase « toute la Russie est allée vers l'est » était suivie de :
...Et envers moi-même,
Inflexible dans la bataille menaçante,
Comme dans un miroir éveillé,
Ouragan de l'Oural, de l'Altaï
Fidèle au devoir, jeune
La Russie venait sauver Moscou.
Boris Filippov note que ces lignes n'ont pas disparu par hasard : « La Russie, comme si elle se réveillait de son sommeil pétersbourgeois, allait sauver sa palette nationale primordiale, inférieure, Moscou.<…>Mais Akhmatova a supprimé cette fin. Le raisonnement de Filippov (Filistinsky), autrefois collaborateur actif taché de sang, sur ce sujet semble quelque peu ambigu, mais son interprétation de ces lignes (et son rejet de celles-ci) ne peut être niée comme convaincante. Le motif contrasté de Saint-Pétersbourg et de Moscou, apparu dans le poème, disparaît alors.
Pas sur les hauteurs bleues des Carpates...
Il est à votre porte !
À travers.
Que Dieu vous pardonne !
(Combien de morts sont arrivées au poète,
Garçon stupide : il a choisi celui-ci, -
Il n'a pas toléré les premières insultes,
Il ne savait pas quel seuil
Est-ce que ça vaut le coup et combien est-ce cher ?
Une vue s'ouvrira devant lui...)
En même temps, cette mort contient une amère prophétie : tout le monde du « carnaval » survivra. derniers jours; une nouvelle vie commence, posant de sérieux défis à une personne, la testant avec les dernières épreuves. Comprendre la culture du début du siècle d'où Akhmatova est issue, en tenant compte de l'expérience des années suivantes, devient un thème transversal dans ses travaux ultérieurs (par exemple, dans « Élégies du Nord »). C'est le thème d'un destin parallèle, d'une vie possible et non réalisée. Si dans d'autres œuvres surgit une alternative prospère, mais intérieurement dénuée de sens (par exemple, la vie en exil), alors dans « Un poème sans héros », une image différente et terrible surgit :
Et derrière les barbelés,
Au cœur même de la dense taïga -
Je ne sais pas quelle année nous sommes -
Devenu une poignée de poussière de camp,
Devenu un conte de fées à partir d'un conte terrible,
Mon double vient pour un interrogatoire.
Et puis il quitte l'interrogatoire.
Aux deux messagers de la Fille sans nez
Destiné à le protéger.
Et j'entends même d'ici -
N'est-ce pas un miracle ? —
Les sons de votre voix :J'ai payé pour toi
Chistoganom,
J'y suis allé exactement dix ans
Sous le revolver,
Ni à gauche ni à droite
je n'ai pas regardé
Et j'ai une mauvaise réputation
Elle bruissait.
Une autre alternative tragique est la mort dans une ville assiégée. Akhmatova regarde sa jeunesse « carnavalesque » non seulement de ses propres yeux, mais aussi avec les yeux de ces « doubles ». Ils ont tous dû payer pour la frivolité captivante de la « Belle Epoque ».
« Les Douze » de Blok et « Frost, Red Nose » de Nekrasov.
« Un poème sans héros » est une tentative de créer un poème moderniste « anti-Onéguine ». Le caractère conventionnel et la ponctuation de l'intrigue, l'abondance de réminiscences et de citations (y compris d'elle-même), des remarques en prose semblables à celles du théâtre, une réflexion interne de nature presque postmoderne (une conversation avec un éditeur imaginaire sur le contenu du poème), chronologique des sauts, et enfin, la mobilité d'un texte en constante évolution - tout cela fait de « Poème sans héros » une œuvre unique en son genre.
Les recherches d'Akhmatova révèlent une similitude inattendue avec les recherches dans le domaine de la grande forme d'auteurs extrêmement éloignés d'elle, comme Nikolai Zabolotsky et Alexander Vvedensky. Les « Quatre descriptions » de Vvedensky (1934), où l’un des quatre « mourants » est un esthète-suicide de 1911 (et l’autre meurt au front trois ans plus tard), fait écho thématiquement au poème d’Akhmatova.
Akhmatova combine le courage moderniste dans le domaine de la composition et de la structure du texte avec son langage caractéristique, qui alterne entre une intonation conversationnelle vivante et un romantisme résolument « archaïque ». poétismes Mot ou expression poétique. . Cependant, dans le contexte du poème, ces poétismes sont perçus comme une « citation magnifique » et font partie d’un jeu étonnant par son courage et sa complexité.
bibliographie
- Akhmatova A. A. Poème sans héros. Prose sur le poème. Matériaux du livret de ballet / Prep. N.I. Krainova. Saint-Pétersbourg : Mir, 2009.
- Akhmatova A. A. Poème sans héros : [Collection] / Intro. Art. R.D. Timenchik. M. : Maison d'édition MPI, 1989.
- Verblovskaya I. S. Bien-aimé d'un amour amer. Saint-Pétersbourg Anna Akhmatova. Saint-Pétersbourg : Revue « Neva », 2003.
- Zhirmunsky V. M. L'œuvre d'Anna Akhmatova. L. : Nauka, 1973.
- Luknitsky P.K. Acumiana. Rencontres avec Anna Akhmatova : En 2 volumes. Paris : YMCA-Press, 1991.
- Kikhney L. G., Temirshina O. R. « Un poème sans héros » d'Akhmatova et la poétique du postmodernisme // Bulletin de l'Université de Moscou. Série 9. Philologie. 2002. N° 3. P. 53-62.
- Timenchik R.D. Anna Akhmatova dans les années 1960 : En 2 volumes M. ; Jérusalem : Ponts de culture / Gesharim, 2014.
- Timenchik R. D. Portrait du Seigneur des Ténèbres dans « Poème sans héros » // Nouvelle revue littéraire. 2001. N° 52. P. 200-205.
- Timenchik R. D., Toporov V. N., Tsivyan T. V. Akhmatova et Kuzmin // Littérature russe. 1978. Vol. VI. Non. 3. P. 213-303.
- Timenchik R.D. Épisode de Riga dans « Poème sans héros » d'Anna Akhmatova // Daugava. 1984. N° 2. pp. 113-121.
- Chukovskaya L.K. Héros de « Poème sans héros » // Bannière. 2004. N° 9. pp. 128-141.
Liste complète des références