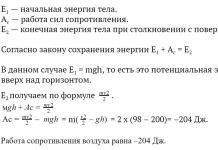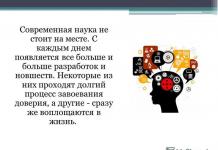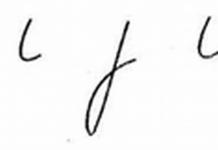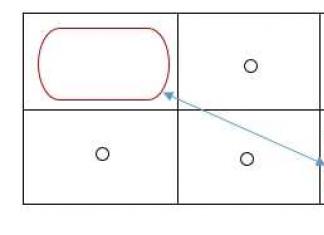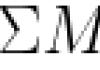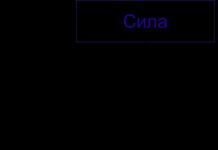travail de diplômé
1.4 Interrelation des émotions et des processus cognitifs
En lien avec les particularités du stimulus, il est d'usage de distinguer au moins deux types de stress : physiologique et psycho-émotionnel. Le stimulus qui provoque une réponse au stress est appelé un facteur de stress. Un irritant peut devenir un stresseur du fait de son interprétation cognitive, c'est-à-dire des valeurs qu'une personne attribue à ce stimulus (stress psycho-émotionnel).
La capacité des processus cognitifs à évoquer des émotions augmente considérablement lorsqu'ils sont liés à des événements importants pour une personne. En conséquence, nous obtenons que les processus cognitifs eux-mêmes sont stimulés par des effets, et ce n'est que secondairement qu'ils apportent leur contribution supplémentaire au développement et au contenu des émotions, les modifiant souvent radicalement.
La relation entre les processus émotionnels et cognitifs peut être décrite comme suit. Nous ressentons d'abord, et ensuite seulement nous savons et comprenons. En même temps, les processus cognitifs eux-mêmes qui affectent les émotions se réalisent dans le cortex cérébral, qui est déjà émotionnel et n'est pas affectivement neutre. Par conséquent, un déterminant purement cognitif des émotions n'existe pas, et donc l'émotion à un stimulus significatif est l'unité des processus affectifs-cognitifs.
Il existe des relations non seulement directes mais aussi inverses entre les processus cognitifs et émotionnels. L'activité cognitive peut être non seulement source d'émotions, mais aussi dépendre de l'état émotionnel du sujet. Ainsi, dans la joie, nous voyons le monde à travers des lunettes roses, et dans la peur, nous le regardons à travers un canal de vision étroit.
Ainsi, la prise de conscience par les parents que la cause du comportement déviant de leur enfant est en eux-mêmes peut être très stressante.
Cependant, tous les parents perçoivent cette information différemment. Ainsi, dans les travaux sur l'activité nerveuse supérieure, il existe une hypothèse sur la spécialisation inductive-déductive du cerveau.
Selon cette hypothèse, dans le processus d'apprentissage, l'hémisphère droit fonctionne selon le principe de déduction, c'est-à-dire qu'il effectue d'abord une synthèse puis une analyse.
L'hémisphère gauche fonctionne selon le principe de l'induction - d'abord en analysant les stimuli, puis en les synthétisant.
Il existe de nombreuses preuves que la perception des signaux émotionnels est sous le contrôle de l'hémisphère droit et que l'hémisphère droit est plus étroitement associé que le gauche aux réponses autonomes.
Ainsi, les clients au cerveau droit seront plus sujets au stress et auront davantage besoin d'aide pour se déculpabiliser.
Analyse du problème de mécanisme comportement agressif humain dans la psychologie moderne
Dans ses travaux ultérieurs, L. Berkowitz a révisé sa théorie originale, déplaçant l'accent des messages sur l'agression vers les processus émotionnels et cognitifs, et mettant ainsi l'accent sur ...
Pour la première fois dans le cadre de la psychologie générale, le problème de la relation entre les processus mentaux et les états a été formulé par N. D. Levitov dans la monographie "Sur les états mentaux de l'homme". L'étude des états, selon l'auteur...
Interaction des états mentaux et des processus cognitifs au cours des activités d'apprentissage des élèves
D'un point de vue philosophique, la question de la relation entre les concepts de processus et d'état a été analysée par A. L. Simanov. Ontologiquement, tout état est soumis à des processus de changement, à son tour...
Interaction des états mentaux et des processus cognitifs au cours des activités d'apprentissage des élèves
Lors de l'étude de la relation entre les états mentaux et les processus cognitifs, un certain nombre de difficultés surgissent, dont la solution détermine la logique de la recherche empirique. Selon nous...
L'habilitation cognitive dans le système de pratique psychosociale
Il existe de nombreuses approches cognitives différentes, dans mon travail je ne considérerai que certaines d'entre elles en prenant l'exemple de J. Kelly, A. Bandura, A. Beck, L. Festinger, A. Ellis. Théorie socio-cognitive de la personnalité...
Sphère cognitive chez les patients atteints de schizophrénie
L'éventail des troubles caractéristiques de la schizophrénie est très large. Selon le degré de progression de la maladie, ils peuvent être moins ou plus prononcés. Une variété de troubles de la pensée sont très caractéristiques de la schizophrénie...
styles cognitifs
Ainsi, les styles cognitifs sont des façons individuellement particulières de traiter les informations sur son environnement sous la forme de différences individuelles dans la perception, l'analyse, la structuration, la catégorisation et l'évaluation de ce qui se passe. À son tour...
styles cognitifs
Dans la littérature étrangère et nationale moderne, on peut trouver des descriptions d'environ deux douzaines de styles cognitifs différents. Attardons-nous tout d'abord sur la description de ces styles cognitifs...
Mécanismes de formation d'un comportement agressif
Ce que les enfants pensent de l'agressivité peut également influencer leur comportement. Les différences dans les niveaux d'agressivité des enfants peuvent être associées à différentes façons dont l'enfant apprend le monde qui l'entoure...
Analyse psychologique du comportement opportun des étudiants
Dans la pratique du conseil psychologique des enfants lié au développement de leurs capacités intellectuelles générales, il est recommandé d'utiliser des méthodes privées pour le psychodiagnostic de l'intelligence ...
Soutien psychologique à la formation de la personnalité dans le système d'éducation innovante
On peut dire ce qui suit sur le développement des qualités cognitives d'un écolier junior. Une caractéristique d'une psyché saine d'un enfant est l'activité cognitive ...
Le rôle des émotions dans la vie humaine
Si tout ce qui se passe peut provoquer certaines émotions chez une personne, le lien entre les émotions d'une personne et sa propre activité est particulièrement étroit. Aujourd'hui, personne ne nie le lien des émotions avec les caractéristiques de l'activité vitale du corps ...
4. Données des sciences naturelles sur le cerveau humain, son intellect, etc. 1. L'essence et le concept d'une personne en tant qu'être social 1.1 Qui est une personne ? L'homme a commencé à réfléchir à qui il est vraiment ...
L'homme, sa santé, ses émotions, sa créativité, ses performances
Une personne, sa santé, ses émotions, sa créativité, ses performances - tous ces facteurs sont interdépendants. Seule une personne saine spirituellement et physiquement peut créer, inventer, se donner entièrement au travail. Les psychologues notent...
Dès sa naissance, une personne est entourée de sons, de couleurs, d'objets, de personnes, en un mot, de tout ce qui provoque des émotions. Parmi les autres processus mentaux (cognitifs, volitionnels), les émotions occupent une place particulière, puisqu'elles affectent à la fois toutes les composantes de la cognition : sensation, perception, imagination, mémoire et pensée, et les processus volitionnels.
Dans les sensations, qui peuvent être agréables ou désagréables, il y a toujours une tonalité émotionnelle. Dans le processus de perception, le même objet apparaîtra différemment devant une personne joyeuse, aigrie ou triste. La mémorisation sera d'autant plus facilitée par la bonne humeur. La mémoire émotionnelle est assez forte : les personnes ayant une mémoire émotionnelle développée se souviennent bien des sentiments mêmes qui les possédaient autrefois. En même temps, les émotions aident une personne à forcer les souvenirs douloureux hors de la conscience.
La qualité de la pensée dépend souvent de l'état émotionnel: une personne joyeuse et heureuse résoudra avec beaucoup plus de succès la tâche qui lui est assignée, tandis que le malheur, l'anxiété compliqueront le processus de solution.
Les émotions positives augmentent la motivation, tandis que les émotions négatives la diminuent.
Les processus volontaires sont également étroitement liés aux émotions : l'attractivité émotionnelle d'un objectif multiplie la force d'une personne et facilite la mise en œuvre d'une décision. Les personnes qui sont dans un état dépressif ont une capacité réduite à prendre une décision volontaire. Une personne indifférente, avec des émotions faiblement exprimées, ne peut pas non plus être volontaire. L'humeur se reflète à toutes les étapes d'un acte volontaire, mais les processus volitifs à n'importe quelle étape peuvent évoquer une variété de sentiments.
Les émotions, conformément à leurs principales caractéristiques, font référence à chacun des trois types de phénomènes mentaux : processus mentaux, états mentaux et propriétés mentales d'une personne.
Les émotions en tant que processus mental sont caractérisées par une courte durée et un dynamisme, elles ont un début et une fin assez prononcés. Les processus émotionnels comprennent, par exemple, le ton sensuel, les émotions situationnelles. Les émotions en tant qu'état mental se distinguent par une constance relative et une durée suffisante. Ils existent en tant qu'unité d'expérience et de comportement humains. Les états émotionnels comprennent les humeurs et le stress.
Les affects, bien qu'ils soient des réactions émotionnelles à court terme, appartiennent également aux états mentaux, étant donné qu'ils forment un syndrome holistique de réactions émotionnelles et comportementales et qu'ils ont une longue séquelle. Si des processus et des états émotionnels surviennent souvent et sont vécus de la même manière dans des situations similaires, ils acquièrent une stabilité et se fixent dans la structure de la personnalité, devenant des propriétés émotionnelles de la personnalité.
Comme tous les phénomènes émotionnels, ils sont caractérisés par le signe, la modalité et la force. Il peut s'agir de propriétés telles que la gaieté, l'optimisme, la sensibilité, la retenue ou le pessimisme, l'insensibilité, l'irritabilité, etc. Certaines propriétés émotionnelles, notamment l'équilibre, l'irascibilité, le ressentiment, dépendent des propriétés du système nerveux et du tempérament.
Fondamentalement, les propriétés émotionnelles d'une personne se forment au cours du processus de la vie humaine, dans le système de certaines situations et relations de la vie à la suite des états émotionnels les plus fréquemment répétés. Par exemple, lors de l'exécution d'une activité, l'enfant échoue, ce qui lui cause des émotions négatives - chagrin, insatisfaction envers lui-même. Si, dans une telle situation, les adultes soutiennent l'enfant, aident à corriger les erreurs, les émotions vécues resteront un épisode passager de sa vie. Si les échecs se répètent (rappelez-vous le célèbre tableau de F.P. Reshetnikov "Encore un diable") et que l'enfant est reproché, honteux, qualifié d'incapable ou de paresseux, il développe généralement un état émotionnel de frustration. Cela se traduit par des expériences négatives à long terme, par la perte d'intérêt pour cette activité, sa désorganisation et des résultats encore pires. Si le système de relations existant persiste longtemps, la frustration devient un moyen stable de répondre aux échecs et se transforme en un trait de personnalité - la frustration.
Désormais, l'enfant considère chacun de ses échecs comme naturel, il perd confiance en lui, il développe une faible estime de soi et le niveau de réclamations diminue. La correction psychologique des manifestations de frustration présente des difficultés importantes, même si cela est possible avec une organisation correcte des activités de l'enfant, en tenant compte de ses intérêts et de ses capacités, avec des changements dans les conditions de vie et le système de relations avec les personnes qui l'entourent.
Il existe une interdépendance entre les processus émotionnels, les états et les traits de personnalité. Les propriétés émotionnelles d'une personne sont formées comme un renforcement des états émotionnels. Par la suite, ils deviennent un facteur important déterminant le cours de tous les processus et états émotionnels.
Dans l'ontogenèse, des complexes stables de propriétés émotionnelles se forment, qui déterminent l'émotivité de la personnalité dans son ensemble. L'émotivité est une propriété intégrative d'une personne qui caractérise le contenu, la qualité et la dynamique des émotions et des sentiments.
L'émotivité se manifeste dans le signe et la modalité des émotions dominantes, dans les caractéristiques de leur apparition et de leur expression externe, dans la volonté et la capacité d'ouvrir aux autres le monde de leurs expériences, la stabilité émotionnelle et la nature du bien-être émotionnel, etc. .
Une personne avec une prédominance d'émotions positives se caractérise par une attitude joyeuse. Dans un état de joie, d'inspiration, de bonheur, une personne éprouve une poussée de force, sa capacité de travail augmente et des relations amicales avec d'autres personnes se forment. Mais en même temps, il est important que les émotions positives remplissent leur principale fonction adaptative - reflètent la relation objective des influences environnementales avec les besoins du sujet. Si cette fonction s'affaiblit ou est perdue et que les émotions positives n'ont pas de raison d'être, l'une des formes de pathologie émotionnelle se développe - l'euphorie.
Il s'agit d'un état émotionnel de gaieté inadéquate accrue avec une diminution de la pensée critique. L'euphorie interfère avec la vie normale, le travail et la communication. La fonction adaptative des émotions négatives est également très importante pour une personne, car elle lui donne des informations sur la nocivité ou le danger de l'environnement. La peur, par exemple, peut éveiller chez une personne des forces qu'elle ne soupçonnait même pas, et ainsi lui sauver la vie. Mais si les émotions négatives dominent le comportement et la structure de la personnalité, l'apparence psychologique d'une personne change.
Avec la dominance de la colère, une personnalité agressive et conflictuelle se forme. Avec la dominance de la peur, une personne développe de l'anxiété, de l'anxiété, de la timidité, de la timidité. Dans les formes extrêmes de prédominance des émotions négatives, une personne perçoit tout sous un jour sombre, elle développe une dépression, qui se traduit par une passivité prononcée, une diminution ou un manque total d'intérêt pour le monde qui l'entoure.
Dans ces cas, une personne a besoin d'une aide psychologique ou psychiatrique. La dépression peut être causée par un chagrin causé par des circonstances tragiques, une maladie ou un deuil. Aider une personne en proie à une réaction asthénique forte et irremplaçable, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer, de sympathiser avec elle, de contribuer à la formation d'une nouvelle perspective de vie et de nouvelles significations.
Les gens diffèrent grandement entre eux en termes d'émotions dominantes et d'expression extérieure, de capacité et de désir de révéler leur monde intérieur, leurs sentiments. Certaines personnes se caractérisent par des sentiments forts et une manifestation violente d'émotions. D'autres sont plus calmes et réservés émotionnellement.
La pleine ouverture des sentiments pour les autres n'est inhérente qu'aux enfants. En vieillissant, ils commencent à prendre soin de l'intégrité de leurs expériences intérieures et à maîtriser la capacité de restreindre leurs manifestations extérieures. Dans une plus large mesure, un comportement émotionnel retenu est caractéristique des introvertis. C'est aussi le résultat de l'éducation, du manque de communication. Il existe également certaines différences entre les sexes. Les hommes sont plus restreints dans l'expression de leurs sentiments.
L'incapacité ou le refus de divulguer ses sentiments crée souvent des difficultés de communication et entrave la résolution constructive des conflits. Les gens montrent leurs émotions de différentes manières dans les cadres officiels et dans la communication intime et personnelle. La chaleur des relations, l'amitié, l'amour aident une personne à surmonter la barrière de la retenue et de l'isolement. Par exemple, les formations pour améliorer la compétence communicative comprennent des exercices spéciaux qui développent la capacité d'analyser ses émotions et ses sentiments et de les utiliser de manière adéquate dans les processus de communication.
La stabilité émotionnelle se manifeste par divers degrés de sensibilité aux stimuli émotionnels et par divers degrés de violation des mécanismes mentaux de régulation sous l'influence de l'excitation émotionnelle. Avec une stabilité émotionnelle élevée, un stimulus plus fort est nécessaire pour évoquer l'émotion.
Les émotions qui surviennent dans le processus d'activité ne réduisent pas son efficacité. Une personne peut garder le contrôle de ses émotions et faire face au stress avec plus de succès. La stabilité émotionnelle dépend à la fois de facteurs psychophysiologiques et psychologiques. Les premiers incluent les propriétés du système nerveux, les seconds - des mécanismes complexes d'autorégulation et de contrôle du comportement, formés au cours du processus d'éducation de l'individu.
L.S. Vygotsky a montré que ces mécanismes reposent sur une relation complexe et ambiguë entre les émotions et la pensée. D'une part, la compréhension de ses émotions conduit à leur affaiblissement voire à leur destruction.
Le psychologue américain E. Titchener a soutenu que l'attention est hostile aux émotions si elle est focalisée directement sur elles. D'autre part, les émotions et la pensée fonctionnent dans l'esprit humain dans son ensemble. C'est ce que L.S. Vygotsky le principe de l'unité de l'affect et de l'intellect dans la structure du comportement et de l'activité humaine. La décision de telle ou telle action est prise par une personne en train de peser soigneusement toutes les circonstances et tous les motifs. Lorsque les actions et les actes sont effectués uniquement sur la base des arguments de l'esprit, ils ont moins de succès que lorsqu'ils sont soutenus par les émotions. Habituellement, un acte de comportement spécifique commence et se termine par une évaluation émotionnelle de la situation et décision mais la pensée domine.
Si une personne est incapable de reconnaître et de comprendre ses émotions, elle ne peut pas les maîtriser. Dans ce cas, l'émotivité prend le pas sur l'intellect, ce qui peut se traduire par des prises de décision impulsives, ou diverses formes de comportements inappropriés : incontinence, agressivité, anxiété accrue, amusement déraisonnable, etc. L'incapacité à faire face à ses émotions est particulièrement prononcée dans les situations critiques difficiles. situations, par exemple, dans des conditions de conflit, de manque de temps ou de surmotivation de l'activité. Ainsi, les étudiants émotionnellement instables affichent généralement des résultats inférieurs lorsqu'ils effectuent des tests ou des examens responsables.
Connaître les caractéristiques de l'émotivité d'une autre personne contribue à la compréhension de ses actions et de ses actes, à la mise en place de formes et de méthodes de communication adéquates avec elle, à l'organisation rationnelle des activités. La stabilité émotionnelle est une condition nécessaire à la réussite de la mise en œuvre de nombreux types de activité professionnelle, y compris pédagogique . Le travail d'un enseignant se caractérise par un dynamisme élevé, des tensions, une abondance de situations conflictuelles, une variété de problèmes qui nécessitent des solutions rapides et non triviales. Dans le même temps, il est important que l'enseignant soit capable de faire face avec compétence aux émotions et aux affects émergents, sans succomber aux sentiments d'irritation, de ressentiment, d'antipathie. Dans l'apparence psychologique d'un enseignant, des qualités émotionnelles telles que le calme, la prudence, la retenue des réactions impulsives et la capacité de contrôler son état émotionnel sont importantes.
La particularité de la sphère émotionnelle d'une personne détermine en grande partie les spécificités de son comportement, de ses activités, de sa communication, de son attitude face à la vie et de son bien-être émotionnel. Chaque individu développe un système individuel de fluctuations de bien-être émotionnel, un sentiment d'être heureux ou malheureux. BI. Dodonov a appelé au sens figuré ce type de fluctuation un "pendule émotionnel".
Pour certaines personnes, le bien-être émotionnel se rapproche du pôle "bonheur", pour d'autres il se rapproche du pôle "malheur". Des différences de bien-être émotionnel sont souvent observées chez des personnes qui sont objectivement dans des conditions de vie similaires. Cela signifie que le sentiment d'être heureux ou malheureux dépend non seulement des circonstances de la vie, mais aussi des besoins et du caractère d'une personne, de ses valeurs et de ses significations, des caractéristiques de son émotivité et de sa personnalité dans son ensemble.
LA PSYCHOLOGIE DES ÉMOTIONS
Plenum Press New York et Londres
psychologie des émotions
Saint-Pétersbourg
Moscou Kharkiv Minsk 1999
Carroll E. Izard
Psychologie des émotions
Série "Masters of Psychology" Traduit de l'anglais A. Tatlybaeva
Rédacteur en chef Rédacteur en chef Rédacteur en chef Consultant scientifique Artiste Relecteurs Conception Mise en page
V.Usmanov
M. Churakov
V. Popov
V. Loskutov
V. Reine
M. Roshal, E. Shnitnkova
N. Migalovskaïa
A. Rapoport
BBK88.352.1 UDC 159,96 Izard K.E.
I32 Psychologie des émotions / Perev. de l'anglais. - Saint-Pétersbourg : Maison d'édition "Piter", 1999, - 464 p. : ill. (Série Maîtrise en psychologie) ISBN 5-314-00067-9
Le nom de Carroll E. Izard, l'un des créateurs de la théorie des émotions différentielles, est connu de tous. psychologue. "Psychology of Emotions" (1991) est une version élargie et révisée de son livre "Human Emotions" (1978), qui est devenu l'un des manuels de base du cours de psychologie de la personnalité dans notre pays. Dans The Psychology of Emotions, Izard analyse et résume la grande quantité de nouvelles données expérimentales et de concepts théoriques qui sont entrés dans l'utilisation scientifique au cours des dernières décennies, au cours desquelles la science des émotions a évolué rapidement. Recommandé pour les étudiants en psychologie de la personnalité, psychologie sociale, cognitive, clinique.
© 1991 par Plenum Press, New York.
© Traduction en russe par A. Tatlybaev
© Série, conception. Maison d'édition "Piter", 1999.
Droits de publication obtenus dans le cadre d'un accord avec Plenum Press, USA.
Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme ou
par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite des détenteurs des droits d'auteur.
ISBN 5-314-00067-9 ISBN 0-306-43865-8
Toutes les marques et marques déposées mentionnées dans cette publication sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Maison d'édition "Peter". 196105, Saint-Pétersbourg, st. Blagodatnaya, 67 ans. Licence de la République de Lettonie n° 066333 datée du 23 février 1999.
Signé pour publication le 25 février 1999. Format 70x100 U 16 . Impression offset. Papier offset.
Conv. PL. 37.7. Tirage 10 000 exemplaires. Commande n° 364.
ι Imprimé à partir de transparents prêts à l'emploi pour le "Livre technique" de l'Ordre de la bannière rouge de l'entreprise d'État du travail
Comité Fédération Russe par presse 198005, Saint-Pétersbourg, Izmailovsky pr., 29.
Avant-propos.................................12
Remerciements..................................14
Chapitre 1
À propos de l'origine
et fonctions des émotions..................................15
Sur la question de l'origine
motivation et émotions.................................18
Origine de la motivation
Survie .......................................18
L'origine des émotions.................19
De la pulsion physiologique à l'émotion : faim, goût, dégoût ................................................ ..........22
Types de motivations.................................................. 23
Réflexes et automatisés
Comportement..................................................24
Instinct..................................25
Disques................................................. .26
Émotions.................................27
Interaction du sentiment et de la pensée :
affectif-cognitif
constructions ........................................28
Quelques caractéristiques des émotions.... 30
Stabilité-variabilité ......... 30
Congénitale acquise.. 31
La question du positif et
émotions négatives.................................34
L'impact des émotions sur une personne:
aperçu .......................................34
Les émotions et le corps..................................35
Interaction des émotions et des processus de développement de la personnalité
et relations sociales.................36
Émotions et perception
processus cognitifs ..................................38
Sommaire................................................. .38
Chapitre 2 \ Définition des émotions. Relation des émotions avec les processus cognitifs, le comportement et la personnalité .......................41
Les émotions dans les théories des émotions
et Personnalité ..................................................41
Concept psychanalytique
affect et motivation.................................41
Approche de mesure : excitation, activation
et mise à l'échelle des émotions..............46
Les théories cognitives de l'émotion et
personnalités.................................................. .49
Émotions résultant de processus biologiques. Des schémas émotionnels comme
traits de personnalité.................................53
Approche cognitivo-affective...54
La théorie des émotions différentielles .... 54 Les émotions comme principal
système de motivation .................... 55
Six systèmes d'organisation
personnalités ..................................................55
Émotions et système émotionnel... 56
Complexes émotionnels complexes
dans la vie critique
situations.................................................................. 60
Qu'est-ce qu'une émotion de base ?................................63
Comment comprendre les émotions .................................. 65
Sommaire................................................. 67
Glossaire .......................................................69
Lectures complémentaires.................71
chapitre 3
Émotions, conscience et connexion des émotions
et processus cognitifs ................ 73
Conceptualisation de la Conscience................74
La conscience comme courant de pensée ................................74
Étude expérimentale
courant de conscience ..................................76
La conscience comme paradigme..............77
La conscience comme aspect de l'organisation biologique ....................................... ... 78
Émotions et conscience en tant qu'expérience des processus biologiques..............79
Les émotions comme facteur organisateur de la conscience .................................. ... .81
Sensation, émotion, conscience............ 82
Sentiment, sens et émotion.................................83
Affects et Niveaux de Conscience..............83
Émotion et perception..............................................84
Interaction entre l'émotion
et processus cognitif
et la conscience .................................................. .. 86
Réflexe conditionné
activateurs d'émotions ....................... 86
Émotions, conscience, processus cognitifs et action .................................................. 88
Fonctions des hémisphères et émotions ...... 89
Les émotions et l'organisation de la conscience..........91
Conscient et durable
caractéristiques des émotions .................................. 92
La qualité de l'émotionnel
expériences invariablement .................. 93
L'émotion est toujours avec nous.............. 94
Sentiment, perception, connaissance..............96
Changements d'âge
dans les processus émotionnels et
dans les opérations de la conscience ....................... 96
Changements d'âge
dans les réactions émotionnelles.................97
Activateurs d'âge et d'émotions..........98
Quand les sentiments prennent le dessus
l'esprit, ou
La crise de l'adolescence ....... 98
Reprendre..........*................................100
Lectures supplémentaires.............101
LES ÉMOTIONS DANS LES THÉORIES DES ÉMOTIONS ET DE LA PERSONNALITÉ
Malgré le fait que McDougall dans sa théorie (McDougall, 1908) ait souligné la relation étroite entre les émotions et l'activité volitive (conation), et que ses travaux et ceux de Freud (1938) aient jeté les bases de l'étude de la relation entre les émotions, la motivation et le comportement, un L'un des problèmes les plus graves de la psychologie est que la plupart des théories de la personnalité, des théories du comportement et des théories des émotions ont peu à voir les unes avec les autres. Tout à fait caractéristique est le fait que les auteurs de nombreuses théories de la personnalité ne mentionnent même pas le problème des émotions. En règle générale, ils utilisent l'un ou l'autre concept lié à la motivation, mais en même temps, ils considèrent rarement les émotions privées comme des variables de motivation. Les chercheurs en émotions n'analysent également, en règle générale, qu'une ou plusieurs composantes du processus émotionnel - sa composante neurophysiologique, expressive ou phénoménologique. Dans le même temps, à de rares exceptions près (par exemple, Tornkins, 1962, 1963), ils ne corrèlent presque pas leurs données avec les données des théories de la personnalité et les données des théories comportementales. Ce chapitre donne un bref aperçu de plusieurs approches de l'étude des émotions, dont chacune est corrélée avec des données provenant d'études d'autres fonctions du corps ou de la personnalité dans son ensemble ; le chapitre fournit des éléments qui nous aideront à définir l'émotion et à comprendre son essence.
Concept psychanalytique de l'affect et de la motivation
L'œuvre de Freud (Freud, 1930, 1936, 1938) et sa théorie psychanalytique occupent à juste titre une place particulière dans l'histoire de la psychologie et dans l'histoire des sciences du comportement. Freud a généré des constructions heuristiques telles que l'inconscient, la dynamique des rêves, le développement de la conscience, il a introduit dans l'utilisation scientifique des concepts tels que<защитный механизм>, <вытеснение>, <подавление>, <сопротивление>, <перенос>Il a soulevé des questions de sexualité infantile et d'amnésie infantile. Mais dans le cadre du thème que nous avons désigné, la méthode proposée par Freud pour analyser les mécanismes du fonctionnement de la personnalité mérite une mention spéciale. Il a ouvert un nouveau champ de connaissances scientifiques - le domaine de la motivation humaine, en a fait une partie importante de la psychologie moderne et est ainsi devenu le fondateur de la tradition psychodynamique (Boring, 1950). Le concept freudien d'affect nous intéresse à cet égard, mais nous le considérerons de manière générale, dans le cadre de sa théorie de la motivation.
La base de la théorie psychanalytique classique de la motivation est la théorie freudienne des pulsions instinctives. Par rapport à cette théorie, comme par rapport à la psychanalyse elle-même, les vues de Freud se sont constamment transformées et développées. À cet égard, ses vues ne se prêtent presque pas à une définition précise et à une systématisation, cette tâche n'appartient même pas aux étudiants de Freud. Le résumé de la théorie de la psychanalyse de Rapaport (1960) est considéré comme le plus correct, et c'est celui-ci qui a servi de source principale à l'excursus ci-dessous.
Rapaport met en garde le lecteur contre les généralisations excessives, l'exhorte à ne pas exagérer le rôle des pulsions instinctives dans la motivation, car, en s'appuyant uniquement sur les pulsions instinctives, il est extrêmement difficile d'expliquer des phénomènes comportementaux déterminés par l'ego, tels que le phénomène de défense psychologique ou le phénomène de synthèse cognitive et de différenciation. Les instincts ne nous permettront en aucun cas de mieux comprendre le rôle que joue la stimulation externe dans le comportement humain, ou les fonctions de la conscience qui résultent de l'attention portée à un stimulus externe.
L'attraction instinctive, ou motif instinctif, est définie par Rapaport comme une force motivante interne, ou intrapsychique, qui se caractérise par : a) l'inconditionnalité ; b) caractère cyclique ; c) sélectivité et d) remplaçabilité. Ce sont ces quatre caractéristiques qui déterminent la nature motrice des pulsions ou motifs. D'autre part, le comportement cognitif ou exploratoire peut en quelque sorte être considéré comme une fonction d'un stimulus externe ; les déterminants d'un tel comportement ne sont pas cycliques, sélectifs ou remplaçables.
Rapaport pense que les quatre propriétés ci-dessus des pulsions instinctives sont des caractéristiques quantitatives plutôt que qualitatives, c'est-à-dire que les pulsions diffèrent par le degré d'expression de chacune de ces propriétés. De plus, les pulsions instinctives peuvent être évaluées à l'aide de quatre autres caractéristiques, telles que : a) l'intensité (pression) - la force de la pulsion et la nécessité d'effectuer les actions dans lesquelles la pulsion est représentée ; b) le but de l'attraction - l'action vers laquelle l'attraction pousse et qui conduit à la satisfaction ; c) l'objet d'attraction - celui dans lequel ou à travers lequel le désir peut atteindre son but ou sa satisfaction ; et d) la source - le processus physiologique de l'une ou l'autre partie du corps, perçu comme une excitation.
Il est difficile de donner une définition précise de l'affect dans le cadre de la théorie psychanalytique classique. La complexité est causée par le fait que Freud et ses disciples ont interprété ce terme de manière extrêmement large, le chargeant de significations de plus en plus diverses au fur et à mesure que la théorie se développait. Ainsi, dans ses premiers écrits, Freud écrit que l'affect, ou l'émotion, est la seule force motrice vie mentale, et dans ses œuvres ultérieures, il<уже говорит об аффектах как об интрапсихиче-ских факторах, пробуждающих фантазии и желания индивида>(Rapaport, 1960, p. 191). Concluant l'examen des données psychanalytiques et autres, Rapaport arrive à la conclusion suivante :
Une seule des théories expliquant les mécanismes d'émergence des émotions ne contredit pas les données empiriques. Son essence est la suivante : une image perceptive perçue de l'extérieur sert d'initiateur à un processus inconscient au cours duquel l'énergie instinctive inconsciente de l'individu est mobilisée ; si cette énergie ne peut se trouver une application légale (dans le cas où les exigences instinctives sont en conflit), elle se déverse par d'autres voies sous la forme d'une activité involontaire ; différents types d'activités<эмоциональная экспрессия>et<эмоциональное переживание>- peuvent se manifester simultanément, alternativement ou indépendamment les uns des autres : la manifestation ouverte de l'attirance instinctive est taboue par la culture, et donc des décharges émotionnelles constantes d'intensité variable sont inhérentes à une personne ; en conséquence, la vie mentale d'une personne est saturée non seulement de celles décrites dans les manuels<чистыми>émotions telles que la rage, la peur, etc., mais aussi un large éventail d'autres émotions, des plus intenses aux plus modérées, conventionnelles, intellectuellement raffinées (Rapaport, 1960, p. 37).
Dans la littérature psychanalytique, trois aspects de l'affect sont considérés - la composante énergétique de l'attraction instinctive (<заряд>affecter), processus<разрядки>et la perception de la libération finale (sensation ou sentiment d'émotion). En même temps, la réalisation de l'affect et sa composante sensuelle ne sont envisagées que dans le cadre de l'expression de l'émotion ; la valeur communicative de ces aspects de l'affect n'a été reconnue par la psychanalyse qu'après les travaux de Schachtel (Schachtel, 1959). Cependant, Rapaport notait dès 1953 que<аффект как набор сигналов - столь же обязательное средство познания реальности, как и мышление>(Rapaport, 1953, p. 196). Où<заряд>l'affect est évalué par une mesure quantitative ou d'intensité, tandis que le processus<разрядки>perçue ou ressentie par l'individu dans des catégories qualitatives.
La théorie de Freud et la psychanalyse dans son ensemble considéraient avant tout les affects négatifs résultant de pulsions conflictuelles - par conséquent, leur intérêt particulier pour un mécanisme de défense tel que le refoulement est compréhensible. Or, l'affect par nature est un phénomène de conscience et ne peut être un objet de refoulement. Seule la composante idéationnelle de l'attraction instinctive n'est pas admise dans la conscience. Lorsque des mécanismes répressifs sont déclenchés, ses composantes idéationnelles et affectives sont séparées. En conséquence, une interdiction est imposée à l'investissement préconscient de ses représentations instinctives et à l'utilisation des images verbales qui leur sont associées. Ainsi, à l'aide du mécanisme de refoulement, on prévient un conflit à l'un des niveaux (par exemple, entre l'intérêt généré par la libido et la sanction du surmoi), et en même temps, à l'autre niveau, le risque de formation de symptômes névrotiques ou psychosomatiques est réduit. Si les mécanismes répressifs échouent, un conflit surgit entre l'inconscient et le préconscient, et un affect qualitativement différent, déjà symbolisé, apparaît dans la conscience. Cet affect est négatif, il est généré par une représentation aux couleurs conflictuelles, et donc l'asservit et peut provoquer des troubles mentaux (Singer, 1990).
Le concept freudien de motif en tant que représentation idéationnelle-affective dans la conscience est analogue aux concepts d'organisation idéo-affective (Tornkins, 1962, 1963) et de structure affective-cognitive (lzard, 1971, 1972). Les structures affectives-cognitives sont comprises non seulement comme des représentations de pulsions instinctives, mais aussi comme des structures ou des orientations de la conscience résultant de l'interaction de l'émotion (la condition motivationnelle initiale) et de la cognition.
Un autre concept freudien -<желание>est encore plus proche du concept de structure affective-cognitive. Freud a été le premier à parler de désir (à propos<страстном желании воплощения>) comme force motrice des rêves. Au niveau inconscient, le désir est une impulsion instinctive, et au niveau préconscient il se manifeste sous forme de rêves et de fantasmes.<Желание выступает в роли аффективно-организующего принципа, оно использует механизмы конденсации, замещения, символизации и вторичной детализации, чтобы скрыть истинное содержание сновидения, чтобы выразить себя в форме, приемлемой для сознания>(Rapaport, 1961, p. 164). Le concept de structure affective-cognitive dans la théorie des émotions différentielles diffère de celui de Freud.<желания>le fait qu'en tant que facteur d'organisation et de motivation considère l'affect, et non les processus d'idéation. Les deux théories s'accordent à dire que les facteurs affectifs et cognitifs, d'une manière ou d'une autre, ou d'une manière ou d'une autre, déterminent la motivation humaine d'une manière ou d'une autre.
Holt (Holt, 1976) a résolument rejeté la théorie des pulsions instinctives et a proposé son propre concept, assez convaincant, d'affect et de motivation. Il met l'accent sur l'importance de la stimulation externe et des processus perceptivo-cognitifs, mais reconnaît en même temps l'importance des phénomènes associés à l'expression et à l'expérience des émotions.
Holt (Holt, 1967) et un certain nombre d'autres auteurs (Kubie, 1974 ; Rubinstein, 1967 ; Peterfreund, 1971) attirent l'attention sur le fait que les données empiriques ne nous permettent pas de considérer l'attraction instinctive comme une sorte d'énergie psychique ou force motrice. Selon Holt, malgré le fait que le désir sexuel, l'agressivité, la peur et d'autres phénomènes affectifs peuvent être considérés comme biologiquement déterminés, innés (<хотя и наблюдаемые в самых разнообразных модификациях>), elles ne sont activées qu'en raison de la prise de conscience par l'individu des pressions externes - c'est-à-dire sous l'influence d'aspects significatifs de l'environnement (Murray, 1948), qui peuvent être mieux définis en termes de réglementations et de prescriptions sociales.
Proposant sa théorie de la motivation, Holt s'appuie sur le concept<желание>au sens où Freud l'entendait dans ses premiers écrits, et le définit comme<ког-нитивно-аффективное понятие, формулируемое в терминах смысла того или иного действия и предположений о приятном или неприятном исходе>(Holt, 1976, p. 179). Dans le concept de Klein (Klein, 1976), la principale propriété du système motivationnel est<перцептивно-оценочном рассогласовании>. Le décalage dans ce cas est interprété comme une comparaison consciente, préconsciente ou inconsciente de l'image perceptive et de l'image créée par l'imagination, puis la conclusion sur leur valeur relative. En fait, cette approche diffère peu de l'approche mise en œuvre dans les théories cognitivement orientées des émotions (Arnold, 1960a ; Lazarus, 1974, 1984 ; Pribram, 1970 ; Schachter, 1971), qui décrivent les processus d'évaluation et de contrôle - les processus de comparaison les affaires étatiques existantes et potentielles. Ainsi, le désir, phénomène clé de la motivation, est appréhendé comme un décalage, comme<когнитивно-аффективное состояние, родственное неудовлетворенности>(Holt, 1976, p. 182). Un degré modéré de désaccord excite un plaisir et un intérêt modérés, et un degré extrême et inattendu conduit à la peur et au mécontentement. Dans le même temps, l'affirmation de Holt selon laquelle différents degrés d'inadéquation peuvent donner lieu à différents affects est très similaire à la tentative de Singer (1974) de lier le degré de gravité de l'un ou l'autre des affects au succès de l'assimilation des informations cognitives.
Les travaux d'Helen Lewis sur le rôle de la honte et de la culpabilité dans le développement de la personnalité, en psychopathologie et en psychothérapie, s'appuient sur la théorie de la psychanalyse, sur des recherches en psychologie expérimentale et sur la psychothérapie centrée sur la personne. Dans son œuvre la plus célèbre<Стыд, вина и неврозы>(Shame and Guilt in Neurosis, 1971) elle aborde l'éternel problème de la distinction entre honte et culpabilité, considérant ces deux émotions comme des facteurs de motivation indépendants et importants. Elle soutient de manière convaincante que le problème doit son origine à Freud ; la confusion s'est installée depuis que Freud n'a pas réussi à tracer une ligne claire entre<самостью>(soi-même) et<эго>, depuis qu'il était d'usage de parler de<суперэго>en termes de pulsions instinctives (pulsion de mort) et souligner le rôle de l'état affectif de culpabilité. Dans le cadre de la théorie construite par Freud, il n'y avait pas de place pour le concept de honte, il ne considérait pas la honte comme une composante du surmoi, tout comme il ne pouvait reconnaître le rôle de la honte dans le développement de la dépression.
Il existe une technique bien connue développée par Witkin (Witkin, 1949) avec ses collègues. À l'aide de cette technique, on peut déterminer le style perceptif-cognitif d'un individu, évaluer sa dépendance de champ-indépendance de champ, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la pensée et le comportement de l'individu sont dus à une stimulation externe ou interne. Lewis, basé sur les recherches de Witkin, a démontré la relation entre les styles perceptuels-cognitifs (styles de fonctionnement du surmoi) et la manifestation de la culpabilité ou de la honte dans les processus perceptuels-cognitifs. Son travail a montré la nécessité d'étudier la honte et la culpabilité en tant qu'émotions qui motivent les fonctions du surmoi.
Au cours de la recherche, Lewis a montré que la peur ou l'attente de la honte agit comme un motif de retenue dans le comportement de l'individu et comme une force contribuant à la formation de l'identité de soi. D'autre part, Lewis voit la honte comme un état émotionnel qui, dans des manifestations extrêmes, peut provoquer des troubles mentaux et des problèmes de personnalité, et en ce sens est à l'opposé d'un sentiment d'autonomie personnelle. Elle a constaté que dans le domaine du patient dépendant, l'émotion de honte génère une hostilité dirigée vers l'intérieur, envers soi-même.
La dépendance de champ-indépendance de champ, considérée comme un style d'activité perceptivo-cognitive, détermine le fonctionnement du surmoi. Ainsi, chez les patients dépendants du champ, nous sommes plus susceptibles d'observer des manifestations d'émotions de honte, et chez les patients indépendants du champ, des émotions de culpabilité.
Dans son travail, Lewis révèle la signification positive de l'émotion de la honte, montrant à quel point elle est importante pour maintenir l'estime de soi, l'estime de soi et les liens émotionnels d'une personne. Ses découvertes de différences dans l'expression de la honte et de la culpabilité soutiennent son idée que la honte, en tant qu'état affectif du surmoi, joue un rôle dans le développement de la dépression et de l'hystérie, tandis que la culpabilité provoque des troubles obsessionnels et la paranoïa. De plus, Lewis émet l'hypothèse qu'il peut y avoir des différences significatives entre les sexes dans la sphère émotionnelle, suggérant que les femmes, contrairement aux hommes, sont plus susceptibles de ressentir l'émotion de la honte et c'est pourquoi elles sont plus sujettes à la dépression et à l'hystérie.
Approche de mesure : éveil, activation et mise à l'échelle des émotions
Spencer (1890) a été l'un des premiers à considérer les émotions (sentiments) comme une partie mesurable de la conscience. Wundt (1896), développant cette tradition, a proposé de décrire la sphère émotionnelle (sensuelle) de la conscience, en l'évaluant à l'aide de trois dimensions : plaisir-déplaisir, détente-tension et calme-excitation. Par la suite, ces critères ont été utilisés par Woodworth (Woodworth, 1938) et Schlosberg (Schlosberg, 1941) dans un certain nombre d'études sur l'expression émotionnelle.
Les émotions comme excitation de l'organisme. Duffy (1934, 1941, 1951, 1962), basé sur les concepts de Spencer et Wundt, pense que tout comportement peut être expliqué en termes d'un seul phénomène - l'excitation de l'organisme, un concept qui présente des similitudes évidentes avec la dimension relaxation-tension de Wundt. . Duffy (1962) soutient que le comportement n'est variable que le long de deux vecteurs, qu'elle appelle directionnalité et intensité. L'orientation comportementale est définie par Duffy en termes de sélectivité de réponse, de sélectivité basée sur les attentes, d'orientation cible de l'organisme et de relation entre les stimuli perçus. L'individu se soumet à la situation ou l'évite, selon sa signification - motivante ou menaçante. Duffy établit une analogie entre sa compréhension de la directionnalité, ou<ответа на взаимоотношения>, et<когнитивными картами>Tolman (1932) ou<сигнальными функциями>Hebb (Hebb, 1955).
La deuxième caractéristique du comportement - l'intensité - Duffy définit comme une conséquence de l'excitabilité générale de l'organisme ou comme la mobilisation de l'énergie, et considère la mesure de l'intensité<количество энергии, высвобожденной из тканей организма>(Duffy, 1962, p. 17). Selon Duffy, l'émotion n'est qu'un point ou un ensemble de points sur l'échelle de l'excitation, il n'y a donc pas de place pour les variétés discrètes d'émotions dans sa théorie, et on ne peut parler de la variabilité de l'émotion que du point de vue de intensité.
Bien que les idées de Duffy appartenaient à une ligne de pensée qui tendait à exclure les phénomènes émotionnels de la théorie psychologique et de la recherche expérimentale, sa conception a ouvert la voie à la théorie de l'activation, qui à son tour a grandement contribué à l'essor actuel de la recherche sur les interactions cerveau-comportement.
Activation neuronale, émotion et comportement. Suite à la découverte par Moruzzi et Magun de certaines fonctions de la formation réticulaire du tronc cérébral, Lindsley (Lindsley, 1951, 1957) a proposé sa propre - activation - théorie des émotions et du comportement. Trop large et difficile à mesurer le concept d'excitation de l'organisme mis en avant par Duffy (Duffy, 1962), il a remplacé le concept d'activation, qu'il définissait comme une excitation neuronale de la formation réticulaire du tronc cérébral avec des modifications concomitantes des paramètres électroencéphalographiques de le cortex. Son interprétation de l'émotion présuppose l'existence d'un stimulus émotionnel préalable, soit externe et conditionnel, soit interne et inconditionnel. De tels stimuli excitent des impulsions qui activent le tronc cérébral, qui à son tour envoie des impulsions au thalamus et au cortex cérébral. Un hypothétique mécanisme d'activation transforme ces impulsions en un comportement caractérisé par<эмоциональным возбуждением>, et dans les paramètres EEG caractérisés par une faible amplitude, une haute fréquence et une asynchronie.
Lorsque des impulsions surviennent en raison d'une diminution de la stimulation émotionnelle et affectent directement le thalamus, des complexes EEG synchronisés, de haute amplitude et de basse fréquence apparaissent. Lindsley prédit que dans ces conditions, un comportement opposé à celui observé dans ces conditions devrait être détecté.<эмоциональном возбуждении>, C'est<эмоциональная апатия>. Lindsley a compris que sa théorie n'expliquait pas la nature des émotions individuelles : son objectif principal était d'établir une relation entre certaines conditions antécédentes, les modifications de l'activité électrique cérébrale mesurées par l'EEG et le comportement observé.
La plupart des chercheurs modernes qui étudient le problème de l'excitation ne croient plus qu'il existe un seul type d'excitation. De plus, ils associent des types d'excitation à des traits de personnalité individuels. Par exemple, Zuckerman (Zukennan, 1979) pense que chaque trait de personnalité est basé sur son propre type d'excitation. Dans ses premiers travaux, il écrivait que pour une personne douée, le type d'excitation optimal est la recherche de sensations. Zuckerman (1984) a montré que le besoin de sensations en tant que trait de personnalité a des fondements neurochimiques distincts ainsi que des manifestations cognitives et comportementales distinctes. Il est en corrélation positive avec les aspects impulsifs, mais pas sociaux, de l'extraversion. Il est également corrélé à des comportements à risque tels que la consommation de drogue, le saut à ski et les choix de carrière risqués. Les personnes pour qui la soif de nouvelles expériences est devenue un trait de personnalité cherchent généralement à les trouver dans des expériences passionnantes et passionnantes.
Mise à l'échelle de l'expression émotionnelle. Depuis 1872, après la publication du célèbre ouvrage de Darwin<Выражение эмоций у человека и животных>, un domaine d'émotions aussi complexe que les expressions faciales expressives a été considéré par de nombreux scientifiques comme une discipline indépendante. Certains de ces auteurs ont apporté des contributions inestimables à l'analyse et à la compréhension de l'expression, mais ont souvent échoué à intégrer leurs importantes découvertes dans la psychologie de la personnalité et du comportement.
L'étude des expressions faciales, qui composent sujet principal Notre intérêt a commencé avec Woodworth (1938), lorsqu'il a proposé le premier système vraiment efficace pour classer les expressions faciales des émotions individuelles. Il a montré que toute la variété des expressions faciales expressives peut être catégorisée à l'aide d'une échelle linéaire, suggérant les six étapes suivantes : 1) amour, joie, bonheur ; 2) surprise ; 3) peur, souffrance ; 4) colère, détermination ; 5) dégoût ; 6) mépris.
Schlosberg (Schlosberg, 1941), appliquant le schéma de classification de Woodworth lors de l'analyse de photographies de personnes ayant différentes expressions faciales, a suggéré qu'elles peuvent être décrites de manière plus adéquate si l'échelle de Woodworth est représentée par un cercle à deux axes : plaisir-déplaisir (plaisir-déplaisir , axe P-U ) et acceptation-rejet (acceptation-rejet, axe A-R). Schlossberg a ensuite ajouté une troisième dimension, la tension du sommeil, et est ainsi venu très près d'accepter et de valider empiriquement les trois dimensions du sentiment proposées pour la première fois par Wundt en 1896.
L'approche de Schlosberg est similaire à celle qui sous-tend l'expérience psychophysique, Schlosberg a également tenté d'associer des jugements à certains phénomènes physiquement mesurables. Dans les premières expériences de Schlosberg, les sujets évaluaient les expressions faciales sur les photographies sur deux échelles en neuf points :<удовольствие-неудовольствие>et à l'échelle<принятие-отвержение>, puis pour chaque image, les scores moyens pour les deux mesures ont été calculés.
Si imaginez Échelles P-U et A-R comme deux axes perpendiculaires se coupant au point 5 (fig. 2-1) et les enfermant dans un cercle centré au point indiqué, alors chaque évaluation des images présentées peut être représentée comme un point dans l'espace à l'intérieur d'un quadrant du cercle . Pour évaluer l'expression émotionnelle du visage, pour déterminer la catégorie d'émotion, vous devez tracer une ligne à partir du centre du cercle, du point d'intersection des échelles linéaires, en passant par le point tracé jusqu'au bord du cercle. La corrélation entre les valeurs de l'échelle circulaire, définies à l'aide de la méthode de tri, et les valeurs déterminées ou prédites à l'aide de deux échelles à neuf points était de 0,76. Ainsi, on peut dire que les échelles<удовольствие-неудовольствие>et<принятие-отвержение>permettent avec une précision suffisante de classer les expressions faciales présentées (même sur les photographies) en termes d'émotions discrètes.
La mesure du stress du sommeil a été introduite par Schlosberg et ses collaborateurs (Engen, Levy, Schlosberg, 1957) sous l'influence des travaux de Duffy et Lindsley et des données indiquant qu'une telle mesure est<активация>important pour l'analyse des émotions. À l'aide d'une série spécialement conçue de photographies d'expressions expressives de visages humains (la série Lightfoot), ils ont montré que les critères<удовольствие-неудовольствие>, <принятие-отвержение>et<сон-напряжение>assez fiable (respectivement 0,94, 0,87 et 0,92 à N = 225). Triiandis et Lambert (1958) ont utilisé les trois mesures de Schlosberg dans une étude interculturelle et ont prouvé leur validité pour les Grecs et les Américains. Cependant, plus tard, d'autres chercheurs (Abelson et Sermat, 1962; Ekman, 1964) ont révélé une forte corrélation entre les mesures<принятие-отвержение>et<сон-напряжение>et ont ainsi remis en question leur indépendance les unes par rapport aux autres et la possibilité de leur utilisation en tant que mesures indépendantes. Plusieurs autres auteurs ont également contribué au développement d'une approche de mesure dans l'étude des émotions et des expressions faciales expressives (Hofstatter, 1955-1956 ; lzard, Nunnally, 1965 ; Plutchik, 1962). Certaines de ces études ont conduit au développement de nouvelles mesures telles que<контроль-импульсивность>(Osgood, 1966),<внимание-невнимание>(Frijda & Phillipszoon, 1963) et<уверенность-неуверенность>(Frijda, 1970).
Les recherches approfondies d'Osgood sur les expressions faciales expressives l'ont amené à formuler trois dimensions d'expression, qu'il a interprétées en termes de dimensions sémantiques d'indices linguistiques. Il est arrivé à la conclusion que ces dimensions qu'il a identifiées - plaisir, activité et contrôle - correspondent à ses dimensions sémantiques d'évaluation, d'activité et de pouvoir.
Théories cognitives de l'émotion et de la personnalité
Les théories cognitives de l'émotion et de la personnalité comprennent au moins deux grandes classes de théories. Ce sont les soi-disant théories.<Я>, ou les théories de la conscience de soi, et les théories qui considèrent les processus cognitifs comme la cause première ou la composante de l'émotion. Le concept central et prédominant de toutes les théories<Я>est le concept de concept de soi. Le concept de soi est un phénomène holistique et intégré, constitué de la perception et de la connaissance que l'individu a de lui-même, et c'est à lui que l'on accorde une grande importance explicative dans les théories.<Я>(Rogers, 1951; Snygg et Combs, 1949). Dans le cadre de ces théories, le comportement est considéré comme une fonction de la perception et surtout de la perception de soi de l'individu.
théories<Я>, sentiment et émotion. Plus la perception ou la connaissance qu'une personne a d'elle-même sont profondes, plus elles sont liées au noyau de sa personnalité, à son moi, plus elles incluent des sentiments, des émotions. La menace du concept de soi provoque la peur chez une personne, l'oblige à se défendre, tandis que la confirmation et l'approbation du concept de soi provoquent de la joie et de l'intérêt chez une personne.
Dans les théories<Я>l'importance d'analyser<чувственного содержания>(par opposition aux expressions verbales strictement sémantiques), ce qui est considéré comme particulièrement important dans le travail d'un psychothérapeute. Un psychothérapeute qui aide une personne à résoudre des problèmes psychologiques doit être capable de voir l'émotion derrière les déclarations du patient. Ce principe est utilisé par de nombreux domaines de la psychothérapie moderne et de la psychologie de la croissance personnelle (par exemple, dans les groupes de formation psychologique, les groupes de réunion, en Gestalt-thérapie). Cependant, la plupart des théories<Я>fonctionne uniquement avec le concept général d'émotion ou de sentiment, presque sans utiliser le concept d'émotions discrètes.
L'émotion en fonction des processus cognitifs. Certaines théories modernes considèrent l'émotion principalement comme une réaction ou un ensemble de réactions provoquées par des processus cognitifs. Une telle vision de la nature des émotions, qui est très caractéristique des représentants de la culture occidentale, est évidemment générée par ces idées sur la nature humaine qui ont leurs racines chez Aristote, Thomas d'Aquin, Diderot, Kant et d'autres philosophes. Ces représentations sont les suivantes : a) l'homme, avant tout et dans la plus large mesure, est un être rationnel ; b) le principe rationnel est utile, bénéfique pour une personne, le principe émotionnel lui nuit et l'entrave ; c) l'esprit (processus cognitifs) devrait servir de facteur de contrôle et de remplacement des émotions.
La plus développée des théories de l'émotion et de la personnalité, construite dans le cadre de la tradition ci-dessus, est la théorie d'Arnold (Arnold, 1960a, 19606). Selon cette théorie, l'émotion surgit à la suite de l'impact d'une certaine séquence d'événements décrits en termes de perception et d'évaluation.
Terme<восприятие>Arnold interprète comment<элементарное понимание>. Dans ce cas<воспринять>objet signifie dans un certain sens<понять>elle, quelle que soit la façon dont elle affecte le percepteur. Pour que l'image présentée dans l'esprit reçoive une coloration émotionnelle, l'objet doit être évalué du point de vue de son influence sur le percepteur. L'émotion n'est donc pas une évaluation, bien qu'elle puisse la porter en elle-même comme une composante intégrale et nécessaire. Plus précisément, une émotion est une attraction ou un rejet inconscient d'un objet, résultant de l'évaluation de l'objet comme bon ou mauvais pour l'individu.
L'évaluation elle-même est un acte non médiatisé, instantané, intuitif, non associé à la réflexion. Il se produit immédiatement après la perception de l'objet, agit comme le dernier maillon du processus perceptif et ne peut être considéré comme un processus séparé que réflexivement.
Ces trois actes, perception-évaluation-émotion, sont si étroitement imbriqués que notre expérience quotidienne ne peut être qualifiée de connaissance objective ; il s'agit toujours de cognition-acceptation ou de cognition-rejet L'appréciation intuitive de la situation donne lieu à une tendance à l'action, qui est vécue comme une émotion et s'exprime par divers changements somatiques et qui peut provoquer des réponses comportementales(Arnold, 1960a, p. 177).
L'émotion peut avoir un effet résiduel ou prolongé. Les tendances à l'action provoquées par l'émotion ont une influence organisatrice sur le processus de perception et d'évaluation ultérieures ; émotions<завораживают и захватывают нас>(Arnold, 1960a, p. 184). De plus, l'évaluation intuitive et la réponse émotionnelle ont tendance à être constantes, de sorte qu'un objet ou une situation, évalué d'une certaine manière et ayant réagi émotionnellement,<всякий раз>évoquent la même appréciation et la même émotion (Arnold, 1960a, p. 184). De plus, l'évaluation de l'objet et la réponse émotionnelle à celui-ci ont tendance à être généralisées - elles sont transférées à toute la classe d'objets.
Autres théories cognitives de l'émotion. Schachter et ses collègues (Schachter, 1966, 1971 ; Schachter et Singer, 1962) ont suggéré que les émotions surgissent sur la base de l'excitation physiologique et de l'évaluation cognitive de la situation qui a provoqué cette excitation. Un certain événement ou une certaine situation provoque une excitation physiologique, et l'individu doit évaluer le contenu de l'excitation, c'est-à-dire la situation qui l'a provoqué. Le type ou la qualité de l'émotion ressentie par un individu ne dépend pas de la sensation qui découle de l'excitation physiologique, mais de la façon dont l'individu évalue la situation. Noter (<по памяти или чувству>) permet à une personne de définir l'excitation comme la joie ou la colère, la peur ou le dégoût, ou toute autre émotion appropriée à la situation. Selon Schechter, la même excitation physiologique peut être vécue à la fois comme de la joie et de la colère (et comme toute autre émotion), selon l'interprétation de la situation. Mandler (Mandler, 1975) et Lazarus (Lazarus, 1982) adhèrent au même point de vue lorsqu'ils expliquent les processus d'activation émotionnelle.
Dans une expérience bien connue, Schachter et Singer (1962) ont testé leur théorie de la manière suivante : un groupe de sujets a reçu une injection d'adrénaline d'excitation, l'autre un placebo. Chacun des groupes a été divisé en trois sous-groupes - un sujet a reçu de vraies informations sur l'effet du médicament, l'autre a reçu de fausses informations et le troisième n'a rien dit sur l'effet possible du médicament. Après l'administration du médicament, tous les sujets faussement informés, certains des sujets qui avaient des informations exactes et certains des sujets qui n'avaient aucune information, sont tombés en compagnie d'une personne qui a démontré un comportement euphorique ; le reste des sujets se sont retrouvés en compagnie d'une personne qui dépeint la rage. Les chercheurs ont constaté que les sujets mal informés et non informés avaient tendance à imiter l'humeur et le comportement de l'acteur, à la fois euphorique et colérique. Les sujets qui avaient des informations précises sur l'action de l'adrénaline étaient moins sensibles aux influences extérieures. Dans le groupe modèle euphorique, les sujets mal informés et non informés ont évalué leurs états joyeux beaucoup plus haut que les sujets correctement informés, mais ces évaluations n'étaient pas très différentes de celles du groupe placebo. Dans le groupe qui a suivi<гневной>modèle, les notes les plus élevées pour l'état de colère expérimenté ont été données par des sujets non informés, mais les membres du groupe placebo n'ont pas confirmé le modèle de Schechter. Leurs notes sur l'échelle de colère autodéclarée ne différaient pas de celles des sujets mal informés et non informés.
Les travaux de Schechter ont stimulé l'étude théorique et expérimentale des émotions, bien que de nombreux chercheurs critiquent son approche méthodologique (lzard, 1971 ; Manstead et Wagner, 1981 ; Plutchik et Ax, 1967). Il est également déprimant que deux expériences reproduisant l'expérience de Schechter-Singer n'aient pas confirmé ses résultats (Marshall, 1976 ; Maslach, 1979). Maslach a démontré qu'une excitation inexpliquée et suggérée par hypnose du système nerveux autonome donne envie à une personne d'interpréter négativement son état intérieur et ses sentiments. Aucune relation significative n'a été trouvée entre les actions de l'acteur et ce que les sujets ont rapporté de leurs expériences. Marshall, à la suite de Schechter et Singer, a utilisé la technique d'excitation narcotique dans son expérience et a obtenu des résultats similaires à ceux de Maslach.
Les derniers développements théoriques des directions cognitiviste et socio-cognitiviste s'apparentent aux théories biosociales dans leur approche du rôle motivationnel et adaptatif des émotions, mais s'en distinguent en ce que les processus cognitifs se voient attribuer un rôle prioritaire dans le processus d'émergence des émotions. . Cependant, pour l'un comme pour l'autre, le fait que les processus cognitifs servent de maillon nécessaire dans la chaîne des événements qui activent l'émotion est indiscutable.
La principale contribution des théories cognitives à l'étude des émotions est la description des processus cognitifs spécifiques aux émotions - un type particulier d'inférence qui provoque une émotion spécifique. Ils ont également approfondi notre compréhension de la relation entre les émotions et les processus cognitifs.
Weiner (1985) explique les antécédents cognitifs de l'émotion en termes d'attribution causale. Selon Weiner, la cause de l'émotion est une fonction d'attribution personnelle à la causalité ou à la cause de l'événement déclencheur. Il propose trois dimensions de causalité : locus (interne-externe), stabilité (stabilité-instabilité) et contrôle (contrôlabilité-incontrôlabilité). Ainsi, par exemple, si vous faites la queue et que quelqu'un essaie de se placer devant vous, vous êtes plus susceptible de considérer sa tentative comme motivée et contrôlée de manière interne, et de vous sentir en colère. Mais si la même personne se trouve au même endroit par accident - par exemple, quelqu'un passe devant et la pousse grossièrement - alors vous interprétez la raison comme externe et non réglementée et, très probablement, vous ressentirez de la pitié pour elle ou de la tristesse.
Des schémas plus sophistiqués de mesures causales ont également été développés (Ellsworth et Smith, 1988 ; Roseman, 1984 ; Smith et Ellsworth, 1985). Ainsi, certains théoriciens proposent de compléter le paramètre de contrôle par le paramètre de responsabilité. Ils croient que l'attribution de la responsabilité et du contrôle est importante pour distinguer les émotions de surprise (responsabilité/contrôle externe) et de culpabilité (responsabilité/contrôle interne).
Certains chercheurs, suivant la tradition cognitiviste, ont tenté de diviser le processus d'activation émotionnelle en étapes. Dans leurs recherches, ils prouvent que les notes/attributions sont les véritables précurseurs de l'émotion. Parce qu'une émotion se produit dans les millisecondes d'un événement interne ou externe, il est extrêmement difficile d'identifier le processus cognitif qui a précédé l'émotion. Cependant, quelle que soit la place occupée par les processus cognitifs dans la chaîne causale, ils participent sans aucun doute au processus d'émergence de l'émotion et font partie de la phénoménologie générale associée aux émotions. Ainsi, les cognitivistes, à la fois théoriciens et praticiens, continuent d'apporter des contributions significatives au développement de la psychologie des émotions.
Émotions résultant de processus biologiques. Les modèles émotionnels comme traits de personnalité
Plutchik (Plutchik, 1962, 1980) considérait les émotions comme un moyen d'adaptation qui jouait un rôle important dans la survie à tous les niveaux évolutifs. Vous trouverez ci-dessous les prototypes de base du comportement adaptatif et leurs émotions correspondantes (structures affectives-cognitives).
Complexe adaptatif protypique ; émotion primaire.
1. Incorporation - l'absorption de nourriture et d'eau;
Adoption;
2. Rejet - réaction de rejet, excrétion, vomissements ; dégoûter;
3. Destruction - suppression des obstacles sur le chemin de la satisfaction; Colère;
4. Protection - initialement en réponse à la douleur ou à la menace de douleur ; Craindre;
5. Comportement reproducteur - réactions accompagnant le comportement sexuel; Joie;
6. Privation - la perte d'un objet qui procure du plaisir; douleur;
7. Orientation - réaction au contact avec un nouvel objet inconnu ; la frayeur;
8. Exploration - activité volontaire plus ou moins erratique visant à explorer l'environnement ; Espoir ou curiosité;
Plutchik définit l'émotion comme une réaction somatique complexe associée à un processus biologique adaptatif spécifique commun à tous les organismes vivants. L'émotion primaire, selon Plutchik, est limitée dans le temps et est initiée par un stimulus extérieur. Chaque émotion primaire et chaque émotion secondaire (c'est-à-dire une combinaison de deux ou plusieurs émotions primaires) correspond à un certain complexe physiologique et expresso-comportemental. Selon Plutchik (1954), le blocage constant des réactions motrices adéquates dans les situations conflictuelles ou frustrantes provoque une tension musculaire chronique, qui peut servir d'indicateur d'une mauvaise adaptation ; il cite un certain nombre de données expérimentales à l'appui de cette thèse.
Selon Plutchik, sa théorie des émotions peut être utile dans l'étude de la personnalité et en psychothérapie. Il a proposé de considérer les traits de personnalité comme une combinaison de deux ou plusieurs émotions primaires, voire mutuellement exclusives. Une telle approche - une analyse de la manière dont les émotions sont mélangées - peut contribuer à une meilleure compréhension de nombreux phénomènes émotionnels importants. Par exemple, le Dodger propose les formules suivantes : fierté = colère + joie ; amour = joie + + acceptation ; curiosité = surprise + acceptation ; modestie = peur + acceptation ; haine = colère + surprise ; culpabilité = peur + joie ou plaisir ; sentimentalité = acceptation + chagrin. Les régulateurs sociaux (phénomènes de surmoi) peuvent être compris dans le système de Plutchik comme une combinaison de peur et d'autres émotions, et l'anxiété comme une combinaison de peur et d'attente. Selon lui, l'analyse des situations qui suscitent la peur chez une personne et l'identification des attentes d'une personne par rapport à de telles situations aident à comprendre la dynamique de l'anxiété.
Approche cognitive-affective
Selon Singer, la relation étroite entre l'affect et les processus cognitifs est basée sur les tentatives de l'enfant de s'adapter à un environnement nouveau et en constante évolution. Singer, comme Tomkins (Tornkins, 1962) et Izard (lzard, 1971), pense que la nouveauté de l'environnement active l'émotion d'intérêt, qui, à son tour, renforce l'activité exploratoire de l'enfant. La conscience environnementale et un ajustement réussi réduisent les niveaux d'excitation et activent l'émotion de joie, tandis qu'une grande quantité de matériel complexe qui n'est pas disponible pour l'assimilation peut provoquer de la peur, de la tristesse ou de la peur.
Le résultat le plus important des recherches de Singer a été l'introduction de ses développements dans le domaine de l'imagination et de l'affect dans la pratique de la psychothérapie (Singer, 1974). Il souligne l'importance d'utiliser l'imagination en combinaison avec l'action (par exemple, dans un jeu de rôle), à l'aide de laquelle le patient apprend à comprendre une variété de manifestations affectives, apprend à contrôler ses émotions, ses pensées et son comportement. Selon Singer, le travail d'imagination et de fantaisie aide à former un sentiment de compétence, développe la maîtrise de soi. Ainsi, par exemple, il a traité avec succès le voyeurisme, en s'appuyant uniquement sur l'imagination du patient. Singer a encouragé le patient à imaginer quelque chose de malsain, dégoûtant, par exemple, lui a demandé d'imaginer un homme nu atteint de lèpre, et a appris au patient à se souvenir de cette image dans les moments d'attirance malsaine, lorsqu'il avait envie de regarder par la fenêtre d'un maison voisine pour y voir une femme se déshabiller. Des images féminines aux couleurs positives ont été utilisées par Singer pour neutraliser la peur hétérosexuelle et les inclinations homosexuelles. Ces techniques se sont généralisées en thérapie psychodynamique, ce qui a permis de comprendre les mécanismes de succès de cette technique.
THÉORIE DES ÉMOTIONS DIFFÉRENTIELLES
La théorie des émotions différentielles a un riche héritage intellectuel et prétend être liée aux travaux classiques de Duchenne, Darwin, Spencer, Kierkegaard, Wundt, James, Cannon, MacDougal, Dumas, Dewey, Freud, Rado et Woodworth, ainsi que aux œuvres plus modernes de Jacobson, Sinnot, Mau-rera, Gelgorn, Harlow, Bowlby, Simonov, Ekman, Holt, Singer et bien d'autres. Tous ces scientifiques, représentant des disciplines et des points de vue différents, sont généralement enclins à reconnaître le rôle central des émotions dans la motivation, la communication sociale, la cognition et le comportement. Cependant, le mérite de la justification conceptuelle de la théorie appartient à notre contemporain, Sylvan Tomkins, dont le brillant ouvrage en deux volumes<Аффект, воображение, сознание>seront fréquemment cités tout au long de ce livre.
La théorie des émotions différentielles est ainsi nommée parce que l'objet de son étude est les émotions privées, chacune étant considérée séparément des autres, comme un processus émotionnel-motivationnel indépendant qui affecte la sphère cognitive et le comportement humain. La théorie est basée sur cinq thèses clés : 1) dix émotions fondamentales (qui seront brièvement définies au chapitre 4 et discutées en détail dans les chapitres suivants) forment le système motivationnel de base de l'existence humaine ; 2) chaque émotion fondamentale a une motivation unique et implique une forme spécifique d'expérience ; 3) les émotions fondamentales, telles que la joie, la tristesse, la colère ou la honte, sont vécues de différentes manières et affectent la sphère cognitive et le comportement humain de différentes manières ; 4) les processus émotionnels interagissent avec les pulsions, avec les processus homéostatiques, perceptuels, cognitifs et moteurs et les influencent ; 5) à leur tour, les pulsions, les processus homéostatiques, perceptivo-cognitifs et moteurs affectent le cours du processus émotionnel.
Les émotions comme principal système de motivation
La théorie des émotions différentielles reconnaît les fonctions des déterminants du comportement dans la plus large gamme de ses manifestations : de la violence et du meurtre, d'une part, aux actes d'abnégation et d'héroïsme, d'autre part. Les émotions sont considérées non seulement comme le principal système de motivation du corps, mais aussi comme des processus personnels fondamentaux qui donnent un sens et un sens à l'existence humaine. Ils jouent un rôle important à la fois dans le comportement humain et dans son monde intérieur.
Six systèmes d'organisation de la personnalité
La personnalité est le résultat d'une interaction complexe de six systèmes : homéostatique, incitatif (système pulsionnel), émotionnel, perceptif, cognitif et moteur. Chaque système est dans une certaine mesure autonome et indépendant, et en même temps chacun des systèmes est en quelque sorte lié aux autres.
Le système homéostatique est essentiellement une série de systèmes entrelacés et interdépendants qui fonctionnent automatiquement et inconsciemment. Les principaux d'entre eux sont les systèmes endocrinien et cardiovasculaire, qui sont associés à la personnalité en raison d'une interaction fréquente avec le système émotionnel. Les mécanismes homéostatiques sont généralement considérés comme auxiliaires du système émotionnel, mais les hormones, les neurotransmetteurs, les enzymes et d'autres régulateurs métaboliques jouent également un rôle dans la régulation et l'émotion activée par le renforcement.
Le système d'entraînement est basé sur les changements tissulaires et les déficits qui en résultent qui signalent à l'individu les besoins du corps. Les pulsions fondamentales sont la faim, la soif, le désir sexuel, la recherche du confort et l'évitement de la douleur. Il est difficile de contester le rôle important des pulsions dans les situations de lutte pour la survie, mais dans la vie de tous les jours (lorsque les besoins de base et le besoin de confort sont satisfaits), les pulsions n'ont de signification psychologique que dans la mesure où elles affectent les émotions. Les exceptions sont la libido et la pulsion d'évitement de la douleur, qui ont toutes deux certaines des caractéristiques de l'émotion en elles-mêmes. Ils interagissent inévitablement avec les émotions, et c'est à cause de cette interaction qu'ils jouent un rôle important dans l'organisation de la personnalité et du comportement.
Pour l'organisation de la personnalité, pour son interaction sociale et pour l'être humain au sens le plus élevé du terme, quatre systèmes sont fondamentalement importants : émotionnel, perceptif, cognitif et moteur. Leur interaction forme la base d'un comportement véritablement humain. Le résultat de l'harmonie dans les relations des systèmes est un comportement efficace. Et vice versa, un comportement inefficace, l'inadaptation est une conséquence directe d'une violation ou d'une mauvaise mise en œuvre de l'interaction systémique.
Les émotions et le système émotionnel
La théorie des émotions différentielles vient du fait qu'elle reconnaît la nécessité d'étudier les émotions individuelles. Cependant, la présence d'une douzaine d'émotions fondamentales, qui, combinées à des pulsions et à des processus cognitifs, forment un ensemble innombrable de structures affectives et cognitives, rend extrêmement difficile l'étude de la motivation humaine.
Les psychologues praticiens dans n'importe lequel des domaines d'activité - en ingénierie, en psychologie de l'éducation ou clinique - arrivent tôt ou tard inévitablement à une compréhension de la spécificité des émotions individuelles. Lorsqu'ils traitent avec des gens, ils voient que les gens sont heureux, tristes, en colère, effrayés, et pas seulement<испытывают>une certaine émotion. De nos jours, les psychologues praticiens utilisent de moins en moins des termes généraux tels que<эмоциональная проблема>, <эмоциональное нарушение>ou<эмоциональное расстройство>, ils tentent d'analyser les affects individuels et les complexes affectifs, en les considérant comme des phénomènes motivationnels.
Définition de l'émotion. La théorie des émotions différentielles définit l'émotion comme un processus complexe qui a des aspects neurophysiologiques, neuromusculaires et sensoriels-expérimentaux. L'aspect neurophysiologique de l'émotion est défini principalement en termes d'activité électrochimique du système nerveux central. Les nerfs faciaux, le tissu musculaire et les propriocepteurs des muscles faciaux sont également impliqués dans le processus émotionnel. On suppose que l'émotion est une fonction du système nerveux somatique (qui contrôle les mouvements volontaires) et qu'une émotion activée somatiquement mobilise le système nerveux autonome (qui régule l'activité des organes et systèmes internes, l'état des tissus corporels), et que , à son tour, peut renforcer et améliorer l'émotion.
Au niveau neuromusculaire, ou expressif, l'émotion se manifeste principalement sous la forme d'une activité mimique, ainsi que de réactions pantomimiques, viscéro-endocriniennes et parfois vocales.
Au niveau sensoriel, l'émotion est une expérience qui a une signification directe pour l'individu. L'expérience de l'émotion peut provoquer un processus dans l'esprit qui est complètement indépendant des processus cognitifs.
Les processus neurochimiques, suivant des programmes innés, provoquent des manifestations mimiques et somatiques complexes, qui sont ensuite réalisées par rétroaction, à la suite desquelles une personne a un sentiment / une expérience d'émotion. Ce sentiment/expérience à la fois motive la personne et l'alerte de la situation. La réponse innée à l'expérience sensorielle d'une émotion positive évoque un sentiment de bien-être chez l'individu et encourage et soutient la réponse d'approche. Les émotions positives contribuent à l'interaction constructive d'une personne avec d'autres personnes, avec des situations et des objets. Les émotions négatives, au contraire, sont vécues comme néfastes et difficiles à supporter, évoquent une réaction de retrait et ne contribuent pas à une interaction constructive. Nous avons déjà dit que, malgré la division philistine des émotions en positives et négatives, le vrai signe d'un expérience émotionnelle ne peut être déterminé qu'à partir du contexte général.
En conclusion de la discussion des éléments individuels de la définition de l'émotion, il convient de noter que l'émotion n'est pas seulement une réaction de l'organisme. Elle ne peut pas être considérée uniquement comme une action accomplie en réponse à un événement ou à une situation stimulante, elle est en soi un stimulus, ou une cause, de nos actions. Apparemment, on peut même dire que les émotions, dans une plus ou moins grande mesure, ont la capacité de s'auto-générer. Cette affirmation semble particulièrement vraie en ce qui concerne l'émotion d'intérêt, qui joue un rôle inhabituellement important dans notre vie quotidienne, nous incitant à telle ou telle activité. Quoi qu'il en soit, toute émotion activée - qu'elle soit générée par des informations sensorielles (par exemple, la sensation de douleur) ou des processus cognitifs (évaluation, attribution) ou qu'elle ait été une réponse à un événement - a elle-même une influence motivante et organisatrice sur nos pensées et nos actions. À leur tour, la pensée et le comportement, ainsi que les informations stockées dans la mémoire, ont une contre-influence sur lui.
La nature systémique des émotions. Les émotions sont dynamiquement, mais en même temps plus ou moins stables, interconnectées, de sorte que la théorie des émotions différentielles les considère comme un système (Cicchetti, 1990). Certaines émotions, en raison de la nature de leurs mécanismes innés sous-jacents, sont organisées hiérarchiquement. Même Darwin (Darwin, 1872) a noté que l'attention peut évoluer vers la surprise, et la surprise -<в изумленное оцепенение>rappelle la peur. Développant cette observation, Thomkins (Tornkins, 1962) soutient que les stimuli qui évoquent les émotions d'intérêt, de peur et d'horreur représentent une sorte de hiérarchie dans laquelle un stimulus d'intensité modérée suscite l'intérêt, et un stimulus de la plus grande intensité, l'horreur. . La validité de cette thèse peut être vue si vous observez la réaction de l'enfant à un son inconnu. Un son d'intensité modérée suscite l'intérêt de l'enfant. Mais si le son inconnu est suffisamment fort lors de la première présentation, il peut effrayer l'enfant, et un son très fort et aigu peut terrifier l'enfant.
En faveur de l'organisation systémique des émotions, une caractéristique telle que la polarité en témoigne également. Évidemment, il y a des émotions qui sont directement opposées les unes aux autres. Le phénomène de polarité a été observé par de nombreux chercheurs depuis Darwin (Darwin, 1872), et chacun d'eux a fourni des preuves en faveur de son existence (Plutchik, 1962). La joie et la tristesse, la colère et la peur sont les exemples les plus courants de polarité. On peut considérer comme contraires et telles émotions comme l'intérêt et le dégoût, la honte et le mépris. Cependant, comme les concepts<позитивное>, <негативное>, la polarité n'est pas une caractéristique qui définit rigidement la relation entre les émotions ; la polarité n'implique pas nécessairement la négation mutuelle. Parfois, les opposés ne s'opposent pas, l'un peut causer l'autre, et un exemple de cela peut nous être au moins aussi compréhensible.<слезы радости>.
D'autres émotions, celles qui ne constituent pas des paires polaires entre elles, dans certaines circonstances, peuvent également être interconnectées entre elles. Lorsqu'une personne rencontre un objet inconnu (potentiellement excitant, potentiellement dangereux) ou se retrouve dans une nouvelle situation, son intérêt peut se transformer en peur. De la même manière, le mépris, mêlé de joie et d'excitation, provoque<воинствующий энтузиазм>(Lorenz, 1966). Si une personne éprouve régulièrement ou assez souvent deux ou plusieurs émotions fondamentales en même temps, si en même temps elles sont associées à certains processus cognitifs avec un certain degré d'obligation, cela peut conduire à la formation d'une structure affective-cognitive ou voire une orientation affective-cognitive. Le terme descriptif orientation affective-cognitive semble être utile pour comprendre certains traits de personnalité. Par exemple, une combinaison d'émotions d'intérêt et de peur, associée à l'idée que le risque, le dépassement du danger contient un élément de jeu, de divertissement, conduit à la formation d'une telle orientation affective-cognitive (ou traits de personnalité) comme une soif d'aventure . Cependant, la combinaison de l'intérêt et de la peur peut être associée au risque lié aux activités de recherche - dans ce cas, l'orientation affective-cognitive d'une personne sera la curiosité.
Non seulement la recherche de la structure des émotions décrite ci-dessus nous permet de définir les émotions comme un système. De plus, les émotions partagent certaines caractéristiques communes. Ainsi, contrairement aux pulsions, les émotions ne sont pas cycliques : les processus digestifs ou tout autre processus métabolique se produisant dans le corps ne peuvent pas faire ressentir à une personne l'émotion d'intérêt, de dégoût ou de honte deux ou trois fois par jour. Les émotions, en tant que facteur de motivation, sont polyvalentes et flexibles. Si la satisfaction d'une pulsion physiologique, telle que la faim ou la soif, nécessite des actions très spécifiques et une nourriture ou une boisson tout à fait objective, alors des émotions de joie, de mépris ou de peur peuvent être provoquées par une variété de stimuli.
Les émotions ont un effet régulateur sur les pulsions et autres systèmes de personnalité. Cette capacité de régulation est l'une des fonctions les plus importantes et les plus courantes des émotions : chaque émotion peut augmenter ou diminuer l'effet d'une autre émotion, pulsion physiologique ou structure affective-cognitive. Par exemple, les pulsions non réduites qui sont dans la tolérance du corps évoquent l'émotion, qui à son tour renforce la pulsion. L'attirance sexuelle renforcée par l'émotion d'intérêt-excitation peut devenir insupportable, tandis que l'émotion de dégoût, de peur ou de chagrin peut l'affaiblir, la masquer, la réduire ou la supprimer.
Les systèmes biologiques au service des émotions. Il existe deux systèmes biologiques qui servent le travail du système émotionnel humain. Il s'agit du système réticulaire du tronc cérébral, qui régule les modifications du niveau d'activité neuronale, et du système viscéro-endocrinien innervé de manière autonome, qui contrôle des paramètres tels que la sécrétion hormonale, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, etc. Le système viscéro-endocrinien aide le corps à se préparer à l'action dirigée provoquée par l'émotion et aide à soutenir à la fois l'émotion et l'action.
Le système émotionnel fonctionne rarement indépendamment des autres systèmes. Certaines émotions ou complexes d'émotions se manifestent presque toujours en interaction avec les systèmes perceptifs, cognitifs et moteurs, et le fonctionnement efficace de la personnalité dépend de l'équilibre et de l'intégration de l'activité des différents systèmes. En particulier, puisque l'influence de toute émotion - intense ou modérée - est généralisée, alors tous les systèmes et organes physiologiques sont plus ou moins impliqués dans l'émotion. L'effet de l'émotion sur le corps est mis en évidence par une réponse spécifique à l'émotion dans les systèmes cardiovasculaire, respiratoire et autres systèmes fonctionnels.
Sources d'émotion. Les sources de l'émotion peuvent être décrites en termes de processus neuronaux, affectifs et cognitifs. Au niveau neuronal, l'origine de l'émotion peut être expliquée comme le résultat de l'activité de certains médiateurs et structures cérébrales, à l'aide desquels les informations entrantes sont évaluées. Au niveau affectif, l'activation de l'émotion peut être expliquée en termes de processus sensoriels et perceptifs, et au niveau cognitif, en termes de processus de pensée individuels. Le problème de l'activation cognitive de l'émotion a été beaucoup plus étudié que les deux autres types d'activation, mais il est néanmoins toujours utile de rappeler qu'en plus des sources cognitives, il existe également des sources d'émotions non cognitives (neurales, affectives). Dans les chapitres suivants, nous parlerons en détail des trois types d'activateurs, mais pour l'instant, nous nous contenterons de les énumérer, en donnant des exemples appropriés.
1. Activateurs neuronaux et neuromusculaires :
a) des hormones et des neurotransmetteurs produits naturellement ;
b) stupéfiants;
c) comportement expressif (expressions faciales, pantomimes);
d) changements dans la température du sang cérébral et processus neurochimiques subséquents.
2. Activateurs affectifs :
b) désir sexuel;
c) fatigue ;
d) une autre émotion.
3. Activateurs cognitifs :
a) évaluation ;
b) attribution ;
c) mémoire ;
d) anticipation.
La théorie des émotions différentielles souligne que l'émotion peut être causée directement par des processus neurochimiques et affectifs sans la participation de processus cognitifs. La liste ci-dessus des activateurs d'émotions neurales, neuromusculaires et affectives est une liste de causes non cognitives du processus émotionnel. De plus, la théorie des émotions différentielles souligne qu'il existe une relation génétiquement déterminée entre une émotion spécifique et l'expérience spécifique qui l'accompagne, et leur existence séparée dans la conscience est acquise. Il s'ensuit que l'expression faciale et la réaction d'une personne à sa propre émotion jouent un rôle important dans le déroulement et la régulation du processus émotionnel. Le lecteur qui souhaite se familiariser avec ces dispositions de la théorie des émotions différentielles pourra se reporter aux travaux d'Izard et de Malatesta (Malatesta, 1987 ; lzard, 1990).
COMPLEXES ÉMOTIONNELS COMPLEXES DANS DES SITUATIONS DE VIE CRITIQUES
Bien que le but de cet ouvrage soit de justifier la discrétion des émotions, dont chacune sera consacrée à un chapitre distinct, dans la vie de chaque personne il y a des moments où il éprouve simultanément plusieurs émotions. Il arrive qu'une émotion le pousse à faire une chose et qu'une autre lui dicte le contraire. Nous considérerons l'interaction complexe de plusieurs émotions en utilisant l'exemple de l'histoire de Mary sur la crise vécue par elle à l'âge de dix-sept ans.
A cette époque, j'étais terriblement malheureux. Je pensais que ma mère était une schizophrène paranoïaque. Quoi que je fasse, elle était toujours insatisfaite, ou plutôt, tout la rendait folle. Dans un esprit de protestation, afin d'affirmer d'une manière ou d'une autre mon droit à l'indépendance, j'ai commencé à fumer, boire et<тусоваться>, - ce dernier l'a particulièrement irritée. À la fin de tout, j'ai commencé à vivre une vie sexuelle au mépris d'elle.
J'ai rencontré Jeff peu avant mes dix-sept ans. Il me semblait que je tombais éperdument amoureux et, vu mon âge, j'étais probablement vraiment amoureux. Nous sommes entrés dans une relation d'un commun accord, et au moins ce n'était pas un sentiment de protestation qui m'a poussé à cela, mais toujours de l'amour. Plus tard, cependant, j'ai commencé à m'amuser en pensant que j'étais engagé dans de telles affaires, dont, si ma mère le savait, ses cheveux se dresseraient sur la tête. Et en même temps je me sentais coupable, j'ai compris que la joie vengeresse n'est pas le meilleur sentiment. Cependant, déjà à cette époque, je commençais à douter que j'aimais ma mère - c'était probablement le problème. Si avant mon amour pour elle était inconditionnel - je l'adorais simplement, maintenant je me demandais de plus en plus - l'ai-je jamais aimée ? J'ai vécu un terrible conflit interne, j'ai été submergé par des sentiments variés, parfois contradictoires. Je me souvenais du passé avec nostalgie, je me suis mis en colère en pensant au présent et je me suis senti coupable quand je me suis surpris à penser que je ne l'aimais pas. Je me suis demandé - suis-je vraiment si cruel que de telles pensées me viennent à l'esprit ? Quoi qu'il en soit, Jeff est vite devenu le sens de ma vie. Il n'a pas seulement<вписался>en compagnie de mes amis, il est devenu un symbole de ma protestation contre ma mère.
Parlant de ses sentiments, Maria ne mentionne pas à quel point son cœur battait lorsqu'elle était en colère contre ses parents, elle ne parle pas de la lourdeur dans sa poitrine qu'elle ressentait lorsqu'elle était submergée par le désir. Vivant une émotion forte, nous ne prêtons souvent pas attention à ses manifestations corporelles, mais néanmoins elles ont lieu et elles sont extrêmement importantes. Dans l'histoire de Marie, les phénomènes mimiques ne sont pas décrits, ce qui n'est pas surprenant. Elle parle de ses sentiments profonds, décrit les expériences qui ont troublé son cœur et se sont déposées dans son esprit. Malgré le fait que dans des conditions stressantes, les expressions faciales sont l'un des principaux moyens par lesquels une personne communique avec ses proches, nous sommes rarement conscients de nos expressions faciales. Lors d'une vive dispute avec nos parents ou notre conjoint, nous ne pensons pas à ce qui est écrit sur notre visage, mais en attendant ces<сообщения>contiennent des informations très importantes et, que nous en soyons conscients ou non, elles sont extrêmement importantes. Si l'émotion est authentique, son expression faciale se produit automatiquement et inconsciemment, mais la nature automatisée de la réaction n'enlève rien à sa signification.
Après quelques mois de notre amitié avec Jeff, la pensée m'est venue à quel point, à quel point<правильно>ce serait si je concevais un enfant de lui. Il m'a semblé que c'est la plus belle chose que l'amour puisse créer. Et j'ai aussi pensé :<Уж от ЭТОГО она просто обалдеет!>Samedi, quand Jeff est venu me chercher, j'étais seul à la maison. La veille, j'avais eu une grosse dispute avec ma mère, et le simple souvenir d'elle me rendait malade. Jeff n'avait pas de préservatifs avec lui, mais cette circonstance ne me dérangeait pas, je pensais qu'au moment crucial il interromprait simplement l'acte. Mais pendant notre intimité, j'ai pris une décision consciente. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réalisé qu'il n'interromprait pas l'acte si je ne le lui rappelais pas. Et je n'ai pas rappelé, même si je savais très bien qu'au milieu du cycle mensuel (et j'étais juste à cette période), le risque de tomber enceinte est le plus grand. J'ai gardé le silence parce que je savais que CECI serait la forme la plus élevée de ma protestation contre mes parents. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler ma vie.
Je devais avoir mes règles deux semaines plus tard, mais elles ne sont pas venues. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais je me suis calmée, je me suis dit que ce n'était qu'un échec du cycle menstruel. Ce n'est que le mois suivant que j'ai vraiment eu peur, quand je n'ai plus eu mes règles. Mais étrangement - j'ai éprouvé en même temps un sentiment qui ne m'était pas familier. La pensée que je portais un enfant d'un être cher a éveillé dans mon âme une sorte d'attente chaleureuse et joyeuse. Maintenant, je pensais, Jeff et moi avions un lien que personne ne pouvait briser. Personne n'aurait pu le faire, mais c'est Jeff qui, lorsqu'il a entendu parler de ma grossesse, a décidé que j'essayais de l'épouser ainsi et a déclaré qu'il ne voulait plus me voir.
J'ai eu un autre test - une conversation avec mes parents. J'avais terriblement peur de lui, et j'avais aussi honte. Si auparavant je voulais vraiment me venger d'eux pour tout, leur faire du mal, maintenant je ne voulais plus du tout. Au contraire, je sentais que c'étaient les personnes les plus proches de moi, j'avais besoin d'eux, j'avais plus que jamais besoin d'eux.
Ce sont les sentiments, les émotions qui ont déterminé le train de pensée et le comportement de Mary. Elle était à peine consciente des changements qui se produisaient dans son corps, et probablement pas du tout consciente de l'expression sur son visage lorsqu'elle était en colère ou triste, mais son sens de chaque émotion était extrêmement aigu. Parlant de la façon dont elle s'est sentie en colère ou dégoûtée, de la peur ou de la perte qu'elle a ressentie, elle parle de ses sentiments. Et ces sensations sont présentées dans son esprit comme des émotions, comme des expériences qui ont prédéterminé ses pensées et ses actions.
Les émotions sont une classe particulière de processus et d'états mentaux associés à des instincts, des besoins et des motivations, reflétant sous forme d'expérience directe (satisfaction, joie, peur, etc.) l'importance des phénomènes et des situations affectant l'individu pour la mise en œuvre de sa vie . Cette définition est incomplète, car elle ne reflète pas un certain nombre de caractéristiques essentielles des émotions et leur différence avec les processus cognitifs, à savoir : a) la connexion des émotions avec la sphère inconsciente n'est pas reflétée, b) leur relation à l'activité (et non activité de la vie) d'une personne, c) la spécificité de leur occurrence), d) les modèles de leur fonctionnement, etc.
Reconnaissant la différence essentielle entre les phénomènes mentaux cognitifs et émotionnels, il serait erroné d'affirmer leur complète autonomie, leur indépendance l'un par rapport à l'autre. La position de L.S. est connue. Vygotsky sur l'unité de "l'affect et l'intellect", ainsi que sur l'opinion selon laquelle "sans émotions humaines, il ne peut y avoir de cognition humaine". Cependant, cette unité ne signifie pas l'identité. Les processus émotionnels et cognitifs interagissent étroitement, mais ils ne sont pas identiques - et c'est l'essence du problème.
L'isolement de l'expérience en tant que forme de manifestation des émotions par opposition à une image dans la sphère cognitive met l'accent sur la différence entre les processus cognitifs et émotionnels, les définissant comme des formes de réflexion mentale met l'accent sur leur connexion, leur unité. Les processus émotionnels affectent l'activité cognitive d'une personne, régulant sa direction, dosant les informations. Les émotions et les sentiments vécus laissent leur empreinte sur nos capacités intellectuelles.
Les systèmes cognitifs et émotionnels fournissent ensemble une orientation dans l'environnement. Par rapport aux informations cognitives, les informations émotionnelles sont moins structurées. Les émotions sont une sorte de stimulateur d'associations de domaines d'expérience différents, parfois sans rapport, qui contribuent à l'enrichissement rapide de l'information initiale. Il s'agit d'un système de "réponse rapide" à tout changement de l'environnement extérieur important du point de vue de la sphère des besoins.
Le fondateur de la théorie de l'installation D.N. Uznadze a souligné que les états émotionnels et les processus cognitifs ont des contenus mentaux irréductibles les uns aux autres. Les processus cognitifs se caractérisent par une réflexion objective et disséquée au maximum de la réalité environnante. Les états émotionnels, au contraire, ont un caractère diffus, holistique, représentant l'état du sujet. Ils contribuent à une réflexion claire de la situation objective et à la concentration de la conscience sur celle-ci.
S.L. Rubinshtein note à ce sujet que les états émotionnels sont caractérisés par plusieurs traits phénoménologiques : premièrement, à la différence des processus cognitifs, ils expriment des modifications de l'état interne du sujet et de sa relation à l'objet ; deuxièmement, ils diffèrent par leur polarité.
Dans le cadre de l'approche neuropsychologique, E.D. Chomsky a résumé les principales différences entre les états émotionnels et les processus cognitifs en tant que fonctions mentales supérieures.
1. Les fonctions mentales cognitives supérieures sont divers types d'activités mentales visant à résoudre certains problèmes psychologiques, c'est-à-dire pour obtenir un certain résultat. Les états émotionnels initient et accompagnent la résolution des tâches cognitives, reflétant le succès ou l'échec de leur mise en œuvre par rapport à l'un ou l'autre besoin. Leur « rendez-vous » est la régulation et l'évaluation des actions et des situations.
2. Les fonctions mentales cognitives supérieures sont largement conscientes et soumises à la forme de contrôle la plus parfaite - le contrôle volontaire. Les phénomènes émotionnels sont moins conscients et moins gérables.
3. Les états émotionnels sont caractérisés par le signe et la modalité, d'autres phénomènes sont qualitativement spécifiques à la sphère cognitive, par exemple la sensation de couleur.
4. Les états émotionnels sont étroitement liés aux processus de besoin-motivation, étant leurs "miroirs internes". Les processus cognitifs sont moins motivés par les besoins, à l'exception des besoins gnostiques, étant principalement des "mécanismes de connaissance".
5. Les états émotionnels sont étroitement liés à divers processus physiologiques (végétatifs, hormonaux, etc.), les processus cognitifs le sont dans une moindre mesure, alors qu'ils interagissent différemment avec le travail des systèmes physiologiques.
6. Les phénomènes émotionnels sont inclus comme un élément obligatoire dans la structure de la personnalité. Les processus cognitifs déterminent la structure de la personnalité dans une moindre mesure : leurs violations particulières sont compatibles avec la sécurité de la personnalité en tant que telle.
Ainsi, les concepts théoriques de divers auteurs montrent que les états mentaux et les processus cognitifs ont des caractéristiques spécifiques et, par conséquent, sont des classes relativement indépendantes de phénomènes mentaux.
A côté du problème de la spécificité de ces phénomènes mentaux, n'est pas moins important le problème de leur unité. A l'époque de la « révolution cognitive », les états émotionnels n'étaient considérés que comme des facteurs source d'erreur et soumis à contrôle lors des expérimentations. À la fin du siècle dernier, les émotions ont commencé à revenir dans l'étude des processus cognitifs, par exemple, l'idée est exprimée de la saturation des représentations cognitives (dont il inclut les perceptions et les représentations) avec des expériences émotionnelles.
Actuellement, de plus en plus de scientifiques se concentrent sur la relation étroite entre les deux catégories. Des modèles sont en cours d'élaboration montrant que l'évaluation finale de la situation est le résultat d'une interaction complexe de processus cognitifs et d'états émotionnels. On a trouvé l'effet de « cadrage émotionnel des processus décisionnels », selon lequel les états (regret, irritation, satisfaction, etc.) sont provoqués par des « effets de cadrage », puisqu'ils dépendent du fait que le résultat est perçu sous forme de BENEFICE ou PERTE.
Selon V. D. Shadrikov, la séparation des processus et des états correspond au stade analytique global de l'étude de la psyché. Sur la base d'une approche systématique, il est nécessaire de procéder à la synthèse des connaissances accumulées. Dans sa conception du monde intérieur d'une personne, l'auteur donne une place prépondérante aux états émotionnels. Concernant la question de la relation entre les processus cognitifs et les états, l'auteur écrit que les états émotionnels déterminent le côté productif des processus mentaux. Ils activent non seulement les processus cognitifs, mais créent également leur arrière-plan émotionnel, leur coloration émotionnelle. Par conséquent, lors de la caractérisation des processus cognitifs, nous pouvons parler de perception émotionnelle, de mémoire émotionnelle, de pensée émotionnelle. Cependant, selon l'auteur, cet aspect des processus mentaux n'a pas été suffisamment développé.
L'idée que les sphères émotionnelle et cognitive du psychisme sont inextricablement liées et doivent être étudiées à l'unisson, pour la première fois en psychologie domestique formulé par S. L. Rubinshtein et L. S. Vygotsky.
La question de «l'unité de l'intellect et de l'affect» était considérée par L. S. Vygotsky comme centrale dans la théorie du développement mental de l'enfant. Cette unité se trouve dans l'interconnexion dynamique et l'influence mutuelle de ces aspects de la psyché à tous les stades du développement mental. La manière d'aborder cette question « vitale » est de considérer les sphères affective et intellectuelle comme un seul système dynamique de signification. Ces idées ont été développées plus avant dans le travail expérimental d'OK Tikhomirov et de ses étudiants.
Du point de vue de la théorie de l'activité, l'interaction des processus cognitifs et des états émotionnels a été considérée dans le contexte du sujet. activités pratiques. Étant donné que les processus cognitifs répondent à certains besoins et motifs, ils subissent l'influence régulatrice des états émotionnels. La relation étroite entre les processus cognitifs et les états émotionnels exprime, selon A. N. Leontiev, la partialité du sujet, son activité, l'appartenance de la réflexion sensorielle au sujet actif.
La partialité de la conscience du sujet s'exprime dans la sélectivité de l'attention, dans la coloration émotionnelle des processus cognitifs. Dans le même temps, les émotions remplissent la fonction de signaux internes et reflètent la relation entre les motifs et le succès (ou la possibilité d'une mise en œuvre réussie) de l'activité correspondante du sujet. Ils sont un reflet sensuel direct de ces relations, une expérience, survenant avant une appréciation rationnelle par le sujet de son activité.
Selon S. L. Rubinshtein, il ne faut pas opposer processus et états mentaux, la dynamique des états et les lois auxquelles ils obéissent sont indissociables de la dynamique des processus mentaux. L'acte holistique de réflexion par le sujet sur tel ou tel objet doit servir de véritable unité du mental. Le "produit" de la réflexion a toujours dans sa composition l'unité de deux composantes opposées - "des connaissances et des attitudes, intellectuelles et émotionnelles, dont l'une ou l'autre peut être prédominante".
Par conséquent, tout comme les états peuvent subordonner les processus cognitifs (par exemple, une personne ne comprend que ce qu'elle «ressent»), les processus cognitifs peuvent provoquer divers états émotionnels. L'auteur note que l'existence d'états intellectuels de surprise, de curiosité, de doute, de confiance est un exemple de l'interpénétration des sphères intellectuelle et émotionnelle.
L'idée de l'unité des états et des processus, ainsi que la nature dynamique de leur relation, avec L. S. Vygotsky, S. L. Rubinshtein, est également exprimée par de nombreux autres chercheurs. Par exemple, A. V. Petrovsky note que dans le contexte de la psyché, les processus et les états mentaux individuels agissent comme une unité, formant des systèmes d'activité intégraux qui mettent en œuvre les transitions mutuelles de «l'objectif» et du «subjectif», agissant ainsi comme un système dynamique. Une opinion similaire est exprimée par J. Piaget, selon laquelle le comportement implique l'existence de deux aspects interdépendants : énergétique (ou affectif) et cognitif (ou structurel). L'aspect affectif assure des échanges avec l'environnement, qui sont structurés par des processus cognitifs qui déterminent la relation entre le sujet et l'objet. Les sphères affective et cognitive sont ainsi indissociables, tout en restant distinctes.
L'unité dialectique des deux catégories est notée par I. I. Chesnokova. Selon l'auteur, l'état est une manière d'organiser les processus mentaux dans un certain laps de temps. D'autre part, le cours du déploiement des processus mentaux eux-mêmes, directement liés aux conditions d'activité, produit de nouveaux états mentaux qui commencent à interagir avec l'état de fond.
K. Izard, considérant la relation entre les processus cognitifs et les états émotionnels, note que les états émotionnels sont souvent associés à des images mentales, formant des structures affectives-cognitives, et que la composante émotionnelle fournit une charge de motivation pour la structure. À titre d'exemple, l'auteur cite un état de bonheur dans lequel une personne perçoit le monde à travers des "lunettes roses", tandis que l'état émotionnel organise et dirige l'activité mentale de l'individu. L'analyse théorique de la relation entre les processus cognitifs et les états émotionnels conduit l'auteur à la conclusion suivante : comment un état peut activer un processus cognitif et influencer son cours, et vice versa. Par conséquent, la relation entre les processus cognitifs (perception, imagination, mémoire, réflexion) et les états émotionnels "... peut être caractérisée comme dynamique et réciproque".
La relation entre les processus cognitifs et les états mentaux se manifeste le plus clairement dans les états altérés. Ch. Tart dans la définition de "l'état modifié de conscience" indique que l'une de ses caractéristiques catégorielles les plus importantes est un changement dans la qualité des processus mentaux. C'est le changement de la qualité des processus cognitifs qui est le critère des états altérés, bien que l'individu ressente également des changements quantitatifs, par exemple une augmentation ou une diminution du nombre d'images visuelles, une plus ou moins grande clarté des images, etc. les études citées par Ch. Tart montrent l'effet de ces états sur les caractéristiques qualitatives et quantitatives des processus cognitifs : perception du temps, sélectivité et volume d'attention, pensée logique, etc.
Notons encore un aspect de la relation entre états et processus, lié au concept de composante dominante des États. Sur la base de ce critère, N.D. Levitov a classé les états mentaux en trois groupes : cognitif, volontaire et émotionnel. Avec la dominance de n'importe quel composant, l'état lui-même peut être considéré comme un composant dépendant.
La relation entre les états mentaux et les processus cognitifs est complexe, contradictoire, interdépendante. Chaque composante de la psyché a une expression particulière et concrète dans l'état mental. Cependant, si un composant domine, l'état peut être considéré comme faisant partie de celui-ci. Par conséquent, il est logique de distinguer tout un groupe d'états mentaux, dont la caractéristique commune sera la prédominance de l'un des processus cognitifs. Par exemple, dans le contexte de toutes les autres manifestations de la psyché, le processus de pensée ou d'imagination peut prendre la valeur prédominante. Dans ce cas, les états mentaux doivent être considérés comme des états de réflexion, de rêve, de rêverie. En particulier, sur la base de la dominance, un groupe d'états mentaux gnostiques est distingué : curiosité, surprise, perplexité, doute, perplexité, rêverie, etc.
Ainsi, l'analyse des positions théoriques de divers auteurs montre que les processus cognitifs et les états mentaux diffèrent en termes de dynamisme, de contenu mental, de structure, de fonctions et de fondements neurophysiologiques. D'autre part, ils sont considérés par de nombreux chercheurs comme des phénomènes mentaux interdépendants.
Lors de l'étude de la relation entre les états mentaux et les processus cognitifs, un certain nombre de difficultés surgissent, dont la solution détermine la logique de la recherche empirique. La question la plus importante est conjonctive deux phénomènes mentaux. En effet, les états mentaux et les processus cognitifs sont traditionnellement considérés comme des catégories distinctes de phénomènes mentaux, en même temps, la plupart des chercheurs considèrent les processus cognitifs comme une composante des états mentaux. Cela est dû au fait que les processus cognitifs, en tant que composants d'états, caractérisent l'état dans son ensemble et que des méthodes de diagnostic des processus cognitifs sont utilisées pour étudier les états. Par exemple, des études ont montré que les signes de fatigue les plus prononcés et les plus significatifs sont une altération de l'attention - le volume diminue, les fonctions de commutation et de répartition de l'attention en souffrent. Par conséquent, au niveau psychologique, cette condition peut être considérée comme un syndrome cognitif de la personnalité.
Dans le même temps, le degré d'intégration de chaque processus individuel dans la structure des états mentaux peut être différent. Cette disposition est mise en évidence dans les études empiriques de A.O. Prokhorov, dans lequel l'État est considéré comme un système fonctionnel qui intègre les processus et les propriétés nécessaires à l'exécution efficace des activités.
Lors de l'étude des relations entre les deux catégories, il est nécessaire d'être guidé par les principes d'"interaction" et de "non-disjonctivité du mental". Le dernier principe dans la formulation de S.L. Rubinshtein se lit comme suit: «En psychologie, on parle souvent de l'unité des émotions, de l'affect et de l'intellect, estimant que cela dépasse un point de vue abstrait qui divise la psychologie en éléments ou fonctions séparés ... En réalité, nous devons parler non à propos de l'unité des émotions et de l'intellect dans la personnalité de la vie, mais de l'unité de l'émotionnel ou de l'affectif et de l'intellectuel dans les émotions elles-mêmes, ainsi que dans l'intellect lui-même.
Conformément à ces principes, non seulement les états mentaux intègrent les processus cognitifs, mais vice versa. Les processus de pensée sont un intégrateur d'un certain ensemble d'états émotionnels qui remplissent des fonctions d'orientation et heuristiques. La fonction d'intégration peut également être assurée par les processus cognitifs de la mémoire de travail, de l'imagination et de l'attention.
La mise en œuvre de ces principes dans la pratique est facilitée par une approche systématique qui considère le système comme un ensemble de composants en interaction. Ainsi, les processus cognitifs et les états mentaux, tout en restant des catégories indépendantes de phénomènes mentaux, peuvent en même temps être considérés comme un seul système en interaction.
Le concept d '«interaction» en tant que catégorie philosophique désigne les processus d'influence mutuelle de divers objets les uns sur les autres, leur interdépendance. En termes ontologiques, ce concept est un attribut de la réalité objective avec ses autres propriétés inaliénables : mouvement, espace, temps, réflexion, structure, etc. "L'interaction" définit l'organisation structurelle de tout système matériel et révèle leurs propriétés.
Le concept d'« interaction » fixe les effets directs et inverses des choses et des phénomènes les uns sur les autres, les relations directes et indirectes entre les objets, les échanges mutuels de matière, d'énergie et d'informations. La concrétisation du concept d'interaction s'effectue à travers les concepts de « changement », « formation », « processus », « développement ».
À statistiques mathématiques"interaction" fait référence à l'effet de l'interdépendance de deux variables, par exemple, la difficulté d'une tâche et le niveau d'excitation interagissent souvent de telle manière qu'une excitation accrue conduit à une augmentation du succès de la résolution de problèmes simples, mais un diminution du succès de la résolution de problèmes complexes.
En psychologie, « l'interaction » est considérée comme un processus d'influence mutuelle qui génère un conditionnement et une interconnexion mutuels, ainsi qu'un facteur d'intégration qui contribue à la formation de structures.
L'essence de la catégorie "interaction", telle qu'appliquée à la psychologie générale, a été pleinement révélée dans ses travaux par S.L. Rubinshtein et Ya.A. Ponomarev. Pour définir "l'interaction", ils ont utilisé le concept de "réflexion" - une propriété universelle de la matière, qui consiste en la capacité des objets à reproduire les caractéristiques structurelles et les relations d'autres objets. L'interaction est le reflet de certains phénomènes par d'autres.
La catégorie d'interaction est plus large que la catégorie d'activité, puisque celle-ci ne peut se réaliser sans interaction étroite du sujet avec l'environnement. Même interne, mentale, par exemple, l'activité mentale se produit à propos de quelque chose et est une interaction dans la représentation (sous une forme figurative ou conceptuelle). C'est pourquoi le concept d'interaction est méthodologiquement plus correct que le concept d'activité : il saisit le lien inséparable entre sujet et objet.
L'interaction est toujours associée au dépassement de l'incertitude, par conséquent, dans la phylogenèse, se forment des mécanismes de prise de décision, d'interprétation, de réflexion, de planification, d'anticipation, qui permettent de transformer l'incertitude en certitude ou de réduire la probabilité d'incertitude dans le futur. Surmonter l'incertitude en tant que barrière d'information et d'énergie conduit au développement de systèmes biologiques et sociaux, et la personnalité est considérée comme un produit et un moyen de surmonter l'incertitude par la psyché et la conscience, car surmonter l'incertitude lors de l'interaction avec la situation n'est possible que sur le base de la certitude "interne" du sujet.
Du point de vue de l'application pratique, la question de l'interaction se résume à la contrôlabilité d'un phénomène particulier, ainsi qu'à la possibilité de son changement délibéré. L'étude de l'interaction ou la révélation de la conditionnalité régulière des phénomènes mentaux permet ensuite de procéder à la recherche des voies de leur formation, de leur éducation et de leur auto-administration.
Considérons quelques approches de l'étude de l'interaction.
Approche systémique. L'étude des états mentaux en tant que phénomène polyfonctionnel, holistique, multiniveau nécessite un appareil méthodologique adéquat. Ces exigences sont satisfaites par l'approche système, comprise comme "un ensemble de méthodes par lesquelles un objet réel est décrit comme un ensemble de composants en interaction".
L'une des variétés de l'approche systémique est l'approche analytique du système de Ya.A. Ponomarev. Selon le chercheur, "seul un système en interaction peut être un véritable objet d'analyse scientifique".
Du point de vue de Ya. A. Ponomarev, l'analyse de tout système en interaction en termes fonctionnels, quelles que soient ses spécificités, permet de distinguer les catégories « produit » et « processus ». Le premier reflète le côté statique et spatial du système. Dans le second - le côté dynamique, temporel]. Le fonctionnement des systèmes en interaction s'effectue par des transitions mutuelles du processus vers un produit et une réorganisation des structures des composants par la différenciation et la réintégration de leurs éléments. Les produits d'interaction résultant du processus se transforment en conditions d'un nouveau processus, influençant tout le cours de l'interaction dans la direction opposée. En fonction des propriétés inhérentes aux composants, une méthode d'interaction est formée, sur la base de laquelle le système peut être attribué à une forme ou à une autre. Pour différencier des formes d'interaction qualitativement uniques, Ya.A. Ponomarev identifie deux critères : structure d'organisation système en interaction (critère qualitatif) et Période de latence (critère quantitatif), qui exprime l'unité de temps naturelle inhérente à une forme particulière d'interaction. Ainsi, le temps peut être considéré comme un aspect procédural de l'interaction.
Distinguez les interactions « externes » et « internes ». Les liens externes impliquent la réorganisation des structures des composants par le biais de liens internes. La condition de tout processus d'interaction est un déséquilibre dans le système de composants qui s'est développé en ce moment. Elle peut être causée à la fois par des influences externes et des processus au sein du composant. Toute modification de l'état de l'un des composants entraîne une modification de la relation entre les composants, agissant comme une raison de leur interaction.
Décrit par Ya.A. Ponomarev, les caractéristiques de l'interaction contiennent une tendance au développement du système, puisque son équilibre ne reste jamais statique, mais n'est préservé que dans la dynamique. L'auteur définit le concept de "développement" comme suit : "Le développement est un mode d'existence d'un système de systèmes en interaction, associé à la restructuration d'un système particulier, à la formation de structures temporelles et spatiales qualitativement nouvelles."
Donnons les conditions les plus générales nécessaires à l'interaction : premièrement, ce qui entre en interaction doit se référer à un certain niveau structurel : biologique, mental, physique, etc. (loi de similarité) ; deuxièmement, les structures en interaction ne doivent pas être identiques, elles doivent différer d'une certaine manière pour que l'interaction se produise (la loi de la différence).
À la suite de la réalisation de ces conditions, une influence mutuelle, un échange mutuel et la génération d'un produit d'interaction se produisent.
Approche synergique. En synergétique, le concept d'« interaction » joue un rôle fondamental, qui se reflète dans sa définition en tant que science de l'interaction. La voie de la compréhension des systèmes complexes réside dans la découverte des lois sur la base desquelles ils s'organisent à partir de leur activité interne. Les processus conduisant à l'émergence de structures spatio-temporelles sont appelés « auto-organisation ».
Actuellement, les idées de synergie sont activement utilisées dans divers domaines psychologie. Du point de vue de la synergie, les problèmes du monde intérieur d'une personne, des états mentaux, de la perception, des groupes sociaux, etc. sont étudiés. La synergie peut être considérée comme un nouveau paradigme possible de la science psychologique.
L'une des tâches les plus importantes de la synergétique est l'étude de la relation entre l'être et le devenir. Les conditions initiales incarnées dans l'état du système sont associées à l'être, et les lois régissant le développement temporel du système sont associées au devenir. L'être et le devenir doivent être considérés comme deux aspects corrélés de la réalité. L'idée principale de la synergétique est qu'au stade de la formation, le déséquilibre agit comme une source d'ordre. Le déséquilibre est ce qui génère « l'ordre à partir du chaos.
La vision synergique du monde permet une nouvelle approche du problème de la gestion efficace du développement de systèmes complexes. La gestion inefficace d'un système cognitif ou social consiste à imposer une forme d'organisation inhabituelle au système. Selon la nouvelle approche, il faut se focaliser sur les lois propres d'évolution et d'auto-organisation des systèmes complexes.
G. Haken a été le premier à introduire le terme "synergétique" dans l'usage scientifique. Cette circonstance est due au fait que, contrairement à d'autres chercheurs, G. Haken a accordé une attention particulière aux applications de ses idées en psychologie et dans d'autres sciences humaines. En particulier, lorsqu'il discute de l'application de la synergétique dans les sciences humaines, l'auteur note : « Des concepts synergétiques tels que le paramètre d'ordre et la subordination sont applicables aux sciences qui n'ont pas encore été mathématisées, et aux sciences qui ne le seront jamais, par exemple, à la théorie du développement de la science ».
Répondant aux critiques sur l'application de la synergétique en psychologie, l'auteur note que les principes de la synergétique sont utilisés partout, il serait étrange qu'ils ne s'étendent pas au cerveau et à son activité mentale. L'auteur a exprimé la position initiale dans l'étude des processus mentaux comme suit: "L'activité mentale du cerveau se déroule conformément aux principes de base de l'auto-organisation."
Selon l'approche de G. Haken, les systèmes biologiques et sociaux sont très complexes et il est impossible de proposer une "recette" générale pour leur analyse. Par conséquent, il est nécessaire d'utiliser l'idée principale de la synergie: "Recherche de changements qualitatifsà l'échelle macroscopique.
G. Haken, dans le cadre de son approche, a formulé les principales questions de la synergétique : Quels mécanismes donnent naissance à de nouvelles structures macroscopiques ? Comment décrire les transitions d'un état à un autre ? Pour trouver des réponses à ces questions, l'auteur met en évidence les caractéristiques suivantes des systèmes synergétiques et des "outils" pour leur étude.
1. Les systèmes complexes sont conçus pour exécuter certaines fonctions qui ne peuvent être exécutées qu'avec l'interaction coordonnée de ses éléments constitutifs.
2. Dans tous les cas d'intérêt pour la synergétique, le rôle décisif est joué par la dynamique, il est donc nécessaire d'étudier l'évolution spatio-temporelle du système.
3. Parmi les propriétés distinctives des systèmes synergétiques figure leur stochasticité, l'évolution temporelle des systèmes dépend de causes qui ne sont pas prévisibles avec une précision absolue.
4. Une caractéristique essentielle des systèmes synergétiques est qu'ils peuvent être contrôlés en modifiant les facteurs externes qui agissent sur eux. Ces facteurs externes sont appelés "paramètres de contrôle". En changeant les paramètres de contrôle, on peut étudier l'auto-organisation du système.
5. L'outil principal pour l'étude des systèmes dynamiques est les "paramètres d'ordre", qui déterminent le comportement des composants du système. L'essence du paramètre d'ordre est qu'il s'agit d'une forme de mouvement de la matière, d'un indicateur de coopération et d'une valeur abstraite.
Le paramètre d'ordre remplit deux fonctions, d'une part, il subjugue les éléments du sous-système, d'autre part, les mêmes éléments le maintiennent inchangé.
Le comportement des paramètres d'ordre peut être illustré de deux manières : premièrement, par un modèle spatio-temporel approprié, et deuxièmement, en utilisant des calculs exacts.
Le concept d'états mentaux hors d'équilibre. Dans le cadre de cette approche, basée sur les idées de la synergétique, les états sont considérés comme des structures fonctionnelles qui se forment à la suite de l'introduction d'énergie et d'informations dans le système et qui possèdent une certaine quantité d'énergie.
Selon A.O. Prokhorov, la catégorie des "états de non-équilibre" comprend un sous-ensemble de l'ensemble de tous les états, dont les manifestations dépendent du niveau d'activité mentale du sujet. Ces états sont mis à jour en raison de la signification personnelle des situations, de leur contenu spécifique et de la forte saturation des informations. Les états mentaux hors d'équilibre surviennent en réaction à diverses situations importantes de l'activité de la vie. La composante principale des états de déséquilibre est la composante émotionnelle. Plus fonction communeétats de non-équilibre est d'assurer le processus d'auto-organisation du système.
Les états d'équilibre relatif, les états d'activité mentale accrue et diminuée sont distingués. États de non-équilibre différents niveaux les intensités ont des qualités spécifiques qui se reflètent dans leur structure, leurs fonctions, leur influence sur d'autres phénomènes mentaux.
Les états mentaux hors équilibre ont un certain nombre de caractéristiques spécifiques : les paramètres du système instable sont un petit nombre de caractéristiques d'état qui décrivent la macrostructure (modalité, durée, intensité), ils déterminent le comportement des parties constitutives du système et la relation entre elles ; dans la gamme allant d'états à long terme de faible intensité à des états à court terme de forte intensité, la cohérence de leur structure augmente.
Aspects réflexifs, sémantiques et dynamiques des relations entre états et processus cognitifs
La sélection du versant réflexif des relations des phénomènes étudiés est nécessaire pour les raisons suivantes.
Premièrement, l'inclusion de la réflexion dans la relation des états et des processus cognitifs correspond aux dispositions de la "pointe" de la psychologie cognitive - le métacognitivisme. Selon cette approche, il existe des processus métacognitifs spéciaux qui ne sont pas directement impliqués dans le traitement de l'information, mais remplissent la fonction de sa régulation. La réflexion fait partie des processus métacognitifs et forme un tout indissociable des processus de base du traitement de l'information. Par exemple, dans le concept d'intelligence M.A. La réflexion intellectuelle froide est incluse dans l'expérience métacognitive, qui est la base psychologique de la capacité d'autorégulation intellectuelle. Dans le cadre de l'étude de la pensée V.V. Selivanov renvoie la réflexion à l'une des principales composantes significatives de la pensée - le plan métacognitif, "... manifesté dans la réflexion permanente sur les manières d'agir avec un objet connaissable, les méthodes d'analyse et de généralisation des conditions et des exigences de la tâche, la compréhension connaissances et significations. »
Deuxièmement, l'objet des processus cognitifs ne sont pas seulement les objets du monde extérieur, mais aussi leurs propres processus, états et propriétés. En particulier, les états mentaux eux-mêmes deviennent des « informations » qui doivent être traitées. La vie intérieure de l'individu, son monde intérieur sont extrêmement riches, ils occupent l'attention d'une personne pas moins, et souvent plus que les événements et les circonstances du monde environnant. Tout cela est un déterminant fort de l'état mental. Le degré de prise de conscience par le sujet de son état est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'état mental, il souligne le rôle régulateur de la conscience de soi.
Troisièmement, au cours de l'exécution d'une activité, il y a une "séparation" de l'attention, dont une partie est dirigée vers le contenu de l'activité, et l'autre vers soi-même. Ici se manifestent l'efficacité et la "sagesse" de l'organisation de la psyché, puisque le même système cognitif remplit les fonctions d'orientation dans l'environnement externe et interne. L'auteur propose de distinguer les niveaux des processus réflexifs en fonction des niveaux de la structure de la hiérarchie cognitive. Les états mentaux deviennent alors l'objet d'un processus métacognitif dont l'une des fonctions est l'orientation dans le contenu interne du psychisme. Il convient de noter qu'à un moment N.D. Levitov a distingué l'état mental de concentration intérieure, dans lequel les pensées et les expériences sont au centre de la conscience. La signification fonctionnelle de cet état réside dans la gestion de l'attention et de l'orientation dans le contenu interne de sa propre psyché. Comme établi, le transfert de l'attention de l'activité principale à soi-même est une condition nécessaire à l'autorégulation de l'état psychophysiologique.
Quatrièmement, aujourd'hui parmi les méthodes de diagnostic des troubles mentaux la place principale est occupée par les méthodes psychologiques qui s'adressent à la conscience et à la conscience de soi du sujet, son expérience intérieure et sa réflexion. L'importance de la conscience de soi et de la réflexion est confirmée par l'attention portée par les chercheurs au concept d'expérience en tant qu'unité de base des états mentaux.
Ainsi, il existe des fondements théoriques pour considérer la réflexion comme l'un des principaux facteurs de la relation entre les états et les processus cognitifs.
En même temps, l'aspect réflexif est le domaine le moins étudié de la relation entre états et processus. L'un des premiers à prêter attention à ce problème fut F.D. Gorbov dans le cadre de la psychologie de l'aviation et de l'espace, étudiant les états mentaux en conjonction avec les phénomènes gnostiques créés dans le processus d'autoréflexion. Selon l'auteur, différents états mentaux selon le degré d'expérience sont déterminés par des conditions différentes pour le déroulement de ce processus. Le sujet se « retrouve » dans une activité accompagnée d'introspection (réflexion) et de changements dans le sens de lui-même, entraînant des changements dans l'état mental. Ainsi, dans chaque état mental, il y a un « effet miroir » et un « effet écho » sous une forme latente. L'auteur note l'opportunité de considérer le système "je - le deuxième je" comme un mécanisme important pour la perception et la gestion de son propre États mentaux. Dans le cadre de la régulation réflexive de l'activité mentale, on peut également distinguer le système « je suis un contrôleur » - « je suis un performeur ».
La recherche montre que la conscience de soi fournit des informations qui conduisent à un changement d'état. Cela est dû au fait que dans les situations significatives, l'information sur soi est essentielle pour le sujet, provoquant ainsi un changement d'état. Cela peut être illustré par l'exemple de la timidité situationnelle, dont l'un des facteurs est une maîtrise de soi accrue.
La maîtrise de soi est une réflexion et une évaluation rationnelles par le sujet de ses propres actions sur la base de motifs et d'attitudes personnellement significatifs. Avec une maîtrise de soi accrue, conséquence de la concentration constante du sujet sur lui-même, une personne analyse constamment son comportement, s'évalue négativement, prend soin de l'impression causée et, en général, donne une évaluation négative de son propre état . En conséquence, un état de timidité apparaît, qui est déterminé non seulement par la situation extérieure, mais également par les processus d'autoréflexion.
Dans le dictionnaire psychologique de V.P. Zinchenko et B.G. La réflexion de Meshcheryakov est comprise comme un processus de pensée visant à analyser, comprendre, prendre conscience de soi, y compris ses propres actions, expériences, états, attitudes envers soi-même et les autres, etc. Conceptuellement, procéduralement et fonctionnellement, la réflexion est associée à l'auto-observation, à l'introspection , conscience de soi.
Dans le dictionnaire psychologique édité par A.V. La réflexion de Petrovsky est comprise comme un processus de connaissance de soi par le sujet d'actes et d'états mentaux internes. La réflexion n'est pas seulement la connaissance ou la compréhension du sujet lui-même, mais aussi la découverte de la façon dont les autres connaissent et comprennent le « réflecteur », ses caractéristiques personnelles, ses réactions émotionnelles et ses représentations cognitives.
OUI. Leontiev relie la réflexion à la fonction de régulation sémantique de la vie. Le résultat de l'élaboration réflexive des significations est leur transformation, décrite par l'auteur comme les effets de la prise de conscience du sens. Les processus de restructuration des structures sémantiques sont la solution du problème du sens - déterminer la place d'un objet ou d'une situation dans le contexte de la vie du sujet. Le résultat est la verbalisation du sens originel, son incarnation dans le sens. Ainsi, la prise de conscience des significations s'effectue du fait de la réflexion dirigée par le sujet sur ses rapports au monde.
Une définition proche de la réflexion est donnée par V. I. Slobodchikov et E. I. Isaev: «... C'est une capacité si spécifiquement humaine qui lui permet de faire de ses pensées, de ses états émotionnels, de ses actions et de ses relations, en général, l'objet d'une attention particulière. (analyse et évaluation) et transformation pratique (jusqu'à l'abnégation au nom d'objectifs nobles et de la mort « pour son ami ») ». Les auteurs caractérisent la réflexion comme la capacité d'effectuer une autodétermination sémantique des valeurs par rapport à la vie en général.
Le concept de réflexion est du même ordre que le concept d'interprétation. La réflexion est une explication par une personne à elle-même de son propre comportement, états, expériences, etc. En conséquence, une estimation cohérente des états propres est obtenue. L'interprétation est un processus informationnel car elle réduit l'incertitude qui donne lieu à de nombreuses interprétations. L'essence de l'interprétation (atteindre la certitude) consiste également à déterminer le sens de l'information, sa signification personnelle (évaluation).
Cette compréhension de la réflexion fait écho aux dispositions des théories cognitives des émotions. Dans la théorie cognitive des émotions de S. Schechter, l'interprétation des informations dont dispose l'individu sur son propre état et l'influence extérieure est le principal facteur déterminant l'intensité, la durée et la modalité de l'état émotionnel. L'interprétation et l'évaluation de l'état sont mises en œuvre sur la base de processus cognitifs. Des idées similaires sont présentées par R. Lazarus dans le contexte de la théorie psychologique du stress. L'interprétation et l'évaluation sont considérées comme des processus de détermination du sens de la situation et des possibilités de la surmonter. Selon l'auteur, une telle évaluation est également réalisée sur la base de processus cognitifs. Dans le cadre du concept d'autorégulation de l'état psychophysiologique, une composante cognitive est considérée, qui est responsable de l'évaluation de son propre état.
Ainsi, dans les définitions considérées de la réflexion, tout d'abord, son côté intellectuel est noté comme un processus d'analyse, d'évaluation, d'interprétation de ses états internes, processus, propriétés. Au cours de la réflexion sur soi, le sujet se transforme en un contenu de processus cognitifs. La relation étroite entre la réflexion et la sphère sémantique du sujet est également soulignée.
De plus, dans la recherche moderne, on a tendance à considérer la relation entre les états émotionnels et la cognition comme médiatisée et régulée par la personnalité. Les chercheurs pensent qu'il existe un système de certains traits de personnalité ou capacités qui sont responsables de l'organisation de l'influence des états émotionnels sur la sphère cognitive d'une personne. En particulier, cette tendance se concrétise dans le développement du problème de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est comprise comme un certain modèle de capacités qui implique l'intersection de la sphère émotionnelle et de la cognition. Quatre facteurs d'intelligence émotionnelle ont été identifiés : perception des émotions, compréhension des émotions, gestion des émotions, utilisation des émotions. L'intelligence émotionnelle est au cœur de l'autorégulation, en fait elle a à voir avec reflets leurs états émotionnels propres et "étrangers" et leur gestion à des fins d'adaptation. Le produit final de l'intelligence émotionnelle est la prise de décision basée sur la compréhension des états émotionnels, qui sont une évaluation différenciée des événements qui ont une signification personnelle.
Dans le cadre de la psychologie sociale, un « modèle de l'impact » des états émotionnels sur la cognition est en cours d'élaboration. Les liens entre les deux sphères reposent sur divers mécanismes dont la pertinence est déterminée par le type de pensée sociale et la situation. Premièrement, les émotions servent à initier des catégories cognitives identiques ou similaires, et deuxièmement, les états émotionnels sont des informations sur certains phénomènes du monde social. Ces mécanismes sont activés dans diverses situations. Si une personne a besoin d'une réflexion et d'une interprétation approfondies des informations, l'influence des états émotionnels sur la cognition s'effectue par le premier mécanisme, avec des tâches qui nécessitent peu d'effort cognitif - par le second, réfléchissant mécanisme. Les états émotionnels ont des effets plus importants sur le processus de cognition lorsqu'une personne est impliquée dans une activité cognitive active.
Ainsi, dans les études citées, les états mentaux et les processus cognitifs sont considérés comme un objet cognitif, ils sont « perçus », « réfléchis », « évalués », « interprétés ». Tous ces processus sont mis en œuvre sur une base réflexive. Par conséquent, on peut supposer qu'un domaine de recherche prometteur peut être l'étude de la relation entre les états et les processus cognitifs, en tenant compte de la réflexion, sur la base de laquelle l'interprétation de l'état, son «sens», influençant le caractéristiques significatives des processus cognitifs, a lieu. D'autre part, la réflexion est considérée comme le niveau personnel le plus élevé de régulation des processus cognitifs. Par conséquent, compte tenu des positions de divers chercheurs, on peut faire une hypothèse sur l'influence significative de la réflexion sur l'interaction des états mentaux et des processus cognitifs.
Le versant sémantique de la relation entre états mentaux et cognitifs processus.
Les dispositions suivantes peuvent servir de base la plus générale pour mettre en évidence l'aspect sémantique des relations entre états et processus cognitifs.
1)Principe méthodologique général de "non-disjonctivité du mental"(S.L. Rubinshtein, A.V. Brushlinsky), selon laquelle les phénomènes mentaux contiennent des aspects procéduraux et personnels, tandis que la relation des deux aspects reste ontologiquement inséparable, « non disjonctive ». Le mental en tant que processus se caractérise par son extrême dynamisme, sa mobilité continue et sa variabilité. Le cadre méthodologique de l'étude du mental en tant que processus implique la révélation de la relation entre les étapes du processus au cours de leur formation. L'aspect personnel des phénomènes mentaux apparaît dans le cas de l'étude de la relation d'une personne à certaines tâches, à la situation dans son ensemble, à d'autres personnes, etc.
Dans le cadre de la relation entre états et processus cognitifs, la nécessité de prendre en compte les relations personnelles a été pointée par S.L. Rubinstein, BF. Lomov, V.N. Myasishchev et d'autres Ainsi, selon B.F. Lomov, le concept de «relations subjectives d'une personne» est le plus général, désignant la position subjective d'une personne dans une situation donnée. "Attitude" inclut le moment de l'évaluation, exprime la partialité de l'individu et est proche dans son contenu des concepts de "signification personnelle", "attitude", en même temps, parlant par rapport à eux générique. En tant que traits de personnalité intégraux, les relations affectent tous les processus mentaux (phénomènes) et se manifestent par des réactions émotionnelles.
L'une des mises en œuvre modernes de «l'approche personnelle» de l'étude de la relation entre la cognition et les états émotionnels est le développement du problème des capacités émotionnelles («intelligence émotionnelle»).
2) La position de L. S. Vygotsky sur l'unité des aspects intellectuels et affectifs de la psyché. Selon ce principe relation processus intellectuels et les émotions s'effectuent dans le cadre d'un "système sémantique dynamique".
Cette idée a été mise en œuvre avec le plus de succès par O.K. Tikhomirov et ses collaborateurs dans des études expérimentales sur la régulation émotionnelle de la pensée. Le lien inextricable entre les états émotionnels et la pensée a été montré, le facteur «central» de leur interaction a été révélé - «la signification du but ultime». Sous l'influence du sens du but ultime, le sens de la situation se développe, médiatisé par le développement des « sens opératoires » des éléments de la situation. Dans les travaux ultérieurs, le motif a commencé à être considéré comme un système sémantique dynamique formant un système.
Examinons ces études plus en détail. D'ACCORD. Tikhomirov a étudié la relation entre la pensée et les états émotionnels dans le processus de résolution de problèmes d'échecs complexes. Les résultats des expériences ont montré que la «décision émotionnelle» précède parfois l'émission d'une solution toute faite de dizaines de minutes, et à l'avenir, elle délimite la zone des recherches ultérieures, dirigeant l'activité mentale. Ainsi, selon l'auteur, "... les états émotionnels remplissent diverses fonctions régulatrices et heuristiques dans la pensée". Interprétant la nature du lien entre les états émotionnels et trouvant l'idée principale de résoudre le problème, l'auteur conclut que les états sont inclus dans le processus de recherche d'une solution. Ils sont associés à la sélection d'une zone approximative où une solution peut être trouvée, comme s'ils déterminaient la signification subjective d'une direction de recherche particulière.
Dans les études de Yu.E. Vinogradov montre l'impossibilité d'une solution correcte de problèmes mentaux difficiles sans la participation d'états émotionnels. L'auteur pointe le phénomène de "développement émotionnel", qui consiste en une augmentation de l'activation émotionnelle lors de l'exécution d'opérations logiques, dont le point culminant est la "solution émotionnelle" du problème. Le développement émotionnel, y compris une évaluation des éléments objectivement significatifs, a contribué à la formation de leur signification chez les sujets, de sorte que les processus de développement émotionnel et sémantique se sont avérés interconnectés, tandis que plus tôt la coloration émotionnelle des actions avec une signification objective éléments sont apparus, plus vite leur sens a été formé et la tâche a été résolue. Ainsi, selon l'auteur, l'activation et la régulation émotionnelles ont un impact significatif sur la structure de l'activité mentale, étant les fonctions les plus importantes des émotions dans le processus de résolution de problèmes complexes.
Selon I.A. Vasiliev, lorsqu'il étudie le problème de la régulation émotionnelle de l'activité mentale, il est légitime d'utiliser des concepts tels que "les émotions et les sentiments intellectuels". Ces émotions surviennent au cours de l'activité mentale et sont dirigées vers le processus mental lui-même, en corrélation avec ses phases individuelles. C'est cette orientation qui détermine la possibilité de réguler l'activité mentale. Par exemple, au cours de l'analyse d'une situation problématique, une contradiction apparaît entre les exigences du but et sa propre expérience, vécue sous la forme d'un état de surprise. Les tentatives de résolution des contradictions conduisent à une certaine conjecture, ce qui conduit à l'apparition d'un état de conjecture. L'étape de vérification des suppositions qui ont surgi est caractérisée par les états de doute et de certitude. L'acceptation d'une intuition conduit à la dominance de l'émotion de la certitude. Au dernier stade, des émotions spécifiques apparaissent associées au résultat de l'activité mentale. Ainsi, les émotions intellectuelles, lorsqu'elles sont considérées dans l'unité avec le processus de pensée, reçoivent une caractéristique significative. L'auteur estime que les émotions intellectuelles sont une évaluation, sur cette base, il distingue la fonction d'orientation et de motivation des émotions dans le processus de pensée. Ces fonctions sont des formes spécifiques de régulation émotionnelle.
3)Le concept de détermination sémantique des états par A. O. Prokhorova, au sein duquel est développée l'hypothèse que l'organisation sémantique de la conscience détermine la sélectivité de l'influence des situations de vie sur le sujet. La situation est « réfractée », médiatisée par des structures sémantiques, on y distingue des composantes significatives qui ont du sens pour le sujet, les états mentaux sont une conséquence de cette détermination. Ainsi, les caractéristiques sémantiques de la personnalité sont l'un des facteurs de la relation entre la réflexion cognitive et l'état actualisant, influençant les caractéristiques de ce dernier.
À un moment donné, B.A. Vyatkin et L.Ya. Dorfman, considérait l'expérience comme l'unité initiale d'analyse des états mentaux, liant la situationnalité et l'objectivité des expériences aux aspects énergétiques et sémantiques, tandis que ce dernier aspect était noté comme le principal. Ces deux caractéristiques des expériences, selon les auteurs, déterminent la modalité de l'état.
Le rôle important des caractéristiques sémantiques dans la relation entre les états et les processus cognitifs, compte tenu de leur lien avec les expériences, peut également être mis en évidence par les études JI. R. Fakhrutdinova, qui, en particulier, a examiné la relation entre les perceptions visuelles et les idées avec les états mentaux. Il a été montré que les expériences du sujet sont le lien médiateur dans les relations entre états et processus cognitifs. Selon l'auteur, l'accumulation de changements dans les caractéristiques quantitatives et qualitatives des processus se produit dans ce maillon intermédiaire, le changement de l'état mental lui-même se produit après avoir dépassé une certaine "masse critique". Ainsi, les expériences agissent comme un mécanisme d'autorégulation dans un système complexe "d'état de processus". Les résultats de l'étude indiquent que les caractéristiques spatio-temporelles sont prédominantes dans l'influence des processus mentaux sur les états à travers les expériences.
De plus, dans le cadre d'une psyché holistique, l'aspect sémantique agit en conjonction avec ses autres caractéristiques signifiantes. Le concept de "contenu", en règle générale, est en corrélation avec la catégorie de conscience et ses composants. Pour la conscience, le sujet, la signification sémantique est spécifique, qui est le contenu sémantique des diverses formations mentales. Le contenu sémantique se forme chez une personne en train de maîtriser la parole et le langage. Au niveau de la conscience, les états mentaux et les processus cognitifs acquièrent une nature symbolique dont l'étude est associée à la phénoménologie du sujet. Par exemple, les états mentaux au niveau de la conscience sont représentés par des significations et des expériences. L'aspect contenu n'est spécifique qu'à la psyché humaine et reflète son conditionnement culturel et historique. Selon D.A. Leontiev: "L'âme est le contenu."
V.M. Rousalov. Le contenu, y compris la vision du monde, les idéaux, les valeurs, les aspirations, etc., est déterminé par des facteurs sociaux. Les caractéristiques dynamiques, qui se manifestent dans les caractéristiques temporelles du comportement (tempo, rythme, vitesse des opérations, etc.), sont significativement liées aux propriétés biologiques d'une personne. L'auteur a montré que les propriétés dynamiques de la personnalité, qui se manifestent dans le tempérament et les capacités, sont déterminées par l'organisation des qualités naturelles d'une personne. Dans le même temps, les propriétés naturelles ne déterminent pas les caractéristiques significatives de l'activité mentale.
En ce qui concerne le problème de la détermination des états, N.D. Levitov: "... L'état mental d'une personne dépend dans une plus large mesure de l'importance pour une personne de la situation dans laquelle elle se trouve."
Récemment, le côté contenu des états mentaux est devenu le sujet d'un intérêt accru des chercheurs. Par exemple, A.O. Prokhorov a mené des recherches sur les espaces d'états sémantiques. Il a été établi que les processus cognitifs sont médiatisés par des états qui affectent leur déroulement, leurs manifestations et leur conscience, et établissent également la complexité catégorielle des processus. L'auteur a identifié quatre facteurs principaux - catégories qui déterminent les processus cognitifs dans l'espace sémantique des états mentaux : activité, évaluation, attitude, dynamisme. Les mêmes facteurs sont entrés dans la structure catégorielle des états mentaux, montrant ainsi qu'il existe une certaine proximité de la catégorisation de ces phénomènes dans l'esprit humain. L'influence des caractéristiques de niveau des processus cognitifs sur la taille des espaces sémantiques des états a également été révélée - une plus grande productivité des processus cognitifs correspond à un plus grand espace sémantique des états mentaux.
Le contenu sémantique des états et processus mentaux est associé à un contenu sensoriel, certaines données disponibles pour la conscience. Selon la tradition phénoménologique d'E. Husserl, l'intentionnalité ou « référence » des phénomènes mentaux à certains objets du monde extérieur est une caractéristique essentielle de la vie mentale. Dans les Amsterdam Reports, l'auteur écrit : «... Comme la réflexion nous le révèle, il est inséparable de la perception qu'elle est la perception de ceci et de cela, de même que l'expérience d'un souvenir est en soi le rappel de ceci et de cela. . - quelque chose, tout comme penser - il y a penser à telle ou telle pensée, les gens ont peur de quelque chose, ils aiment quelque chose, etc. Du point de vue de la théorie psychologique de la signification, un état est « une orientation intentionnelle active du sujet vers certains phénomènes du monde extérieur ou intérieur ».
En psychologie domestique, le terme "objectivité" est un analogue du concept d'intentionnalité. OUI. Léontiev note que l'incompréhension de ce terme "objectivité" est plutôt la règle que l'exception. Le sujet peut être à la fois un objet idéal et un objet matériel ; le sujet fait également partie intégrante des événements de la vie et des actions spécifiques du sujet.
L'objectivité des états mentaux est traditionnellement associée aux concepts de situation et d'expérience. L'expérience par le sujet de son attitude face à la situation ou aux différentes étapes de l'activité est une caractéristique essentielle de l'état. Cette compréhension des états nous permet de répondre à la question « pourquoi un état apparaît-il ? ».
Les caractéristiques de contenu dans l'étude des états jouent un rôle décisif. L'état mental est souvent caractérisé non pas tant par sa nature fonctionnelle (il est mental, émotionnel ou volontaire), que par le côté contenu, l'orientation. La colère inappropriée, causée par une raison insignifiante, ne peut être identifiée à la colère, réaction à une infraction grave. Sous la direction de N.D. Levitov a compris l'attitude sélective particulièrement expérimentée envers la réalité, qui est caractéristique d'une personne donnée. L'orientation selon cette définition signifie le contenu d'objectifs et de motifs significatifs. L'auteur appelle la pleine conscience comme l'une des formes d'orientation, comme sa caractéristique, qui se manifeste à la fois dans l'attention involontaire et volontaire.
Au niveau de la conscience, les expériences acquièrent leur sens et donnent lieu à une caractéristique importante de la vie mentale - la signification. Toute activité dépend de la "signification" des images sensorielles, de la conscience du sujet. L'activité objective du sujet est toujours médiatisée par les processus de la conscience. Les significations, représentant une relation interne particulière, réfractent la situation dans l'esprit d'une personne. Le sujet distingue entre la signification objective de certains phénomènes et leur signification pour lui-même, ainsi, les mêmes phénomènes peuvent acquérir une signification personnelle différente dans la conscience du sujet, ce qui crée la partialité de la conscience humaine. Par définition, A.N. Leontiev, la signification personnelle est la relation entre les motifs et les objectifs de l'activité, est une évaluation de la signification vitale pour le sujet des circonstances objectives et de ses actions dans ces circonstances.
Les caractéristiques de contenu des processus cognitifs, comme le montrent les études des scientifiques nationaux, sont déterminées par leur objectivité en tant que propriété principale. Les objets du monde environnant ou leurs agrégats, constituant des situations intégrales, forment le contenu sensoriel des processus cognitifs. Au niveau de la conscience, les processus cognitifs acquièrent les qualités de catégorisation et de signification. Ainsi, les processus cognitifs sont déterminés avant tout par le monde objectif. Des postes similaires sont occupés dans la psychologie cognitive étrangère.
Dans le même temps, l'une des questions problématiques dans le cadre de l'approche informationnelle est la question de la représentation de l'information sur le monde extérieur dans l'esprit humain. Cela est dû au fait que les représentations internes ne sont pas isomorphes à la réalité environnante, mais ont comme condition préalable l'expérience antérieure d'une personne. Ce sont les structures de l'expérience passée qui déterminent le contenu et les caractéristiques procédurales des processus cognitifs.
Les études empiriques montrent principalement l'influence des états émotionnels sur les processus cognitifs. Parallèlement, de nombreux chercheurs constatent en termes de contenu l'effet inverse des processus cognitifs sur les états.
L'un des mécanismes d'une telle influence est l'amorçage cognitif. Le contenu d'une pensée particulière augmente la probabilité que d'autres pensées apparaissent dans l'esprit, sémantiquement liées à l'originale. En conséquence, l'état émotionnel correspondant à la "pensée germe" est amélioré.
Un autre mécanisme implique des évaluations cognitives. Par exemple, le concept de R. Lazare accorde une place importante à la signification de l'événement par rapport au bien-être de l'individu. L'intensité des états dépend de « combien est en jeu » et de la confiance de la personne dans sa capacité à faire face à la situation. Partant de l'idée de la signification subjective des événements, l'auteur introduit le concept d '«évaluation» et décrit certaines de ses variétés: «dommage», «menace», «défi».
La relation à double sens entre les processus cognitifs et les états d'agressivité chez les enfants a été étudiée par N.A. Doubinko. Un niveau élevé d'agressivité est associé à la perception de situations ambiguës comme dangereuses, nuisibles et menaçantes. Ainsi, cet état mental détermine les caractéristiques qualitatives de la connaissance du monde environnant. En revanche, les États agressifs collégiens peut être le résultat d'un faible développement des compétences sociocognitives. Les idées des enfants sur l'agressivité affectent leurs états et leur comportement.
L'état mental a influence significative sur la perception et la classification des situations de vie actuelles. D'autre part, les souvenirs d'événements de la vie modifient l'état du sujet en fonction de leur contenu. De plus, les auteurs notent que, parallèlement aux événements stressants, les états dépressifs du sujet peuvent provoquer un style cognitif négatif.
Ainsi, non seulement les processus cognitifs acquièrent une direction sous l'influence des états émotionnels, mais vice versa. Cela souligne à nouveau la nécessité de considérer ces phénomènes mentaux comme un système en interaction. En même temps, il est important de noter le lien de l'orientation avec la sphère sémantique de la personnalité. Par exemple, D.A. Léontiev réfère l'intentionnalité aux caractéristiques les plus générales de la sphère sémantique, puisque le sens de quelque chose indique le but ou l'orientation de la cible.
Sur la base des études théoriques et expérimentales considérées, on peut supposer que le contexte sémantique de l'activité a un impact significatif sur la relation entre les états et les processus cognitifs, déterminant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des états mentaux (modalité, polarité, intensité, etc. ) et les processus cognitifs (orientation, sélectivité, productivité). De plus, la productivité des processus cognitifs peut dépendre non seulement des états vécus, mais aussi de la « correspondance » des états et des processus cognitifs en termes de contenu.
Aspect dynamique des relations entre états mentaux et processus cognitifs est associée aux exigences d'une approche systémique fonctionnelle de leur étude, au sein de laquelle des opportunités sont ouvertes pour identifier les modèles de relations entre deux phénomènes mentaux et leurs fonctions. Selon E.P. Ilyin : "Comprendre l'état comme le statu quo de la psyché humaine (c'est-à-dire une tranche de son état fonctionnel à l'heure actuelle) contredit la compréhension de l'état comme des processus en développement dynamique et ne nous permet pas d'identifier ni la cause ou les mécanismes de son apparition. Il est nécessaire d'enregistrer la dynamique des indicateurs pendant une certaine période de temps sous certaines influences sur une personne (méthode diachronique).
L'aspect dynamique est lié à l'aspect contenu, puisque l'intensité de l'état peut être considérée comme une condition du maintien de certaines structures intentionnelles de la conscience. Cette approche reflète les liens interdisciplinaires entre la théorie psychologique du sens et les idées conceptuelles sur l'état en tant que structure fonctionnelle dotée d'une certaine énergie.
Dans l'étude de la dynamique des états et processus mentaux, les catégories scientifiques générales d'énergie, d'espace et de temps jouent un rôle important. D'après B. F. Lomov, le niveau des processus et des états mentaux rapproche la psychologie des sciences naturelles, il est donc légitime d'utiliser ici les méthodes des sciences naturelles. Cette particularité de l'objet d'étude a contribué au fait que de nombreuses études ont été réalisées dans le cadre d'une approche systématique et de la méthodologie de la synergétique.
Historiquement, les premières études expérimentales de la relation entre les états émotionnels et les processus cognitifs ont commencé à être menées dans le laboratoire de V.M. Bekhterev. Par exemple, dans la thèse de V.V. Sreznevsky, l'influence de l'état de peur sur les processus mémoire à court terme Plus tard, S.L. Rubinshtein, résumant les résultats de nombreuses études empiriques, est arrivé à la conclusion que les états peuvent à la fois augmenter et diminuer l'efficacité de l'activité, peuvent donner des effets de sens opposé ou des effets généralisés qui s'appliquent à toutes les manifestations de la personnalité. S.L. Rubinstein a noté que les processus mentaux et les états mentaux ne devraient pas être opposés, car la dynamique des états et les modèles auxquels ils obéissent sont inextricablement liés à la dynamique des processus mentaux. En outre, l'auteur a souligné la dépendance de ce dernier aux propriétés de l'individu, ainsi que le rapport du niveau de ses réalisations et de ses revendications qui se sont développées au cours d'activités antérieures.
Influence régulatrice des états émotionnels sur les processus mentaux S.L. Rubinstein a décrit à l'aide de la métaphore des "passerelles", qui, installées à une hauteur ou à une autre, adaptent le cours des processus cognitifs, volitionnels et autres, définissant ainsi divers aspects dynamiques de l'activité. Dans le même temps, l'auteur note la dépendance des caractéristiques dynamiques des états à leur contenu (relation à l'objet vers lequel l'activité est dirigée).
Parmi recherche contemporaine le côté dynamique des relations entre les états et les processus cognitifs est le plus pleinement représenté dans les travaux d'A.O. Prokhorov. Selon l'auteur, l'étude des mécanismes de la relation entre les états mentaux et les processus devrait consister à étudier la structure des états mentaux. L'état mental, étant le reflet de l'ensemble de la psyché dans son ensemble et de sa certaine composante dominante dans une période de temps donnée, joue le rôle de lien entre les processus mentaux et les traits de personnalité. Chaque composant de la psyché, avec son efficacité suffisante par rapport aux autres composants, peut caractériser un certain état temporaire dans son ensemble. Dans ce cas, l'état mental peut être considéré comme faisant partie de cette composante mentale. De ce point de vue, on peut parler de l'influence mutuelle des processus mentaux et des états.
L'état mental agit comme un niveau fonctionnel général d'activité mentale, par rapport auquel les processus mentaux se développent. En raison des différences dans l'ordre des caractéristiques temporelles des processus et des états, les caractéristiques variables des états sont des paramètres des processus (par exemple, elles définissent le niveau, la plage des changements dans les processus mentaux). Le niveau et les caractéristiques polaires des états mentaux sont d'une importance primordiale.
Des études empiriques de la relation entre les états mentaux et les processus ont été menées dans des conditions réelles d'activités éducatives et pédagogiques dans les écoles et les universités : cours, conférences, séminaires, exercices pratiques, etc. Prokhorov a découvert qu'il existe trois types d'influence des états mentaux sur les processus cognitifs (intervalle de temps heure-jour):
- Les états «passants» qui influencent tout le processus mental (fournissent le contexte);
- états qui affectent le déploiement du processus mental, qui "démarrent";
- les États qui fournissent le milieu du processus ;
- états qui affectent la fin du processus.
Les résultats des études de la relation entre processus et états ont permis d'identifier les schémas de leur interaction : intégration, différenciation, désintégration (caractéristiques dynamiques de l'interaction). Les processus d'intégration sont associés à la convergence des processus individuels vers les états, la désintégration - avec l'effondrement des structures précédentes, la différenciation - avec la formation de blocs structurels et fonctionnels à partir de différents processus et états au cours de l'activité.
Du côté des caractéristiques quantitatives et qualitatives de la relation entre processus et états, les résultats suivants ont été obtenus :
- Les processus mentaux sont impliqués de différentes manières dans l'interaction avec les états de l'intervalle de temps actuel (le rapport du nombre de corrélations significatives à leur nombre total, la valeur moyenne de l'implication des processus cognitifs est de 19%).
- Chaque état individuel intègre plusieurs processus mentaux.
- Un rapport de connexions stables - variables entre les processus mentaux et les états a été trouvé (22% / 78%, respectivement).
- Il existe une particularité de l'intégration des processus et des états mentaux chez les écoliers et les étudiants, en raison du facteur d'activité.
- Les caractéristiques d'âge de l'interaction des processus mentaux et des états sont révélées, par exemple, l'implication de l'imagination dans l'interaction avec les états augmente dans l'ontogenèse (de la 5e à la 10e année).
Ainsi, ces études ont établi que les états mentaux intègrent les processus, agissent comme une manière de les organiser (assurer leur alignement avec les exigences de l'activité), ce qui se manifeste dans l'ampleur de l'inclusion de ces derniers dans les relations avec les états et les spécificités de l'activité. leurs relations. Les états mentaux affectent les caractéristiques procédurales des processus, fournissent le contexte et les étapes du déploiement des processus. Les régularités de la dynamique des relations incluent les processus d'intégration, de différenciation et de désintégration. Des états séparés intègrent plusieurs processus différents. La prédominance de connexions instables et changeantes dans la structure de l'interaction des processus et des états, ainsi qu'une tendance à une plus grande fréquence et à une plus grande proximité des connexions entre les états et les processus d'un niveau hiérarchique supérieur (imagination, pensée) ont été constatées.
En raison du niveau élevé de connexions instables entre les processus mentaux et les états de la structure fonctionnelle, un changement de cette dernière (qualité, nomenclature, signe, intensité) est assuré, ce qui assure l'équilibre du sujet avec l'environnement. Grâce à des connexions relativement stables, la gestion des processus cognitifs est assurée, leur fixation dans la structure fonctionnelle des états.
La question de la relation entre les états mentaux et les processus cognitifs est souvent abordée dans le cadre de l'étude de certaines caractéristiques psychologiques qui affectent la relation de ces phénomènes mentaux. Apparemment, les plus significatifs d'entre eux sont leurs propres caractéristiques d'états et de processus cognitifs.
En ce qui concerne les états mentaux, une caractéristique aussi importante qui détermine les caractéristiques qualitatives des relations est Au niveau de l'état. À cet égard, les études de T.A. Nemchin, qui a étudié l'état de tension neuropsychique. Le chercheur identifie trois niveaux de stress neuropsychique, dont les plus informatifs sont le stress « modéré » et « excessif ». Avec un stress modéré, l'efficacité des principales propriétés de l'attention augmente : le volume, la stabilité et la concentration de l'attention augmentent. Les indicateurs de la mémoire à court terme et de la pensée logique s'améliorent également. En général, il y a une augmentation de l'efficacité de l'activité cognitive, malgré les caractéristiques interfonctionnelles multidirectionnelles des processus cognitifs individuels.
Avec un stress excessif, il y avait une diminution significative des indicateurs de volume, de stabilité, de concentration, de changement d'attention. La productivité de la mémoire à court terme et de la pensée logique est considérablement réduite. Ainsi, les résultats de l'étude montrent qu'à un niveau de stress neuropsychique élevé, l'activité cognitive du sujet est désorganisée.
Le mécanisme des relations entre les processus cognitifs et les états de stress T.A. Nemchin décrit sur la base de la théorie des systèmes fonctionnels. La raison du passage d'un état de repos opérationnel à un état d'activité accrue, ressenti subjectivement comme un stress modéré, est, selon l'auteur, une information sur les changements des conditions externes, qui passe par des analyseurs au niveau perceptif-gnostique du l'organisation neuropsychique de l'individu. Les fonctions gnostiques d'attention, de mémoire, de pensée logique sont activées et augmentent leur productivité, offrant un reflet adéquat de la situation et une efficacité optimale. En conséquence, une évaluation adéquate de la situation et un résultat souhaité programmable sont formés, ce qui est un facteur de formation du système. Dans un état de tension excessive, ce mécanisme est violé, ce qui conduit à une évaluation inadéquate de la situation et à une violation de la coordination des activités des sous-systèmes, ce qui conduit finalement à une désorganisation des activités.
Ainsi, l'auteur attache une importance décisive dans le processus d'adaptation à une situation difficile au bloc d'information du système fonctionnel de tension neuropsychique. Le principal facteur déterminant les mécanismes de formation des états mentaux qui reflètent le processus d'adaptation à des conditions difficiles n'est pas tant l'essence objective de la situation que son évaluation subjective par une personne.
Des études similaires en relation avec les caractéristiques de niveau de l'état de stress ont été menées par L.A. Kitaïev-Smyk. Les résultats des études ont montré que dans le contexte d'un état de stress, non seulement la détérioration des indicateurs des processus cognitifs est possible, mais également leur amélioration significative, conformément aux indicateurs de la participation de ces fonctions à l'activité (avec la préservation des facteurs de motivation qui encouragent l'individu à une activité utile). Le principe de «renforcement de la direction principale» est mis en œuvre en raison de l'affaiblissement des secondaires, qui obéit à la loi de Yerkes-Dodson (avec une augmentation de l'extrême du facteur de stress, après l'amélioration des indicateurs des processus cognitifs, leur détérioration se produit).
Sous un stress modéré, les processus cognitifs se caractérisent par une accentuation de l'attention et de la réflexion, la capacité de prendre des décisions éclairées. Une augmentation de l'intensité du facteur de stress provoque un "rétrécissement" de l'attention, entraînant la perte d'informations importantes pour l'activité. De plus, la perception du temps est déformée, la concentration de l'attention, les indicateurs de mémoire de travail et de réflexion sont réduits. En même temps, le facteur d'extrêmeté est subjectif ; les changements dans l'interprétation de la situation, la certitude et la signification déterminent les possibilités de gestion des manifestations cognitives du stress.
Une autre caractéristique importante qui influence l'interaction avec les processus cognitifs est polarité États.
Dans des études menées par A.O. Prokhorov a montré qu'en général, les états négatifs s'aggravent, tandis que les états positifs augmentent la productivité des processus cognitifs. Selon l'auteur, la raison de ces relations réside dans les différences dans les états vécus par le sujet, à la suite desquelles les fonctions d'intégration et de différenciation des états relient les caractéristiques dynamiques des processus avec des états qualitativement différents de différentes manières.
L'influence des états mentaux négatifs sur le sous-système cognitif dans son ensemble est montrée dans les études empiriques de N.D. Zavalova avec les co-auteurs. Dans certaines conditions d'activité de vol, les états mentaux peuvent conduire à la désintégration d'une réflexion mentale intégrale selon le mécanisme de restructuration des relations dominantes entre ses principaux niveaux : perception, représentation, pensée. Dans le cas de la valeur dominante d'un des niveaux, une déformation importante du système des processus cognitifs peut être observée.
Des études ont également montré que la perception des couleurs dépend de manière significative de la polarité des états d'une personne. Par exemple, les expériences désagréables augmentent la sensibilité au rouge, tandis que les émotions positives rendent une personne plus sensible au bleu. Dans des conditions de stress mental, il y a une détérioration de la discrimination des stimuli de couleur, une réduction de la composante jaune de la perception des couleurs.
L'influence des états émotionnels positifs sur les processus cognitifs est étudiée de manière intensive dans la psychologie étrangère. Les résultats de l'étude de la mémoire montrent que les processus associatifs sont plus productifs dans les états émotionnels positifs. Par rapport aux états négatifs, les sujets sont plus susceptibles de trouver des liens entre divers phénomènes, pensées et idées.
Les données expérimentales obtenues indiquent que l'expérience d'états positifs contribue à une augmentation de la productivité de la pensée, à une amélioration de la compréhension de situations complexes et à une augmentation de la productivité des associations verbales.
Les états positifs (qui incluent le calme, la satisfaction, la joie, l'intérêt, la sérénité, etc.) ont un effet bénéfique sur la pensée - le répertoire des actions mentales augmente, la compréhension des tâches complexes s'améliore et les résultats des tests de créativité et d'esprit vif augmentent . Sur la base de recherches empiriques, «The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions» (The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions) est proposée, selon laquelle un complexe d'états émotionnels positifs augmente considérablement le potentiel de pensée, en tant que résultat, la ressource physique, intellectuelle et sociale de l'individu augmente.
Ainsi, les données empiriques considérées parlent de l'asymétrie fonctionnelle des états mentaux positifs et négatifs. Les états négatifs (détresse, anxiété, peur, paresse, fatigue, etc.) sont généralement associés à la désorganisation des processus cognitifs et à une diminution de leur productivité. Les états émotionnels positifs (calme, intérêt, joie, amour, satisfaction, etc.), au contraire, peuvent être une source importante d'augmentation de l'efficacité intellectuelle d'une personne.
L'une de ces caractéristiques est le style cognitif individuel. D'après M. A. Les styles cognitifs froids sont des capacités métacognitives responsables de la régulation de l'activité intellectuelle. Leurs principales fonctions sont la participation à la construction de représentations mentales objectivées de ce qui se passe et le contrôle des états affectifs dans des conditions de réflexion cognitive. Il existe des preuves dans la littérature concernant la relation entre les styles cognitifs et les états émotionnels. Par exemple, le style cognitif « analyticité » est principalement associé à des manifestations d'états de peur et de détresse, tandis que le fonctionnement avec le style cognitif « synthétique » est associé à un état de colère.
La sensibilité des processus cognitifs à l'influence des états dépend également du degré de structuration du processus cognitif. Par ce terme, J. Reikovsky comprenait le degré de séparation du phénomène réfléchi des autres phénomènes (par exemple, les figures de l'arrière-plan), le degré de séparation des composants du phénomène et les liens entre eux, ainsi que la mesure de la certitude de la structure et de l'organisation du phénomène. Le degré de structuration du processus cognitif dépend, tout d'abord, des propriétés de la réalité connue : moins l'objet de la cognition lui-même est organisé, moins le processus cognitif est structuré. Cette caractéristique dépend des conditions dans lesquelles la cognition a lieu, par exemple, un mauvais éclairage ; une image floue donnée par un projecteur, etc. Selon J. Reikovsky, plus le processus cognitif est structuré, moins il est soumis à l'influence des états émotionnels.
De plus, ces dernières années, dans le cadre du psychodiagnostic, on a eu tendance à considérer les méthodes de mesure des processus cognitifs comme projectives ou quasi-projectives. Cela attire l'attention sur l'analyse qualitative du processus de réalisation des tâches et souligne la dépendance des caractéristiques des processus cognitifs aux facteurs personnels. Ainsi, une approche holistique du psychisme est partiellement réalisée, puisque l'opposition des tests de personnalité et des tests de mesure des caractéristiques des processus cognitifs est levée.
Outre les caractéristiques "propres", d'autres facteurs psychologiques (et psychophysiologiques) influencent apparemment également la relation entre les états et les processus cognitifs, par exemple régulation involontaire. Les idées modernes sur la régulation involontaire des composants d'activation des états sont associées à la théorie de l'autorégulation du tonus mental du psychophysiologiste américain D. Freeman.
Dans des situations ordinaires, l'autorégulation de l'État est « tissée » dans l'activité exécutée en tant que sous-système par le biais de composants d'activation. Les changements d'état se font automatiquement, régulés à un niveau inconscient et involontaire, reflétés par l'activation d'indicateurs physiologiques. Dans des conditions compliquées (manque de temps, exigences accrues de précision, sélectivité, etc.), une personne a besoin d'analyser le «prix» et les moyens d'activité, ce qui se manifeste par une augmentation des tendances à communiquer avec des amis et un expérimentateur, un augmentation de l'activité motrice et de la parole, et un changement rapide de pose, en termes de respiration, de pouls, etc. Ces manifestations caractérisent l'autorégulation involontaire des états, qui vise principalement les composants énergétiques d'activation. La prise de conscience de l'incohérence de l'état actuel avec les exigences de l'activité conduit à la transformation de l'autorégulation en une activité indépendante avec son propre motif, son objectif, son image de l'État. Le motif principal de l'activité d'autorégulation des états est l'évitement des états mentaux négatifs et le désir d'états mentaux positifs.
La moindre possibilité de combiner deux types d'activité est l'activité qui requiert une attention soutenue, excluant son passage à l'autorégulation de l'État. Ainsi, l'inefficacité de l'autorégulation des états dans des conditions d'activité intellectuelle complexe (résolution de tâches visuelles et verbales) a été démontrée.
Un mécanisme similaire pour réguler l'état de monotonie est décrit par E.P. Ilyin. Dans ce cas, le signe principal est une diminution de l'activité mentale, qui se traduit par une perte d'intérêt pour le travail, une diminution de l'attention, une augmentation du temps de la réaction visuo-motrice et une augmentation des influences parasympathiques. Cependant, une telle diminution est en conflit avec les buts et objectifs de l'activité, par conséquent, des mécanismes de régulation sont activés qui sont conçus pour activer les systèmes fonctionnels. L'autorégulation s'effectue par une augmentation de l'activité motrice, entraînant une augmentation du flux d'influx proprioceptifs vers le cortex cérébral. Ainsi, la relation entre l'état de monotonie et les processus cognitifs est médiée par les mécanismes de régulation involontaires de l'individu.
Une autre caractéristique qui affecte la relation entre les états et les processus cognitifs peut être amour propre personnalité. Par exemple, des données sont présentées selon lesquelles, à niveau élevé de développement de l'intelligence, les individus ayant une faible estime de soi réussissent moins bien à effectuer des tâches intellectuelles que les individus ayant une haute estime de soi. Des études empiriques (réalisées sur un échantillon d'adolescents) montrent que le mécanisme psychologique de l'influence de l'estime de soi sur l'efficacité de l'activité intellectuelle est les états émotionnels du sujet.
Le rôle de l'auto-évaluation dans la détermination des états de tension est important. L'auto-évaluation joue un rôle régulateur dans les activités, qui se manifeste dans les caractéristiques de la formation des objectifs, le niveau des réclamations, par rapport au sujet et aux conditions de l'activité.
La relation entre les états et les processus cognitifs (attention, mémoire, réflexion) peut être influencée par les processus d'antipathie, le rapport des évaluations de l'extrême de la situation et la capacité à la surmonter, ainsi que la motivation à la réalisation, les objectifs personnels importants, etc.
Ainsi, l'interaction des états et des processus cognitifs est déterminée par les caractéristiques des états vécus (signe, intensité, niveau, modalité) et des processus cognitifs (le niveau de développement des processus cognitifs, le degré d'organisation des sous-systèmes cognitifs). De plus, les chercheurs notent l'influence des caractéristiques personnelles : estime de soi, autorégulation, style cognitif, etc. Apparemment, aucun de ces facteurs ne peut prédire avec précision la relation entre les états et les processus cognitifs. Par exemple, bien que la plupart des auteurs soulignent l'influence des indicateurs de niveau d'états sur les caractéristiques des processus cognitifs, il est en même temps noté que le résultat de l'interaction dépend de l'inclusion de facteurs de motivation à la réussite, d'autorégulation, d'évaluation et d'interprétation de la situation, etc.
Ainsi, la relation entre les états mentaux et les processus cognitifs est complexe et multiforme. Représentant un système dynamique unique, l'interaction des processus et des états est soumise à l'influence de nombreuses caractéristiques personnelles.
Attribuer les aspects réflexifs, sémantiques et dynamiques de la relation des états mentaux et des processus cognitifs. La réflexivité, la signification personnelle et le facteur temps ont un effet cumulatif sur l'interaction des états mentaux et des processus cognitifs.
Les indicateurs de niveau de réflexivité médiatisent l'interaction des états mentaux et des processus cognitifs. La fonction régulatrice de la réflexivité est associée à ses caractéristiques de niveau : un niveau élevé de réflexivité contribue à une productivité élevée des processus cognitifs à moindre coût énergétique ; le niveau moyen de réflexivité assure l'atteinte d'une productivité maximale des processus cognitifs, sous réserve de l'activation d'états de haute intensité; un faible niveau de réflexivité se caractérise par une productivité minimale des processus cognitifs sur toute la gamme des changements d'intensité des états.
La signification personnelle influence l'organisation de l'interaction des processus cognitifs et des états mentaux. La prédominance de l'orientation procédurale du sens personnel (par rapport à l'orientation vers l'affirmation de soi) dans les situations d'activité d'apprentissage renforce la relation entre les processus cognitifs et les états d'intensité moyenne et faible. Dans le même temps, le niveau d'intégration des processus cognitifs avec des états d'intensité élevée diminue. En termes quantitatifs, cela se traduit par une augmentation de la productivité des processus cognitifs dans des états moins intenses.
En termes dynamiques, l'interaction d'états typiques et de processus cognitifs au cours de l'activité éducative conduit à l'émergence de structures spatio-temporelles qualitativement différentes fondées sur une évolution synchrone de leurs relations : au début des séances de formation, les structures d'états et les processus cognitifs sont caractérisés par un niveau moyen d'intégration ; le milieu des classes s'accompagne de la désintégration des connexions dans la structure des processus cognitifs et d'une augmentation simultanée du niveau d'intégration des états; la fin des entraînements se caractérise haut niveau intégration de la structure des processus cognitifs et faible intégration de la structure des états.
Il a été établi que l'influence des états sur les processus cognitifs est médiatisée par une caractéristique temporelle. Au stade initial des séances d'entraînement, la productivité des processus cognitifs est facilitée par des états d'intensité moyenne, aux stades suivants (milieu et fin de cours) - par des états de haute intensité. Les processus d'attention sont les plus «sensibles» à l'interaction avec les états mentaux dans l'activité éducative, leurs indicateurs sont statistiquement significativement réduits dans les états négatifs de haute et de basse intensité. Les processus de mémoire et de perception sont les plus résistants à l'influence des états : pendant les séances d'entraînement, leurs caractéristiques restent constantes ou s'améliorent.