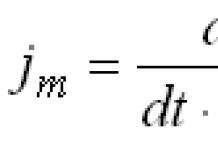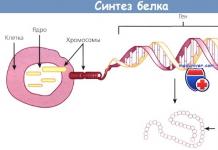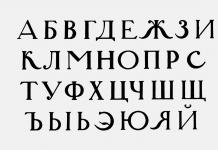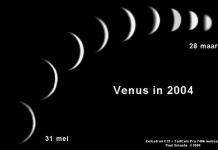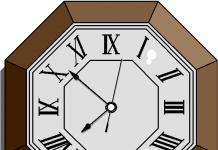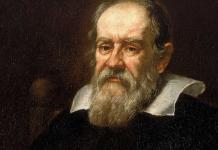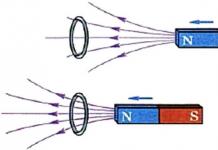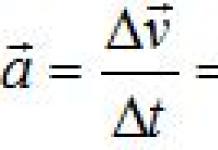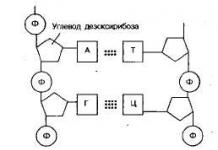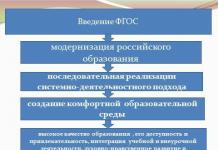F.W.J. Schelling
Études philosophiques sur l'essence de la liberté humaine et sujets connexes
(AVERTISSEMENT). 1809
La présentation qui suit n'appelle, de l'avis de l'auteur, que quelques remarques préliminaires. Puisque l’essence de la nature spirituelle comprend avant tout la raison, la pensée et la cognition, l’opposition entre la nature et l’esprit a naturellement été considérée en premier sous cet aspect. Une ferme conviction que la raison n'est caractéristique que de l'homme, une conviction dans la subjectivité complète de toute pensée et connaissance et que la nature est complètement dépourvue de raison et de capacité de penser, ainsi que le type de représentation mécanique qui domine partout - pour la dynamique Le principe réveillé par Kant n'est passé que dans une certaine forme la plus élevée du mécanique et n'a pas été reconnu dans son identité avec le principe spirituel - justifier suffisamment une telle ligne de pensée. Maintenant, la racine de l'opposition a été arrachée, et l'établissement d'une vision plus correcte peut être tranquillement laissé au mouvement général vers une connaissance plus élevée. Le moment est venu de révéler la plus haute, ou plutôt la véritable opposition, celle entre nécessité et liberté, dont la seule considération nous introduit au centre le plus profond de la philosophie. Après la première présentation générale de son système (dans le Journal of Speculative Physics), dont la suite fut malheureusement interrompue par des circonstances extérieures, l'auteur de cet ouvrage se limita uniquement aux recherches philosophiques naturelles ; donc, outre ce qui est requis dans le travail "Philosophie et religion" le début, qui est resté insuffisamment clair en raison de l'ambiguïté de la présentation, dans cet ouvrage il expose pour la première fois en toute certitude son concept de la partie idéale de la philosophie ; Pour que ce premier travail acquière sa signification, il est nécessaire de l'accompagner de cette étude qui, de par la nature même du sujet, doit inévitablement contenir des conclusions plus profondes sur le système dans son ensemble que dans toute étude d'un caractère plus spécifique. Malgré le fait que l'auteur n'a jamais exprimé son opinion nulle part (à l'exception de son ouvrage « Philosophie et religion ») sur les principaux problèmes qui seront abordés ici - sur le libre arbitre, le bien et le mal, la personnalité, etc., ce n'est pas a empêché certains de lui attribuer, selon leur propre compréhension, des opinions qui, même dans leur contenu, étaient totalement incompatibles avec l'ouvrage mentionné, apparemment laissé sans aucune attention. Beaucoup de choses qui sont incorrectes sur un certain nombre de questions, y compris celles discutées ici, ont également été exprimées prétendument conformément aux principes fondamentaux de l’auteur par ses soi-disant partisans non invités. Il semblerait que seul un système établi et complet puisse avoir des partisans au sens propre du terme. L'auteur n'a encore jamais présenté ce genre de système à l'attention des lecteurs et n'en a développé que ses aspects individuels (et ceux-ci ne sont souvent que dans un cadre séparé, par exemple polémique). Ainsi, il pensait que ses écrits devaient être considérés comme des fragments d'un tout, dont les liens peuvent être discernés avec une plus grande perspicacité que celle qui caractérise habituellement les partisans et une plus grande bonne volonté que celle des opposants. Comme le seul exposé scientifique de son système restait inachevé, personne ne l’a compris dans sa véritable tendance, ou très peu l’ont compris. Immédiatement après l'apparition de ce fragment, son discrédit et sa déformation ont commencé, d'une part, des explications, des révisions et des traductions, de l'autre, et le plus grand mal a été la transposition des pensées de l'auteur dans un langage soi-disant plus brillant (puisqu'il s'agissait d'un c'est à cette époque qu'une ivresse poétique totalement incontrôlable s'empare des esprits). Il semble désormais que le moment soit venu d’adopter des impulsions plus sensées. Le désir de loyauté, de diligence et de profondeur est ravivé. On commence à voir dans le vide ceux qui se sont affublés des maximes de la nouvelle philosophie, assimilant les héros du théâtre français ou les danseurs de corde, pour ce qu'ils sont réellement. Quant à ceux qui, sur tous les marchés, répétaient, comme des airs d'orgue de Barbarie, les nouveautés dont ils s'étaient emparés, ils ont fini par susciter un tel dégoût universel que bientôt ils ne trouveront plus d'auditeurs, surtout si les critiques, qui pourtant ne cherchent pas pour faire du mal, cessez d'affirmer, en écoutant chaque rhapsodie incompréhensible, qui comprenait plusieurs tournures d'un écrivain célèbre, qu'elle a été écrite conformément à ses principes de base. Il est préférable de considérer ces rhapsodes comme des écrivains originaux, car, par essence, ils veulent tous ne faire qu'un, et beaucoup d'entre eux, dans un certain sens, le sont. Que cet essai serve à éliminer un certain nombre d’opinions préconçues, d’une part, et de bavardages vides et irresponsables, d’autre part. Enfin, nous aimerions que ceux qui se sont opposés ouvertement ou secrètement à l'auteur dans cette affaire expriment leurs opinions aussi franchement que cela a été fait ici. La pleine maîtrise d'un sujet permet de l'exprimer librement et clairement ; les méthodes artificielles de polémique ne peuvent pas être une forme de philosophie. Mais nous souhaitons plus encore que l'esprit d'aspirations communes s'établisse de plus en plus et que l'esprit sectaire qui s'est trop souvent emparé des Allemands n'empêche pas l'acquisition de connaissances et d'opinions dont le plein développement était prévu depuis des temps immémoriaux. pour les Allemands et dont ils n'ont peut-être jamais été aussi proches qu'aujourd'hui. Munich, le 31 mars 1809 La tâche de la recherche philosophique sur l'essence de la liberté humaine peut être, d'une part, d'identifier son concept correct, car, si immédiat que soit le sentiment de liberté qui appartient à chaque personne, il n'est en aucun cas superficiel. de conscience et même pour l'exprimer simplement avec des mots, il faut plus qu'une pureté et une profondeur de pensée ordinaires ; d’un autre côté, ces études peuvent viser à relier ce concept à la vision scientifique du monde dans son ensemble. Puisqu'un concept ne peut jamais être défini dans son individualité et n'acquiert une complétude scientifique complète que par l'établissement de sa connexion avec le tout, cela s'applique en premier lieu au concept de liberté qui, s'il a une réalité, ne doit pas être seulement un concept subordonné. ou concept secondaire, mais aussi l'un des points centraux dominants du système, alors les deux côtés nommés de l'étude ici, comme ailleurs, coïncident. Certes, conformément à une légende ancienne, mais en aucun cas oubliée, le concept de liberté est généralement incompatible avec le système, et toute philosophie qui revendique l'unité et l'intégrité conduit inévitablement au déni de la liberté. Il n'est pas facile de réfuter des déclarations générales de ce type, car on ne sait absolument pas quelles idées limitantes sont associées au mot « système », à la suite desquelles un jugement peut s'avérer tout à fait correct, mais en même temps exprimer quelque chose d'assez ordinaire. Cette opinion peut aussi se réduire au fait que la notion de système en général et en elle-même contredit la notion de liberté ; alors comment peut-on admettre - puisque la liberté individuelle est toujours liée d'une manière ou d'une autre à l'univers dans son ensemble (qu'elle soit pensée de manière réaliste ou idéaliste) - l'existence d'un système quelconque, ne serait-ce que dans l'esprit divin, un système, avec lequel la liberté existe également. Affirmer en général que ce système ne pourra jamais être compris par l'esprit humain, c'est encore une fois ne rien affirmer, car selon le sens donné à cette affirmation, elle peut être vraie ou fausse. Tout dépend de la définition du principe qui sous-tend la connaissance humaine ; pour confirmer la possibilité d'une telle connaissance, nous pouvons citer ce que Sextus a dit à propos d'Empédocle : « Le grammairien et l'ignorant supposeront qu'une telle connaissance n'est rien d'autre que la vantardise et le désir de se considérer supérieur aux autres - propriétés complètement étrangères à chacun. qui est même engagé d'une manière ou d'une autre dans la philosophie. Quiconque part de la théorie physique et sait que la doctrine de la connaissance du semblable par le semblable est très ancienne (elle est attribuée à Pythagore, mais se retrouve déjà chez Platon et a été exprimée bien plus tôt par Empédocle), comprendra que le philosophe prétend avoir une connaissance (divine) similaire parce que lui seul, gardant son esprit pur et non affecté par la méchanceté, comprend, avec Dieu en lui-même, Dieu en dehors de lui. Ceux qui sont étrangers à la science ont tendance à la comprendre comme une connaissance complètement abstraite et sans vie, semblable à la géométrie ordinaire. Il serait plus simple et plus convaincant de nier la présence d'un système dans la volonté ou l'esprit de l'être primordial, d'affirmer qu'en général il n'y a que des volontés séparées, dont chacune est un centre pour elle-même et, selon Fichte, est la substance absolue de chaque Moi. Cependant, l'esprit qui aspire à l'unité et le sentiment qui affirme la liberté et l'individualité ne sont toujours freinés que par des exigences violentes, qui ne conservent pas longtemps leur force et sont finalement rejetées. Ainsi Fichte a été contraint de témoigner dans son enseignement de la reconnaissance de l'unité, bien que sous l'apparence misérable de l'ordre moral mondial, dont la conséquence immédiate était l'opposition et l'incohérence de cet enseignement. Par conséquent, il nous semble que, peu importe le nombre d'arguments en faveur d'une telle affirmation qui soient avancés d'un point de vue purement historique, c'est-à-dire basés sur des systèmes antérieurs (nous n'avons pas trouvé d'arguments tirés de l'essence de la raison et de la connaissance n'importe où), l'établissement d'un lien entre le concept de liberté et la vision du monde dans son ensemble restera toujours une tâche nécessaire, sans la solution de laquelle le concept même de liberté restera incertain et la philosophie restera dépourvue de toute valeur. Car seule cette grande tâche est la force motrice inconsciente et invisible de tout désir de connaissance, depuis ses formes les plus basses jusqu'à ses formes les plus élevées ; Sans la contradiction entre nécessité et liberté, non seulement la philosophie, mais en général toutes les plus hautes maîtrises de l'esprit seraient vouées à la destruction, ce qui est le sort des sciences dans lesquelles cette contradiction ne trouve pas d'application. Refuser cette tâche en renonçant à la raison s'apparente plus à une fuite qu'à une victoire. Après tout, on pourrait tout aussi bien renoncer à la liberté en se tournant vers la raison et la nécessité – dans les deux cas, il n’y aurait aucune base pour le triomphe. Cette opinion est exprimée plus clairement dans la déclaration : le seul système de raison possible est le panthéisme, mais le panthéisme est inévitablement le fatalisme. De tels noms généraux, qui définissent immédiatement l'ensemble des vues, sont sans aucun doute une magnifique découverte. Si un nom approprié est trouvé pour un système, alors tout le reste vient naturellement et il n'est pas nécessaire de gaspiller des efforts dans une étude détaillée de ce qui rend le système unique. Même un profane peut, dès que ces noms lui sont donnés, porter son jugement sur les choses les plus profondes de la pensée humaine. Cependant, lorsqu’on fait une déclaration aussi importante, il s’agit toujours d’une définition plus précise du concept. Après tout, si le panthéisme ne signifie rien d’autre que la doctrine de l’immanence des choses en Dieu, alors il serait difficilement possible de nier que toute vision rationnelle doit, d’une manière ou d’une autre, graviter vers cette doctrine. Mais c’est ici le sens qui fait la différence. Sans aucun doute, une vision fataliste peut également être associée au panthéisme ; cependant, il n'y est pas lié dans son essence, comme le montre clairement le fait que beaucoup sont arrivés au panthéisme précisément en raison du sentiment très vivant de liberté qui leur est inhérent. La majorité, si elle voulait être sincère, admettrait que, conformément à ses idées, la liberté individuelle contredit presque toutes les propriétés de l'être suprême, par exemple sa toute-puissance. La reconnaissance de la liberté nous oblige à reconnaître en dehors de la puissance divine et avec elle une puissance qui n'est pas conditionnelle dans son principe, ce qui, selon ces concepts, est impensable. De même que le Soleil éteint tous les corps célestes du firmament, de même, et dans une plus grande mesure encore, la force infinie éteint toute force finie. La causalité absolue chez un seul être ne laisse à tous les autres qu'une passivité inconditionnelle. À cela s'ajoute la dépendance de toutes les créatures du monde à l'égard de Dieu et le fait que même la continuation même de leur existence n'est qu'une création constamment renouvelée, dans laquelle l'être fini n'est pas produit comme une sorte d'universel indéfini, mais comme cet être fini. individu défini avec telles pensées, aspirations et actions et non d'autres. Dire que Dieu s'abstient d'exercer sa toute-puissance pour que l'homme puisse agir, ou qu'il permet la liberté, n'explique rien : si Dieu s'abstenait ne serait-ce qu'un instant d'exercer sa toute-puissance, l'homme cesserait d'être. Existe-t-il une autre issue à ce débat que la conviction qu'il n'est possible de sauver l'homme et sa liberté, puisque sa liberté n'est inconcevable en opposition à la toute-puissance de Dieu, qu'en introduisant l'homme et sa liberté dans l'être divin lui-même, affirmant que l'homme n'est pas hors de Dieu, mais en Dieu, et que son activité même entre dans la vie de Dieu ? C'est précisément à partir de là que les mystiques et les religieux de tous les temps ont acquis la foi en l'unité de l'homme avec Dieu, ce qui, apparemment, est nécessaire au sentiment intérieur tout autant, sinon plus, que la raison et la spéculation. L'Écriture Sainte elle-même voit précisément dans la conscience de liberté l'empreinte et la garantie de la foi que nous vivons et demeurons en Dieu. Comment un enseignement que tant de personnes ont appliqué à l’homme, précisément pour sauver la liberté, peut-il nécessairement contredire la liberté ? Une autre explication, comme on le croit généralement, plus correcte, du panthéisme revient au fait qu'il consiste en l'identification complète de Dieu avec les choses, dans la confusion de la créature avec le créateur, d'où découlent de nombreuses autres déclarations dures et inacceptables. déduit. Cependant, il n’est guère possible de trouver une distinction plus complète entre les choses et Dieu que celle que l’on trouve chez Spinoza, dont l’enseignement est considéré comme un exemple classique du panthéisme. Dieu est ce qui est en soi et n'est compris qu'à partir de lui-même ; le fini est ce qui existe nécessairement dans un autre et ne peut être compris qu'à partir de cet autre. Selon cette distinction, il est évident que les choses diffèrent de Dieu, non pas en degré ou en limites, comme cela pourrait paraître d'après une doctrine de modification superficiellement acceptée, mais en général. Cependant, quel que soit le rapport des choses à Dieu, elles sont absolument séparées de Dieu en ce sens qu'elles ne peuvent être que dans un autre et après un autre (c'est-à-dire en lui et après lui), que leur concept est dérivé et serait complètement impossible sans le concept de Dieu; au contraire, Dieu est la chose unique et initialement indépendante, qui s'affirme, à laquelle tout le reste ne se rapporte que comme quelque chose d'affirmé, en conséquence d'un fondement. Ce n’est que sous cette prémisse que d’autres propriétés des choses, par exemple leur éternité, sont significatives. Dieu est éternel par nature, mais les choses sont seulement avec lui et comme conséquence de son existence, c'est-à-dire de manière dérivée. C'est à cause de cette différence que toutes les choses individuelles prises ensemble ne peuvent pas, comme on le suppose habituellement, constituer Dieu, car il n'existe aucune connexion par laquelle ce qui est par nature dérivé puisse passer dans ce qui par sa nature est original. les points individuels d'un cercle, pris dans leur totalité, ne peuvent pas former un cercle, puisqu'il les précède nécessairement dans son concept dans son ensemble. Plus absurde encore est l’opinion selon laquelle, dans l’enseignement de Spinoza, même une chose distincte doit nécessairement être égale à Dieu. Car même si nous trouvons chez Spinoza une expression acerbe selon laquelle toute chose est une modification de Dieu, les éléments de ce concept sont si contradictoires qu'il s'effondre immédiatement dans son interprétation. Modifié, c'est-à-dire dérivé, Dieu n'est pas Dieu dans son propre sens le plus élevé ; par ce seul ajout, la chose reprend sa place où elle est éternellement séparée de Dieu. La raison de ces interprétations erronées, auxquelles d'autres systèmes ont été sujets dans une certaine mesure, est une méconnaissance générale de la loi de l'identité ou de la signification de la copule dans un jugement. Après tout, on peut expliquer même à un enfant qu'aucune phrase dans laquelle, conformément à l'interprétation acceptée, est exprimée l'identité du sujet et du prédicat, n'affirme ainsi une coïncidence complète ou même un lien direct entre les deux. ; par exemple, la phrase « ce corps est bleu » ne veut pas dire que le corps est bleu en cela et par ce en quoi et par quoi il est corps, mais seulement ce qui suit : ce qui est ce corps est aussi bleu, bien que non dans le même sens. Cependant, une telle hypothèse, indiquant une ignorance totale de ce qui constitue l'essence de la copule, est constamment avancée à notre époque lorsque nous parlons de l'application supérieure de la loi de l'identité. Si, par exemple, on avance la proposition : « Le parfait est l'imparfait », alors son sens est celui-ci : l'imparfait n'est pas par quoi et en quoi il est imparfait, mais par le parfait qui est en lui ; à notre époque, le sens de cette position est le suivant : parfait et imparfait ne font qu'un, tous pareils les uns aux autres, le pire et le meilleur, la bêtise et la sagesse. Ou la position : « le bien est le mal », ce qui signifie : le mal n'a pas le pouvoir d'être par lui-même ; ce qui existe en lui est (considéré en soi et pour soi) bon ; cette disposition est interprétée comme suit : la différence éternelle entre le bien et le mal, la vertu et le vice est niée, on suppose que logiquement ils ne font qu'un. Ou bien, si l'on affirme que le nécessaire et le libre ne font qu'un, ce qui signifie que ce qui (en dernière instance) est l'essence du monde moral est aussi l'essence de la nature, cela s'entend ainsi : le libre est rien de plus qu'une force de la nature, un ressort qui, comme tout autre, est subordonné au mécanisme. Une chose similaire se produit avec l’affirmation selon laquelle l’âme et le corps ne font qu’un ; on l'interprète ainsi : l'âme est matérielle, elle est air, éther, suc nerveux, etc., au contraire - que le corps est une âme ou que dans l'énoncé précédent ce qui semble nécessaire est en soi libre - est prudemment pas remarqué, bien que ce soit sur la même base que l'on puisse déduire de cette déclaration. De tels malentendus, même s'ils ne sont pas intentionnels, indiquent un degré d'immaturité dialectique au-delà duquel la philosophie grecque est allée presque dès ses premiers pas, et nous obligent à considérer comme notre devoir indispensable de recommander avec persistance une étude approfondie de la logique. L'ancienne logique réfléchie distinguait le sujet et le prédicat comme antécédent et conséquent (antecendens et consequens) et exprimait ainsi le sens réel de la loi de l'identité. Cette relation est valable même dans une phrase tautologique, si elle n’est pas totalement dénuée de sens. Celui qui dit : « Le corps est un corps » pense le sujet de la phrase comme absolument différent du prédicat, à savoir : le premier comme une unité, le second comme les propriétés individuelles contenues dans le concept de corps, qui s'y rapportent. comme antécédents aux conséquences. C'est le sens d'une autre explication ancienne, selon laquelle sujet et prédicat s'opposent comme effondrés et élargis (implicitum et explicitum).
F.W.J. SchellingÉtudes philosophiques sur l'essence de la liberté humaine et sujets connexes
(AVERTISSEMENT). 1809
La présentation qui suit n'appelle, de l'avis de l'auteur, que quelques remarques préliminaires.
Puisque l’essence de la nature spirituelle comprend avant tout la raison, la pensée et la cognition, l’opposition entre la nature et l’esprit a naturellement été considérée en premier sous cet aspect. Une ferme conviction que la raison n'est caractéristique que de l'homme, une conviction dans la subjectivité complète de toute pensée et connaissance et que la nature est complètement dépourvue de raison et de capacité de penser, ainsi que le type de représentation mécanique qui domine partout - pour la dynamique Le principe réveillé par Kant n'est passé que dans une certaine forme la plus élevée du mécanique et n'a pas été reconnu dans son identité avec le principe spirituel - justifier suffisamment une telle ligne de pensée. Maintenant, la racine de l'opposition a été arrachée, et l'établissement d'une vision plus correcte peut être tranquillement laissé au mouvement général vers une connaissance plus élevée.
Le moment est venu de révéler la plus haute, ou plutôt la véritable opposition, celle entre nécessité et liberté, dont la seule considération nous introduit au centre le plus profond de la philosophie.
Après la première présentation générale de son système (dans le Journal of Speculative Physics), dont la suite fut malheureusement interrompue par des circonstances extérieures, l'auteur de cet ouvrage se limita uniquement aux recherches philosophiques naturelles ; donc, outre ce qui est requis dans le travail "Philosophie et religion" le début, qui est resté insuffisamment clair en raison de l'ambiguïté de la présentation, dans cet ouvrage il expose pour la première fois en toute certitude son concept de la partie idéale de la philosophie ; Pour que ce premier travail acquière sa signification, il est nécessaire de l'accompagner de cette étude qui, de par la nature même du sujet, doit inévitablement contenir des conclusions plus profondes sur le système dans son ensemble que dans toute étude d'un caractère plus spécifique.
Malgré le fait que l'auteur n'a jamais exprimé son opinion nulle part (à l'exception de son ouvrage « Philosophie et religion ») sur les principaux problèmes qui seront abordés ici - sur le libre arbitre, le bien et le mal, la personnalité, etc., ce n'est pas a empêché certains de lui attribuer, selon leur propre compréhension, des opinions qui, même dans leur contenu, étaient totalement incompatibles avec l'ouvrage mentionné, apparemment laissé sans aucune attention. Beaucoup de choses qui sont incorrectes sur un certain nombre de questions, y compris celles discutées ici, ont également été exprimées prétendument conformément aux principes fondamentaux de l’auteur par ses soi-disant partisans non invités.
Il semblerait que seul un système établi et complet puisse avoir des partisans au sens propre du terme. L'auteur n'a encore jamais présenté ce genre de système à l'attention des lecteurs et n'en a développé que ses aspects individuels (et ceux-ci ne sont souvent que dans un cadre séparé, par exemple polémique). Ainsi, il pensait que ses écrits devaient être considérés comme des fragments d'un tout, dont les liens peuvent être discernés avec une plus grande perspicacité que celle qui caractérise habituellement les partisans et une plus grande bonne volonté que celle des opposants. Comme le seul exposé scientifique de son système restait inachevé, personne ne l’a compris dans sa véritable tendance, ou très peu l’ont compris. Immédiatement après l'apparition de ce fragment, son discrédit et sa déformation ont commencé, d'une part, des explications, des révisions et des traductions, de l'autre, et le plus grand mal a été la transposition des pensées de l'auteur dans un langage soi-disant plus brillant (puisqu'il s'agissait d'un c'est à cette époque qu'une ivresse poétique totalement incontrôlable s'empare des esprits). Il semble désormais que le moment soit venu d’adopter des impulsions plus sensées. Le désir de loyauté, de diligence et de profondeur est ravivé. On commence à voir dans le vide ceux qui se sont affublés des maximes de la nouvelle philosophie, assimilant les héros du théâtre français ou les danseurs de corde, pour ce qu'ils sont réellement. Quant à ceux qui, sur tous les marchés, répétaient, comme des airs d'orgue de Barbarie, les nouveautés dont ils s'étaient emparés, ils ont fini par susciter un tel dégoût universel que bientôt ils ne trouveront plus d'auditeurs, surtout si les critiques, qui pourtant ne cherchent pas pour faire du mal, cessez d'affirmer, en écoutant chaque rhapsodie incompréhensible, qui comprenait plusieurs tournures d'un écrivain célèbre, qu'elle a été écrite conformément à ses principes de base. Il est préférable de considérer ces rhapsodes comme des écrivains originaux, car, par essence, ils veulent tous ne faire qu'un, et beaucoup d'entre eux, dans un certain sens, le sont.
Que cet essai serve à éliminer un certain nombre d’opinions préconçues, d’une part, et de bavardages vides et irresponsables, d’autre part.
Enfin, nous aimerions que ceux qui se sont opposés ouvertement ou secrètement à l'auteur dans cette affaire expriment leurs opinions aussi franchement que cela a été fait ici. La pleine maîtrise d'un sujet permet de l'exprimer librement et clairement ; les méthodes artificielles de polémique ne peuvent pas être une forme de philosophie. Mais nous souhaitons plus encore que l'esprit d'aspirations communes s'établisse de plus en plus et que l'esprit sectaire qui s'est trop souvent emparé des Allemands n'empêche pas l'acquisition de connaissances et d'opinions dont le plein développement était prévu depuis des temps immémoriaux. pour les Allemands et dont ils n'ont peut-être jamais été aussi proches qu'aujourd'hui.
La tâche de la recherche philosophique sur l'essence de la liberté humaine peut être, d'une part, d'identifier son concept correct, car, si immédiat que soit le sentiment de liberté qui appartient à chaque personne, il n'est en aucun cas superficiel. de conscience et même pour l'exprimer simplement avec des mots, il faut plus qu'une pureté et une profondeur de pensée ordinaires ; d’un autre côté, ces études peuvent viser à relier ce concept à la vision scientifique du monde dans son ensemble. Puisqu'un concept ne peut jamais être défini dans son individualité et n'acquiert une complétude scientifique complète que par l'établissement de sa connexion avec le tout, cela s'applique en premier lieu au concept de liberté qui, s'il a une réalité, ne doit pas être seulement un concept subordonné. ou concept secondaire, mais aussi l'un des points centraux dominants du système, alors les deux côtés nommés de l'étude ici, comme ailleurs, coïncident. Certes, conformément à une légende ancienne, mais en aucun cas oubliée, le concept de liberté est généralement incompatible avec le système, et toute philosophie qui revendique l'unité et l'intégrité conduit inévitablement au déni de la liberté. Il n'est pas facile de réfuter des déclarations générales de ce type, car on ne sait absolument pas quelles idées limitantes sont associées au mot « système », à la suite desquelles un jugement peut s'avérer tout à fait correct, mais en même temps exprimer quelque chose d'assez ordinaire. Cette opinion peut aussi se réduire au fait que la notion de système en général et en elle-même contredit la notion de liberté ; alors comment peut-on admettre - puisque la liberté individuelle est toujours liée d'une manière ou d'une autre à l'univers dans son ensemble (qu'elle soit pensée de manière réaliste ou idéaliste) - l'existence d'un système quelconque, ne serait-ce que dans l'esprit divin, un système, avec lequel la liberté existe également. Affirmer en général que ce système ne pourra jamais être compris par l'esprit humain, c'est encore une fois ne rien affirmer, car selon le sens donné à cette affirmation, elle peut être vraie ou fausse. Tout dépend de la définition du principe qui sous-tend la connaissance humaine ; pour confirmer la possibilité d'une telle connaissance, nous pouvons citer ce que Sextus a dit à propos d'Empédocle : « Le grammairien et l'ignorant supposeront qu'une telle connaissance n'est rien d'autre que la vantardise et le désir de se considérer supérieur aux autres - propriétés complètement étrangères à chacun. qui est même engagé d'une manière ou d'une autre dans la philosophie. Quiconque part de la théorie physique et sait que la doctrine de la connaissance du semblable par le semblable est très ancienne (elle est attribuée à Pythagore, mais se retrouve déjà chez Platon et a été exprimée bien plus tôt par Empédocle), comprendra que le philosophe prétend avoir une connaissance (divine) similaire parce que lui seul, gardant son esprit pur et non affecté par la méchanceté, comprend, avec Dieu en lui-même, Dieu en dehors de lui. Ceux qui sont étrangers à la science ont tendance à la comprendre comme une connaissance complètement abstraite et sans vie, semblable à la géométrie ordinaire. Il serait plus simple et plus convaincant de nier la présence d'un système dans la volonté ou l'esprit de l'être primordial, d'affirmer qu'en général il n'y a que des volontés séparées, dont chacune est un centre pour elle-même et, selon Fichte, est la substance absolue de chaque Moi. Cependant, l'esprit qui aspire à l'unité et le sentiment qui affirme la liberté et l'individualité ne sont toujours freinés que par des exigences violentes, qui ne conservent pas longtemps leur force et sont finalement rejetées. Ainsi Fichte a été contraint de témoigner dans son enseignement de la reconnaissance de l'unité, bien que sous l'apparence misérable de l'ordre moral mondial, dont la conséquence immédiate était l'opposition et l'incohérence de cet enseignement. Par conséquent, il nous semble que, peu importe le nombre d'arguments en faveur d'une telle affirmation qui soient avancés d'un point de vue purement historique, c'est-à-dire basés sur des systèmes antérieurs (nous n'avons pas trouvé d'arguments tirés de l'essence de la raison et de la connaissance n'importe où), l'établissement d'un lien entre le concept de liberté et la vision du monde dans son ensemble restera toujours une tâche nécessaire, sans la solution de laquelle le concept même de liberté restera incertain et la philosophie restera dépourvue de toute valeur. Car seule cette grande tâche est la force motrice inconsciente et invisible de tout désir de connaissance, depuis ses formes les plus basses jusqu'à ses formes les plus élevées ; Sans la contradiction entre nécessité et liberté, non seulement la philosophie, mais en général toutes les plus hautes maîtrises de l'esprit seraient vouées à la destruction, ce qui est le sort des sciences dans lesquelles cette contradiction ne trouve pas d'application. Refuser cette tâche en renonçant à la raison s'apparente plus à une fuite qu'à une victoire. Après tout, on pourrait tout aussi bien renoncer à la liberté en se tournant vers la raison et la nécessité – dans les deux cas, il n’y aurait aucune base pour le triomphe.
Cette opinion est exprimée plus clairement dans la déclaration : le seul système de raison possible est le panthéisme, mais le panthéisme est inévitablement le fatalisme. De tels noms généraux, qui définissent immédiatement l'ensemble des vues, sont sans aucun doute une magnifique découverte. Si un nom approprié est trouvé pour un système, alors tout le reste vient naturellement et il n'est pas nécessaire de gaspiller des efforts dans une étude détaillée de ce qui rend le système unique. Même un profane peut, dès que ces noms lui sont donnés, porter son jugement sur les choses les plus profondes de la pensée humaine. Cependant, lorsqu’on fait une déclaration aussi importante, il s’agit toujours d’une définition plus précise du concept. Après tout, si le panthéisme ne signifie rien d’autre que la doctrine de l’immanence des choses en Dieu, alors il serait difficilement possible de nier que toute vision rationnelle doit, d’une manière ou d’une autre, graviter vers cette doctrine. Mais c’est ici le sens qui fait la différence. Sans aucun doute, une vision fataliste peut également être associée au panthéisme ; cependant, il n'y est pas lié dans son essence, comme le montre clairement le fait que beaucoup sont arrivés au panthéisme précisément en raison du sentiment très vivant de liberté qui leur est inhérent. La majorité, si elle voulait être sincère, admettrait que, conformément à ses idées, la liberté individuelle contredit presque toutes les propriétés de l'être suprême, par exemple sa toute-puissance. La reconnaissance de la liberté nous oblige à reconnaître en dehors de la puissance divine et avec elle une puissance qui n'est pas conditionnelle dans son principe, ce qui, selon ces concepts, est impensable. De même que le Soleil éteint tous les corps célestes du firmament, de même, et dans une plus grande mesure encore, la force infinie éteint toute force finie. La causalité absolue chez un seul être ne laisse à tous les autres qu'une passivité inconditionnelle. À cela s'ajoute la dépendance de toutes les créatures du monde à l'égard de Dieu et le fait que même la continuation même de leur existence n'est qu'une création constamment renouvelée, dans laquelle l'être fini n'est pas produit comme une sorte d'universel indéfini, mais comme cet être fini. individu défini avec telles pensées, aspirations et actions et non d'autres. Dire que Dieu s'abstient d'exercer sa toute-puissance pour que l'homme puisse agir, ou qu'il permet la liberté, n'explique rien : si Dieu s'abstenait ne serait-ce qu'un instant d'exercer sa toute-puissance, l'homme cesserait d'être. Existe-t-il une autre issue à ce débat que la conviction qu'il n'est possible de sauver l'homme et sa liberté, puisque sa liberté n'est inconcevable en opposition à la toute-puissance de Dieu, qu'en introduisant l'homme et sa liberté dans l'être divin lui-même, affirmant que l'homme n'est pas hors de Dieu, mais en Dieu, et que son activité même entre dans la vie de Dieu ? C'est précisément à partir de là que les mystiques et les religieux de tous les temps ont acquis la foi en l'unité de l'homme avec Dieu, ce qui, apparemment, est nécessaire au sentiment intérieur tout autant, sinon plus, que la raison et la spéculation. L'Écriture Sainte elle-même voit précisément dans la conscience de liberté l'empreinte et la garantie de la foi que nous vivons et demeurons en Dieu. Comment un enseignement que tant de personnes ont appliqué à l’homme, précisément pour sauver la liberté, peut-il nécessairement contredire la liberté ?
Une autre explication, comme on le croit généralement, plus correcte, du panthéisme revient au fait qu'il consiste en l'identification complète de Dieu avec les choses, dans la confusion de la créature avec le créateur, d'où découlent de nombreuses autres déclarations dures et inacceptables. déduit. Cependant, il n’est guère possible de trouver une distinction plus complète entre les choses et Dieu que celle que l’on trouve chez Spinoza, dont l’enseignement est considéré comme un exemple classique du panthéisme. Dieu est ce qui est en soi et n'est compris qu'à partir de lui-même ; le fini est ce qui existe nécessairement dans un autre et ne peut être compris qu'à partir de cet autre. Selon cette distinction, il est évident que les choses diffèrent de Dieu, non pas en degré ou en limites, comme cela pourrait paraître d'après une doctrine de modification superficiellement acceptée, mais en général. Cependant, quel que soit le rapport des choses à Dieu, elles sont absolument séparées de Dieu en ce sens qu'elles ne peuvent être que dans un autre et après un autre (c'est-à-dire en lui et après lui), que leur concept est dérivé et serait complètement impossible sans le concept de Dieu; au contraire, Dieu est la chose unique et initialement indépendante, qui s'affirme, à laquelle tout le reste ne se rapporte que comme quelque chose d'affirmé, en conséquence d'un fondement. Ce n’est que sous cette prémisse que d’autres propriétés des choses, par exemple leur éternité, sont significatives. Dieu est éternel par nature, mais les choses sont seulement avec lui et comme conséquence de son existence, c'est-à-dire de manière dérivée. C'est à cause de cette différence que toutes les choses individuelles prises ensemble ne peuvent pas, comme on le suppose habituellement, constituer Dieu, car il n'existe aucune connexion par laquelle ce qui est par nature dérivé puisse passer dans ce qui par sa nature est original. les points individuels d'un cercle, pris dans leur totalité, ne peuvent pas former un cercle, puisqu'il les précède nécessairement dans son concept dans son ensemble. Plus absurde encore est l’opinion selon laquelle, dans l’enseignement de Spinoza, même une chose distincte doit nécessairement être égale à Dieu. Car même si nous trouvons chez Spinoza une expression acerbe selon laquelle toute chose est une modification de Dieu, les éléments de ce concept sont si contradictoires qu'il s'effondre immédiatement dans son interprétation. Modifié, c'est-à-dire dérivé, Dieu n'est pas Dieu dans son propre sens le plus élevé ; par ce seul ajout, la chose reprend sa place où elle est éternellement séparée de Dieu. La raison de ces interprétations erronées, auxquelles d'autres systèmes ont été sujets dans une certaine mesure, est une méconnaissance générale de la loi de l'identité ou de la signification de la copule dans un jugement. Après tout, même un enfant peut comprendre qu'aucune phrase dans laquelle, conformément à l'interprétation acceptée, est exprimée l'identité du sujet et du prédicat, n'affirme ainsi une coïncidence complète ou même un lien direct entre les deux ; par exemple, la phrase « ce corps est bleu » ne veut pas dire que le corps est bleu en cela et par ce en quoi et par quoi il est corps, mais seulement ce qui suit : ce qui est ce corps est aussi bleu, bien que non dans le même sens. Cependant, une telle hypothèse, indiquant une ignorance totale de ce qui constitue l'essence de la copule, est constamment avancée à notre époque lorsque nous parlons de l'application supérieure de la loi de l'identité. Si, par exemple, on avance la proposition : « Le parfait est l'imparfait », alors son sens est celui-ci : l'imparfait n'est pas par quoi et en quoi il est imparfait, mais par le parfait qui est en lui ; à notre époque, le sens de cette position est le suivant : parfait et imparfait ne font qu'un, tous pareils les uns aux autres, le pire et le meilleur, la bêtise et la sagesse. Ou la position : « le bien est le mal », ce qui signifie : le mal n'a pas le pouvoir d'être par lui-même ; ce qui existe en lui est (considéré en soi et pour soi) bon ; cette disposition est interprétée comme suit : la différence éternelle entre le bien et le mal, la vertu et le vice est niée, on suppose que logiquement ils ne font qu'un. Ou bien, si l'on affirme que le nécessaire et le libre ne font qu'un, ce qui signifie que ce qui (en dernière instance) est l'essence du monde moral est aussi l'essence de la nature, cela s'entend ainsi : le libre est rien de plus qu'une force de la nature, un ressort qui, comme tout autre, est subordonné au mécanisme. Une chose similaire se produit avec l’affirmation selon laquelle l’âme et le corps ne font qu’un ; on l'interprète ainsi : l'âme est matérielle, elle est air, éther, suc nerveux, etc., au contraire - que le corps est une âme ou que dans l'énoncé précédent ce qui semble nécessaire est en soi libre - est prudemment pas remarqué, bien que ce soit sur la même base que l'on puisse déduire de cette déclaration. De tels malentendus, même s'ils ne sont pas intentionnels, indiquent un degré d'immaturité dialectique au-delà duquel la philosophie grecque est allée presque dès ses premiers pas, et nous obligent à considérer comme notre devoir indispensable de recommander avec persistance une étude approfondie de la logique. L'ancienne logique réfléchie distinguait le sujet et le prédicat comme antécédent et conséquent (antecendens et consequens) et exprimait ainsi le sens réel de la loi de l'identité. Cette relation est valable même dans une phrase tautologique, si elle n’est pas totalement dénuée de sens. Celui qui dit : « Le corps est un corps » pense le sujet de la phrase comme absolument différent du prédicat, à savoir : le premier comme une unité, le second comme les propriétés individuelles contenues dans le concept de corps, qui s'y rapportent. comme antécédents aux conséquences. C'est le sens d'une autre explication ancienne, selon laquelle sujet et prédicat s'opposent comme effondrés et élargis (implicitum et explicitum).
Cependant, les partisans de la déclaration ci-dessus nous diront que dans la critique du panthéisme, il ne s'agit pas du tout du fait que Dieu est tout (il est difficile d'échapper à sa reconnaissance même avec la compréhension habituelle de ses propriétés), mais de le fait que les choses ne sont rien, que ce système détruit toute individualité. Cette nouvelle définition semble contredire la précédente ; car si les choses ne sont rien, comment peut-on confondre Dieu avec elles ? Alors partout il n’y a qu’une divinité pure et sans nuages. Ou si en dehors de Dieu (non seulement extra, mais aussi praeter Deum) il n'y a rien, alors comment est-Il tout, pas seulement en paroles ; ainsi, le concept tout entier se désintègre et se transforme en néant. Et en général, la question se pose de savoir si la renaissance de ces noms généraux, qui, peut-être, sont d'une grande importance dans l'histoire des hérésies, mais lorsqu'ils sont appliqués aux créatures de l'esprit, où, tout comme dans les phénomènes naturels, permet d'obtenir beaucoup de résultats, des définitions mineures conduisent à des changements significatifs et ne servent que de moyen grossier. Il est d’ailleurs très douteux que la dernière définition que nous avons donnée s’applique même à Spinoza. Car même si, en plus de la substance (praeter), il ne reconnaît que ses états - tels qu'il considère les choses, il s'agit cependant d'un concept purement négatif, qui n'exprime rien de significatif ou de positif, mais qui sert à déterminer la relation des choses à Dieu, et non à ce qu'elles soient considérées pour elles-mêmes. Du caractère incomplet de cette définition, on ne peut pas conclure que, selon cet enseignement, les choses ne contiennent rien de positif (bien que toujours de nature dérivée). Spinoza exprime sa pensée de la manière la plus précise suivante : l'être individuel est la substance elle-même, considérée dans l'une de ses modifications, c'est-à-dire les conséquences. Si nous désignons la substance infinie A, et la substance infinie considérée dans une de ses conséquences comme A/a, alors le positif dans A/a est bien entendu A ; cependant il ne s'ensuit pas que A/a = A, c'est-à-dire que la substance infinie considérée dans son corollaire soit la même que la substance infinie en tant que telle ; en d'autres termes, il ne s'ensuit pas que - ne soit pas une substance spéciale, bien qu'elle soit une conséquence de A. Or, cela ne se trouve pas chez Spinoza ; mais d’abord nous parlons ici du panthéisme en général ; il faut alors se poser la question : cette vision est-elle réellement incompatible avec le spinozisme en soi ? Il est peu probable que quiconque puisse contester cela, puisqu’il est reconnu que les monades leibniziennes, qui correspondent pleinement à ce qu’est A/a dans l’expression ci-dessus, ne peuvent être considérées comme un moyen de réfuter de manière décisive le spinozisme. Sans ce genre d'ajout, certaines affirmations de Spinoza restent complètement mystérieuses, par exemple selon lesquelles l'essence de l'âme humaine est un concept vivant de Dieu, compris comme éternel (et non comme transitoire). Même si la substance existait dans ses autres conséquences A/a, A/c... seulement temporairement, alors dans cette conséquence, dans l'âme humaine = a, elle demeure pour toujours et est donc éternellement et impérissablement séparée en tant que A/a d'elle-même. comme un.
Si nous déclarons que le trait distinctif du panthéisme est le déni non pas de l'individualité, mais de la liberté, alors de nombreux systèmes qui par ailleurs diffèrent considérablement du panthéisme relèveront de ce concept. Car dans tous les systèmes des temps modernes précédant la découverte de l’idéalisme, tant dans le système de Leibniz que dans celui de Spinoza, il n’y a pas de véritable concept de liberté ; Quant à la liberté, telle que beaucoup d'entre nous la pensent, se vantant d'en avoir le sentiment le plus vif - la liberté, qui se résume simplement à la domination du principe rationnel sur le principe sensuel et les désirs - alors une telle liberté peut être obtenue sans beaucoup d’efforts, assez facilement et même avec une plus grande certitude déduite du système de Spinoza. Par conséquent, le déni de la liberté ou son affirmation semble reposer, en général, sur quelque chose de complètement différent de l'acceptation ou du rejet du panthéisme (l'immanence des choses en Dieu). Si à première vue il semble que la liberté, qui ne saurait s'opposer à Dieu, est ici immergée dans l'identité, on peut néanmoins affirmer que cette apparition n'est que la conséquence d'une idée imparfaite et vide de la loi de l'identité. . Le principe de la loi de l'identité n'exprime pas cette unité qui, tournant dans la sphère de l'identité, est incapable de progresser et est donc elle-même insensible et sans vie. L'unité de cette loi est directement créatrice. Déjà dans le rapport du sujet au prédicat, nous avons identifié le rapport de la raison à la conséquence, et la loi de la raison est donc aussi primordiale que la loi de l'identité. Il faut donc que l'éternel soit immédiatement et tel qu'il est en soi, aussi le fondement. Ce dont il est le fondement dans son essence est donc dépendant et, selon la vision immanente, contenu en lui. Cependant, la dépendance n’élimine pas l’indépendance, ni même la liberté. Il ne définit pas l'essence, mais affirme seulement que le dépendant, quel qu'il soit, ne peut être qu'une conséquence de ce dont il dépend ; la dépendance ne nous dit pas ce qu'est cette personne dépendante et ce qu'elle n'est pas. Chaque individu organique, en tant que quelque chose de devenu, n'existe qu'à travers un autre et est donc dépendant du devenir, mais non de l'être. Il n’y a rien d’incohérent, selon Leibniz, à ce que celui qui est Dieu soit en même temps engendré, ou vice versa : tout comme il n’y a aucune contradiction à ce que celui qui est fils de l’homme soit lui-même un homme. Au contraire, il serait contradictoire que le dépendant ou ce qui en est la conséquence n'étaient pas indépendants. Nous aurions alors une dépendance sans dépendance, une conséquence sans ce qui en découle (consequentia absque consequente), et nous n'aurions donc pas de conséquence réelle, en d'autres termes, le concept tout entier se submergerait. La même chose s’applique au fait d’être dans un autre. Un membre individuel, tel que l'œil, n'est possible que dans l'intégrité de l'organisme ; néanmoins, il a une vie pour lui, voire une sorte de liberté, dont la présence est clairement démontrée par le fait qu'il est sujet à la maladie. Si ce qui demeure dans un autre n'était pas lui-même vivant, alors l'existence serait sans le séjour, c'est-à-dire qu'il ne resterait rien du tout. Un point de vue beaucoup plus élevé naît d'une telle considération de l'être divin lui-même, dont l'idée serait complètement contredite par un effet qui n'est pas une génération, c'est-à-dire la position d'un être indépendant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est impossible de comprendre comment un être tout parfait pourrait se contenter d’une machine, même la plus parfaite. Quelle que soit la façon dont on considère le fait de suivre des personnes à partir de Dieu, cela ne peut jamais être une simple influence ou un accomplissement mécanique, dans lequel ce qui est produit pour soi n'est rien ; Cela ne peut pas être considéré comme une émanation dans laquelle ce qui suit reste le même que ce dont il découle, et n'est donc pas quelque chose de propre, indépendant. La conséquence des choses venant de Dieu est la révélation de Dieu. Mais Dieu ne peut se révéler à lui-même que dans ce qui lui est semblable, dans des êtres libres agissant par eux-mêmes, dont l'existence n'a d'autre fondement que Dieu, mais qui sont les mêmes que Dieu. Il parle et ils sont l'essence. Si toutes les créatures du monde n’étaient que des pensées de l’âme divine, c’est seulement grâce à cela qu’elles seraient vivantes. Après tout, les pensées sont véritablement générées par l’âme ; cependant, la pensée générée est une force indépendante agissant pour elle-même ; De plus, elle acquiert une telle importance dans l'âme humaine qu'elle vainc sa propre mère et la soumet à elle-même. Pendant ce temps, l'imagination divine, qui est à l'origine du caractère unique des êtres du monde, est différente de l'imagination humaine, ne donnant qu'une réalité idéale à ses créations. Ce dans lequel la divinité est représentée ne peut être qu'un être indépendant ; car qu'est-ce qui limite nos idées, sinon le fait que nous voyons quelque chose comme dépendant ? Dieu contemple les choses en elles-mêmes. En soi, l'être n'est qu'éternel, reposant sur lui-même, sa volonté, sa liberté. Le concept d’absolu ou de divinité dérivée est si cohérent qu’il constitue le concept central de toute philosophie. Une telle divinité est inhérente à la nature. Immanence en Dieu et liberté ne se contredisent pas tellement qu'il n'y a que le libre, et en tant qu'il est libre, qui est en Dieu ; ce qui n'est pas libre, et comme il ne l'est pas, est nécessaire en dehors de Dieu.
Bien qu’une telle déduction générale ne puisse en elle-même satisfaire ceux qui aspirent à une compréhension plus profonde, elle montre en tout cas que le déni de la liberté formelle n’est pas nécessairement associé au panthéisme. Nous ne nous attendons pas à ce qu’on nous objecte en pointant du doigt le spinozisme. Il faut faire preuve d’une grande détermination pour affirmer que tout système formé dans l’esprit humain est un système de raison
Exprimons une fois pour toutes notre opinion définitive sur le spinozisme ! Ce système est du fatalisme, non pas parce qu’il croit que les choses existent en Dieu, car, comme nous l’avons montré, le panthéisme n’exclut pas la possibilité d’une liberté au moins formelle. Par conséquent, le fatalisme de Spinoza doit avoir une base complètement différente et indépendante. L'erreur de son système ne réside pas dans le fait qu'il pose les choses en Dieu, mais dans le fait que ce sont des choses dans le concept abstrait des entités du monde, et en outre de la substance infinie elle-même, qui pour lui est aussi une chose. Par conséquent, ses arguments contre la liberté sont complètement déterministes et nullement panthéistes. Il considère la volonté comme une chose et arrive tout naturellement à la conclusion que dans chacune de ses actions, elle doit être déterminée par une autre chose, qui à son tour est déterminée par une autre, etc. à l'infini. D'où l'absence de vie de son système, l'absence d'âme de la forme, la pauvreté des concepts et des expressions, la rigidité inflexible des définitions, qui s'accorde pleinement avec le caractère abstrait de la considération ; d'où - et de manière assez cohérente - sa vision mécaniste de la nature. Peut-on douter que même une idée dynamique de la nature devrait modifier de manière significative les conceptions fondamentales du spinozisme ? Si la doctrine de l'existence des choses en Dieu est la base de tout le système, alors avant qu'elle puisse devenir un principe d'un système de raison, il faut au moins y apporter de la vitalité et une liberté vis-à-vis de l'abstraction. Combien générales sont les affirmations selon lesquelles les êtres finis sont des modifications ou des conséquences de Dieu ; quel gouffre reste ici à combler et combien de questions restent à répondre ! Le spinozisme pourrait être comparé dans son ossification à la statue de Pygmalion, qu'il fallait spiritualiser avec le souffle chaud de l'amour ; mais cette comparaison n'est pas tout à fait exacte, car le spinozisme est plutôt comme une création esquissée seulement en termes généraux, dans laquelle, si elle était spiritualisée, de nombreux traits manquants et incomplets pourraient être découverts. On peut plutôt la comparer aux images de divinités les plus anciennes, qui semblaient d'autant plus mystérieuses qu'on leur donnait moins de traits vivants individuels. En un mot, il s’agit d’un système réaliste unilatéral, et une telle définition, qui n’est pas la première, semble moins diffamatoire que le panthéisme, et reflète bien plus correctement l’originalité du spinozisme.
Il serait dommage de répéter ici les nombreuses explications de ce problème que l'on peut trouver dans les premiers ouvrages de l'auteur. Le but de son effort inlassable était de montrer l'interpénétration du réalisme et de l'idéalisme. Le concept fondamental de Spinoza, inspiré du principe de l'idéalisme (et modifié sur un point essentiel), a également trouvé une base vivante dans une considération plus élevée de la nature et de l'unité dynamique connue du mental et du spirituel, d'où a émergé la philosophie naturelle ; en tant que physique pure, elle pouvait exister pour elle-même, mais dans le cadre de la philosophie dans son ensemble, elle n'était toujours considérée que comme une seule, à savoir sa partie réelle, capable de s'élever jusqu'à un véritable système de raison seulement lorsqu'elle était complétée par la partie idéale dans laquelle la liberté règne. En lui (dans la liberté), affirme l'auteur, se trouve le dernier acte de potentialisation, par lequel toute la nature se transforme en sensation, en intelligence et finalement en volonté. Dans le dernier cas, le plus élevé, il n’y a pas d’autre existence que la volonté. La volition est l'existence primordiale, et c'est seulement à la volition que sont applicables tous les prédicats de cette existence : l'absence de fondement, l'éternité, l'indépendance du temps, l'affirmation de soi. Toute philosophie ne s’efforce que de trouver cette expression la plus élevée.
Avant cela, la philosophie a été élevée à notre époque par l'idéalisme : ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons commencer à étudier notre sujet, car nous n'avons en aucun cas l'intention de nous attarder sur toutes les difficultés qui peuvent être et ont été associées au concept de liberté, si nous partons d'un système réaliste ou dogmatique unilatéral. Cependant, quels que soient les sommets que nous ayons atteints dans ce domaine grâce à l'idéalisme et même s'il est certain que nous lui devons la première conception parfaite de la liberté formelle, l'idéalisme en lui-même n'est en aucun cas un système complet, et dès que nous Si nous voulons parvenir à une compréhension plus précise et plus précise de la doctrine de la liberté, cela nous laisse complètement désemparés. Notons tout d'abord que pour que l'idéalisme se soit développé en système, il est tout à fait insuffisant d'affirmer que « le véritable réel n'est que l'activité, la vie et la liberté » - cette affirmation est également compatible avec l'idéalisme subjectif (qui se comprend lui-même) de Fichte ; ici, il faut montrer le contraire, à savoir que la base de tout ce qui est réel (la nature, le monde des choses) est l'activité, la vie et la liberté, ou, pour reprendre la terminologie de Fichte, que non seulement je (Ichheit) est tout, mais que, à l'inverse, tout est moi (Ichheit). L’idée de faire de la liberté le fondement de toute philosophie a libéré l’esprit humain en général – pas seulement par rapport à lui-même – et a produit une révolution plus décisive dans toutes les branches de la science qu’aucune des révolutions précédentes. Le concept idéaliste est le véritable triomphe de la plus haute philosophie de notre temps et surtout de son plus haut réalisme. Que ceux qui la jugent ou se l’attribuent réfléchissent au fait que sa prémisse la plus profonde est la liberté ; Sous quel jour différent verraient-ils et comprendraient-ils alors cet enseignement ! Seuls ceux qui ont goûté à la liberté peuvent éprouver le besoin de tout lui assimiler, de l'étendre à l'univers entier. Quiconque n'aborde pas la philosophie de cette manière ne fait que suivre les autres et les imiter dans leurs actions, sans ressentir la cause de ces actions. Il sera toujours étonnant que Kant, qui ne distinguait d'abord les choses en elles-mêmes des phénomènes que négativement dans l'indépendance du temps, puis considérait dans les explications métaphysiques de la Critique de la raison pratique l'indépendance du temps et la liberté comme des concepts corrélatifs, n'en soit pas parvenu à l'idée d'étendre ce seul possible concept positif de l'être en soi et sur les choses, ce qui lui permettrait de s'élever directement dans sa recherche à un point de vue supérieur et de surmonter la négativité qui caractérise sa philosophie théorique. Mais d'un autre côté, si la liberté est généralement un concept positif de l'être en soi, alors l'étude de la liberté humaine est à nouveau rejetée dans le domaine de l'universel, puisque l'intelligible, qui seul en constitue le fondement, est aussi l'essence de l'être. les choses en elles-mêmes. Par conséquent, l’idéalisme seul ne suffit pas à révéler la différence spécifique de la liberté humaine, c’est-à-dire exactement ce qui la détermine. Ce serait également une erreur de supposer que le panthéisme est éliminé et détruit par l’idéalisme – une opinion qui ne peut se former qu’en mélangeant le panthéisme avec un réalisme unilatéral. Car du point de vue du panthéisme en tant que tel, il est totalement indifférent que les choses soient contenues dans la substance absolue ou que les volontés individuelles soient contenues en même quantité - dans la volonté primordiale. Dans le premier cas, le panthéisme est réaliste, dans le second il est idéaliste, mais le concept de base reste inchangé. C’est à partir de là qu’il devient déjà évident que les difficultés les plus significatives contenues dans le concept de liberté ne peuvent être résolues par l’idéalisme lui-même, comme par tout autre système unilatéral. Le fait est que l'idéalisme ne donne, d'une part, que la conception la plus générale et, de l'autre, seulement une conception formelle de la liberté. Le concept réel et vivant de la liberté est qu’elle est la capacité du bien et du mal.
C'est la plus grande difficulté de toute la doctrine de la liberté, qui se fait sentir depuis longtemps et est inhérente non seulement à tel ou tel système, mais dans une plus ou moins grande mesure à tous ; elle se manifeste avec la plus grande évidence en relation avec le concept d'immanence. Car soit le mal réel est permis, alors le mal doit inévitablement être placé dans la substance infinie ou dans la volonté primordiale, ce qui détruit complètement le concept d'un être tout parfait ; ou bien il faut nier d’une manière ou d’une autre la réalité du mal, ce qui fait disparaître simultanément le concept réel de liberté. Des difficultés non moins surgissent si l'on admet même le lien le plus lointain entre Dieu et les créatures du monde ; car même si ce lien se limite seulement au soi-disant concours ou à la participation nécessaire de Dieu aux actions de la créature, qui, en raison de sa dépendance essentielle à l'égard de Dieu, doit être autorisée, même en affirmant la présence de la liberté, alors Dieu se révèle nécessairement être la source du mal, car en permettant à peu de gens les actions d'une créature complètement dépendante, il vaut mieux y participer ; ou enfin, là aussi, il faut nier la réalité du mal d'une manière ou d'une autre. La position selon laquelle tout ce qui est positif dans la création vient de Dieu doit être affirmée dans ce système. Si donc nous acceptons que le mal contient quelque chose de positif, alors ce positif vient aussi de Dieu. A cela on peut objecter : le positif dans le mal, dans la mesure où il est positif, est bien. Ainsi, le mal ne disparaît pas, mais il est vrai qu’il ne s’explique pas. Car si existence Il y a du bien dans le mal, d'où ça vient ? quoi il y a cette existence, base, qu'est-ce qui, en fait, constitue le mal ? Ce qui est tout à fait différent de cette affirmation (même si elle a souvent été confondue avec elle) est qu'il n'y a rien de positif dans le mal ou, en d'autres termes, qu'il n'existe pas du tout (il n'existe pas avec le mal). ou en autre positif ), mais que toutes les actions sont plus ou moins positives et que la différence entre elles ne réside que dans un degré plus ou moins grand de perfection, et comme une telle différence ne conduit pas à l'opposition, le mal disparaît complètement. C’est le deuxième point de vue possible associé à la position selon laquelle tout ce qui est positif vient de Dieu. Ici, la puissance qui se manifeste dans le mal, il est vrai, est comparativement moins parfaite que la puissance qui se manifeste dans le bien, mais en elle-même ou sans comparaison, elle est encore la perfection, qui doit donc, comme tout le reste, dériver de Dieu. Ce que nous appelons mal n'est en elle qu'un moindre degré de perfection, qui n'apparaît comme un défaut que dans notre comparaison, mais dans la nature des choses il n'en est pas un. On ne peut nier que telle soit la véritable opinion de Spinoza. On pourrait essayer d'éviter ce dilemme de la manière suivante : le positif, qui vient de Dieu, est la liberté, elle-même indifférente au mal et au bien. Cependant, si nous considérons cette indifférence non seulement négativement, mais comme une capacité positive et vivante de bien et de mal, alors il est impossible de comprendre comment la capacité de mal peut découler de Dieu, considéré comme uniquement le bien. De là, notons-le au passage, il est clair : si la liberté est réellement ce qu'elle devrait être selon ce concept (et elle l'est certainement), alors la tentative faite ci-dessus pour dériver la liberté de Dieu ne peut pas non plus être considérée comme correcte ; car si la liberté est la capacité de faire le mal, alors sa racine doit être indépendante de Dieu. À cet égard, on pourrait être tenté de se tourner vers le dualisme. Le système du dualisme, s’il est réellement considéré comme une doctrine de deux principes absolument différents et indépendants, n’est qu’un système de fragmentation et de désespoir de l’esprit. Si nous considérons l'essence fondamentale du mal comme dépendante de l'essence fondamentale du bien, alors toute la difficulté de l'origine du mal à partir du bien, concentrée cependant dans une seule essence, augmentera plutôt que diminuera. Même si nous supposons que l'essence mauvaise a été initialement créée par une essence bonne et s'est éloignée de l'essence originelle par sa propre faute, alors la première manifestation de la capacité d'agir contre Dieu reste toujours inexplicable dans tous les systèmes précédents. Par conséquent, même si nous éliminons non seulement l'identité, mais aussi tout lien entre les êtres du monde et Dieu, même si nous considérons leur existence entière, et donc l'existence du monde, comme un éloignement de Dieu, cela ne ferait que quelque peu éloigner la difficulté, mais ne l’éliminerait pas. Après tout, pour découler de Dieu, les êtres du monde devraient exister d'une manière ou d'une autre avant cela, c'est pourquoi la doctrine de l'émanation ne peut en aucun cas être opposée au panthéisme, car elle présuppose l'existence originelle des choses en Dieu. et présuppose ainsi clairement le panthéisme. L’éloignement du monde d’avec Dieu ne peut s’expliquer que de la manière suivante : ou bien il est involontaire de la part des choses, mais pas de la part de Dieu – alors les choses sont plongées dans un état de malheur et de méchanceté par Dieu ; Dieu est donc l'auteur de cette condition ; ou bien elle est involontaire des deux côtés, causée, comme certains le prétendent, par une sorte d'excès d'essence - une idée totalement intenable ; ou, enfin, elle est arbitrairement commise par des choses qui se sont détachées de Dieu, c'est-à-dire une conséquence de la culpabilité, qui sera suivie d'une chute toujours plus profonde, alors cette première culpabilité est elle-même mauvaise et, par conséquent, ne fournit pas d'explication. de son origine. Cependant, sans cette hypothèse auxiliaire, qui, expliquant l'origine du mal dans le monde, détruit complètement le bien et remplace le panthéisme par le pandémonisme, dans le système d'émanation l'opposition entre le bien et le mal disparaît complètement : le bien, passant par d'innombrables étapes intermédiaires et progressivement l'affaiblissement, se perd dans ce qui est déjà, il n'y a même pas une lueur de bien - un peu comme la façon dont Plotin décrit avec humour mais de manière peu convaincante la transition du bien primordial en matière et en mal. Selon lui, au cours d'une subordination et d'une distance constantes, quelque chose de final surgit, au-delà duquel rien ne peut surgir, et c'est cela (impossible de produire davantage) qui est le mal. En d’autres termes, s’il y a quelque chose après le premier, alors il doit y en avoir un dernier, dans lequel il n’y a plus rien du premier, et c’est la question et la nécessité du mal.
Les considérations ci-dessus montrent clairement à quel point il est injuste d’attribuer toute la gravité de ce problème difficile à un seul système, d’autant plus que le système opposé, supposément supérieur, ne satisfait également que très peu. Les lieux communs de l’idéalisme ne peuvent pas non plus aider ici. Avec l’aide de concepts abstraits sur Dieu, comme l’actus purissimus, comme ceux avancés par la philosophie ancienne, ou ceux que la nouvelle philosophie crée constamment dans son désir d’éloigner Dieu de la nature autant que possible, rien ne peut être réalisé. Dieu est quelque chose de plus réel qu'un simple ordre moral du monde, et il porte en lui des forces motrices complètement différentes et plus vivantes que celles que lui attribuent les idéalistes abstraits avec leur sophistication débile.
Schelling FV Études philosophiques sur l'essence de la liberté humaine et sujets connexes
F.W.J. Schelling
ÉTUDES PHILOSOPHIQUES SUR L'ESSENCE DE LA LIBERTÉ HUMAINE
ET SUJETS CONNEXES
(AVERTISSEMENT). 1809
La présentation qui suit n'appelle, de l'avis de l'auteur, que quelques remarques préliminaires.
Puisque l’essence de la nature spirituelle comprend avant tout la raison, la pensée et la cognition, l’opposition entre la nature et l’esprit a naturellement été considérée en premier sous cet aspect. Une ferme conviction que la raison n'est caractéristique que de l'homme, une conviction dans la subjectivité complète de toute pensée et connaissance et que la nature est complètement dépourvue de raison et de capacité de penser, ainsi que le type de représentation mécanique qui domine partout - pour la dynamique Le principe réveillé par Kant n'est passé que dans une certaine forme la plus élevée du mécanique et n'a pas été reconnu dans son identité avec le principe spirituel - justifier suffisamment une telle ligne de pensée. Maintenant, la racine de l'opposition a été arrachée, et l'établissement d'une vision plus correcte peut être tranquillement laissé au mouvement général vers une connaissance plus élevée.
Le moment est venu de révéler la plus haute, ou plutôt la véritable opposition, celle entre nécessité et liberté, dont la seule considération nous introduit au centre le plus profond de la philosophie.
Après la première présentation générale de son système (dans le Journal of Speculative Physics), dont la suite fut malheureusement interrompue par des circonstances extérieures, l'auteur de cet ouvrage se limita uniquement aux recherches philosophiques naturelles ; donc, mis à part le début posé dans l'ouvrage « Philosophie et Religion », qui est resté insuffisamment clair en raison de l'ambiguïté de la présentation, dans cet ouvrage il expose pour la première fois avec une totale certitude son concept de la partie idéale de la philosophie ; Pour que ce premier travail acquière sa signification, il est nécessaire de l'accompagner de cette étude qui, de par la nature même du sujet, doit inévitablement contenir des conclusions plus profondes sur le système dans son ensemble que dans toute étude d'un caractère plus spécifique.
Malgré le fait que l'auteur n'a jamais exprimé son opinion nulle part (à l'exception de son ouvrage « Philosophie et religion ») sur les principaux problèmes qui seront abordés ici - sur le libre arbitre, le bien et le mal, la personnalité, etc., ce n'est pas a empêché certains de lui attribuer, selon leur propre compréhension, des opinions qui, même dans leur contenu, étaient totalement incompatibles avec l'ouvrage mentionné, apparemment laissé sans aucune attention. Beaucoup de choses qui sont incorrectes sur un certain nombre de questions, y compris celles discutées ici, ont également été exprimées prétendument conformément aux principes fondamentaux de l’auteur par ses soi-disant partisans non invités.
Il semblerait que seul un système établi et complet puisse avoir des partisans au sens propre du terme. L'auteur n'a encore jamais présenté ce genre de système à l'attention des lecteurs et n'en a développé que ses aspects individuels (et ceux-ci ne sont souvent que dans un cadre séparé, par exemple polémique). Ainsi, il pensait que ses écrits devaient être considérés comme des fragments d'un tout, dont les liens peuvent être discernés avec une plus grande perspicacité que celle qui caractérise habituellement les partisans et une plus grande bonne volonté que celle des opposants. Comme le seul exposé scientifique de son système restait inachevé, personne ne l’a compris dans sa véritable tendance, ou très peu l’ont compris. Immédiatement après l'apparition de ce fragment, son discrédit et sa déformation ont commencé, d'une part, des explications, des révisions et des traductions, de l'autre, et le plus grand mal a été la transposition des pensées de l'auteur dans un langage soi-disant plus brillant (puisqu'il s'agissait d'un c'est à cette époque qu'une ivresse poétique totalement incontrôlable s'empare des esprits). Il semble désormais que le moment soit venu d’adopter des impulsions plus sensées. Le désir de loyauté, de diligence et de profondeur est ravivé. On commence à voir dans le vide ceux qui se sont affublés des maximes de la nouvelle philosophie, assimilant les héros du théâtre français ou les danseurs de corde, pour ce qu'ils sont réellement. Quant à ceux qui, sur tous les marchés, répétaient, comme des airs d'orgue de Barbarie, les nouveautés dont ils s'étaient emparés, ils ont fini par susciter un tel dégoût universel que bientôt ils ne trouveront plus d'auditeurs, surtout si les critiques, qui pourtant ne cherchent pas pour faire du mal, cessez d'affirmer, en écoutant chaque rhapsodie incompréhensible, qui comprenait plusieurs tournures d'un écrivain célèbre, qu'elle a été écrite conformément à ses principes de base. Il est préférable de considérer ces rhapsodes comme des écrivains originaux, car, par essence, ils veulent tous ne faire qu'un, et beaucoup d'entre eux, dans un certain sens, le sont.
Que cet essai serve à éliminer un certain nombre d’opinions préconçues, d’une part, et de bavardages vides et irresponsables, d’autre part.
Enfin, nous aimerions que ceux qui se sont opposés ouvertement ou secrètement à l'auteur dans cette affaire expriment leurs opinions aussi franchement que cela a été fait ici. La pleine maîtrise d'un sujet permet de l'exprimer librement et clairement ; les méthodes artificielles de polémique ne peuvent pas être une forme de philosophie. Mais nous souhaitons plus encore que l'esprit d'aspirations communes s'établisse de plus en plus et que l'esprit sectaire qui s'est trop souvent emparé des Allemands n'empêche pas l'acquisition de connaissances et d'opinions dont le plein développement était prévu depuis des temps immémoriaux. pour les Allemands et dont ils n'ont peut-être jamais été aussi proches qu'aujourd'hui.
La tâche de la recherche philosophique sur l'essence de la liberté humaine peut être, d'une part, d'identifier son concept correct, car, si immédiat que soit le sentiment de liberté qui appartient à chaque personne, il n'est en aucun cas superficiel. de conscience et même pour l'exprimer simplement avec des mots, il faut plus qu'une pureté et une profondeur de pensée ordinaires ; d’un autre côté, ces études peuvent viser à relier ce concept à la vision scientifique du monde dans son ensemble. Puisqu'un concept ne peut jamais être défini dans son individualité et n'acquiert une complétude scientifique complète que par l'établissement de sa connexion avec le tout, cela s'applique en premier lieu au concept de liberté qui, s'il a une réalité, ne doit pas être seulement un concept subordonné. ou concept secondaire, mais aussi l'un des points centraux dominants du système, alors les deux côtés nommés de l'étude ici, comme ailleurs, coïncident. Certes, conformément à une légende ancienne, mais en aucun cas oubliée, le concept de liberté est généralement incompatible avec le système, et toute philosophie qui revendique l'unité et l'intégrité conduit inévitablement au déni de la liberté. Il n'est pas facile de réfuter des déclarations générales de ce type, car on ne sait absolument pas quelles idées limitantes sont associées au mot « système », à la suite desquelles un jugement peut s'avérer tout à fait correct, mais en même temps exprimer quelque chose d'assez ordinaire. Cette opinion peut aussi se réduire au fait que la notion de système en général et en elle-même contredit la notion de liberté ; alors comment peut-on admettre - puisque la liberté individuelle est toujours liée d'une manière ou d'une autre à l'univers dans son ensemble (qu'elle soit pensée de manière réaliste ou idéaliste) - l'existence d'un système quelconque, ne serait-ce que dans l'esprit divin, un système, avec lequel la liberté existe également. Affirmer en général que ce système ne pourra jamais être compris par l'esprit humain, c'est encore une fois ne rien affirmer, car selon le sens donné à cette affirmation, elle peut être vraie ou fausse. Tout dépend de la définition du principe qui sous-tend la connaissance humaine ; pour confirmer la possibilité d'une telle connaissance, nous pouvons citer ce que Sextus a dit à propos d'Empédocle : « Le grammairien et l'ignorant supposeront qu'une telle connaissance n'est rien d'autre que la vantardise et le désir de se considérer supérieur aux autres - propriétés complètement étrangères à chacun. qui est même engagé d'une manière ou d'une autre dans la philosophie. Quiconque part de la théorie physique et sait que la doctrine de la connaissance du semblable par le semblable est très ancienne (elle est attribuée à Pythagore, mais se retrouve déjà chez Platon et a été exprimée bien plus tôt par Empédocle), comprendra que le philosophe prétend avoir une connaissance (divine) similaire parce que lui seul, gardant son esprit pur et non affecté par la méchanceté, comprend, avec Dieu en lui-même, Dieu en dehors de lui. Ceux qui sont étrangers à la science ont tendance à la comprendre comme une connaissance complètement abstraite et sans vie, semblable à la géométrie ordinaire. Il serait plus simple et plus convaincant de nier la présence d'un système dans la volonté ou l'esprit de l'être primordial, d'affirmer qu'en général il n'y a que des volontés séparées, dont chacune est un centre pour elle-même et, selon Fichte, est la substance absolue de chaque Moi. Cependant, l'esprit qui aspire à l'unité et le sentiment qui affirme la liberté et l'individualité ne sont toujours freinés que par des exigences violentes, qui ne conservent pas longtemps leur force et sont finalement rejetées. Ainsi Fichte a été contraint de témoigner dans son enseignement de la reconnaissance de l'unité, bien que sous l'apparence misérable de l'ordre moral mondial, dont la conséquence immédiate était l'opposition et l'incohérence de cet enseignement. Par conséquent, il nous semble que, peu importe le nombre d'arguments en faveur d'une telle affirmation qui soient avancés d'un point de vue purement historique, c'est-à-dire basés sur des systèmes antérieurs (nous n'avons pas trouvé d'arguments tirés de l'essence de la raison et de la connaissance n'importe où), l'établissement d'un lien entre le concept de liberté et la vision du monde dans son ensemble restera toujours une tâche nécessaire, sans la solution de laquelle le concept même de liberté restera incertain et la philosophie restera dépourvue de toute valeur. Car seule cette grande tâche est la force motrice inconsciente et invisible de tout désir de connaissance, depuis ses formes les plus basses jusqu'à ses formes les plus élevées ; Sans la contradiction entre nécessité et liberté, non seulement la philosophie, mais en général toutes les plus hautes maîtrises de l'esprit seraient vouées à la destruction, ce qui est le sort des sciences dans lesquelles cette contradiction ne trouve pas d'application. Refuser cette tâche en renonçant à la raison s'apparente plus à une fuite qu'à une victoire. Après tout, on pourrait tout aussi bien renoncer à la liberté en se tournant vers la raison et la nécessité – dans les deux cas, il n’y aurait aucune base pour le triomphe.
Schelling FV
Études philosophiques sur l'essence de la liberté humaine et sujets connexes
F.W.J. Schelling
ÉTUDES PHILOSOPHIQUES SUR L'ESSENCE DE LA LIBERTÉ HUMAINE
ET SUJETS CONNEXES
(AVERTISSEMENT). 1809
La présentation qui suit n'appelle, de l'avis de l'auteur, que quelques remarques préliminaires.
Puisque l’essence de la nature spirituelle comprend avant tout la raison, la pensée et la cognition, l’opposition entre la nature et l’esprit a naturellement été considérée en premier sous cet aspect. Une ferme conviction que la raison n'est caractéristique que de l'homme, une conviction dans la subjectivité complète de toute pensée et connaissance et que la nature est complètement dépourvue de raison et de capacité de penser, ainsi que le type de représentation mécanique qui domine partout - pour la dynamique Le principe réveillé par Kant n'est passé que dans une certaine forme la plus élevée du mécanique et n'a pas été reconnu dans son identité avec le principe spirituel - justifier suffisamment une telle ligne de pensée. Maintenant, la racine de l'opposition a été arrachée, et l'établissement d'une vision plus correcte peut être tranquillement laissé au mouvement général vers une connaissance plus élevée.
Le moment est venu de révéler la plus haute, ou plutôt la véritable opposition, celle entre nécessité et liberté, dont la seule considération nous introduit au centre le plus profond de la philosophie.
Après la première présentation générale de son système (dans le Journal of Speculative Physics), dont la suite fut malheureusement interrompue par des circonstances extérieures, l'auteur de cet ouvrage se limita uniquement aux recherches philosophiques naturelles ; donc, mis à part le début posé dans l'ouvrage « Philosophie et Religion », qui est resté insuffisamment clair en raison de l'ambiguïté de la présentation, dans cet ouvrage il expose pour la première fois avec une totale certitude son concept de la partie idéale de la philosophie ; Pour que ce premier travail acquière sa signification, il est nécessaire de l'accompagner de cette étude qui, de par la nature même du sujet, doit inévitablement contenir des conclusions plus profondes sur le système dans son ensemble que dans toute étude d'un caractère plus spécifique.
Malgré le fait que l'auteur n'a jamais exprimé son opinion nulle part (à l'exception de son ouvrage « Philosophie et religion ») sur les principaux problèmes qui seront abordés ici - sur le libre arbitre, le bien et le mal, la personnalité, etc., ce n'est pas a empêché certains de lui attribuer, selon leur propre compréhension, des opinions qui, même dans leur contenu, étaient totalement incompatibles avec l'ouvrage mentionné, apparemment laissé sans aucune attention. Beaucoup de choses qui sont incorrectes sur un certain nombre de questions, y compris celles discutées ici, ont également été exprimées prétendument conformément aux principes fondamentaux de l’auteur par ses soi-disant partisans non invités.
Il semblerait que seul un système établi et complet puisse avoir des partisans au sens propre du terme. L'auteur n'a encore jamais présenté ce genre de système à l'attention des lecteurs et n'en a développé que ses aspects individuels (et ceux-ci ne sont souvent que dans un cadre séparé, par exemple polémique). Ainsi, il pensait que ses écrits devaient être considérés comme des fragments d'un tout, dont les liens peuvent être discernés avec une plus grande perspicacité que celle qui caractérise habituellement les partisans et une plus grande bonne volonté que celle des opposants. Comme le seul exposé scientifique de son système restait inachevé, personne ne l’a compris dans sa véritable tendance, ou très peu l’ont compris. Immédiatement après l'apparition de ce fragment, son discrédit et sa déformation ont commencé, d'une part, des explications, des révisions et des traductions, de l'autre, et le plus grand mal a été la transposition des pensées de l'auteur dans un langage soi-disant plus brillant (puisqu'il s'agissait d'un c'est à cette époque qu'une ivresse poétique totalement incontrôlable s'empare des esprits). Il semble désormais que le moment soit venu d’adopter des impulsions plus sensées. Le désir de loyauté, de diligence et de profondeur est ravivé. On commence à voir dans le vide ceux qui se sont affublés des maximes de la nouvelle philosophie, assimilant les héros du théâtre français ou les danseurs de corde, pour ce qu'ils sont réellement. Quant à ceux qui, sur tous les marchés, répétaient, comme des airs d'orgue de Barbarie, les nouveautés dont ils s'étaient emparés, ils ont fini par susciter un tel dégoût universel que bientôt ils ne trouveront plus d'auditeurs, surtout si les critiques, qui pourtant ne cherchent pas pour faire du mal, cessez d'affirmer, en écoutant chaque rhapsodie incompréhensible, qui comprenait plusieurs tournures d'un écrivain célèbre, qu'elle a été écrite conformément à ses principes de base. Il est préférable de considérer ces rhapsodes comme des écrivains originaux, car, par essence, ils veulent tous ne faire qu'un, et beaucoup d'entre eux, dans un certain sens, le sont.
Que cet essai serve à éliminer un certain nombre d’opinions préconçues, d’une part, et de bavardages vides et irresponsables, d’autre part.
Enfin, nous aimerions que ceux qui se sont opposés ouvertement ou secrètement à l'auteur dans cette affaire expriment leurs opinions aussi franchement que cela a été fait ici. La pleine maîtrise d'un sujet permet de l'exprimer librement et clairement ; les méthodes artificielles de polémique ne peuvent pas être une forme de philosophie. Mais nous souhaitons plus encore que l'esprit d'aspirations communes s'établisse de plus en plus et que l'esprit sectaire qui s'est trop souvent emparé des Allemands n'empêche pas l'acquisition de connaissances et d'opinions dont le plein développement était prévu depuis des temps immémoriaux. pour les Allemands et dont ils n'ont peut-être jamais été aussi proches qu'aujourd'hui.
La tâche de la recherche philosophique sur l'essence de la liberté humaine peut être, d'une part, d'identifier son concept correct, car, si immédiat que soit le sentiment de liberté qui appartient à chaque personne, il n'est en aucun cas superficiel. de conscience et même pour l'exprimer simplement avec des mots, il faut plus qu'une pureté et une profondeur de pensée ordinaires ; d’un autre côté, ces études peuvent viser à relier ce concept à la vision scientifique du monde dans son ensemble. Puisqu'un concept ne peut jamais être défini dans son individualité et n'acquiert une complétude scientifique complète que par l'établissement de sa connexion avec le tout, cela s'applique en premier lieu au concept de liberté qui, s'il a une réalité, ne doit pas être seulement un concept subordonné. ou concept secondaire, mais aussi l'un des points centraux dominants du système, alors les deux côtés nommés de l'étude ici, comme ailleurs, coïncident. Certes, conformément à une légende ancienne, mais en aucun cas oubliée, le concept de liberté est généralement incompatible avec le système, et toute philosophie qui revendique l'unité et l'intégrité conduit inévitablement au déni de la liberté. Il n'est pas facile de réfuter des déclarations générales de ce type, car on ne sait absolument pas quelles idées limitantes sont associées au mot « système », à la suite desquelles un jugement peut s'avérer tout à fait correct, mais en même temps exprimer quelque chose d'assez ordinaire. Cette opinion peut aussi se réduire au fait que la notion de système en général et en elle-même contredit la notion de liberté ; alors comment peut-on admettre - puisque la liberté individuelle est toujours liée d'une manière ou d'une autre à l'univers dans son ensemble (qu'elle soit pensée de manière réaliste ou idéaliste) - l'existence d'un système quelconque, ne serait-ce que dans l'esprit divin, un système, avec lequel la liberté existe également. Affirmer en général que ce système ne pourra jamais être compris par l'esprit humain, c'est encore une fois ne rien affirmer, car selon le sens donné à cette affirmation, elle peut être vraie ou fausse. Tout dépend de la définition du principe qui sous-tend la connaissance humaine ; pour confirmer la possibilité d'une telle connaissance, nous pouvons citer ce que Sextus a dit à propos d'Empédocle : « Le grammairien et l'ignorant supposeront qu'une telle connaissance n'est rien d'autre que la vantardise et le désir de se considérer supérieur aux autres - propriétés complètement étrangères à chacun. qui est même engagé d'une manière ou d'une autre dans la philosophie. Quiconque part de la théorie physique et sait que la doctrine de la connaissance du semblable par le semblable est très ancienne (elle est attribuée à Pythagore, mais se retrouve déjà chez Platon et a été exprimée bien plus tôt par Empédocle), comprendra que le philosophe prétend avoir une connaissance (divine) similaire parce que lui seul, gardant son esprit pur et non affecté par la méchanceté, comprend, avec Dieu en lui-même, Dieu en dehors de lui. Ceux qui sont étrangers à la science ont tendance à la comprendre comme une connaissance complètement abstraite et sans vie, semblable à la géométrie ordinaire. Il serait plus simple et plus convaincant de nier la présence d'un système dans la volonté ou l'esprit de l'être primordial, d'affirmer qu'en général il n'y a que des volontés séparées, dont chacune est un centre pour elle-même et, selon Fichte, est la substance absolue de chaque Moi. Cependant, l'esprit qui aspire à l'unité et le sentiment qui affirme la liberté et l'individualité ne sont toujours freinés que par des exigences violentes, qui ne conservent pas longtemps leur force et sont finalement rejetées. Ainsi Fichte a été contraint de témoigner dans son enseignement de la reconnaissance de l'unité, bien que sous l'apparence misérable de l'ordre moral mondial, dont la conséquence immédiate était l'opposition et l'incohérence de cet enseignement. Par conséquent, il nous semble que, peu importe le nombre d'arguments en faveur d'une telle affirmation qui soient avancés d'un point de vue purement historique, c'est-à-dire basés sur des systèmes antérieurs (nous n'avons pas trouvé d'arguments tirés de l'essence de la raison et de la connaissance n'importe où), l'établissement d'un lien entre le concept de liberté et la vision du monde dans son ensemble restera toujours une tâche nécessaire, sans la solution de laquelle le concept même de liberté restera incertain et la philosophie restera dépourvue de toute valeur. Car seule cette grande tâche est la force motrice inconsciente et invisible de tout désir de connaissance, depuis ses formes les plus basses jusqu'à ses formes les plus élevées ; Sans la contradiction entre nécessité et liberté, non seulement la philosophie, mais en général toutes les plus hautes maîtrises de l'esprit seraient vouées à la destruction, ce qui est le sort des sciences dans lesquelles cette contradiction ne trouve pas d'application. Refuser cette tâche en renonçant à la raison s'apparente plus à une fuite qu'à une victoire. Après tout, on pourrait tout aussi bien renoncer à la liberté en se tournant vers la raison et la nécessité – dans les deux cas, il n’y aurait aucune base pour le triomphe.
Si les choses existent en elles-mêmes, nous arrivons à cette incohérence fondamentale de la coïncidence miraculeuse de l’ordre mondial avec les lois de la raison, que Schelling a si bien exposée. Évidemment, la seule solution possible au dilemme est la seconde, qui consiste à affirmer qu’il n’y a pas de choses en elles-mêmes. Schelling n’a pas seulement remarqué qu’en « libérant » la critique de la contradiction, il s’est en fait lui-même libéré de l’influence du Kant historique et, détruisant les chaînes de la critique, il est passé à une métaphysique libre. Ainsi, dit Schelling, les objets n’existent pas en dehors de l’esprit, mais naissent dans l’esprit, dans un processus spirituel auto-créateur. Dans ce processus, il est nécessaire de faire la distinction entre l’étape inconsciente ou préparatoire et la conscience qui la suit. Ce qui est créé dans un processus inconscient apparaît à la conscience éveillée comme quelque chose donné de l'extérieur - comme le monde extérieur ou la nature. La nature se développe en toute liberté. La volonté pure et autonome est le principe spirituel qui est à la base de ce développement.
Dans cette affirmation, Schelling et Fichte anticipent la philosophie de la volonté. Fichte n'a fait qu'esquisser de manière abstraite le processus inconscient du développement de la nature et a laissé sous-développé la tâche très importante de découvrir ce développement dans la réalité concrète. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de se tourner vers le contenu des sciences empiriques et de construire le développement de la nature, en l'appliquant à ce matériel factuel. Il faut sortir du cadre étroit du raisonnement abstrait « pour entrer dans le champ libre et ouvert de la réalité objective ». Schelling s'est chargé de cette tâche au cours de la deuxième période, philosophique naturelle, de son activité.
Deuxième période
L'appel à la philosophie naturelle ne découlait pas seulement de problèmes philosophiques : il était également requis par le développement des sciences empiriques et répondait généralement à tous les intérêts intellectuels de l'époque. Des phénomènes obscurs et mystérieux et des affinités chimiques ont retenu l'attention à la fin du siècle. attention générale. Dans le même temps, il rendit publique sa découverte, la théorie fut remplacée par la théorie de l'oxygène et la théorie de l'excitabilité se répandit dans le monde médical allemand. Tout cela nécessitait une unification et une explication générale.
Entre tous les phénomènes naturels nouvellement découverts, une sorte de parenté et de dépendance se faisait vaguement sentir. Il fallait trouver un principe général qui révélerait le mystère de la nature et permettrait d'établir la connexion interne de toutes ses manifestations. Seule la philosophie pourrait fournir un tel principe. Schelling comprenait clairement les exigences de l'époque et orientait ses efforts pour les satisfaire. Il avait la combinaison d'une pensée philosophique profonde avec l'œil sobre et vif d'un naturaliste, nécessaire pour résoudre les problèmes philosophiques naturels. Et si la philosophie naturelle de Schelling s'est avérée être une entreprise infructueuse à bien des égards et n'a donné que des résultats éphémères, alors la raison en est à voir non pas dans le manque de talent ou de connaissances nécessaires de Schelling, mais dans l'extrême difficulté des problèmes philosophiques naturels. surtout à cette époque, avec l’absence totale de développement des sciences empiriques.
La philosophie naturelle de Schelling a trouvé plusieurs expressions dans de nombreux essais, écrits les uns après les autres entre 2000 et 2000. Les premiers essais ont le caractère d'esquisses ou d'esquisses. Au fur et à mesure de son développement, Schelling a complété et modifié les opinions exprimées précédemment et a présenté sa théorie sous des formes nouvelles, plus complètes et plus élaborées. Dans ses dernières œuvres philosophiques naturelles, une nouvelle phase de son développement philosophique est apparue, exprimée dans la philosophie de l'identité.
La tâche de Schelling était de retracer le développement de la nature depuis ses stades les plus bas jusqu'aux manifestations les plus élevées de la vie consciente. Pour Schelling, la nature toute entière est une intelligentsia endormie, parvenue à un éveil complet dans l'esprit humain. L'homme est le but suprême de la nature. « Ich bin der Gott, den sie im Busen hegt, der Geist, der sich in Allem bewegt », s'exclame Schelling dans le poème mentionné ci-dessus.
Le principe de base de la philosophie naturelle de Schelling
Le principe de base de la philosophie naturelle de Schelling est le suivant. Du point de vue de ce principe, la nature toute entière semble ne former qu’une seule et même ramification infinie. Les forces internes qui déterminent le développement des différentes parties de cet organisme sont les mêmes partout. Ce n’est que par une complication et une combinaison mutuelles qu’ils donnent des manifestations extérieures aussi diverses de la nature. Il n’y a pas de frontières nettes entre la nature inorganique et organique. Schelling rejette catégoriquement le point de vue selon lequel des forces vitales particulières seraient censées expliquer les processus vitaux. La nature inorganique elle-même produit la nature organique à partir d'elle-même. La base des deux est un processus de vie unique. La source de ce processus est l’âme du monde, qui anime toute la nature. L'essence de la vie est l'interaction des forces. Mais l’interaction n’existe que là où des forces opposées se rencontrent. C’est pourquoi cette opposition ou dualité doit également être reconnue dans ce qui constitue la base de la vie, c’est-à-dire dans l’âme du monde. Mais cette dualité ne doit pas être comprise comme un principe absolu ; au contraire, il est enraciné dans l'unité de l'âme du monde et aspire éternellement à la réconciliation, qui se réalise dans.
La dualité et la polarité sont des principes universels de la nature et de tout développement. Chaque action naît de la collision d'opposés, chaque produit de la nature est déterminé par des activités dirigées de manière opposée, liées les unes aux autres comme positives et négatives. La matière est le résultat de forces répulsives et attractives ; exprimé en opposition aux pôles; révèle la même opposition entre positif et négatif ; l'affinité chimique se révèle le plus clairement à l'opposé et ; toute vie organique, selon la théorie, consiste en la relation entre les forces opposées de l'irritabilité et de l'irritation ; enfin, la conscience elle-même est conditionnée par l'opposition entre l'objectif et le subjectif.
La recherche philosophique naturelle, selon Schelling, est fondamentalement différente de la recherche empirique. explore la nature sous son aspect extérieur, en tant qu'objet extérieur prêt à l'emploi ; avec de telles recherches, son essence même reste cachée et inexplorée. Le philosophe de la nature représente la nature non pas comme quelque chose de donné, mais comme un objet formé de l’intérieur. Il pénètre au plus profond de ce processus créateur et découvre dans l'objet extérieur le sujet intérieur, c'est-à-dire le principe spirituel. « Le moment est venu, dit Schelling à cette occasion, où la philosophie peut être restaurée. » Puisque la philosophie naturelle comprend l’essence de ce principe interne de la nature, elle peut concevoir le développement de la nature. Bien entendu, dans cette construction, elle doit se tester avec des données provenant d’une expérience externe. Mais l’expérience en elle-même n’exprime que le contingent et non le nécessaire interne.
La première tâche de la philosophie naturelle
La manifestation la plus simple de la nature est. La première tâche de la philosophie naturelle est de construire la matière, en tant que phénomène spatial tridimensionnel, à partir des forces internes de la nature. Puisque Schelling réduit entièrement la matière et toutes ses propriétés à la relation des forces primaires, il appelle cette construction un processus dynamique général. Schelling nie catégoriquement la théorie atomique ou corpusculaire. Il estime que la base du processus dynamique repose sur les deux forces les plus générales et initiales : et la répulsion.
Dans la construction même de la matière, il note trois points.
- Le premier consiste en l’équilibre de deux forces opposées en un point ; dans les deux sens, à partir de ce point, il y a une augmentation des forces dirigées de manière opposée. Cette relation de forces est le magnétisme. Dans la construction de la matière, le magnétisme se révèle comme une force linéaire et détermine la première dimension spatiale.
- Le deuxième point est la séparation des forces liées au premier en un point. Cette séparation permet aux forces d’attraction et de répulsion de se propager selon un angle par rapport à la ligne magnétique d’origine. Ce moment détermine la formation de la deuxième dimension. Cela correspond à la puissance de l’électricité. Si le magnétisme doit être qualifié de force linéaire, alors l’électricité est une force de surface.
- La synthèse du magnétisme et de l'électricité constitue le troisième moment, dans lequel la ligne du magnétisme traverse la surface de propagation de l'électricité. En conséquence, les trois dimensions spatiales sont construites.
Les limites des objets matériels ne sont rien d’autre que les limites des forces d’attraction et de répulsion. Mais ces forces ne suffisent pas à former un corps impénétrable. Les limites du corps et sa structure interne sont constituées de points fixes d’attraction et de répulsion. Cette fixation est réalisée par une troisième force générale, qui synthétise deux forces opposées en chaque point du corps. Schelling appelle cette troisième force, qui pénètre à travers et dans toutes les directions la structure dynamique du corps, la gravité. Le corps en dépend. Parmi les forces de la nature, elle correspond à la force d’affinité chimique. La gravité est la force qui construit la matière dans son dernier instant, reliant définitivement toutes les forces d'attraction et de répulsion. L'affinité chimique se révèle déjà dans la matière formée, également en tant que force de synthèse, forçant des corps différents à se pénétrer et à créer de nouveaux types de matière qualitativement différents. L’ordre décrit de construction de la matière ne doit pas être compris dans le sens d’un ordre temporel.
Ce sont des moments idéaux et intemporels, révélés uniquement par une analyse introspective de la nature dynamique de la matière. Schelling appelle les processus dynamiques qui construisent la matière visible des processus de premier ordre ou de nature productive dans la première puissance. Ces processus sont inaccessibles à l’expérience puisqu’ils précèdent la formation de la matière. Seul le processus du troisième moment (gravité), coïncidant avec l'apparition de la matière, se révèle également dans l'expérience. Tous ces processus correspondent aux mêmes processus qui se produisent déjà dans la matière formée. Ce sont des processus de second ordre ou une nature productive de seconde puissance.
Nous avons ici affaire à ces phénomènes de magnétisme et d'électricité qui nous sont connus par expérience. La lourdeur de la deuxième puissance correspond à la chimie. détermine la formation du corps en remplissant l’espace et en le rendant impénétrable. Elle s'oppose à l'activité de la seconde puissance, qui rend l'espace perméable, ce qui se produit par la destruction de la synthèse des forces d'attraction et de répulsion. Cette force reconstructrice, qui redonne vie à des formes figées et mortes, s'appelle. Les activités du magnétisme, de l’électricité et de la chimie sont combinées en une seule activité commune : le galvanisme.
Transition de la nature inorganique à la nature organique
Dans le galvanisme, Schelling voyait le processus central de la nature, représentant un phénomène de transition de la nature inorganique à la nature organique. Selon les trois activités principales de nature inorganique (magnétisme, électricité et chimie), Schelling établit (sous l'influence de Kielmeyer) trois activités principales de nature organique :
- force productive.
Influence de la philosophie naturelle
La philosophie naturelle de Schelling, comparée à d'autres périodes de son activité philosophique, a eu la plus grande influence et le plus grand succès ; Des gens aux intérêts les plus variés y trouvèrent satisfaction. Pour les représentants des sciences naturelles, la philosophie naturelle était un système qui révélait la nature interne des phénomènes, totalement incapable d'étude et d'explication empiriques. L'unité de toutes les forces de la nature, leur parenté et leur connexion internes, le développement progressif de la nature le long des étapes du monde inorganique et organique - telles sont les idées principales de Schelling, qui ont apporté et mettent toujours en lumière tous les domaines de l'histoire naturelle. recherche. Et si la philosophie naturelle de Schelling, prise dans son ensemble, ne pouvait pas être incluse dans le contenu des sciences, alors l’influence de ses idées et principes fondamentaux sur le développement ultérieur des divers domaines de la connaissance était loin d’être éphémère.
Sous l’influence incontestable de Schelling, l’électromagnétisme fut découvert en 1820. Parmi les collaborateurs et disciples de Schelling à cette époque figuraient le géologue, le biologiste Oken, l'anatomiste comparé K. G., le physiologiste, pathologiste, physiologiste végétal Ness von Esenbeck, les médecins Shelver et le psychologue.
L'influence de la philosophie naturelle de Schelling sur la médecine fut particulièrement forte. Le principe philosophique naturel de l'irritabilité s'est avéré coïncider complètement avec la théorie de Brown, qui était populaire à l'époque. Sous l'influence de deux adeptes de Schelling - Roschlaub et V - est apparue toute une galaxie de jeunes médecins emportés par les idées de Schelling et les ont appliqués dans leurs thèses. Que ce soit à cause de ces adeptes zélés ou du manque de développement des propres vues de Schelling à cette époque, ses idées ont reçu une reproduction plutôt humoristique dans les thèses de médecine. Ils disaient que « l'organisme se trouve sous le diagramme d'une ligne courbe », que « le sang est un aimant qui coule », que « la conception est un puissant choc électrique », etc. Comme on pouvait s'y attendre, les ennemis de Schelling n'ont pas tardé à profiter de l'opportunité et attribuer toutes ces absurdités à propos de Schelling lui-même.
La philosophie naturelle de Schelling n'a pas suscité un enthousiasme moins fort parmi les représentants. La philosophie, qui révélait l'âme dans toutes les manifestations de la nature vivante et morte, voyait des liens et des relations mystérieux entre ses manifestations les plus diverses et, finalement, promettait des formes de vie nouvelles et inconnues dans le processus sans fin de l'être - était, bien sûr, semblable à les impulsions du sentiment romantique et de la fantaisie des contemporains de Schelling . S’il est permis d’appliquer des caractéristiques littéraires générales aux systèmes philosophiques, alors la vision du monde de Schelling a le premier droit d’être appelée philosophie.
Le thème principal de la philosophie naturelle de Schelling était le développement de la nature en tant qu'objet extérieur, depuis les niveaux les plus bas jusqu'à l'éveil de l'intelligentsia en son sein. Dans l'histoire de cette évolution, cependant, un seul aspect du problème philosophique général de la relation entre l'objectif et le subjectif est résolu, à savoir la question du passage de l'objectif au subjectif. L’autre côté reste en suspens, celui de l’émergence inverse de l’objectif dans le subjectif. Comment l'intelligentsia parvient-elle à reproduire la nature et comment cette coordination du processus cognitif avec le développement objectif de la nature est généralement concevable - telles sont les questions qui constituent le thème de l'une des œuvres les plus complètes de Schelling : « System des transcendantalen Idealismus », qui fait référence à à la période de transition de la philosophie naturelle à la philosophie de l'identité.
Troisième période
Le système de l’idéalisme transcendantal se divise, comme les trois critiques de Kant, en trois parties :
- dans la première, théorique, on explore le processus d’objectivation, qui se produit à travers la reproduction par l’esprit de la nature de l’objectif ;
- dans le second, pratique, la création de l'objectif dans l'action libre ;
- dans le troisième, l'esthétique, le processus de créativité artistique, dans lequel l'opposition des principes théoriques et pratiques trouve sa plus haute synthèse.
Schelling considère que l’organe de la recherche transcendantale est la capacité de discerner intérieurement ses propres actes. Dans l'intuition intellectuelle, l'intelligentsia perçoit directement sa propre essence. Dans le développement de l’objectif, Schelling distingue trois époques au cours desquelles l’intelligentsia passe successivement d’un état vague et lié à un acte de libre volonté.
- La première époque commence avec l’émergence. Ce sentiment est provoqué par la propre retenue de chacun, en plaçant une limite à son « je ». C'est la conscience de cette limitation qui apparaît à la conscience comme quelque chose d'extérieur.
- La sensation, reconnue comme objet extérieur, clairement distinguable du sujet, devient productive, marquant la deuxième ère.
- La troisième ère consiste en la libre considération des produits de la contemplation, en passant arbitrairement d'un objet à l'autre.
Ce cours de développement de l'objectif dans la conscience est pleinement cohérent, selon Schelling, avec le développement de la nature révélé dans la philosophie naturelle. Tout comme ici le point de départ est la retenue, le processus dynamique naît ici de la limitation de la force d'attraction répulsive. Dans un cas le produit est sensation, dans l’autre il est matière. De même, toutes les étapes de la connaissance correspondent aux étapes de la nature. La raison de cette correspondance et de cette coïncidence réside dans le fait que les deux processus sont enracinés dans la même essence et sont, dans un certain sens, identiques. La possibilité d'une action libre est due à la capacité de s'abstraire complètement de tous les objets. Grâce à cette abstraction, le « je » se reconnaît comme un principe indépendant et auto-actif. L’activité résultante du « je » pratique devient orientée vers un but. L'activité volontaire est dirigée vers des individus extérieurs à nous. C'est dans cette relation avec les autres êtres qu'il reçoit son contenu varié.
L'idéalisme transcendantal conduit Schelling à comprendre le processus historique comme la réalisation de la liberté. Cependant, comme il s’agit ici de la liberté de tous, et non de celle des individus, cet exercice est limité par l’ordre juridique. La création d’un tel ordre juridique combine les deux. La nécessité est inhérente aux facteurs inconscients du processus historique, la liberté - aux facteurs conscients. Les deux processus mènent au même objectif. La coïncidence du nécessaire et du libre dans la mise en œuvre de l'objectif mondial indique que la base du monde est une sorte d'absolu, ce qui est le cas.
La participation de la puissance divine au processus historique se manifeste de trois manières :
- principalement sous la forme d'une force aveugle régnant sur les gens ; C'est la première période fataliste, caractérisée par un caractère tragique.
- Dans la deuxième période, qui comprend et, le principe dominant est mécanique.
- Dans la troisième période, la puissance divine se manifestera comme. "Quand cette période viendra, alors il y aura Dieu", affirme mystérieusement Schelling.
Le lien entre la philosophie naturelle et l'idéalisme subjectif de Fichte
Les premières esquisses de la philosophie naturelle de Schelling étaient en relation étroite avec. La tâche de Schelling était, entre autres choses, de construire la nature à partir des conditions transcendantales de la connaissance. Si ce problème n’a reçu en réalité qu’une solution apparente, alors, en tout cas, Schelling a reconnu qu’une telle construction était tout à fait possible.
À mesure que la philosophie naturelle se développait, son attitude à l'égard du point de vue de Fichte changea considérablement. La compréhension de la nature comme un objet qui n'existe que dans la conscience, c'est-à-dire comme une réalité purement phénoménale, a été remplacée par une vision de la nature comme quelque chose existant en dehors de la conscience et avant la conscience. Au contraire, la conscience elle-même a acquis le sens de quelque chose de secondaire, n'apparaissant qu'à un certain stade du développement de la nature. En plus du sens d'un phénomène subjectif, le concept de nature a reçu le sens d'un objet totalement indépendant. Ainsi, le point de vue de Schelling commença à s'opposer à l'idéalisme subjectif de Fichte, comme...
Philosophie de l'identité
La philosophie de l'identité est au centre de la vision du monde de Schelling, qui s'est déjà manifestée aux étapes précédentes de son développement philosophique et détermine son achèvement mystique. En même temps, c'est la partie la plus vague et la plus incompréhensible de sa philosophie. Une tentative de relier et d'unir les idées principales des plus grands philosophes en un tout ne pourrait être réalisée que sous le couvert d'une abstraction extrême et à l'aide de concepts errants de « sujet-objet », « idéal-réel », etc.
L'identité absolue apparaît chez Schelling, conciliant deux vues fondamentales et en même temps opposées : et la critique. Dans le premier, la nature est reconnue comme indépendante de la connaissance ; dans le second, il est entièrement compris comme un produit de la connaissance et perd en même temps sa réalité objective. Les deux vues contiennent .
La base de la nature réside en réalité, mais pas dans la connaissance relative, humaine, mais absolue ou, plus précisément, dans la connaissance de soi. Dans ce document, la différence entre objectif et subjectif, idéal et réel est complètement détruite, et donc cette connaissance est en même temps identité absolue. Schelling l'appelle aussi (All-Eine). C'est à la fois un tout complètement achevé, éternel et infini. Le monde entier des choses finies prend sa source dans cette identité absolue, à partir des profondeurs de laquelle il se développe dans un processus auto-créateur continu.
Le développement du monde se déroule selon les degrés de différenciation de l'objectif et du subjectif. Objectif et subjectif sont inhérents à toutes choses finies, en tant que facteurs nécessaires. Ils se rapportent les uns aux autres comme des quantités mutuellement négatives, et donc une augmentation de l'une est associée à une diminution de l'autre. chaque chose finie est entièrement déterminée par la prédominance de l'un ou l'autre facteur. Toutes les choses finies forment différentes formes ou modes de découverte de l'identité absolue, contenant certains degrés de subjectif et d'objectif. Schelling appelle ces types.
Le monde est une gradation de potentiels. Chaque puissance représente un maillon nécessaire dans le monde. Schelling distingue deux grandes séries de potentiels : l'un, à prédominance du subjectif, a un caractère idéal, l'autre, à prédominance de l'objectif, est réel. Les deux séries sont absolument identiques dans leur valeur absolue, mais opposées dans les facteurs croissants de l'idéal et du réel. Schelling schématise ces séries sous la forme de deux lignes de direction opposée partant du point d'indifférence ; aux extrémités de ces lignes sont placés les pôles de détection objective et subjective. Dans cette construction, il est facile de découvrir le schéma préféré de Schelling. Chaque puissance est une manifestation des idées éternelles de l'absolu ; les seconds sont aux premiers ce que la natura naturans est à la nature naturata.
Schelling compare les idées à des unités éternelles dans les profondeurs de l'absolu. La même assimilation du concept de monade a été faite autrefois par nous-mêmes. Dans les concepts d'idée-monade-puissance, unis par le principe le plus élevé d'identité absolue, Schelling tente de combiner la philosophie de Leibniz et de Spinoza avec sa philosophie naturelle. Il est tout à fait naturel que la philosophie de l’identité, qui représente une synthèse des idées des trois philosophes cités, soit en même temps un renouveau de la vision du monde de Bruno, qui constitue une étape historique de Platon à Spinoza et Leibniz.
En son honneur, Schelling a écrit le dialogue « Bruno », qui représente une modification du système d'identité, initialement exposé de manière plus géométrique dans « Darstellung meines Systems der Philosophie ». Chez Bruno, le principe d'identité est caractérisé sous des points de vue légèrement différents. La coïncidence de l'idéal et du réel dans l'absolu est égale à l'unité et. Cette unité la plus élevée est l'idée ou l'intuition pensante ; il combine les deux , et . L’identité de la contemplation et du concept est en même temps l’identité des deux, du fini et de l’infini. L'identité infinie ou, ce qui revient au même, absolue représente pour Schelling un tout idéologique, dépourvu de toute différenciation, mais étant en même temps la source de tout ce qui est différencié. C'est l'abîme de l'existence dans lequel tous les contours se perdent et auquel s'applique la remarque moqueuse selon laquelle tous les chats y sont gris.
La quatrième période
La question de l’émergence du fini des profondeurs de l’infini se pose déjà. La question est de savoir comment comprendre la relation entre la nature inférieure, c'est-à-dire la nature matérielle, et celle-ci. peut être comparé à Dieu en tant que principe complètement indépendant ou déduit de l'essence de Dieu à travers le concept, comme y. Schelling nie ces deux méthodes.
Le problème de la relation du mal avec Dieu peut avoir une solution dualiste – dans laquelle le mal est compris comme un principe indépendant – et une solution immanente. Dans ce dernier cas, le coupable du mal est Dieu lui-même. Schelling concilie ces deux points de vue. Le mal n’est possible qu’avec l’hypothèse de la liberté ; mais la liberté ne peut être qu'en Dieu. En revanche, la racine du mal ne peut pas être dans la personne de Dieu. Schelling élimine cela en acceptant en Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu lui-même.
Cette attitude est particulièrement clairement clarifiée par Schelling dans son « Monument » polémique sur la philosophie de Jacobi. Contre les critiques de Jacobi, qui l'accusait de panthéisme, Schelling avance l'argument selon lequel son panthéisme est une base nécessaire au développement d'une vision théiste du monde. La théologie, à partir d'un Dieu personnel, donne un concept dépourvu de tout fondement et de tout contenu défini. Par conséquent, une telle théologie ne peut être qu’une théologie du sentiment ou de l’ignorance. Au contraire, la philosophie de l'identité est la seule source possible de connaissance philosophique de Dieu, puisqu'elle donne une conception de Dieu tout à fait accessible à la raison, comme personnalité se développant à partir de son principe fondamental. Le théisme est impossible sans le concept d’un Dieu personnel vivant, mais le concept d’un Dieu vivant est impossible sans une compréhension croissante de Dieu, et le développement présuppose la nature à partir de laquelle Dieu se développe. Le théisme doit donc avoir son fondement dans le naturalisme.
La véritable philosophie de la religion est une combinaison des deux points de vue. La découverte de Dieu se déroule par étapes et consiste en une « transmutation » interne ou principe obscur. Les choses finies représentent différents types et formes de cette transmutation. Il y a un certain degré d’illumination en chacun d’eux. Le plus haut degré de cette illumination consiste dans l’esprit ou volonté universelle (Universalwille), qui amène toutes les forces cosmiques dans l’unité intérieure. À cette volonté universelle s’oppose la volonté particulière ou individuelle des créatures individuelles, enracinée dans un fondement différent de Dieu. La volonté séparée des êtres individuels et la volonté universelle représentent deux pôles moraux. Le mal réside dans la prédominance du premier sur le second.
L’homme représente le stade auquel la volonté universelle est découverte pour la première fois. Dans ce document, pour la première fois, apparaît la possibilité de cette bifurcation de la volonté individuelle et universelle, dans laquelle le mal se révèle. Cette possible bifurcation est une conséquence de la liberté humaine. Ainsi, le mal dans la nature humaine consiste à affirmer son isolement, à s'efforcer du centre originel de l'absolu vers la périphérie. Schelling conteste l’opinion de Leibniz selon laquelle le mal est un concept purement négatif de manque ou d’absence de bien. Contrairement à cette vision, il voit le mal comme une force positive dirigée contre la force du bien.
Schelling le confirme en disant que si le mal consistait uniquement en un manque de bonté, alors il ne pourrait se révéler que chez les créatures les plus insignifiantes. Pendant ce temps, en réalité, le mal ne devient possible que pour les êtres les plus parfaits et va souvent de pair avec la découverte de grands pouvoirs, comme par exemple. « Ce n'est pas la terre qui s'oppose au ciel, mais l'enfer », dit Schelling, « et comme le bien, il y a aussi l'inspiration du mal. » Bien que le mal représente une force hostile à Dieu, c’est seulement à travers lui que la découverte de Dieu est possible. Dieu ne peut se révéler qu'en surmontant son contraire, c'est-à-dire le mal, car en général toute essence ne se révèle que dans son contraire : la lumière dans les ténèbres, l'amour dans la haine, l'unité dans la dualité.
Représentant un désir naturel dirigé dans la direction opposée à la volonté universelle, le mal est vaincu par l'acte de renoncer à son individualité. Dans ce renoncement, comme dans le feu, la volonté humaine doit être purifiée pour devenir participante de la volonté universelle. Pour vaincre le mal, vous devez d’abord surmonter le début sombre de la nature élémentaire en vous. Situé au point culminant de la nature, l'homme a naturellement tendance à replonger dans l'abîme, tout comme celui qui a grimpé au sommet d'une montagne est pris de vertige et menace de tomber. Mais la principale faiblesse de l’homme est la peur du bien, car le bien exige le renoncement à soi-même et la mortification de son égoïsme. Cependant, l’homme est par nature capable de surmonter cette peur et ce désir du mal. La liberté consiste en cette capacité.
Par liberté, Schelling entend non pas la possibilité aléatoire de choix dans chaque cas donné, mais l'autodétermination interne. La base de cette autodétermination est le caractère, c'est-à-dire ce prius de l'individualité humaine, qui détermine de temps à autre une constitution humaine donnée et les actions qui en découlent. Le caractère intelligible est cet acte primordial de la volonté individuelle qui détermine ses autres manifestations. La volonté première, qui sous-tend le caractère intelligible, est totalement libre, mais les actes dans lesquels elle se manifeste se succèdent nécessairement et sont déterminés par sa nature originelle. Ainsi, dans le développement d'un caractère intelligible, la liberté se conjugue avec la nécessité (indéterminisme et déterminisme).
En ce sens, Schelling établit le concept de mal ou de bien inné, qui rappelle l'idée de prédestination morale. La culpabilité d’une personne dans le mal qu’elle découvre ne réside pas tant dans ses actes conscients que dans l’autodétermination préconsciente de son caractère intelligible. Schelling considère la question de la personnalité de Dieu en lien étroit avec la question de la relation de Dieu avec le mal. La source du mal est la nature obscure de Dieu. A cela s'oppose le principe idéal en Dieu ou la raison - la personnalité de Dieu consiste en la combinaison de ces deux principes. Le principe idéologique se retrouve dans l'amour. La volonté aveugle d'auto-génération et la libre volonté d'amour sont les activités fondamentales de Dieu, unies dans sa personne.
En vertu de cette connexion, la nature obscure, puisqu’elle est en Dieu, n’est pas encore mauvaise. Il ne devient mauvais que dans la nature des choses finies, là où il n'obéit pas au principe de lumière et à l'unité la plus élevée. Ainsi, le mal ne se développe qu’accessoirement (begleitungsweise) lors de la découverte de Dieu et, bien qu’enraciné dans sa nature obscure, il ne peut être reconnu comme un acte de Dieu. C’est un abus des pouvoirs de Dieu, qui dans sa personne sont absolument bons. L'unification du principe obscur ou élémentaire et idéologique en Dieu se produit par l'amour dans le principe fondamental le plus profond de Dieu (Urgrund), qui est sa personnalité absolue. Ainsi, Dieu lui-même est sujet à développement et passe par trois phases principales de son existence : le principe primordial, l'esprit et la personnalité absolue. Une étude détaillée des phases ou éons de Dieu a été entreprise dans l'œuvre inachevée "Weltalter". Schelling applique ici le concept de puissance aux périodes de développement de Dieu.
La philosophie positive de Schelling
La philosophie positive de Schelling représente, de son propre aveu, l'achèvement de sa philosophie négative antérieure. Le point de vue développé par Schelling dans cette dernière période de son développement n'avait pas d'expression littéraire particulière et fut rendu public à travers des conférences données à l'Université de Berlin et, en outre, dans l'édition posthume des travaux de Schelling sur les papiers qu'il a laissés. derrière.
Schelling définit la philosophie négative comme une vision rationaliste du monde qui comprend le monde en termes de raison. Une telle philosophie était son propre système, ainsi que l’idéalisme de Hegel, qui, selon lui, ne représente qu’un développement détaillé des idées qu’il exprimait. En revanche, la philosophie positive est la compréhension du monde non pas dans son essence rationnelle, mais dans son existence même réelle. Cette compréhension ne repose plus sur une activité rationnelle, mais sur des processus de nature intuitive qui constituent le contenu de la religion. C'est pourquoi la philosophie positive porte son attention sur les domaines de la conscience humaine dans lesquels la vérité s'obtient de manière irrationnelle, à savoir la contemplation et la révélation religieuses et artistiques.
Et la religion de la révélation, c'est-à-dire le christianisme. La mythologie est une religion naturelle dans laquelle la vérité religieuse se révèle dans le processus naturel de développement, tout comme sa signification idéologique se révèle progressivement dans le développement naturel de la nature.
Dans la mythologie, Schelling distingue trois étapes, selon le degré avec lequel la pluralité périphérique du polythéisme est dépassée par l'unité centrale du monothéisme. Dans la religion de la révélation, dont le personnage principal est le Christ lui-même, Schelling voit également trois étapes :
- préexistence,
- l'incarnation et
- réconciliation.
Schelling établit la même triplicité par rapport au développement historique du christianisme, formant trois époques selon les noms des principaux apôtres.
- Le premier âge, Pétra, marque l’unité extérieure et violente de l’Église.
- L'ère de Paul brise cette unité et introduit un esprit de liberté dans le christianisme.
- L'ère future de Jean restaurera l'unité perdue sur la base de la liberté et de l'illumination intérieure.
Pierre est avant tout le représentant de Dieu le Père, Paul – le Fils, Jean – l'Esprit. La philosophie positive de Schelling n’est essentiellement qu’une philosophie de la religion. Sa différence avec les études qui l'ont immédiatement précédée sur la relation du monde avec Dieu était seulement que les questions religieuses y étaient résolues principalement sur la base de spéculations purement philosophiques, tandis que dans la philosophie positive, la recherche philosophique inclut le contenu des religions historiques et donne ce contenu. une interprétation et une forme rationnelles. En fait, la philosophie négative de la dernière période était également imprégnée de cet esprit ; elle était de facto sous l'influence du christianisme, tandis que la philosophie positive était soumise à cette influence de jure et ex principio.
Le sens de la philosophie de Schelling
Schelling n'a pas quitté une école spécifique qui pourrait être désignée par son nom. Son système, qui représentait l'intégration de trois points de vue relativement étrangers
- idéalisme subjectif,
- naturalisme objectif et
- mysticisme religieux,
Elle ne pouvait maintenir son unité quelque peu violente que dans l'horizon de son esprit et dans la forme particulière de sa présentation.
Il est donc tout à fait naturel que de nombreux chercheurs de Schelling ne soient adeptes que de certaines époques de son activité philosophique. Le principal successeur de la vision centrale du monde de Schelling, à savoir le système d'identité, dans sa forme idéologique, était. Enfin, le renouveau des aspirations religieuses et mystiques de Schelling ne peut qu'être noté dans les œuvres de Vl. S. Soloviev, qui dans son histoire sur l'Antéchrist a donné une image vivante de la restauration de l'unité de l'Église par l'aîné éclairé Jean.
L'importance de la philosophie de Schelling réside dans l'idée que le monde est fondé sur un processus idéologique vivant, qui trouve son reflet véridique dans la cognition humaine. Cette idée est en partie une modification de la position fondamentale du rationalisme des XVIIe et XVIIIe siècles. sur l'identité des relations logiques et réelles. Cependant, la justification et le développement de Schelling présentent des différences très significatives. La raison et la réalité extérieure, bien qu'elles soient en correspondance mutuelle chez les rationalistes, sont en réalité étrangères l'une à l'autre et ne sont coordonnées que par la médiation de Dieu. Pour Schelling, la rationalité (ou l'idéologie) et la réalité se pénètrent mutuellement, de sorte que l'acte de cognition est une découverte naturelle de cette identité naturelle. De plus, le concept de liberté a une application beaucoup plus large chez Schelling que chez les rationalistes.
L'idéalisme de Schelling ne peut pas non plus être considéré comme aboli par l'idéalisme de Hegel, dont il se distingue par une plus grande vitalité. Si dans le détail des concepts, dans leur justification plus stricte et plus distincte, l'idéalisme absolu représente sans doute un pas en avant par rapport à l'idéalisme un peu vague de Schelling, alors celui-ci reste totalement affranchi de l'erreur fondamentale de Hegel, qui consiste à réduire le réel sans remonter à l'idéal. Le réel de Schelling ne contient que l'idéal comme sens le plus élevé, mais il a aussi un caractère concret irrationnel et une plénitude vitale. Par conséquent, pour Schelling, il est tout à fait compréhensible que les créatures s’écartent des normes absolues de rationalité et de bonté.
En général, la théorie de l’origine et ses relations avec celle-ci constituent l’une des sections les plus précieuses et les plus réfléchies du système de Schelling, pour laquelle elle revêt une importance durable.
Grands travaux
- "Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt" (1794);
- « Vom Ich als Princip der Philosophie » (1795) ;
- "Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" (1795);
- "Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre" (1796-97) ;
- "Idée pour la philosophie de la nature" (1797);
- "Von der Weltseele" (1798) ;
- "Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie" (1799);
- "Einleitung zum Entwurf" (1799);
- "Système des idéalismes transcendantaux" (1800);
- "Allgemeine Déduction des Processus Dynamischen" (1800);
- "Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie" (1801);
- "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801);
- "Bruno. Ein Gespräch" (1802);
- "Fernère Darstellungen aus dem System der Philosophien" (1802);
- « Philosophie der Kunst » (cours donnés à Iéna en 1802-1803 et à Würzburg en 1804-1805 ; publié à titre posthume).
Les éléments suivants sont importants :
- "Zusätze" pour la deuxième édition de "Ideen" en 1803 et
- "Abhandlung über das Verhältniss des Realen und Idealen in der Natur", annexé à la 2e éd. « Weltseele » (1806) ;
- "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums" (1803);
- « Philosophie et religion » (1804) ;
- "Darlegung des wahren Verhältnisses Naturphilosophie zur verbesserten Fichteschen Lehre" (1806) ;
- « Ueber das Verhältniss der bildenden Künste zur Natur » (discours solennel prononcé à l'Académie des Arts de Munich en 1807) ;
- « Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit » (1809) ;
- "Denkmal der Schrift Jacobis von den göttlichen Dingen" (1812);
- "Weltalter" (à titre posthume);
- "Ueber die Gottheiten von Samothrake" (1815);
- "Ueber den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt" (à titre posthume);
- "Die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung" (philosophie positive - éd. posthume).
En outre, Schelling a écrit de nombreux petits articles et critiques, publiés dans les journaux qu'il publiait et inclus dans l'édition posthume de ses œuvres, entreprise par son fils (1856-1861, 14 volumes). Il comprenait également de nombreux discours solennels de Schelling.