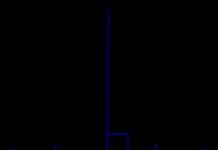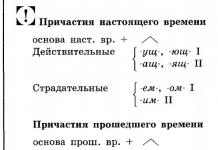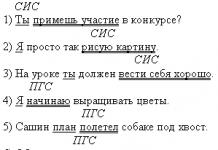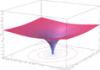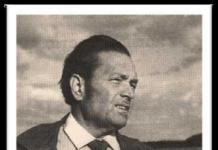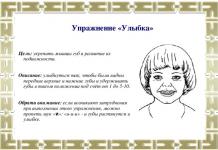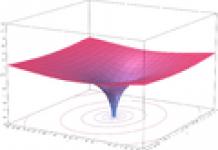La dissonance cognitive est condition mentale, accompagné d'un inconfort causé par l'incohérence ou l'incohérence dans l'esprit d'un certain nombre d'idées et de concepts contradictoires. Malgré la complexité du nom et de la définition, chaque personne est confrontée à quelque chose de similaire presque tous les jours. Parfois, sans le savoir, nous nous plongeons dans un tel état, mais le plus souvent cela se produit pour des raisons indépendantes de la personne.
Signification du concept
La dissonance cognitive est un phénomène psychologique qui implique l'apparition d'une certaine incohérence entre deux cognitions. Ainsi, souvent, dans ses actions, une personne doit soit négliger les directives sociales, soit sacrifier principes personnels. De ce fait, un certain désaccord apparaît entre l’action et la croyance.
À la suite de l'apparition d'une dissonance cognitive, une personne peut recourir à la justification de ses propres actions ou de ses idées fausses qui vont à l'encontre des normes généralement acceptées. Autrement, l’individu doit orienter sa pensée dans une nouvelle direction, qui correspondrait aux opinions des autres et réduirait les sentiments contradictoires.
Dissonance cognitive - qu'est-ce que c'est en termes simples ?
Beaucoup concepts psychologiques et les termes ne sont pas si faciles à comprendre et à comprendre leur signification. Parfois, une explication détaillée est requise. Cela s'applique également à un phénomène tel que la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est en mots simples? L’explication de ce concept est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît à première vue.
Chaque personne a une sorte d'expérience de vie et une opinion personnelle concernant la solution de certaines situations. Cependant, il n’est pas toujours possible de résoudre un problème particulier en se basant sur ses propres idées. Parfois, une personne va à l'encontre de sa propre opinion, par exemple pour plaire aux opinions des autres, aux valeurs sociales ou aux normes de la loi. Cet écart entre les pensées et les actions est appelé dissonance cognitive.
Il arrive parfois qu’un individu enfreigne consciemment ou inconsciemment certaines règles (ou même commette un crime). Dans ce cas, il est important de recevoir une justification non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Ainsi, une personne commence à rechercher ou à inventer des moments qui peuvent atténuer la culpabilité afin d’atténuer les contradictions internes. Il convient également de noter que de telles contradictions peuvent surgir non seulement entre un individu, mais également au niveau du collectif.
La dissonance cognitive se produit aussi souvent lorsqu’une personne doit prendre une décision importante. L’individu est envahi par des doutes qui ne disparaissent pas même lorsque le choix final est fait. L'activité mentale visera pendant un certain temps à faire le tri dans votre tête dans les options possibles et leurs conséquences.

Causes de la dissonance cognitive
La dissonance cognitive peut survenir pour plusieurs raisons courantes, parmi lesquelles les suivantes méritent d'être soulignées :
- incohérence des idées et des concepts qui guident une personne lors de la prise de certaines décisions ;
- écart entre les croyances de vie et les normes généralement acceptées dans la société ou dans un certain cercle ;
- un esprit de contradiction provoqué par une réticence à suivre les normes culturelles et généralement acceptées normes éthiques, et surtout lorsqu'ils vont à l'encontre de la loi ;
- divergence entre les informations obtenues à la suite d'une expérience particulière et de nouvelles conditions ou situations.

Auteur de la théorie
L'auteur de la théorie de la dissonance cognitive est Leon Festinger. Cette doctrine a été présentée en 1957 et visait à expliquer l'essence, les causes et les schémas de ce phénomène. L'auteur considérait ce concept comme un phénomène d'incohérence entre les diverses pensées et idées d'un individu (ou d'un collectif).
Regardez la vidéo : "La théorie de la dissonance cognitive de Leon Festinger"Hypothèses de la théorie
La théorie de la dissonance cognitive de L. Festinger repose sur deux hypothèses principales, qui sont les suivantes :
- du fait que l'apparition d'une dissonance cognitive s'accompagne d'un inconfort psychologique, l'individu tentera par tous les moyens de surmonter cet écart ;
- du premier point, on peut déduire le second, qui stipule qu'une personne évitera par tous les moyens possibles les situations qui pourraient la plonger dans un tel état.
La théorie de la dissonance cognitive de Festinger fournit non seulement une interprétation et une clarification des concepts, mais explique également les moyens de sortir de cet état. De plus, le scientifique considère un certain nombre cas réels, qui sont les exemples les plus typiques en psychologie.

L'essence de la théorie
La première chose à noter est le fait que la théorie de la dissonance cognitive appartient à la catégorie des théories motivationnelles. Cela signifie que cet état est déterminant dans le comportement de l'individu. On peut dire que ce sont les idées et les croyances qui influencent largement les actions d’une personne, ainsi que ses position de vie. Ainsi, la connaissance ne peut être interprétée uniquement comme un ensemble de certains faits. Ce sont principalement des facteurs de motivation qui déterminent le comportement humain dans les deux domaines. Vie courante, et dans des situations non standard.
Le concept de dissonance cognitive combine deux catégories. Le premier d'entre eux est l'intelligence, qui est considérée comme un ensemble de certaines croyances et connaissances, ainsi que d'attitudes à leur égard. Le second est l’affect, c’est-à-dire la réaction aux agents pathogènes et aux stimuli. Au moment même où une personne cesse de trouver un lien ou ressent des contradictions internes entre ces catégories, un état de dissonance cognitive se produit.
Le processus lui-même est inextricablement lié aux événements et expériences passés de l’individu. Ainsi, après avoir commis un certain acte, une personne peut commencer à se repentir ou à éprouver des remords. De plus, cela peut se produire après une période de temps importante. L'individu commence alors à chercher une excuse pour son action ou des faits qui peuvent atténuer sa culpabilité.

Comment réduire les dissonances ?
L'état de dissonance cognitive provoque un inconfort psychologique dont l'individu tente tout naturellement de se débarrasser (ou du moins de réduire quelque peu les sensations désagréables). Il existe plusieurs façons d’obtenir un soulagement à une condition contradictoire, à savoir :
- changer la ligne de votre comportement (si vous sentez que vous faites mal ou que vous agissez contrairement à vos convictions, vous devez orienter vos efforts dans la direction opposée, si cela semble possible dans ce cas particulier) ;
- vous convaincre (c'est-à-dire la recherche de justification de vos actes afin de réduire leur culpabilité voire de les rendre corrects dans votre compréhension) ;
- filtrer les informations (afin de ne pas ressentir de contradictions internes, vous ne devez percevoir que les données positives, et ne pas prendre au sérieux toute négativité ni l'éviter complètement) ;
- prendre en compte toutes les informations et tous les faits sur la situation actuelle, s'en faire une idée, puis construire une nouvelle ligne de comportement qui sera considérée comme la seule correcte.

Comment éviter les dissonances
Puisque le phénomène de dissonance cognitive est associé à un inconfort et stress psychologique, beaucoup préfèrent prévenir cette maladie plutôt que de faire face à ses conséquences plus tard. L'un des moyens les plus accessibles d'y parvenir est d'éviter tout informations négatives, ce qui peut contredire vos convictions personnelles ou la situation actuelle. Cette méthode s'inscrit dans le concept protection psychologique, qui a été développé par Sigmund Freud et développé plus tard par ses disciples.
Dans le cas où l'apparition d'une dissonance cognitive ne peut être évitée, vous pouvez la combattre la poursuite du développement. Pour ce faire, des éléments supplémentaires sont introduits dans le système cognitif, conçus pour présenter la situation actuelle sous un jour positif. Dans ce cas, vous devez ignorer ou éviter de toutes les manières possibles les sources d'informations qui peuvent vous ramener à l'état initial.
L’un des moyens les plus courants et les plus accessibles de faire face à la dissonance est d’accepter la réalité et de s’y adapter. À cet égard, il vaut la peine de se convaincre que la situation est acceptable. De plus, si le phénomène est de longue durée, alors travail psychologique devrait viser à changer ses propres croyances

Dissonance cognitive : exemples tirés de la vie
Dans la vie réelle, vous pouvez souvent rencontrer de tels phénomènes qui provoquent un sentiment d'incohérence ou d'incohérence des croyances avec la situation réelle. C'est une dissonance cognitive. Leurs exemples sont assez nombreux.
L'exemple le plus simple est celui d'un médaillé d'or et d'un étudiant C qui est entré à l'université. Il est tout à fait logique que les enseignants attendent du premier des résultats élevés et un niveau de connaissances décent, mais n'ont pas beaucoup d'espoir pour le second. Cependant, il se peut qu'un excellent étudiant réponde à la question de manière très médiocre et incomplète, tandis qu'un étudiant C, au contraire, donnera une réponse compétente et significative. Dans ce cas, l'enseignant éprouve une dissonance cognitive due au fait que ses croyances se sont avérées incompatibles avec la situation réelle.
Un autre exemple donné par le psychologue A. Leontyev illustre la volonté de réduire l'inconfort. Ainsi, les révolutionnaires emprisonnés ont été contraints de creuser des trous en guise de punition. Naturellement, les prisonniers trouvaient cette activité désagréable, voire dégoûtante. Pour réduire le sentiment d’inconfort psychologique, beaucoup ont donné à leur action un nouveau sens, celui de nuire au régime actuel.
Aussi, la dissonance cognitive peut être envisagée par rapport aux personnes qui ont de mauvaises habitudes (par exemple, les fumeurs, ou celles qui abusent de l'alcool. Il est tout à fait naturel qu'elles se rendent toutes compte tôt ou tard des méfaits de ces phénomènes pour leur corps. Dans ce cas , il existe deux scénarios : soit l'individu essaie par tous les moyens disponibles de se débarrasser d'une mauvaise habitude, soit il commence à chercher des excuses qui, dans son esprit, peuvent l'emporter sur les dommages possibles à la santé.
Un autre exemple est également lié au type situation de vie. Ainsi, par exemple, vous voyez un mendiant dans la rue qui demande l'aumône, mais à son apparence, vous pouvez dire qu'il ne mérite pas vraiment cet argent ou qu'il n'en a pas vraiment besoin (ou peut-être qu'il ne dépensera pas d'argent en nourriture). ou des médicaments, mais de l'alcool ou des cigarettes). Néanmoins, sous l’influence de vos principes de vie ou de vos normes morales, vous ne pouvez pas passer à côté d’une telle personne. Ainsi, sous la direction des principes sociaux, vous faites ce que vous ne voulez pas.
Il arrive parfois qu'avant un examen important, un étudiant ne s'y prépare tout simplement pas. Cela peut être dû à la paresse, à des problèmes de santé, à des circonstances imprévues, etc. Ainsi, comprendre votre responsabilité dans le résultat et réaliser conséquences possibles, l'individu ne fait cependant aucune tentative pour apprendre les notes.
Les filles qui s'efforcent de perdre du poids et se tourmentent avec des régimes sont souvent exposées à une dissonance cognitive. Si à ce moment-là ils veulent manger, par exemple, un gâteau, cela contredira leurs objectifs et idées générales sur une bonne nutrition. Il existe ici plusieurs solutions possibles au problème. Vous pouvez continuer à insister par vous-même et vous priver de sucreries, ou vous pouvez arrêter complètement le régime, en vous assurant que vous avez déjà fière allure. Vous pouvez également vous faire une gourmandise ponctuelle, qui sera ensuite compensée par le jeûne ou l'activité physique.
Conclusion
De nombreux scientifiques et psychologues ont étudié la question de la dissonance cognitive. Il convient particulièrement de prêter attention aux travaux de Leon Festinger, ainsi que de Sigmund Freud et de ses disciples. Leurs théories sont les plus complètes et contiennent non seulement des informations sur le phénomène lui-même et ses causes, mais également sur les moyens de résoudre le problème.
Il convient de noter que la théorie qui décrit le phénomène de dissonance cognitive concerne la théorie motivationnelle. La contradiction qui résulte de l’écart entre les croyances, les désirs et les actions réelles influence largement le comportement futur de l’individu. Il peut accepter la situation et essayer de reconsidérer ses idées, ce qui réduira quelque peu l'état de dissonance, ou il peut recourir à des tentatives pour expliquer ou justifier son comportement, en évitant les données et les faits réels (en se protégeant du monde extérieur) .
Pour éviter un état de dissonance cognitive, vous devez éviter les états contradictoires et les informations qui contredisent vos croyances. De cette façon, vous pouvez vous protéger des contradictions internes qui naissent de la nécessité d’agir contrairement à vos désirs et à vos croyances.
Principales hypothèses de la théorie
- en raison d'une incohérence logique ;
- « en raison de coutumes culturelles » ;
- dans le cas où une opinion individuelle fait partie d’une opinion plus large ;
- en raison du décalage entre l'expérience passée et la situation actuelle.
Par conséquent, les gens sont prêts à justifier leurs illusions : une personne qui a commis un délit ou une erreur est encline à se justifier dans ses pensées, déplaçant progressivement ses croyances sur ce qui s'est passé vers le fait que ce qui s'est passé n'était en réalité pas si terrible. De cette manière, l’individu « régule » sa pensée afin de réduire le conflit en lui-même.
Degré de dissonance
Dans diverses situations qui surviennent dans la vie quotidienne, la dissonance peut augmenter ou diminuer - tout dépend du problème auquel la personne est confrontée.
Ainsi, le degré de dissonance sera minime si une personne, par exemple, donne de l'argent à un mendiant dans la rue, qui (apparemment) n'a pas vraiment besoin d'aumône. Au contraire, le degré de dissonance augmentera plusieurs fois si une personne est confrontée à un examen sérieux et n'essaie pas de s'y préparer.
La dissonance peut (et se produit) dans toute situation où une personne doit faire un choix. De plus, le degré de dissonance augmentera en fonction de l’importance de ce choix pour l’individu.
Réduire la dissonance
Prévenir et éviter la dissonance
Dans certains cas, un individu peut prévenir l’apparition de dissonances et, par conséquent, d’un inconfort interne en essayant d’éviter toute information négative concernant son problème. Si une dissonance est déjà apparue, alors l'individu peut éviter de l'augmenter en ajoutant un ou plusieurs éléments cognitifs « au schéma cognitif » à la place de l'élément négatif existant (qui donne lieu à la dissonance). Ainsi, l'individu aura intérêt à rechercher des informations qui appuieraient son choix (sa décision) et, in fine, affaibliraient ou élimineraient complètement la dissonance, tout en évitant les sources qui viendraient l'augmenter. Cependant, un tel comportement d’un individu peut souvent entraîner des conséquences négatives : une personne peut développer une peur de la dissonance ou des préjugés, ce qui est un facteur dangereux qui influence sa vision du monde.
Il est tout à fait compréhensible qu'il soit beaucoup plus facile pour une personne d'être d'accord avec l'état de choses existant, en ajustant ses attitudes internes en fonction de la situation actuelle, au lieu de continuer à être tourmentée par la question de savoir si elle a fait la bonne chose. La dissonance résulte souvent de la prise de décisions importantes. Choisir entre deux alternatives tout aussi tentantes n'est pas facile pour une personne, cependant, après avoir finalement fait ce choix, une personne commence souvent à ressentir des « cognitions dissonantes », c'est-à-dire les aspects positifs de l'option qu'elle a refusée, et pas si caractéristiques positives ce avec quoi il était d'accord. Pour supprimer (affaiblir) la dissonance, une personne essaie de toutes ses forces d'exagérer l'importance de la décision qu'elle a prise, tout en minimisant l'importance de la décision rejetée. Du coup, l’autre alternative perd tout attrait à ses yeux.
Littérature
Fondation Wikimédia. 2010.
Voyez ce qu’est la « théorie de la dissonance cognitive » dans d’autres dictionnaires :
théorie de la dissonance cognitive- Étymologie. Vient du grec. recherche théorique, anglais connaissances cognitives et divergence de dissonance. Auteur. L. Festinger. Catégorie. Une théorie cognitive qui explique les caractéristiques des processus motivationnels. Spécificité. C'est logique...
- (de la connaissance cognitive anglaise, incohérence de dissonance) socialement théorie psychologique, créé par le psychologue américain L. Festinger, dans lequel des connaissances logiquement contradictoires sur un même sujet se voient attribuer le statut de motivation,... ... Dictionnaire psychologique
Théorie de la dissonance cognitive- – théorie du changement et formation des attitudes par L. Festinger. * * * théorie de la psychologie sociale (L. Festinger), expliquant le comportement illogique d'une personne dans des situations de présence d'informations contradictoires sur un objet, un sujet, une personne. Depuis... ... Dictionnaire encyclopédique en psychologie et pédagogie
THÉORIE DE LA DISSONANCE COGNITIVE- une théorie psychologique qui relie le bien-être et le comportement d'une personne à l'état du système de connaissances dont elle dispose. T.k.d. soutient que les contradictions dans les connaissances d’une personne suscitent un sentiment d’inconfort et un désir de faire tout ce qu’il faut… Glossaire des termes relatifs au conseil psychologique
Voir la théorie de la dissonance cognitive dans le dictionnaire psychologique. EUX. Kondakov. 2000... Grande encyclopédie psychologique
Théorie de la dissonance cognitive- (lat. cognitio cognition et dissonans dissonants) une des applications « théories de la correspondance ». la psychologie sociale, proposé par L. Festinger (1957), élève de K. Levin, explique l'influence du système cognitif sur la perception et le comportement humains... ... Psychologie de la communication. Dictionnaire encyclopédique
THÉORIE DE LA DISSONANCE COGNITIVE- La théorie du changement d'attitude de Leon Festinger, basée sur l'idée que nous nous efforçons d'aligner nos attitudes les unes sur les autres afin d'éliminer les dissonances cognitives. Aussi appelée théorie de la dissonance... Dictionnaire en psychologie
Théorie de la dissonance cognitive- (du latin cognitio – connaissance). Une théorie courante en psychologie sociale occidentale qui considère conflits interpersonnels comme une fatalité, une partie intégrante de l'existence sociale, l'interaction des individus et des groupes. On pense que le conflit... Dictionnaire explicatif des termes psychiatriques
Théorie de la dissonance cognitive- [lat. cognition cognition et lat. dissonans discordant sounding] un des concepts de la psychologie sociale occidentale, avancé par le psychologue américain L. Festinger (1957) et expliquant l'influence du système cognitif sur le comportement humain... ... Lexique psychologique
Annotation.
Le plus œuvre célèbre un classique de la psychologie de Leon Festinger dans une présentation moderne. Le concept de « dissonance cognitive » fait désormais partie de nos vies : ce phénomène psychologique affecte notre comportement et notre perception du monde. Les gens s'efforcent de trouver un équilibre interne entre les informations qu'ils reçoivent et les motivations personnelles de leur comportement - parfois même contraires au bon sens. Le désir de réduire la dissonance est le besoin le plus important dans la vie de toute personne - l'auteur le prouve avec les résultats de nombreuses expériences et des faits historiques étonnants.
Chapitre 1 Introduction à la théorie de la dissonance.
On constate depuis longtemps qu'une personne aspire à l'harmonie intérieure. Ses opinions et attitudes ont tendance à se regrouper en groupes caractérisés par la cohérence de leurs éléments. Bien entendu, il n’est pas difficile de trouver des exceptions à cette règle. Ainsi, une personne peut croire que les Américains noirs ne sont pas pires que leurs concitoyens blancs, mais cette même personne préférerait qu’ils ne vivent pas dans son quartier immédiat. Ou un autre exemple : quelqu'un peut croire que les enfants doivent se comporter calmement et modestement, mais il ressent également une fierté évidente lorsque son enfant bien-aimé attire énergiquement l'attention des invités adultes. Une telle incohérence, qui peut parfois prendre des formes assez dramatiques, attire notre attention principalement parce qu’elle contraste fortement avec l’idée de fond de cohérence interne. Dans la plupart des cas, les opinions et attitudes sociales interdépendantes sont cohérentes les unes avec les autres. Étude après étude, on constate une cohérence dans les attitudes politiques, sociales et autres des gens.
Téléchargez gratuitement le livre électronique dans un format pratique, regardez et lisez :
Téléchargez le livre La théorie de la dissonance cognitive, Festinger L., 2018 - fileskachat.com, téléchargement rapide et gratuit.
- Théorie des circuits électriques, Manuel pour SPO, Malinin L.I., Neiman V.Yu., 2018
- L'expérience d'une nouvelle logique, ou théorie de la pensée, avec l'annexe des lettres de Philalète à Énésidème, Maimon S., 2018
Les manuels et livres suivants.
Théorie dissonance cognitive L. Festinger affirme que positif expérience émotionnelle surgit chez une personne lorsque ses attentes sont confirmées et que ses idées cognitives prennent vie, c'est-à-dire lorsque les résultats réels de l'activité correspondent à ceux escomptés, sont cohérents avec eux ou, ce qui revient au même, sont en consonance. Les émotions négatives surgissent et s'intensifient dans les cas où entre l'attendu et le résultats valides il y a une divergence, une incohérence ou une dissonance dans l’activité.
Subjectivement, une personne éprouve généralement un état de dissonance cognitive comme un inconfort et s'efforce de s'en débarrasser le plus rapidement possible. La sortie de l'état de dissonance cognitive peut être double : soit modifier les attentes et les plans cognitifs pour qu'ils correspondent au résultat réel obtenu, soit essayer d'obtenir un nouveau résultat qui serait cohérent avec les attentes précédentes.
DANS psychologie moderne La théorie de la dissonance cognitive est souvent utilisée pour expliquer les actions et les actions d’une personne dans diverses situations sociales. Les émotions sont considérées comme le motif principal des actions et des actes correspondants. Les facteurs cognitifs sous-jacents jouent un rôle bien plus important dans la détermination du comportement humain que les changements organiques.
L'orientation cognitiviste dominante de la recherche psychologique moderne a conduit au fait que les évaluations conscientes qu'une personne donne à une situation sont également considérées comme des facteurs émotionnels. On pense que de telles évaluations influencent directement la nature de l’expérience émotionnelle.
L'œuvre la plus célèbre de la psychologie classique de Léon Festinger dans une présentation moderne. Le concept de « dissonance cognitive » fait désormais partie intégrante de nos vies : ce phénomène psychologique affecte notre comportement et notre perception du monde. Les gens s'efforcent de trouver un équilibre interne entre les informations qu'ils reçoivent et les motivations personnelles de leur comportement - parfois même contraires au bon sens. Le désir de réduire la dissonance est le besoin le plus important dans la vie de toute personne - l'auteur le prouve avec les résultats de nombreuses expériences et des faits historiques étonnants.
* * *
Le fragment d'introduction donné du livre Théorie de la dissonance cognitive (Leon Festinger, 1957) fourni par notre partenaire du livre - la société litres.
Introduction à la théorie de la dissonance
On constate depuis longtemps qu'une personne aspire à l'harmonie intérieure. Ses opinions et attitudes ont tendance à se regrouper en groupes caractérisés par la cohérence de leurs éléments. Bien entendu, il n’est pas difficile de trouver des exceptions à cette règle. Ainsi, une personne peut croire que les Américains noirs ne sont pas pires que leurs concitoyens blancs, mais cette même personne préférerait qu’ils ne vivent pas dans son quartier immédiat. Ou un autre exemple : quelqu'un peut croire que les enfants doivent se comporter calmement et modestement, mais il ressent également une fierté évidente lorsque son enfant bien-aimé attire énergiquement l'attention des invités adultes. Une telle incohérence, qui peut parfois prendre des formes assez dramatiques, attire notre attention principalement parce qu’elle contraste fortement avec l’idée de fond de cohérence interne. Dans la plupart des cas, les opinions et attitudes sociales interdépendantes sont cohérentes les unes avec les autres. Étude après étude, on constate une cohérence dans les attitudes politiques, sociales et autres des gens.
Le même type de cohérence existe entre les connaissances et les croyances d'une personne et ce qu'elle fait. Une personne convaincue que l'enseignement supérieur– c'est une bonne chose, il fera de son mieux pour encourager ses enfants à aller à l'université. Un enfant qui sait qu'il sera sévèrement puni pour une infraction essaiera de ne pas la commettre, ou du moins de ne pas s'y laisser prendre. Tout cela est si évident que nous prenons pour acquis les exemples de tels comportements. Notre attention est principalement attirée sur divers types d’exceptions à un comportement généralement cohérent. Par exemple, une personne peut être consciente que fumer est nocif pour sa santé, mais continuer à fumer ; De nombreuses personnes commettent des crimes en sachant parfaitement que la probabilité d’être arrêtées et punies est très élevée.
En tenant pour acquis la cohérence, que peut-on dire de ce type d’exceptions ? Très rarement, voire jamais, ces contradictions sont reconnues par la personne elle-même. Habituellement, il fait des tentatives plus ou moins réussies pour rationaliser d'une manière ou d'une autre un tel écart. Ainsi, une personne qui continue de fumer, sachant que cela est nocif pour sa santé, peut aussi croire, par exemple, que le plaisir qu'il procure en fumant est si grand que cela en vaut la peine ; ou que les changements dans la santé d'un fumeur ne sont pas aussi fatals qu'on le croit ; qu'il est impossible, étant une personne vivante, d'éviter toujours tous les dangers existants ; ou, enfin, que s'il arrête de fumer, il risque de prendre du poids, ce qui est également mauvais pour la santé. Ainsi, il réussit à concilier son habitude de fumer avec ses croyances concernant le tabagisme. Cependant, les gens ne parviennent pas toujours à rationaliser leur comportement ; pour une raison ou une autre, les tentatives visant à assurer la cohérence peuvent échouer. La contradiction continue simplement d’exister. Dans ce cas, un inconfort psychologique apparaît.
Nous en sommes donc venus à formuler les principales hypothèses dont ce livre est consacré aux conséquences. Mais d’abord, remplaçons le mot « contradiction » par un terme qui a moins de connotations logiques, à savoir le terme « dissonance ». De même, au lieu d’utiliser le mot « cohérence », j’utiliserai le terme plus neutre de « consonance ». Une définition formelle de ces concepts sera donnée ci-dessous, mais nous nous appuyons maintenant sur leur signification implicite, que nous avons introduite plus haut lors des discussions initiales. Je souhaite donc formuler les principales hypothèses comme suit.
1. L’existence d’une dissonance crée un inconfort psychologique et motivera une personne à essayer de réduire le degré de dissonance et d’atteindre la consonance.
2. Lorsqu'une dissonance se produit, outre le fait que l'individu s'efforcera de la réduire, il évitera également activement les situations et les informations pouvant conduire à une augmentation de la dissonance.
Avant de procéder à un développement détaillé de la théorie de la dissonance et de la volonté de la réduire, il est nécessaire de clarifier la nature de la dissonance en tant que phénomène psychologique, la nature du concept qui la décrit, ainsi que les possibilités d'application de la théorie. associés à cette notion. Les deux principales hypothèses formulées ci-dessus constituent un bon point de départ pour cela. Bien qu’elles soient liées à la dissonance, il s’agit en réalité d’hypothèses très générales. Le terme « dissonance » peut être librement remplacé par un autre concept de nature similaire, par exemple « faim », « frustration » ou « déséquilibre », et les hypothèses qui en résulteront seront tout à fait significatives.
Je suggère que la dissonance, c’est-à-dire l’existence de relations contradictoires entre les éléments individuels d’un système de connaissances, est en soi un facteur de motivation. Par le terme « connaissance », j'entendrai toute opinion ou croyance d'un individu concernant le monde qui l'entoure, lui-même, son propre comportement. La dissonance cognitive peut être comprise comme une condition initiale qui conduit à des actions visant à la réduire, de la même manière, par exemple, que la faim motive des activités visant à la satisfaire. Il s’agit d’un type de motivation complètement différent de celui auquel les psychologues sont habitués, mais néanmoins, comme nous le verrons plus tard, non moins puissant.
Quelques mots maintenant sur le contenu ultérieur de ce livre. Il est consacré à l’analyse de diverses situations liées à l’émergence d’une dissonance cognitive et aux tentatives d’une personne pour la réduire. Si un certain auteur entreprenait d’écrire un livre sur le rôle de la faim en tant que moteur du comportement humain, le résultat serait de nature similaire à celui de mon livre. Un tel ouvrage pourrait contenir des chapitres examinant les effets des tentatives visant à réduire la faim dans des contextes allant d'un nourrisson dans une chaise haute à des adultes lors d'un banquet formel. De même, ce livre décrit et étudie également une variété de situations, allant de la prise de décision individuelle au comportement. Grands groupes de personnes. Puisque le désir de réduire la dissonance est un processus humain fondamental, il n’est pas surprenant que les manifestations de ce processus puissent être observées dans un éventail aussi large.
L’émergence et la persistance de la dissonance
Quand et pourquoi la dissonance se produit-elle ? Pourquoi les gens découvrent-ils parfois qu’ils font des choses qui ne sont pas conformes à leurs pensées, ou qu’ils ont une croyance différente de toutes les autres croyances qu’ils ont ? La réponse à cette question peut être trouvée en analysant deux situations typiques dans lesquelles une dissonance peut survenir.
1. Dans une situation où une personne devient témoin oculaire de nouveaux événements ou lorsqu'elle prend connaissance de nouvelles informations, au moins une dissonance momentanée avec connaissances existantes, opinions ou idées sur leur comportement. Puisqu'une personne ne peut pas contrôler pleinement les événements qui se produisent dans le monde qui l'entoure et les informations qui lui parviennent, une telle dissonance apparaît facilement.
Ainsi, par exemple, une personne planifie un pique-nique en sachant que le temps sera chaud et ensoleillé. Cependant, juste avant son départ, il se peut qu’il commence à pleuvoir. Savoir qu'il pleut entrera en conflit avec sa certitude que la journée est ensoleillée et avec ses projets de sortir de la ville. Ou un autre exemple. Imaginez qu'une personne complètement convaincue de l'inefficacité de la transmission automatique tombe accidentellement sur un article contenant une description convaincante de ses avantages. Et encore une fois, une dissonance apparaîtra dans le système de connaissances de l’individu, au moins pendant un court instant.
2. Même en l’absence d’événements ou d’informations nouveaux et inattendus, la dissonance est sans aucun doute un phénomène quotidien. Il y a très peu de choses dans le monde qui soient complètement noires ou blanches. Il y a très peu de situations dans la vie qui sont si évidentes que les comportements ou les opinions à leur sujet ne soient pas quelque peu contradictoires. Ainsi, un agriculteur américain du Midwest peut être républicain et en même temps ne pas être d’accord avec la position de son parti sur le programme de soutien gouvernemental aux prix agricoles. Une personne qui achète une nouvelle voiture peut préférer l’efficacité d’un modèle et en même temps le design d’un autre. Un entrepreneur qui souhaite investir de manière rentable des fonds gratuits sait que le résultat de son investissement dépend de conditions économiques sur lesquelles il n'est pas en mesure d'influencer. Dans toute situation qui oblige une personne à formuler une opinion ou à faire un choix, une dissonance se crée inévitablement entre les connaissances correspondant à l'action entreprise et les connaissances et opinions associées à d'autres options d'action possibles.
Ainsi, l'éventail des situations dans lesquelles la dissonance est presque inévitable est assez large, mais notre tâche est d'examiner les circonstances dans lesquelles la dissonance, une fois apparue, persiste, c'est-à-dire de répondre à la question dans quelles conditions la dissonance cesse d'être éphémère. Si l'hypothèse énoncée ci-dessus est correcte, à côté de la dissonance, des forces visant à la réduire apparaîtront également. Pour répondre à notre question, considérons les différentes manières possibles de réduire la dissonance.
Nous aborderons cette question plus formellement plus loin dans ce chapitre, en commençant par une illustration utilisant l'exemple d'un gros fumeur confronté à des informations selon lesquelles fumer est nocif pour la santé. Peut-être en a-t-il entendu parler dans un journal ou un magazine, ou en a-t-il entendu parler par des amis ou par un médecin. Bien entendu, ces nouvelles connaissances contrediront le fait qu’il continue de fumer. Si l’hypothèse du désir de réduire la dissonance est correcte, alors quel serait le comportement de notre fumeur imaginaire dans ce cas ?
Premièrement, il peut changer les connaissances sur son comportement en changeant de comportement, c'est-à-dire en arrêtant de fumer, puis son idée deson nouveau comportement sera cohérente (être en accord) avec la connaissance que fumer est nocif. pour la santé .
Deuxièmement, il peut essayer de changer ses « connaissances » concernant les conséquences du tabagisme, ce qui semble assez étrange, mais cela reflète bien l'essence de ce qui se passe. Soit il cessera simplement de reconnaître que fumer lui est nocif, soit il essaiera de trouver des informations indiquant les avantages du tabagisme, réduisant ainsi l'importance des informations sur ses conséquences négatives. Si cet individu peut modifier son système de connaissances de l’une de ces manières, il peut réduire, voire éliminer complètement, la dissonance entre ce qu’il sait et ce qu’il fait.
Il est assez évident que le fumeur de l’exemple ci-dessus peut avoir des difficultés à changer à la fois son comportement et ses croyances. Et c’est précisément pour cette raison que la dissonance, une fois apparue, peut persister assez longtemps. Il n'y a aucune garantie qu'une personne sera capable de réduire ou d'éliminer la dissonance qui en résulte. Un fumeur hypothétique pourrait trouver que le processus d’arrêt du tabac est trop douloureux à supporter. Il peut essayer de trouver des faits spécifiques ou des opinions d'autres personnes qui soutiennent l'idée selon laquelle fumer ne cause pas beaucoup de mal, mais cette recherche peut se terminer par un échec. Ainsi, il se retrouvera dans une position où il continuera à fumer, tout en étant bien conscient que fumer est nocif. Si cela se produit, ses efforts pour réduire la dissonance ne s’arrêteront pas.
Il existe certains domaines de la cognition où l’existence de dissonances significatives est la chose la plus courante. Cela peut se produire lorsque deux ou plusieurs croyances ou valeurs pertinentes au problème en question entrent en conflit les unes avec les autres. En d’autres termes, on ne peut pas avoir une opinion ou adopter un comportement qui ne contredit pas au moins une des croyances établies. Myrdal, dans l’annexe de son livre classique, le démontre très clairement en examinant des exemples de comportement envers les Noirs américains. Myrdal écrit :
« Une personne ou un groupe dont les incohérences dans l'évaluation sont publiquement exposées ressentira le besoin de réduire cette incohérence... Le besoin d'une cohérence logique au sein de la hiérarchie des évaluations morales... dans la mesure de son intensité telle qu'elle est actuellement observée, est un problème assez complexe. phénomène nouveau. Les gens des générations précédentes, vivant dans des conditions de moindre mobilité, moins de communication intellectuelle et moins de discussions publiques sur les problèmes, étaient beaucoup moins susceptibles d'être témoins des valeurs contradictoires des uns et des autres.»
Même si je ne suis pas d’accord avec Myrdal dans son évaluation de l’importance du rôle du discours public dans la création de dissonance, je pense que c’est une très bonne indication d’un certain nombre de raisons pour lesquelles il existe une forte dissonance dans ce domaine.
Les concepts que nous avons abordés ne sont pas entièrement nouveaux ; de nombreux modèles similaires ont déjà été proposés précédemment. Il convient de mentionner deux ouvrages qui proposent des formulations les plus proches de la mienne. Haider, dans un manuscrit encore inédit, discute des relations entre les personnes et des relations entre les sens. Il écrit :
« Pour résumer notre discussion sur les états équilibrés ou harmonieux, nous pouvons dire que ces états sont caractérisés par deux ou plusieurs connexions qui se correspondent. S’il n’y a pas d’état d’équilibre, on souhaite alors l’établir. Soit il y a une tendance à modifier les sentiments affectés, soit la relation entre les éléments pertinents sera équilibrée par l'action ou la réorganisation cognitive. Si le changement n’est pas possible, alors l’état de déséquilibre provoquera des tensions ; les États équilibrés seront préférables aux États déséquilibrés » (Partie II).
Si nous remplaçons le mot « équilibré » par le mot « consonantique » et le mot « déséquilibre » par le mot « dissonance », la déclaration ci-dessus de Heider peut être considérée comme décrivant le même processus dont nous avons discuté jusqu'à présent.
Osgood et Tannenbaum ont récemment publié un article dans lequel ils ont également formulé des idées concernant les changements d'opinions et d'attitudes sociales. Considérant le « principe de congruence », comme ils l’appellent dans leurs travaux, ces auteurs écrivent : « Les changements dans l’évaluation se produisent toujours dans le sens d’une congruence croissante avec le cadre de référence existant. »
Le type particulier d'« incongruence », ou de dissonance cognitive, qu'ils analysent dans leur travail se produit lorsqu'une certaine personne ou une autre source d'information, que le sujet évalue positivement, soutient une opinion que le sujet évalue négativement (ou, à l'inverse, la source l'information est évaluée négativement, mais l'opinion exprimée par celle-ci est évaluée positivement). Les auteurs montrent en outre que dans de telles circonstances, il existe une forte tendance à modifier soit l'évaluation de l'opinion, soit l'évaluation de la source d'information dans une direction qui réduirait la dissonance. Ainsi, si la source d’information a été évaluée positivement et l’opinion négativement, l’individu peut commencer à se sentir moins bien à l’égard de la source d’information ou mieux à l’égard du sujet. À partir des données présentées dans l’article, il apparaît clairement que le résultat dans chaque cas spécifique dépend de ce qui était initialement plus fermement établi dans le système de connaissances de la personne : une évaluation de la source d’information ou une évaluation du problème. Si ses attitudes sociales envers la source d'information sont « polarisées », alors un changement d'opinion est plus probable, et vice versa. En mesurant soigneusement les attitudes sociales initiales à l'égard de la source d'information et du jugement exprimé, ainsi que le degré selon lequel chaque attitude était susceptible de changer avant que la dissonance ne se déclenche, les auteurs de l'étude ont pu prédire avec assez de précision la direction et parfois l'étendue de la dissonance. changements dans les évaluations qui pourraient survenir.
L'important ici est qu'il y ait un désir d'établir des relations de consonnes dans le système cognitif et un désir d'éviter et de réduire les dissonances. De nombreux chercheurs ont noté ce fait, même si très peu l’ont formulé de manière aussi précise et concise que Heider, Osgood et Tannenbaum. Le but de ce livre est de formuler la théorie de la dissonance sous la forme la plus précise et la plus généralement applicable possible, et de montrer les possibilités de son utilisation à des fins d'analyse. large éventail situations et présenter des preuves empiriques pour étayer cette théorie.
Définitions de concepts : dissonance et consonance
Le reste de ce chapitre se concentrera principalement sur une présentation plus formelle de la théorie de la dissonance. J'essaierai de formuler les dispositions de la théorie dans les termes les plus précis et sans ambiguïté. Mais comme les idées qui le sous-tendent ne sont pas encore complètement formées, un certain flou sera inévitable.
Les termes « dissonance » et « consonance » définissent le type de relation qui existe entre des paires d’« éléments ». Ainsi, avant de définir la nature de ces relations, il est nécessaire, dans la mesure du possible, de définir les éléments eux-mêmes.
Les éléments se rapportent à ce que nous appelons la cognition, c'est-à-dire ce qu'une personne sait d'elle-même, de son comportement et de son environnement. Ces éléments sont donc des connaissances. Certains d'entre eux concernent la connaissance de soi : ce que fait un individu donné, ce qu'il ressent, quels sont ses besoins et ses désirs, comment il est, etc. D'autres éléments de connaissance concernent le monde dans lequel il vit : qu'est-ce que où, quoi mène à quoi, ce qui apporte du plaisir à une personne et ce qui apporte de la souffrance, ce qui n'a pas d'importance et ce qui est important, etc.
Il est évident que jusqu'à présent nous avons utilisé le terme « connaissance » dans un sens très large, y compris en relation avec des phénomènes qui ne sont généralement pas inclus dans le sens de ce mot, par exemple les opinions. Une personne ne se forme une opinion que si elle croit qu’elle est vraie et, donc, sur le plan purement psychologique, une opinion n’est pas différente de la « connaissance » en tant que telle. On peut en dire autant des croyances, des valeurs ou des attitudes qui, de notre point de vue, remplissent les mêmes fonctions. Cela ne signifie en aucun cas que ces termes disparates ne traduisent pas de différences importantes. Certaines de ces différences seront décrites ci-dessous. Mais aux fins d’une définition formelle, ce sont tous des « éléments cognitifs », et des relations de consonance et de dissonance peuvent exister entre des paires de ces éléments de connaissance.
Il existe d’autres questions liées à la définition formelle auxquelles il faudrait répondre. Par exemple, dans quel cas un « élément cognitif » est-il un élément unique, et dans quel cas est-il un groupe d’éléments ? Le fait de savoir que l’hiver à Minneapolis est très froid est-il un élément, ou doit-il être considéré comme un ensemble d’éléments constitués de connaissances plus spécifiques ? Il n’y a pas encore de réponse à cette question, mais peut-être n’a-t-elle pas besoin de réponse. Comme nous le montrerons dans les chapitres suivants consacrés aux données empiriques, la présence ou l'absence de réponse à cette question n'affecte en rien la mesure.
Une autre question importante concernant les éléments cognitifs est de savoir comment ils se forment et ce qui détermine leur contenu. A ce stade, nous souhaitons souligner que le facteur le plus important déterminant le contenu des éléments cognitifs est réalité. Les éléments de connaissance sont le reflet de la réalité. En général, ils reflètent la réalité et en forment la carte. La réalité peut être physique, sociale ou psychologique, mais dans tous les cas, la cognition la reflète plus ou moins fidèlement. Bien entendu, tout cela n’a rien de surprenant. Il serait peu probable que des organismes puissent vivre et survivre si les éléments de connaissance n’étaient pas une représentation suffisamment précise de la réalité. En fait, lorsqu’une personne « s’éloigne de la réalité », cela devient très visible.
Autrement dit, les éléments de connaissance correspondent pour l’essentiel à ce qu’une personne fait ou ressent réellement et à ce qui existe réellement dans son environnement. Dans le cas des opinions, des croyances et des valeurs, la réalité peut être ce que les autres pensent ou font ; dans d'autres cas, ce qui est valable peut être ce qu'une personne rencontre dans son expérience ou ce que d'autres lui disent.
Mais à ce stade, on peut affirmer que les individus possèdent souvent des éléments cognitifs qui s’écartent sensiblement de la réalité, du moins de la façon dont nous la percevons nous-mêmes. Ainsi, une précision importante est que la réalité qui affecte l'individu exercera une pression dans le sens de rendre les éléments cognitifs conformes à cette réalité. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments cognitifs existants Toujours correspondent à la réalité. La théorie de la dissonance nous permet de comprendre les situations où les éléments cognitifs contredisent la réalité. Mais il en résulte que si les éléments cognitifs ne correspondent pas à une certaine réalité affectant l'individu, celui-ci éprouve une certaine tension. Et il faut donc pouvoir constater les manifestations de cette tension. Cette relation hypothétique entre les éléments cognitifs et la réalité est importante du point de vue de la mesure du degré de dissonance. Nous reviendrons sur cette question plus tard en discutant des données empiriques.
Nous pouvons maintenant passer à la discussion des relations qui peuvent exister entre des paires d’éléments. Il existe trois types de telles relations, à savoir : la non-pertinence, la dissonance et la consonance. C'est dans cet ordre que nous les aborderons.
Non-pertinence
Deux éléments peuvent tout simplement n’avoir rien en commun. En d’autres termes, dans de telles circonstances, lorsqu’un élément cognitif ne chevauche nulle part un autre élément, les deux éléments sont neutres ou non pertinents l’un par rapport à l’autre.
Par exemple, imaginons une personne qui sait qu'une lettre de New York à Paris, envoyée par courrier maritime régulier, peut prendre deux semaines, et qu'un mois de juillet sec et chaud est très bon pour une riche récolte de céréales dans l'Iowa. Ces deux éléments de connaissance n’ont rien de commun entre eux, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas pertinents l’un par rapport à l’autre. Bien entendu, il est difficile de dire quoi que ce soit de précis sur ces relations sans importance, sauf qu’elles existent. Notre attention se concentrera uniquement sur les paires d'éléments entre lesquels apparaissent des relations de consonance ou de dissonance.
Toutefois, dans de nombreux cas, il est très difficile de décider a priori si deux éléments ne sont pas pertinents. Souvent, cela est tout simplement impossible à déterminer sans prendre en compte le reste des connaissances de l'individu. Parfois, il peut arriver qu'en raison de certains comportements cette personne des éléments auparavant non pertinents peuvent devenir pertinents les uns par rapport aux autres. Cela pourrait se produire même dans l’exemple ci-dessus. Si une personne vivant à Paris spéculait sur la récolte des céréales aux États-Unis, elle voudrait certainement connaître les prévisions météorologiques de l'Iowa et ne recevrait probablement pas cette information par courrier maritime.
Avant de procéder à la définition et à la discussion des relations de consonance et de dissonance qui existent entre les éléments pertinents, il serait utile de souligner une fois de plus le caractère particulier des éléments cognitifs pertinents pour le comportement de l'individu. Un tel élément « comportemental », étant pertinent pour chacun de deux éléments cognitifs mutuellement neutres, peut en fait les rendre pertinents.
Relations pertinentes : dissonance et consonance
À ce stade, le lecteur a probablement déjà formé une intuition sur la dissonance. Deux éléments sont dissonants l'un par rapport à l'autre si, pour une raison ou une autre, ils ne se correspondent pas. Ils peuvent tout simplement ne pas coïncider ou se contredire, ils peuvent ne pas coïncider parce que les normes culturelles ou de groupe l'exigent, etc. Nous pouvons maintenant tenter de donner une définition plus formelle de ce concept.
Examinons deux éléments cognitifs qui existent chez les humains et qui sont pertinents l'un par rapport à l'autre. La définition de la dissonance ignore l’existence de tous les autres éléments cognitifs pertinents pour l’un ou les deux éléments analysés et ne considère que ces deux éléments isolément. Deux éléments, pris isolément de tous les autres, sont dans une relation dissonante si l'un des éléments implique un jugement opposé à l'autre. Plus formellement : X et Y sont dans une relation dissonante si non-X découle de Y. Ainsi, par exemple, si une personne sait qu'il n'y a que des amis dans son environnement, mais éprouve néanmoins de la peur, cela signifie qu'entre ces deux éléments cognitifs il y a une relation dissonante. Ou un autre exemple : si une personne endettée achète une nouvelle voiture, alors les éléments cognitifs correspondants seront dissonants les uns par rapport aux autres. La dissonance peut exister en raison d'une expérience ou d'attentes acquises, ou en raison de ce qui est considéré comme approprié ou généralement accepté, ou pour diverses autres raisons.
Les motivations et les conséquences souhaitées peuvent également être des facteurs permettant de déterminer si deux éléments sont dissonants ou non. Par exemple, une personne qui joue aux cartes pour de l'argent peut continuer à jouer et à perdre, sachant que ses partenaires sont des joueurs professionnels. Cette dernière connaissance peut être en dissonance avec la conscience de son propre comportement, à savoir qu'il continue à jouer. Mais pour dans cet exemple pour identifier ces éléments comme dissonants, il faut accepter avec un degré de probabilité raisonnable que la personne tente de gagner. Si, pour une raison étrange, cette personne veut perdre, alors cette relation sera consonantique.
Il sera utile de donner un certain nombre d'exemples où une dissonance entre deux éléments cognitifs apparaît en raison de raisons diverses, c'est-à-dire là où l'expression « découle de », incluse dans la définition de la dissonance, peut être révélée de différentes manières.
1. Une dissonance peut survenir en raison d'une incompatibilité logique. Si une personne croit que les humains atterriront sur la lune dans un avenir proche, mais croit également que les humains seront incapables de le faire vaisseau spatial, adapté à cet effet, alors ces deux connaissances sont dissonantes l'une par rapport à l'autre. La négation du contenu d'un élément découle du contenu d'un autre élément sur la base d'une logique élémentaire, et l'homme lui-même peut le comprendre au cours d'un raisonnement.
2. Une dissonance peut survenir en raison des normes culturelles. Si une personne lors d'un banquet formel ramasse une cuisse de poulet avec sa main, la connaissance de ce qu'elle fait est en dissonance avec la connaissance qui définit les règles de l'étiquette formelle lors d'un banquet formel. La dissonance survient pour la simple raison que c'est cette culture qui détermine ce qui est consonant et ce qui ne l'est pas. Dans une autre culture, ces deux éléments cognitifs pourraient ne pas être du tout dissonants.
3. Une dissonance peut survenir lorsqu’une opinion spécifique fait, par définition, partie d’une opinion plus générale. Ainsi, si une personne est démocrate mais vote pour le candidat républicain à l’élection présidentielle en cours, les éléments cognitifs correspondant à ces deux ensembles d’opinions sont dissonants les uns par rapport aux autres, car le concept « d’être démocrate » inclut par définition la nécessité de soutenir les candidats du Parti démocrate.
4. La dissonance peut résulter d’expériences passées. Si une personne est prise sous la pluie et voit en même temps qu'elle reste au sec, alors ces deux éléments de connaissance seront dissonants l'un par rapport à l'autre, puisqu'elle sait par expérience passée qu'il est impossible de rester au sec en se tenant dehors. dans la pluie. Si l’on pouvait imaginer une personne qui n’a jamais été surprise par la pluie, alors la connaissance ci-dessus ne serait pas dissonante.
Ces exemples suffisent à illustrer comment la définition du concept de dissonance peut être utilisée empiriquement pour décider si deux éléments cognitifs sont dissonants ou consonants. Bien entendu, il est clair que dans chacune de ces situations, il peut y avoir d’autres éléments de connaissance qui peuvent être en relation consonantique avec l’un ou l’autre des deux éléments de la paire en question. Or, une relation entre deux éléments est dissonante si, quels que soient les autres éléments, l'un des éléments du couple ne suit pas (ou n'est pas censé suivre) de l'autre.
La définition des relations de consonance et de non-pertinence découle de la définition des relations de dissonance. Si dans une paire d'éléments l'un d'eux découle de la signification de l'autre élément, alors la relation entre eux est consonantique. Si ni la négation ni la confirmation de la signification du deuxième élément d’une paire ne découlent du premier élément, alors la relation entre eux n’a pas d’importance.
Les définitions des concepts de dissonance et de consonance ne fournissent cependant pas une base suffisante pour la mesure. Si l’on cherche à tester empiriquement la théorie de la dissonance, il faut avant tout s’assurer que les phénomènes de dissonance et de consonance soient identifiés avec précision. Essayer d'obtenir liste complète de tous les éléments cognitifs est une entreprise désespérée, et même si une telle liste était disponible, dans certains cas, il serait difficile, voire impossible, de déterminer a priori lequel des trois types possibles de connexions se produit dans un cas donné. Cependant, dans de nombreux cas, la définition a priori de la dissonance est claire et précise. (Rappelons également que deux éléments cognitifs peuvent être dissonants pour une personne vivant dans une culture mais pas dans une autre, et en fonction de son expérience passée.) Nous reviendrons sur le problème de la mesure plus en détail dans les chapitres traitant des données empiriques.
Ampleur de la dissonance
Bien entendu, toutes les relations dissonantes ont des intensités différentes. Il est nécessaire de distinguer les degrés de dissonance qui surviennent et de décrire les facteurs qui déterminent la force de l'attitude dissonante. Nous discutons d’abord brièvement de certains déterminants possibles du degré de dissonance qui se produit entre deux éléments, puis nous examinons intensité totale dissonance qui peut exister entre deux systèmes d’éléments.
Un facteur évident qui détermine l’ampleur de la dissonance est lié aux caractéristiques des éléments entre lesquels apparaît la relation dissonante. Si deux éléments cognitifs sont dissonants l’un par rapport à l’autre, alors le degré de dissonance sera directement proportionnel à l’importance de ces éléments. Plus les éléments sont significatifs pour un individu, plus ils ont de valeur pour lui, plus grand sera le degré de relation dissonante entre eux. Ainsi, par exemple, si une personne donne dix centimes à un mendiant, même si elle voit que le mendiant n'a probablement pas vraiment besoin de cet argent, la dissonance qui apparaît entre les deux éléments est assez faible. Aucun de ces deux éléments cognitifs n’est suffisamment important pour un individu donné et n’est associé à des conséquences importantes. Une dissonance bien plus grande se produit, par exemple, si l'élève ne se prépare pas à examen important, même s'il sait que le niveau de ses connaissances est sans doute insuffisant pour réussir. Dans ce cas, les éléments dissonants les uns par rapport aux autres sont beaucoup plus importants pour la personne et, par conséquent, l'ampleur de la dissonance sera beaucoup plus grande.
On peut supposer avec un degré de confiance raisonnable que dans la vie, il est très rare de trouver un système d'éléments cognitifs dans lequel la dissonance est complètement absente. Pour presque toutes les actions qu’une personne pourrait entreprendre ou tout sentiment qu’elle pourrait éprouver, il y aura probablement au moins un élément cognitif qui entretient une relation dissonante avec cet élément « comportemental ». Même pour des informations tout à fait triviales, comme par exemple que quelqu'un va se promener un dimanche après-midi, il est très probable qu'il y ait des éléments dissonants. Une personne qui se promène peut être consciente qu'il y a des tâches qui l'attendent à la maison, qu'il va pleuvoir, etc. En bref, il existe tellement d’autres éléments cognitifs pertinents pour un élément donné que la présence d’un certain degré de dissonance est assez courante.
Considérons maintenant dans son intégralité l'ensemble du contexte des relations dissonantes et consonantiques dans lequel entre un élément cognitif distinct. En supposant pour l’instant, du point de vue opérationnel, que tous les éléments pertinents pour l’élément cognitif en question sont d’égale importance, on peut dire que le montant total de dissonance entre un élément donné et le système de connaissances de l'individu dans son ensemble dépendra directement de la proportion de ces éléments pertinents qui sont dissonants par rapport à l'élément en question. Ainsi, si la grande majorité des éléments pertinents sont en accord avec, par exemple, un élément comportemental du système cognitif, alors le degré de dissonance avec cet élément comportemental sera faible.
Si la proportion d'éléments consonants par rapport à l'élément comportemental considéré est bien inférieure à la proportion d'éléments dissonants, alors le degré de dissonance sera beaucoup plus élevé. Bien entendu, l’ampleur globale de la dissonance dépendra également de la signification ou de la valeur des éléments pertinents qui ont une relation consonantique ou dissonante avec l’élément en question.
La règle ci-dessus peut être facilement généralisée et utilisée pour évaluer le degré de dissonance pouvant exister entre deux groupes d’éléments cognitifs. Cette valeur dépend de la nature du type de relation dominant (dissonante ou consonne) et, bien entendu, de la signification d'éléments spécifiques.
L’ampleur de la dissonance qui se produit est une variable très importante pour déterminer l’intensité du désir de réduire la dissonance. Puisque nous traiterons à plusieurs reprises de la détermination du degré de dissonance lorsque nous examinerons des données empiriques, il sera utile de résumer notre analyse concernant la détermination de l’ampleur de la dissonance. Donc:
1. Si deux éléments cognitifs sont pertinents l'un par rapport à l'autre, alors la nature de la relation entre eux est soit dissonante, soit consonante.
2. L'ampleur de la dissonance (ou de la consonance) augmente à mesure que l'importance et la valeur des éléments impliqués dans cette relation augmentent.
3. Le montant total de dissonance existant entre deux groupes d'éléments cognitifs dépend directement de la proportion pondérée de relations dissonantes parmi les relations pertinentes entre les éléments des deux groupes. Le terme « proportion pondérée » est utilisé ici car chaque relation pertinente serait évaluée en fonction de l'importance des éléments qui la composent.
Réduire la dissonance
L'existence d'une dissonance fait naître le désir de réduire ou d'éliminer complètement la dissonance. L'intensité de ce désir dépend de l'ampleur de la dissonance. En d’autres termes, la dissonance opère exactement de la même manière que le motif, le besoin ou la tension. La présence d'une dissonance entraîne des actions visant à la réduire, tout comme, par exemple, une sensation de faim entraîne des actions visant à l'éliminer.
De plus, par analogie avec le motif, plus l'ampleur de la dissonance est grande, plus grande sera l'intensité de l'action visant à réduire la dissonance, et plus forte sera la tendance à éviter toute situation susceptible d'augmenter le degré de dissonance.
Pour étoffer notre raisonnement sur la manière dont le désir de réduire la dissonance peut se manifester, il est nécessaire d’analyser les manières possibles par lesquelles la dissonance qui en résulte peut être réduite ou éliminée. En général, si une dissonance se produit entre deux éléments, cette dissonance peut être éliminée en modifiant l'un de ces éléments. Ce qui compte, c'est la manière dont ces changements peuvent être effectués. Il existe de nombreuses voies possibles, selon le type d'éléments cognitifs impliqués et le contexte global de connaissances dont dispose la personne dans la situation en question.
Modification des éléments cognitifs comportementaux
Lorsqu'une dissonance apparaît entre un élément cognitif lié à la connaissance de l'environnement et un élément cognitif comportemental, la dissonance peut bien entendu être éliminée en modifiant l'élément comportemental afin qu'il devienne en accord avec l'élément environnemental. Le moyen le plus simple et le plus facile d’y parvenir est de modifier l’action ou le sentiment auquel se rapporte l’élément comportemental. Puisque, comme nous l’avons vu, la connaissance est le reflet de la réalité, si le comportement d’un organisme change, alors les éléments cognitifs correspondants changeront de la même manière. Cette méthode de réduction ou d'élimination de la dissonance est très courante. Notre comportement et nos sentiments changent souvent en réponse aux nouvelles informations que nous recevons. Si une personne sortait de la ville pour un pique-nique et remarquait qu'il commençait à pleuvoir, elle pouvait simplement rentrer chez elle. De nombreuses personnes ont complètement abandonné le tabac après avoir découvert que celui-ci était très nocif pour la santé.
Cependant, il n'est pas toujours possible d'éliminer la dissonance ni même de la réduire de manière significative en modifiant l'action ou le sentiment correspondant. Changer un comportement peut être trop difficile, ou le changement lui-même, en éliminant une dissonance, peut à son tour en créer toute une série de nouvelles. Ces questions seront abordées plus en détail ci-dessous.
Changer les éléments cognitifs reflétant l’environnement
Tout comme il est possible de modifier des éléments cognitifs comportementaux en modifiant le comportement qu’ils reflètent, il est parfois possible de modifier éléments cognitifs reflétant l’environnement, en changeant la situation qui leur correspond. Bien entendu, ce processus est plus difficile que le changement de comportement, pour la simple raison qu’il nécessite un degré suffisant de contrôle sur l’environnement, ce qui est assez rare.
Changer l'environnement pour réduire la dissonance est beaucoup plus facile lorsque la dissonance est associée à l'environnement social que lorsqu'elle est associée à l'environnement physique. Pour illustrer cette différence, permettez-moi de vous donner un exemple humoristique. Imaginez une personne qui a l'habitude de faire les cent pas dans le salon de sa maison. Pour une raison inconnue, il enjambe toujours une certaine zone du sol. L’élément cognitif correspondant à cette habitude est sans doute en dissonance avec sa connaissance que cette zone du sol est aussi lisse et résistante que les autres zones, et n’est en rien différente du reste du sol. Si un soir, alors que sa femme n'est pas à la maison, il fait un trou dans cette partie du sol, il éliminera complètement la dissonance. Savoir qu'il y a un trou dans le sol sera en excellente consonance avec le fait qu'il enjambe constamment l'endroit où il se trouve. En bref, cela modifiera l'élément cognitif en modifiant efficacement l'environnement pour éliminer la dissonance.
Chaque fois qu'une personne a un contrôle suffisant sur l'environnement, elle peut utiliser cette méthode pour réduire la dissonance. Par exemple, si un individu est habituellement hostile envers les autres, il peut s’entourer de personnes qui provoquent l’hostilité. Ses attitudes envers les personnes avec lesquelles il est en contact seront ainsi des éléments cognitifs consonants traduisant son comportement hostile. Cependant, la capacité de manipuler l’environnement est assez limitée, c’est pourquoi d’autres méthodes permettant de réduire la dissonance sont beaucoup plus courantes.
Si un élément cognitif change, mais qu'une certaine réalité qu'il reflète dans l'esprit de l'individu reste inchangée, alors certains moyens doivent être utilisés pour ignorer la situation réelle ou la contrecarrer. Parfois, cela est pratiquement impossible, sauf dans les cas extrêmes où nous parlons de sur la psychose. Si une personne est prise sous la pluie et est mouillée de la tête aux pieds, elle sera presque certainement consciente qu'il pleut à verse, quelle que soit sa tendance à ignorer ce fait. Dans d’autres cas, il est relativement facile de modifier un élément cognitif sans rien changer réellement. Par exemple, une personne peut changer d'opinion sur une certaine personnalité politique, même si le comportement de cette personnalité situation politique restent globalement inchangés. Habituellement, pour cela, il suffit à une personne de trouver des personnes qui sont d'accord avec elle et qui soutiendront sa nouvelle opinion. En général, façonner la réalité sociale en obtenant l’approbation et le soutien d’autres personnes est l’un des principaux moyens de modifier les connaissances lorsque le besoin s’en fait sentir. Il est facile de remarquer que dans les cas où un tel soutien social est nécessaire, la présence de dissonance et, par conséquent, la tension qui en résulte et le désir de changer l'élément cognitif conduisent à divers processus sociaux. Ceci sera discuté en détail dans les chapitres 8 à 10, qui examinent les manifestations du désir de réduire la dissonance dans les grands et petits groupes sociaux.
Ajouter de nouveaux éléments cognitifs
Ainsi, nous avons établi que pour éliminer complètement la dissonance, il est nécessaire de modifier certains éléments cognitifs. Il est clair que cela n'est pas toujours possible. Mais même si la dissonance ne peut pas être complètement éliminée, elle peut toujours être réduite en ajoutant de nouveaux éléments cognitifs au système de connaissances de l’individu.
Par exemple, s’il existe une dissonance entre des éléments cognitifs concernant les méfaits du tabagisme et le fait qu’une personne continue de fumer, alors la dissonance globale peut être réduite en ajoutant de nouveaux éléments cognitifs cohérents avec le fait de fumer. En présence d’une telle dissonance, on peut s’attendre à ce qu’une personne recherche activement de nouvelles informations susceptibles de réduire la dissonance globale. Dans le même temps, il évitera les informations susceptibles d’augmenter la dissonance existante. Ainsi, pour poursuivre notre exemple, un fumeur peut rechercher et lire avec voracité tout document contestant les résultats d’études démontrant les méfaits du tabac. Dans le même temps, il évitera les documents qui étayent les conclusions de ces études. S'il n'est toujours pas possible d'éviter la confrontation avec des informations sur les dangers du tabagisme, il sera sceptique lors de la lecture.
Les possibilités d'ajouter de nouveaux éléments au système de connaissances réduisant les dissonances existantes sont très grandes. Notre fumeur, par exemple, peut se référer aux statistiques sur les accidents de voiture. Ayant conclu que les méfaits du tabagisme ne peuvent être comparés au danger auquel il s'expose en conduisant, l'individu réduit quelque peu la dissonance en réduisant importanceéléments cognitifs qui entrent en conflit.
Le raisonnement ci-dessus indique la possibilité de réduire la dissonance en modifiant la proportion de relations dissonantes et consonantiques de l'élément cognitif. Un autre manière possible consiste à ajouter un nouvel élément cognitif au système de connaissances, qui en un certain sens « réconcilie » deux éléments qui sont dans une relation dissonante l’un avec l’autre. Pour illustrer cela, voici un exemple tiré d’une étude. Spiro dans son article décrit certains aspects du système de croyance des Ifaluk, une société analphabète. Pour nos besoins, les caractéristiques suivantes de ce système sont importantes :
1. Les Ifaluk croient fermement que tout le monde est bon. Autrement dit, non seulement tous les gens devraient être gentils, mais ils le sont en réalité.
2. En grandissant, les enfants de cette tribu traversent une période où, pour une raison ou une autre, leur comportement se caractérise par des manifestations d'agression ouverte, d'hostilité et de désir de destruction.
De toute évidence, la croyance selon laquelle tout le monde est bon contraste fortement avec le comportement des enfants dans cette culture. Il existe de nombreuses façons de réduire cette dissonance. L’une d’elles consiste à changer votre croyance en l’essence de la nature humaine ou à la transformer de telle manière qu’elle ne s’applique qu’aux adultes. Une autre voie possible consiste à modifier le contenu de l’idée de gentillesse afin que les manifestations d’agressivité chez les adolescents puissent être considérées comme bonnes. Cependant, la méthode Ifaluk pour réduire la dissonance était différente. Un élément a été inclus dans le système de croyance qui a réduit le degré de dissonance en conciliant la croyance ci-dessus en la bonté humaine et les preuves d'hostilité chez les enfants. À savoir, en plus de la croyance en la bonne nature de l'homme : les Ifaluks étaient convaincus de l'existence de mauvais esprits qui habitent les gens et les obligent à faire de mauvaises choses.
Grâce à l'inclusion de cet élément dans le système de croyances, les connaissances concernant comportement agressif les enfants n’étaient plus en conflit avec la conviction que tout le monde est bon. Ce ne sont pas les enfants qui se comportent de manière agressive, mais les mauvais esprits qui les possèdent. D'un point de vue psychologique, c'est un moyen très efficace de réduire la dissonance, puisqu'elle est associée à un changement du système de croyance, à une institutionnalisation au niveau culturel. Moins moyens efficaces ils ne se seraient tout simplement pas répandus aussi largement et ne seraient pas devenus généralement acceptés.
Avant de poursuivre, je tiens à souligner à nouveau qu'avoir le désir de réduire la dissonance, ou même prendre des mesures pour réduire la dissonance, ne garantit pas que la dissonance diminuera. La personne peut être incapable de trouver le soutien social nécessaire pour modifier un élément cognitif ou ne pas être en mesure de trouver de nouveaux éléments réduisant le degré de dissonance. Il est également fort possible que le désir de réduire la dissonance finisse par conduire à son augmentation. Cela dépend de ce à quoi la personne est confrontée au moment où elle essaie de réduire la dissonance. Il est important ici qu'en présence de dissonance, tentatives Réduisez-le. Si ces tentatives échouent, des symptômes d’inconfort psychologique commencent à apparaître. Et plus la dissonance est tangible et significative, plus ce malaise se manifeste clairement et ouvertement.
Résistance à la réduction de la dissonance
Puisque la dissonance peut être réduite ou éliminée entièrement en modifiant un ou plusieurs éléments cognitifs, il est nécessaire de considérer la résistance de ces éléments au changement. Le fait qu’un élément change ou non, et si oui, lequel, dépend bien entendu en partie du degré de résistance inhérent aux éléments. Bien sûr, si aucun élément cognitif du système de connaissances d’un individu n’offrait de résistance au changement, il n’y aurait aucune raison pour qu’une dissonance durable surgisse. Une dissonance à court terme peut survenir, mais si les éléments cognitifs d’un système donné ne résistent pas au changement, alors la dissonance sera immédiatement éliminée. Examinons les principales sources de résistance à la réduction des dissonances. Ils différeront pour deux classes d'éléments cognitifs : ceux reflétant le comportement du sujet ou l'environnement.
Résistance au changement des éléments cognitifs comportementaux
La première et la plus importante source de résistance au changement n'importe lequel L'élément cognitif est son lien avec la réalité. Si une personne voit que l’herbe est verte, il lui est très difficile de penser que ce n’est pas le cas. Si une personne marche dans la rue, il lui sera difficile de ne pas s’en apercevoir. Si l'on prend en compte ce lien fort, parfois écrasant, avec la réalité, alors le problème du changement d'un élément cognitif comportemental devient un problème de changement du comportement qui est associé à cet élément. Par conséquent, la résistance au changement d’un élément cognitif est identique à la résistance au changement de comportement, qui se reflète dans cet élément, à moins, bien sûr, que la personne ait perdu contact avec la réalité.
Bien entendu, de nombreux comportements ne résistent que peu ou pas du tout au changement. Nous modifions continuellement bon nombre de nos actions et de nos sentiments en réponse à des situations changeantes. Si la rue que nous empruntons habituellement pour aller au travail est fermée pour réparation, il n'est généralement pas difficile de changer de comportement et de faire un détour pour se rendre au travail. Quelles sont alors les circonstances qui font qu’il est difficile pour un individu de modifier ses actions ?
1. De tels changements peuvent être douloureux ou impliquer une sorte de perte. Par exemple, une personne a dépensé une grosse somme d’argent pour acheter une maison. S'il veut maintenant changer quelque chose, par exemple s'il n'aime pas la maison ou les voisins, il doit alors se préparer aux désagréments liés au déménagement et aux éventuelles pertes financières si la maison est vendue. Une personne qui souhaiterait arrêter de fumer devra endurer l’inconfort et la douleur associés à l’arrêt de la nicotine. Il est clair que dans de telles circonstances, il y aura une certaine résistance au changement. L’ampleur de cette résistance dépendra de l’ampleur de l’inconfort et de la perte futurs qui devront être endurés.
2. Un comportement devenu inacceptable pour un individu d'un point de vue peut rester tout à fait satisfaisant d'un autre. Une personne peut continuer à aller déjeuner au même restaurant tous les jours, même si la nourriture y est devenue mauvaise, si ses amis y mangent toujours. Ou, par exemple, une personne dominatrice et dure envers ses enfants aura du mal à refuser l'opportunité de commander, même si pour une raison ou une autre elle souhaiterait changer de comportement. Dans de tels cas, le degré de résistance au changement dépendra directement du degré de satisfaction reçu de la forme de comportement existante.
3. Il se peut qu’il soit tout simplement impossible d’apporter des changements. Ce serait une erreur de croire qu’une personne peut modifier son comportement si elle le souhaite vraiment. Les modifications peuvent ne pas être possibles pour plusieurs raisons. Certains comportements, notamment les réactions émotionnelles, échappent au contrôle volontaire. Par exemple, une personne peut éprouver une réaction de peur intense à laquelle elle est incapable de faire face. Il peut également être difficile de mettre en œuvre un changement de comportement simplement parce que cela est nouvelle forme ne fait pas partie du répertoire comportemental de la personne. Un père peut ne pas être en mesure de changer son comportement envers ses enfants simplement parce qu’il ne connaît pas d’autre façon de se comporter. La troisième circonstance qui rend le changement impossible est le caractère irréversible de certaines actions. Si, par exemple, une personne a vendu sa maison, mais a ensuite décidé de la restituer et que le nouveau propriétaire refuse de vendre la maison, alors rien ne peut être fait. L’action est terminée et est irréversible. Mais dans une situation où le changement de comportement est impossible, on ne peut pas dire que la résistance au changement de l'élément cognitif correspondant soit infiniment grande. La résistance au changement que possède l’élément cognitif ne peut évidemment pas être plus grande que l’influence de la réalité.
Résistance au changement des éléments cognitifs reflétant l’environnement
Ici, comme dans le cas des éléments cognitifs comportementaux, la principale source de résistance au changement réside dans le lien de ces éléments avec la réalité. Dans le cas des éléments cognitifs comportementaux, la résistance à leur modification est associée à la résistance à changer la réalité correspondante, c'est-à-dire le comportement. Lorsque nous traitons d'éléments liés à environnement, la situation est quelque peu différente. Lorsqu'il existe une réalité claire et définie correspondant à un certain élément cognitif, les possibilités de la modifier sont pratiquement nulles. Si, par exemple, une certaine personne souhaitait modifier ses connaissances concernant l'emplacement d'un certain bâtiment qu'elle voit quotidiennement, elle ne pourrait guère le faire.
Cependant, la réalité liée à l’un ou l’autre élément cognitif n’est dans de nombreux cas pas aussi claire et sans ambiguïté. Lorsqu'un individu est confronté à une réalité sociale, c'est-à-dire basée sur des accords avec d'autres personnes, la résistance au changement dépendra de la difficulté qu'il aura à trouver d'autres personnes qui soutiennent sa nouvelle opinion.
Il existe une autre source de résistance au changement dans les éléments cognitifs, tant comportementaux qu’environnementaux. Cependant, nous avons jusqu’à présent reporté sa discussion, car elle génère largement une résistance au changement dans les éléments cognitifs environnementaux. Cette source est que l’élément à remplacer est étroitement lié à de nombreux autres éléments. Dans la mesure où cet élément est en accord avec de nombreux autres éléments, et dans la mesure où son remplacement remplacerait les consonances par des dissonances, l'élément en question résistera au changement.
Les discussions ci-dessus ne peuvent en aucun cas être considérées comme une analyse exhaustive des raisons de la résistance au changement. Il s’agit d’une analyse destinée à faciliter l’opérationnalisation plutôt que la conceptualisation. Quel que soit le type de dissonance auquel nous sommes confrontés, le facteur le plus important lorsqu’on tente de l’éliminer en modifiant les éléments cognitifs affectés par elle est la résistance au changement qui en résulte, mais la source de cette résistance importe peu.
Limites à l'augmentation de la dissonance
La dissonance maximale pouvant exister entre deux éléments quelconques est déterminée par le degré de résistance au changement de l’élément le moins résistant. Une fois que le degré de dissonance atteint sa valeur maximale, l’élément cognitif le moins persistant va changer, éliminant ainsi la dissonance.
Cela ne signifie pas que le degré de dissonance se rapprochera souvent de cette valeur maximale possible. Lorsqu’une forte dissonance apparaît, dont l’ampleur reste néanmoins inférieure à l’ampleur de la résistance au changement des éléments impliqués, la réduction de cette dissonance dans le système de connaissances dans son ensemble peut très bien être obtenue par l’ajout de nouveaux éléments cognitifs. Ainsi, même s’il existe une très forte résistance au changement, la dissonance globale du système peut rester à un niveau assez faible.
Prenons, à titre d'exemple, une personne qui a dépensé une somme d'argent importante pour acheter une nouvelle voiture coûteuse. Imaginons qu'après avoir effectué cet achat, il découvre qu'il y a un problème avec la voiture et que sa réparation coûtera très cher. De plus, il s'avère que ce modèle est beaucoup plus cher à exploiter que les autres voitures, et en plus de cela, ses amis prétendent que cette voiture est tout simplement moche. Si le degré de dissonance devient suffisamment grand, c'est-à-dire corrélé au degré de résistance au changement de l'élément le moins résistant (qui dans cette situation est le plus susceptible d'être un élément comportemental), alors cette personne peut finalement vendre la voiture, malgré tous les désagréments et pertes financières qui en découlent. Ainsi, la dissonance ne dépasserait pas le degré de résistance qui apparaît lorsqu’il est nécessaire de changer de comportement, c’est-à-dire de prendre la décision de vendre la voiture.
Considérons maintenant une situation dans laquelle le degré de dissonance pour une personne qui a acheté une nouvelle voiture serait assez important, mais toujours inférieur à la dissonance maximale possible (c'est-à-dire inférieur au degré de résistance au changement caractéristique de la voiture la moins résistante au changement). élément cognitif). Aucun des éléments cognitifs existants ne changerait donc, mais la personne pourrait maintenir le degré de dissonance globale assez bas en ajoutant de nouvelles connaissances en accord avec le fait de posséder une nouvelle voiture. Il pourrait conclure que la puissance et les performances d’une voiture sont plus importantes que son économie et son design. Il commencerait à conduire plus vite que d'habitude et deviendrait complètement convaincu que la capacité d'atteindre des vitesses élevées est caractéristique importante voiture. Grâce à cela et à d’autres connaissances similaires, cet individu pourrait bien réussir à maintenir la dissonance à un faible niveau.
Il est fort possible qu'il y ait une situation où des tentatives d'ajout système existant connaissances, les nouveaux éléments cognitifs des consonnes échoueront et en même temps, la situation financière du héros de notre exemple évoluera de telle manière qu'il ne pourra pas vendre la voiture. Il est cependant encore possible de réduire le degré de dissonance en ajoutant de nouveaux éléments cognitifs, mais ces éléments seront d’une nature différente. Une personne peut admettre à elle-même et aux autres qu'acheter cette voiture était une erreur et que si elle devait acheter à nouveau une voiture, elle choisirait un modèle différent. Ce processus de séparation psychologique de l’action engagée peut réduire considérablement la dissonance. Toutefois, la résistance à de tels changements peut parfois être très forte. Le degré maximum de dissonance pouvant survenir dans de telles circonstances dépendra de la difficulté pour une personne donnée d'accepter que l'acte qu'elle a commis était irréfléchi ou stupide.
Éviter la dissonance
Jusqu'à présent, notre discussion a été consacrée à l'examen des problèmes associés à la tendance à réduire ou à éliminer la dissonance. Dans certaines circonstances, il existe également une volonté explicite d’éviter d’augmenter la dissonance ou d’empêcher son apparition. Analysons de telles situations et les manifestations possibles d'une tendance à éviter les dissonances croissantes.
Cette tendance apparaît comme une conséquence naturelle de l’émergence de la dissonance. C'est particulièrement important si, pour réduire la dissonance, il est nécessaire de trouver un moyen de remplacer un élément cognitif existant par un autre ou d'inclure un nouvel élément cognitif dans le système. Dans tous ces cas, la recherche d’un soutien social ou de nouvelles informations doit être extrêmement sélective. Une personne engagera facilement une conversation avec quelqu'un qui, selon elle, approuvera le contenu d'un nouvel élément cognitif, et évitera probablement de discuter du sujet avec ceux qui soutiennent l'élément qu'elle essaie de changer. La personne sera ouverte aux sources d’informations qui ajouteraient des éléments de consonnes et évitera les sources d’informations qui augmentent la dissonance.
S’il y a peu ou pas de dissonance, nous ne sommes pas susceptibles de rencontrer ce type de sélectivité dans la recherche et la perception de l’information. En l’absence de dissonance, il n’y aura aucune motivation pour rechercher des sources de soutien ou Informations Complémentaires. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Les expériences passées peuvent provoquer de la peur chez un individu et, par conséquent, susciter un désir d'éviter les situations conduisant à une dissonance. Dans ce cas, on peut s’attendre à un comportement prudent de la part de l’individu.
La peur de la dissonance peut conduire à une réticence à agir. Nous prenons de nombreuses mesures et faisons beaucoup de choses qui sont très difficiles à changer. Par conséquent, il est très probable que la dissonance, une fois apparue, non seulement ne diminuera pas, mais au contraire augmentera. Éviter l’apparition d’une dissonance peut conduire à une réticence à prendre des mesures et, en fin de compte, à un refus d’accepter la responsabilité des actions entreprises. Lorsque l’inaction ou le refus de prendre une décision particulière est impossible, l’action peut s’accompagner d’un déni cognitif. Ainsi, par exemple, une personne qui a acheté une nouvelle voiture et qui a peur de la dissonance peut immédiatement après avoir effectué l'achat déclarer qu'elle s'est rendu compte que son action était mauvaise. Cette peur de la dissonance est relativement rare, mais elle est possible. Les différences individuelles dans la peur de la dissonance et la capacité à résoudre efficacement la dissonance sont importantes pour déterminer la probabilité de s'engager dans ce comportement d'évitement de la dissonance. Le problème purement méthodologique est de pouvoir caractériser séparément la situation et la personnalité de la personne dans les cas où un tel comportement protecteur a priori sera utilisé.
Conclusion
L'essence fondamentale de la théorie de la dissonance que nous avons décrite est assez simple et forme abrégée est comme suit:
1. Les éléments cognitifs peuvent entretenir une relation de dissonance ou d’incohérence les uns avec les autres.
2. L'existence d'une dissonance provoque le désir de la réduire et d'essayer d'éviter son augmentation ultérieure.
3. Les manifestations d'un tel désir consistent en un changement de comportement, un changement dans les connaissances existantes et une recherche biaisée de nouvelles informations et de nouvelles opinions concernant le jugement ou l'objet qui a généré la dissonance.
Bien que sens général La théorie de la dissonance est assez simple, cependant, de nombreuses conséquences en découlent et elle peut être utilisée pour analyser un grand nombre de situations qui, à première vue, n'ont rien de commun entre elles. Les chapitres suivants du livre seront consacrés à une analyse détaillée de ces implications spécifiques de la théorie de la dissonance et à une description des preuves empiriques correspondantes.