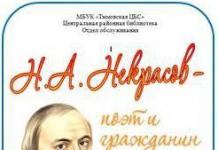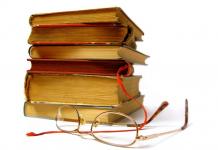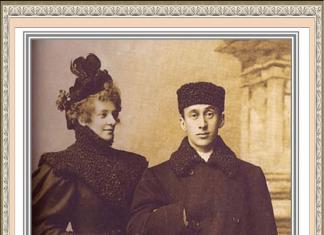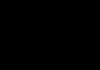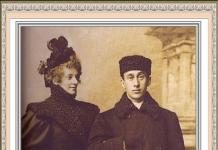Yesenin et la révolution
L.P. Egorova, P.K. Tchekalov« Il n'y a pas de problème « Yesenin et la Révolution » en tant que tel », écrit l'auteur de la section Yesenin dans l'ouvrage de référence pour étudiants N. Zuev. Selon sa conception, Yesenin n'était ni un révolutionnaire ni un chanteur de la révolution. C’est juste que lorsque le monde se divise, la fissure traverse le cœur du poète. « Les tentatives de foi naïve et les déceptions inévitables sont déclarées le sujet d'une conversation spéciale, qui ne doit pas éclipser « les fondements moraux de la personnalité du poète, la recherche de Dieu et de lui-même dans le monde, qui se reflétaient directement dans son œuvre » (8 ; 106). Sans diminuer l'importance du dernier sujet et renvoyer le lecteur aux travaux de N. Zuev, qui a révélé les origines religieuses et folkloriques de l'imagerie de Yesenin (d'ailleurs, ces dernières sont couvertes dans un certain nombre de monographies et d'articles). - 39; 4; 12), nous considérons toujours qu'il est nécessaire de souligner l'attitude de Yesenin envers la révolution, d'autant plus que cela est obligatoire non seulement pour les déclarations de l'auteur lui-même, mais aussi pour les images poétiques, l'intérêt du poète pour la personnalité de Lénine.
Selon les mémoires des contemporains, « Yesenin a accepté octobre avec un plaisir indescriptible ; et l'a accepté, bien sûr, uniquement parce qu'il y était déjà intérieurement préparé, que tout son tempérament inhumain était en harmonie avec octobre » (30 ; 1, 267) .
Essenine lui-même a écrit succinctement dans son autobiographie : « Durant les années de la révolution, il était entièrement du côté d'Octobre, mais il acceptait tout à sa manière, avec un parti pris paysan. » La dernière clause n’est pas fortuite et elle se fera sentir plus tard. Mais la première période de la révolution, qui donna la terre aux paysans, fut effectivement accueillie avec sympathie par le poète. Déjà en juin 1918, « La Colombe jordanienne » était écrite avec les lignes célèbres :
Le ciel est comme une cloche
Le mois est une langue
Ma mère est ma patrie,
Je suis bolchevik.
Fin 1918 - début 1919. "Heavenly Drummer" a été créé :
Les feuilles des étoiles tombent
Dans les rivières de nos champs.
Vive la révolution
Sur terre et au ciel !...
En février 1919, Yesenin admet également qu’il est bolchevik et qu’il est « heureux de maîtriser le pays ».
Dans le poème inachevé « Promenade dans les champs » (il est symptomatique qu’il soit resté inachevé), Yesenin réfléchit sur le pouvoir mystérieux de l’influence des idées de Lénine sur les masses (« Il est comme un sphinx devant moi »). Le poète est préoccupé par la question, qui n'est pas oiseuse pour lui, « avec quelle force il a pu secouer le globe ».
Mais il a choqué.
Faites du bruit et voilez-vous !
Tournez plus fort, mauvais temps,
Lavez-le aux malheureux
La honte des forts et des églises.
Comme on dit, on ne peut pas effacer les paroles d’une chanson.
L’arrivée de Yesenin chez les bolcheviks a été perçue comme une étape « idéologique », et le poème « Inonia » a été considéré comme une indication claire de la sincérité de ses passions impies et révolutionnaires. A.M. Mikeshin a souligné que le poète voyait dans la révolution un « ange du salut » apparu au monde de la vie paysanne « sur son lit de mort », périssant sous les assauts du bourgeois Moloch (22 : 42).
Comme déjà noté dans la critique, les poèmes de Yesenin « Inonia », « Transfiguration », « Colombe de Jourdain », « Batteur céleste », « Pantocrator » « ont éclaté dans une rafale poétique de rébellion « ontologique », poussée par l'audace d'un remake radical. de l’ensemble de l’ordre mondial existant dans un système différent, jusqu’à la « ville d’Inonia, où vit la divinité des vivants ». Ici, nous rencontrerons de nombreux motifs cosmiques qui nous sont déjà familiers. poésie prolétarienne, jusqu'à la Terre contrôlée - un vaisseau céleste : « Nous vous donnons un arc-en-ciel comme arc, le cercle polaire arctique comme harnais, Oh, emmenez notre globe terrestre sur une autre piste » (« Pantocrator »). Les idées visant à établir un statut d’être transformé, pliées par l’électricité révolutionnaire de l’époque, acquièrent les traits aigus d’une fureur combattant Dieu, d’un titanisme purement humain, rapprochant ces œuvres de Yesenin de certaines œuvres de Maïakovski de la fin des années 10. La transformation du monde se rêve dans des images de violence contre lui, allant parfois jusqu'au véritable « hooliganisme » cosmique : « Je lèverai les mains vers la lune, je l'écraserai comme une noix... Maintenant sur les sommets des étoiles je t'élève, terre !.. Je mordrai la couverture du lait Même pour Dieu je m'arracherai la barbe en découvrant mes dents », etc. (« Inonie »). Il convient de noter qu’une telle frénésie poétique disparaît rapidement (...) de la poésie de Yesenin." (33 ; 276).
Les plus intéressants dans ces poèmes sont les motifs bibliques et impies, ce qui les rapproche encore une fois des œuvres de Maïakovski ("Mystery Bouffe", "Cloud in Pants"), mais chez Yesenin, cela est organiquement lié à la culture populaire, avec le thème de "le rôle sacrificiel de la Rus', le choix de la Russie pour le salut du monde, le thème de la mort de la Rus' pour l'expiation des péchés universels." (12 ; 110).
Citant les vers de « La Colombe jordanienne » : « Ma mère est ma patrie, je suis bolchevique », A.M. Mikeshin souligne que dans ce cas, le poète « était un vœu pieux » et était encore loin du véritable bolchevisme (22 ; 43). C’est probablement pour cette raison que la déception s’est rapidement installée à l’égard de la révolution. Yesenin a commencé à regarder non pas vers l'avenir, mais vers le présent. « Une nouvelle période s’ouvrait dans l’évolution idéologique et créatrice du poète » (22 ; 54). La révolution n’était pas pressée de justifier les espoirs du poète d’un « paradis paysan » rapide, mais elle a révélé beaucoup de choses que Yesenin ne pouvait pas percevoir de manière positive. Déjà en 1920, il admettait dans une lettre à E. Livshits : « Je suis très triste maintenant que l'histoire traverse une époque difficile de meurtre de l'individu en tant que personne vivante, car ce qui se passe est complètement différent du socialisme. à quoi j'ai pensé... C'est un espace exigu pour les vivants, un espace exigu pour construire un pont vers le monde invisible, car ces ponts sont coupés et détruits sous les pieds des générations futures. Bien sûr, celui qui l'ouvrira verra alors ceux-ci. les ponts sont déjà couverts de moisissure, mais c'est toujours dommage que si une maison est construite, mais que personne n'y habite.." (10 ; 2, 338-339).
Dans ce cas, on ne peut qu’être surpris par le pouvoir de prévoyance manifesté dans ces paroles. Ils ont passé 70 ans à construire une maison appelée « socialisme », ils ont sacrifié des millions de vies humaines, beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie, et en conséquence ils l'ont abandonnée et ont commencé à en construire une autre, sans être complètement sûrs que les gens du pays l'avenir voudrait y vivre aussi "à la maison". L’histoire, comme nous le voyons, se répète. Et notre époque est probablement quelque peu similaire à celle de Yesenin.
Simultanément à cette lettre, Yesenin écrit le poème « Sorokoust », dont la première partie est remplie d'une prémonition d'un désastre imminent : « Le cor fatal souffle, souffle ! Que pouvons-nous faire, que pouvons-nous faire maintenant ?.. Vous on ne peut se cacher nulle part de la mort, on ne peut échapper nulle part à l'ennemi... Et le taureau silencieux de la cour (...) a senti des troubles sur le terrain..." Dans la dernière 4ème partie du poème, le pressentiment des troubles s'intensifie et prend une connotation tragique :
C'est pourquoi le matin de septembre
Sur terreau sec et froid,
Ma tête s'est écrasée contre la clôture,
Les baies de sorbier sont trempées de sang...
Le participe métaphorique écrasé en combinaison avec le sang des baies de sorbier évoque dans l’esprit du lecteur l’image d’un être vivant qui contenait les doutes, les tourments, la tragédie et les contradictions de l’époque et qui s’est suicidé en raison de leur intraitabilité.
Sensations anxieuses pendant longtemps n'a pas quitté Yesenin. En 1924, alors qu’il travaillait sur le poème « Walk in the Field », il écrivit également :
Russie! Chère terre au cœur !
L'âme recule devant la douleur.
Le domaine n'a pas entendu parler depuis de nombreuses années
Le chant du coq, le chien qui aboie.
Depuis combien d'années notre vie tranquille
Verbes paisibles perdus.
Comme la variole, les creux des sabots
Les pâturages et les vallées sont creusés...
Dans le même 1924, dans un court poème « Au départ de la Russie », Yesenin s'écria avec douleur : « Amis ! Amis ! Quelle scission dans le pays, Quelle tristesse dans l'ébullition joyeuse !.. » Enviant ceux « qui ont passé leur vie dans bataille, qui a défendu la grande idée", le poète n'a pas pu départager les deux camps en guerre ni finalement choisir un camp. Cela cache le drame de sa situation : "Quel scandale ! Quel grand scandale ! Je me suis retrouvé dans un écart étroit..." Yesenin a réussi à exprimer son état et son attitude d'homme agité, confus et tourmenté par les doutes : " Qu'ai-je vu ? Je n'ai vu qu'une bataille. Oui, au lieu de chants, j'ai entendu de la canonnade... » La « Lettre à une femme » parle de la même chose :
Tu ne savais pas
Que je suis en fumée totale,
Dans une vie déchirée par une tempête
C'est pour ça que je suis tourmenté parce que je ne comprends pas -
Où nous mène le sort des événements…
L'image de la fumée dans ce cas, selon V.I. Khazan, signifie « le trouble de la conscience du héros lyrique, l'incertitude Le chemin de la vie" (35 ; 25). De la question tragique « Où nous mène le sort des événements ? », du tourment mental, Yesenin, avec son organisation mentale instable, s'est enfui dans une stupeur ivre. La douleur de son âme pour la Russie et le Le peuple russe était noyé et noyé dans le vin. À ce sujet, les mémoires de ses contemporains disent : « Yesenin, accroupi, remuait distraitement les tisons qui brûlaient avec difficulté, puis, fixant d'un air maussade ses yeux aveugles sur un point, commença doucement :
J'étais au village. Tout s'écroule... Il faut être soi-même de là pour comprendre... La fin de tout (...)
Yesenin se leva et, joignant sa tête à deux mains, comme s'il voulait en faire sortir les pensées qui le tourmentaient, dit d'une voix étrange, différente de la sienne :
Ça fait du bruit comme un moulin, je ne comprends pas moi-même. Ivre ou quoi ? Ou c’est aussi simple que ça… » (30 ; 1, 248-249).
D’autres souvenirs nous convainquent également que l’ivresse de Yesenin avait des raisons complexes et profondes :
« Quand j'ai essayé de lui demander, au nom de diverses « bonnes choses », de ne pas trop boire et de prendre soin de lui, il est soudain devenu terriblement, particulièrement agité : « Je ne peux pas, eh bien, n'est-ce pas. comprends, je ne peux pas m'empêcher de boire... Si je n'avais pas bu, comment aurais-je pu survivre à tout ce qui s'est passé ?.." Et il marchait, confus, gesticulant sauvagement, à travers la pièce, s'arrêtant parfois et me saisissant la main. .
Plus il buvait, plus il parlait avec noirceur et amertume du fait que tout ce en quoi il croyait était en déclin, que sa révolution « Yesenin » n'était pas encore arrivée, qu'il était complètement seul. Et encore, comme dans sa jeunesse, mais maintenant ses poings se serraient douloureusement, menaçant des ennemis invisibles et le monde... Et puis, dans un tourbillon débridé, dans la confusion des concepts, un seul mot clair et répétitif tourbillonnait :
Russie! Vous comprenez - la Russie !.." (30 ; 1, 230).
En février 1923, de retour d'Amérique en Europe, Yesenin écrit à Sandro Kusikov : « Sandro, Sandro ! Mélancolie mortelle, insupportable, je me sens étranger et inutile ici, mais dès que je me souviens de la Russie, je me souviens de ce qui m'attend là-bas. , je n'y retournerai pas. » Je le veux. Si j'étais seul, s'il n'y avait pas de sœurs, j'abandonnerais tout et j'irais en Afrique ou ailleurs. J'en ai marre d'être un beau-fils russe dans mon propre pays. Je suis fatigué de cette f... attitude condescendante de ceux qui sont au pouvoir, et c'est encore plus écoeurant d'endurer la flagornerie de mes propres frères, je ne peux pas, par Dieu, crier au garde ou prendre un couteau et prendre. la grande route.
Maintenant, alors qu'il ne reste de la révolution que du raifort et une pipe (...), il est devenu évident que vous et moi étions et serons le salaud auquel tous les chiens peuvent être pendus (...).
Et maintenant, maintenant, un découragement maléfique m'envahit. Je ne comprends plus à quelle révolution j’ai appartenu. Je ne vois qu'une chose, ni en février ni en octobre, apparemment. Une sorte de novembre était et se cache en nous (...)" (16 ; 7, 74-75 - souligné par moi - P.Ch.).
Puis à Berlin au petit matin du 2 mars 1923. Yesenin ivre dira à Alekseev et Gul : « J'aime ma fille (...) et j'aime la Russie (...), et j'aime la révolution, j'aime beaucoup la révolution » (16 ; 7, 76). Mais après avoir lu la lettre à Kusikov, la dernière partie de la confession du poète n'inspire plus confiance. En tout cas, on a l’impression qu’il aimait « une sorte de novembre », mais pas février ni octobre…
"Taverne de Moscou"
Ainsi, la crise mentale du poète au début des années 20. en grande partie à cause de sa déception face aux résultats de la révolution. Cette relation devient claire dans le poème ultérieur « Lettre à une femme » (1924) :
La Terre est un vaisseau !
Mais soudain quelqu'un
Pour une nouvelle vie, une nouvelle gloire
Au milieu des tempêtes et des blizzards
Il la dirigeait majestueusement.
Eh bien, lequel d'entre nous est le plus grand sur le pont ?
Vous n’êtes pas tombé, n’avez pas vomi ou juré ?
Ils sont peu nombreux, avec une âme expérimentée,
Qui est resté fort en pitching.
Et puis moi aussi
Sous le bruit sauvage
Mais connaissant avec maturité le travail,
Il descendit dans la cale du navire,
Pour ne pas voir les gens vomir.
Cette prise était -
Taverne russe,
Et je me suis penché sur le verre,
Pour que, sans souffrir pour personne,
Se ruiner
Dans une stupeur ivre...
Le fait que le tournant de Yesenin vers le vin était une étape consciente est également démontré par d'autres vers de poèmes, tous deux inclus dans « Taverne de Moscou » et non inclus dans ce cycle :
Et moi-même, la tête baissée,
Je verse du vin dans mes yeux,
Pour ne pas voir le visage fatal,
Penser un instant à autre chose.
(« Ils boivent encore ici, se battent et pleurent »).
Je suis déjà prêt. Je suis timide.
Regardez l'armée de bouteilles !
Je collectionne les embouteillages -
Tais-toi mon âme.
(« La joie est donnée aux grossiers »).
Dans le vin, le poète a voulu s'oublier, « ne serait-ce qu'un instant », pour échapper aux questions qui le tourmentaient. Ce n’est peut-être pas la seule raison, mais c’est l’une des principales. C'est ainsi que Yesenin entre dans le monde des tavernes avec son atmosphère suffocante de stupeur ivre, qui trouvera plus tard une incarnation vivante dans le cycle « Taverne de Moscou » (1923-1924).
Une analogie avec A.A. Blok, qui en 1907-1913 sonnait aussi : « Je suis cloué au comptoir de la taverne, je suis ivre depuis longtemps, je m'en fiche » ou « Et peu importe lesquels embrassent tes lèvres, caressent tes épaules... » » La critique dans cette page de la poésie de Blok voit la particularité du symbolisme avec son décor : « Riez des illusions brisées, vengez-les par un échec moral" (Lurie). Évidemment, cette position est devenue caractéristique poésie de l'âge d'argent, dont une certaine étape est représentée par la poésie de S. Yesenin.
En 1923, lors d'un voyage à l'étranger à Berlin, Yesenin publia le recueil « Poèmes d'un bagarreur ». Le livre comprenait 4 poèmes, réunis par un seul titre «Moscow Tavern». Il comprenait les poèmes « Ils boivent encore ici, se battent et pleurent », « Éruption cutanée, harmonica... Ennui... », « Chante, chante sur cette foutue guitare », « Oui, maintenant c'est décidé sans retour. .» Ils leur ont déjà donné une évaluation succincte et objective :
« Les poèmes de ce cycle se distinguent par une phraséologie volontairement vulgaire (...) Les intonations hystériques, les motifs monotones des prouesses ivres, remplacés par une mélancolie mortelle - tout cela témoignait de pertes notables dans créativité artistique Essénine. Il n'y avait plus l'arc-en-ciel de couleurs qui distinguait ses poèmes précédents - ils étaient remplacés par des paysages ternes de la ville nocturne, observés à travers les yeux d'un homme perdu : ruelles tortueuses, rues courbes, lanternes de taverne brillant à peine dans le brouillard. .. La sincérité sincère, l'émotivité profonde des poèmes lyriques de Yesenin ont cédé la place à la sensibilité nue, à la mélodie plaintive d'une romance gitane" (41 ; 64).
Dans une courte préface du recueil « Poèmes d'un bagarreur », l'auteur a écrit : « Je me sens comme un maître en poésie russe et c'est pourquoi j'insère dans le discours poétique des mots de toutes les nuances, il n'y a pas de mots impurs, il n'y a que des idées impures. L'embarras de la parole audacieuse que j'ai prononcée n'incombe pas à moi, et au lecteur ou à l'auditeur. Les mots sont des citoyens, je suis leur commandant, j'aime beaucoup les paroles maladroites, je les mets dans les rangs comme des recrues maladroites. sera le même que toute l'armée dans les rangs du discours »(27 ; 257).
Un peu plus tard, le poète a déclaré : « On me demande pourquoi dans mes poèmes j'utilise parfois des mots qui ne sont pas acceptés dans la société - c'est si ennuyeux parfois, si ennuyeux que tout à coup on a envie de jeter quelque chose. Mais que sont des « mots indécents ». ? est utilisé par toute la Russie, pourquoi ne pas leur donner le droit de citoyenneté en littérature" (30 ; 2, 242).
Et la « citoyenneté » a été accordée :
Éruption cutanée, harmonica. L'ennui... L'ennui...
Les doigts de l'accordéoniste coulent comme une vague.
Bois avec moi, sale salope
Bois avec moi.
Ils t'aimaient, ils t'abusaient -
Insupportable.
Pourquoi regardes-tu ces éclaboussures bleues comme ça ?
Ou tu veux me frapper au visage ? (...)
Éruption cutanée, harmonica. Rash, mon problème fréquent.
Bois, loutre, bois.
Je préférerais avoir celui-là aux gros seins là-bas -
Elle est plus bête.
Je ne suis pas la première parmi les femmes...
Un bon nombre d'entre vous
Mais avec quelqu'un comme toi, avec une salope
Seulement pour la première fois...
Ce poème a déjà marqué un changement brutal dans l'intonation, le vocabulaire, le style même de s'adresser à une femme, toute la structure et la mélodie du vers : « C'est comme si nous regardions les vers d'un autre poète Le rythme tremblant, le langage récitatif. , vocabulaire vulgaire, cynisme aigri - tout cela ne ressemble en rien à cette tendresse, à cette poésie, parfois même à cette fabulosité, qui résonnaient dans ses poèmes précédents sur l'amour" (41 ; 109).
En effet, dans toute l’œuvre de Yesenin, c’est le seul poème dans lequel une attitude aussi irrespectueuse et offensante envers les femmes s’exprime. Des épithètes indignes (« salope moche », « loutre », « salope »), adressées au début à la petite amie du héros lyrique, prennent à la fin un caractère généralisé et s'adressent à toutes les femmes : « meute de chiens ». Et plus le contenu du poème est vulgaire, plus sa fin est surprenante, où le héros se met soudain à verser des larmes de sentimentalité et demande pardon :
À ta meute de chiens
Il est temps d'attraper froid.
Chérie, je pleure.
Pardon pardon...
Ici, le passage de l’intonation offensante à la demande de pardon est si rapide et si brutal que la sincérité des larmes du héros ne nous inspire pas une confiance totale. I.S. Eventov voit le problème différemment :
« Ici l'amour est piétiné, réduit à un sentiment charnel, la femme est défigurée, le héros lui-même est démoralisé, et sa mélancolie, interrompue par la violence, n'est remplacée qu'à la toute fin par une note de repentir pitoyable (...)
L'idée se suggère involontairement d'une certaine délibération, démonstratif du tableau dépeint par le poète (et du vocabulaire qu'il utilise), qu'il semble afficher toute l'abomination du tourbillon de taverne dans lequel il a plongé et qui ne lui plaît pas du tout. tout, ne le console pas, mais au contraire - le charge »(41 ; 109).
Néanmoins, il convient de noter que malgré tout le vocabulaire « réduit » de ce poème, il est loin de l'obscénité qui s'est déversée dans le courant littéraire ces jours-ci. Et plus important encore, le « sel » du poème ne réside pas dans les « mots indécents », mais dans la conscience du héros de la culpabilité et de la douleur.
Une attitude ambivalente envers « l'objet » de l'amour est également observée dans le poème « Chante, chante sur la guitare damnée », où, d'une part, le poète regarde les beaux poignets d'une femme et « ses épaules de soie fluides ». , cherche le bonheur en elle, mais trouve la mort . Le héros est prêt à accepter le fait qu'elle en embrasse une autre, la traite de « jeune belle poubelle » et ensuite : « Oh, attends, je ne la gronde pas. Oh, attends, je ne la maudis pas. . » Et les belles lignes suivantes : « Laissez-moi jouer dans mon esprit sur cette corde basse », révèlent-ils. état interne une personne qui se rend compte calmement, sans effort, de sa fascination pour un « sujet » qui n'est pas digne de son attention, mais en même temps ne se précipite pas pour tirer des conclusions, comme si cette situation ne le dérangeait pas trop. Mais dans la deuxième partie du poème, le héros glisse à nouveau dans la vie quotidienne vulgaire, affichant l'énumération de ses victoires sur les femmes, réduisant le sens et le but de la vie au « niveau du lit » : « Notre vie est un drap et un lit. , Notre vie est un baiser et une piscine. Et malgré le dernier vers apparemment optimiste (« Je ne mourrai jamais, mon ami »), le poème laisse une impression douloureuse. Il devient clair que dans cette « tanière » « il n'y a pas de place pour la joie humaine, il n'y a aucun espoir de bonheur ici. L'amour ici n'est pas une fête du cœur, il apporte la mort à une personne, il la détruit comme une peste » ( 41 ; 109-110).
Dans le poème "Oui ! Maintenant c'est décidé. Pas de retour..." le vide spirituel du héros est poussé à l'extrême. La poétique du vers est déprimante avec des couleurs sombres dès le début : les feuilles ailées du peuplier ne sonneront plus, la maison basse se baissera, le vieux chien est mort... Et comme développement naturel de la ligne d'épaississement de couleurs, déjà à la fin de la deuxième strophe naît une hypothèse posée calmement : « Dans les rues courbes de Moscou Pour mourir, je sais, Dieu m'a jugé. Même la description du mois, comme s'il envoyait ses rayons sur la terre en abondance, semble avoir été introduite dans le poème uniquement pour mieux mettre en valeur la figure d'un homme marchant la tête baissée dans une taverne familière. Et puis dans le poème on ne trouvera pas une seule lueur ; alors tout est décrit uniquement en couleurs noires :
Le bruit et le vacarme dans ce terrible repaire,
Mais toute la nuit, jusqu'à l'aube,
Je lis de la poésie aux prostituées
Et je fais frire de l'alcool avec les bandits...
Non seulement la conscience de la chute morale en cours du héros jusqu'au plus bas est déprimante, mais le vocabulaire lui-même est déprimant : bruit, vacarme, repaire, glauque, prostituées, bandits, friture, alcool... Et la dernière confession du Le héros lyrique sonne comme la clôture logique de l’intrigue devant les bandits et les prostituées : « Je suis comme toi, perdu, je ne peux pas revenir en arrière maintenant. » Après cela, même la deuxième strophe, répétée à la fin avec une prédiction tragique de sa propre mort, probablement destinée à renforcer l'horreur et l'horreur du vers, n'atteint pas son objectif, puisqu'il n'y a rien pour « renforcer », la limite de la chute a déjà été indiqué plus haut.
Des motifs de désespoir seront également entendus dans les œuvres ultérieures du cycle. Ainsi, dans les vers « Je n'ai jamais été aussi fatigué auparavant », nous rencontrons à nouveau des images d'une vie malavisée, de nuits ivres interminables, d'une mélancolie rampante, d'une force obscure habituée au vin... C'est comme si le poète ne le faisait même pas. avoir la force d'être étonné d'une situation aussi dramatique , il admet de manière totalement impartiale, comme s'il s'agissait de quelque chose d'ordinaire et de familier, ce qu'il est impossible à une personne sensée d'admettre sans tremblement intérieur :
J'en ai marre de me torturer sans but,
Et avec un étrange sourire sur son visage
Je suis tombé amoureux de porter un body léger
Lumière tranquille et paix d'un homme mort...
C'est probablement pour cela qu'A. Voronsky avait des raisons d'écrire sur la « Taverne de Moscou » dans le magazine « Krasnaya Nov » :
"Pour la première fois dans l'histoire de la poésie russe, apparaissent des poèmes dans lesquels, avec une imagerie excellente, un réalisme, une véracité et une sincérité artistiques, la frénésie de la taverne est élevée au rang de "perle de la création", jusqu'à son apothéose." Il a qualifié les poèmes de ce cycle de « potence, finis, désespérés » et a soutenu qu'ils montraient clairement « une démagnétisation, une prostration spirituelle, une profonde antisocialité, un effondrement quotidien et personnel, une désintégration de la personnalité » (27 ; 254).
V. Kirshon a exprimé son profond désaccord avec cette évaluation : « Seule une personne insensible peut dire qu'Esenin a porté cette frénésie, cette maladie à son apothéose... Lisez attentivement ses poèmes, et devant vous se tient la figure (...) d'un poète. qui est ivre ivre, et au milieu d'un déversement de clair de lune parmi des collégiennes et des voleurs, il souffre et souffre de cette racaille, est arraché à la vie et à l'abomination, regrette les forces si bêtement gaspillées (...) Que de lourdeur, que de douleur , qui s'inspire des réjouissances ivres, s'exprime de manière hystérique dans ces vers".
On peut convenir avec V. Kirshon que le poète n'admire vraiment ni les images de réjouissances de taverne ni sa propre situation, qu'il ressent profondément la tragédie de sa chute, mais en même temps, il serait faux de rejeter complètement Les jugements de Voronsky sont sans fondement. Aujourd'hui, il est important non seulement que le poète ait vécu « la Taverne de Moscou » (« Je l'ai vu, je l'ai vécu à ma manière »), mais aussi qu'il s'élève au-dessus de ce qu'il a vécu et ressenti jusqu'à une généralisation typique (« J'ai dû raconte-le en vers »). La preuve en est le cycle de poèmes «L'amour d'un voyou».
"L'amour du voyou"
En juillet 1924, à Leningrad, Yesenin publia un nouveau recueil de poèmes sous le titre général « Taverne de Moscou », qui comprenait quatre sections : des poèmes comme introduction à « Taverne de Moscou », « Taverne de Moscou » elle-même, « L'amour d'un voyou, » et un poème en guise de conclusion.
Le cycle « L'amour d'un voyou » comprend 7 poèmes écrits dans la seconde moitié de 1923 : « Un feu bleu a commencé », « Tu es aussi simple que tout le monde », « Laisse les autres te boire », « Chéri, asseyons-nous ensuite à toi », « Je suis triste. » regarde-toi », « Ne me tourmente pas avec sang-froid », « La soirée a haussé des sourcils noirs ». Tous étaient dédiés à l'actrice de théâtre de chambre Augusta Miklashevskaya, que Yesenin a rencontrée à son retour de l'étranger. « L'amour pour cette femme guérit l'âme malade et dévastée du poète, il l'harmonise, l'éclaire et l'élève, inspire l'auteur à créer, lui fait croire encore et d'une manière nouvelle à la signification d'un sentiment idéal » (28 ; 181).
Ce n'est pas un hasard si Yesenin a placé ces deux cycles dans une même collection l'un après l'autre ; ils se poursuivent, se développent et se complètent ; Ainsi, « L'amour d'un voyou » n'est pas exempt des motifs de « Moscow Tavern ». Par exemple, dans le poème « Je suis triste de te regarder », on sent bien l'empreinte de la période « taverne » :
Ça me rend triste de te regarder
Quelle douleur, quel dommage !
Je sais, seulement du cuivre de saule
Nous sommes restés chez vous en septembre.
Les lèvres de quelqu'un d'autre ont été déchirées
Votre chaleur et votre corps tremblant.
C'est comme s'il pleuvait à torrent
D'une âme un peu endormie (...)
Après tout, je ne me suis pas sauvé non plus
Pour une vie tranquille, pour des sourires.
Si peu de routes ont été parcourues
Tant d'erreurs ont été commises...
Et le poème « Ne me tourmente pas avec sang-froid » s'ouvre sur la confession : « Obsédée par une épilepsie sévère, Mon âme est devenue comme un squelette jaune. » De plus, l'auteur, opposant la réalité aux rêves d'enfant, montre ironiquement la véritable incarnation du rêve de gloire, de popularité et d'amour. Le tournant du raisonnement commence par un « Oui ! » déclaré haut et fort, suivi d'une liste de « richesses » (« ... Il ne reste qu'un plastron de chemise Avec une paire de bottes à la mode »), la célébrité est caractérisée ( « Mon nom terrifie, Comme un gros mot venant d'une clôture » ), l'amour (« Tu embrasses, mais tes lèvres sont comme de l'étain »). Mais ici encore, un tournant de pensée se dessine, associé au désir de «rêver à nouveau comme un garçon - dans la fumée» «à propos d'autre chose, de quelque chose de nouveau», dont le poète ne peut pas encore exprimer le nom avec des mots. Ainsi, de la conscience de l'obsession de « l'épilepsie sévère », le poète en vient au désir d'un rêve, qui donne à la fin du poème une ambiance affirmant la vie (Yudkevich ; 166). Mais des notes optimistes avaient déjà été observées lors du cycle précédent. Malgré les motifs dévorants de mélancolie et de vide spirituel, dans «Moscow Tavern», il y a des percées vers la lumière, vers le désir de rompre avec la disparition de la taverne. Ainsi, dans la finale du poème «Je n'ai jamais été aussi fatigué auparavant», des salutations sont envoyées aux «moineaux et corbeaux, ainsi qu'au hibou sanglotant dans la nuit». Ici, il crie de toutes ses forces, comme s'il reprenait sa puissance : « Chers oiseaux, tremblez dans le bleu, dites-moi que j'ai fait un scandale... »
Dans le poème « Cette rue m'est familière », que Yesenin a inclus plus tard dans « La Taverne de Moscou », les couleurs claires, les couleurs préférées du poète, commencent déjà à prédominer : « voir partir paille bleue", "village bleu", "points bleus", "pattes vertes", "fumée bleue"... Le poème éprouve la nostalgie de la terre natale, un état de paix, d'harmonie complète monde intérieur héros en se souvenant de la maison de ses parents :
Et maintenant, dès que je ferme les yeux,
Je ne vois que la maison de mes parents.
Je vois un jardin parsemé de bleu,
August s'allongea tranquillement contre la clôture.
Tenir des tilleuls dans des pattes vertes
Bruit et gazouillis d'oiseaux...
Si auparavant le poète déclarait fermement et sans équivoque : « Oui ! Maintenant, c'est décidé, j'ai quitté mes champs natals sans retour... », maintenant il réalise avec une tristesse tranquille : « Ce n'est que plus près de ma terre natale que je voudrais maintenant me tourner. Et le poème se termine par une bénédiction :
La paix soit avec toi - la paille des champs,
La paix soit avec vous - maison en bois !
Le motif du « hooliganisme passager », d'ailleurs, le renoncement aux scandales, le regret d'être tout « comme un jardin négligé », ont été entendus dans le premier poème du cycle « Un feu bleu a balayé » :
Un feu bleu commença à balayer,
Des proches oubliés.
Pour la première fois je refuse de faire un scandale (...)
J'oublierais les tavernes pour toujours
Et j'aurais renoncé à écrire de la poésie,
Touche juste ta main fine
Et tes cheveux sont de la couleur de l’automne.
Je te suivrais pour toujours
Que ce soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre...
Pour la première fois j'ai chanté l'amour,
Pour la première fois, je refuse de faire un scandale.
Ici héros lyrique déclare sans équivoque : « J’ai arrêté d’aimer boire et danser et j’ai perdu la vie sans regarder en arrière. » Il voit le sens de son existence en regardant sa bien-aimée, « en voyant le bassin doré de ses yeux », en touchant sa main fine et ses cheveux, « la couleur de l'automne ». Il devient important pour le héros de prouver à sa bien-aimée « comment un tyran sait aimer, comment il sait être soumis ». Par amour, non seulement il renonce au passé, il est prêt à oublier sa « patrie » et à abandonner sa vocation poétique. Le héros ressent la possibilité d'un renouveau sous l'influence de l'amour, et dans le poème cela s'exprime par le mode subjonctif « Je ne ferais que te regarder », « J'oublierais les tavernes pour toujours », « Je te suivrais pour toujours » ( 1 ; 100-101).
Le motif de « faire passer le hooliganisme » comme un fait déjà accompli est énoncé dans le poème « Laissez les autres vous boire » :
Je ne mens jamais avec mon cœur,
Je peux dire avec confiance
Que je dis adieu au hooliganisme.
Le poème est imprégné d'une ambiance « d'automne » (« l'œil est la fatigue d'automne », « Septembre a frappé à la fenêtre avec une branche de saule cramoisi » en accord avec l'âge et l'état d'esprit du poète. Mais les motifs d'automne dans ce cas non seulement n'apportent pas de notes tristes, mais ils semblent inhabituellement frais et jeunes :
Oh, l'âge de l'automne ! Il m'a dit
Plus précieux que la jeunesse et l'été...
Le héros trouve dans « l’âge de l’automne » un charme unique, déterminé par le fait que sa bien-aimée « a commencé à plaire doublement à l’imagination du poète ». Il se rend compte que son bien-aimé est le seul dont le héros a besoin ; selon lui, elle seule « pourrait être la compagne du poète », elle seule est capable d'influencer un changement dans un mode de vie déjà établi :
Que pourrais-je faire pour toi seul ?
Élevé dans la constance,
Chante le crépuscule des routes
Et le hooliganisme en voie de disparition.
La ligne d'amour poursuit son développement dans le poème «Tu es aussi simple que tout le monde», où le portrait de l'être aimé apparaît au héros lyrique comme l'icône sévère du visage de la Mère de Dieu. L'amour lui fait sentir dans sa poitrine « le cœur fou d'un poète », donne lieu à une inspiration créatrice : « Et maintenant soudain les paroles des chansons les plus tendres et les plus douces grandissent. Mais le point culminant est la quatrième strophe centrale, dans laquelle le héros refuse clairement le « zénith » (la gloire) au nom de l'amour et où le nom d'Auguste est magnifiquement joué en relation avec la fraîcheur d'août :
Je ne veux pas voler au zénith.
Le cœur a trop besoin.
Pourquoi ton nom sonne ainsi ?
Vous aimez la fraîcheur du mois d’août ?
Dans le poème suivant (« Chéri, asseyons-nous l'un à côté de l'autre »), le héros lyrique se réjouit « d'écouter un blizzard sensuel » (une merveilleuse métaphore de l'amour !). Même l'apparition de sa bien-aimée avec son « regard doux » est perçue par lui comme un « salut » :
C'est l'or de l'automne
Cette mèche de cheveux blanchâtres -
Tout est apparu comme salut
Un râteau agité...
D'après les mémoires des contemporains, on sait que la relation entre Yesenin et Miklashevskaya se reflète systématiquement dans les poèmes du cycle : du premier « Un feu bleu a commencé à balayer » jusqu'au final « Le soir a soulevé des sourcils noirs ». où le héros de la question rhétorique « N'ai-je pas arrêté de t'aimer hier ? montre clairement que l’amour est passé. Il est caractéristique qu'en même temps le texte du poème soit à nouveau saturé de couleurs sombres : la soirée aux sourcils noirs, la jeunesse trempée, la troïka tardive et ronflante, le lit d'hôpital qui peut « calmer » le héros pour toujours, l'obscurité les forces qui le tourmentaient, le détruisaient... et sur ce fond d'obscurité grandissante, un sortilège de mémoire résonne des lignes lumineuses adressées à celui qui est tombé en désamour :
L'apparence est affectueuse ! Look mignon!
Un seul je ne t'oublierai pas !
« En disant au revoir à la jeunesse et à l'amour, le poète conserve la foi dans la vie et le bonheur. Des questions hystériques et des jugements désespérés (...) il arrive à la conviction que ce n'est pas la fin de la vie, mais l'achèvement d'une certaine étape. de la vie - « vie antérieure » (1 ; 104).
Après une longue pause dans l'œuvre de Yesenin, le thème de l'amour résonna à nouveau dans le cycle « L'amour d'un voyou » et, en comparaison avec les poèmes de sa prime jeunesse, acquit une force de maturité. Le poète reviendra sur ce thème dans la toute dernière période de sa vie et l'enrichira de nouveaux chefs-d'œuvre poétiques : « Je me souviens, mon amour, je me souviens », « Le blizzard pleure comme un violon manouche », « Oh, tel une tempête de neige, bon sang ! et etc.
Bibliographie
1. Belskaya L.L. Mot de chanson. La maîtrise poétique de Sergei Yesenin. Livre pour les enseignants - M., 1990.
2. Belyaev I. Véritable Yesenin - Voronej, 1927.
3. Vasilyeva M. La Courbe de la Vérité // Revue littéraire - 1996. - N°1.
4. Voronova O.E. Images bibliques dans la poésie de S. Yesenin// Problèmes réels critique littéraire moderne - M., 1995.
5. Garina N. Souvenirs de S.A. Yesenin et G.F. Ustinov // Zvezda - 1995. - N° 9.
6. Gul R. Yesenin à Berlin // Frontière russe. Spécialiste. Numéro du journal "Russie littéraire" - 1990.
6a. Zhuravlev V. « Brûlé par le feu verbal » // Littérature à l'école - 1991. - N° 5.
7. Zaïtsev P.N. De souvenirs de rencontres avec le poète // Revue littéraire - 1996. - N°1.
8. Zuev N.N. Poésie de S.A. Yesenin. Origines folkloriques. Philosophie du monde et de l'homme // Littérature russe. XXe siècle. Documents de référence. - M., 1995.
9. Enisherlov V. Trois ans // Ogonyok.- 1985.- N° 40.
10. Collection Yesenin S. Op. en 2 volumes - Minsk, 1992.
11. Ivanov G. Fils " années terribles Russie". Frontière russe. Numéro spécial du journal "Russie littéraire". - 1990.
11a. Ivanov G. Maïakovski. Yesenin // Bulletin de l'Université d'État de Moscou. Ser. 9.- M., 1992.- N° 4.
12. Kaprusova M.N. Thèmes et motifs du poème de S. Yesenin « La Colombe jordanienne » // Classiques russes du XXe siècle : Limites d'interprétation. Collection de documents de conférences scientifiques - Stavropol, 1995.
14. Karpov A.S. Poèmes de Sergueï Yesenin - M., 1989.
15. Kornilov V. Victoire sur le mythe // Revue littéraire - 1996. - 1.
16. Kunyaev S., Kunyaev S. « La pipe de Dieu ». Biographie de Sergei Yesenin // Notre contemporain - 1995. - N 3-9.
17. Lurie S. Manuel d'auto-instruction du jeu tragique // Zvezda.- 1996.- N 5.
18. Maklakova G. Une autre solution aux vieux problèmes // La langue russe à l'école - 1989. - N° 11.
20. Meksh E.B. Base mythopoétique du poème de S. Yesenin « L'Homme noir » // Thèmes et images éternels dans la littérature soviétique - Grozny, 1989.
21. Mikeshin A. Sur l'idéal esthétique de la poésie de Yesenin // De l'histoire de la littérature soviétique des années 20 - Ivanovo, 1963.
22. Mikeshin A.M. "Inonia" de S. Yesenin comme poème romantique// Genres dans le processus littéraire - Vologda, 1986.
22a. Oh, Rus', bats des ailes. Collection Yesenin. - M., 1994.
23. Pastukhova L.N. Le poète et le monde. Leçon sur les paroles de Sergei Yesenin // Littérature à l'école - 1990. - N°5.
24. Perkhin V.V. La poésie de S.A. Yesenin dans le bilan de D.A. Gorbov (Sur les pages d'un article oublié de 1934) // Sciences philologiques - 1996. - N 5.
25. Petrova N. « Le Troisième ». Yesenin-Miklashevskaya-Barmin//Revue littéraire.- 1996.- N 1.
26. Prokushev Yu. Distance à la mémoire du peuple - M., 1978.
27. Prokushev Yu. Sergueï Yesenin. Image. Poésie. Époque. - M., 1989.
28. Ivre M. Tragique Yesenin // Neva - 1995. - N° 10.
30. S.A. Yesenin dans les mémoires de ses contemporains. En 2 volumes - M. - 1986.
31. Sergei Yesenin dans la poésie et dans la vie. Mémoires de contemporains - M., 1995.
32. Skorokhodov M.V. Vie/mort de l'opposition dans poésie ancienne S.A. Yesenina// Classiques russes du XXe siècle : limites de l'interprétation. Collection de documents de conférences scientifiques - Stavropol, 1995.
33. Semenova S. Surmonter la tragédie - M., 1989.
34a. Tartakovsky P. "Je vais étudier..." "Motifs persans" de Sergueï Yesenin et classiques orientaux // Dans le monde de Yesenin - M., 1986.
35. Khazan V.I. Problèmes de la poétique de S.A. Yesenin - Moscou-Grozny, 1988.
36. Khazan V.I. « Anamnèse » mythologique de l'eau dans la poésie de S.A. Yesenin // Thèmes et images éternels dans la littérature soviétique - Grozny, 1989.
37. Khazan V.I. Le thème de la mort dans les cycles lyriques des poètes russes du XXe siècle - Grozny, 1990.
38. Khodasevich V. Yesenin // Frontière russe. Spécialiste. Numéro du journal "Russie littéraire" - 1990.
39. Kharchevnikov V.I. Style poétique de Sergueï Yesenin (1910-1916 - Stavropol, 1975).
40. Kholshevnikov V. « Shagane, tu es à moi, Shagane !.. » Étude stylistique et poétique // Dans le monde de Yesenin.
41. Eventov I.S. Sergueï Yesenin. Livre pour étudiants - M., 1987.
42. Yudkevitch L.G. Chanteur et citoyen - Kazan, 1976.
Ils ont coïncidé avec une époque où des tournants brusques se produisaient en Russie. Parmi eux, il convient de mentionner tout d’abord les événements révolutionnaires, qui se sont immédiatement reflétés dans les poèmes et les poèmes de l’écrivain. Rien qu’en étudiant l’œuvre de Yesenin, nous pouvons retracer l’attitude de l’écrivain envers la révolution.
Comment la révolution s’est-elle reflétée dans l’œuvre de Yesenin ?
Initialement, comme pour beaucoup de gens, y compris les écrivains, Yesenin considérait la révolution comme une nouvelle étape dans l'histoire du pays, où tout ce qui était ancien devait être détruit et où un nouveau était né. Yesenin perçoit avec joie les événements révolutionnaires, car, comme d'autres, dans sa naïveté, il croyait vraiment à de meilleurs changements. Mais Yesenin a regardé ce qui se passait du point de vue de la paysannerie, et c'est ce point de vue qui apparaîtra un peu plus tard. Entre-temps, l'écrivain voit une nouvelle époque où il y aura du bonheur pour l'homme et où sa vie sera pleine et libre. Il croit au changement et renvoie ses poèmes post-révolutionnaires au bloc Transfiguration. Ce nom était symbolique, car l’écrivain croyait en une meilleure transformation du pays. Ainsi, dans son Inony, le poète se qualifie de bolchevik, et dans Le Tambour céleste, il salue la révolution avec ces mots : Vive la révolution.
Cependant, déjà en 1920, l'écrivain changea radicalement d'opinion sur la révolution. L’enthousiasme cède la place à la déception, qui commence à se refléter dans la créativité. Le socialisme ne répond pas aux espoirs de Yesenin. Aujourd'hui, le poète critique la révolution et se repent de sa naïveté et de sa croyance en la justesse de ses idées. L'écrivain a vu la dévastation que la révolution a provoquée en elle-même et l'ordre établi était étranger à Yesenin. Des œuvres telles que Retour à la patrie apparaissent, où le héros lyrique a vu une terre étrangère, avec des étrangers, bien qu'il soit retourné dans son pays natal.
Yesenin : le dernier poète du village
Un tel paradis paysan tant attendu devient lointain, car le socialisme avait des objectifs complètement différents. En conséquence, le pays s’est retrouvé embourbé dans guerre civile, et la dévastation et la pauvreté régnaient partout. La vie rurale prend fin, les fenêtres sont brisées et les chevaux vivants sont remplacés par une cavalerie d'acier. Le village entre en conflit avec la ville, où le premier est condamné. Désespéré, le poète dans ses œuvres envoie des malédictions au cheval de fer et, après les événements révolutionnaires, il se fait appeler le dernier poète villages. Il voit que même si le thème du village est évoqué dans la littérature, le mode de vie du village lui-même périra.
En étudiant les œuvres de l’écrivain, nous avons vu que Yesenin n’a pas rejeté le nouveau gouvernement, il ne pouvait tout simplement pas comprendre et accepter le nouveau mode de vie et s’est avéré superflu parmi ce qui se passait. Les autorités socialistes ne pouvaient pas pardonner une telle attitude envers elles-mêmes, alors elles oublient l'écrivain et, après sa mort, ses œuvres sont interdites. Cependant, la contribution de Yesenin au développement de la littérature est énorme et, malgré tout ce qui s'est passé, le poète n'a pas cessé d'aimer sa patrie, essayant d'accepter nouveau monde, mais sans plaisir. Cela signifie qu'ils n'ont pas pu l'effacer complètement des pages de l'histoire, c'est pourquoi on se souvient de lui et aujourd'hui, beaucoup admirent ses œuvres et sa créativité.
Il n'y a pas de problème « Yesenin et la Révolution » en tant que tel, écrit l'auteur de la section Yesenin dans l'ouvrage de référence pour étudiants N. Zuev. Selon sa conception, Yesenin n'était ni un révolutionnaire ni un chanteur de la révolution. C’est juste que lorsque le monde se divise, la fissure traverse le cœur du poète.
Selon les mémoires des contemporains, « Yesenin a accepté octobre avec un plaisir indescriptible ; et l'a accepté, bien sûr, uniquement parce qu'il y était déjà intérieurement préparé, que tout son tempérament inhumain était en harmonie avec octobre ».
Essenine lui-même a écrit succinctement dans son autobiographie : « Durant les années de la révolution, il était entièrement du côté d'Octobre, mais il acceptait tout à sa manière, avec un parti pris paysan. » La dernière clause n’est pas fortuite et elle se fera sentir plus tard. Mais la première période de la révolution, qui donna la terre aux paysans, fut effectivement accueillie avec sympathie par le poète. Déjà en juin 1918, « La Colombe jordanienne » était écrite avec les lignes célèbres :
Le ciel est comme une cloche
Le mois est une langue
Ma mère est ma patrie,
Je suis bolchevik.
Fin 1918 - début 1919. "Heavenly Drummer" a été créé :
Les feuilles des étoiles tombent
Dans les rivières de nos champs.
Vive la révolution
Sur terre et au ciel !...
L’arrivée de Yesenin chez les bolcheviks a été perçue comme une étape « idéologique », et le poème « Inonia » a été considéré comme une indication claire de la sincérité de ses passions impies et révolutionnaires.
Dans le même 1924, dans un court poème « Au départ de la Russie », Yesenin s'écria avec douleur : « Amis ! Amis ! Quelle scission dans le pays, Quelle tristesse dans l'ébullition joyeuse !.. » Enviant ceux « qui ont passé leur vie dans bataille, qui a défendu la grande idée", le poète n'a pas pu départager les deux camps en guerre ni finalement choisir un camp. Cela cache le drame de sa situation : "Quel scandale ! Quel grand scandale ! Je me suis retrouvé dans un écart étroit..." Yesenin a réussi à exprimer son état et son attitude d'homme agité, confus et tourmenté par les doutes : " Qu'ai-je vu ? Je n'ai vu qu'une bataille. Oui, au lieu de chants, j'ai entendu de la canonnade... » La « Lettre à une femme » parle de la même chose :
Tu ne savais pas
Que je suis en fumée totale,
Dans une vie déchirée par une tempête
C'est pour ça que je suis tourmenté parce que je ne comprends pas -
Où nous mène le sort des événements…
De la question tragique « Où nous mène le sort des événements ? », du tourment mental, Yesenin, avec son organisation mentale instable, s'est enfui dans une stupeur ivre. La douleur de son âme pour la Russie et le peuple russe a été noyée et noyée dans le vin. Les mémoires de ses contemporains disent à ce sujet : « Yesenin, accroupi, remuait distraitement les tisons qui brûlaient avec difficulté, puis, fixant d'un air maussade ses yeux aveugles sur un point, commença doucement :
J'étais au village. Tout s'écroule... Il faut être là soi-même pour comprendre... La fin de tout
D’autres souvenirs nous convainquent également que l’ivresse de Yesenin avait des raisons complexes et profondes :
« Quand j'ai essayé de lui demander, au nom de diverses « bonnes choses », de ne pas trop boire et de prendre soin de lui, il est soudain devenu terriblement, particulièrement agité : « Je ne peux pas, eh bien, n'est-ce pas. comprends, je ne peux pas m'empêcher de boire... Si je n'avais pas bu, comment aurais-je pu survivre à tout ce qui s'est passé ?.." Et il marchait, confus, gesticulant sauvagement, à travers la pièce, s'arrêtant parfois et me saisissant la main. . révolution du poème Octobre Yesenin
Plus il buvait, plus il parlait avec noirceur et amertume du fait que tout ce en quoi il croyait était en déclin, que sa révolution « Yesenin » n'était pas encore arrivée, qu'il était complètement seul.
Ainsi, la crise mentale du poète au début des années 20. en grande partie à cause de sa déception face aux résultats de la révolution.
Dans le vin, le poète a voulu s'oublier, « ne serait-ce qu'un instant », pour échapper aux questions qui le tourmentaient. Ce n’est peut-être pas la seule raison, mais c’est l’une des principales. C'est ainsi que Yesenin entre dans le monde des tavernes avec son atmosphère suffocante de stupeur ivre, qui a ensuite trouvé une incarnation vivante dans le cycle «Moscow Tavern»
Les poèmes de ce cycle se distinguent par une phraséologie délibérément vulgaire (...) Des intonations hystériques, des motifs monotones de prouesses ivres, remplacées par une mélancolie mortelle - tout cela témoignait de pertes notables dans le travail artistique de Yesenin. Il n'y avait plus l'arc-en-ciel de couleurs qui distinguait ses poèmes précédents - ils étaient remplacés par des paysages ternes de la ville nocturne, observés à travers les yeux d'un homme perdu : ruelles tortueuses, rues courbes, lanternes de taverne brillant à peine dans le brouillard. .. La sincérité sincère, l'émotivité profonde des poèmes lyriques de Yesenin ont cédé la place à la sensibilité nue, la mélodie plaintive d'une romance gitane
En juillet 1924, à Leningrad, Yesenin publia un nouveau recueil de poèmes sous le titre général « Taverne de Moscou », qui comprenait quatre sections : des poèmes comme introduction à « Taverne de Moscou », « Taverne de Moscou » elle-même, « L'amour d'un voyou, » et un poème en guise de conclusion.
Le cycle « L'amour d'un voyou » comprend 7 poèmes écrits dans la seconde moitié de 1923 : « Un feu bleu a commencé », « Tu es aussi simple que tout le monde », « Laisse les autres te boire », « Chéri, asseyons-nous ensuite à toi », « Je suis triste. » regarde-toi », « Ne me tourmente pas avec sang-froid », « La soirée a haussé des sourcils noirs ». Tous étaient dédiés à l'actrice de théâtre de chambre Augusta Miklashevskaya, que Yesenin a rencontrée à son retour de l'étranger. « L’amour pour cette femme guérit l’âme malade et dévastée du poète ; il l’harmonise, l’éclaire et l’élève, incite l’auteur à créer, lui fait croire encore et encore à la signification d’un sentiment idéal. »
Après une longue pause dans l'œuvre de Yesenin, le thème de l'amour résonna à nouveau dans le cycle « L'amour d'un voyou » et, en comparaison avec les poèmes de sa prime jeunesse, acquit une force de maturité. Le poète reviendra sur ce sujet dans la toute dernière période de sa vie et l'enrichira de nouveaux chefs-d'œuvre poétiques.
Le début du XXe siècle constitue un tournant dans l’histoire non seulement de la Russie, mais de l’humanité tout entière. La révolution est devenue un choc puissant pour tous, mettant fin à l’ancien monde et annonçant la création d’un monde nouveau. Mais ce nouveau monde lumineux était si fantomatique et lointain, et la réalité était si ambiguë, complexe et dure !
Sergei Yesenin a eu l'opportunité de vivre et de créer dans cette période difficile et mouvementée. Et sa perception des événements qui se déroulent est capturée dans la créativité poétique.
«Le poète du village», Yesenin attendait avant tout de la révolution le bénéfice du village russe, et il y réagit d'abord positivement. Cependant, à quel point ces mots sont contre nature, anti-Yesenin et peu sincères, et ressemblent à des rimes de propagande :
Le ciel est comme une cloche
Le mois est une langue
Ma mère est ma patrie,
Je suis bolchevik.
("Jordanie Colombe")
Mais très vite, la ferveur révolutionnaire de Yesenin s’est évanouie : il s’est rendu compte que le monde nouveau et heureux promis n’était pas du tout celui dont il avait rêvé. Une terrible déception a empoisonné le poète joyeux et brillant. De retour dans son pays natal après une longue séparation, il parle de la révolution avec des mots peu joyeux : « Cet ouragan est passé. Peu d'entre nous ont survécu » (« La Russie soviétique »). Confus, le poète réalise : « La langue de mes concitoyens m’est devenue comme une étrangère, // Dans mon propre pays, je suis comme un étranger. » Le discours grossier des révolutionnaires fait mal à l’oreille du poète :
« Nous lui avons déjà donné ceci et cela »
Ce bourgeois… qui… est en Crimée… »
Et les érables froissent les épis de leurs longues branches,
Et les femmes gémissent dans la pénombre muette.
Au lieu de chansons folkloriques sincères, de gentilles cours
chansons, romances lyriques, les gens « chantent de la propagande Bed-
Nogo Demyan." Yesenin, stupéfait et abasourdi, ne l'a pas fait
croit que c'est sa Russie, sa Rus' bien-aimée !
Ainsi va le pays !
Pourquoi diable suis-je
J'ai crié en vers que je suis amical avec les gens ? —
s'exclame le poète confus et furieux. Après tout, ce ne sont pas les gens qu'il a connus ! Tout est faux!
Yesenin regarde avec hostilité, voire horreur, la façon dont la ville grondante, de fer et puante s'approche de sa nature belle, pittoresque et pure, écrasant la verdure et les fleurs, détruisant toute harmonie. la paix de Dieu: "Il vient, il vient, le terrible messager du Cinquième gros fourré fait mal", "Le voici, le voici avec un ventre de fer, Tirant ses doigts vers les gorges des plaines" ("Quarante bouches"). Et le poète a peur et souffre, et une rage impuissante l'étouffe : « Bon sang, méchant invité !
Mais tout comme un amant sincère pardonnera tout péché à sa bien-aimée et l'acceptera tel qu'il est, ainsi Yesenin ne renonce pas à sa patrie bien-aimée, il accepte de la suivre sur le chemin qu'elle a choisi :
J'accepte tout.
Je prends tout tel quel.
Prêt à suivre les sentiers battus.
Je donnerai toute mon âme à octobre et mai,
Mais je ne donnerai pas la lyre à mon bien-aimé.
Le dernier vers de cette strophe contient toute la sincérité de Yesenin : il ne pourra pas honnêtement glorifier la révolution de tout son cœur ! Les mots si doux qu'il a gardés pour cette autre Rus ne sortiront jamais de ses lèvres sur elle !
Ma poésie n'est plus nécessaire ici,
Et, peut-être, moi-même, je ne suis pas non plus nécessaire ici. —
Yesenin conclut tristement. Mais il en a besoin - sa chère et bien-aimée Patrie, et il lui restera à jamais fidèle - cette même «sixième partie de la terre avec le nom court de «Rus»».
Le XXe siècle a été fatidique pour notre pays, plein de chocs et de déceptions. Ses débuts ont été brûlés par le feu des révolutions qui ont changé le cours de toute l’histoire du monde. C'est à cette époque que S. A. Yesenin, le chanteur inimitable de la Russie, grand patriote, a eu l'occasion de créer, qui, avec toute sa créativité, a chanté « Un sixième de la terre // Avec le titre Bref Rus'" Octobre 1917...
« l'heure de la transformation mûrit », le poète attend avec impatience l'apparition du « brillant invité ». Dans le poème « La Colombe du Jourdain », écrit en 1918, le poète admet son appartenance à la révolution :
mois de langue
La « colombe » apporte la joyeuse nouvelle de la transformation du monde, l'« hôte lumineux » conduira les gens au bonheur. Se félicitant de la nouvelle révolutionnaire, Yesenin espérait qu'elle apporterait prospérité et bonheur aux paysans. C’est précisément là qu’il a vu le sens de la révolution, son but. Elle a dû créer un monde où il n'y a pas de « taxes sur les terres arables », où les gens se reposent « avec bonheur », « sagement », « dans une danse en rond ». Le poème « Heavenly Drummer » (1919) est complètement différent, il est proche des paroles invitantes et accusatrices des poètes prolétariens.
«le paradis des paysans», mais en elle Yesenin a vu de manière inattendue d'autres côtés qu'il ne pouvait pas percevoir positivement. "Le socialisme en cours est complètement différent de ce que je pensais... Il est à l'étroit pour les vivants, construisant étroitement un pont vers le monde invisible... car ces ponts sont coupés et explosés sous les pieds du futur. générations. » Quelle est cette prévoyance ? N’est-ce pas ce que tout le monde a vu et compris des décennies plus tard ? En effet, « les grandes choses se voient de loin ». « Ma Rus', qui es-tu ? » » demande le poète au début des années 20, réalisant que la révolution n'a pas apporté la grâce, mais la ruine au village. L'attaque de la ville contre le village a commencé à être perçue comme la mort de tous les êtres vivants réels. Il a semblé au poète que la vie, dans laquelle les champs indigènes résonnent du rugissement mécanique du « cheval de fer », contredit les lois de la nature et viole l'harmonie. Yesenin écrit le poème "Sorokoust".
« Ne sait-il pas vraiment que les chevaux vivants // ont été vaincus par la cavalerie d'acier ? Un voyage à l'étranger oblige à nouveau le poète à repenser la réalité post-révolutionnaire.
Je suis le compagnon de voyage le plus féroce"
Le poète écrit.
Cependant, l'angoisse mentale persiste. L’incohérence des événements provoque l’incohérence des sentiments, il y a une blessure saignante dans l’âme du poète, il est incapable de comprendre ses sentiments et ses pensées. Dans le poème « Lettre à une femme », Yesenin déplore :
Ce que je ne comprends pas
Où nous mène le sort des événements… »
Dans le poème « Au départ de la Russie », Yesenin s'exclame avec douleur : « Amis ! Amis! Quelle scission dans le pays, quelle tristesse dans l'ébullition joyeuse !.. » Le poète ne parvenait pas à trancher entre les deux camps en guerre, ni finalement à choisir un camp. Cela cache le drame de sa situation : « Quel scandale ! Quel gros scandale ! Je me suis retrouvé dans un écart étroit... » D'un côté, il se compte parmi les « animaux de compagnie de la victoire de Lénine », et de l'autre, il se déclare prêt à « relever son pantalon // Courir après le Komsomol» avec une ironie non dissimulée.
Dans le poème "Leaving Rus'", Yesenin admet amèrement son inutilité nouvelle Russie: "Ma poésie n'est plus nécessaire ici." Il ne renonce cependant pas complètement à appartenir à Russie soviétique: "Je donnerai toute mon âme à octobre et mai...", bien qu'il ne se reconnaisse pas comme un chanteur de la révolution : "mais je n'abandonnerai pas ma chère lyre." Le poète n'a jamais trouvé la tranquillité d'esprit et n'a pas pu comprendre pleinement les processus sociaux qui ont affecté la Russie. Un seul sentiment n'a jamais quitté son œuvre : le sentiment d'amour sincère pour la patrie. C'est exactement ce que la poésie lui apprend. Comme un sortilège, comme une prière, l'appel de Yesenin résonne dans nos cœurs : « Ô Rus', bats des ailes !