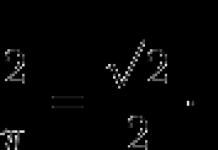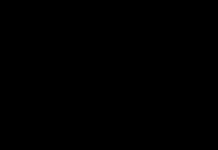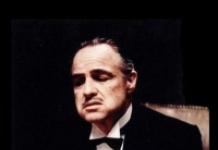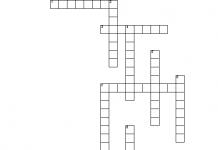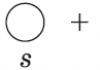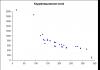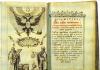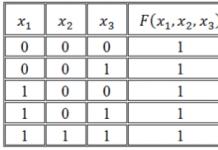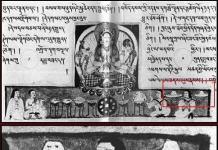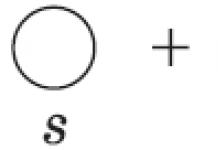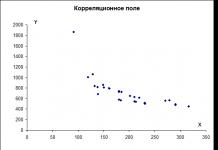Dans les années 1930, la Chine était la principale arène de combat du Japon, et les chars relativement lents étaient les plus adaptés à ce théâtre d'opérations. Après la provocation du 18 septembre 1931 en Mandchourie du Sud chemin de fer Armée du Guandong attaqua les troupes chinoises et commença la capture et l'occupation de la Mandchourie. Lors de ce que l'on appelle «l'incident de Mandchourie», un peloton de véhicules blindés et des trains blindés de l'armée du Guandong ont peut-être joué un rôle plus important que les chars - des trains blindés, par exemple, étaient déjà utilisés en décembre 1931 dans la campagne contre Fukumen et Nyuzhang. .
Ce n'est que lors de l'offensive de janvier 1932 que les Japonais envoyèrent contre les troupes chinoises la 1ère compagnie de chars distincte du capitaine Hyakutaki, composée d'un peloton de chars Renault FT-17 et d'un peloton de Renault NC-27 (Otsu). Cependant, ces chars n'ont pas eu à se battre réellement: les troupes chinoises se sont empressées de battre en retraite. Cependant, cet épisode peut être considéré comme le début de la participation des forces blindées japonaises aux hostilités. Après l'occupation de la Mandchourie, les Japonais reçurent les Renault FT de l'armée mandchoue, qu'ils attachèrent à leurs Renault.
Le 28 janvier 1932, des troupes de débarquement de la flotte japonaise débarquèrent à Shanghai avec des canons de campagne et des obusiers, ainsi que - selon des sources ouvertes - 14 véhicules blindés et 11 chars. À cette époque, Shanghai disposait déjà de plusieurs chars Renault japonais - ils y furent envoyés à la fin des années 1920 pour garder, avec les Français et les Américains, les voies ferrées pendant les troubles en Chine. Les troupes chinoises n'ont pas empêché le débarquement des unités japonaises, mais à Shanghai même, les Japonais ont rencontré de la résistance. Et en février, la 2e compagnie de chars distincte du capitaine Shigemi, composée de 5 chars moyens Type 89 et de 10 chars légers Renault NC-27, opérait à Shanghai. Ici, les actions de la force d'assaut amphibie étaient soutenues par une unité de tankettes Carden-Loyd MkVIb (désignation japonaise - Type 88). Après ces combats, les chars Renault furent officiellement retirés du service - leur suspension s'avéra plus faible et moins adaptée aux opérations dans ces conditions que celle des chars Type 89 de fabrication japonaise. En particulier, dans la 1ère Compagnie de Chars Séparée, les chars Renault sont remplacés par des Type 89. Constituée de 11 chars Type 89 et de deux véhicules blindés Type 92, cette compagnie participe à l'Opération Nekka en mars 1933 en Chine (première bataille de grande envergure armées chinoises et japonaises pendant cette guerre).
Après avoir lancé une offensive depuis Chaoyang le 1er mars, la compagnie atteint Chengje le 4 mars, après avoir parcouru 320 km en trois jours. Pas mal pour les chars de ces années-là. Un peloton de chars légers de type 92 a été utilisé pour la reconnaissance. Et les Japonais ont volontiers remis leurs Renault obsolètes - les leurs et celles françaises capturées en Chine - aux « armées » de l'État fantoche du Mandchoukouo qu'ils ont créé. En 1935, des chars d'une brigade mécanisée mixte de l'armée du Guandong opéraient dans la région de Shanghai.
Le 7 juillet 1937 a été marqué par « l'incident du pont Marco Polo » - une escarmouche entre des soldats de l'armée japonaise en Chine et une compagnie de soldats chinois, qui a servi de prétexte au début d'une agression à grande échelle contre la Chine. Le 28 juillet, les troupes japonaises ont capturé Peiping et Tianjin et, lors de l'assaut sur Peiping, elles ont utilisé quatre véhicules blindés du génie SS comme lance-flammes automoteurs. Deux régiments de chars (commandés par les colonels Baba et Yamala), équipés principalement de moyens Type 89 et de petits Type 94, furent transportés vers le nord de la Chine.
Ils furent affectés à la 1re armée qui, le 14 septembre 1937, lança une offensive au sud de Pékin en direction sud-ouest. Les chars étaient utilisés pour soutenir l'infanterie et étaient affectés directement aux divisions d'infanterie.
Les chars de la 1re brigade mécanisée mixte de l'armée du Guandong ont été utilisés de la même manière.
Au total, en 1937, les Japonais disposaient de 400 chars en Mandchourie. Les Chinois, avec leur supériorité significative en termes d'effectifs, ne disposaient pratiquement pas d'armes antichar modernes, ce qui. combiné à un mauvais entraînement militaire, a contribué au succès des chars japonais. Il suffit de mentionner qu'au début de la guerre sino-japonaise, l'armée japonaise était 4 à 5 fois plus nombreuse que la Chine en termes de puissance de feu, de 13 fois en aviation et de 36 fois en chars.
L’invasion de la Chine est rapidement passée d’une « expédition coloniale » à une guerre prolongée à grande échelle. La Chine est restée direction importanteà partir du Japon. Ainsi, pour l'action dans la « région de la Moraine du Sud » en 1941, le Japon a alloué 11 divisions. 3 brigades d'infanterie et 9 régiments de chars, réunis en 4 armées, avec un effectif total d'environ 400 000 personnes. L'armée expéditionnaire en Chine comprenait simultanément 21 divisions d'infanterie. 20 brigades d'infanterie, réunies en 5 armées avec un effectif total d'environ 600 000 personnes.
Les exemples suivants indiquent l'ampleur de l'utilisation des chars dans la guerre sino-japonaise. Lors de l'opération Pékin-Tannjing en août 1937, les forces japonaises s'élevaient à 65 000 à 70 000 personnes. 750 canons et seulement 120 chars, et ils se heurtèrent à 120 000 soldats chinois avec seulement 70 canons. Les Chinois ont opposé une résistance acharnée, malgré l'utilisation d'armes chimiques contre eux, et les Japonais ont dû constituer une réserve dans la direction Nankou-Zhangjiakou, qui comprenait environ 45 000 personnes et 180 à 200 chars. Fin novembre 1937, les forces japonaises de plus de 20 000 personnes, dont des unités mécanisées et des avions, lancèrent une attaque contre la région frontalière Shanxi-Chahar-Hebei. Cependant, l'opération a échoué - les Japonais ont été confrontés à des actions coordonnées de détachements de partisans, ont perdu plus de 2 000 personnes et parmi les trophées obtenus par les partisans figuraient un char et plusieurs véhicules.
La nécessité de résister à l'agression japonaise a obligé les troupes du Kuomintang et les troupes communistes chinoises à unir leurs forces et, par conséquent, les Japonais ont dû impliquer des forces importantes dans les opérations. Pour mener à bien l'opération Xuzhou en mai 1938, les Japonais ont concentré plus de 20 000 personnes et environ 400 chars.
L'opération de capture de Xuzhou comprenait le 1er régiment de chars du colonel Iwanaka (24 chars moyens Type 89, 8 petits chars Type 94 TK), le 2e régiment du colonel Imada (36 chars Type 89), le 5e régiment du colonel Hosomi (32 chars Type 89 et 15 Type 94). Cela a permis de réussir et de prendre Xuzhou. Cependant, il n’a pas été possible d’encercler et de détruire les troupes chinoises.
Au début de l'opération Wuhan-Canton (dans le sud de la Chine) en août 1938, les Japonais avaient concentré 12 divisions d'infanterie, renforcées par de l'artillerie lourde et deux divisions. régiments de chars- seulement 240 000 personnes, 376 canons et 180 chars. Ici, ils étaient soutenus non seulement par l'aviation, mais aussi par les navires de la flotte fluviale. Après de longues batailles, les Japonais occupent Wuhan le 24 octobre, mettant fin en leur faveur à la première étape de la guerre sino-japonaise.
En mars 1939, lors de l'attaque de Nanchang, les Japonais regroupent les chars moyens Type 89 et petits Type 94 TK des 5ème et 7ème régiments de chars et de la 7ème compagnie de chars distincte sous le commandement unique du Colonel Ishii (commandant du 5ème régiment) et a envoyé ce groupe de chars dans une sorte de raid. Cette décision rare pour les Japonais fut couronnée de succès et Nanchang fut occupée par l'infanterie japonaise avec moins de pertes que prévu en préparation de l'opération.
Lors d'une opération privée contre Changsha à l'automne 1939, les Japonais impliquèrent environ 150 000 personnes et plus de 100 chars et véhicules blindés. Les Chinois n'ont pu arrêter l'offensive japonaise dans cette direction et rétablir la situation après des combats acharnés (13 septembre - 10 octobre) que grâce à une supériorité numérique significative et à l'implication généralisée des détachements partisans.
Lors de l'offensive de janvier 1941, des forces japonaises composées de 150 000 personnes, équipées de canons 240 et de chars 120, ont agi contre les provinces du Hunan et du Guangxi, en Chine centrale. Au cours de cette opération, des unités de chars étaient constamment « projetées » en avant pour ouvrir la voie à l'infanterie. Mais en raison du mauvais terrain et des fréquentes contre-attaques chinoises, les bons du 24 janvier au 2 février n'ont apporté qu'un succès limité.
Les adversaires des chars japonais en Chine étaient les chars légers Vickers-E dont disposaient les troupes du Kuomintang, les tankettes Carden-Lloyd M 1931 de fabrication britannique et les chars légers Pz. Kpfw. Je Ausf. Une cale fabriquée en Allemagne et CV33 Fiat Ansaldo fabriquée en Italie. À partir de 1937, des chars soviétiques T-26 furent fournis, ainsi que des canons antichar de 45 mm. En 1937-1940 Lors des opérations en Chine, les Japonais ont utilisé principalement des canons anciens - le moyen Type 89 et le petit Type 94 TK. L'armée du Guandong préférait garder les modèles les plus récents prêts à entrer en guerre avec l'URSS.
Événements précédant la Seconde Guerre mondiale
Raisons du déclenchement de l'attaque allemande contre la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale
Les chars, les avions et l'artillerie décident du sort des batailles de la Seconde Guerre mondiale
L'occupation de la France par les nazis en 1940. La lutte de l'Angleterre contre l'Allemagne nazie
Guerre dans les Balkans : en Yougoslavie, en Grèce en 1941
Raisons des victoires et des défaites dans le Grand Guerre patriotique
Vous devez être honnête en tout
même quand il s'agit de la patrie.
Tout citoyen est obligé de mourir pour sa Patrie,
mais personne ne peut être contraint de mentir au nom de sa patrie.
Sh.-L. Montesquieu
La première guerre éclata en 1931 Extrême Orient. Les militaristes japonais ont occupé la Mandchourie dans le but de préparer un tremplin pour la saisie de toute la Chine et une attaque contre Union soviétique. Les vastes espaces et les richesses incalculables de l’Extrême-Orient hantaient l’armée japonaise.
Les énormes ressources matérielles et financières des monopoles des États-Unis, de l'Angleterre et de la France ont aidé l'Allemagne nazie à recréer en peu de temps son industrie militaire, à former et à armer l'armée et la marine.
Fasciste Allemagneélargi le cercle de ses alliés. Elle a conclu des accords militaires avec la Finlande, la Roumanie, la Bulgarie mais aussi avec la Hongrie. L’Allemagne a renforcé son influence en Turquie et en Iran et a fait de l’Espagne franquiste sa base militaro-économique. Toutes les ressources industrielles et militaires des pays capitalistes d’Europe et les armes des armées européennes vaincues étaient aux mains des nazis. Cependant, tous les actes d’agression commis par l’Allemagne nazie entre 1938 et 1941 n’ont servi que de prélude à l’attaque contre l’URSS. Chronique des principaux événements de la Seconde Guerre mondiale
| Calendrier historique | |
| 1931 | Invasion japonaise de la Mandchourie |
| 1932 | Pacte de non-agression franco-soviétique |
| 1932-1934 | Conférence de Genève sur le désarmement |
| 20 janvier 1933 | A. Hitler est devenu chancelier du Reich - chef du gouvernement allemand |
| 1933 | Le retrait de l'Allemagne de la Société des Nations |
| 1933 | Le retrait du Japon de la Société des Nations |
| 1934 | admission de l'URSS à la Société des Nations |
| 1935 | traités d'assistance mutuelle entre la France, la Tchécoslovaquie et l'URSS |
| 1935 | introduction de la conscription universelle en Allemagne |
| Mars 1935 | transfert de la Sarre à l'Allemagne |
| 1935-1936 | Capture italienne de l'Éthiopie |
| Mars 1936 | Occupation de la Rhénanie par l'Allemagne |
| 1936 | en France, le gouvernement de Front populaire dirigé par le socialiste Léon Blum |
| 1936-1939 | Guerre civile en Espagne, la montée au pouvoir des fascistes menés par Franco |
| Octobre 1936 | accord de coopération entre l’Allemagne et l’Italie (« axe Berlin-Rome ») |
| novembre 1936 | Pacte anti-Komintern entre l'Allemagne et le Japon |
| 1937 | Invasion japonaise du nord de la Chine |
| novembre 1937 | Adhésion de l'Italie au Pacte anti-Komintern (« Triangle Rome-Tokyo-Berlin ») |
| 1937 | Le retrait de l'Italie de la Société des Nations |
| Mars 1938 | prise de l'Autriche par l'Allemagne (« Anschluss de l'Autriche ») |
| 29 juillet - 11 août 1938 | Conflit armé soviéto-japonais dans la région du lac. Hasan |
| septembre 1938 | Accord de Munich entre l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Angleterre sur la question de la Tchécoslovaquie |
| Mars 1939 | Occupation de toute la Tchécoslovaquie par l'Allemagne |
| mai 1939 | batailles des troupes soviéto-mongoles avec le Japon dans la région de la rivière Khalkhin Gol |
| août 1939 | négociations entre l'Angleterre, la France et l'URSS à Moscou |
| 23 août 1939 | traité de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne, protocole secret sur le partage des sphères d'intérêt en Europe |
Invasion japonaise de la Mandchourie
Le 18 septembre 1931, une explosion de train s'est produite sur la voie ferrée du chemin de fer de Mandchourie du Sud (SMRR), propriété japonaise, près de la ville de Liutiaogou, près de Mukden. Cette explosion, organisée, comme il s'est avéré plus tard, par des agents japonais, a été déclarée sabotage par les gardes militaires chinois. Sous prétexte d'assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le 18 septembre, deux compagnies de soldats japonais ont été introduites sur la zone routière, qui ont essuyé des tirs de la garde routière chinoise. Les soldats japonais ont riposté puis, dans un échange de tirs continu, ont attaqué la caserne de la police chinoise et des troupes chinoises régulières. Depuis 1919, les forces armées japonaises étaient stationnées dans une partie de la péninsule du Liaodong en Mandchourie (région du Guandong, en transcription occidentale : Kwantung ; à ne pas confondre avec l'actuelle province chinoise du Guangdong), jusqu'à la Première Guerre mondiale, ancienne colonie allemande - soi-disant l'armée du Guandong.
Conformément aux plans opérationnels japonais, cette armée, en cas d'urgence, était censée passer à l'offensive contre l'armée du nord-est de la Chine et occuper une bande le long du chemin de fer de Mandchourie du Sud (SMR) au sud de Changchun. Ce plan est entré en vigueur. Le lendemain soir (19 septembre), les forces japonaises occupèrent les villes de Mukden et Changchun. Les troupes chinoises commencèrent à battre en retraite dans le désarroi. La particularité de la situation était que les opérations militaires en Mandchourie ont été lancées à l'initiative de l'armée japonaise elle-même - le commandement de l'armée du Guandong. Le gouvernement japonais à Tokyo n'a pas autorisé les actions militaires.
Tout en préconisant la transformation de la Mandchourie en une zone de domination japonaise, le gouvernement entendait en même temps y parvenir par des moyens politiques et économiques, bien qu'en recourant à la menace de la force. Cependant, l’élite militaire a agi en utilisant des méthodes d’agression directe, mettant les autorités civiles devant le fait accompli. En raison des spécificités du fonctionnement du pouvoir d'État au Japon, le gouvernement de Tokyo n'a pas toujours été en mesure de contrôler les actions de l'armée. Le commandement des forces armées japonaises sur le continent disposait donc d’une grande autonomie dans ses actions en Chine. Le comportement agressif de l'armée japonaise sur le continent pourrait diminuer si des politiciens relativement prudents arrivaient au pouvoir à Tokyo ; au contraire, il pourrait s'intensifier si le gouvernement de la capitale était dirigé par des dirigeants partageant les mêmes idées de l'armée du Guandong.
Lors des événements de Mandchourie, les troupes japonaises n'y comptaient que 10 000 personnes, tandis que la taille de l'armée chinoise dans cette région atteignait 300 000. Mais Chiang Kai-shek a abandonné d'avance la lutte armée. Il envoya un télégramme au maréchal Zhang Xueliang, dans lequel il qualifiait les actions de l'armée japonaise de provocation ordinaire. Pour éviter d'élargir le conflit, il suggère de s'abstenir de résister aux forces japonaises. Compte tenu des faiblesses internes de la Chine, Chiang Kai-shek considérait qu'une guerre à grande échelle avec le Japon serait désastreuse en raison de l'incapacité des forces armées chinoises à résister aux Japonais sur le champ de bataille. Pour la même raison, le gouvernement de Chiang Kai-shek n'a pas officiellement déclaré la guerre au Japon et n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec ce dernier. Chiang Kai-shek a également évité les négociations directes avec la partie japonaise, adhérant à une tactique attentiste et espérant gagner du temps pour renforcer les capacités de défense de la Chine. La partie chinoise a placé ses espoirs de résolution de la situation dans la médiation de la Société des Nations et des États-Unis. Les dirigeants chinois espéraient profiter des contradictions entre le Japon et les autres puissances.
La question chinoise à la Société des Nations. Le 21 septembre 1931, le gouvernement chinois envoya un message à la Société des Nations à Genève dans lequel, se référant à l'art. 11 de la Charte de la Ligue, il appelle à prêter attention au conflit entre la Chine et le Japon et à prendre des mesures pour empêcher l'escalade du conflit et rétablir le statu quo. Le rôle principal dans la Ligue a été joué par la Grande-Bretagne, la France et le Japon - membres du Conseil de cette organisation, mais pour résoudre ce problème grande importance Il y avait aussi la position des États-Unis, qui ne faisaient pas partie de la Ligue. Lors des événements de Moukden, Londres a cherché à éviter une aggravation des relations avec Tokyo. La France a suivi une ligne similaire. À l’instigation des deux puissances, le Conseil de la Ligue a demandé à Washington si les États-Unis comptaient ou non accuser le Japon de violer le pacte Kellogg-Briand de 1928 (qui stipulait le refus des pays signataires de recourir à la force pour résoudre les différends internationaux). En réponse, le secrétaire d'État américain Henry Stimson a clairement indiqué que son pays n'avait l'intention de prendre aucune mesure contre l'agression japonaise. Ainsi, la question chinoise a commencé à être discutée au Conseil de la Ligue dans un environnement favorable à Tokyo.
Au cours de la discussion, le représentant chinois a accusé les troupes japonaises d'actions agressives non provoquées et a appelé la Ligue à obliger le Japon à retirer ses troupes du territoire occupé. Le délégué japonais K. Yoshizawa n'a pas reconnu le bien-fondé des accusations. Il a déclaré qu'un incident d'importance locale s'était produit en Mandchourie et que les actions de l'armée japonaise étaient de nature défensive et avaient été causées par le sabotage chinois sur le chemin de fer. La partie japonaise a assuré le Conseil que le gouvernement japonais n'avait pas l'intention d'étendre le conflit et était favorable à une résolution pacifique par le biais de négociations bilatérales entre Tokyo et Nanjing. La partie chinoise s'étant opposée aux négociations directes avec les Japonais, le Conseil a envoyé des télégrammes aux gouvernements des deux pays les appelant à faire des efforts pour empêcher une nouvelle escalade de l'incident et à retirer immédiatement leurs troupes vers les positions qu'ils occupaient à l'époque. du déclenchement du conflit. Les gouvernements chinois et japonais ont accepté en principe les propositions du Conseil, mais n'ont pris aucun engagement spécifique. Le 30 septembre, le Conseil de la Ligue a adopté une résolution invitant les deux parties à s'abstenir de toute action violant la paix et à prendre des mesures pour normaliser les relations. Ce document fut approuvé non seulement par les délégués japonais et chinois, mais également par le consul américain à Genève. Les dirigeants américains ont en outre déclaré que, quelle que soit la Ligue, ils soutiendraient ses efforts pour résoudre la situation.
La résolution de la Société des Nations n'a pas eu d'effet modérateur sur le comportement de la partie japonaise. De nouveaux contingents de troupes d'occupation ont commencé à arriver en Mandchourie. Le commandement de l'armée du Guandong s'est opposé à l'intervention de la Ligue dans le conflit sino-japonais. Son commandant, le général Honjo, a déclaré que le Japon ne reconnaissait plus le pouvoir du dirigeant Zhang Xueliang en Mandchourie. Le 8 octobre, des avions japonais ont bombardé la ville de Jinzhou pour la première fois dans l'histoire du monde. Et les mêmes jours, les Japonais lancent une attaque sur Qiqihar. Dans le cadre de l'expansion des hostilités et du bombardement de Jinzhou, le représentant chinois s'est à nouveau tourné vers la Société des Nations pour lui demander de discuter de la situation actuelle et a de nouveau exigé le retrait des troupes japonaises des territoires occupés.
Cependant, dans ce cas, les membres de la Ligue ont refusé de prendre des mesures décisives contre le Japon. Mais ils ont invité un délégué spécial des États-Unis aux discussions à Genève en tant que pays participant et initiateur du pacte Kellogg-Briand, que le Japon pourrait être accusé d'avoir violé dans la situation actuelle. Les actions du Japon au cours de la première quinzaine d'octobre ont entraîné certains changements dans la politique américaine. Washington a cessé de soutenir l'idée de négociations directes entre la Chine et le Japon et a commencé à pencher en faveur d'actions conjointes des pays membres de la Société des Nations. Les États-Unis ont envoyé à Genève un représentant doté de pouvoirs d'observateur, censé participer aux discussions sur le conflit sino-japonais uniquement dans les cas affectant l'application du pacte Kellogg-Briand.
Parallèlement, le président du Conseil de la Ligue, le ministre français des Affaires étrangères Aristide Briand, a demandé à la Chine et au Japon de développer conjointement des conditions mutuellement acceptables pour résoudre le conflit. Mais Tchang Kaï-chek refuse de nouveau de négocier directement avec Tokyo jusqu'au retrait des troupes japonaises du territoire occupé. A la recherche d'une issue, Briand propose une résolution (adoptée le 24 octobre), qui prévoit le retrait de toutes les troupes japonaises d'ici la date de la prochaine réunion du Conseil, c'est-à-dire le 16 novembre 1931, la Chine soutenait la résolution et le Japon votait contre. En conséquence, Briand reconnaît que la résolution n'a pas de force juridique, mais qu'elle a une force morale. Le secrétaire d'État américain Stimson a également refusé d'approuver la résolution, estimant que l'inclusion d'une référence au délai de retrait des troupes donne à la résolution un caractère d'ultimatum, et que la présentation d'un ultimatum devrait impliquer une volonté de recourir à la force en cas de son rejet, auquel les États-Unis n’étaient pas prêts. Dans l'espoir de prendre l'initiative, la partie japonaise a envoyé à Nanjing une proposition visant à mener des négociations bilatérales sur la répression des mouvements anti-japonais en Chine et en Mandchourie, le respect des droits issus des traités du Japon et la protection des citoyens japonais en Mandchourie.
En fonction de l'issue des négociations proposées, Tokyo était prêt à discuter du problème du retrait des troupes. En réponse, le gouvernement chinois a réitéré sa position précédente : le point de départ pour résoudre le différend devrait être le retrait préliminaire des troupes japonaises dans un délai déterminé. La Grande-Bretagne était encline à soutenir la position du Japon, mais les États-Unis soutenaient vigoureusement la Chine. Le 16 novembre 1931, lors de la séance suivante du Conseil, le délégué chinois exigea que l'art. 16 de la Charte, qui prévoyait l'introduction de sanctions économiques. Mais cette fois, le représentant américain, qui avait reçu des instructions du président américain Herbert Hoover de résister à l'imposition de sanctions contre le Japon, a persuadé le délégué chinois de retirer son projet. Puis, sur les conseils de Briand, le représentant japonais lui-même proposa d’envoyer une commission en Mandchourie pour étudier la situation sur le terrain. Pendant ce temps, les combats se déroulaient en Mandchourie.
Fin novembre 1931, la Chine exigea que le Conseil de la Société des Nations prenne immédiatement des mesures pour créer une zone neutre en Mandchourie dans la région de Jinzhou avec le déploiement temporaire là-bas, sous le commandement de la Société des Nations, de troupes d'États neutres - Grande-Bretagne, France, Italie, etc. Cette idée a été suggérée par la Chine par les États-Unis et est devenue sa dernière tentative pour arrêter l'avancée des troupes japonaises avec l'aide de la Ligue. Cependant, en réponse, la Chine a reçu une recommandation persistante du Conseil de retirer les troupes chinoises de Mandchourie au-delà de la ligne de la Grande Muraille de Chine afin d'éviter un affrontement avec les unités japonaises. Les troupes de Chiang Kai-shek sont contraintes de quitter la Mandchourie. Le 10 décembre 1931, la Société des Nations décide de créer une commission chargée d'étudier la situation en Mandchourie. En janvier 1932, elle fut créée.
La commission était composée de représentants de cinq pays et était dirigée par le diplomate britannique Victor Alexander George Lytton. Il fut décidé de reporter toute discussion ultérieure sur la situation en Mandchourie jusqu'à ce que le rapport de la Commission Lytton soit présenté. Politique de l'URSS concernant le conflit en Extrême-Orient. L’invasion de la Mandchourie par les troupes japonaises met l’URSS dans une situation difficile. L'Union soviétique entretenait des relations productives avec le Japon après leur restauration en 1925. Ces relations étaient meilleures que celles de l'URSS avec la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et la Chine. Mais il y avait un fait d'agression directe qui menaçait à la fois les intérêts économiques soviétiques en Mandchourie (CER) et la sécurité des frontières soviétiques d'Extrême-Orient. Pour l’URSS, dont le système de défense était relativement faible en Extrême-Orient, il était important d’éviter de se laisser entraîner dans le conflit mandchou et dans la confrontation avec le Japon.
Moscou s'est laissé guider par ces considérations. Les dirigeants soviétiques considéraient initialement les événements de Mandchourie comme le résultat d’une conspiration antérieure entre le Japon et d’autres grandes puissances. Partant de cette prémisse erronée, les dirigeants soviétiques considérèrent l’intervention diplomatique de l’URSS comme inappropriée. Intervention militaire L’Union Soviétique en était totalement exclue. Dans le même temps, la presse soviétique dénonçait l'intervention du Japon en Chine, la Société des Nations comme une arme de guerre et les États-Unis comme un partisan de la division de la Chine. Dans ce contexte, la ligne officielle du gouvernement soviétique, qui déclarait une stricte neutralité et une non-ingérence dans le conflit, paraissait remarquablement différente. Parmi les grandes puissances, l’URSS a adopté la position la plus prudente durant cette période.
L'attitude apparemment calme du gouvernement soviétique à l'égard des événements de Mandchourie et l'absence de démarches vers Tokyo ont éveillé des soupçons dans les cercles diplomatiques et journalistiques de l'Occident et de la Chine quant à l'existence d'un accord secret entre l'URSS et le Japon concernant la situation en Mandchourie ou sur la non-intervention de Moscou dans le conflit sino-japonais, tout comme le Japon a poursuivi une ligne de non-ingérence dans le conflit sino-soviétique sur le chemin de fer chinois oriental en 1929. En même temps, au Japon, au contraire, ils pensaient que l'URSS se préparait à intervenir dans le conflit sino-japonais et agirait dès qu'elle concentrerait un nombre suffisant de troupes en Extrême-Orient. À l'automne 1931, des rumeurs non confirmées sur l'assistance militaire de l'Union soviétique à la Chine dans l'agression anti-japonaise commencèrent à se répandre dans la presse chinoise et japonaise. La partie chinoise les a dissous afin de provoquer un conflit entre Moscou et Tokyo, la partie japonaise - pour découvrir les véritables intentions de l'URSS et la mettre en garde contre de telles démarches. Le gouvernement japonais a même demandé des explications à Moscou. Moscou a répondu que la Chine ne recevait pas d'assistance militaire de l'URSS. En fait, lors de la campagne de Mandchourie de 1931, personne n’a soulevé la question de l’assistance soviétique aux unités chinoises. Ce n'est qu'au début de 1932, alors que l'occupation de la Mandchourie était presque achevée, que se posa la question de l'assistance soviétique aux formations provinciales chinoises, qui continuaient à combattre les envahisseurs et manquaient d'armes. Cependant, les appels répétés aux représentants soviétiques locaux pour obtenir des armes au printemps et à l'été 1932 n'ont pas abouti.
Il était interdit aux diplomates soviétiques en Mandchourie d'entrer en contact avec les chefs militaires chinois locaux, bien que les représentants chinois aient tenté à plusieurs reprises d'établir de tels contacts. Le gouvernement soviétique considérait ces tentatives comme des provocations visant à impliquer l'URSS dans un conflit avec le Japon. Ces soupçons ont été aggravés par le fait que l'armée chinoise cherchait en réalité à combattre avec des unités japonaises près de la frontière soviéto-mandchoue et la traversait avec ses troupes, se cachant des persécutions japonaises. Il y avait même des informations sur l'intention des troupes japonaises de poursuivre les unités chinoises sur le territoire soviétique. Des cas particulièrement nombreux de Chinois traversant la frontière soviétique ont eu lieu fin 1932 - début 1933. Initialement, les autorités soviétiques ont interné tout le personnel militaire chinois et les ont envoyés au plus profond de l'URSS.
Lorsque le nombre des internés commença à se chiffrer par milliers, les autorités soviétiques locales d'Extrême-Orient reçurent pour instructions de n'interner désormais que le personnel de commandement, de désarmer le reste, de leur offrir certains emplois et, s'ils refusaient de travailler, de les expulser vers leur pays. Mandchourie. Les craintes d'irriter le Japon se sont manifestées dans le refus de l'URSS de permettre à une commission de la Société des Nations (dirigée par Lord Lytton) de traverser le territoire soviétique pour se rendre en Mandchourie et de lui fournir des informations sur la situation sur le terrain, informations dont disposaient les représentants soviétiques. en Mandchourie.
La politique étrangère du Japon était étroitement dépendante de la situation intérieure, mais dans l'ensemble elle était très prudente, même si elle ne pouvait s'empêcher de prendre en compte la nécessité de coopération et de concurrence avec la Chine et sa pression de plus en plus croissante pour accroître les investissements en Mandchourie.
Les « intérêts particuliers » du Japon dans la région ont été reconnus par le Traité de paix russo-japonais de 1905.
Et les accords sino-japonais conclus par la suite. Cela s'appliquait particulièrement au contrôle de la péninsule du Liaodong et du chemin de fer transmandchourien, aux droits d'exploitation des gisements minéraux et à la reconnaissance des privilèges des citoyens japonais dans les activités agricoles, industrielles et commerciales. L'accord avec la Chine de mai 1915 durcit encore les conditions de mise en œuvre de ces concessions. Une situation inacceptable se développait pour la Chine, d'autant plus que les conséquences de la transition sanglante vers le système post-révolutionnaire devenaient de plus en plus graves. Cela explique pourquoi le gouvernement chinois a cherché soit à abolir ces privilèges, soit à les rendre inefficaces.
Les Chinois ont tenté de bloquer le droit des citoyens japonais d'acquérir des terres dans le sud de la Mandchourie, d'exploiter le minerai de fer et d'exploiter les chemins de fer dans cette région. Nous parlions de questions très importantes sur lesquelles il existait des réglementations juridiques complexes. Sur la base des traités, les Japonais ont obtenu le contrôle du chemin de fer dans le sud de la Mandchourie et ont en même temps acquis « tous les privilèges, droits et propriétés de l'ensemble du réseau ferroviaire de cette région ». Il s’agit d’un article que les Japonais ont tendance à interpréter de manière trop large, au détriment de la juridiction chinoise. À cela s’ajoutait le fait que les Japonais n’étaient absolument pas disposés à renoncer au droit d’investir dans la poursuite de la construction de chemins de fer. En 1931, ils construisirent
Il existe environ 1 000 kilomètres de voies ferrées dans toute la Mandchourie, arguant du souhait de contribuer ainsi à la croissance économique de la région.
Ici, différents intérêts s’entremêlent dans un enchevêtrement complexe. A cela s'ajoutait la question de près d'un million d'émigrants coréens en Mandchourie, que les Chinois considéraient comme l'avant-garde de l'invasion japonaise, la Corée faisant alors partie de l'Empire du Soleil Levant, ce qui sapait le pouvoir du gouvernement chinois et appelait remettre en question la capacité de Tokyo à influencer la situation.
Durant ces années, le Japon était au pouvoir sous la direction d'Osachi Hamaguchi, formé par le parti Minseito. En 1930, il entre en conflit aigu avec les milieux militaires et avec le Conseil privé de la Couronne en raison du fait qu'à la Conférence maritime de Londres, il a accepté des conditions considérées comme humiliantes par les dirigeants réactionnaires du Japon. marine. En novembre 1930, Hamaguchi fut assassiné par un fanatique nationaliste. Il décède quelques mois plus tard, en avril 1931 ; Il est remplacé à la tête du gouvernement par un autre représentant du même parti, le baron Reihiro Wakatsuki, qui représente alors le Japon à la Conférence de Londres. Le baron Hihuro Shidehara devient ministre des Affaires étrangères. Mais si Hamaguchi était une personnalité forte, capable de résoudre les contradictions politiques internes, alors le nouveau chef du gouvernement ne disposait pas d'une autorité suffisante et n'était pas en mesure de résister à la pression des cercles militaristes opérant en Mandchourie.
Lorsque plusieurs unités militaires sous commandement japonais en Mandchourie occupèrent Moukden le 18 septembre 1931, ville principale région et ont poursuivi leur progression à travers le territoire de la Mandchourie sous prétexte de protéger les chemins de fer, qui appartenaient aux Japonais et qui auraient été soumis aux attaques constantes des forces irrégulières chinoises, le gouvernement de Tokyo s'est alors retrouvé devant le fait accompli. Trois jours plus tard, le gouvernement chinois faisait appel à la Société des Nations et, en tant que partie au pacte Kellogg-Briand, au gouvernement américain. La situation était complexe et exigeait une approche prudente. Personne en dehors du Japon ne voulait créer de difficultés à son gouvernement faible et à son ministre des Affaires étrangères Shidehara en les opposant à la réaction nationaliste et militariste qui se produirait si l'étranger condamnait une action entreprise sans l'approbation du gouvernement afin de le mettre dans l'embarras.
L'appel de la Chine à la Société des Nations a été examiné sur la base de l'art. 11 de sa Charte, qui définit les modalités d'intervention politique de la Ligue en cas de conflit. Le 22 septembre, le Conseil de la Ligue a approuvé à l'unanimité (c'est-à-dire même avec la participation du représentant japonais au vote) une résolution invitant les parties à s'abstenir de toute démarche susceptible de compliquer la situation et à retirer leurs troupes vers leurs positions d'origine. La Chine salue l'intervention de l'Organisation de Genève ; le Japon, au contraire, plus fort militairement, insiste sur la nécessité de négociations directes, affirmant qu'il a déjà entamé le retrait de ses troupes, utilisées uniquement à des fins de précaution.
La situation restait instable ; la Société des Nations, poursuivant ses tentatives de pacification, se tourna vers les États-Unis en leur proposant de se joindre à ses actions. Les Américains ont soutenu ses activités de maintien de la paix et ont pris un certain nombre de mesures unilatérales qui ont contraint les Japonais à respecter les traités. Les Japonais ont continué leurs tours. Le gouvernement de Tokyo s’est retrouvé pris dans une situation contradictoire : d’un côté, il était sous la pression internationale et, de l’autre, il devait affronter le pouvoir et la force des cercles militaristes à l’intérieur du pays.
La crise s'est développée lentement dans ce sens pendant plusieurs semaines, jusqu'au 24 octobre, lorsque la Société des Nations, contrairement à l'avis du gouvernement japonais, a clairement exigé que Tokyo retire ses troupes avant le 16 novembre. Le refus japonais d'accepter cette demande a contraint Washington à envoyer une très vive protestation au Japon le 24 novembre, en réponse à laquelle le ministre Shidehara s'est engagé à arrêter l'avancée des troupes. Shidehara a rempli son obligation et a obtenu le consentement des généraux pour suspendre les hostilités. En outre, le gouvernement japonais a accepté la création d'une commission internationale et a même exigé qu'une commission d'enquête dirigée par Lord Lytton soit envoyée en Mandchourie, qui en fait n'a été créée que six mois plus tard, en juin 1932. C'est le retard dans la création d'une commission d'enquête internationale. la nomination de la commission Lytton qui indique que sous couvert Bonne volonté les intentions et les objectifs étaient cachés, loin d’être aussi décisifs et fondés sur des principes qu’on l’avait déclaré précédemment.
Shidehara a consacré toutes ses ressources politiques à poursuivre une politique d'apaisement.
Il fut vivement critiqué pour son acquiescement et, le lendemain de la décision de nommer la commission, le 11 décembre 1931, il fut contraint de démissionner. Ainsi, pendant que les diplomates négociaient, les militaires parvenaient à lever le principal obstacle à la liberté d'action.
Chapitre 3. Crise et effondrement du système de Versailles
élégant. Les opérations militaires en Mandchourie reprirent et l'occupation de toute la région fut achevée début janvier 1932. Lorsque Lytton arriva en Mandchourie, il dut faire face à une situation complètement différente de celle qui existait lorsque la décision de créer la commission fut prise. fait.
Le tournant brutal de la politique japonaise vers le militarisme signifiait le rejet de l'orientation politique suivie dans la période d'après-guerre, qui a conduit à la fin de l'ère précédente de prédominance des partis politiques et au début d'une nouvelle étape d'un mouvement rapide, quoique retour progressif à la domination militaire. Au niveau international, cela a provoqué une vive réaction de la part des Américains. Le secrétaire d’État Henry Stimson a envoyé une note diplomatique dure à Tokyo et à Pékin, connue plus tard sous le nom de « Doctrine Stimson ».
Il a déclaré que le Gouvernement des États-Unis ne pouvait admettre « la validité d'aucune disposition de facto et n'avait pas l'intention de reconnaître aucun traité ou accord entre gouvernements ou leurs agents qui pourrait porter préjudice aux droits des États-Unis ou aux droits de leurs citoyens ». citoyens chinois, sur la base des traités existants, y compris ceux relatifs aux questions de souveraineté, d'indépendance ou d'intégrité territoriale et administrative de la République de Chine, concernant la politique internationale à l'égard de la Chine, connue sous le nom de « politique de la porte ouverte ». Le gouvernement des États-Unis n'a pas non plus l'intention de reconnaître aucune disposition, traité ou accord qui serait conclu par des méthodes contraires aux articles du Pacte de Paris (Pacte Kellogg) du 27 août 1928, auquel la Chine, le Japon et les États-Unis ont souscrit. sont des fêtes."
À cette pression diplomatique, il faut ajouter les mesures timides prises par la Société des Nations en réponse au défi ouvert. Les personnalités prudentes (ou impuissantes) de la diplomatie européenne préféraient au contraire se cacher derrière des formules astucieuses selon lesquelles, avant de prendre position, il leur fallait attendre le rapport de la commission d'enquête (mais elles n'étaient pas pressées de en désigner un).
Ainsi, les Japonais obtinrent la liberté de poursuivre leur action militaire en dehors de la Mandchourie, sur le territoire chinois. Certains incidents entre Chinois et Japonais survenus dans le port de Shanghai servirent de prétexte au bombardement de la ville par des navires de guerre japonais, suivi du débarquement de troupes (fin janvier 1932). Pour la première fois, les forces armées des deux États sont entrées en conflit direct. Chinois
Partie 1. Vingt ans entre deux guerres
la résistance, plus encore que l'intervention de la Société des Nations, obligea les Japonais à mettre fin aux hostilités. Le 5 mai, les combats à Shanghai s'arrêtent et quelque temps plus tard, les Japonais retirent leurs troupes.
Ainsi, grâce à un affrontement militaire de diversion à Shanghai, les Japonais prirent le contrôle total de la Mandchourie. Le 18 février 1932, ils transformèrent la région en un État indépendant appelé Mandchoukouo et, après un certain temps, le nommèrent dirigeant. ancien empereur China Pu Yi, qui a perdu son trône très jeune et a maintenant reçu un nouveau nom, Kang Te. En septembre, un traité d'alliance a été signé entre le Japon et le Mandchoukouo, confirmant la dépendance du Mandchoukouo à l'égard du Japon. Ces événements ont eu un impact sur la situation déjà instable en Chine et sont devenus le signe avant-coureur des actions expansionnistes japonaises, qui se sont confirmées plusieurs années plus tard.
Bien que les Américains n'aient pas exprimé très clairement leur attitude face au fait accompli, ils ont confirmé la position de « non-reconnaissance » de celui-ci, partagée par la Société des Nations - le gouvernement japonais y est resté indifférent. Le rapport de la Commission Lytton, publié le 1er octobre, a révélé des faits déjà évidents : les intérêts japonais existants en Mandchourie méritaient d'être protégés, mais la création de l'État artificiel du Mandchoukouo était arbitraire de manière injustifiable, car il suffirait que la Chine accorde de larges autonomie à la Mandchourie, en maintenant sa souveraineté sur ce territoire.
Les historiens qui ont suivi ont loué l'objectivité du rapport de la commission, mais en réalité il aurait été plus juste de souligner les platitudes évidentes et inutiles qu'il contenait. Il est généralement assez facile de donner une évaluation formelle des faits accomplis, surtout s'il n'y a aucun désir de présenter, bien que faibles, mais des explications concrètes de ce qui s'est passé.
Aucune des puissances européennes n’était à ce moment-là en mesure d’agir contre le Japon. La Grande-Bretagne, trop préoccupée par la restauration de sa puissance impériale, n’entendait pas saper l’amitié traditionnelle qui la liait au Japon. Les Soviétiques avaient des préoccupations complètement différentes qui exigeaient leur attention, même si l’action japonaise représentait pour eux une réelle menace, puisqu’elle provenait de leur plus proche voisin. Les Américains, qui traversaient la pire période de la récession économique, étaient occupés par une campagne électorale qui exigeait une gestion prudente des questions de politique étrangère. Les Français auraient pu anticiper importance mondiale« rupture », qui constitue une menace pour l'ensemble du système de Versailles, mais ils ne le font bien sûr pas
Au début du 20e siècle Société humaine atteint haut niveau développement dans presque tous les domaines, à l’exception de la politique, notamment internationale. La mondialisation de la vie sociale exigeait une politique internationale et elle était dominée par le nationalisme.
La tâche consistant à organiser une gestion efficace du système des relations internationales est devenue primordiale. Mais la politique et le droit n’étaient pas prêts pour cela.
Tout cela ne pouvait que provoquer une réaction appropriée. Répandu mouvements sociaux qui a exigé des changements fondamentaux dans le mécanisme de gestion des relations internationales.
Ils ont joué un rôle important dans le fait qu'en 1919 les puissances victorieuses ont décidé de créer la Société des Nations et ont adopté son acte fondateur - le Statut. La première organisation politique générale a été créée pour assurer la paix et la coopération entre les États.
En 1919, la Société des Nations est créée, dont l'objectif principal est d'assurer la paix universelle et de promouvoir la coopération internationale entre les États.
La Société des Nations offrait d'importantes opportunités pour coordonner les efforts des États afin d'assurer la paix. Mais le nationalisme primitif a triomphé. Les intérêts nationaux de tous les États en ont souffert. Tout cela ne pouvait qu’affecter le droit international. Des mesures ont été prises pour définir les objectifs généraux et les principes fondamentaux du droit international. La réglementation de la coopération dans des domaines particuliers a été développée. La conscience juridique internationale s’est renforcée. Mais en général, les États n’ont pas manifesté d’intérêt pour l’amélioration du droit international.
La Société des Nations n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa tâche principale, liée à la Charte, liée à la résolution pacifique des conflits internationaux. Elle n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'attaque du Japon contre la Chine, de l'Italie contre l'Éthiopie, de l'Allemagne contre l'Autriche et la Tchécoslovaquie, de l'Italie contre l'Espagne, etc.
La Société des Nations était, par essence, l’expression extérieure des relations d’après-guerre dans le monde capitaliste. Cependant, le véritable gagnant, hégémon industriel et créancier de toute l’Europe, s’est avéré être les États-Unis, qui ne voulaient pas adhérer à la Société des Nations. Ainsi, deux groupes ont émergé dans le monde capitaliste : la Société des Nations, qui a dirigé le contrôle anglo-français des vaincus, et les États-Unis d'Amérique, non liés par ces accords.

L'expansion du Japon sur le continent a commencé dans les années 90 années XIX siècle. En vertu du traité de Shimonoseki en 1895, le Japon reçut Formose et les îles Pescadores. Selon le traité de Portsmouth de 1905, le Japon a reçu la péninsule du Guandong avec Port Arthur, la route du sud de la Mandchourie avec un droit de passage pour 35 ans, reconnaissance de la liberté d'action en Corée, dont l'annexion formelle a eu lieu en 1910.

Signature du traité de paix de Portsmouth. De gauche à droite : du côté russe (partie la plus éloignée du tableau) - G. A. Planson, K. D. Nabokov, S. Yu. Witte, R. R. Rosen, I. Ya. Korostovets ; du côté japonais (près d'une partie de la table) - Adachi (allemand), Ochiai, Komura (anglais), Takahira (anglais), Sato (japonais).
Le Japon s'orientait vers l'industrialisation. Mais le principal obstacle au « développement de l’industrie japonaise » était sa dépendance à l’égard des marchés étrangers pour les matières premières industrielles et alimentaires. Le Japon cherchait à compenser le manque de fer, de charbon, de pétrole, de coton et de riz en s'étendant sur le continent et en s'emparant des ressources naturelles de la Mandchourie et de la Chine proprement dite. Il s'implante de plus en plus dans le sud de la Mandchourie et en Chine, prenant possession des richesses en charbon et en minerais des provinces du Shandong, du Hubei, du Henan, du Shanxi, construisant des chemins de fer, des usines et des chantiers navals, suscitant des craintes dans d'autres pays industrialisés.

Pendant la guerre mondiale (8 janvier 1915), le Japon a présenté à la Chine « 21 exigences » - un ultimatum composé de 5 sections. Le premier exigeait le transfert de toutes les concessions allemandes au Japon, le second imposait un programme de subordination économique de la Mandchourie, le troisième les droits et privilèges exclusifs du Japon dans la gestion de l'usine de Hanyeping, le quatrième l'obligation de ne pas céder ou louer les ports. , baies et îles à une troisième puissance. côte de la Chine, dans la cinquième - l'invitation par la Chine de conseillers japonais dans le domaine de la gestion politique, financière et militaire, le transfert des institutions de police dans les points les plus importants de la Chine à la gestion commune des Japonais et des Chinois, l'établissement d'un arsenal nippo-chinois en Chine, et stipulait également la pénétration du Japon dans le bassin du fleuve Yangtze.
Malgré le fait qu'en 1917 la Chine est entrée dans la guerre mondiale aux côtés de l'Entente, les pays participants ont été contraints d'accepter les succès du Japon, concluant un certain nombre de traités secrets avec lui en 1917 ; même les États-Unis reconnaissaient que le Japon avait des intérêts « particuliers » dans les zones « adjacentes » au Japon. Mais déjà à cette époque, l’envoyé américain à Pékin déclarait : « Même si les puissances ont été contraintes de donner au Japon la liberté d’action en Chine, le jour du jugement viendra sans aucun doute. »

Ainsi, Guerre mondiale a donné au Japon Shandong avec Kiao-Chao, les îles du Pacifique qui appartenaient auparavant à l'Allemagne (Maréchal, Mariana, Caroline et Peleus), l'expansion et le renforcement des positions économiques dans le sud de la Mandchourie, de la Mongolie, des régions Chine du sud et dans les zones des mers du sud.
L'objectif du Japon en Mandchourie était de faire de cette dernière un objet de domination monopolistique japonaise. La question mandchoue est aussi, d’une manière générale, la question chinoise, qui, à son tour, occupe une place centrale dans le problème du Pacifique. La maîtrise de la Mandchourie est la clé de la maîtrise de la Chine du Nord adjacente, dont les centres industriels sont situés à proximité immédiate des frontières de la Mandchourie, et donc la clé de la domination sur l'ensemble de la Chine.
La lutte du Kuomintang (parti bourgeois) avec le Parti communiste chinois détourne l'attention des autorités chinoises du danger extérieur imminent. Les rumeurs sur l’imminence d’une opération militaire japonaise en Mandchourie commencèrent à se répandre au sein du gouvernement japonais dès le début de l’été 1931. En septembre, l'armée du Guandong a commencé à effectuer des manœuvres plus souvent et à correspondre par télégraphe et courrier avec le gouvernement japonais. Une situation alarmante s'est créée sur tout le chemin de fer de Mandchourie du Sud (Chemin de fer de Mandchourie du Sud).
Le 18 septembre, au nord de Moukden, une « explosion » s'est produite sur l'un des embranchements du chemin de fer du sud de Moscou. Le commandement militaire japonais a imputé toute la responsabilité de «l'explosion» aux fantassins chinois, dont les cadavres le lendemain ont été vêtus d'uniformes de sapeur. Le fait même des dommages a suscité des soupçons voies ferrées. Personne, à l'exception des soldats japonais, n'a examiné le site de « l'explosion ».

Au moment de l'incident, les troupes japonaises en Mandchourie comptaient 10 400 personnes ; après l'incident, les troupes japonaises sont arrivées en Mandchourie brigade militaire de Corée, soit 3 500 personnes. Les troupes japonaises se distinguaient par leurs bons officiers et leur discipline. Malgré les déclarations pacifiques de l'ambassadeur du Japon en URSS K. Hirota, le 18 septembre 1931, les troupes japonaises attaquent la Mandchourie (nord-est de la Chine) sans déclarer la guerre.
Dès les premiers jours, les Japonais ont occupé toute la zone adjacente aux chemins de fer de Mandchourie du Sud, Mukden-Andong et Girin-Changchun avec les villes de Mukden, Changchun, Girin, Andong et Yingkou (Nyuchwang).
Au moment de la prise de Moukden par les Japonais, le Conseil de la Société des Nations se réunissait à Genève, où se trouvaient des représentants du Japon et de la Chine. La Chine s'est immédiatement tournée vers la Société des Nations sur la base de l'article 11 de sa Charte. Le Conseil de la Société des Nations a décidé que les troupes japonaises devaient se retirer de Mandchourie au plus tard le 16 novembre. Le Japon n'a prêté aucune attention à ce geste de la Société des Nations.

Le 8 octobre a eu lieu le premier bombardement aérien de la ville de Jinzhou (à la frontière de la Mandchourie et de la Chine proprement dite), où le gouvernement de Moukden avait alors été évacué. En octobre et novembre, le commandement japonais a lancé des opérations contre le commandant des troupes chinoises dans la région de Qiqihar, le général Ma, afin d'étendre la portée de l'occupation japonaise vers le nord. Cette opération se termine par la prise de Qiqihar par les troupes japonaises le 18 novembre 1931 (sur la ligne Chinese Eastern Railway).
À partir de la seconde quinzaine de novembre, le principal théâtre d'opérations militaires s'est déplacé vers le sud de la Mandchourie. Les troupes japonaises ont commencé à avancer le long de la voie ferrée Mukden-Shanghaiguan dans le but de repousser les forces militaires de Zhang Xueliang situées ici hors de Mandchourie et en même temps d'écraser le mouvement naissant des partisans chinois.
Dans le même temps, la lutte victorieuse des partisans a contrecarré le projet japonais de s'emparer de la province de Zhehe et a contraint le commandement japonais à redistribuer ses forces pour la défense du chemin de fer du sud de Moscou et des zones les plus importantes, et à mener une longue et obstinée lutte. lutte à terme avec les partisans. Ce n'est qu'à la fin du mois de janvier que les Japonais ont réussi à débarrasser le chemin de fer du sud de Moscou de ses partisans, les poussant dans les régions montagneuses et libérant ainsi les principales forces de l'armée pour l'opération contre Harbin, qui, en plus de sa grande importance économique. , a servi de centre du mouvement anti-japonais.
Malgré l'énorme portée mouvement partisan, le manque de direction unifiée et d'organisation solide nous a empêché d'obtenir un succès décisif dans la lutte contre les Japonais.
Le 2 janvier 1932, les troupes japonaises occupent Jinzhou et mettent ainsi fin à l'existence du gouvernement de Moukden sur le territoire mandchou. Les détachements vaincus des troupes chinoises, enfermés dans le nord de la Mandchourie, devinrent plus tard des partisans ou passèrent du côté du Japon.
Le 5 janvier, les Japonais occupèrent le port de Holudao dans la baie de Liaodong et le 7 janvier, les troupes japonaises s'approchèrent de la Grande Muraille à Shanghai Guan et capturèrent la porte principale menant de la Mandchourie à la Chine proprement dite.
En janvier 1932, les préparatifs commencèrent pour la prise de la région de Harbin par les troupes japonaises. Comme avant la prise de la région de Qiqihar, le commandement japonais a d'abord utilisé les forces militaires de ses protégés, les généraux chinois, et lorsque ces forces n'étaient pas suffisantes, il a déplacé ses troupes. Avançant le long de la CER, les forces japonaises au nombre de 100 000 atteignirent Harbin en février et se répandirent vers l’est et l’ouest le long de la ligne CER. Par la suite, Harbin est devenue l'une des principales bases des forces d'occupation japonaises, d'où des expéditions ont été menées dans toutes les directions tout au long de l'année pour combattre les partisans chinois et les restes des troupes chinoises.

Avec l'occupation de Harbin, tous les principaux centres commerciaux et politiques de Mandchourie ainsi que l'ensemble du système ferroviaire tombèrent aux mains des Japonais. Les autorités militaires japonaises ont saisi des arsenaux, des dépôts d'armes, des avions et des fonds confisqués dans les transports, les entreprises industrielles et les banques.
Fin février, une conférence des nouveaux organes de gouvernement local fut convoquée à Moukden et le 1er mars 1932, la formation d'un État mandchou « indépendant », le « Mandchoukouo », fut officiellement annoncée.
Ce nouvel État avait des conseillers japonais dans chaque département et sa force militaire était l'armée japonaise. L'empereur déchu de la dynastie Mandchoue, Pu Yi, qui avait vécu de nombreuses années sous la protection japonaise, fut nommé à la tête de ce nouvel État.
Le 10 mars 1932, le Mandchoukouo envoya un avis aux puissances proposant leur reconnaissance. La reconnaissance du Mandchoukouo par les maîtres japonais n'a pas suivi immédiatement : la diplomatie japonaise a dû tester la situation internationale. Ce n'est que le 15 septembre 1932 que cette reconnaissance fut formalisée sous la forme du Protocole nippo-mandchou, selon lequel le Mandchoukouo confirmait tous les droits et intérêts du Japon sur le territoire de la Mandchourie et y autorisait la présence de troupes japonaises.
En s'emparant de la Mandchourie, le Japon a violé le traité des neuf puissances de Washington et le pacte Kellogg-Briand et violé ainsi la Charte de la Société des Nations, dont il était membre.
Conformément à la résolution de la Société des Nations du 10 décembre 1931, la Société envoya une commission dirigée par Lord Lytton pour étudier la situation en Extrême-Orient. Le rapport de la commission fut publié le 1er octobre 1932, lorsque le Mandchoukouo fut officiellement reconnu par le Japon.
Pour contrer les revendications japonaises sur la Mandchourie, la Commission Lytton a présenté son plan, basé sur le contrôle international de la Mandchourie, et le point le plus important de ce plan était le retrait de toutes les forces armées japonaises et chinoises de Mandchourie.
La tentative ci-dessus pour résoudre le problème mandchou a été présentée par la Commission Lytton, principalement sous l'influence américaine, et bien qu'elle ait porté un certain coup aux plans de l'impérialisme japonais, elle n'avait aucune chance d'être mise en œuvre.
En réponse au rapport Lytton, les milieux militaires japonais et l'ensemble de la presse japonaise ont déclaré que le Japon poursuivrait sa politique fermement établie en Mandchourie quelles que soient les conclusions de la Commission Lytton et que, quelle que soit l'attitude de la Société des Nations et des autres puissances à l'égard de la Mandchourie Question importante, la politique du Japon ne pouvait être ni ébranlée ni modifiée.
La discussion officielle sur le rapport Lytton commença en novembre 1932 et ne se termina qu'en mars 1933, lorsque les Japonais avaient déjà capturé la province de Rehe, avec les « recommandations » suivantes de la Société des Nations sur la question mandchoue :
1. Le règlement de cette question doit avoir lieu sur la base de la Charte de la Société des Nations, du Pacte Kellogg et du Traité des Neuf Puissances de Washington.
2. Les troupes japonaises situées en dehors de la zone ferroviaire du sud de Moscou doivent être évacuées, car la souveraineté sur ce territoire appartient à la Chine.
3. Une organisation gouvernementale dotée d'une large autonomie reconnaissant la souveraineté chinoise devrait être établie en Mandchourie, et les droits et intérêts particuliers du Japon devraient être pris en compte.
4. La Chine et le Japon devraient entamer des négociations pour résoudre cette question au sein d'un comité spécial composé de représentants des membres de la Ligue et avec la participation des États-Unis et de l'URSS.
5. Les membres de la Société des Nations doivent continuer à refuser la reconnaissance du Mandchoukouo.

Le gouvernement soviétique refusa d'adhérer à la résolution de la Société des Nations et de participer au Comité consultatif, soulignant dans sa réponse du 7 mars 1933 que la majorité des États dont les représentants seraient inclus dans le Comité consultatif n'entretenaient aucune relation avec l'URSS. et, par conséquent, y étaient hostiles - il est donc peu probable qu'un tel comité soit en mesure de remplir la tâche de coordination des actions avec l'Union soviétique.
Les États-Unis ont accepté de coopérer avec le Comité, mais n'ont pas pu nommer un représentant ayant les fonctions de membre du Comité et ont chargé leur envoyé en Suisse de suivre l'évolution de l'affaire.
Quant au Japon, se rendant compte que les États-Unis évitaient par tous les moyens possibles un affrontement direct avec le Japon et que d'autres puissances ne soutiendraient pas le Japon afin de préserver le prestige de la Société des Nations, il se retira de la Société des Nations en 1933. , confiant que son retrait n'entraînerait pas l'application d'aucune sanction de nature économique ou militaire.
Ainsi, la décision de la Société des Nations n'a rien changé à la situation en Extrême-Orient et n'a pas arrêté l'offensive japonaise qui s'est déroulée immédiatement après l'adoption de la résolution de la Société des Nations.
La lutte du Kuomintang (parti bourgeois) avec le Parti communiste chinois a détourné l’attention des diplomates chinois et des agents du contre-espionnage chinois du danger extérieur imminent. Les rumeurs sur l’imminence d’une opération militaire japonaise en Mandchourie commencèrent à se répandre au sein du gouvernement japonais dès le début de l’été 1931. En septembre, l'armée du Guandong a commencé à effectuer des manœuvres plus souvent et à correspondre par télégraphe et courrier avec le gouvernement japonais. Une situation alarmante s'est créée sur tout le chemin de fer de Mandchourie du Sud (Chemin de fer de Mandchourie du Sud).
Le 18 septembre, au nord de Moukden, une « explosion » s'est produite sur l'un des embranchements du chemin de fer du sud de Moscou. Le commandement militaire japonais a imputé toute la responsabilité de «l'explosion» aux fantassins chinois ordinaires, dont les cadavres le lendemain ont été vêtus d'uniformes de sapeur. Le fait même des dommages causés aux voies ferrées a éveillé les soupçons. Personne, à l'exception des soldats japonais, n'a examiné le site de « l'explosion ».
Au moment de l'incident, les troupes japonaises en Mandchourie comptaient 10 400 personnes ; après l'incident, une brigade militaire japonaise de 3 500 personnes est arrivée en Mandchourie en provenance de Corée. Les troupes japonaises se distinguaient par leurs bons officiers et leur discipline. Malgré les déclarations pacifiques de l'ambassadeur du Japon en URSS K. Hirota, le 18 septembre 1931, les troupes japonaises attaquent la Mandchourie (nord-est de la Chine) sans déclarer la guerre.
La défaite de près de cent mille armées du dirigeant mandchou Zhang Xueliang par les troupes japonaises et leur mouvement rapide vers la frontière soviétique ne pouvaient que provoquer une réponse à Moscou. Tard dans la soirée du 19 septembre, le commissaire adjoint du peuple aux Affaires étrangères L.M. Karakhan a convoqué l'ambassadeur du Japon et lui a demandé des informations sur les événements de Mandchourie. Les troupes japonaises occupaient alors Moukden, un centre majeur du sud de la Mandchourie. Le commissaire adjoint du peuple a indiqué à l'ambassadeur que Moscou attachait « la plus grande importance » aux événements de Mandchourie. K. Hirota a promis de demander des instructions à son gouvernement et d'informer L.M. Karakhan sur les événements en Mandchourie. Le temps a passé, mais aucune information n’a été reçue du côté japonais.
28 octobre 1931 ambassadeur du Japonà Moscou a fait une déclaration officielle disant que le colis serait « indésirable » troupes soviétiques sur le CER (China Eastern Railway), car cela aggraverait la situation sur le chemin de fer, ce qui obligerait le Japon à prendre « les mesures de protection nécessaires ». La partie japonaise a accusé l'URSS d'aider les troupes chinoises en fournitures et en armes. L.M. Karakhan, dans un communiqué publié le lendemain, a réfuté ces affirmations, affirmant que l'URSS adhérait à une politique de non-intervention en Chine. Le commissaire adjoint du peuple a souligné que l'Union soviétique respectait les traités internationaux conclus avec la partie chinoise.
Mais l’Union soviétique a souvent fourni une assistance aux unités individuelles de l’armée chinoise luttant contre les envahisseurs japonais. De telles mesures prises par Moscou s'expliquaient par la perspective possible d'une extension des hostilités à l'Extrême-Orient soviétique. Ainsi, la politique de non-intervention a été violée, mais pas au détriment des intérêts de la Chine et de l’URSS. Les autorités japonaises ont exigé à plusieurs reprises que le gouvernement soviétique leur remette les soldats chinois. Mais Moscou, entrant dans un conflit diplomatique avec Tokyo, a refusé de répondre à ces exigences. Par exemple, l'armée chinoise dirigée par les généraux Su Bingwen, Li De et d'autres, pressée par les Japonais, a été autorisée à franchir la frontière soviéto-chinoise dans la zone de l'Art. Se défendre. Plus de 9 000 soldats chinois se retrouvent sur le territoire soviétique.
Chiang Kai-shek a un jour admis qu’il existait en Chine une croyance largement répandue selon laquelle les Chinois ne pouvaient « s’opposer au Japon qu’en alliance avec la Russie soviétique ».
Le gouvernement chinois s’est tourné vers la Société des Nations pour obtenir de l’aide, mais cela n’a abouti à rien. Le Japon n’annexe pas directement la Mandchourie, mais l’y forme le 1er mars 1932. État fantoche Mandchoukouo. Le gouvernement japonais reconnut le nouvel « État » et assuma la responsabilité de sa défense.
Au Japon, certains hommes politiques pensaient que l’Union soviétique se préparait à prendre le parti de la Chine dès qu’elle concentrerait un groupe militaire puissant en Extrême-Orient. En réalité, cela ne répondait pas aux intérêts nationaux de l’URSS. Le gouvernement soviétique avait tort au début (c’est bien d’en parler pour nous qui vivons dans ce pays). début XXI siècle) considérait les événements de Mandchourie comme le résultat d'une conspiration préliminaire entre le Japon et d'autres puissances. Mais cela pourrait très bien être le cas.
Littérature
- Politique étrangère de l'URSS. Tome III. 1925 – 1934 Recueil de documents. M., 1945.
- Galenovitch Yu.M. Jiang Zhongzhen, ou l'inconnu Chiang Kai-shek. M., 2002.
- Histoire de la guerre sur Océan Pacifique. Tome 1. M., 1957.
- Histoire de la Chine. M., 1998.
- Kapitsa M.S. Relations soviéto-chinoises 1931 – 1945 M., 1954.
- Crise et guerre. Les relations internationales au centre et à la périphérie du système mondial dans les années 30 et 40. M., 1998.
- Mileksetov A.V. Capitale bureaucratique en Chine. M., 1972.
- Des guerres tacites. Histoire des services spéciaux 1919 - 1945. Volume 2. Odessa, 2007.
- Sokolov V.V. Aux postes de combat sur le front diplomatique. Vie et œuvre de L.M. Karakhana. M., 1983.
- Jacob Kovalio. La perception japonaise de la politique étrangère stalinienne au début des années 1930. // Journal d'histoire contemporaine. 1984. Vol 19, n° 2.