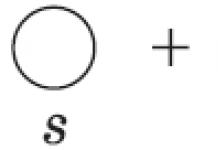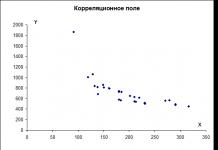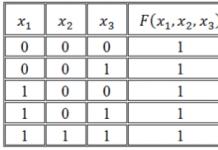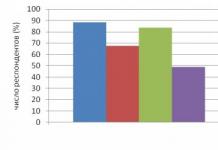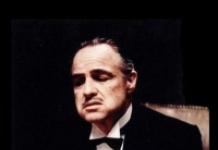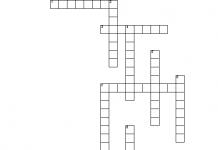En bref, la guerre de 1812 est devenue l’événement le plus difficile et le plus important du XIXe siècle pour l’Empire russe. Dans l’historiographie russe, on l’appelle la Guerre patriotique de 1812.
Comment se fait-il que la France et la Russie, qui entretenaient des relations amicales et alliées depuis de nombreuses années, soient devenues adversaires et aient lancé des opérations militaires l’une contre l’autre ?
La raison principale de tous les conflits militaires de cette époque impliquant la France, y compris la guerre de 1812, était en bref liée aux ambitions impériales de Napoléon Bonaparte. Arrivé au pouvoir grâce à la Grande Révolution française, il ne cache pas sa volonté d'étendre l'influence de l'Empire français au plus grand nombre de pays possible. Une immense ambition et d'excellentes qualités de commandant et de diplomate ont fait de Napoléon le dirigeant de presque toute l'Europe en peu de temps. Insatisfaite de cet état de fait, la Russie quitte l'alliance avec la France et rejoint l'Angleterre. Les anciens alliés sont donc devenus des ennemis.
Puis, lors des guerres infructueuses des Alliés contre les troupes de Napoléon, l'Empire russe fut contraint d'accepter un accord de paix avec la France. C'est ainsi que fut signée la Paix de Tilsit. Sa principale condition était que la Russie maintienne le blocus continental de l'Angleterre, que Napoléon voulait ainsi affaiblir. Les autorités de l'Empire russe voulaient profiter de cette trêve comme d'une opportunité pour accumuler des forces, car tout le monde comprenait la nécessité de combattre davantage Napoléon.
Mais le blocus a menacé l’économie russe, et les autorités russes ont alors eu recours à une astuce. Ils commencèrent à commercer avec des pays neutres, par l'intermédiaire desquels ils continuèrent à commercer avec l'Angleterre, en les utilisant comme intermédiaires. Dans le même temps, la Russie n’a pas formellement violé les termes de la paix avec la France. Elle était indignée, mais ne pouvait rien faire.
Guerre de 1812, brièvement sur les raisons
De nombreuses raisons ont permis de mener des opérations militaires directement entre la France et la Russie :
1. Le non-respect par la Russie des termes du Traité de paix de Tilsit ;
2. Refus de marier d’abord Catherine, la sœur d’Alexandre Ier, puis Anna, à l’empereur de France ;
3. La France a violé les accords de la paix de Tilsit en poursuivant l'occupation de la Prusse.
En 1812, la guerre devint inévitable pour les deux pays. La France et la Russie s’y sont préparées à la hâte, rassemblant autour d’elles des alliés. L'Autriche et la Prusse étaient du côté de la France. Les alliés de la Russie sont la Grande-Bretagne, la Suède et l'Espagne.
Progression des hostilités
La guerre commença le 12 juin 1812 avec le transfert de l'armée de Napoléon de l'autre côté du fleuve Neman. Les troupes russes étaient divisées en trois parties, l'emplacement exact du passage de la frontière par l'ennemi n'étant pas connu. Les troupes françaises l'ont traversé dans la zone de l'armée sous le commandement de Barclay de Tolly. Constatant l'énorme supériorité numérique de l'ennemi et essayant de préserver ses forces, il ordonna la retraite. Les armées de Barclay de Tolly et de Bagration parviennent à s'unir près de Smolensk. C'est là que s'est déroulée la première bataille de cette guerre. Les troupes russes n'ont pas réussi à défendre la ville et ont poursuivi leur retraite plus profondément dans le pays en août.
Après l'échec des troupes russes près de Smolensk, le peuple entre dans la lutte contre l'armée de Napoléon. Les actions partisanes actives des habitants du pays contre l'ennemi ont commencé. Le mouvement partisan apporta un énorme soutien à l'armée dans la lutte contre les troupes françaises.
En août, le général M. Kutuzov devient commandant en chef des troupes russes. Il approuva la tactique de ses prédécesseurs et poursuivit la retraite ordonnée de l'armée vers Moscou.
Près de Moscou, près du village de Borodino, a eu lieu la bataille la plus importante de cette guerre, démystifiant complètement le mythe de l'invincibilité de Napoléon - la bataille de Borodino. Les forces des deux armées étaient alors presque identiques.
À la suite de la bataille de Borodino, aucune des deux parties ne pouvait se qualifier de vainqueur, mais les troupes françaises étaient gravement épuisées.
En septembre, conformément à la décision de Koutouzov, avec laquelle Alexandre Ier était d'accord, les troupes russes ont quitté Moscou. Des gelées commencèrent, auxquelles les Français n'étaient pas habitués. Quasiment enfermée à Moscou, l'armée de Napoléon était complètement démoralisée. Les troupes russes, au contraire, se reposèrent et reçurent un soutien sous forme de nourriture, d'armes et de volontaires.
Napoléon décide de battre en retraite, qui se transforme bientôt en fuite. Les troupes russes obligent les Français à battre en retraite le long de la route de Smolensk qu'ils avaient entièrement détruite.
En décembre 1812, l'armée sous le commandement de Napoléon quitta finalement le territoire russe et la guerre de 1812 se termina par la victoire complète du peuple russe.
Résultats
À la suite de la guerre de 1812, de nombreuses personnes sont mortes et l’économie et la culture russes ont subi d’énormes dégâts.
La victoire dans la guerre a uni la société russe, a provoqué une prise de conscience nationale et a conduit au développement d'un mouvement social et d'une pensée sociale, y compris d'opposition. Les décembristes se faisaient appeler « les enfants de 1812 ».
D'autre part, cela a renforcé les cercles dirigeants du pays dans leurs réflexions sur la force, voire la supériorité du système social russe et, par conséquent, sur l'inutilité des réformes, renforçant ainsi la tendance conservatrice de la politique intérieure.
Les troupes russes ont marché victorieusement à travers l'Europe et sont entrées triomphalement dans Paris aux côtés des armées des Alliés, ce qui a exceptionnellement élevé l'autorité internationale de la Russie et en a fait la puissance militaire la plus puissante.
Grâce à de nouvelles acquisitions, le territoire de la Russie s'est élargi et sa population a augmenté. Mais, ayant inclus les terres de la « Grande Pologne » dans sa composition, elle fut confrontée pendant de nombreuses années à un problème polonais très douloureux, dû à la lutte incessante du peuple polonais pour l'indépendance nationale.
Sainte-Alliance - une union conservatrice de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche, créée dans le but de maintenir l'ordre international établi au Congrès de Vienne (1815). La déclaration d'assistance mutuelle de tous les souverains chrétiens, signée le 14 (26) septembre 1815, fut ensuite progressivement rejointe par tous les monarques de l'Europe continentale, à l'exception du pape et du sultan turc. N'étant pas, au sens exact du terme, un accord formalisé entre les puissances qui leur imposerait certaines obligations, la Sainte-Alliance est néanmoins entrée dans l'histoire de la diplomatie européenne comme « une organisation cohésive avec un pouvoir clérical bien défini. idéologie monarchiste, créée sur la base de la suppression des sentiments révolutionnaires, là où ils ne se sont jamais manifestés. »
Après le renversement de Napoléon et le rétablissement de la paix paneuropéenne, parmi les puissances qui se considéraient entièrement satisfaites de la distribution des « récompenses » au Congrès de Vienne, le désir de préserver l'ordre international établi est apparu et s'est renforcé, et les moyens car c'était l'union permanente des souverains européens et la convocation périodique de congrès internationaux. Mais comme cet objectif a été contredit par les mouvements nationaux et révolutionnaires des peuples en quête de formes d’existence politique plus libres, une telle aspiration a rapidement acquis un caractère réactionnaire.
L'initiateur de la Sainte-Alliance était l'empereur russe Alexandre Ier, même si lors de la rédaction de l'acte de la Sainte-Alliance, il considérait toujours qu'il était possible de favoriser le libéralisme et d'accorder une constitution au Royaume de Pologne. L'idée d'une Union est née en lui, d'une part, sous l'influence de l'idée de devenir un artisan de la paix en Europe en créant une Union qui éliminerait même la possibilité d'affrontements militaires entre États, et d'autre part main, sous l'influence de l'humeur mystique qui s'est emparée de lui. Ce dernier explique aussi l'étrangeté du libellé même du traité d'union, qui n'était semblable ni dans la forme ni dans le contenu aux traités internationaux, ce qui obligeait de nombreux spécialistes du droit international à n'y voir qu'une simple déclaration des monarques qui l'avaient signé. .
Signé le 14 (26) septembre 1815 par trois monarques - l'empereur François Ier d'Autriche, le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse et l'empereur Alexandre Ier, il n'a d'abord suscité rien d'autre que de l'hostilité à son égard dans les deux premiers.
Le contenu de cet acte était extrêmement vague et flexible, et on pouvait en tirer les conclusions pratiques les plus diverses, mais son esprit général ne contredisait pas, mais favorisait plutôt l'humeur réactionnaire des gouvernements d'alors. Sans parler de la confusion d'idées appartenant à des catégories complètement différentes, la religion et la morale y déplacent complètement le droit et la politique des domaines qui appartiennent sans aucun doute à ces dernières. Construit sur la base légitime de l'origine divine du pouvoir monarchique, il établit une relation patriarcale entre les souverains et les peuples, et les premiers sont chargés de l'obligation de gouverner dans un esprit « d'amour, de vérité et de paix », tandis que les seconds ne doivent que obéissez : le document ne parle pas du tout des droits du peuple par rapport aux mentions du pouvoir.
Enfin, obligeant les souverains à toujours « se prêter mutuellement assistance, renforcement et assistance », la loi ne dit rien sur exactement dans quels cas et sous quelle forme cette obligation doit être exécutée, ce qui a permis de l'interpréter dans le sens où l'assistance est obligatoire dans tous les cas, dans les cas où les sujets feront preuve de désobéissance à leurs souverains « légitimes ».
C’est exactement ce qui s’est produit : le caractère chrétien même de la Sainte-Alliance a disparu et il ne s’agissait que de la répression de la révolution, quelle que soit son origine. Tout cela explique le succès de la Sainte-Alliance : bientôt tous les autres souverains et gouvernements européens la rejoignirent, sans exclure la Suisse et les villes libres allemandes ; Seuls le prince régent anglais et le pape n'y souscrivirent pas, ce qui ne les empêcha pas d'être guidés par les mêmes principes dans leur politique ; seul le sultan turc ne fut pas accepté dans la Sainte-Alliance en tant que souverain non chrétien.
Signe du caractère de l’époque, la Sainte-Alliance fut le principal organe de la réaction paneuropéenne contre les aspirations libérales. Son importance pratique a été exprimée dans les résolutions d'un certain nombre de congrès (Aix-la-Chapelle, Troppaus, Laibach et Vérone), au cours desquels le principe d'intervention dans les affaires intérieures d'autres États a été pleinement développé dans le but de réprimer par la force tous les mouvements nationaux et révolutionnaires. et maintenir le système existant avec ses tendances absolutistes et cléricales-aristocratiques.
La guerre patriotique de 1812 a commencé le 12 juin. Ce jour-là, les troupes de Napoléon ont traversé le fleuve Néman, déclenchant les guerres entre les deux couronnes de France et de Russie. Cette guerre dura jusqu'au 14 décembre 1812, se terminant par la victoire complète et inconditionnelle des forces russes et alliées. Il s'agit d'une page glorieuse de l'histoire russe, que nous examinerons en référence aux manuels d'histoire officiels de la Russie et de la France, ainsi qu'aux livres des bibliographes Napoléon, Alexandre 1er et Koutouzov, qui décrivent en détail les événements qui se déroulent à ce moment.
➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤Début de la guerre
Causes de la guerre de 1812
Les causes de la guerre patriotique de 1812, comme toutes les autres guerres de l'histoire de l'humanité, doivent être considérées sous deux aspects : les causes du côté de la France et les causes du côté de la Russie.
Raisons de France
En quelques années seulement, Napoléon a radicalement changé ses idées sur la Russie. Si, arrivé au pouvoir, il écrivait que la Russie était son seul allié, alors en 1812, la Russie était devenue une menace pour la France (considérez l'empereur). À bien des égards, cela a été provoqué par Alexandre 1er lui-même. C’est pourquoi la France a attaqué la Russie en juin 1812 :
- Violation des accords de Tilsit : assouplissement du blocus continental. Comme vous le savez, le principal ennemi de la France à cette époque était l'Angleterre, contre laquelle le blocus était organisé. La Russie y a également participé, mais en 1810, le gouvernement a adopté une loi autorisant le commerce avec l'Angleterre par l'intermédiaire d'intermédiaires. Cela a effectivement rendu l'ensemble du blocus inefficace, ce qui a complètement sapé les plans de la France.
- Refus dans le mariage dynastique. Napoléon cherchait à se marier avec la cour impériale russe afin de devenir « l’oint de Dieu ». Cependant, en 1808, il se vit refuser le mariage avec la princesse Catherine. En 1810, il se vit refuser le mariage avec la princesse Anna. En conséquence, en 1811, l’empereur français épousa une princesse autrichienne.
- Transfert des troupes russes à la frontière avec la Pologne en 1811. Dans la première moitié de 1811, Alexandre 1er ordonna le transfert de 3 divisions vers les frontières polonaises, craignant un soulèvement de la Pologne qui pourrait s'étendre aux terres russes. Cette démarche était considérée par Napoléon comme une agression et une préparation à la guerre contre les territoires polonais, alors déjà subordonnés à la France.
Soldats! Une nouvelle et deuxième guerre polonaise commence ! La première s'est terminée à Tilsit. Là, la Russie a promis d'être un allié éternel de la France dans la guerre avec l'Angleterre, mais n'a pas tenu sa promesse. L'empereur russe ne veut donner d'explications sur ses actes que lorsque les aigles françaises franchiront le Rhin. Pensent-ils vraiment que nous sommes devenus différents ? Ne sommes-nous vraiment pas les gagnants d’Austerlitz ? La Russie a présenté à la France un choix : la honte ou la guerre. Le choix est évident ! Allons-y, traversons le Néman ! Le deuxième hurlement polonais sera glorieux pour les armes françaises. Elle apportera un messager à l’influence destructrice de la Russie sur les affaires européennes.
Ainsi commença une guerre de conquête pour la France.
Raisons de Russie
La Russie avait également des raisons impérieuses de participer à la guerre, qui s’est avérée être une guerre de libération pour l’État. Les principales raisons sont les suivantes :

- Des pertes importantes pour toutes les couches de la population dues à la rupture des échanges commerciaux avec l’Angleterre. Les opinions des historiens sur ce point diffèrent, car on pense que le blocus n'a pas affecté l'État dans son ensemble, mais exclusivement son élite, qui, en raison du manque de possibilités de commercer avec l'Angleterre, a perdu de l'argent.
- L'intention de la France de recréer le Commonwealth polono-lituanien. En 1807, Napoléon créa le duché de Varsovie et chercha à recréer l'ancien État à sa taille réelle. Peut-être que ce n'était qu'en cas de saisie de ses terres occidentales par la Russie.
- Violation par Napoléon de la paix de Tilsit. L'un des principaux critères pour la signature de cet accord était que la Prusse devait être débarrassée des troupes françaises, mais cela n'a jamais été fait, bien qu'Alexandre 1er le rappelle constamment.
Depuis longtemps, la France tente d'empiéter sur l'indépendance de la Russie. Nous avons toujours essayé d'être doux, dans l'espoir de détourner ses tentatives de s'emparer de nous. Malgré notre désir de maintenir la paix, nous sommes obligés de rassembler des troupes pour défendre notre patrie. Il n’y a aucune possibilité de résolution pacifique du conflit avec la France, ce qui signifie qu’il ne reste plus qu’une chose : défendre la vérité, défendre la Russie contre les envahisseurs. Je n'ai pas besoin de rappeler aux commandants et aux soldats le courage, il est dans nos cœurs. Le sang des vainqueurs, le sang des Slaves coule dans nos veines. Soldats! Vous défendez le pays, défendez la religion, défendez la patrie. Je suis d'accord. Dieu est avec nous.
Rapport de forces et de moyens au début de la guerre
La traversée du Néman par Napoléon a eu lieu le 12 juin, avec 450 000 personnes à sa disposition. Vers la fin du mois, 200 000 personnes supplémentaires l’ont rejoint. Si l'on tient compte du fait qu'à cette époque il n'y avait pas eu de pertes importantes des deux côtés, le nombre total de l'armée française au début des hostilités en 1812 était de 650 000 soldats. Il est impossible de dire que les Français constituaient 100 % de l'armée, puisque l'armée combinée de presque tous les pays européens a combattu aux côtés de la France (France, Autriche, Pologne, Suisse, Italie, Prusse, Espagne, Hollande). Cependant, ce sont les Français qui constituent la base de l'armée. C'étaient des soldats confirmés qui avaient remporté de nombreuses victoires auprès de leur empereur.
La Russie, après la mobilisation, comptait 590 000 soldats. Initialement, l'armée comptait 227 000 personnes, et elles étaient divisées sur trois fronts :
- Nord - Première Armée. Commandant : Mikhaïl Bogdanovitch Barclay de Tolly. Nombre de personnes : 120 mille personnes. Ils étaient situés au nord de la Lituanie et couvraient Saint-Pétersbourg.
- Centrale - Deuxième Armée. Commandant - Piotr Ivanovitch Bagration. Nombre de personnes : 49 mille personnes. Ils étaient situés dans le sud de la Lituanie, couvrant Moscou.
- Sud - Troisième Armée. Commandant - Alexandre Petrovitch Tormasov. Nombre de personnes : 58 mille personnes. Ils étaient situés à Volyn et couvraient l'attaque de Kiev.
En Russie également, des détachements de partisans étaient actifs, dont le nombre atteignait 400 000 personnes.
La première étape de la guerre - L'offensive des troupes de Napoléon (juin-septembre)
A 6 heures du matin le 12 juin 1812, la guerre patriotique contre la France napoléonienne commença pour la Russie. Les troupes de Napoléon traversent le Néman et se dirigent vers l'intérieur des terres. La direction principale de l’attaque était censée être Moscou. Le commandant lui-même a déclaré : « Si je prends Kiev, je soulèverai les Russes par les pieds, si je prends Saint-Pétersbourg, je les prendrai à la gorge, si je prends Moscou, je frapperai le cœur de la Russie ».

L'armée française, commandée par de brillants commandants, recherchait une bataille générale, et le fait qu'Alexandre 1 divise l'armée en 3 fronts fut très bénéfique pour les agresseurs. Cependant, au stade initial, Barclay de Tolly a joué un rôle décisif en donnant l'ordre de ne pas engager de bataille avec l'ennemi et de se retirer plus profondément dans le pays. Cela était nécessaire pour unir les forces et renforcer les réserves. En se retirant, les Russes ont tout détruit : ils ont tué du bétail, empoisonné l'eau, incendié les champs. Au sens littéral du terme, les Français ont avancé sur les cendres. Plus tard, Napoléon s'est plaint que le peuple russe menait une guerre ignoble et ne se comportait pas selon les règles.
Direction nord
Napoléon envoya à Saint-Pétersbourg 32 000 personnes dirigées par le général MacDonald. La première ville sur cette route fut Riga. Selon le plan français, MacDonald était censé s'emparer de la ville. Connectez-vous avec le général Oudinot (il avait 28 000 personnes à sa disposition) et passez à autre chose.
La défense de Riga était commandée par le général Essen avec 18 000 soldats. Il brûla tout autour de la ville, et la ville elle-même était très bien fortifiée. À ce moment-là, MacDonald avait capturé Dinaburg (les Russes ont abandonné la ville au début de la guerre) et n'a pris aucune autre action active. Il comprend l'absurdité de l'assaut sur Riga et attend l'arrivée de l'artillerie.
Le général Oudinot occupa Polotsk et tenta de séparer le corps de Wittgenstein de l'armée de Barclay de Tolly. Cependant, le 18 juillet, Wittgenstein lance un coup inattendu sur Oudinot, qui n'est sauvé de la défaite que par l'arrivée du corps de Saint-Cyr. En conséquence, l'équilibre est revenu et aucune opération offensive active n'a été menée dans la direction du nord.
Direction sud
Le général Ranier, avec une armée de 22 000 personnes, était censé agir en direction du sud, bloquant l'armée du général Tormasov, l'empêchant de se connecter avec le reste de l'armée russe.
Le 27 juillet Tormasov a encerclé la ville de Kobryn, où se sont rassemblées les principales forces de Ranier. Les Français ont subi une terrible défaite: en un jour, 5 000 personnes ont été tuées dans la bataille, ce qui a contraint les Français à battre en retraite. Napoléon se rendit compte que la direction sud de la guerre patriotique de 1812 était en danger d'échec. Il y transféra donc les troupes du général Schwarzenberg, au nombre de 30 000 personnes. En conséquence, le 12 août, Tormasov a été contraint de se retirer à Loutsk et d'y prendre la défense. Par la suite, les Français n'ont entrepris aucune action offensive active dans la direction sud. Les principaux événements se sont déroulés en direction de Moscou.
Le déroulement des événements de la société offensive
Le 26 juin, l'armée du général Bagration s'avança de Vitebsk, dont Alexandre 1er s'était donné pour mission d'engager la bataille avec les principales forces ennemies afin de les épuiser. Tout le monde réalisa l'absurdité de cette idée, mais ce n'est que le 17 juillet qu'il fut finalement possible de dissuader l'empereur de cette idée. Les troupes commencèrent à se retirer vers Smolensk.
Le 6 juillet, le grand nombre des troupes de Napoléon apparaît clairement. Pour éviter que la guerre patriotique ne s'éternise, Alexandre Ier signe un décret portant création d'une milice. Littéralement, tous les résidents du pays y sont inscrits - il y a au total environ 400 000 volontaires.
Le 22 juillet, les armées de Bagration et de Barclay de Tolly s'unissent près de Smolensk. Le commandement de l'armée unie fut repris par Barclay de Tolly, qui disposait de 130 000 soldats, tandis que la ligne de front de l'armée française comptait 150 000 soldats.

Le 25 juillet, un conseil militaire s'est tenu à Smolensk, au cours duquel a été discutée la question de l'acceptation de la bataille afin de lancer une contre-offensive et de vaincre Napoléon d'un seul coup. Mais Barclay s'est prononcé contre cette idée, réalisant qu'une bataille ouverte avec un ennemi, un brillant stratège et tacticien, pourrait conduire à un échec monumental. En conséquence, l’idée offensive n’a pas été mise en œuvre. Il a été décidé de se retirer davantage, à Moscou.
Le 26 juillet commence la retraite des troupes, que le général Neverovsky était censé couvrir en occupant le village de Krasnoye, fermant ainsi le contournement de Smolensk pour Napoléon.
Le 2 août, Murat et un corps de cavalerie tentent de percer les défenses de Neverovsky, mais en vain. Au total, plus de 40 attaques ont été lancées avec l'aide de la cavalerie, mais il n'a pas été possible d'obtenir le résultat souhaité.
Le 5 août est l'une des dates importantes de la guerre patriotique de 1812. Napoléon commença l'assaut sur Smolensk, capturant les banlieues le soir. Cependant, la nuit, il fut chassé de la ville et l'armée russe poursuivit sa retraite massive de la ville. Cela a provoqué une tempête de mécontentement parmi les soldats. Ils pensaient que s'ils parvenaient à chasser les Français de Smolensk, il serait alors nécessaire de les détruire là-bas. Ils ont accusé Barclay de lâcheté, mais le général n'a mis en œuvre qu'un seul plan : épuiser l'ennemi et mener une bataille décisive lorsque l'équilibre des forces était du côté de la Russie. A cette époque, les Français avaient tout l'avantage.

Le 17 août, Mikhaïl Illarionovitch Koutouzov arrive dans l'armée et en prend le commandement. Cette candidature n'a soulevé aucune question, puisque Koutouzov (un élève de Souvorov) était très respecté et était considéré comme le meilleur commandant russe après la mort de Souvorov. Arrivé dans l'armée, le nouveau commandant en chef a écrit qu'il n'avait pas encore décidé quoi faire ensuite: "La question n'est pas encore résolue: soit perdre l'armée, soit abandonner Moscou".
Le 26 août eut lieu la bataille de Borodino. Son résultat suscite encore de nombreuses questions et controverses, mais il n’y avait alors pas de perdant. Chaque commandant a résolu ses propres problèmes : Napoléon a ouvert la voie à Moscou (le cœur de la Russie, comme l'a écrit l'empereur de France lui-même), et Koutouzov a pu infliger de lourds dégâts à l'ennemi, marquant ainsi le tournant initial de la bataille de 1812.
Le 1er septembre est un jour important, décrit dans tous les manuels d'histoire. Un conseil militaire s'est tenu à Fili, près de Moscou. Kutuzov a rassemblé ses généraux pour décider quoi faire ensuite. Il n'y avait que deux options : battre en retraite et rendre Moscou, ou organiser une deuxième bataille générale après Borodino. La plupart des généraux, sur la vague du succès, réclament une bataille afin de vaincre Napoléon au plus vite. Kutuzov lui-même et Barclay de Tolly se sont opposés à cette évolution des événements. Le conseil militaire de Fili s’est terminé par la phrase de Koutouzov : « Tant qu’il y a une armée, il y a de l’espoir. Si nous perdons l’armée près de Moscou, nous perdrons non seulement l’ancienne capitale, mais aussi toute la Russie.»
2 septembre - suite aux résultats du conseil militaire des généraux, qui s'est tenu à Fili, il a été décidé qu'il était nécessaire de quitter l'ancienne capitale. L'armée russe se retira et Moscou elle-même, avant l'arrivée de Napoléon, selon de nombreuses sources, fut soumise à de terribles pillages. Cependant, ce n’est même pas l’essentiel. En retraite, l'armée russe met le feu à la ville. Moscou en bois a brûlé près des trois quarts. Le plus important est que tous les entrepôts alimentaires ont été littéralement détruits. Les raisons de l'incendie de Moscou résident dans le fait que les Français n'obtiendraient rien qui puisse être utilisé par les ennemis pour se nourrir, se déplacer ou à d'autres égards. En conséquence, les troupes agressives se sont retrouvées dans une position très précaire.
La deuxième étape de la guerre - la retraite de Napoléon (octobre - décembre)
Ayant occupé Moscou, Napoléon considérait la mission accomplie. Les bibliographes du commandant écrivirent plus tard qu'il était fidèle : la perte du centre historique de la Russie briserait l'esprit victorieux et les dirigeants du pays devaient venir vers lui pour lui demander la paix. Mais cela ne s'est pas produit. Kutuzov s'est installé avec son armée à 80 kilomètres de Moscou près de Tarutin et a attendu que l'armée ennemie, privée de ravitaillement normal, s'affaiblisse et opère elle-même un changement radical dans la guerre patriotique. Sans attendre une offre de paix de la Russie, l'empereur français lui-même prend l'initiative.

La quête de paix de Napoléon
Selon le plan initial de Napoléon, la prise de Moscou devait être décisive. Ici, il a été possible d'établir une tête de pont pratique, notamment pour une campagne contre Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie. Cependant, le retard dans les déplacements en Russie et l'héroïsme du peuple, qui s'est battu pour littéralement chaque parcelle de terre, ont pratiquement contrecarré ce plan. Après tout, un voyage dans le nord de la Russie en hiver pour l'armée française avec des approvisionnements alimentaires irréguliers équivalait en réalité à la mort. Cela est devenu clairement évident vers la fin du mois de septembre, lorsqu'il a commencé à faire plus froid. Par la suite, Napoléon écrivit dans son autobiographie que sa plus grande erreur fut la campagne contre Moscou et le mois passé là-bas.
Conscient de la gravité de sa situation, l'empereur et commandant français a décidé de mettre fin à la guerre patriotique contre la Russie en signant un traité de paix avec elle. Trois tentatives de ce type ont été faites :
- 18 septembre. Un message fut envoyé à Alexandre 1 par l'intermédiaire du général Tutolmin, qui déclarait que Napoléon vénérait l'empereur russe et lui offrait la paix. Tout ce qu’il exige de la Russie, c’est d’abandonner le territoire lituanien et de revenir au blocus continental.
- 20 septembre. Alexandre 1er reçut une deuxième lettre de Napoléon avec une proposition de paix. Les conditions proposées étaient les mêmes qu'avant. L’empereur russe n’a pas répondu à ces messages.
- Le 4 octobre. Le désespoir de la situation a conduit Napoléon à implorer littéralement la paix. C'est ce qu'il écrit à Alexandre 1er (selon le grand historien français F. Ségur) : « J'ai besoin de paix, j'en ai besoin, à tout prix, sauvez simplement votre honneur. » Cette proposition fut remise à Koutouzov, mais l'empereur de France ne reçut jamais de réponse.
Retraite de l'armée française à l'automne-hiver 1812

Il devint évident pour Napoléon qu'il ne serait pas en mesure de signer un traité de paix avec la Russie et qu'il était imprudent de passer l'hiver à Moscou, que les Russes avaient incendiée lors de leur retraite. De plus, il était impossible de rester ici, car les raids constants des milices causaient de gros dégâts à l'armée. Ainsi, au cours du mois où l'armée française était à Moscou, ses effectifs ont diminué de 30 000 personnes. En conséquence, la décision a été prise de battre en retraite.
Le 7 octobre, les préparatifs de la retraite de l'armée française commencent. L'un des ordres donnés à cette occasion était de faire sauter le Kremlin. Heureusement, cette idée n’a pas fonctionné pour lui. Les historiens russes attribuent cela au fait qu'en raison de l'humidité élevée, les mèches se sont mouillées et ont échoué.
Le 19 octobre commence la retraite de l'armée de Napoléon de Moscou. Le but de cette retraite était d'atteindre Smolensk, car c'était la seule grande ville voisine qui disposait d'approvisionnements alimentaires importants. La route passait par Kalouga, mais Koutouzov bloquait cette direction. L'avantage étant désormais du côté de l'armée russe, Napoléon décida de le contourner. Cependant, Kutuzov avait prévu cette manœuvre et rencontra l'armée ennemie à Maloyaroslavets.
Le 24 octobre eut lieu la bataille de Maloyaroslavets. Durant la journée, cette petite ville est passée d'un côté à l'autre 8 fois. Dans la phase finale de la bataille, Koutouzov réussit à prendre des positions fortifiées et Napoléon n'osa pas les prendre d'assaut, car la supériorité numérique était déjà du côté de l'armée russe. En conséquence, les plans français furent contrecarrés et ils durent se retirer à Smolensk par la même route par laquelle ils étaient allés à Moscou. C'était déjà une terre brûlée – sans nourriture et sans eau.
La retraite de Napoléon s'accompagne de lourdes pertes. En effet, outre les affrontements avec l’armée de Koutouzov, nous avons également dû faire face à des détachements de partisans qui attaquaient quotidiennement l’ennemi, notamment ses unités arrière. Les pertes de Napoléon furent terribles. Le 9 novembre, il réussit à s'emparer de Smolensk, mais cela n'apporta pas de changement fondamental au cours de la guerre. Il n'y avait pratiquement pas de nourriture dans la ville et il n'était pas possible d'organiser une défense fiable. En conséquence, l’armée a été soumise à des attaques presque continues de la part des milices et des patriotes locaux. Napoléon resta donc à Smolensk pendant 4 jours et décida de se retirer davantage.
Traversée de la rivière Bérézina

Les Français se dirigeaient vers la rivière Bérézina (dans l'actuelle Biélorussie) pour traverser le fleuve et rejoindre le Néman. Mais le 16 novembre, le général Chichagov s'empare de la ville de Borisov, située sur la Bérézina. La situation de Napoléon est devenue catastrophique - pour la première fois, la possibilité d'être capturé se profilait activement pour lui, puisqu'il était encerclé.
Le 25 novembre, sur ordre de Napoléon, l'armée française commence à simuler une traversée au sud de Borissov. Chichagov a adhéré à cette manœuvre et a commencé à transférer des troupes. À ce stade, les Français ont construit deux ponts sur la Bérézina et ont commencé la traversée les 26 et 27 novembre. Ce n'est que le 28 novembre que Chichagov réalisa son erreur et tenta de livrer bataille à l'armée française, mais il était trop tard : la traversée fut achevée, bien qu'au prix de la perte d'un grand nombre de vies humaines. 21 mille Français sont morts en traversant la Bérézina ! La « Grande Armée » ne comptait plus que 9 000 soldats, dont la plupart n'étaient plus capables de combattre.
C'est lors de cette traversée que se produisirent des gelées d'une intensité inhabituelle, auxquelles faisait référence l'empereur français, justifiant d'énormes pertes. Le 29e bulletin, publié dans l'un des journaux français, indiquait que jusqu'au 10 novembre, le temps était normal, mais qu'après ce froid très intense est arrivé, auquel personne n'était préparé.
Traversée du Néman (de la Russie à la France)
La traversée de la Bérézina montra que la campagne de Russie de Napoléon était terminée : il perdit la guerre patriotique en Russie en 1812. Ensuite, l'empereur décida que son séjour ultérieur dans l'armée n'avait aucun sens et le 5 décembre, il quitta ses troupes et se dirigea vers Paris.
Le 16 décembre, à Kovno, l'armée française franchit le Neman et quitte le territoire russe. Ses effectifs n'étaient que de 1 600 personnes. L'armée invincible, qui terrifiait toute l'Europe, fut presque entièrement détruite par l'armée de Koutouzov en moins de 6 mois.
Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique de la retraite de Napoléon sur la carte.
Résultats de la guerre patriotique de 1812
La guerre patriotique entre la Russie et Napoléon revêtait une grande importance pour tous les pays impliqués dans le conflit. En grande partie grâce à ces événements, la domination indivise de l'Angleterre en Europe est devenue possible. Cette évolution a été prévue par Kutuzov, qui, après la fuite de l'armée française en décembre, a envoyé un rapport à Alexandre 1er, dans lequel il a expliqué au souverain qu'il fallait mettre fin immédiatement à la guerre, et que la poursuite de l'ennemi et la libération de l’Europe serait bénéfique au renforcement de la puissance de l’Angleterre. Mais Alexandre n'écouta pas les conseils de son commandant et commença bientôt une campagne à l'étranger.
Raisons de la défaite de Napoléon à la guerre
Pour déterminer les principales raisons de la défaite de l'armée napoléonienne, il faut s'attarder sur les plus importantes, qui sont le plus souvent utilisées par les historiens :
- Une erreur stratégique de la part de l'empereur de France, qui a siégé à Moscou pendant 30 jours et a attendu les représentants d'Alexandre 1er pour plaider en faveur de la paix. En conséquence, il commença à faire plus froid et les provisions s'épuisèrent, et les raids constants des mouvements partisans marquèrent un tournant dans la guerre.
- Unité du peuple russe. Comme d'habitude, face au grand danger, les Slaves s'unissent. C'était pareil cette fois. Par exemple, l'historien Lieven écrit que la principale raison de la défaite de la France réside dans le caractère massif de la guerre. Tout le monde s'est battu pour les Russes : les femmes et les enfants. Et tout cela était idéologiquement justifié, ce qui rendait le moral de l’armée très fort. L'empereur de France ne l'a pas brisé.
- La réticence des généraux russes à accepter une bataille décisive. La plupart des historiens l’oublient, mais que serait-il arrivé à l’armée de Bagration s’il avait accepté une bataille générale au début de la guerre, comme le souhaitait réellement Alexandre 1er ? 60 mille de l’armée de Bagration contre 400 mille de l’armée de l’agresseur. Cela aurait été une victoire inconditionnelle et ils n’auraient guère eu le temps de s’en remettre. Le peuple russe doit donc exprimer sa gratitude à Barclay de Tolly, qui, par sa décision, a donné l'ordre de la retraite et de l'unification des armées.
- Le génie de Koutouzov. Le général russe, qui a reçu une excellente formation de Souvorov, n'a commis aucune erreur de calcul tactique. Il est à noter que Kutuzov n'a jamais réussi à vaincre son ennemi, mais a réussi à gagner tactiquement et stratégiquement la guerre patriotique.
- Le général Frost est utilisé comme excuse. Pour être honnête, il faut dire que les gelées n'ont pas eu d'impact significatif sur le résultat final, puisqu'au moment où les gelées anormales ont commencé (mi-novembre), l'issue de la confrontation était décidée : la grande armée était détruite.

L'année 2012 marque le 200e anniversaire de l'événement patriotique militaro-historique - la Guerre patriotique de 1812, qui revêt une grande importance pour le développement politique, social, culturel et militaire de la Russie.
Début de la guerre
12 juin 1812 (style ancien) L'armée française de Napoléon, après avoir traversé le Neman près de la ville de Kovno (aujourd'hui Kaunas en Lituanie), envahit l'Empire russe. Ce jour est inscrit dans l’histoire comme le début de la guerre entre la Russie et la France.

Dans cette guerre, deux forces se sont affrontées. D’une part, l’armée de Napoléon, composée d’un demi-million (environ 640 000 personnes), qui ne comprenait que la moitié des Français et comprenait également des représentants de presque toute l’Europe. Une armée enivrée par de nombreuses victoires, dirigée par de célèbres maréchaux et généraux dirigés par Napoléon. Les atouts de l'armée française résidaient dans son grand nombre, son bon soutien matériel et technique, son expérience du combat et sa croyance en l'invincibilité de l'armée.

Elle se heurte à l'opposition de l'armée russe, qui représente au début de la guerre un tiers de l'armée française. Avant le début de la Guerre patriotique de 1812, la guerre russo-turque de 1806-1812 venait de se terminer. L'armée russe était divisée en trois groupes éloignés les uns des autres (sous le commandement des généraux M.B. Barclay de Tolly, P.I. Bagration et A.P. Tormasov). Alexandre Ier était au quartier général de l'armée de Barclay.

Le coup de l'armée de Napoléon est porté par les troupes stationnées à la frontière ouest : la 1ère armée de Barclay de Tolly et la 2e armée de Bagration (153 mille soldats au total).
Connaissant sa supériorité numérique, Napoléon plaçait ses espoirs dans une guerre éclair. L’une de ses principales erreurs a été de sous-estimer l’élan patriotique de l’armée et du peuple russes.

Le début de la guerre fut un succès pour Napoléon. A 6 heures du matin le 12 (24) juin 1812, l'avant-garde des troupes françaises entre dans la ville russe de Kovno. Le passage de 220 000 soldats de la Grande Armée près de Kovno a duré 4 jours. 5 jours plus tard, un autre groupe (79 mille soldats) sous le commandement du vice-roi d'Italie Eugène Beauharnais traverse le Neman au sud de Kovno. Au même moment, encore plus au sud, près de Grodno, le Neman est traversé par 4 corps (78 à 79 000 soldats) sous le commandement général du roi de Westphalie, Jérôme Bonaparte. En direction nord, près de Tilsit, le Neman croisa le 10e corps du maréchal MacDonald (32 000 soldats), qui visait Saint-Pétersbourg. Dans la direction sud, de Varsovie à travers le Bug, un corps autrichien distinct du général Schwarzenberg (30 à 33 000 soldats) a commencé à envahir.
L'avancée rapide de la puissante armée française contraint le commandement russe à se retirer plus profondément dans le pays. Le commandant des troupes russes, Barclay de Tolly, a évité une bataille générale, préservant l'armée et s'efforçant de s'unir à l'armée de Bagration. La supériorité numérique de l'ennemi posait la question d'un réapprovisionnement urgent de l'armée. Mais en Russie, il n’y avait pas de conscription universelle. L'armée était recrutée par conscription. Et Alexandre, j'ai décidé de franchir une étape inhabituelle. Le 6 juillet, il publie un manifeste appelant à la création d'une milice populaire. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers détachements partisans. Cette guerre a uni toutes les couches de la population. Comme aujourd’hui comme hier, le peuple russe n’est uni que par le malheur, le chagrin et la tragédie. Peu importe qui vous êtes dans la société, quel est votre revenu. Le peuple russe a lutté uni pour défendre la liberté de sa patrie. Tous les peuples sont devenus une force unique, c'est pourquoi le nom de « Guerre patriotique » a été déterminé. La guerre est devenue un exemple du fait que le peuple russe ne permettra jamais que la liberté et l'esprit soient asservis; il défendra jusqu'au bout son honneur et son nom.
Les armées de Barclay et de Bagration se rencontrent près de Smolensk fin juillet, remportant ainsi leur premier succès stratégique.
Bataille pour Smolensk
Le 16 août (nouveau style), Napoléon s'approcha de Smolensk avec 180 000 soldats. Après l'unification des armées russes, les généraux ont commencé à exiger avec insistance du commandant en chef Barclay de Tolly une bataille générale. À 6 heures 16 août Napoléon lance l'assaut sur la ville.

Lors des batailles près de Smolensk, l'armée russe a fait preuve de la plus grande résilience. La bataille de Smolensk a marqué le développement d'une guerre nationale entre le peuple russe et l'ennemi. L'espoir de Napoléon d'une guerre éclair s'anéantissait.

Bataille pour Smolensk. Adam, vers 1820

La bataille acharnée pour Smolensk a duré 2 jours, jusqu'au matin du 18 août, lorsque Barclay de Tolly a retiré ses troupes de la ville en feu pour éviter une grande bataille sans chance de victoire. Barclay en avait 76 000, et 34 000 autres (l’armée de Bagration).Après la prise de Smolensk, Napoléon se dirige vers Moscou.
Pendant ce temps, la retraite prolongée a provoqué le mécontentement du public et des protestations parmi la majeure partie de l'armée (surtout après la capitulation de Smolensk). Ainsi, le 20 août (selon le style moderne), l'empereur Alexandre Ier a signé un décret nommant M.I. comme commandant en chef de l'armée. Troupes russes. Koutouzova. A cette époque, Koutouzov avait 67 ans. Commandant de l'école Souvorov, avec un demi-siècle d'expérience militaire, il jouissait du respect universel tant dans l'armée que parmi le peuple. Cependant, il dut également battre en retraite afin de gagner du temps pour rassembler toutes ses forces.
Koutouzov n'a pas pu éviter une bataille générale pour des raisons politiques et morales. Le 3 septembre (nouveau style), l'armée russe se retira dans le village de Borodino. Une nouvelle retraite signifiait la capitulation de Moscou. À cette époque, l'armée de Napoléon avait déjà subi des pertes importantes et la différence en nombre entre les deux armées s'était réduite. Dans cette situation, Kutuzov a décidé de livrer une bataille générale.

À l'ouest de Mozhaisk, à 125 km de Moscou près du village de Borodina 26 août (7 septembre, nouveau style) 1812 Une bataille a eu lieu qui restera à jamais gravée dans l’histoire de notre peuple. - la plus grande bataille de la guerre patriotique de 1812 entre les armées russe et française.

L'armée russe comptait 132 000 personnes (dont 21 000 milices mal armées). L'armée française, à ses trousses, comptait 135 000 hommes. Le quartier général de Koutouzov, estimant qu'il y avait environ 190 000 personnes dans l'armée ennemie, a choisi un plan défensif. En fait, la bataille était un assaut des troupes françaises sur une ligne de fortifications russes (éclairs, redoutes et lunettes).
.jpg)
Napoléon espérait vaincre l'armée russe. Mais la résilience des troupes russes, où chaque soldat, officier et général était un héros, bouleversa tous les calculs du commandant français. La bataille a duré toute la journée. Les pertes furent énormes des deux côtés. La bataille de Borodino est l'une des batailles les plus sanglantes du XIXe siècle. Selon les estimations les plus prudentes des pertes totales, 2 500 personnes sont mortes sur le terrain chaque heure. Certaines divisions ont perdu jusqu'à 80 % de leurs effectifs. Il n’y avait presque aucun prisonnier des deux côtés. Les pertes françaises s'élevaient à 58 000 personnes, celles des Russes à 45 000 personnes.

L’empereur Napoléon rappellera plus tard : « De toutes mes batailles, la plus terrible a été celle que j'ai menée près de Moscou. Les Français se sont montrés dignes de gagner, et les Russes se sont montrés dignes d’être qualifiés d’invincibles.

Bataille de cavalerie
Le 8 (21) septembre, Koutouzov ordonna la retraite vers Mozhaisk avec la ferme intention de préserver l'armée. L'armée russe s'est retirée, mais a conservé son efficacité au combat. Napoléon n'a pas réussi à réaliser l'essentiel : la défaite de l'armée russe.
13 (26) septembre dans le village de Fili Kutuzov a eu une réunion sur le futur plan d'action. Après le conseil militaire de Fili, l'armée russe, par décision de Koutouzov, fut retirée de Moscou. « Avec la perte de Moscou, la Russie n’est pas encore perdue, mais avec la perte de l’armée, la Russie est perdue ». Ces paroles du grand commandant, entrées dans l'histoire, ont été confirmées par les événements ultérieurs.

A.K. Savrasov. La cabane dans laquelle s'est déroulé le célèbre concile de Fili

Conseil militaire de Fili (A.D. Kivshenko, 1880)
Prise de Moscou
Dans la soirée 14 septembre (27 septembre, nouveau style) Napoléon entra sans combat dans Moscou vide. Dans la guerre contre la Russie, tous les plans de Napoléon se sont systématiquement effondrés. S'attendant à recevoir les clés de Moscou, il resta en vain plusieurs heures sur la colline Poklonnaya, et lorsqu'il entra dans la ville, il fut accueilli par des rues désertes.

Incendie à Moscou du 15 au 18 septembre 1812 après la prise de la ville par Napoléon. Peinture d'A.F. Smirnova, 1813
Déjà dans la nuit du 14 (27) au 15 (28) septembre, la ville était en proie à un incendie qui, dans la nuit du 15 (28) au 16 (29) septembre, s'intensifiait tellement que Napoléon fut contraint de quitter la Kremlin.
.jpg)
Environ 400 habitants de la classe inférieure ont été abattus parce qu'ils étaient soupçonnés d'incendie criminel. L'incendie a fait rage jusqu'au 18 septembre et a détruit la majeure partie de Moscou. Sur les 30 000 maisons qui se trouvaient à Moscou avant l'invasion, « à peine 5 000 » restaient après le départ de Napoléon de la ville.
Alors que l'armée de Napoléon était inactive à Moscou, perdant son efficacité au combat, Koutouzov se retira de Moscou, d'abord vers le sud-est le long de la route de Riazan, mais ensuite, tournant vers l'ouest, il flanqua l'armée française, occupa le village de Tarutino, bloquant la route de Kalouga. gu. Les bases de la défaite finale de la « grande armée » ont été posées dans le camp de Tarutino.

Lorsque Moscou brûla, l’amertume contre les occupants atteignit son plus haut degré d’intensité. Les principales formes de guerre du peuple russe contre l'invasion de Napoléon étaient la résistance passive (refus du commerce avec l'ennemi, laisser les céréales non récoltées dans les champs, destruction de la nourriture et du fourrage, pénétrer dans les forêts), la guérilla et la participation massive aux milices. Le cours de la guerre a été particulièrement influencé par le refus de la paysannerie russe de fournir à l'ennemi des provisions et du fourrage. L'armée française était au bord de la famine.
De juin à août 1812, l'armée de Napoléon, poursuivant les armées russes en retraite, parcourut environ 1 200 kilomètres du Néman à Moscou. En conséquence, ses lignes de communication ont été considérablement tendues. Compte tenu de ce fait, le commandement de l’armée russe a décidé de créer des détachements de partisans volants pour opérer à l’arrière et sur les lignes de communication de l’ennemi, dans le but d’empêcher son approvisionnement et de détruire ses petits détachements. Le plus célèbre, mais loin d'être le seul commandant d'escouades volantes, était Denis Davydov. Les détachements partisans de l'armée ont reçu le plein soutien du mouvement partisan paysan qui a émergé spontanément. Alors que l'armée française avançait plus profondément en Russie, que la violence de l'armée napoléonienne augmentait, après les incendies à Smolensk et à Moscou, après que la discipline dans l'armée de Napoléon ait diminué et qu'une partie importante de celle-ci se soit transformée en une bande de maraudeurs et de voleurs, la population de La Russie a commencé à passer d’une résistance passive à une résistance active à l’ennemi. Rien qu'au cours de son séjour à Moscou, l'armée française a perdu plus de 25 000 personnes à cause des actions partisanes.
Les partisans formaient en quelque sorte le premier cercle d'encerclement autour de Moscou, occupée par les Français. Le deuxième cercle était constitué de milices. Les partisans et les milices encerclaient Moscou en un cercle serré, menaçant de transformer l'encerclement stratégique de Napoléon en un encerclement tactique.
Combat de Tarutino
Après la capitulation de Moscou, Koutouzov a évidemment évité une bataille majeure, l'armée a accumulé des forces. Pendant ce temps, 205 000 miliciens ont été recrutés dans les provinces russes (Iaroslavl, Vladimir, Toula, Kaluga, Tver et autres) et en Ukraine 75 000. Le 2 octobre, Kutuzov a retiré l'armée au sud du village de Tarutino, plus près de Kalouga.
A Moscou, Napoléon se retrouve dans un piège : il n'est pas possible de passer l'hiver dans la ville ravagée par le feu : les recherches de nourriture en dehors de la ville ne se passent pas bien, les communications étendues des Français sont très vulnérables et l'armée commence à se désintégrer. Napoléon commença à se préparer à se retirer dans ses quartiers d'hiver quelque part entre le Dniepr et la Dvina.
Lorsque la « grande armée » se retira de Moscou, son sort fut décidé.
.jpg)
Bataille de Tarutino, 6 octobre (P. Hess)
18 octobre(nouveau style) Les troupes russes attaquées et vaincues près de Taroutino Corps français de Murat. Ayant perdu jusqu'à 4 000 soldats, les Français se retirèrent. La bataille de Tarutino est devenue un événement marquant, marquant le passage de l'initiative de la guerre à l'armée russe.
La retraite de Napoléon
19 octobre(dans un style moderne) l'armée française (110 000) avec un énorme convoi a commencé à quitter Moscou par la vieille route de Kalouga. Mais la route de Napoléon vers Kalouga était bloquée par l’armée de Koutouzov, située près du village de Tarutino sur la vieille route de Kalouga. En raison du manque de chevaux, la flotte d'artillerie française fut réduite et les grandes formations de cavalerie disparurent pratiquement. Ne voulant pas percer une position fortifiée avec une armée affaiblie, Napoléon contourna le village de Troitsky (Troitsk moderne) sur la nouvelle route de Kaluga (autoroute moderne de Kiev) pour contourner Tarutino. Cependant, Koutouzov transféra l'armée à Maloyaroslavets, coupant ainsi la retraite française le long de la route de Nouvelle Kalouga.
Au 22 octobre, l'armée de Koutouzov comptait 97 000 soldats réguliers, 20 000 cosaques, 622 canons et plus de 10 000 miliciens. Napoléon disposait de jusqu'à 70 000 soldats prêts au combat, la cavalerie avait pratiquement disparu et l'artillerie était beaucoup plus faible que celle russe.
12 (24) octobre a eu lieu bataille de Maloyaroslavets. La ville a changé de mains huit fois. En fin de compte, les Français ont réussi à capturer Maloyaroslavets, mais Kutuzov a pris une position fortifiée à l'extérieur de la ville, que Napoléon n'a pas osé prendre d'assaut.Le 26 octobre, Napoléon ordonna la retraite vers le nord, vers Borovsk-Vereya-Mozhaisk.
%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg)
A.Averyanov. Bataille de Maloyaroslavets 12 (24) octobre 1812
Lors des batailles de Maloyaroslavets, l'armée russe a résolu un problème stratégique majeur : elle a contrecarré le projet de percée des troupes françaises en Ukraine et a forcé l'ennemi à se retirer le long de l'ancienne route de Smolensk, qu'il avait détruite.
De Mojaïsk, l'armée française reprit son mouvement vers Smolensk par la route par laquelle elle avançait vers Moscou.
La défaite définitive des troupes françaises eut lieu lors du franchissement de la Bérézina. Les batailles du 26 au 29 novembre entre les corps français et les armées russes de Chichagov et Wittgenstein sur les deux rives de la Bérézina lors de la traversée de Napoléon sont entrées dans l'histoire comme bataille sur la Bérézina.
%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%20(1844).jpg)
Les Français se retirent par la Bérézina le 17 (29) novembre 1812. Peter von Hess (1844)
En traversant la Bérézina, Napoléon a perdu 21 000 personnes. Au total, jusqu'à 60 000 personnes ont réussi à traverser la Bérézina, pour la plupart des civils et des restes non prêts au combat de la « Grande Armée ». Des gelées d'une rare intensité, qui frappent lors de la traversée de la Bérézina et se poursuivent dans les jours suivants, finissent par exterminer les Français, déjà affaiblis par la faim. Le 6 décembre, Napoléon quitte son armée et se rend à Paris pour recruter de nouveaux soldats pour remplacer ceux tués en Russie.

Le principal résultat de la bataille de la Bérézina fut que Napoléon évita une défaite totale dans des conditions de supériorité significative des forces russes. Dans la mémoire des Français, le franchissement de la Bérézina n'occupe pas moins de place que la plus grande bataille de Borodino.
Fin décembre, les restes de l'armée de Napoléon furent expulsés de Russie.
La « campagne de Russie de 1812 » était terminée 14 décembre 1812.
Résultats de la guerre
Le principal résultat de la guerre patriotique de 1812 fut la destruction presque complète de la Grande Armée de Napoléon.Napoléon a perdu environ 580 000 soldats en Russie. Ces pertes comprennent 200 000 tués, de 150 à 190 000 prisonniers, environ 130 000 déserteurs qui ont fui vers leur pays d'origine. Les pertes de l'armée russe, selon certaines estimations, s'élèveraient à 210 000 soldats et miliciens.
En janvier 1813, la « Campagne étrangère de l'armée russe » a commencé : les combats se sont déplacés vers le territoire de l'Allemagne et de la France. En octobre 1813, Napoléon fut vaincu à la bataille de Leipzig et en avril 1814, il abdiqua le trône de France.
La victoire sur Napoléon a rehaussé comme jamais auparavant le prestige international de la Russie, qui a joué un rôle décisif au Congrès de Vienne et a exercé, au cours des décennies suivantes, une influence décisive sur les affaires européennes.
Dates clés
12 juin 1812- invasion de l'armée de Napoléon en Russie par le fleuve Néman. 3 armées russes étaient très éloignées les unes des autres. L'armée de Tormasov, étant en Ukraine, ne pouvait pas participer à la guerre. Il s'est avéré que seules 2 armées ont pris le coup. Mais ils ont dû battre en retraite pour se connecter.
3 août- une liaison entre les armées de Bagration et de Barclay de Tolly près de Smolensk. Les ennemis en ont perdu environ 20 000 et les nôtres environ 6 000, mais Smolensk a dû être abandonnée. Même les armées unies étaient 4 fois plus petites que l’ennemi !
8 août- Kutuzov a été nommé commandant en chef. Stratège expérimenté, blessé à plusieurs reprises au combat, l'élève de Souvorov était apprécié du peuple.
26 août- La bataille de Borodino a duré plus de 12 heures. C'est considéré comme une bataille générale. Aux abords de Moscou, les Russes ont fait preuve d'un héroïsme massif. Les pertes de l'ennemi furent plus importantes, mais notre armée ne put passer à l'offensive. La supériorité numérique des ennemis était encore grande. À contrecœur, ils décidèrent de rendre Moscou afin de sauver l’armée.
septembre octobre- siège de l'armée de Napoléon à Moscou. Ses attentes n'ont pas été satisfaites. Il n'était pas possible de gagner. Koutouzov a rejeté les demandes de paix. La tentative de fuite vers le sud a échoué.
octobre décembre- expulsion de l'armée de Napoléon de Russie le long de la route détruite de Smolensk. Sur 600 000 ennemis, il en reste environ 30 000 !
25 décembre 1812- L'empereur Alexandre Ier a publié un manifeste sur la victoire de la Russie. Mais il fallait continuer la guerre. Napoléon avait encore des armées en Europe. S’ils ne sont pas vaincus, il attaquera à nouveau la Russie. La campagne étrangère de l’armée russe dura jusqu’à la victoire en 1814.
Préparé par Sergueï Shulyak
INVASION (film d'animation)
Guerre patriotique de 1812 |
|
Empire russe |
|
Destruction presque complète de l'armée de Napoléon |
|
Adversaires |
|
Alliés : |
Alliés : |
L'Angleterre et la Suède n'ont pas participé à la guerre sur le territoire russe |
|
Commandants |
|
Napoléon Ier |
Alexandre Ier |
E. MacDonald |
M. I. Koutouzov |
Jérôme Bonaparte |
M.B. Barclay de Tolly |
K.-F. Schwarzenberg, E. Beauharnais |
PI Bagration † |
N.-Sh. Oudinot |
A.P. Tormasov |
K.-V. Perrin |
P. V. Chichagov |
L.-N. Davout, |
P.H. Wittgenstein |
Points forts des partis |
|
610 000 soldats, 1 370 canons |
650 000 soldats, 1 600 canons, 400 000 miliciens |
Pertes militaires |
|
Environ 550 000, 1 200 canons |
210 mille soldats |
Guerre patriotique de 1812- les actions militaires de 1812 entre la Russie et l'armée de Napoléon Bonaparte qui envahit son territoire. Dans les études napoléoniennes, le terme « Campagne de Russie de 1812" (fr. pendentif campagne de Russie l "année 1812).
Cela s'est terminé par la destruction presque complète de l'armée napoléonienne et le transfert des opérations militaires sur le territoire de la Pologne et de l'Allemagne en 1813.
Napoléon avait initialement appelé à cette guerre deuxième polonais, car l'un de ses objectifs déclarés de campagne était la renaissance de l'État polonais indépendant en opposition à l'Empire russe, y compris les territoires de la Lituanie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Dans la littérature pré-révolutionnaire, il existe une épithète de guerre telle que « l’invasion de douze langues ».
Arrière-plan
Situation politique à la veille de la guerre
Après la défaite des troupes russes lors de la bataille de Friedland en juin 1807. L'empereur Alexandre Ier a conclu le traité de Tilsit avec Napoléon, selon lequel il s'est engagé à rejoindre le blocus continental de l'Angleterre. En accord avec Napoléon, la Russie prit la Finlande à la Suède en 1808 et réalisa un certain nombre d'autres acquisitions territoriales ; Napoléon avait les mains libres pour conquérir toute l’Europe à l’exception de l’Angleterre et de l’Espagne. Après une tentative infructueuse d'épouser la grande-duchesse de Russie, Napoléon épouse en 1810 Marie-Louise d'Autriche, fille de l'empereur autrichien François, renforçant ainsi ses arrières et prenant pied en Europe.
Les troupes françaises, après une série d’annexions, se rapprochent des frontières de l’Empire russe.
Le 24 février 1812, Napoléon conclut un traité d'alliance avec la Prusse, qui était censé déployer 20 000 soldats contre la Russie et assurer la logistique de l'armée française. Napoléon a également conclu une alliance militaire avec l'Autriche le 14 mars de la même année, selon laquelle les Autrichiens s'engageaient à déployer 30 000 soldats contre la Russie.
La Russie a également préparé diplomatiquement l’arrière. À la suite de négociations secrètes au printemps 1812, les Autrichiens ont clairement indiqué que leur armée ne s'éloignerait pas de la frontière austro-russe et ne ferait aucun zèle au profit de Napoléon. En avril de la même année, côté suédois, l'ancien maréchal napoléonien Bernadotte (futur roi de Suède Charles XIV), élu prince héritier en 1810 et chef de facto de l'aristocratie suédoise, donne l'assurance de sa position amicale envers la Russie et conclut un traité d'alliance. Le 22 mai 1812, l'ambassadeur de Russie Koutouzov (futur maréchal et conquérant de Napoléon) réussit à conclure une paix profitable avec la Turquie, mettant fin à la guerre de cinq ans pour la Moldavie. Dans le sud de la Russie, l’armée du Danube de Chichagov fut libérée pour servir de barrière contre l’Autriche, qui fut contrainte de s’allier à Napoléon.
Le 19 mai 1812, Napoléon part pour Dresde, où il passe en revue les monarques vassaux d'Europe. De Dresde, l'empereur se rendit à la « Grande Armée » sur le fleuve Neman, qui séparait la Prusse et la Russie. Le 22 juin, Napoléon a écrit un appel aux troupes, dans lequel il accusait la Russie de violer l'accord de Tilsit et qualifiait l'invasion de deuxième guerre polonaise. La libération de la Pologne est devenue l'un des slogans qui ont permis d'attirer de nombreux Polonais dans l'armée française. Même les maréchaux français ne comprenaient pas le sens et les objectifs de l'invasion de la Russie, mais ils obéissaient habituellement.
Le 24 juin 1812, à 2 heures du matin, Napoléon ordonna le début de la traversée vers la rive russe du Neman par 4 ponts au-dessus de Kovno.
Causes de la guerre
Les Français ont porté atteinte aux intérêts des Russes en Europe et ont menacé la restauration de la Pologne indépendante. Napoléon a exigé que le tsar Alexandre Ier renforce le blocus de l'Angleterre. L’Empire russe ne respecte pas le blocus continental et impose des droits de douane sur les marchandises françaises. La Russie exige le retrait des troupes françaises de Prusse, stationnées là-bas en violation du traité de Tilsit.
Forces armées des opposants
Napoléon a pu concentrer environ 450 000 soldats contre la Russie, dont les Français eux-mêmes représentaient la moitié. Des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Néerlandais et même des Espagnols mobilisés de force prirent également part à la campagne. L'Autriche et la Prusse ont alloué des corps (30 000 et 20 000, respectivement) contre la Russie dans le cadre d'accords d'alliance avec Napoléon.
L'Espagne, ayant immobilisé environ 200 000 soldats français dans une résistance partisane, a apporté une grande aide à la Russie. L'Angleterre a fourni un soutien matériel et financier à la Russie, mais son armée a été impliquée dans des batailles en Espagne et la puissante flotte britannique n'a pas pu influencer les opérations terrestres en Europe, bien que ce soit l'un des facteurs qui ont fait pencher la position de la Suède en faveur de la Russie.
Napoléon disposait des réserves suivantes : environ 90 000 soldats français dans les garnisons d'Europe centrale (dont 60 000 dans le 11e corps de réserve en Prusse) et 100 000 dans la Garde nationale française, qui, selon la loi, ne pouvait pas combattre hors de France.
La Russie disposait d'une grande armée, mais ne pouvait pas mobiliser rapidement de troupes en raison du mauvais état des routes et de l'immensité du territoire. Le coup de l'armée de Napoléon fut porté par les troupes stationnées à la frontière occidentale : la 1re armée de Barclay et la 2e armée de Bagration, soit un total de 153 000 soldats et 758 canons. Encore plus au sud, en Volyn (nord-ouest de l'Ukraine), se trouvait la 3e armée de Tormasov (jusqu'à 45 000 canons 168), qui servait de barrière contre l'Autriche. En Moldavie, l’armée du Danube de Chichagov (55 000, 202 canons) s’est opposée à la Turquie. En Finlande, le corps du général russe Shteingel (19 mille canons 102) s'est opposé à la Suède. Dans la région de Riga, il y avait un corps d'Essen distinct (jusqu'à 18 000), jusqu'à 4 corps de réserve étaient situés plus loin de la frontière.
Selon les listes, les troupes cosaques irrégulières comptaient jusqu'à 110 000 cavaliers légers, mais en réalité jusqu'à 20 000 Cosaques ont pris part à la guerre.
Infanterie, |
Cavalerie, |
Artillerie |
Cosaques, |
Garnisons, |
Note |
|
35 à 40 000 soldats, |
110 à 132 000 personnes dans la 1re armée de Barclay en Lituanie, |
|||||
1370 canons |
190 |
450 000 personnes ont envahi la Russie. Après le début de la guerre, 140 000 autres sont arrivés en Russie sous forme de renforts. Dans les garnisons d'Europe jusqu'à 90 000 + Garde nationale en France (100 000) |
Plans stratégiques des partis
Dès le début, la partie russe a planifié une longue retraite organisée afin d'éviter le risque d'une bataille décisive et d'une éventuelle perte de l'armée. L'empereur Alexandre Ier déclara à l'ambassadeur de France en Russie, Armand Caulaincourt, lors d'une conversation privée en mai 1811 :
|
« Si l'empereur Napoléon déclenche une guerre contre moi, alors il est possible et même probable qu'il nous battra si nous acceptons la bataille, mais cela ne lui donnera pas encore la paix. Les Espagnols furent battus à plusieurs reprises, mais ils ne furent ni vaincus ni soumis. Et pourtant ils ne sont pas aussi loin de Paris que nous : ils n’ont ni notre climat ni nos ressources. Nous ne prendrons aucun risque. Nous disposons d’un vaste espace derrière nous et nous maintiendrons une armée bien organisée. […] Si le sort des armes tranche contre moi, alors je préférerais me retirer au Kamtchatka plutôt que de céder mes provinces et de signer dans ma capitale des traités qui ne sont qu'un répit. Le Français est courageux, mais les longues épreuves et le mauvais climat le fatiguent et le découragent. Notre climat et notre hiver se battront pour nous.» |
Cependant, le plan de campagne initial élaboré par le théoricien militaire Pfuel prévoyait une défense au camp fortifié de Driss. Pendant la guerre, le plan de Pfuel fut rejeté par les généraux comme impossible à mettre en œuvre dans les conditions de la guerre de manœuvre moderne. Les entrepôts d'artillerie destinés à approvisionner l'armée russe étaient répartis sur trois lignes :
- Vilna - Dinabourg - Nesvizh - Bobruisk - Polonnoe - Kiev
- Pskov - Porkhov - Chostka - Briansk - Smolensk
- Moscou - Novgorod - Kalouga
Napoléon souhaitait mener une campagne limitée pour 1812. Il a déclaré à Metternich : « Le triomphe sera le sort des plus patients. J'ouvrirai la campagne en traversant le Néman. Je le terminerai à Smolensk et Minsk. Je vais m'arrêter là.« L'empereur français espérait que la défaite de l'armée russe dans la bataille générale obligerait Alexandre à accepter ses conditions. Caulaincourt dans ses mémoires rappelle la phrase de Napoléon : « Il commença par parler des nobles russes qui, en cas de guerre, craindraient pour leurs palais et, après une grande bataille, forceraient l'empereur Alexandre à signer la paix.»
Offensive de Napoléon (juin-septembre 1812)
A 6 heures du matin le 24 juin (12 juin, style ancien) 1812, l'avant-garde des troupes françaises entra dans le Kovno russe (Kaunas moderne en Lituanie), en traversant le Neman. Le passage de 220 000 soldats de l'armée française (1er, 2e, 3e corps d'infanterie, gardes et cavalerie) près de Kovno a duré 4 jours.
Les 29 et 30 juin, près de Prena (l'actuelle Prienai en Lituanie) un peu au sud de Kovno, un autre groupe (79 mille soldats : 6e et 4e corps d'infanterie, cavalerie) sous le commandement du prince Beauharnais franchit le Néman.
Au même moment, le 30 juin, encore plus au sud près de Grodno, le Neman est traversé par 4 corps (78 à 79 mille soldats : 5e, 7e, 8e corps d'infanterie et 4e corps de cavalerie) sous le commandement général de Jérôme Bonaparte.
Au nord de Kovno, près de Tilsit, le Neman croise le 10e corps du maréchal français MacDonald. Au sud de la direction centrale de Varsovie, la rivière Bug a été traversée par un corps autrichien distinct de Schwarzenberg (30 à 33 000 soldats).
L'empereur Alexandre Ier apprit le début de l'invasion tard dans la soirée du 24 juin à Vilna (l'actuelle Vilnius en Lituanie). Et déjà le 28 juin, les Français entrèrent à Vilna. Ce n'est que le 16 juillet que Napoléon, après avoir réglé les affaires de l'État dans la Lituanie occupée, quitta la ville à la suite de ses troupes.
De Neman à Smolensk (juillet - août 1812)
Direction nord
Napoléon envoya le 10e corps du maréchal MacDonald, composé de 32 000 Prussiens et Allemands, au nord de l'Empire russe. Son objectif était de capturer Riga, puis, en s'unissant au 2e corps du maréchal Oudinot (28 000), d'attaquer Saint-Pétersbourg. Le noyau du corps de MacDonald était un corps prussien fort de 20 000 hommes sous le commandement du général Gravert (plus tard York). Macdonald s'est approché des fortifications de Riga, mais, faute d'artillerie de siège, il s'est arrêté aux abords éloignés de la ville. Le gouverneur militaire de Riga, Essen, incendia les faubourgs et s'enferma dans la ville avec une forte garnison. Essayant de soutenir Oudinot, Macdonald captura Dinaburg abandonnée sur la Dvina occidentale et arrêta les opérations actives, en attendant l'artillerie de siège de la Prusse orientale. Les Prussiens du corps de Macdonald essayèrent d'éviter les affrontements militaires actifs dans cette guerre étrangère, cependant, si la situation menaçait « l'honneur des armes prussiennes », les Prussiens offrirent une résistance active et repoussèrent à plusieurs reprises les incursions russes depuis Riga avec de lourdes pertes.
Oudinot, ayant occupé Polotsk, décida de contourner par le nord le corps séparé de Wittgenstein (25 000), alloué par la 1re armée de Barclay lors de la retraite à travers Polotsk, et de le couper de l'arrière. Craignant les liens d'Oudinot avec MacDonald, Wittgenstein attaqua le 30 juillet le 2/3 du corps d'Oudinot, qui ne s'attendait pas à une attaque et fut affaibli par une marche sur le 2/3 du corps, lors de la bataille de Klyastitsy et le renvoya à Polotsk. La victoire permet à Wittgenstein d'attaquer Polotsk les 17 et 18 août, mais le corps de Saint-Cyr, envoyé à temps par Napoléon pour soutenir le corps d'Oudinot, contribue à repousser l'attaque et à rétablir l'équilibre.
Oudinot et MacDonald se sont retrouvés coincés dans des combats de faible intensité et sont restés sur place.
direction de Moscou
Les unités de la 1re armée de Barclay étaient dispersées de la Baltique à Lida, avec leur quartier général situé à Vilna. Compte tenu de l'avancée rapide de Napoléon, le corps russe divisé risquait d'être vaincu au coup par coup. Le corps de Dokhturov s'est retrouvé dans un environnement opérationnel, mais a pu s'échapper et arriver au point de rassemblement de Sventsyany. Au même moment, le détachement de cavalerie de Dorokhov se trouva coupé du corps et réuni à l’armée de Bagration. Après l'union de la 1re armée, Barclay de Tolly commença à se retirer progressivement vers Vilna et plus loin vers Drissa.
Le 26 juin, l'armée de Barclay quitta Vilna et arriva le 10 juillet au camp fortifié de Drissa sur la Dvina occidentale (au nord de la Biélorussie), où l'empereur Alexandre Ier prévoyait de combattre les troupes napoléoniennes. Les généraux parviennent à convaincre l'empereur de l'absurdité de cette idée avancée par le théoricien militaire Pfuel (ou Ful). Le 16 juillet, l’armée russe poursuit sa retraite via Polotsk jusqu’à Vitebsk, laissant le 1er corps du lieutenant-général Wittgenstein défendre Saint-Pétersbourg. À Polotsk, Alexandre Ier a quitté l'armée, convaincu de partir par les demandes persistantes des dignitaires et de sa famille. Général exécutif et stratège prudent, Barclay se retira sous la pression de forces supérieures de presque toute l'Europe, ce qui irrita grandement Napoléon, intéressé par une bataille générale rapide.
La 2e armée russe (jusqu'à 45 000 hommes) sous le commandement de Bagration au début de l'invasion était située près de Grodno, dans l'ouest de la Biélorussie, à environ 150 kilomètres de la 1re armée de Barclay. Au début, Bagration partit rejoindre la 1re armée principale, mais lorsqu'il atteignit Lida (à 100 km de Vilno), il était trop tard. Il a dû échapper aux Français vers le sud. Pour couper Bagration des forces principales et le détruire, Napoléon envoya le maréchal Davout avec une force pouvant atteindre 50 000 soldats pour traverser Bagration. Davout quitte Vilna pour Minsk, qu'il occupe le 8 juillet. En revanche, depuis l'ouest, Jérôme Bonaparte attaque Bagration avec 4 corps, qui traverse le Neman près de Grodno. Napoléon cherchait à empêcher la fusion des armées russes afin de les vaincre pièce par pièce. Bagration, avec des marches rapides et des combats d'arrière-garde réussis, s'est détaché des troupes de Jérôme, et le maréchal Davout est désormais devenu son principal adversaire.
Le 19 juillet, Bagration était à Bobruisk sur la Bérézina, tandis que le 21 juillet Davout occupait Mogilev sur le Dniepr avec des unités avancées, c'est-à-dire que les Français étaient en avance sur Bagration, étant au nord-est de la 2e armée russe. Bagration, s'étant approché du Dniepr à 60 km en aval de Mogilev, envoya le 23 juillet le corps du général Raevsky contre Davout dans le but de repousser les Français de Moguilev et de prendre une route directe vers Vitebsk, où selon les plans les armées russes devaient s'unir. À la suite de la bataille près de Saltanovka, Raevsky retarda l'avancée de Davout vers l'est jusqu'à Smolensk, mais le chemin vers Vitebsk fut bloqué. Bagration a pu traverser le Dniepr dans la ville de Novoye Bykhovo sans interférence le 25 juillet et s'est dirigé vers Smolensk. Davout n'avait plus la force de poursuivre la 2e armée russe, et les troupes de Jérôme Bonaparte, désespérément en retrait, traversaient toujours le territoire boisé et marécageux de la Biélorussie.
Le 23 juillet, l'armée de Barclay arrive à Vitebsk, où Barclay veut attendre Bagration. Pour empêcher l'avancée des Français, il envoie le 4e corps d'Osterman-Tolstoï à la rencontre de l'avant-garde ennemie. Le 25 juillet, à 26 verstes de Vitebsk, eut lieu la bataille d'Ostrovno, qui se poursuivit le 26 juillet.
Le 27 juillet, Barclay se retire de Vitebsk à Smolensk, après avoir appris l'approche de Napoléon avec les forces principales et l'impossibilité pour Bagration de percer jusqu'à Vitebsk. Le 3 août, les 1re et 2e armées russes s'unissent près de Smolensk, remportant ainsi leur premier succès stratégique. Il y eut un court répit dans la guerre ; les deux camps mettaient de l'ordre dans leurs troupes, fatigués des marches incessantes.
En arrivant à Vitebsk, Napoléon s'arrête pour reposer ses troupes, frustrées après une offensive de 400 km en l'absence de bases de ravitaillement. Ce n'est que le 12 août, après bien des hésitations, que Napoléon partit de Vitebsk pour Smolensk.
Direction sud
Le 7e corps saxon sous le commandement de Rainier (17-22 mille) était censé couvrir le flanc gauche des principales forces de Napoléon de la 3e armée russe sous le commandement de Tormasov (25 mille sous les armes). Rainier a pris une position de cordon le long de la ligne Brest-Kobrin-Pinsk, étalant un corps déjà petit sur 170 km. Le 27 juillet Tormasov était encerclé par Kobryn, la garnison saxonne sous le commandement de Klengel (jusqu'à 5 mille) était entièrement vaincue. Brest et Pinsk furent également débarrassés des garnisons françaises.
Réalisant que Rainier, affaibli, ne serait pas en mesure de retenir Tormasov, Napoléon décida de ne pas attirer le corps autrichien de Schwarzenberg (30 000) dans la direction principale et le laissa au sud contre Tormasov. Rainier, rassemblant ses troupes et rejoignant Schwarzenberg, attaque Tormasov le 12 août à Gorodechny, obligeant les Russes à se replier sur Loutsk (nord-ouest de l'Ukraine). Les principales batailles ont lieu entre les Saxons et les Russes, les Autrichiens tentent de se limiter aux bombardements d'artillerie et aux manœuvres.
Jusqu'à fin septembre, des combats de faible intensité ont eu lieu vers le sud, dans une zone marécageuse peu peuplée de la région de Loutsk.
Outre Tormasov, dans la direction sud se trouvait le 2e corps de réserve russe du lieutenant-général Ertel, formé à Mozyr et apportant son soutien à la garnison bloquée de Bobruisk. Pour bloquer Bobruisk, ainsi que pour couvrir les communications d'Ertel, Napoléon quitta la division polonaise de Dombrowski (10 000) du 5e corps polonais.
De Smolensk à Borodine (août-septembre 1812)
Après l'unification des armées russes, les généraux ont commencé à exiger avec insistance de Barclay une bataille générale. Profitant de la position dispersée des corps français, Barclay décide de les vaincre un à un et marche le 8 août vers Rudnya, où était cantonnée la cavalerie de Murat.
Cependant, Napoléon, profitant de la lente avancée de l'armée russe, rassembla son corps en un seul poing et tenta de se placer à l'arrière de Barclay, en contournant son flanc gauche par le sud, pour lequel il traversa le Dniepr à l'ouest de Smolensk. Sur le chemin de l'avant-garde de l'armée française se trouvait la 27e division du général Neverovsky, couvrant le flanc gauche de l'armée russe près de Krasnoïe. La résistance obstinée de Neverovsky donna le temps de transférer le corps du général Raevsky à Smolensk.
Le 16 août, Napoléon s'approcha de Smolensk avec 180 000 hommes. Bagration a chargé le général Raevsky (15 000 soldats), dans le 7e corps duquel ont rejoint les restes de la division Neverovsky, de défendre Smolensk. Barclay était contre une bataille qui, à son avis, n’était pas nécessaire, mais à cette époque il existait un véritable double commandement dans l’armée russe. Le 16 août à 6 heures du matin, Napoléon lance l'assaut de la ville par une marche. La bataille acharnée pour Smolensk s'est poursuivie jusqu'au matin du 18 août, lorsque Barclay a retiré ses troupes de la ville en feu pour éviter une bataille majeure sans chance de victoire. Barclay en avait 76 000, 34 000 autres (l'armée de Bagration) couvraient la route de retraite de l'armée russe vers Dorogobuzh, que Napoléon pouvait couper par une manœuvre de détour (similaire à celle qui a échoué à Smolensk).
Le maréchal Ney poursuit l'armée en retraite. Le 19 août, lors d'une bataille sanglante près de Valutina Gora, l'arrière-garde russe a arrêté le maréchal, qui a subi des pertes importantes. Napoléon envoya le général Junot passer derrière les arrières russes par un détour, mais il ne put terminer sa tâche, se heurtant à un marais infranchissable, et l'armée russe partit en bon ordre vers Moscou jusqu'à Dorogobuzh. La bataille de Smolensk, qui a détruit une grande ville, a marqué le développement d’une guerre nationale entre le peuple russe et l’ennemi, immédiatement ressentie tant par les fournisseurs français ordinaires que par les maréchaux de Napoléon. Les colonies situées le long de la route de l'armée française ont été incendiées, la population a été éloignée autant que possible. Immédiatement après la bataille de Smolensk, Napoléon fit une proposition de paix déguisée au tsar Alexandre Ier, si loin d'être en position de force, mais ne reçut pas de réponse.
Les relations entre Bagration et Barclay après avoir quitté Smolensk devenaient de plus en plus tendues à chaque jour de retraite, et dans cette dispute, l'humeur de la noblesse n'était pas du côté du prudent Barclay. Le 17 août, l'empereur réunit un conseil qui lui recommanda de nommer le général d'infanterie le prince Koutouzov commandant en chef de l'armée russe. Le 29 août, Koutouzov reçut l'armée à Tsarevo-Zaimishche. Ce jour-là, les Français entrèrent à Viazma.
Poursuivant la ligne stratégique générale de son prédécesseur, Koutouzov n'a pu éviter une bataille générale pour des raisons politiques et morales. La société russe exigeait une bataille, même si elle était inutile d’un point de vue militaire. Le 3 septembre, l'armée russe se retira dans le village de Borodino ; une nouvelle retraite impliquait la capitulation de Moscou. Kutuzov a décidé de livrer une bataille générale, car l'équilibre des forces s'était déplacé dans le sens russe. Si au début de l'invasion Napoléon avait une triple supériorité en nombre de soldats sur l'armée russe adverse, le nombre des armées était désormais comparable - 135 000 pour Napoléon contre 110 à 130 000 pour Koutouzov. Le problème de l’armée russe était le manque d’armes. Alors que la milice fournissait jusqu'à 80 000 à 100 000 guerriers des provinces centrales de la Russie, il n'y avait pas d'armes pour armer la milice. Les guerriers ont reçu des piques, mais Koutouzov n'a pas utilisé les gens comme « chair à canon ».
Le 7 septembre (26 août, Old Style) près du village de Borodino (124 km à l'ouest de Moscou), la plus grande bataille de la guerre patriotique de 1812 a eu lieu entre les armées russe et française.
Après près de deux jours de bataille, qui consistèrent en un assaut des troupes françaises sur la ligne fortifiée russe, les Français, au prix de 30 à 34 000 soldats, repoussèrent le flanc gauche russe hors de position. L'armée russe subit de lourdes pertes et Koutouzov ordonna la retraite vers Mozhaisk le 8 septembre avec la ferme intention de préserver l'armée.
Le 13 septembre à 16 heures, dans le village de Fili, Koutouzov a ordonné aux généraux de se réunir pour une réunion sur le plan d'action ultérieur. La plupart des généraux se sont prononcés en faveur d'une nouvelle bataille générale avec Napoléon. Koutouzov interrompit alors la réunion et annonça qu'il ordonnait la retraite.
Le 14 septembre, l’armée russe traverse Moscou et atteint la route de Riazan (au sud-est de Moscou). Vers le soir, Napoléon entre dans Moscou vide.
Prise de Moscou (septembre 1812)
Le 14 septembre, Napoléon occupa Moscou sans combat et, dans la nuit du même jour, la ville était en proie à un incendie qui, dans la nuit du 15 septembre, s'intensifia tellement que Napoléon fut contraint de quitter le Kremlin. L'incendie a fait rage jusqu'au 18 septembre et a détruit la majeure partie de Moscou.
Jusqu'à 400 citadins des classes inférieures ont été abattus par une cour martiale française, soupçonnés d'incendie criminel.
Il existe plusieurs versions de l'incendie - incendie criminel organisé à la sortie de la ville (généralement associé au nom de F.V. Rostopchin), incendie criminel commis par des espions russes (plusieurs Russes ont été abattus par les Français pour de telles accusations), actions incontrôlées des occupants, accidentel incendie dont la propagation a été facilitée par le chaos général dans une ville abandonnée. L'incendie avait plusieurs sources, il est donc possible que toutes les versions soient vraies à un degré ou à un autre.
Kutuzov, se retirant du sud de Moscou vers la route de Riazan, a exécuté la célèbre manœuvre de Tarutino. Après avoir écarté la piste des cavaliers qui poursuivaient Murat, Koutouzov tourna vers l'ouest depuis la route de Riazan passant par Podolsk sur l'ancienne route de Kaluga, où il atteignit le 20 septembre dans la région de Krasnaya Pakhra (près de la ville moderne de Troitsk).
Puis, convaincu que sa position n'était pas rentable, le 2 octobre, Kutuzov a transféré l'armée vers le sud, dans le village de Tarutino, situé le long de l'ancienne route de Kaluga, dans la région de Kaluga, non loin de la frontière avec Moscou. Avec cette manœuvre, Kutuzov a bloqué les principales routes de Napoléon vers les provinces du sud et a également créé une menace constante pour les communications arrière des Français.
Napoléon a qualifié Moscou non pas de position militaire, mais de position politique. Ainsi, il tente à plusieurs reprises de se réconcilier avec Alexandre Ier. A Moscou, Napoléon se retrouve pris au piège : il n'était pas possible de passer l'hiver dans une ville dévastée par un incendie, le fourrage en dehors de la ville ne se passait pas bien, les communications françaises s'étendant sur des milliers de kilomètres étaient très vulnérables, l'armée, après avoir subi des épreuves, a commencé à se désintégrer. Le 5 octobre, Napoléon envoya le général Lauriston à Koutouzov pour passer chez Alexandre Ier avec l'ordre : « J'ai besoin de paix, j'en ai absolument besoin à tout prix, sauf seulement l'honneur" Kutuzov, après une courte conversation, renvoya Lauriston à Moscou. Napoléon commença à préparer une retraite non pas encore de Russie, mais vers des quartiers d'hiver quelque part entre le Dniepr et la Dvina.
La retraite de Napoléon (octobre-décembre 1812)
L'armée principale de Napoléon a entaillé profondément la Russie comme un coin. Au moment où Napoléon entre à Moscou, l'armée de Wittgenstein, tenue par les corps français de Saint-Cyr et d'Oudinot, surplombe son flanc gauche au nord dans la région de Polotsk. Le flanc droit de Napoléon a été piétiné près des frontières de l'Empire russe en Biélorussie. L'armée de Tormasov associe à sa présence le corps autrichien de Schwarzenberg et le 7e corps de Rainier. Les garnisons françaises le long de la route de Smolensk gardaient la ligne de communication et les arrières de Napoléon.
De Moscou à Maloyaroslavets (octobre 1812)
Le 18 octobre, Koutouzov lance une attaque contre la barrière française sous le commandement de Murat, qui surveillait l'armée russe près de Tarutino. Ayant perdu jusqu'à 4 000 soldats et 38 canons, Murat se retira à Moscou. La bataille de Tarutino est devenue un événement marquant, marquant la transition de l'armée russe vers une contre-offensive.
Le 19 octobre, l'armée française (110 000) avec un énorme convoi a commencé à quitter Moscou par l'ancienne route de Kalouga. Napoléon, en prévision de l'hiver prochain, envisageait de se rendre à la grande base la plus proche, Smolensk, où, selon ses calculs, étaient stockés des fournitures pour l'armée française en difficulté. Dans les conditions tout-terrain russes, il était possible de se rendre à Smolensk par une route directe, la route de Smolensk, par laquelle les Français arrivaient à Moscou. Une autre route menait vers le sud à travers Kaluga. La deuxième route était préférable, car elle traversait des zones non ravagées et la perte de chevaux due au manque de fourrage dans l'armée française atteignait des proportions alarmantes. En raison du manque de chevaux, la flotte d'artillerie fut réduite et les grandes formations de cavalerie française disparurent pratiquement.
La route vers Kalouga était bloquée par l'armée de Napoléon, positionnée près de Tarutino sur l'ancienne route de Kalouga. Ne voulant pas percer une position fortifiée avec une armée affaiblie, Napoléon a tourné dans la zone du village de Troitskoye (Troitsk moderne) sur la nouvelle route de Kaluga (autoroute moderne de Kiev) pour contourner Tarutino.
Cependant, Koutouzov transféra l'armée à Maloyaroslavets, coupant ainsi la retraite française le long de la nouvelle route de Kalouga.
Le 24 octobre eut lieu la bataille de Maloyaroslavets. Les Français ont réussi à capturer Maloyaroslavets, mais Kutuzov a pris une position fortifiée à l'extérieur de la ville, que Napoléon n'a pas osé prendre d'assaut. Au 22 octobre, l'armée de Koutouzov comptait 97 000 soldats réguliers, 20 000 cosaques, 622 canons et plus de 10 000 miliciens. Napoléon disposait de jusqu'à 70 000 soldats prêts au combat, la cavalerie avait pratiquement disparu et l'artillerie était beaucoup plus faible que celle russe. Le cours de la guerre était désormais dicté par l’armée russe.
Le 26 octobre, Napoléon ordonna la retraite vers le nord, vers Borovsk-Vereya-Mozhaisk. Les batailles pour Maloyaroslavets furent vaines pour les Français et ne firent que retarder leur retraite. De Mojaïsk, l'armée française reprit son mouvement vers Smolensk le long de la route par laquelle elle avançait vers Moscou.
De Maloyaroslavets à la Bérézina (octobre-novembre 1812)
De Maloyaroslavets au village de Krasny (45 km à l'ouest de Smolensk), Napoléon est poursuivi par l'avant-garde de l'armée russe sous le commandement de Miloradovitch. Les cosaques et les partisans de Platov attaquèrent de tous côtés les Français en retraite, ne laissant à l'ennemi aucune possibilité de ravitaillement. L'armée principale de Koutouzov s'est lentement déplacée vers le sud parallèlement à Napoléon, effectuant ce qu'on appelle la marche de flanc.
Le 1er novembre, Napoléon passe Viazma, le 8 novembre il entre à Smolensk, où il passe 5 jours à attendre les retardataires. Le 3 novembre, l'avant-garde russe a sévèrement battu le dernier corps français lors de la bataille de Viazma. Napoléon avait à sa disposition à Smolensk jusqu'à 50 000 soldats sous les armes (dont seulement 5 000 cavaliers) et à peu près le même nombre de soldats inaptes qui furent blessés et perdirent leurs armes.
Les unités de l'armée française, considérablement réduites en marche depuis Moscou, entrèrent à Smolensk pendant une semaine entière dans l'espoir de se reposer et de se nourrir. Il n'y avait pas de grandes réserves de nourriture dans la ville, et ce qui s'y trouvait était pillé par des foules incontrôlables de soldats de la Grande Armée. Napoléon ordonna l'exécution de l'intendant français Sioff qui, face à la résistance des paysans, ne parvint pas à organiser la collecte de nourriture.
La position stratégique de Napoléon s'était fortement détériorée, l'armée du Danube de Chichagov approchait par le sud, Wittgenstein avançait par le nord, dont l'avant-garde s'emparait de Vitebsk le 7 novembre, privant les Français des réserves alimentaires qui y étaient accumulées.
Le 14 novembre, Napoléon et la garde quittent Smolensk à la suite du corps d'avant-garde. Le corps de Ney, qui était à l'arrière-garde, ne quitta Smolensk que le 17 novembre. La colonne des troupes françaises était considérablement étendue, car les difficultés de la route empêchaient une marche compacte de grandes masses de personnes. Koutouzov a profité de cette circonstance pour couper la route de retraite des Français dans la région de Krasnoïe. Du 15 au 18 novembre, à la suite des combats près de Krasny, Napoléon réussit à percer, perdant de nombreux soldats et la majeure partie de l'artillerie.
L'armée du Danube de l'amiral Chichagov (24 000) s'empare de Minsk le 16 novembre, privant Napoléon de son plus grand centre arrière. De plus, le 21 novembre, l'avant-garde de Chichagov s'empare de Borissov, là où Napoléon envisageait de traverser la Bérézina. Le corps d'avant-garde du maréchal Oudinot chassa Chichagov de Borissov jusqu'à la rive ouest de la Bérézina, mais l'amiral russe, doté d'une forte armée, gardait les éventuels points de passage.
Le 24 novembre, Napoléon s'approche de la Bérézina, rompant avec les armées de Wittgenstein et de Koutouzov.
De la Bérézina à Néman (novembre-décembre 1812)
Le 25 novembre, grâce à une série de manœuvres habiles, Napoléon réussit à détourner l’attention de Chichagov vers Borisov et le sud de Borisov. Chichagov pensait que Napoléon avait l'intention de traverser par ces endroits afin de prendre un raccourci vers la route de Minsk et de se diriger ensuite vers les alliés autrichiens. Pendant ce temps, les Français ont construit 2 ponts au nord de Borisov, le long desquels, les 26 et 27 novembre, Napoléon a traversé la rive droite (ouest) de la Bérézina, chassant les faibles gardes russes.
Conscient de son erreur, Chichagov attaque Napoléon avec ses forces principales le 28 novembre sur la rive droite. Sur la rive gauche, l'arrière-garde française défendant le passage est attaquée par le corps de Wittgenstein qui s'approche. L'armée principale de Koutouzov a pris du retard. Sans attendre que toute la foule immense des traînards français, composée de blessés, de gelés, de ceux qui ont perdu leurs armes et de civils, ait traversé, Napoléon a ordonné l'incendie des ponts le matin du 29 novembre. Le principal résultat de la bataille de la Bérézina fut que Napoléon évita une défaite totale dans des conditions de supériorité significative des forces russes. Dans la mémoire des Français, le franchissement de la Bérézina n'occupe pas moins de place que la plus grande bataille de Borodino.
Ayant perdu jusqu'à 30 000 personnes au passage, Napoléon, avec 9 000 soldats restés sous les armes, se dirigea vers Vilna, rejoignant en chemin les divisions françaises opérant dans d'autres directions. L'armée était accompagnée d'une foule nombreuse de personnes inaptes, principalement des soldats des États alliés qui avaient perdu leurs armes. Le déroulement de la guerre dans sa phase finale, la poursuite pendant deux semaines par l'armée russe des restes des troupes napoléoniennes jusqu'à la frontière de l'Empire russe, est décrit dans l'article « De la Bérézina au Néman ». Les fortes gelées qui frappent pendant la traversée finissent par exterminer les Français, déjà affaiblis par la faim. La poursuite des troupes russes n'a pas donné à Napoléon l'occasion de rassembler au moins quelques forces à Vilna ; la fuite des Français s'est poursuivie vers le Néman, qui séparait la Russie de la Prusse et de l'État tampon du duché de Varsovie.
Le 6 décembre, Napoléon quitte l'armée et se rend à Paris pour recruter de nouveaux soldats pour remplacer ceux tués en Russie. Sur les 47 000 gardes d'élite qui sont entrés en Russie avec l'empereur, six mois plus tard, il ne restait que quelques centaines de soldats.
Le 14 décembre, à Kovno, les restes pitoyables de la « Grande Armée », au nombre de 1 600 personnes, traversèrent le Neman pour entrer en Pologne, puis en Prusse. Plus tard, ils furent rejoints par les restes de troupes venues d’autres directions. La guerre patriotique de 1812 s'est terminée par la destruction presque complète de la « Grande Armée » envahissante.
La dernière étape de la guerre a été commentée par l'observateur impartial Clausewitz :
Direction nord (octobre-décembre 1812)
Après la 2e bataille de Polotsk (18-20 octobre), qui eut lieu 2 mois après la 1re, le maréchal Saint-Cyr se replia vers le sud jusqu'à Chashniki, rapprochant dangereusement l'armée de Wittgenstein de la ligne arrière de Napoléon. Durant ces jours, Napoléon commença sa retraite de Moscou. Le 9e corps du maréchal Victor, arrivé en septembre comme réserve de Napoléon d'Europe, fut immédiatement envoyé au secours de Smolensk. Les forces combinées des Français atteignirent 36 000 soldats, ce qui correspondait approximativement aux forces de Wittgenstein. Une bataille imminente eut lieu le 31 octobre près de Chashniki, à la suite de laquelle les Français furent vaincus et reculés encore plus au sud.
Vitebsk est restée découverte ; un détachement de l’armée de Wittgenstein a pris d’assaut la ville le 7 novembre, capturant 300 soldats de la garnison et des vivres pour l’armée en retraite de Napoléon. Le 14 novembre, le maréchal Victor, près du village de Smolyan, tenta de repousser Wittgenstein de l'autre côté de la Dvina, mais sans succès, et les partis maintinrent leurs positions jusqu'à ce que Napoléon s'approche de la Bérézina. Puis Victor, rejoignant l'armée principale, se retira dans la Bérézina comme arrière-garde de Napoléon, retenant la pression de Wittgenstein.
Dans les États baltes près de Riga, une guerre de position a été menée avec de rares incursions russes contre le corps de MacDonald. Le corps finlandais du général Steingel (12 000) est venu en aide à la garnison de Riga le 20 septembre, mais après une sortie réussie le 29 septembre contre l'artillerie de siège française, Steingel a été transféré à Wittgenstein à Polotsk sur le théâtre des principales opérations militaires. Le 15 novembre, Macdonald, à son tour, attaque avec succès les positions russes, détruisant presque un important détachement russe.
Le 10e corps du maréchal MacDonald ne commença sa retraite de Riga vers la Prusse que le 19 décembre, après que les restes pitoyables de l'armée principale de Napoléon eurent quitté la Russie. Le 26 décembre, les troupes de MacDonald durent engager la bataille avec l'avant-garde de Wittgenstein. Le 30 décembre, le général russe Dibich a conclu un accord d'armistice avec le commandant du corps prussien, le général York, connu au lieu de signature sous le nom de Convention de Taurogen. Ainsi, Macdonald perdit ses principales forces et dut se retirer précipitamment à travers la Prusse orientale.
Direction sud (octobre-décembre 1812)
Le 18 septembre, l'amiral Chichagov avec une armée (38 000) s'est approché du Danube jusqu'au front sud lent de la région de Loutsk. Les forces combinées de Chichagov et Tormasov (65 000) ont attaqué Schwarzenberg (40 000), obligeant ce dernier à partir pour la Pologne à la mi-octobre. Chichagov, qui a pris le commandement principal après le rappel de Tormasov, a donné aux troupes un repos de 2 semaines, après quoi, le 27 octobre, il a déménagé de Brest-Litovsk à Minsk avec 24 000 soldats, laissant au général Sacken un effectif de 27 000 hommes. corps contre les Autrichiens Schwarzenberg.
Schwarzenberg poursuivit Chichagov, contournant les positions de Sacken et se couvrant de ses troupes avec le corps saxon de Rainier. Rainier fut incapable de retenir les forces supérieures de Sacken et Schwarzenberg fut contraint de se tourner vers les Russes depuis Slonim. Avec des forces conjointes, Rainier et Schwarzenberg chassèrent Sacken au sud de Brest-Litovsk. Cependant, l'armée de Chichagov pénétra à l'arrière de Napoléon et occupa Minsk le 16 novembre, et le 21 novembre s'approcha de Borisov sur la Bérézina, où Napoléon en retraite prévoyait traverser.
Le 27 novembre, Schwarzenberg, sur ordre de Napoléon, se dirigea vers Minsk, mais s'arrêta à Slonim, d'où le 14 décembre il se retira via Bialystok vers la Pologne.
Résultats de la guerre patriotique de 1812
Napoléon, génie reconnu de l'art militaire, envahit la Russie avec des forces trois fois supérieures aux armées de la Russie occidentale sous le commandement de généraux non marqués par de brillantes victoires, et après seulement six mois de campagne, son armée, la plus forte de l'histoire, fut complètement détruit.
La destruction de près de 550 000 soldats dépasse l’imagination même des historiens occidentaux modernes. Un grand nombre d'articles sont consacrés à la recherche des raisons de la défaite du plus grand commandant et à l'analyse des facteurs de la guerre. Les raisons les plus fréquemment invoquées sont le mauvais état des routes en Russie et le gel ; certains tentent d'expliquer la défaite par la mauvaise récolte de 1812, raison pour laquelle il n'a pas été possible d'assurer un approvisionnement normal.
La campagne de Russie (dans les noms occidentaux) a reçu le nom de Patriotique en Russie, ce qui explique la défaite de Napoléon. Une combinaison de facteurs a conduit à sa défaite : la participation populaire à la guerre, l'héroïsme massif des soldats et des officiers, le talent de leadership de Koutouzov et d'autres généraux et l'utilisation habile des facteurs naturels. La victoire dans la Guerre patriotique a provoqué non seulement une montée de l'esprit national, mais aussi un désir de moderniser le pays, qui a finalement conduit au soulèvement des décembristes en 1825.
Clausewitz, analysant la campagne de Napoléon en Russie d’un point de vue militaire, arrive à la conclusion :
Selon les calculs de Clausewitz, l'armée d'invasion en Russie, ainsi que les renforts pendant la guerre, comptaient 610 mille des soldats, dont 50 mille soldat de l'Autriche et de la Prusse. Alors que les Autrichiens et les Prussiens, opérant dans des directions secondaires, survécurent pour la plupart, seule l'armée principale de Napoléon s'était rassemblée de l'autre côté de la Vistule en janvier 1813. 23 mille soldat. Napoléon a perdu 550 mille des soldats entraînés, toute la garde d'élite, plus de 1 200 canons.
Selon les calculs du fonctionnaire prussien Auerswald, au 21 décembre 1812, 255 généraux, 5 111 officiers et 26 950 soldats de rang inférieur avaient traversé la Prusse orientale en provenance de la Grande Armée, « dans un état pitoyable et pour la plupart sans armes ». Beaucoup d'entre eux, selon le comte Ségur, moururent de maladie en arrivant en territoire sûr. À ce nombre, il faut ajouter environ 6 000 soldats (revenus dans l'armée française) des corps Rainier et Macdonald, opérant dans d'autres directions. Apparemment, parmi tous ces soldats de retour, 23 000 (mentionnés par Clausewitz) se sont ensuite rassemblés sous le commandement des Français. Le nombre relativement important d'officiers survivants permet à Napoléon d'organiser une nouvelle armée, appelant les recrues de 1813.
Dans un rapport adressé à l'empereur Alexandre Ier, le maréchal Koutouzov estime le nombre total de prisonniers français à 150 mille homme (décembre 1812).
Bien que Napoléon ait réussi à rassembler de nouvelles forces, leurs qualités combattantes ne pouvaient pas remplacer les anciens combattants morts. La guerre patriotique de janvier 1813 s'est transformée en « campagne étrangère de l'armée russe » : les combats se sont déplacés sur le territoire de l'Allemagne et de la France. En octobre 1813, Napoléon fut vaincu à la bataille de Leipzig et abdiqua du trône de France en avril 1814 (voir article Guerre de la Sixième Coalition).
L'historien du milieu du XIXe siècle M.I. Bogdanovich a retracé la reconstitution des armées russes pendant la guerre selon les déclarations des archives scientifiques militaires de l'état-major. Il a estimé les renforts de l'armée principale à 134 000 personnes. Au moment de l'occupation de Vilna en décembre, l'armée principale comptait 70 000 soldats dans ses rangs, et la composition des 1re et 2e armées occidentales au début de la guerre s'élevait à 150 000 soldats. Ainsi, la perte totale en décembre s'élève à 210 000 soldats. Parmi eux, selon l’hypothèse de Bogdanovich, jusqu’à 40 000 blessés et malades ont repris leurs fonctions. Les pertes des corps opérant dans les directions secondaires et les pertes des milices pourraient s'élever à environ 40 000 personnes. Sur la base de ces calculs, Bogdanovich estime les pertes de l'armée russe pendant la guerre patriotique à 210 000 soldats et milices.
Mémoire de la guerre de 1812
Le 30 août 1814, l'empereur Alexandre Ier publia un Manifeste : « Le 25 décembre, jour de la Nativité du Christ, sera désormais un jour de célébration d'action de grâce sous le nom dans le cercle ecclésial : la Nativité de notre Sauveur Jésus-Christ et le souvenir de la délivrance de l'Église et de l'Empire russe de l'invasion. des Gaulois et avec eux les vingt langues».
Le plus haut manifeste sur l'action de grâce à Dieu pour la libération de la Russie 25/12/1812
|
Dieu et le monde entier en sont témoins avec quels désirs et avec quelle force l'ennemi est entré dans notre patrie bien-aimée. Rien ne pouvait détourner ses intentions mauvaises et obstinées. S'appuyant fermement sur ses propres forces et sur les forces terribles qu'il avait rassemblées contre Nous auprès de presque toutes les puissances européennes, et poussé par l'avidité de la conquête et la soif de sang, il s'empressa de faire irruption au sein même de Notre Grand Empire pour y déverser sur lui toutes les horreurs et les désastres qui n'ont pas été générés par hasard, mais depuis les temps anciens, la guerre dévastatrice qui leur était préparée. Connaissant par expérience la soif sans bornes du pouvoir et l'impudence de ses entreprises, la coupe amère des maux préparés par lui pour Nous, et le voyant déjà entrer dans Nos frontières avec une rage indomptable, Nous avons été contraints, d'un cœur douloureux et contrit, d'invoquer Dieu pour obtenir de l'aide, dégainons notre épée et promettons à Notre Royaume que Nous ne la mettrons pas dans le vagin, jusqu'à ce qu'au moins un des ennemis reste armé dans Notre pays. Nous avons placé cette promesse fermement dans nos cœurs, espérant la grande valeur du peuple qui nous a été confié par Dieu et dans lequel nous ne nous sommes pas trompés. Quel exemple de courage, de courage, de piété, de patience et de fermeté la Russie a montré ! L'ennemi qui lui avait brisé la poitrine avec tous les moyens inouïs de cruauté et de frénésie n'a pas pu parvenir au point qu'elle soupire ne serait-ce qu'une seule fois à propos des blessures profondes qu'il lui a infligées. Il semblait qu'avec l'effusion de son sang, l'esprit de courage augmentait en elle, avec les incendies de ses villes, l'amour pour la Patrie s'enflammait, avec la destruction et la profanation des temples de Dieu, la foi se confirmait en elle et inconciliable la vengeance surgit. L'armée, la noblesse, la noblesse, le clergé, les marchands, le peuple, en un mot, tous les grades et toutes les fortunes du gouvernement, n'épargnant ni leurs biens ni leur vie, formaient une seule âme, une âme à la fois courageuse et pieuse, autant flamboyant d'amour pour la Patrie comme d'amour pour Dieu. De ce consentement et de ce zèle universels naquirent bientôt des conséquences qui n'étaient guère incroyables, dont on n'entendait presque jamais parler. Que ceux rassemblés de 20 royaumes et nations, unis sous une même bannière, imaginent les forces terribles avec lesquelles l'ennemi avide de pouvoir, arrogant et féroce est entré dans Notre pays ! Un demi-million de fantassins et de cavaliers et environ un millier et demi de canons le suivirent. Avec une milice aussi énorme, il pénètre jusqu'au milieu de la Russie, se propage et commence à semer le feu et la dévastation partout. Mais six mois à peine se sont écoulés depuis qu’il est entré dans Nos frontières, et où est-il ? Il convient ici de répéter les paroles du Chanteur sacré : « J'ai vu les méchants élevés et imposants comme les cèdres du Liban. Et je suis passé par là, et voici, je l'ai cherché, et sa place n'a pas été trouvée. En vérité, cette noble parole s’est réalisée dans toute la puissance de sa signification sur notre orgueilleux et méchant ennemi. Où sont ses troupes, comme une nuée de nuages noirs poussés par les vents ? Dispersé comme la pluie. Une grande partie d'entre eux, ayant arrosé la terre de sang, recouvrent l'espace des champs de Moscou, Kalouga, Smolensk, Biélorusse et Lituanien. Une autre grande part dans des batailles diverses et fréquentes fut faite prisonnière avec de nombreux chefs militaires et généraux, et de telle manière qu'après des défaites répétées et sévères, leurs régiments entiers, recourant à la générosité des vainqueurs, inclinèrent les armes devant eux. Le reste, tout aussi nombreux, chassés dans leur fuite rapide par nos troupes victorieuses et accueillis par la racaille et la famine, parcouraient le chemin de Moscou jusqu'aux frontières de la Russie avec des cadavres, des canons, des charrettes, des obus, de sorte que le plus petit, le plus insignifiant une partie des épuisés restant de toutes leurs nombreuses forces et des guerriers désarmés, à peine à moitié morts, peuvent venir dans leur pays, pour les informer, à l'horreur et au tremblement éternels de leurs compatriotes, puisqu'une terrible exécution s'abat sur ceux qui osez, avec des intentions abusives, pénétrer dans les entrailles de la puissante Russie. Maintenant, avec une joie sincère et une ardente gratitude envers Dieu, Nous annonçons à Nos chers et fidèles sujets que l'événement a dépassé même Notre espérance et que ce que Nous avons annoncé au début de cette guerre s'est réalisé au-delà de toute mesure : il n'y a plus de un seul ennemi sur la face de Notre terre ; ou mieux encore, ils sont tous restés ici, mais comment ? morts, blessés et prisonniers. Le fier souverain et chef lui-même pouvait à peine s'enfuir avec ses fonctionnaires les plus importants, ayant perdu toute son armée et tous les canons qu'il avait apportés avec lui, qui, plus d'un millier, sans compter ceux qu'il avait enterrés et coulés, lui furent repris. et sont entre nos mains. Le spectacle de la mort de ses troupes est incroyable ! Vous pouvez à peine en croire vos propres yeux ! Qui pourrait faire ça ? Sans enlever une gloire digne ni au célèbre commandant en chef de nos troupes, qui a apporté des mérites immortels à la patrie, ni à d'autres chefs et chefs militaires habiles et courageux qui se sont distingués par leur zèle et leur zèle ; ni en général pour l'ensemble de Notre courageuse armée, nous pouvons dire que ce qu'ils ont fait dépasse les forces humaines. Reconnaissons donc la providence de Dieu dans cette grande affaire. Prosternons-nous devant son saint trône, et voyant clairement sa main, punissant l'orgueil et la méchanceté, au lieu de la vanité et de l'arrogance à propos de nos victoires, apprenons de ce grand et terrible exemple à être doux et humbles exécutant ses lois et sa volonté, pas comme ces profanateurs qui se sont éloignés des temples de la foi de Dieu, Nos ennemis, dont les corps en nombre incalculable sont éparpillés comme nourriture pour chiens et corvidés ! Grand est le Seigneur notre Dieu dans sa miséricorde et dans sa colère ! Allons par la bonté de nos actes et la pureté de nos sentiments et de nos pensées, seul chemin qui mène à Lui, au temple de sa sainteté, et là, couronnés de gloire par sa main, rendons grâce pour la générosité versée. sur nous, et tombons vers Lui avec de chaleureuses prières, afin qu'Il puisse étendre Sa miséricorde sur Par Nous, et en cessant les guerres et les batailles, Il Nous enverra la victoire ; désirait la paix et le silence. |
La fête de Noël était également célébrée comme le Jour de la Victoire moderne jusqu'en 1917.
Pour commémorer la victoire de la guerre, de nombreux monuments et mémoriaux ont été érigés, parmi lesquels les plus célèbres sont la cathédrale du Christ-Sauveur et l'ensemble de la place du Palais avec la colonne Alexandre. Un projet grandiose a été mis en œuvre en peinture, la Galerie militaire, composée de 332 portraits de généraux russes ayant participé à la guerre patriotique de 1812. L’une des œuvres les plus célèbres de la littérature russe est le roman épique « Guerre et Paix », dans lequel L. N. Tolstoï tente de comprendre les problèmes humains mondiaux sur fond de guerre. Le film soviétique Guerre et Paix, basé sur le roman, a remporté un Oscar en 1968 ; ses scènes de bataille à grande échelle sont toujours considérées comme inégalées.
Au début de sa campagne de Russie de 1812, le 11 (23) au matin, il adressa un appel à la « Grande Armée » déjà mobilisée et préparée pour l’invasion. Ça disait:
« Guerriers ! La Seconde Guerre de Pologne commence. La première s'est terminée sous Friedland et Tilsit... La Russie nous donne le choix entre le déshonneur ou la guerre, cela ne fait aucun doute. Nous irons de l'avant, traverserons le Néman et y amènerons la guerre.
La Seconde Guerre de Pologne glorifiera les armes françaises autant que la première. Mais la paix que nous instaurerons sera durable et détruira cinquante ans d’influence russe fière et déplacée dans les affaires européennes.»
Le même jour, à 21 heures, la traversée du fleuve Néman a commencé.
Traversée du Néman par Napoléon. Gravure colorisée. D'ACCORD. 1816
.jpg)
A. Albrecht. Le corps italien d'Eugène Beauharnais traverse le Néman. 30 juin 1812
La « Grande Armée » de Napoléon envahit la Russie soudainement, sans déclaration de guerre préalable. Voilà une « petite » astuce militaire. Le 10 (22) juin, l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg A. Lauriston a présenté au chef du ministère des Affaires étrangères de Russie, le prince A.I. La note de Saltykov. Il s’ensuit que désormais l’empereur Napoléon Ier Bonaparte « se considère en état de guerre avec la Russie ». A Vilna, où se trouvait le souverain russe, le billet n'a été livré que trois jours plus tard.
Napoléon a rejeté la proposition de paix, car à ce moment-là ses unités d'avant-garde étaient déjà sur le territoire russe et avançaient. Il demanda au général russe :
Dites-moi, pour aller à Moscou, quelle est la meilleure route à prendre ?
A la question arrogante de l'Empereur de France, le lieutenant-général A.D. Balachov répondit sèchement et brièvement :
Charles XII a traversé Poltava...
Le 12 (24) juin, l'empereur Alexandre Ier a signé le Manifeste sur le début de la guerre avec la France. Il a appelé tous les secteurs de la société à défendre la foi, la patrie et la liberté et a déclaré résolument :
"...Je ne déposerai pas les armes tant qu'il ne restera plus un seul guerrier ennemi dans Mon Royaume."
La supériorité de la « Grande Armée » en termes de force, ainsi que l'échec du déploiement stratégique des armées russes à la frontière, leur manque de direction unifiée, ont obligé les commandants de l'armée à chercher une issue à la situation actuelle, qui a été observée dans la connexion rapide des 1re et 2e armées occidentales. Mais cela ne pouvait être accompli qu’en se retirant plus profondément sur leur territoire dans des directions convergentes.
Avec les combats d'arrière-garde, les armées russes furent contraintes de battre en retraite...
Avec des combats d'arrière-garde, les 1re et 2e armées occidentales furent contraintes de battre en retraite sous la pression de forces ennemies supérieures. La 1re armée occidentale quitta Vilna et se retira dans le camp de Dris, et bientôt un écart de 200 km s'ouvrit entre les armées. Les principales forces des troupes napoléoniennes s'y sont précipitées, occupant Minsk le 26 juin (8 juillet) et créant la menace de vaincre les armées russes une à une.
Cependant, un tel mouvement offensif des Français ne s'est pas déroulé sans heurts pour eux. Le 16 (28) juin, le détachement d'arrière-garde du général de division livre une bataille acharnée à l'avant-garde du corps du maréchal près de Vilkomir. Le même jour, le corps cosaque volant du général combattit l'ennemi près de Grodno.
Après avoir pris Vilna sans combat, Napoléon, changeant ses plans, décide d'attaquer la 2e armée occidentale, de l'encercler et de la détruire. A cet effet, les troupes de E. Beauharnais (30 000 personnes) et de J. Bonaparte (55 000 personnes) ont été allouées, et le corps de 50 000 hommes du maréchal L. Davout a reçu l'ordre, se déplaçant à l'est de Minsk, de se rendre à l'arrière russe et fermer l'encerclement.
PI. Bagration n'a réussi à éviter la menace d'encerclement que grâce à une retraite forcée en direction du sud-est. Manœuvrant habilement parmi les forêts biélorusses, le commandant a rapidement retiré ses troupes via Bobruisk jusqu'à Moguilev.
Le 6 (18) juillet, l'empereur Alexandre Ier s'est adressé au peuple russe avec un appel à se rassembler au sein de l'État.
La « Grande Armée » fondait sous nos yeux à mesure qu’elle s’enfonçait plus profondément en Russie. L'empereur français a dû allouer des forces importantes contre les troupes russes qui se trouvaient sur ses flancs. Sur le chemin de Moscou, le corps de 30 000 hommes de Ch. Rainier et la 3e armée occidentale sont restés sur place. Contre le 26 millième corps du lieutenant général, opérant en direction de Saint-Pétersbourg, les corps de N. Oudinot (38 000 personnes) et (30 000 personnes) ont été détachés des forces principales. Un corps de 55 000 hommes fut envoyé pour capturer Riga.
Après l'occupation de Mogilev par les Français, les armées russes ont continué à battre en retraite en direction de Smolensk. Au cours de la retraite, plusieurs combats d'arrière-garde acharnés ont eu lieu - près de Mir, Ostrovno et Saltanovka.
.jpg)
R. Adam. Bataille d'Ostrovno 27 juillet 1812 1845
Lors de la bataille près de la ville de Mir le 27 juin (9 juillet), la cavalerie cosaque du général de cavalerie M.I. Platova inflige une sévère défaite à la cavalerie ennemie. Le 11 (23) juillet près de Saltanovka, la 26e division d'infanterie du général de division I.F. combattit vaillamment. Paskevich, qui a résisté au coup des forces françaises supérieures.
.jpg)
N.-É. Samokish. L'exploit des soldats de Raevsky près de Saltanovka. 1912
Batailles de Smolensk et Polotsk, batailles près de Kobryn et Gorodechny
Le 22 juillet (3 août), les armées russes se sont unies près de Smolensk, gardant leurs forces principales prêtes au combat. Ici s'est déroulée la première grande bataille de la guerre patriotique de 1812. La bataille de Smolensk a duré trois jours : du 4 (16) août au 6 (18) août.
Les régiments russes repoussèrent toutes les attaques des Français et ne se retirèrent que sur ordre, laissant à l'ennemi une ville en feu, dans laquelle sur 2 250 maisons seulement survécurent environ 350. Presque tous les habitants la quittèrent avec les troupes. Une résistance courageuse près de Smolensk a contrecarré le plan de Napoléon visant à imposer une bataille générale aux principales forces russes dans des conditions défavorables pour elles.
.jpg)
PENNSYLVANIE. Krivonogov. Défense de Smolensk. 1966
Les échecs ont frappé l’avancée de la « Grande Armée » non seulement près de Smolensk et de Valutina Gora. Une tentative des Français d'avancer en direction de Saint-Pétersbourg avec les corps de N. Oudinot et L. Saint-Cyr (renforcés par les troupes bavaroises) s'est soldée par une défaite lors des batailles de Klyastitsy et Golovchitsy du 18 au 20 juillet (30 juillet). - 1 août). Le corps du général C. Renier échoua à Kobryn le 15 (27) juillet et à Gorodechna le 31 juillet (12 août), et le maréchal J. MacDonald ne put s'emparer de Riga.
Nomination du commandant en chef M.I. Koutouzova
Après les batailles de Smolensk, les armées russes unies ont continué leur retraite vers Moscou. La stratégie de retraite de M.B., impopulaire ni dans l’armée ni dans la société russe. Barclay de Tolly, laissant un territoire important à l'ennemi, a contraint l'empereur Alexandre Ier à créer le poste de commandant en chef de toutes les armées russes et, le 8 (20) août, à y nommer un général d'infanterie de 66 ans.
Sa candidature a été soutenue à l'unanimité par la Commission extraordinaire de sélection du commandant en chef. Le commandant Kutuzov, qui possédait une vaste expérience du combat, était populaire parmi l'armée russe et parmi la noblesse. L'empereur le plaça non seulement à la tête de l'armée active, mais lui subordonna également les milices, les réserves et les autorités civiles dans les provinces touchées par la guerre.
Des courriers ont été envoyés de la capitale aux quartiers généraux des 1re, 2e, 3e armées de l'Ouest et du Danube avec notification de la nomination du commandant en chef. 17 (29) août M.I. Koutouzov est arrivé au quartier général de l'armée. Lorsque Napoléon apprit l'apparition du commandant en chef qui lui était si familier dans le camp ennemi, il prononça une phrase devenue prophétique: "Koutuzov ne pouvait pas venir pour continuer la retraite".
Le commandant russe a été accueilli par les troupes avec beaucoup d'enthousiasme. Les soldats ont déclaré : « Koutouzov est venu battre les Français. » Tout le monde comprit que désormais la guerre prendrait un tout autre caractère. Les troupes commencèrent à parler d’une bataille générale imminente avec la « Grande Armée » de Napoléon et de la fin de la retraite.
.jpg)
S.V. Gérasimov. Arrivée de M.I. Kutuzov à Tsarevo-Zaimishche. 1957
Cependant, le commandant en chef a refusé de livrer une bataille générale à l'ennemi à Tsarevo-Zaimishche, considérant la position choisie comme défavorable aux troupes russes. Après avoir retiré l'armée pour plusieurs marches vers Moscou, M.I. Kutuzov s'est arrêté devant la ville de Mozhaisk. Le vaste champ situé près du village de Borodino a permis de positionner les troupes avec le plus grand avantage et de bloquer simultanément les routes de l'ancienne et de la nouvelle Smolensk.
23 août (4 septembre) Le maréchal M.I. Golenishchev-Kutuzov rapporta à l'empereur Alexandre Ier : « La position dans laquelle je me suis arrêté au village de Borodino, 12 verstes devant Mozhaisk, est l'une des meilleures, que l'on ne peut trouver que dans des endroits plats. Le point faible de cette position, qui se trouve sur le flanc gauche, je vais essayer de le corriger avec l'art. Il est souhaitable que l'ennemi nous attaque dans cette position ; alors j’ai un grand espoir de victoire.
.jpg)
L'offensive de la « Grande Armée » de Napoléon pendant la guerre patriotique de 1812
Bataille pour la redoute Chevardinsky
La bataille de Borodino a eu son propre prologue - la bataille de la redoute Shevardinsky le 24 août (5 septembre) sur l'extrême flanc gauche de la position russe. Ici, la 27e division d'infanterie du major-général et le 5e régiment Jaeger tenaient la défense. En deuxième ligne se trouvait le 4e corps de cavalerie du général de division K.K. Sievers. Au total, ces troupes, sous le commandement général d'un lieutenant général, comptaient 8 000 fantassins, 4 000 cavaliers et 36 canons.
Une bataille féroce et sanglante a éclaté près de la redoute en terre pentagonale inachevée. Trois divisions d'infanterie du corps du maréchal L. Davout et le corps de cavalerie des généraux E. Nansouty et L.-P. s'approchent de Chevardino. Montbrun tenta de prendre la redoute en mouvement. Au total, environ 30 000 fantassins et 10 000 cavaliers ont attaqué cette fortification de campagne des troupes russes et le feu de 186 canons est tombé. Autrement dit, au début de la bataille de Chevardin, les Français avaient une supériorité en forces plus de trois fois supérieure et une supériorité écrasante en artillerie.
De plus en plus de troupes furent impliquées dans cette affaire. Les échanges de tirs ont dégénéré à maintes reprises en combat au corps à corps. La redoute changea de mains trois fois ce jour-là. Profitant de leur supériorité numérique, les Français, après une bataille acharnée de quatre heures, occupaient encore à 20 heures la fortification presque entièrement détruite, mais ne parvenaient pas à la garder entre leurs mains. Général d'infanterie P.I. Bagration, qui a personnellement mené la bataille, après avoir mené une forte contre-attaque de nuit avec les forces des 2e divisions de grenadiers et 2e cuirassiers, occupe à nouveau la fortification. Au cours de cette bataille, les 57e, 61e et 111e régiments de ligne français défendant dans la redoute subissent d'importantes pertes.
La fortification de campagne a été entièrement détruite par les tirs d'artillerie. Koutouzov se rendit compte que la redoute ne pouvait plus constituer un obstacle sérieux aux troupes napoléoniennes et ordonna à Bagration de se retirer vers les chasses de Semenov. A 23 heures du soir, les Russes quittent la redoute Shevardinsky et emportent les canons avec eux. Trois d'entre eux, dont les voitures étaient cassées, devinrent des trophées ennemis.
Les pertes françaises lors de la bataille de Chevardin s'élevaient à environ 5 000 personnes, les pertes russes étaient à peu près les mêmes. Lorsque le lendemain Napoléon inspecte le 61e régiment de ligne, le plus endommagé de la bataille, il demande au commandant du régiment où était passé l'un de ses deux bataillons. Il répondit : « Sire, il est dans la redoute. »
La bataille générale de la guerre patriotique de 1812 a eu lieu le 26 août (7 septembre) sur le champ de Borodino, célèbre pour ses armes russes. Lorsque la « Grande Armée » s’approcha de Borodino, l’armée de Koutouzov se prépara à l’affronter. Des fortifications de campagne ont été érigées sur le terrain des hauteurs de Kurgan (batterie de Raevsky) et près du village de Semenovskoye (éclairs inachevés de Semenovsky, ou Bagrationovsky).
Napoléon a amené avec lui environ 135 000 personnes avec 587 canons. Kutuzov comptait environ 150 000 personnes avec 624 canons. Mais ce nombre comprenait 28 000 guerriers mal armés et non entraînés des milices de Smolensk et de Moscou et environ 8 000 cavaliers irréguliers (cosaques). Les troupes régulières (113 à 114 000) comprenaient également 14 600 recrues. L'artillerie russe avait la supériorité en termes de nombre de canons de gros calibre, mais 186 d'entre eux n'étaient pas en position de combat, mais dans la réserve principale d'artillerie.
La bataille a commencé à 5 heures du matin et a duré jusqu'à 20 heures. Pendant toute la journée, Napoléon n'a réussi ni à percer la position russe au centre, ni à la contourner par les flancs. Les succès tactiques partiels de l'armée française - les Russes se sont retirés d'environ 1 km de leur position d'origine - n'en sont pas devenus victorieux. Tard dans la soirée, les troupes françaises frustrées et exsangues furent retirées vers leurs positions d'origine. Les fortifications de campagne russes qu'ils prirent furent tellement détruites qu'il ne servait plus à rien de les tenir. Napoléon n'a jamais réussi à vaincre l'armée russe.
La bataille de Borodino n'est pas devenue décisive dans la guerre patriotique de 1812. Napoléon Bonaparte n'a pas réussi à atteindre l'objectif principal de sa campagne en Russie : vaincre l'armée russe dans une bataille générale. Il a gagné tactiquement, mais a perdu stratégiquement. Ce n'est pas un hasard si le grand écrivain russe Léon Nikolaïevitch Tolstoï considérait la bataille de Borodino comme une victoire morale pour les Russes.
Les pertes dans la bataille étant énormes et leurs réserves épuisées, l'armée russe se retira du champ de Borodino et se replia sur Moscou, tout en menant une action d'arrière-garde. Le 1er (13) septembre, au conseil militaire de Fili, une majorité de voix a soutenu la décision du commandant en chef « dans le but de préserver l'armée et la Russie » de laisser Moscou à l'ennemi sans combat. Le lendemain, 2 (14) septembre, les troupes russes quittent la capitale.
Changement d'initiative stratégique
Sous le couvert d'une arrière-garde commandée par un général d'infanterie, la principale armée russe a effectué la manœuvre de marche de Tarutino et s'est installée dans le camp de Tarutino, couvrant de manière fiable le sud du pays.
Napoléon, qui a occupé Moscou après un incendie catastrophique, a langui pendant 36 jours dans l'immense ville incendiée, attendant en vain une réponse à sa proposition de paix à Alexandre Ier, bien sûr, à des conditions qui lui étaient favorables : après tout, les Français "a frappé la Russie en plein cœur."
Cependant, à cette époque, la paysannerie des provinces de la Grande Russie déchirées par la guerre s'est soulevée dans une guerre populaire à grande échelle. Les détachements de partisans de l'armée étaient actifs. L'armée active a été reconstituée par plus d'une douzaine de régiments de cavalerie irrégulière, principalement 26 régiments de la milice cosaque du Don.
Les régiments de l'armée du Danube sont redéployés vers le sud, en Volhynie, qui, unie à la 3e armée d'observation sous le commandement de l'amiral, mène avec succès des opérations contre l'ennemi. Ils repoussèrent les corps autrichiens et saxons de la « Grande Armée », occupèrent Minsk, où se trouvaient les arrière-magasins français, et capturèrent Borissov.
Les troupes de l'empereur français étaient en réalité encerclées : Borissov, situé devant elles, était occupé par les Russes, le corps de Wittgenstein pendait du nord et l'armée principale se déplaçait de l'est. Dans une situation aussi critique, Napoléon a fait preuve d'une énergie extraordinaire et d'une grande compétence en tant que commandant. Il a détourné l'attention de l'amiral P.V. Chichagova a organisé un faux passage au sud de Borissov et a lui-même pu transférer les restes des troupes sur deux ponts construits à la hâte sur la Bérézina à Studenka.
.jpg)
Yu. Falat. Pont sur la Bérézina. 1890
Mais le franchissement de la Bérézina fut un désastre pour la « Grande Armée ». Elle a perdu ici, selon diverses estimations, entre 25 000 et 40 000 personnes tuées, blessées et capturées. Napoléon réussit néanmoins à faire ressortir et à conserver pour l'avenir la fleur de ses généraux, la majeure partie du corps des officiers et de la garde impériale.
.jpg)
P. Hesse. Traversée de la Bérézina. années 1840
La libération du territoire de l'Empire russe de l'ennemi a pris fin le 14 (26) décembre, lorsque les troupes russes ont occupé les villes frontalières de Bialystok et Brest-Litovsk.
Dans un ordre adressé à l'armée, le « sauveur de la patrie », le maréchal Mikhaïl Illarionovitch Golenishchev-Kutuzov, prince de Smolensky, a félicité les troupes pour l'expulsion complète de l'ennemi de Russie et les a appelés à « achever la défaite de l'armée ». ennemi sur ses propres champs. C'est ainsi que s'est terminée la guerre patriotique de 1812, ou, comme l'appelait le grand poète russe A.S.. Pouchkine, « L’orage de la douzième année ».
« L’ennemi avec de pauvres restes a fui par notre frontière »
Le principal résultat de la guerre patriotique de 1812 fut la quasi-destruction de la « Grande Armée » de l’empereur Napoléon Ier. Son prestige politique et la puissance militaire de son empire furent irrémédiablement endommagés.
.jpg)
Artiste inconnu. Le départ de Napoléon de l'armée en 1812
On estime que sur 608 000 personnes qui ont pris part à la campagne de Russie de Napoléon, environ 30 000 personnes ont traversé le Neman. Seuls les corps autrichiens, prussiens et saxons opérant sur les flancs de la « Grande Armée » subirent des pertes mineures. Plus de 550 000 soldats et officiers des pays d'Europe occidentale sont morts sur les champs de bataille russes ou ont été capturés. Le chef d'état-major de la Grande Armée, le maréchal A. Berthier, rapporte à l'empereur des Français : « L'armée n'existe plus ».
.jpg)
E. Kossak. La retraite de Napoléon de Russie. 1827
MI. Golenishchev-Koutuzov écrivit à Alexandre Ier à la fin de la guerre : « L'ennemi et ses pauvres restes ont fui par notre frontière. » Son rapport à l'empereur sur les résultats de la campagne de 1812 disait : « Napoléon entra avec 480 000 hommes et en retira environ 20 000, laissant 150 000 prisonniers et 850 canons en place. »
.jpg)
Retrait de la Grande Armée de Napoléon de Russie
La fin officielle de la guerre patriotique de 1812 est considérée comme le manifeste de l'empereur Alexandre Ier du 25 décembre de la même année. Le souverain victorieux y annonçait publiquement qu’il avait tenu parole de ne pas arrêter la guerre « jusqu’à ce qu’un des ennemis reste sur notre terre ».
L’échec de l’invasion napoléonienne de la Russie et la mort de la « Grande Armée » dans son immensité ne signifiaient pas encore la défaite de la France napoléonienne. Mais la victoire des armes russes en 1812 changea radicalement le climat politique en Europe. Bientôt, le royaume de Prusse et l'empire d'Autriche, alliés de la France, deviennent alliés de la Russie, dont l'armée devient le noyau des forces de la 6e coalition anti-française.
Matériel préparé par l'Institut de recherche (histoire militaire)
Académie militaire de l'état-major
Forces armées de la Fédération de Russie