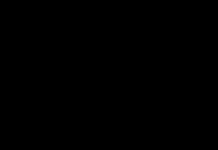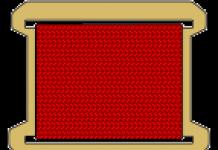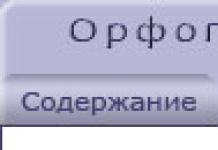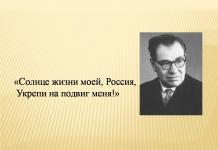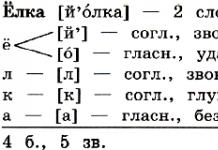La Russie a mené de nombreuses guerres contre les envahisseurs, il y a eu des guerres en guise d'obligations envers les alliés, mais, malheureusement, il y a eu des guerres dont les causes étaient liées aux activités analphabètes des dirigeants du pays.
Histoire du conflit
Tout a commencé de manière assez pacifique, même sous Mikhaïl Gorbatchev, qui, en annonçant le début de la perestroïka, a en fait ouvert la voie à l'effondrement d'un immense pays. C'est à cette époque que l'URSS, qui perdait activement ses alliés en politique étrangère, commença à avoir des problèmes au sein de l'État. Tout d’abord, ces problèmes étaient liés à l’éveil du nationalisme ethnique. Ils se sont manifestés le plus clairement dans les territoires de la Baltique et du Caucase.
Déjà à la fin de 1990, le Congrès national du peuple tchétchène avait été convoqué. Il était dirigé par Dzhokhar Dudayev, major général armée soviétique. L'objectif du congrès était la sécession de l'URSS et la création d'une République tchétchène indépendante. Peu à peu, cette décision a commencé à se réaliser.
Au cours de l'été 1991, une double puissance a été observée en Tchétchénie : le gouvernement de la République socialiste soviétique autonome tchétchène-ingouche lui-même a continué à y travailler et le gouvernement République tchétchène Ichkérie de Dzhokhar Dudayev. Mais en septembre 1991, après l'action infructueuse du Comité d'urgence de l'État, les séparatistes tchétchènes ont estimé qu'un moment favorable était arrivé et les gardes armés de Dudayev ont saisi le centre de télévision, le Conseil suprême et la Maison de la radio. En fait, un coup d'État a eu lieu.
Le pouvoir est passé aux mains des séparatistes et le 27 octobre ont eu lieu des élections législatives et présidentielles dans la république. Tout le pouvoir était concentré entre les mains de Doudaïev.
Néanmoins, le 7 novembre, Boris Eltsine a jugé nécessaire d'instaurer l'état d'urgence en République tchétchène-ingouche et a ainsi créé la raison du déclenchement d'une guerre sanglante. La situation était aggravée par le fait qu'il y avait dans la république une grande quantité d'armes soviétiques, qu'ils n'avaient pas le temps de retirer.
Pendant un certain temps, la situation dans la république resta contenue. Une opposition se crée contre Doudaïev, mais les forces sont inégales.
Le gouvernement Eltsine de l’époque n’avait ni la force ni la volonté politique prendre des mesures efficaces et, en fait, entre 1991 et 1994, la Tchétchénie est devenue pratiquement indépendante de la Russie. Elle a formé ses propres autorités, ses propres symboles d’État. Cependant, en 1994, le gouvernement Eltsine a décidé de rétablir l’ordre constitutionnel en Tchétchénie. Les troupes russes furent amenées sur son territoire, ce qui marqua le début d'une guerre à grande échelle.
Progression des hostilités
|
Attaque de l'aviation fédérale sur les aérodromes tchétchènes. Détruire des avions militants |
|
|
Entrée des troupes fédérales sur le territoire de la Tchétchénie |
|
|
Les troupes fédérales se sont approchées de Grozny |
|
|
Le début de l'assaut sur Grozny |
|
|
Prise du palais présidentiel |
|
|
Création du groupe « Sud » et blocus complet Groznyi |
|
|
Conclusion d'une trêve temporaire |
|
|
Malgré la trêve, les combats de rue continuent. Les groupes militants se retirent de la ville |
|
|
Le dernier quartier de Grozny a été libéré. L'administration pro-russe de la Tchétchénie a été créée, dirigée par S. Khadzhiev et U. Avturkhanov. |
|
|
Capture d'Arghun |
|
|
Shali et Goudermes pris |
|
|
Combats près du village de Semashki |
|
|
avril 1995 |
Fin des combats dans les basses terres de Tchétchénie |
|
Le début des hostilités dans la Tchétchénie montagneuse |
|
|
Capture de Vedeno |
|
|
Les centres régionaux de Shatoi et Nozhai-Yourt ont été pris |
|
|
Attaque terroriste à Boudennovsk |
|
|
Premier cycle de négociations. Moratoire sur lutte Pour une période indéterminée |
|
|
Deuxième cycle de négociations. Un accord sur l'échange de prisonniers « tous contre tous », le désarmement des détachements du ChRI, le retrait des troupes fédérales, le maintien élections libres |
|
|
Les militants capturent Argoun, mais après la bataille, ils sont chassés par les troupes fédérales |
|
|
Goudermes a été capturé par des militants et une semaine plus tard éliminé par les troupes fédérales. |
|
|
Des élections ont eu lieu en Tchétchénie. Vous avez vaincu Doku Zavgaev. |
|
|
Attaque terroriste à Kizliar |
|
|
Attaque militante contre Grozny |
|
|
Liquidation de Djokhar Doudaïev |
|
|
Rencontre à Moscou avec Z. Yandarbiev. Accord d'armistice et échange de prisonniers |
|
|
Après l'ultimatum fédéral, les attaques contre les bases militantes ont repris |
|
|
Opération Jihad. Attaque séparatiste sur Grozny, assaut et prise de Goudermes |
|
|
Accords de Khassaviourt. Les troupes fédérales ont été retirées de Tchétchénie et le statut de république a été reporté au 31 décembre 2001. |
Résultats de la guerre
Les séparatistes tchétchènes ont perçu les accords de Khasavyurt comme une victoire. Les troupes fédérales ont été contraintes de quitter la Tchétchénie. Tout le pouvoir restait entre les mains de la République autoproclamée d'Itchkérie. Au lieu de Dzhokhar Dudayev, Aslan Maskhadov a pris le pouvoir, qui n'était pas très différent de son prédécesseur, mais avait moins d'autorité et était contraint de constamment faire des compromis avec les militants.
La fin de la guerre a laissé derrière elle une économie dévastée. Les villes et les villages n'ont pas été restaurés. À la suite de la guerre et du nettoyage ethnique, tous les représentants des autres nationalités ont quitté la Tchétchénie.
La situation sociale interne a radicalement changé. Ceux qui auparavant luttaient pour l’indépendance ont sombré dans des querelles criminelles. Les héros de la république se sont transformés en bandits ordinaires. Ils chassaient non seulement en Tchétchénie, mais aussi dans toute la Russie. Le kidnapping est devenu un business particulièrement lucratif. Les régions voisines l’ont particulièrement ressenti.
La première guerre de Tchétchénie est un conflit militaire entre les forces gouvernementales de la Fédération de Russie et les forces armées tchétchènes de 1994 à 1996. L'objectif des autorités russes était d'établir leur souveraineté sur le territoire qui a déclaré l'indépendance de la Tchétchénie. L'armée russe a réussi à établir son contrôle sur la plupart des colonies tchétchènes, mais la tâche consistant à réprimer la résistance des séparatistes tchétchènes n'a pas été résolue. Les combats étaient caractérisés gros montant pertes parmi les militaires et les civils. En 1996, les dirigeants russes ont accepté de signer un accord de paix, selon lequel les troupes gouvernementales ont été retirées de Tchétchénie, et les dirigeants séparatistes ont convenu de reporter à l'avenir la question de la reconnaissance de l'indépendance.
L’affaiblissement du pouvoir d’État en URSS au cours des années de perestroïka a conduit à une intensification des mouvements nationalistes, notamment en Tchétchéno-Ingouchie. En 1990, le Congrès national du peuple tchétchène a été créé, dont l'objectif était la sécession de la Tchétchénie de l'URSS et la création d'un État tchétchène indépendant. Il était dirigé par le général Dzhokhar Dudayev. En 1991, un double pouvoir s'est effectivement développé dans la république : le Congrès national du peuple tchétchène s'est opposé à l'appareil officiel du parti et de l'État.
Lors des événements d'août 1991, les dirigeants officiels de la Tchétchéno-Ingouchie ont soutenu le Comité d'urgence de l'État. Après l'échec de la tentative de suppression de M.S. Gorbatchev et B.N. Eltsine du pouvoir le 6 septembre 1991, D. Dudayev a annoncé la dissolution des structures de l'État républicain tchétchène, ses partisans de Dudayev ont pris d'assaut le bâtiment du Conseil suprême de Tchétchéno-Ingouchie. Les autorités russes ont initialement soutenu les actions des Dudayevites, mais il est vite devenu clair que les nouvelles autorités tchétchènes ne reconnaissaient pas la suprématie des lois russes sur leur territoire. Une campagne anti-russe massive a commencé en Tchétchénie, génocide de l'ensemble de la population non tchétchène.
Le 27 octobre 1991, des élections présidentielles et parlementaires ont eu lieu dans la république. Dzhokhar Dudayev est devenu président de la Tchétchénie et les sentiments nationalistes ont prévalu parmi les députés du Parlement. Ces élections ont été déclarées illégales par la Fédération de Russie. Le 7 novembre 1991, le président russe Boris Eltsine a signé un décret instaurant l'état d'urgence en Tchétchéno-Ingouchie. La situation dans la république s'est aggravée : des groupes séparatistes armés ont bloqué les bâtiments des organes des affaires intérieures et de la sécurité de l'État, les camps militaires et les artères de transport. En fait, l'état d'urgence n'a pas été instauré ; le retrait des unités militaires russes, des troupes internes et des unités de police de la république a commencé, qui s'est achevé à l'été 1992. Dans le même temps, les séparatistes ont capturé et pillé une partie importante des entrepôts militaires, obtenant ainsi d'importants stocks d'armes, y compris des armes lourdes.
La victoire des séparatistes à Grozny a conduit à l'effondrement de la Tchétchéno-Ingouchie. Malgobek, Nazranovsky et une partie du district de Sunzhensky, habités par les Ingouches, formèrent la République d'Ingouchie, dont les autorités préconisaient le développement ultérieur de leur peuple dans le cadre de Fédération Russe. La République socialiste soviétique autonome tchétchène-ingouche a cessé d'exister le 10 décembre 1992. Après l'effondrement de l'URSS, Djokhar Dudayev a annoncé la sécession définitive de la Tchétchénie de la Fédération de Russie.
Entre 1991 et 1994, la Tchétchénie était un État indépendant de facto, mais n’était légalement reconnu par personne. Officiellement, elle s'appelait la République tchétchène d'Itchkérie, avait des symboles d'État (drapeau, armoiries, hymne), des autorités - le président, le parlement, le gouvernement, les tribunaux. Le 12 mars 1992, sa Constitution a été adoptée, déclarant la Tchétchénie un État laïc indépendant. Le système étatique de la Tchétchénie s'est avéré inefficace et a pris un caractère criminel. Les attaques armées contre les trains ont pris une ampleur massive, ce qui a obligé le gouvernement russe à décider d'arrêter le trafic ferroviaire sur le territoire de la Tchétchénie à partir d'octobre 1994. Les groupes criminels tchétchènes ont reçu plus de 4 000 milliards de roubles grâce à de faux avis. Les prises d’otages et la traite des esclaves sont devenues monnaie courante. Bien que les autorités tchétchènes n'aient pas transféré d'impôts au budget panrusse, des fonds de sources fédérales sont arrivés en Tchétchénie, notamment pour le paiement des retraites et des prestations sociales. Cependant, les dirigeants de Doudaïev ont dépensé cet argent à leur guise.
Le règne de Djokhar Doudaïev a été marqué par un nettoyage ethnique contre l’ensemble de la population non tchétchène, principalement russe. La plupart des non-Tchétchènes ont été contraints de quitter la Tchétchénie, expulsés de leurs foyers et privés de leurs biens. La propagande anti-russe a été alimentée dans les médias, les cimetières russes ont été profanés. Les personnalités étatiques et religieuses musulmanes de la Tchétchénie indépendante se sont adressées aux Tchétchènes en appelant à tuer les Russes. Dans le camp séparatiste, des contradictions liées à la répartition du pouvoir sont rapidement apparues. Le Parlement a tenté de résister au style de leadership autoritaire de Dzhakhar Dudayev. Le 17 avril 1993, le président de la Tchétchénie a annoncé la dissolution du Parlement et de la Cour constitutionnelle. Le 4 juin de la même année, un détachement armé de Dudayevites sous le commandement de Shamil Basayev a finalement dispersé une réunion des députés du parlement tchétchène et de la Cour constitutionnelle. Ainsi, un coup d'État a eu lieu en Tchétchénie, établissant le régime du pouvoir personnel de Dzhokhar Dudayev. Ce n'est qu'en août 1994 que les pouvoirs législatifs du Parlement ont été rétablis.
Après le coup d'État du 4 juin 1993, la formation d'une opposition anti-Dudaev a commencé dans les régions du nord de la Tchétchénie. La première organisation d'opposition fut le Comité de salut national (KNS), qui entendait renverser le pouvoir de Doudaïev par la force. Cependant, ses troupes furent vaincues. Le CNS a été remplacé par le Conseil provisoire de la République tchétchène (VCCR), qui s'est déclaré la seule autorité légitime sur le territoire de la Tchétchénie. Le VSChR a été reconnu par les autorités russes, qui lui ont fourni un soutien, notamment des armes et des volontaires.
Depuis l’été 1994, les combats entre les partisans de Doudaïev et les forces de l’opposition VSChR se sont généralisés. Les troupes fidèles à Doudaïev exécutées opérations offensives dans les districts de Nadterechny et d'Urus-Martan, contrôlés par l'opposition. Les chars et l'artillerie étaient utilisés dans les batailles. Les opérations militaires se sont déroulées avec plus ou moins de succès, s'appuyant sur Aide russe, l'opposition a tenté à deux reprises (12 septembre et 15 octobre 1994) de s'emparer de Grozny, mais sans succès. Les autorités russes ont cherché à empêcher la défaite de l’opposition et se sont retrouvées de plus en plus entraînées dans le conflit intra-tchétchène. Après un nouvel échec lors de l'assaut de Grozny (26 novembre 1994), le président russe B.N. Eltsine a décidé d'éliminer le problème tchétchène par la force.
Le 11 décembre 1994, le décret « Sur les mesures visant à assurer la légalité, l'ordre public et la sécurité publique sur le territoire de la République tchétchène » a été signé. Le même jour, des unités du Groupe des forces unies (OGV), composées d'unités de l'armée russe et de troupes internes, sont entrées sur le territoire de la Tchétchénie de trois côtés - de l'ouest (de l'Ossétie du Nord à l'Ingouchie), du nord-ouest (de la région de Mozdok en Ossétie du Nord), de l'est (de Kizlyar, du territoire du Daghestan).
Le groupe oriental a été bloqué dans la région de Khasavyurt au Daghestan résidents locaux- Akkin Tchétchènes. Le groupe occidental a également été bloqué par les habitants de l'Ingouchie, a essuyé des tirs près du village de Barsuki, mais, en recourant à la force, a pénétré en Tchétchénie. Le 12 décembre, le groupe Mozdok s'est approché du village de Dolinsky, à 10 km de Grozny. Ici, les troupes russes ont essuyé le feu d'un système d'artillerie à roquettes tchétchène Grad et sont entrées dans la bataille pour le village.
Le 15 décembre, le groupe Kizlyar atteint le village de Tolstoï-Yourt. Le 19 décembre, le groupe occidental a bloqué Grozny par l'ouest, en contournant la crête Sunzhensky. Le lendemain de l'occupation de Dolinsky, le groupe Mozdok bloqua Grozny par le nord-ouest. Le groupe Kizlyar s'est approché de la ville par l'est. Des unités de la 104e division aéroportée ont fermé les routes vers Grozny depuis les gorges de l'Argun. Cependant, les accès à la ville par le sud n'étaient pas coupés.
Le 31 décembre 1994, l'assaut sur Grozny a commencé, environ 250 véhicules blindés sont entrés dans la ville. Dans les combats de rue, son extrême vulnérabilité a été révélée, les troupes russes se sont révélées mal préparées aux opérations de combat, il n'y avait pas de communication fiable entre les unités, il n'y avait pas d'interaction et de coordination des actions des unités individuelles. L’espoir que les séparatistes se retireraient devant le rempart blindé ne s’est pas concrétisé. Les groupes occidentaux et orientaux des troupes russes, ayant perdu une partie importante de leurs véhicules blindés, n'ont pas pu pénétrer dans la ville. En direction nord 131e Maikopskaya brigade de fusiliers motorisés et 81e Petrakuvsky régiment de fusiliers motorisés, qui étaient sous le commandement du général K.B. Pulikovsky, a réussi à pénétrer jusqu'à la gare et au palais présidentiel. Mais là, ils furent encerclés et vaincus.
Les troupes russes ont dû changer de tactique : au lieu d'utiliser massivement des véhicules blindés, des groupes d'assaut aériens manœuvrables, soutenus par l'artillerie et l'aviation, se sont lancés dans la bataille. De violents combats de rue ont éclaté à Grozny. Le 9 janvier 1995, le bâtiment de l'Institut pétrolier de Grozny et l'aéroport étaient occupés. Le 19 janvier, le centre-ville était débarrassé des séparatistes et occupé Palais présidentiel. Les détachements tchétchènes se sont retirés de l'autre côté de la rivière Sunzha et ont pris des positions défensives sur la place Minutka. Les routes ouvertes vers le sud leur ont permis de transférer des renforts et des munitions à Grozny et d'échapper rapidement aux attaques.
Début février, le nombre de troupes russes en Tchétchénie était passé à 70 000 personnes. Le général Anatoly Kulikov est devenu le commandant de l'OGV. Le 3 février 1995, le groupe « Sud » est formé et le blocus de Grozny depuis le sud commence. Le 13 février, dans le village de Sleptsovskaya (Ingouchie), des négociations ont eu lieu entre Anatoly Kulikov et le chef d'état-major des forces armées de Tchétchénie, Aslan Maskhadov, sur la conclusion d'une trêve temporaire - les parties ont échangé des listes de prisonniers de guerre. , les deux camps ont eu la possibilité de retirer les morts et les blessés des rues de la ville. Les combats actifs à Grozny ont repris le 20 février, mais Troupes tchétchènes, privé de soutien, se retire progressivement de la ville. Le 6 mars 1995, le détachement de Chamil Basayev se retire de Tchernorechye, la dernière zone de Grozny contrôlée par les séparatistes. À la suite de l’assaut, la ville fut transformée en ruines. Après la chute de Grozny, de nouveaux organes gouvernementaux ont été organisés en Tchétchénie, dirigés par Salambek Khadzhiev et Umar Avturkhanov, qui prônaient la préservation de la République tchétchène dans le cadre de la Fédération de Russie.
Pendant ce temps, les troupes russes prenaient le contrôle des régions de plaine de la Tchétchénie. Le commandement russe a mené des négociations actives avec la population locale, les exhortant à expulser les militants des zones peuplées. Les troupes fédérales occupaient des hauteurs dominantes au-dessus des villages et des villes. Grâce à cette tactique, du 15 au 23 mars, les troupes Militants tchétchènes ont quitté Argun (23 mars), Shali (30 mars), Goudermes (31 mars). Dans la partie occidentale de la Tchétchénie, depuis le 10 mars, des combats ont eu lieu pour le village de Bamut. Là, les 7 et 8 avril, des détachements des troupes internes et de la police ont mené une opération visant à débarrasser le village de Samashki des militants, au cours de laquelle des civils sont également morts. L'opération de Samachki a fait sensation dans les médias du monde entier, a eu un impact négatif sur l'image de l'armée russe et a renforcé le sentiment anti-russe en Tchétchénie.
Les 15 et 16 avril, l'assaut sur Bamut commence. Les troupes russes ont réussi à pénétrer dans le village et à prendre pied aux abords. Cependant, les militants ont conservé entre leurs mains les hauteurs dominantes du village. Les combats pour Bamut se sont poursuivis jusqu'en 1996. Mais d’une manière générale, en avril 1995, les troupes russes occupaient presque tout le territoire plat de la Tchétchénie ; les séparatistes ont dû se limiter à des opérations purement de sabotage et de guérilla.
Le 28 avril 1995, la partie russe a annoncé la suspension des hostilités de sa part. Le 12 mai, des actions ont commencé pour établir le contrôle de la Tchétchénie montagneuse. Les troupes russes ont frappé les villages de Chiri-Yourt (à l'entrée des gorges d'Argun) et de Serzhen-Yourt (à l'entrée des gorges de Vedenskoye). Une supériorité significative en effectifs et en équipement a permis aux troupes russes, malgré les conditions montagneuses difficiles et la résistance ennemie, de s'emparer des centres régionaux de Vedeno (3 juin), Shatoy et Nozhai-Yourt (12 juin). Ainsi, dès l’été 1995, la plupart des colonies de Tchétchénie passèrent sous le contrôle des autorités fédérales. Des détachements de séparatistes tchétchènes se sont lancés dans la guérilla. Ils conservèrent largement leur force de combat, bénéficièrent du soutien de la population tchétchène et la lutte contre eux devait être longue et intense. Les militants tchétchènes ont largement manœuvré dans toute la république et sont réapparus déjà en mai 1995 près de Grozny.
Le 14 juin 1995, un groupe de militants tchétchènes comptant 195 personnes, dirigé par Shamil Basayev, a réussi à pénétrer dans des camions sur le territoire du territoire de Stavropol. Dans la ville de Boudennovsk, après une attaque contre le bâtiment du département des affaires intérieures de la ville, les Bassaïevites ont occupé l'hôpital municipal et y ont rassemblé les civils capturés. Au total, environ deux mille otages se sont retrouvés entre les mains des terroristes. Bassaïev a présenté des exigences aux autorités russes : la cessation des hostilités et le retrait des troupes russes de Tchétchénie. Les dirigeants des forces de sécurité russes ont décidé de prendre d'assaut le bâtiment de l'hôpital. La bataille a duré environ quatre heures, mais les terroristes ont occupé le bâtiment principal de l'hôpital avec la plupart des otages. Le deuxième assaut s'est également soldé par un échec. Après l'échec des opérations militaires visant à libérer les otages, des négociations ont commencé entre le président du gouvernement russe, V.S. Tchernomyrdine et Shamil Bassaïev. Les terroristes ont reçu des bus à bord desquels ils sont arrivés, avec 120 otages, au village tchétchène de Zandak, où les otages ont été libérés.
Après les événements de Boudionnovsk, du 19 au 22 juin, des négociations ont eu lieu à Grozny entre les parties russe et tchétchène, au cours desquelles il a été décidé d'introduire un moratoire sur les hostilités pour une durée indéterminée. Lors d'un nouveau cycle de négociations (27-30 juin), un accord a été conclu sur l'échange de prisonniers selon le principe « tous contre tous », le désarmement des groupes séparatistes, le retrait des troupes russes de Tchétchénie et la tenue de libérations libres. élections. En général, ces accords se sont révélés bénéfiques pour les séparatistes. Le moratoire sur les opérations militaires a lié les mains de l’armée russe qui ne pouvait pas mener d’opérations militaires. Il n’y a pas eu de véritable désarmement des forces armées tchétchènes. Les militants sont retournés dans leurs villages, où des « unités d'autodéfense » ont été créées.
Dans le même temps, la guerre partisane contre les forces fédérales ne s'est pas arrêtée et des combats locaux ont eu lieu dans toute la Tchétchénie. De temps en temps, des groupes militants occupaient de vastes zones peuplées, qui devaient être libérées à l'aide de véhicules blindés et d'avions. Le 6 octobre 1995, contre le commandant du Groupe des Forces Unies (OGV), le général A.A. Une tentative d'assassinat a été commise contre Romanov et il a été grièvement blessé. Cet événement a contribué à l’escalade des tensions et a largement anéanti les espoirs d’une résolution pacifique du conflit.
À la veille des élections des nouvelles autorités de la République tchétchène, prévues en décembre, les dirigeants russes ont décidé de remplacer Salambek Khadzhiev et Umar Avturkhanov par l'ancien dirigeant de la République socialiste soviétique autonome tchétchène-ingouche, Doku Zavgaev, qui semblait plus autoritaire. . Du 10 au 12 décembre, la ville de Goudermes a été prise par les détachements de Salman Raduev, Khunkar-Pacha Israpilov et du sultan Gelikhanov. Le 14 décembre, des combats pour la ville ont éclaté, mais ce n'est que le 20 décembre que les troupes russes ont débarrassé Goudermes des militants. Dans ce contexte, du 14 au 17 décembre 1995, des élections aux autorités locales ont eu lieu en Tchétchénie. Les partisans séparatistes ont annoncé par avance leur boycott et leur non-reconnaissance des élections. Doku Zavgaev a remporté les élections avec plus de 90 % des voix.
Les espoirs d'une stabilisation de la situation en Tchétchénie à la suite des élections ne se sont pas concrétisés. Le 9 janvier 1996, un détachement de militants comptant 256 personnes sous le commandement de Salman Raduev, Turpal-Ali Atgeriyev et Khunkar-Pasha Israpilov a mené un raid sur la ville de Kizlyar au Daghestan. La cible des militants était une base d'hélicoptères et un dépôt de munitions pour les forces fédérales. Les terroristes ont réussi à détruire deux hélicoptères de transport Mi-8. Lorsque des unités de l'armée russe et des forces de l'ordre ont commencé à s'approcher de la ville, les militants se sont emparés de l'hôpital et de la maternité, y conduisant environ trois mille civils. Les autorités fédérales ont négocié avec les terroristes et ont accepté de leur fournir des bus jusqu'à la frontière tchétchène en échange de la libération des otages. Le 10 janvier, un convoi avec des militants et des otages a quitté Kizlyar. Dans le village de Pervomaisky, la colonne a été arrêtée, les militants ont capturé le village. Du 11 au 14 janvier, des négociations infructueuses ont eu lieu et le 15 janvier, les troupes fédérales ont lancé l'assaut sur Pervomaisky. Le 16 janvier dans le port turc du groupe Trabzon Terroristes tchétchènes s'est emparé du navire à passagers "Avrasia" et a menacé de tirer sur les otages russes si l'assaut sur Pervomaisky n'était pas arrêté. Après deux jours de négociations, les terroristes se sont rendus aux autorités turques. La bataille de Pervomaiskoye a duré plusieurs jours : le 18 janvier, sous le couvert de l'obscurité, les militants ont brisé l'encerclement et ont fui vers la Tchétchénie.
Le 6 mars 1996, plusieurs groupes de militants attaquent Grozny, contrôlée par les troupes russes. Les militants ont capturé le quartier Staropromyslovsky de la ville et ont tiré sur les points de contrôle russes. Grozny est resté sous le contrôle des forces armées russes, mais lors de leur retraite, les séparatistes ont emporté avec eux des vivres, des médicaments et des munitions. Au printemps 1996, il est devenu évident que la guerre en Tchétchénie était devenue longue et nécessitait d'importants investissements budgétaires. Dans le contexte du début de la campagne électorale présidentielle de 1996, la poursuite des hostilités a eu un impact négatif sur les chances de B.N. Eltsine conserve son poste.
Le 21 avril 1996, l'aviation russe a réussi à détruire le président de la Tchétchénie, Dzhokhar Dudayev, et les 27 et 28 mai, une réunion des délégations russe et tchétchène s'est tenue à Moscou, au cours de laquelle une décision a été prise sur une trêve à partir de juin. 1er janvier 1996 et échange de prisonniers. Le 10 juin à Nazran, lors du prochain cycle de négociations, un nouvel accord a été conclu sur le retrait des troupes russes du territoire de la Tchétchénie (à l'exception de deux brigades), le désarmement des détachements séparatistes et la tenue de élections libres et démocratiques. élections. La question du statut de la république fut de nouveau provisoirement reportée.
Après la réélection de B.N. Eltsine, alors président de la Russie (3 juillet 1996), le nouveau secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Alexandre Lebed, a annoncé la reprise des hostilités en Tchétchénie. Cependant, à cette époque, les unités de l'armée russe en Tchétchénie avaient largement perdu leur efficacité au combat et étaient désorientées quant aux objectifs de la guerre et à l'identification de l'ennemi. La majorité de la population tchétchène ne faisait pas confiance aux autorités locales et fédérales et considérait les soldats russes comme des occupants. La puissance accrue des formations militaires des séparatistes tchétchènes a été démontrée par les combats d'août 1996, lorsque les troupes russes, malgré leur supériorité en effectifs et en équipement, ont été contraintes de quitter les villes de Grozny, Goudermes et Argoun. Ces échecs incitent les autorités fédérales à mettre fin à la guerre. Le 31 août 1996, des représentants de la Russie (président du Conseil de sécurité Alexandre Lebed) et de l'Itchkérie (Aslan Maskhadov) ont signé un accord de trêve dans la ville de Khasavyurt (Daghestan). Les troupes russes ont été complètement retirées de Tchétchénie et la décision sur le statut de la république a été reportée au 31 décembre 2001.
Les accords de Khasavyurt ont effectivement accordé l’indépendance à la Tchétchénie, mais légalement, sa souveraineté n’a été reconnue par aucun pays au monde. Au cours des combats, les troupes russes ont perdu 4 103 personnes tuées et 1 231 disparues. Les pertes du côté tchétchène sont estimées à 17 000 personnes et la population civile a perdu entre 30 000 et 40 000 personnes. La quasi-totalité de la population non tchétchène a quitté la Tchétchénie. L'économie, les infrastructures, les villes et les villages de la république ont été en grande partie détruits. Après la fin des hostilités, la Tchétchénie est entrée dans une période de crise profonde, dans le contexte de laquelle les adeptes des formes radicales et agressives de l'islam ont acquis une influence croissante.
Le 11 décembre 1994 éclate la première guerre de Tchétchénie. Le contexte du conflit et la chronique des combats en Tchétchénie dans la revue Voenpro consacrée à l'anniversaire du début de la guerre. Ce conflit peut être considéré comme le triste symbole d’une Russie qui ne s’était pas encore trouvée, qui se trouvait à la croisée des chemins, dans l’intemporalité entre l’effondrement d’une grande puissance et la naissance d’une nouvelle Russie.
Raisons du déclenchement de la guerre de Tchétchénie

Pourriture Union soviétique se sont produits différemment selon les États. Il y a même eu des conflits territoriaux locaux, mais les choses n'ont abouti à une guerre ouverte que dans le Caucase du Nord.
Au cours des derniers mois de l'existence de l'URSS en Tchétchéno-Ingouchie, l'ancien général de l'armée de l'air Dzhokhar Dudayev a créé l'organisation Congrès national du peuple tchétchène. Elle a fixé pour tâche principale le retrait de la république de l’Union et la proclamation de son indépendance complète à tous égards.
Après l'échec des putschistes à Moscou, les Dudayevites ont annoncé la dissolution de toutes les autorités syndicales et, le 6 septembre 1991, ont saisi tous les bâtiments gouvernementaux de Grozny, ainsi que la Maison de la Radio et le centre de télévision.

Après la liquidation légale définitive de l'URSS, Djokhar Dudayev a déclaré l'indépendance de la Tchétchénie et a été élu premier président de la République tchétchène d'Itchkérie. Le gouvernement russe n'a pas reconnu les élections et Boris Eltsine a publié un décret introduisant l'état d'urgence dans les territoires contrôlés par les séparatistes.
Mais de nombreuses foules d'habitants sont descendues dans les rues et ont bloqué les unités militaires, les commissariats de police, les bâtiments du KGB et tous les principaux nœuds de transport, ce qui a empêché l'instauration de l'état d'urgence.

À la suite de trois jours de débats au Conseil suprême de la RSFSR, la décision a été prise de retirer toutes les forces paramilitaires de Tchétchénie. Dans le même temps, les séparatistes ont reçu une grande quantité d’armes et d’équipements qui n’ont pas pu être évacués faute de moyens de transport.
Il convient de noter que la République d’Ingouchie s’est séparée de la Tchétchénie et a choisi de faire partie de la Fédération de Russie, de sorte que seule la Tchétchénie est devenue un État « indépendant », qui n’a été reconnu par aucun pays au monde.
Pour cette raison, l'État n'a pas pu établir de relations internationales et les gens ont souffert d'un banditisme et d'un chômage endémiques. La situation de la criminalité était extrêmement haut niveau, et les autorités n'ont pas pu établir une vie normale.
La population russophone de Tchétchénie s'est retrouvée dans une situation désespérée, pratiquement abandonnée par les autorités fédérales. La période de 1992 à 1994 constitue une page sombre de l’histoire des Russes en Tchétchénie.
Selon de nombreux témoignages de l'époque, la position de la minorité nationale slave en Tchétchénie n'était pas enviable.

Pour cette raison, une opposition au pouvoir de Dzhokhar Dudayev est apparue dans le pays, qui s'est organisé en Conseil provisoire de la République tchétchène. Personne n'a réussi à gagner sur le terrain politique et, à l'été 1994, une guerre civile a éclaté. Le gouvernement russe a officieusement soutenu le Soviet suprême de Tchétchénie, car avec son aide, il a été possible de renverser le pouvoir de Dudayev et de ramener la Tchétchénie dans la Fédération.

Officiellement, la date du début de la 1ère guerre de Tchétchénie dans toutes les sources est le 11 décembre 1994. Mais en fait troupes fédérales ont participé à guerre civile du côté de l’opposition. En particulier, à la suite de l'assaut de Grozny le 26 novembre 1994, 68 militaires russes ont été capturés par les Dudayevites. Les militants ont promis de tirer sur tout le monde si la Fédération de Russie ne se reconnaissait pas officiellement comme partie au conflit.
En conséquence, certains soldats ont été libérés, mais leur nombre ne dépassait pas 30 personnes. Dans le même temps, seules 21 personnes ont été identifiées nommément sur les listes, de sorte que les autorités ne reconnaissent pas un si grand nombre de prisonniers.
Des images de soldats russes ont été diffusées 24 heures sur 24 à la télévision, ce qui a provoqué un tollé général. C'est pourquoi, le 11 décembre, Boris Eltsine a publié un décret « sur les mesures visant à garantir la légalité, l'ordre public et la sécurité publique sur le territoire de la République tchétchène ».
C'est de cet événement que vient la date du début de la guerre de Tchétchénie. De plus, une campagne à court terme et la défaite de l'armée d'Itchkérie en quelques jours étaient initialement prévues. Le Ministre de la Défense de la Fédération de Russie a même déclaré que l'armée russe pouvait résoudre le problème en quelques heures.
Mais le début de la guerre en Tchétchénie a rapidement refroidi les ardeurs des hommes politiques et des militaires. En seulement deux jours de combats, les troupes fédérales ont perdu environ deux cents personnes, même si personne n'a officiellement reconnu ces pertes.

De plus, plus de la moitié des combattants sont morts en marche, lorsque des colonnes de troupes ont attaqué des « détachements volants » de militants dans des embuscades. Dès le premier jour de la guerre, Djokhar Dudayev a décidé de mener guérilla, ce qui, compte tenu d'un tel rapport de forces, était la seule bonne décision.
Le début de la première guerre de Tchétchénie a confirmé la réticence du commandement à développer les bonnes tactiques et à utiliser efficacement les renseignements. Des colonnes de troupes tombèrent à maintes reprises dans des embuscades, subissant d'énormes pertes en hommes et en matériel. Les échecs sur le champ de bataille ébranlent le moral de l’armée, qui se sent abandonnée à la merci du sort. Le sentiment anti-guerre dans la société s’est également accru.
Le début de la guerre de Tchétchénie en 1994 s'est accompagné non seulement d'opérations militaires dans le Caucase du Nord, mais également d'attentats terroristes dans des villes russes. Les militants ont ainsi tenté d'intimider la population civile et de la contraindre à influencer le gouvernement afin d'obtenir le retrait des troupes. Ils n’ont pas réussi à semer la panique, mais nombreux sont ceux qui ont encore du mal à se souvenir de cette époque.
Un autre fait remarquable après le déclenchement de la guerre en Tchétchénie en 1994 a été la capacité de certains commandants de terrain à préparer parfaitement les pièges et à sortir des combats sans pratiquement aucune perte. Le fait est que l'épine dorsale de l'armée d'Itchkérie était constituée de soldats et d'officiers des troupes soviétiques qui avaient subi le baptême du feu en Afghanistan et connaissaient bien les subtilités tactiques de la guerre.
Et les entrepôts d'armes et de munitions laissés sur place lors du retrait des forces russes ont permis de se défendre efficacement sur tous les secteurs des fronts.

Le début désastreux de la première guerre de Tchétchénie en 1994 a contraint le ministère de la Défense de la Fédération de Russie à introduire de toute urgence des forces supplémentaires et à établir une interaction entre toutes les branches de l'armée. Après cela, les premières victoires ont commencé et les forces fédérales ont commencé à avancer rapidement plus profondément dans les possessions séparatistes.
Le résultat fut l'accès aux banlieues de Grozny et le début de l'assaut sur la capitale le 31 décembre 1994. Au cours de combats sanglants et acharnés qui ont duré jusqu'au 6 mars 1995, la Russie a perdu environ un millier et demi de soldats tués et jusqu'à 15 000 blessés.
Mais la chute de la capitale n’a pas brisé la résistance des séparatistes et les tâches principales n’ont donc pas été accomplies. Avant le début de la guerre en Tchétchénie objectif principal l'objectif était la liquidation de Djokhar Doudaïev, puisque la résistance des militants reposait en grande partie sur son autorité et son charisme.
Destruction de Djokhar Doudaïev

Après plusieurs tentatives infructueuses pour détruire le président, celui-ci fut assassiné le 21 avril 1996. Pour ce faire, un missile à tête chercheuse a été utilisé, qui a localisé le signal du téléphone portable du général lorsqu'il l'allumait pour passer plusieurs appels.
Selon des données non officielles, plusieurs millions de dollars auraient été dépensés pour l'opération, la création d'armes et la recherche d'informateurs, ce qui représentait à l'époque une somme assez importante.
La mort de l’actuel « père de l’Itchkérie » a provoqué des troubles dans les rangs des séparatistes, mais ceux-ci n’ont pas stoppé la résistance armée. Les militants ont pu se remettre de leur perte en août, lorsqu'ils ont rassemblé leurs forces et mené l'opération Jihad. Du 6 au 22 août 1996, les forces fédérales ont perdu totalement ou partiellement le contrôle d'Argoun, Goudermes et Grozny.
Au cours des combats, les pertes se sont élevées à environ 500 personnes tuées et un millier et demi de blessés plus ou moins graves. Néanmoins, même en ces jours difficiles, sont nés des héros dont on se souvient encore aujourd'hui.
Les événements d'août 1996 constituent une triste page de histoire russe. Un certain nombre d’événements et de faits suggèrent une trahison des intérêts russes aux plus hauts niveaux du pouvoir de cette période.
Chronologie de la première guerre tchétchène
- 11 décembre 1994 - les troupes du Groupe uni des forces russes entrent en Tchétchénie par trois directions ;
- 12 décembre - Le groupe Mozdok de l'OGV prend position à 10 km de Grozny ;
- 15 décembre - Le groupe Kizlyar occupe Tolstoï-Yourt ;
- 19 décembre - Le groupe occidental contourne la crête Sunzhensky et s'empare de Grozny par l'ouest ;
- 20 décembre – Le groupe Mozdok bloque la capitale de la Tchétchénie par le nord-ouest ;
- 20 décembre - Le groupe Kizlyar bloque la ville par l'est, 104e garde. La police de la circulation bloque les gorges d'Argun. Le lieutenant-général Kvashnin devient le commandant de l'OGV ;
- 24-28 décembre - Bataille de Khankala ;
- 31 décembre 1994 - début de l'assaut sur Grozny ;
- 7 janvier 1995 – changement de tactique des forces fédérales. Des groupes de manœuvres d'assaut aéroportés, appuyés par l'aviation et l'artillerie, remplacent les groupes blindés inefficaces en combat urbain ;
- 9 janvier - l'aéroport est occupé ;
- 19 janvier - le palais présidentiel est pris ;
- 1er février - Le colonel général Kulikov devient commandant de l'OGV ;
- 3 février - création du groupe sud de l'OGV, début des tentatives de blocage de Grozny par le sud ;
- 9 février - sortie vers l'autoroute fédérale Rostov-Bakou ;
- 6 mars 1995 – Grozny passe sous le contrôle total des Forces fédérales ;
- 10 mars - début des batailles pour Bamut ;
- 23 mars - Argoun est capturé ;
- 30 mars - Shali est prise ;
- 31 mars - Goudermes est capturée ;
- 7 - 8 avril - opération dans le village de Samashki ;
- 28 avril - 11 mai - suspension des hostilités ;
- 12 mai - le début des batailles pour Chiri-Yourt et Serzhen-Yourt ;
- 3 juin - prise de Vedeno ;
- 12 juin - Nozhai-Yourt et Shatoy ont été pris ;
- 14-19 juin 1995 - attaque terroriste à Budennovsk ;
- 19 - 30 juin - 2 étapes de négociations entre les parties russe et tchétchène, un moratoire sur les opérations militaires, le début d'une guérilla et d'une guerre de sabotage dans toute la Tchétchénie, des batailles locales ;
- 19 juillet - Le lieutenant-général Romanov devient commandant de l'OGV ;
- 6 octobre - tentative d'assassinat contre le lieutenant-général Romanov ;
- 10 - 20 décembre - batailles actives pour Goudermes ;
- 9 - 18 janvier 1996 - attaque terroriste à Kizlyar ;
- 6 - 8 mars - combats dans le district Staropromyslovsky de Grozny ;
- 16 avril - une embuscade contre un convoi de l'armée russe dans les gorges d'Argoun (le village de Yaryshmardy) ;
- 21 avril 1996 - liquidation de Djokhar Dudayev ;
- 24 mai - prise définitive de Bamut ;
- Mai - juillet 1996 - processus de négociation ;
- 9 juillet - reprise des hostilités ;
- 6 - 22 août - Opération Jihad ;
- 6 - 13 août - des militants envahissent Grozny, blocus des forces fédérales dans la ville ;
- à partir du 13 août - déblocage des postes de contrôle de l'OGV, encerclement des forces de Maskhadov ;
- 17 août - ultimatum du général Pulikovsky ;
- 20 août - retour de vacances du commandant de l'OGV, le lieutenant-général Tikhomirov. Condamnation à Moscou de l'ultimatum de Pulikovsky ;
- 31 août - signature des accords de Khasavyurt. La fin de la première guerre tchétchène.
Accords de Khasavyurt de 1996

Après les événements du mois d’août et leur couverture médiatique controversée, la société s’est à nouveau prononcée en faveur de la fin de la guerre. Le 31 août 1996, l'accord de paix de Khasavyurt a été signé, selon lequel la question du statut de la Tchétchénie était reportée de 5 ans et toutes les forces fédérales devaient immédiatement quitter le territoire de la république.
Le déclenchement de la Première Guerre en Tchétchénie était censé apporter une victoire rapide, mais l'armée russe a perdu plus de 5 000 personnes tuées, environ 16 000 blessés et 510 disparus. Il existe d'autres chiffres dans lesquels les pertes irréparables varient de 4 à 14 000 militaires.
Les militants tués sont au nombre de 3 à 8 000 et les pertes civiles sont estimées entre 19 et 25 000 personnes. Les pertes maximales peuvent donc être estimées à 47 000 personnes, et parmi les tâches assignées, seule la liquidation de Dudayev a été menée à bien.
La première guerre de Tchétchénie est toujours le symbole de la « Russie d’Eltsine », une période troublée de notre société. histoire moderne. Nous ne nous engageons pas à juger sans équivoque si la signature de l’accord de Khasavyurt (et les événements qui l’ont précédé en août 1996) était une trahison, mais il est évident qu’elle n’a pas résolu les problèmes en Tchétchénie.
Au début de l'opération, le groupe combiné des forces fédérales comptait plus de 16 500 personnes. La majorité des unités et formations de fusiliers motorisés ayant une composition réduite, elles ont été créées sur cette base détachements combinés. Un organe directeur unique, système commun arrière et soutien technique Le groupe combiné n'avait pas de troupes. Le lieutenant-général Anatoly Kvashnin a été nommé commandant du Groupe des forces unies (OGV) en République tchétchène.
Le 11 décembre 1994, le mouvement des troupes a commencé en direction de la capitale tchétchène, la ville de Grozny. Le 31 décembre 1994, les troupes, sur ordre du ministre de la Défense de la Fédération de Russie, ont lancé l'assaut sur Grozny. Environ 250 véhicules blindés sont entrés dans la ville, extrêmement vulnérables aux combats de rue. Les colonnes blindées russes ont été arrêtées et bloquées par les Tchétchènes dans différents quartiers de la ville, et les unités de combat des forces fédérales entrées dans Grozny ont subi de lourdes pertes.
Après cela, les troupes russes ont changé de tactique : au lieu d'utiliser massivement des véhicules blindés, elles ont commencé à utiliser des groupes d'assaut aériens manœuvrables soutenus par l'artillerie et l'aviation. De violents combats de rue ont éclaté à Grozny.
Début février, les effectifs du Groupe conjoint des forces avaient été portés à 70 000 personnes. Le colonel général Anatoly Kulikov est devenu le nouveau commandant de l'OGV.
Le 3 février 1995, le groupe « Sud » est formé et la mise en œuvre du plan de blocus de Grozny depuis le sud commence.
Le 13 février, dans le village de Sleptsovskaya (Ingouchie), des négociations ont eu lieu entre le commandant de l'OGV Anatoly Kulikov et le chef d'état-major des forces armées du ChRI Aslan Maskhadov sur la conclusion d'une trêve temporaire - les parties ont échangé des listes de prisonniers de guerre, et les deux camps ont également eu la possibilité de retirer les morts et les blessés des rues de la ville. La trêve a été violée par les deux parties.
Fin février, les combats de rue se poursuivent dans la ville (notamment dans sa partie sud), mais les troupes tchétchènes, privées de soutien, se retirent progressivement de la ville.
Le 6 mars 1995, un détachement de militants tchétchènes commandant de terrain Chamil Basayev s'est retiré de Tchernorechye, la dernière zone de Grozny contrôlée par les séparatistes, et la ville est finalement passée sous le contrôle des troupes russes.
Après la prise de Grozny, les troupes ont commencé à détruire les groupes armés illégaux dans d'autres zones peuplées et dans les régions montagneuses de Tchétchénie.
Du 12 au 23 mars, les troupes de l’OGV ont mené avec succès une opération visant à éliminer le groupe ennemi d’Argun et à capturer la ville d’Argun. Du 22 au 31 mars, le groupe Goudermes est liquidé ; le 31 mars, après de violents combats, Chali est occupée.
Après avoir subi un certain nombre de défaites majeures, les militants ont commencé à changer l'organisation et la tactique de leurs unités : les groupes armés illégaux se sont regroupés en petites unités et groupes très maniables axés sur la réalisation de sabotages, de raids et d'embuscades.
Du 28 avril au 12 mai 1995, selon le décret du Président de la Fédération de Russie, un moratoire sur le recours à la force armée a été imposé en Tchétchénie.
En juin 1995, le lieutenant-général Anatoly Romanov a été nommé commandant de l'OGV.
Le 3 juin, après de violents combats, les forces fédérales entrent dans Vedeno ; le 12 juin, les centres régionaux de Shatoi et Nozhai-Yourt sont pris. À la mi-juin 1995, 85 % du territoire de la République tchétchène était sous le contrôle des forces fédérales.
Les groupes armés illégaux ont redéployé une partie de leurs forces des zones montagneuses vers les positions des troupes russes, formé de nouveaux groupes de militants, tiré sur des points de contrôle et des positions des forces fédérales et organisé des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent à Budennovsk (juin 1995), Kizlyar et Pervomaisky. (janvier 1996) .
Le 6 octobre 1995, le commandant de l'OGV, Anatoly Romanov, a été grièvement blessé dans un tunnel près de la place Minutka à Grozny à la suite d'un acte terroriste clairement planifié : l'explosion d'une mine radiocommandée.
Le 6 août 1996, les troupes fédérales, après de lourdes batailles défensives et ayant subi de lourdes pertes, quittent Grozny. Les INVF sont également entrés dans Argun, Gudermes et Shali.
Le 31 août 1996, des accords de cessation des hostilités ont été signés à Khasavyurt, mettant fin à la première campagne tchétchène. Le Traité de Khasavyurt a été signé par le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Alexandre Lebed et le chef d'état-major des formations armées séparatistes Aslan Maskhadov ; la cérémonie de signature s'est déroulée en présence du chef du groupe d'assistance de l'OSCE en République tchétchène, Tim Guldiman. La décision sur le statut de la République tchétchène a été reportée à 2001.
Après la conclusion de l'accord, les troupes fédérales ont été retirées du territoire de la Tchétchénie dans un laps de temps extrêmement court, du 21 septembre au 31 décembre 1996.
Selon les données publiées par l'état-major de l'OGV immédiatement après la fin des hostilités, les pertes des troupes russes s'élèvent à 4 103 tués, 1 231 disparus/désertés/prisonniers et 19 794 blessés.
D'après l'étude statistique « La Russie et l'URSS dans les guerres du XXe siècle » sous la direction générale de G.V. Krivosheeva (2001), Les Forces armées de la Fédération de Russie, d'autres troupes, formations et corps militaires qui ont pris part aux hostilités sur le territoire de la République tchétchène ont perdu 5 042 personnes tuées et mortes, 510 personnes ont été portées disparues et capturées. Les pertes sanitaires se sont élevées à 51 387 personnes, dont 16 098 personnes blessées, choquées et blessées.
Les pertes irréversibles du personnel des groupes armés illégaux de Tchétchénie sont estimées entre 2 500 et 2 700 personnes.
Selon les évaluations d'experts des forces de l'ordre et des organisations de défense des droits de l'homme, nombre total Les pertes civiles se sont élevées à 30 000 à 35 000 personnes, dont celles tuées à Budennovsk, Kizlyar, Pervomaisk et en Ingouchie.
Le matériel a été préparé sur la base des informations de RIA Novosti et de sources ouvertes
(Supplémentaire
L'article parle brièvement de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), menée par la Russie sur le territoire de la Tchétchénie. Le conflit a entraîné de lourdes pertes parmi le personnel militaire russe ainsi que parmi la population civile tchétchène.
- Le déroulement de la première guerre tchétchène
- Résultats de la première guerre tchétchène
Causes de la première guerre tchétchène
- À la suite des événements de 1991 et de la sécession des républiques de l'URSS, des processus similaires ont commencé dans la République socialiste soviétique autonome tchétchène-ingouche. Le mouvement nationaliste dans la république était dirigé par l'ancien Général soviétique D. Doudaïev. En 1991, il proclame la création de la République tchétchène indépendante d'Itchkérie (CRI). Un coup d'État a eu lieu, à la suite duquel les représentants du gouvernement précédent ont été renversés. Les nationalistes se sont emparés des principales institutions gouvernementales. L'instauration de l'état d'urgence dans la république par Boris Eltsine ne pouvait plus rien changer. Le retrait des troupes russes commence.
Le CRI était une république non reconnue non seulement en Russie, mais dans le monde entier. Le pouvoir reposait sur la force militaire et les structures criminelles. Les sources de revenus du nouveau gouvernement étaient la traite des esclaves, les vols et le commerce de drogue et de pétrole provenant du pipeline russe traversant le territoire de la Tchétchénie. - En 1993, D. Dudayev a procédé à un autre coup d'État, dispersant le Parlement et la Cour constitutionnelle. La constitution adoptée par la suite a établi le régime du pouvoir personnel de D. Dudayev.
Sur le territoire du CRI, l'opposition au gouvernement surgit sous la forme du Conseil provisoire de la République tchétchène. Le conseil bénéficie du soutien du gouvernement russe, il reçoit une aide matérielle et des forces spéciales russes sont envoyées pour apporter son soutien. Des affrontements militaires ont lieu entre les détachements de Doudaïev et les représentants de l’opposition.
Le déroulement de la première guerre tchétchène
- Avant même la déclaration officielle des hostilités début décembre 1991, l'aviation russe avait lancé une attaque massive contre les aérodromes tchétchènes, détruisant tous les avions ennemis. B. Eltsine signe un décret sur le début des hostilités. armée russe commence une invasion de la Tchétchénie. Durant les premières semaines, toutes les régions du nord de la Tchétchénie passèrent sous contrôle russe et Grozny fut pratiquement encerclée.
- De fin décembre 1994 à mars 1995. Grozny a été prise d'assaut. Malgré une supériorité significative en nombre et en armement, l'armée russe subit de lourdes pertes et l'assaut dura pendant longtemps. Dans les conditions des combats de rue, l'équipement lourd de l'armée russe ne représentait pas une menace sérieuse : les militants détruisaient facilement les chars avec des lance-grenades. Les soldats n'étaient pour la plupart pas entraînés, il n'y avait pas de plans de la ville et il n'y avait aucune communication établie entre les unités. Déjà pendant l'assaut, le commandement russe change de tactique. Avec le soutien de l'artillerie et de l'aviation, l'offensive est menée par de petits groupes d'assaut aérien. L’usage généralisé de l’artillerie et des bombardements transforme Grozny en ruines. En mars, les derniers groupes de militants le quittent. Des autorités pro-russes sont créées dans la ville.
- Après une série de batailles, l'armée russe s'empare de régions et de villes clés de la Tchétchénie. Cependant, en reculant à temps, les militants ne subissent pas de pertes sérieuses. La guerre prend un caractère partisan. Des militants mènent des attaques terroristes et des attaques surprises contre des positions de l'armée russe dans toute la Tchétchénie. En réponse, des frappes aériennes sont menées, au cours desquelles des civils meurent souvent. Cela provoque la haine Forces russes, la population apporte son aide aux militants. La situation a été compliquée par les attaques terroristes de Budennovsk (1995) et de Kizlyar (1996), au cours desquelles de nombreux civils et soldats sont morts et les militants n'ont subi pratiquement aucune perte.
- En avril 1996, D. Dudayev a été tué à la suite d'une frappe aérienne, mais cela n'a plus affecté le cours de la guerre.
- A la veille des élections présidentielles, Boris Eltsine a décidé, pour des raisons politiques, d'accepter une trêve dans une guerre impopulaire parmi le peuple. En juin 1996, un accord a été signé sur une trêve, le désarmement des séparatistes et le retrait des troupes russes, mais aucune des deux parties n'a respecté les termes de l'accord.
- Immédiatement après avoir remporté les élections, Boris Eltsine a annoncé la reprise des hostilités. En août, des militants prennent d'assaut Grozny. Malgré la supériorité des forces russes, les troupes russes ne parviennent pas à tenir la ville. Un certain nombre d'autres colonies ont été capturées par les séparatistes.
- La chute de Grozny entraîne la signature des accords de Khasavyurt. L'armée russe se retirait de Tchétchénie, la question du statut de la république était reportée de cinq ans.
Résultats de la première guerre tchétchène
- La guerre de Tchétchénie était censée mettre fin au pouvoir illégal sur le territoire de la république. En général, les opérations militaires réussies lors de la première étape de la guerre, la prise de Grozny n'ont pas conduit à la victoire. De plus, les pertes importantes parmi les troupes russes ont rendu la guerre extrêmement impopulaire en Russie. L'utilisation généralisée de l'aviation et de l'artillerie s'est accompagnée de pertes parmi les civils, ce qui a donné à la guerre un caractère partisan prolongé. Les troupes russes ne tenaient que de grands centres et étaient constamment attaquées.
- Le but de la guerre n'a pas été atteint. Après le retrait des troupes russes, le pouvoir était à nouveau aux mains de groupes criminels et nationalistes.