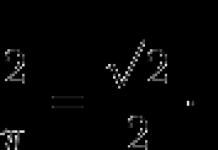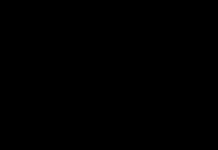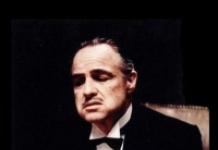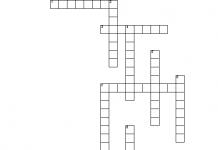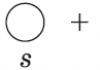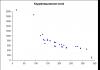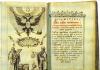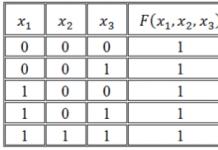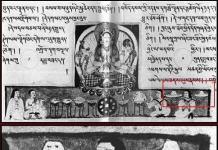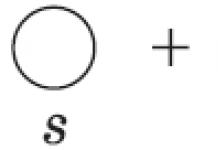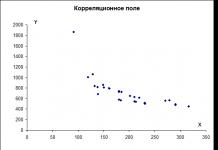La psychologie a parcouru un long chemin dans son développement, la compréhension de l'objet, du sujet et des objectifs de la psychologie a changé. Notons les principales étapes du développement de la psychologie en tant que science.
Étape I - la psychologie comme science de l'âme. Cette définition de la psychologie a été donnée il y a plus de deux mille ans. Ils ont essayé d'expliquer tous les phénomènes incompréhensibles de la vie humaine par la présence d'une âme. Stade II - la psychologie comme science de la conscience. Elle apparaît au XVIIe siècle en lien avec le développement des sciences naturelles. La capacité de penser, de ressentir, de désirer s'appelait la conscience. La principale méthode d'étude était l'observation par une personne d'elle-même et la description des faits. Stade III- la psychologie comme science du comportement. Apparaît au 20ème siècle. La tâche de la psychologie est de mettre en place des expériences et d'observer ce qui peut être vu directement, à savoir le comportement humain, les actions, les réactions (les motivations à l'origine des actions n'ont pas été prises en compte).
La psychologie est une science qui étudie les modèles objectifs, les manifestations et les mécanismes de la psyché.
Pour imaginer plus clairement le chemin du développement de la psychologie en tant que science, considérons brièvement ses principales étapes et orientations.
1. Les premières idées sur la psyché étaient associées à animisme(du latin anima - esprit, âme) - les vues les plus anciennes, selon lesquelles tout ce qui existe dans le monde a une âme. L'âme était comprise comme une entité indépendante du corps qui contrôle tous les objets vivants et inanimés.
2. Plus tard, dans les enseignements philosophiques de l'Antiquité, des aspects psychologiques ont été abordés, qui ont été résolus en termes d'idéalisme ou en termes de matérialisme. Ainsi, les philosophes matérialistes de l'Antiquité Démocrite, Lucrèce, Épicure compris l'âme humaine comme un type de matière, comme une formation corporelle constituée d'atomes sphériques, petits et très mobiles.
3. Selon le philosophe idéaliste grec ancien Platon(427-347 av. J.-C.), qui fut un étudiant et disciple de Socrate, l’âme est quelque chose de divin, différent du corps, et l’âme d’une personne existe avant d’entrer en contact avec le corps. Elle est l'image et l'écoulement de l'âme du monde. L'âme est un principe invisible, sublime, divin et éternel. L’âme et le corps entretiennent une relation complexe l’un avec l’autre. À ma façon origine divine l'âme est appelée à contrôler le corps, à diriger la vie humaine. Cependant, il arrive parfois que le corps prenne l’âme dans ses liens. Le corps est déchiré par divers désirs et passions, il se soucie de la nourriture, est sujet aux maladies, aux peurs et aux tentations. Les phénomènes mentaux sont divisés par Platon en raison, courage (au sens moderne - volonté) et désirs (motivation).
La raison est dans la tête, le courage dans la poitrine, la luxure dans la cavité abdominale. L’unité harmonieuse de la raison, des nobles aspirations et de la luxure donne de l’intégrité à la vie mentale d’une personne. L’âme habite le corps humain et le guide tout au long de sa vie, et après la mort, elle le quitte et entre dans le « monde des idées » divin. Puisque l’âme est la chose la plus élevée chez une personne, elle doit se soucier de sa santé plus que de celle du corps. Selon le genre de vie qu'une personne a menée, après sa mort, un sort différent attend son âme : soit elle errera près de la terre, chargée d'éléments corporels, soit s'envolera de la terre vers le monde idéal, dans le monde des idées, qui existe en dehors de la matière et en dehors de la conscience individuelle. « N’est-il pas dommage que les gens se soucient de l’argent, de la gloire et des honneurs, mais ne se soucient pas de la raison, de la vérité et de leur âme et ne pensent pas à l’améliorer ? - demandent Socrate et Platon.
4. Grand philosophe Aristote dans le traité « Sur l'âme », il distingue la psychologie comme un domaine de connaissance unique et avance pour la première fois l'idée de l'inséparabilité de l'âme et du corps vivant. Aristote rejetait la vision de l’âme en tant que substance. En même temps, il ne considérait pas possible de considérer l'âme isolément de la matière (les corps vivants). L'âme, selon Aristote, est incorporelle ; elle est la forme d'un corps vivant, cause et but de toutes ses fonctions vitales. Aristote a avancé le concept de l'âme comme une fonction du corps, et non comme un phénomène extérieur à celui-ci. L’âme, ou « psychisme », est le moteur qui permet à un être vivant de se réaliser. Si l’œil était un être vivant, son âme serait la vision. De même, l'âme d'une personne est l'essence d'un corps vivant, c'est la réalisation de son existence, croyait Aristote. La fonction principale de l’âme, selon Aristote, est la réalisation de l’existence biologique de l’organisme. Le centre, la « psyché », est situé dans le cœur, là où sont reçues les impressions des sens. Ces impressions constituent une source d'idées qui, combinées les unes aux autres à la suite d'une pensée rationnelle, subordonnent le comportement. Force motrice le comportement humain est le désir ( activité interne corps) associés à des sentiments de plaisir ou de déplaisir. Les perceptions sensorielles constituent le début de la connaissance. Conserver et reproduire les sensations assure la mémoire. La pensée se caractérise par la formation de concepts généraux, de jugements et de conclusions. Une forme particulière d'activité intellectuelle est l'esprit (la raison), apporté de l'extérieur sous la forme de la raison divine. Ainsi, l'âme se manifeste dans diverses capacités d'activité : nourrissante, ressentie, rationnelle. Les capacités supérieures naissent de et sur la base des capacités inférieures. La première capacité cognitive d’une personne est la sensation ; elle prend la forme d’objets sensoriels sans leur matière, tout comme « la cire prend l’impression d’un sceau sans fer ». Les sensations laissent une trace sous forme d'idées - des images de ces objets qui agissaient auparavant sur les sens. Aristote a montré que ces images sont liées dans trois directions : par similitude, par contiguïté et contraste, indiquant ainsi les principaux types de connexions - associations de phénomènes mentaux. Aristote croyait que la connaissance de l'homme n'est possible que grâce à la connaissance de l'Univers et de l'ordre qui y existe. Ainsi, dans un premier temps, la psychologie a agi comme une science de l'âme.
5. À l'époque moyen-âge L'idée a été établie que l'âme est un principe divin et surnaturel et que l'étude de la vie mentale devrait donc être subordonnée aux tâches de la théologie.
Seul le côté extérieur de l’âme, tourné vers le monde matériel, peut être soumis au jugement humain. Les plus grands mystères de l'âme ne sont accessibles que dans l'expérience religieuse (mystique).
6.C XVIIe siècle une nouvelle ère commence dans le développement des connaissances psychologiques. Dans le cadre du développement des sciences naturelles, les lois de la conscience humaine ont commencé à être étudiées à l'aide de méthodes expérimentales. La capacité de penser et de ressentir s’appelle la conscience. La psychologie a commencé à se développer en tant que science de la conscience. Elle se caractérise par des tentatives visant à comprendre le monde spirituel humain principalement à partir de positions philosophiques et spéculatives générales, sans la base expérimentale nécessaire. R. Descartes (1596-1650) conclut sur la différence entre l'âme humaine et son corps : « Le corps, de par sa nature, est toujours divisible, tandis que l'esprit est indivisible. Or, l’âme est capable de produire des mouvements dans le corps. Cet enseignement dualiste contradictoire a donné naissance à un problème appelé psychophysique : comment les processus corporels (physiologiques) et mentaux (spirituels) chez une personne sont-ils liés les uns aux autres ? Descartes a créé une théorie expliquant le comportement sur la base d'un modèle mécaniste. Selon ce modèle, les informations délivrées par les organes sensoriels sont envoyées le long des nerfs sensoriels jusqu'aux ouvertures du cerveau, que ces nerfs dilatent, permettant aux « âmes animales » du cerveau de circuler à travers de minuscules tubes – les nerfs moteurs – dans les muscles, qui gonfler, ce qui entraîne le retrait du membre irrité ou oblige à effectuer telle ou telle action. Ainsi, il n’était plus nécessaire de recourir à l’âme pour expliquer comment naissent des actes comportementaux simples. Descartes a jeté les bases du concept déterministe (causal) du comportement avec son idée centrale du réflexe comme réponse motrice naturelle du corps à une stimulation physique externe. Il s’agit du dualisme cartésien : un corps qui agit mécaniquement et une « âme rationnelle » qui le contrôle, localisée dans le cerveau. Ainsi, le concept d'« âme » a commencé à se transformer en concept d'« esprit », et plus tard en concept de « conscience ». La célèbre phrase cartésienne « Je pense, donc j'existe » est devenue la base du postulat selon lequel la première chose qu'une personne découvre en elle-même est sa propre conscience. L'existence de la conscience est le fait principal et inconditionnel, et la tâche principale de la psychologie est d'analyser l'état et le contenu de la conscience. Sur la base de ce postulat, la psychologie a commencé à se développer - elle a fait de la conscience son sujet.
7. Une tentative de réunir le corps et l'âme de l'homme, séparés par les enseignements de Descartes, a été faite par le philosophe néerlandais Spinoza(1632-1677). Il n’y a pas de principe spirituel particulier ; c’est toujours une des manifestations de la substance étendue (matière).
L'âme et le corps sont déterminés par les mêmes causes matérielles. Spinoza pensait que cette approche permet de considérer les phénomènes mentaux avec la même précision et la même objectivité que les lignes et les surfaces sont considérées en géométrie.
La pensée est une propriété éternelle de la substance (matière, nature), donc dans dans une certaine mesure la pensée est inhérente à la fois à la pierre et aux animaux, et dans une large mesure est inhérente aux humains, se manifestant sous la forme de l'intellect et de la volonté au niveau humain.
8. Philosophe allemand G.Leibniz(1646-1716), rejetant l'égalité du psychisme et de la conscience établie par Descartes, introduit le concept de psychisme inconscient. Dans l'âme humaine, il y a un travail caché continu de forces psychiques - d'innombrables « petites perceptions » (perceptions). D’eux naissent des désirs et des passions conscients.
9. Terme " psychologie empirique" introduit par le philosophe allemand du XVIIIe siècle X. Wolf pour désigner une direction de la science psychologique dont le principe principal est l'observation de phénomènes mentaux spécifiques, leur classification et l'établissement d'une connexion logique entre eux vérifiable par l'expérience. Le Le philosophe anglais J. Locke (1632-1704) considère l'âme humaine comme un environnement passif, mais capable de perception, la comparant à une ardoise vierge sur laquelle rien n'est écrit. Sous l'influence des impressions sensorielles, l'âme humaine, s'éveillant, est rempli d'idées simples, commence à penser, c'est-à-dire à former des idées complexes. Dans le langage de la psychologie, Locke a introduit le concept d'« association » - une connexion entre des phénomènes mentaux, dans laquelle l'actualisation de l'un d'eux entraîne l'apparition d'un autre Ainsi, la psychologie a commencé à étudier comment, grâce à l'association d'idées, une personne prend conscience du monde qui l'entoure. L'étude de la relation entre l'âme et le corps est finalement inférieure à l'étude de l'activité mentale et de la conscience.
Locke croyait qu'il existe deux sources de toute connaissance humaine : la première source est constituée des objets du monde extérieur, la seconde est l'activité de l'esprit d'une personne. L'activité de l'esprit et de la pensée est connue à l'aide d'un sentiment interne spécial - la réflexion. La réflexion, selon Locke, est « l’observation à laquelle l’esprit soumet son activité » ; c’est le fait de diriger l’attention d’une personne vers l’activité de sa propre âme. L'activité mentale peut se dérouler, pour ainsi dire, à deux niveaux : les processus du premier niveau - perceptions, pensées, désirs (chaque personne et chaque enfant en a) ; processus de deuxième niveau - observation ou « contemplation » de ces perceptions, pensées, désirs (seules les personnes ont ce les personnes mûres qui réfléchissent sur eux-mêmes, reconnaissent leurs expériences et états mentaux). Cette méthode d'introspection devient un moyen important d'étudier l'activité mentale et la conscience des personnes.
10. Sélection La psychologie est devenue une science indépendante dans les années 60. XIXème siècle. Il a été associé à la création d'institutions de recherche spéciales - laboratoires et instituts de psychologie, départements d'enseignement supérieur les établissements d'enseignement, ainsi qu'avec l'introduction d'expériences pour étudier les phénomènes mentaux. La première possibilité psychologie expérimentale La psychologie physiologique du scientifique allemand W. Wundt (1832-1920) est devenue une discipline scientifique indépendante. En 1879, il ouvre à Leipzig le premier laboratoire de psychologie expérimentale au monde.
22. Contribution significative au développement de la psychologie du 20e siècle. contribué notre les scientifiques nationaux L.S. (1896-1934), A.N. (1903-1979), A.R. Luria (1902-1977) et P.Ya. (1902-1988). L.S. Vygotski introduit le concept de fonctions mentales supérieures (pensée conceptuelle, discours rationnel, mémoire logique, attention volontaire) en tant que forme de la psyché spécifiquement humaine et socialement déterminée, et a également jeté les bases du concept culturel et historique développement mental personne. Les fonctions nommées existent initialement comme des formes d'activité externe, et seulement plus tard - comme un processus complètement interne (intrapsychique). Ils proviennent de formulaires communication verbale entre les personnes et médiatisé par les signes du langage. Le système de signes détermine le comportement dans une plus grande mesure que nature environnante, depuis le signe, le symbole contient un programme de comportement sous une forme réduite. Les fonctions mentales supérieures se développent au cours du processus d'apprentissage, c'est-à-dire activités conjointes enfant et adulte.
UN. Léontiev a mené une série d'études expérimentales révélant le mécanisme de formation des fonctions mentales supérieures en tant que processus de « croissance » (intériorisation) de formes supérieures d'actions de signes instrumentaux dans les structures subjectives de la psyché humaine.
A.R. Luria a accordé une attention particulière aux problèmes de localisation cérébrale des fonctions mentales supérieures et à leurs troubles. Il était l'un des créateurs nouvelle zone sciences psychologiques- neuropsychologie.
P.Ya. Halperin a considéré processus mentaux(de la perception à la pensée inclusive) comme activité d’orientation du sujet dans des situations problématiques. Le psychisme lui-même, en termes historiques, n'apparaît que dans une situation de vie mobile pour s'orienter à partir d'une image et s'effectue à l'aide d'actions en fonction de cette image. P.Ya. Galperin est l'auteur du concept de formation progressive actions mentales(images, concepts). La mise en œuvre pratique de ce concept peut augmenter considérablement l'efficacité de la formation.
Au XVIIe siècle, une nouvelle ère commence dans le développement des connaissances psychologiques. Elle se caractérise par des tentatives visant à comprendre le monde spirituel humain principalement à partir de positions philosophiques et spéculatives générales, sans la base expérimentale nécessaire. R. Descartes (1596-1650) conclut sur la différence complète qui existe entre l'âme d'une personne et son corps : le corps de par sa nature est toujours divisible, tandis que l'esprit est indivisible. Or, l’âme est capable de produire des mouvements dans le corps. Cet enseignement dualiste contradictoire a donné naissance à un problème appelé psychophysique : comment les processus corporels (physiologiques) et mentaux (spirituels) chez une personne sont-ils liés les uns aux autres ? Descartes a jeté les bases du concept déterministe (causal) du comportement avec son idée centrale du réflexe comme réponse motrice naturelle du corps à une stimulation physique externe.
Le philosophe néerlandais B. Spinoza (1632-1677) a tenté de réunir le corps et l'âme de l'homme, séparés par les enseignements de Descartes. Il n’y a pas de principe spirituel particulier ; c’est toujours une des manifestations de la substance étendue (matière). L'âme et le corps sont déterminés par les mêmes causes matérielles. Spinoza pensait que cette approche permet de considérer les phénomènes mentaux avec la même précision et la même objectivité que les lignes et les surfaces sont considérées en géométrie. Le philosophe allemand G. Leibniz (1646-1716), rejetant l'égalité du psychisme et de la conscience établie par Descartes, a introduit le concept de psychisme inconscient. Dans l'âme humaine, il y a un travail caché et continu de forces psychiques - d'innombrables petites perceptions (perceptions). D’eux naissent des désirs et des passions conscients. La psychologie durant cette période, ainsi que dans les premières étapes du développement de la science ancienne, renforça ses liens avec la philosophie. Cela s'expliquait par le fait que, tout en restant dans le cadre de la science de l'âme (son propre sujet), il était plus difficile à la psychologie de se débarrasser des dogmes scolastiques et de se séparer de la théologie. Cependant, l'accent mis sur la philosophie à cette époque a rétréci le sujet de la psychologie, qui considérait principalement les modèles généraux de développement de la psyché humaine, et non le monde vivant dans son ensemble. Le développement des sciences naturelles à cette époque ne permettait pas encore de construire sur cette base un concept à part entière de la psyché (notamment de la psyché humaine). Cependant, un lien étroit avec la philosophie ne signifiait pas que la psychologie ne cherchait pas à cette époque son propre sujet de recherche, une définition précise de son domaine d'activité. Ce domaine a été compris avant tout comme une étude de la manière dont une personne développe une image du monde qui l'entoure et d'elle-même. De plus, cette image, semble-t-il, aurait dû être consciente. À la suite des psychologues du Moyen Âge, les scientifiques ont vu la différence entre l'homme et les autres êtres vivants dans la conscience de l'âme, dans l'esprit. C’est ainsi que s’est clarifié le sujet de la psychologie, qui est devenue la science de la conscience. Parallèlement, à partir de plusieurs questions,
étudié par la psychologie de l'Antiquité - sur la cognition, sur les forces motrices et
les lois de la psyché, les mécanismes de régulation du comportement - ce sont précisément les problèmes de cognition qui sont apparus.
Cela était dû à plusieurs raisons. Le premier, mentionné ci-dessus, est le désir de prouver la capacité d’une personne à comprendre la vérité sur la base de la connaissance et non de la foi. La communication était considérée par les psychologues anciens comme l’une des composantes de la vie mentale. Ainsi, les problèmes des forces motrices et de la régulation de l'activité externe ont été pendant un certain temps abandonnés de l'étude. Parallèlement, des questions sur le contenu et les caractéristiques de la conscience ont amené les scientifiques à étudier son rôle dans la vie humaine, et donc dans le comportement humain. Encore une fois, la psychologie a dû analyser la différence entre un comportement (affectif) raisonnable et déraisonnable, les limites de la liberté humaine. Ainsi, une analyse de la formation du sujet de psychologie au cours de cette période donne un tableau contradictoire. D'une part, méthodologiquement, la psychologie se limitait aux questions de conscience et aux modes de sa formation, aux étapes de développement de l'image du monde et de soi. D'autre part, l'étude du contenu et des fonctions de la conscience a conduit à l'inclusion effective du comportement, des forces motrices et de la régulation de l'activité non seulement interne, mais aussi externe dans le cercle de recherche des principaux psychologues de l'époque. D'ailleurs, si à la fin du XVIe siècle. les problèmes du sujet de la psychologie, de l'objectivité des méthodes d'étude du psychisme et de l'analyse des données obtenues, qui étaient au cœur de la théorie de F. Bacon, sont apparus, puis, à partir de R. Descartes, les problèmes des fonctions de l'âme, son rôle dans la cognition et le comportement n'est pas devenu moins important.
Au début du Nouvel Âge, malgré les efforts de F. Bacon, l'approche rationaliste était plus répandue, développée par des scientifiques aussi célèbres que R. Descartes, G.W. Leibniz. Cela était dû en grande partie à la nécessité pour la psychologie et la philosophie de surmonter les conséquences de la scolastique.
Cependant, au milieu du siècle, le développement rapide de la science et de l'industrie rendit évident la nécessité de prendre en compte les nouvelles exigences de la psychologie, et donc du sensationnalisme, représenté à cette époque dans les concepts de D. Locke et T. Hobbes, commença à se répandre de plus en plus.
Le terme « psychologie empirique » a été introduit par le philosophe allemand du XVIIIe siècle. X. Wolf pour désigner une direction de la science psychologique dont le principe principal est l'observation de phénomènes mentaux spécifiques, leur classification et l'établissement d'une connexion naturelle expérimentalement vérifiable entre eux. Le philosophe anglais J. Locke (1632-1704) considère l'âme humaine comme un médium passif mais perspicace, la comparant à une page vierge sur laquelle rien n'est écrit. Sous l'influence des impressions sensorielles, l'âme humaine, s'éveillant, se remplit d'idées simples et commence à penser, c'est-à-dire former des idées complexes. Locke a introduit dans le langage de la psychologie le concept d'association - une connexion entre des phénomènes mentaux, dans laquelle l'actualisation de l'un d'eux entraîne l'apparition d'un autre.
L'émergence de méthodes de recherche strictement objectives et les changements dans le domaine de la psychologie ont également affecté la compréhension du concept d'« âme » par la nouvelle génération de psychologues. Puisqu'en expliquant les faits vie mentale Puisqu’elle ne jouait plus son rôle antérieur, selon le principe d’Occam, la psychologie de l’époque ne ressentait pas le besoin d’utiliser ce concept dans ses recherches. Cependant, dans ce cas, il fallait trouver une autre approche pour expliquer l'activité du corps, identifier nouvelle sourceénergie pour l’activité interne et externe. Cela a été aidé par les lois de la mécanique, découvertes par la physique moderne de l'époque, les lois de I. Newton. Ce sont eux qui ont été utilisés par Descartes pour étayer la première théorie du réflexe de l'histoire de la psychologie, qui, au fil du temps, a reçu une justification croissante dans les découvertes dans des domaines scientifiques adjacents à la psychologie et est devenue l'un des postulats de la psychologie moderne.
Au début du XIXe siècle, de nouvelles approches du psychisme commencent à prendre forme. Désormais, ce n’est plus la mécanique, mais la physiologie qui stimule le développement des connaissances psychologiques. Ayant pour sujet un corps naturel particulier, la physiologie en a fait un objet d'étude expérimentale. Au début, le principe directeur de la physiologie était le « principe anatomique ». Les fonctions (y compris mentales) ont été étudiées du point de vue de leur dépendance à l'égard de la structure de l'organe et de son anatomie. La physiologie a traduit les vues spéculatives, parfois fantastiques, de l’époque précédente dans le langage de l’expérience.
La psychologie est devenue une science indépendante dans les années 60 du XIXe siècle. Il a été associé à la création d'institutions de recherche spéciales - laboratoires et instituts de psychologie, départements d'établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'introduction d'expériences pour étudier les phénomènes mentaux. La première version de la psychologie expérimentale en tant que discipline scientifique indépendante fut la psychologie physiologique du scientifique allemand W. Wundt (1832-1920), créateur du premier laboratoire psychologique. Dans le domaine de la conscience, croyait-il, une causalité mentale particulière opère, soumise à une recherche scientifique objective.
Conclusion
Considération historique de faits précis, événements majeurs et les tendances dans le développement de la science psychologique nous permettent d'affirmer que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'approche unifiée, de compréhension commune de ce qu'étudie la psychologie. Différences de points de vue sur les questions les plus centrales de la psychologie, à commencer par la principale - la question du sujet de la psychologie, ainsi que différentes approchesà la compréhension de la personnalité, l'essence du développement mental, l'intelligence, etc. sont si importants que, comme l'écrit G. Allport, « il semble parfois qu'en dehors du dévouement à leur profession, les psychologues ont peu de choses en commun... sur le sujet. Dans les différentes approches psychologiques, les éléments suivants apparaissent comme tels : l'expérience, le comportement, les connexions psychophysiques, les processus de pensée conscients, l'inconscient, la nature humaine et même la « totalité de l'existence mentale humaine ». et peut-être état actuel notre science) par une série d'idées fausses et d'erreurs ? P.Ya. Halperin, considérant le processus historico-psychologique dans le contexte des problèmes actuels, parmi lesquels « la question du sujet d'étude n'est pas seulement la première et aujourd'hui peut-être la plus difficile des grandes questions théoriques de la psychologie, mais en même temps temps une question d’une importance pratique urgente », a donné la réponse suivante à cette question. en cours d'analyse faits historiques, il a souligné la compréhension du sujet de la psychologie qu'ils contiennent (explicitement ou de manière latente). Selon Halperin, tout au long de l'histoire de la psychologie, trois définitions de son sujet ont été proposées : l'âme, la conscience, le comportement. Il les a toutes jugées « insuffisantes », « insolvables », « erronées ». Est-il possible, sur la base d'une telle évaluation des résultats des travaux des prédécesseurs, d'écarter le matériel de leurs recherches et de tout recommencer ? Apparemment, cette position contredit l'un des principes les plus importants savoir scientifique- le principe de l'historicisme.
En raison de l'exceptionnelle complexité de la réalité étudiée en psychologie, quel que soit son nom - psychisme, conscience, etc. - elle n'a reçu une définition tout à fait adéquate dans aucune des approches qui se sont développées dans l'histoire des sciences : chacune des ils ne contiennent qu'un moment de vérité à ce sujet. Mais un tel moment existe, et il doit être révélé ! La psyché humaine est à la fois consciente et inconsciente, elle est sociale et a des prérequis biologiques, elle médiatise notre vie et est elle-même un produit de cette vie, elle est déterminée par les influences extérieures et en est libre, elle possède des connaissances et de l'expérience, elle est holistique, mais et constitué de nombreux éléments, il s’agit à la fois d’un phénomène et d’un processus. Il est faux de considérer l’une de ces dispositions comme une vérité absolue ou une autre comme absolument fausse. Les vues des prédécesseurs sont apparues avec une nécessité historique; elles ont été déterminées par les conditions de leur époque et forment ensemble la logique du développement de la pensée psychologique scientifique en tant que processus de transformations successives du domaine de la psychologie dans le contexte de son objectif. causes et conditions.
La psychologie a commencé avec l'idée de l'âme et, comme L.S. l'a astucieusement noté. Vygotsky, « la psychologie en tant que science devait commencer par l’idée de l’âme ». Il explique plus en détail cette position, évaluant cette idée comme « la première hypothèse scientifique homme ancien, une énorme conquête de la pensée." Pendant plus de 20 siècles, avec son aide, tous les processus vitaux du corps ont été expliqués. Le concept de l'âme dans son contenu n'était pas seulement psychologique, mais plus large, plutôt biologique, expliquant tous les processus vitaux. à l'aide d'une interprétation similaire. "Nous ne voyons pas grand-chose dans cette simple ignorance et erreur, tout comme nous ne considérons pas l'esclavage comme le résultat mauvais caractère", a écrit L.S. Vygotsky. La raison de cette vision de la nature de l'âme était une connaissance insuffisante de la structure et du travail du corps (au XVIIe siècle, le sage Spinoza notait : « de quoi le corps est capable, personne a encore déterminé, c'est-à-dire que l'expérience n'a encore appris à personne de quelles actions le corps est capable en vertu des seules lois de la nature, considérée exclusivement comme corps, et de ce dont il est incapable s'il n'est pas déterminé par l'âme. " Précisément en raison d'une connaissance insuffisante du fonctionnement d'un corps vivant, le concept d'âme est devenu le principe explicatif qui faisait office de source et de détermination de toutes les manifestations d'un organisme vivant, remplaçant les connaissances spécifiques sur les mécanismes de ses fonctions corporelles (respiration , circulation sanguine, nutrition, etc.).Les grandes découvertes des XVIIe et XVIIe siècles. dans diverses sciences et, notamment dans le domaine de l'anatomie et de la physiologie humaines, ont eu un impact véritablement révolutionnaire sur les idées sur l'âme, ont contribué à un changement radical en vue de ses fonctions. Bacon a résumé ces études. "Observer le corps sensible et essayer de découvrir pourquoi il y a une telle action... la nourriture est digérée et expulsée, les mucosités et les jus montent et descendent dans tout le corps, le cœur et les vaisseaux sanguins palpitent, les organes internes, comme des ateliers , chacun accomplit son travail », il est arrivé à la conclusion que les fonctions de l'âme devraient être limitées capacités psychiques. Il a appelé la raison de la large compréhension des fonctions de l'âme, y compris les processus purement corporels, l'ignorance des philosophes anciens.
L'idée de l'âme, par nécessité historique, a été remplacée par le concept de psychisme en tant que sujet de psychologie. Le critère des processus mentaux, contrairement aux processus corporels, a été introduit au XVIIe siècle. R. Descartes. Il a appelé ce critère la conscience. Ainsi, la psychologie a commencé à se développer dans le cadre des enseignements philosophiques sur la conscience. Dans ce contexte est apparu problèmes fondamentaux. Le premier d'entre eux était le problème de la place de la conscience dans l'être, sa relation avec le monde des corps matériels - un problème psychophysique. De Descartes vient leur vive opposition, qui dans son système prend la forme de la doctrine de deux substances opposées : l'une spirituelle, pensante, immatérielle - pour la désigner Descartes retient le concept d'âme, et l'autre corporelle, étendue - Descartes l'appelle corps . Leur hétérogénéité absolue constitue l’essence du dualisme cartésien, qui a déterminé pendant des siècles l’orientation du développement. problèmes psychologiques. Le plus important d'entre eux était le problème de la méthode d'étude de la conscience - il a proclamé l'introspection. J. Locke a formulé le problème de l'étude de l'origine de la conscience et a fixé l'orientation empirique de sa solution : la conscience n'a pas de contenu inné, elle se développe dans l'expérience. Il divise l'expérience elle-même en deux formes : externe - sa source sont les sensations, et interne - sa source est « les actions internes de notre esprit, que nous percevons nous-mêmes et sur lesquelles nous réfléchissons nous-mêmes... appelant la première source sensation, j'appelle la seconde réflexion, parce qu’elle ne délivre que les idées acquises par l’esprit en réfléchissant sur ses propres activités en lui-même. Contrairement aux idées empiriques sensualistes de Locke, G. Leibniz développe une vision rationaliste de la nature de la conscience, lui attribuant certaines vérités innées, ainsi que des inclinations, des prédispositions, etc. Il souligne également le caractère actif de la conscience, qu'il désigne par le concept d'aperception. Pour expliquer le fait le plus important de la vie mentale et de la conscience – sa cohérence – Locke introduit le concept d'association d'idées. Sur cette base émerge la psychologie associative, dont les variantes constituent le contenu principal du développement de la psychologie au XIXe siècle. Née sur la base des sciences naturelles mécanistes du XVIIe siècle, elle a révélé son incohérence sous l'influence des succès de la biologie, et surtout de la théorie évolutionniste de Charles Darwin et des idées évolutionnistes de G. Spencer. L'introduction de l'idée du rôle adaptatif de la psyché dans le comportement a posé les tâches de son étude d'une manière nouvelle et a conduit d'abord à l'émergence du fonctionnalisme avec son exigence d'étudier la psyché dans sa fonction utile, puis à la refus d'étudier le psychisme - dans le behaviorisme. Le behaviorisme et le comportement émergent comme un sujet de recherche qui remplace la conscience. Moins radicaux, mais très significatifs ont été des tournants dans le développement de la doctrine de la conscience, tels que le refus d'identifier la psyché avec la conscience et l'indication de la structure profonde de la psyché avec sa zone inconsciente - cette idée a été développée par divers auteurs, à partir de de Leibniz, mais a reçu son développement fondamental dans la psychanalyse de S. Freud et ses directions proches. La tentative de ne pas limiter l’étude de la conscience au contexte de ses relations avec le monde naturel et de la comprendre comme un produit du développement socio-historique a également été productive. Le problème du conditionnement social de la psyché humaine s'est posé, qui a connu un développement puissant dans la psychologie du XXe siècle.
Certains des tournants les plus importants dans le développement de la pensée psychologique scientifique, brièvement esquissés, ont été objectivement déterminés par des raisons historiques. Associé à chacun d'eux découvertes importantes, ils conservent leur signification - ils ont une signification historique, ils le sont, selon L.S. Vygotsky, un pas vers la vérité. Aucune des tentatives du passé ne peut être écartée, notamment parce que la psychologie n'est pas encore proche d'une compréhension unifiée de sa science, et si tel est son objectif, alors, comme l'a judicieusement noté G. Allport, « il est toujours loin d’y parvenir. » . On admet avec cet auteur : "C'est bien qu'il y ait des adeptes de Locke et de Leibniz, positivistes et personnalistes, freudiens et néo-freudiens, objectivistes et phénoménologues. Ni ceux qui préfèrent les modèles (mathématiques, animaux, mécaniques, psychiatriques), ni ceux ceux qui les rejettent "ne peuvent pas avoir raison dans tous les détails, mais ce qui est important c'est que chacun soit libre de choisir sa propre manière de travailler. La seule personne à blâmer est celle qui voudrait verrouiller toutes les portes sauf une".
L'histoire raconte comment la psychologie maîtrise le sujet de son étude.
Bibliographie:
1. Petrovsky A.V. Yaroshevsky M.G. Histoire et théorie
psychologie en 2 volumes. T-1 1996 ;
2. Petrovsky A.V. Questions d'histoire et de théorie de la psychologie.
3. Jdan A.N. Histoire de la psychologie : de l'Antiquité à
de notre temps : Un manuel pour les étudiants de la Faculté de psychologie. M. : Pédagogique
Société de Russie 1999. – 512 p. ;
4. Martsinkovskaya T.D. Histoire de la psychologie : Manuel.
aide aux étudiants plus haut cahier de texte institutions.- M. : Centre d'édition « Académie », 2001 ;
5. Rubinshtein S.L. Les bases Psychologie générale– Saint-Pétersbourg : Pierre
2002. – 720 p.
6. Histoire de la psychologie du XXe siècle. /Éd. P.Ya.
Galperina, A.N. Jdan. 4e éd. – M. : Avenue Académique ; Ekaterinbourg, Livre d'affaires, 2002. – 832 p.
La psychologie au XVIIe siècle.
Le principal problème de la psychologie du XVIIe siècle était une conception différente du sujet de la psychologie. La question de l’âme est devenue le problème de la conscience en tant que capacité exclusive de l’âme humaine non seulement à penser et à ressentir, mais aussi à refléter tous les actes et tous les états avec une factualité indéniable. La solution à ce problème est devenue le programme principal pour le développement du sujet de la psychologie. La comparaison de la conscience et de la psyché était importante non seulement pour désigner le sujet de la psychologie, mais aussi pour justifier les méthodes, puisque l'introspection est devenue non seulement la principale, mais aussi une méthode équivalente pour étudier la vie mentale. Essentiellement, si l'inconscient n'existe pas et que tous les processus qui se produisent dans l'âme humaine sont conscients, alors la réflexion a une base réelle. Toute l'attention à vie intérieure permet à une personne de comprendre ce qui se passe dans l'âme humaine, et en même temps de faire des données obtenues un sujet d'analyse. De nombreux psychologues de l'époque étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle les critères de l'exactitude de nos connaissances se trouvent dans la conscience. Au XVIIe siècle, avec le développement de divers dispositifs techniques, le principe de leur fonctionnement a de plus en plus attiré l'attention de la pensée scientifique afin de expliquer les fonctions du corps humain à leur ressemblance et à leur image.
La première découverte fut la théorie de Harvey sur le système circulatoire. Il imaginait le cœur comme une pompe qui pompe le sang et, dans ce processus, la présence de l'âme humaine n'était pas du tout requise.
Descartes a ensuite avancé une théorie sur corps humain comme une machine en état de marche. Si le corps humain primitif était considéré comme une sorte de système contrôlé par l’âme, aujourd’hui, avec la théorie de Descartes, le corps était libéré de l’âme. Le corps ne fait que bouger (réflexe), mais l'âme pense (réflexion).
Spinoza a cherché à réfuter les théories de Descartes ; il a soutenu qu'il existe une certaine substance éternelle (la Nature, Dieu), qui possède de nombreuses propriétés inhérentes. De sa théorie, il découle que l'homme est un être physique et spirituel. Il était convaincu que la connaissance intuitive mène, seule l'intuition permet de pénétrer dans l'essence des choses, de connaître concepts généraux, ouvrez des possibilités illimitées de connaissance de soi.
Leibniz prône également une approche de l’homme dans sa globalité. La base de cette unité est le principe spirituel. Dans l’âme, Leibniz distingue plusieurs domaines : le savoir clair, le savoir vague et le domaine de l’inconscient. Il a dérivé une formule de parallélisme psychophysique. Le corps et l’âme effectuent leurs opérations automatiquement et indépendamment.
Thomas Hobbes n'a pris que l'expérience comme base de connaissance. Il a rejeté l'âme en tant qu'entité spéciale. Selon lui, il n’y a rien au monde sauf des corps matériels. Tous les phénomènes mentaux sont soumis aux lois de la mécanique. En influençant le corps, les choses matérielles provoquent des sensations d'où, selon les lois de l'inertie, surgissent des idées, formant des chaînes de pensées. Cette connexion s'appelle une association.
Locke a nié l'existence d'idées innées. La psyché humaine se forme tout au long de sa vie. Il a soutenu que c'est l'éducation qui est d'une grande importance.
Le XVIIe siècle a radicalement élevé la barre des critères scientifiques. Il a réformé les principes explicatifs des siècles précédents. Le principal fonds de connaissances scientifiques comprend des idées mécaniques sur les sensations, le réflexe, l'affect, le motif et l'association.
La science moderne doit son existence précisément à ces longs processus qui ont commencé au XVIIe siècle.
Développement de la pensée psychologique au XVIIe siècle et à l'époque des Lumières (XVIIIe siècle)
Avec l'approbation de dispositifs techniques simples dans la production sociale, le principe de leur fonctionnement a de plus en plus attiré la pensée scientifique pour expliquer les fonctions du corps à son image et à sa ressemblance. La première grande réussite dans cet aspect fut la découverte par Harvey du système circulatoire, dans lequel le cœur était considéré comme une sorte de pompe qui pompe un fluide, ce qui ne nécessite pas la participation de l'âme.
Nouveau croquis théorie psychologique, visant à expliquer les principes de Galilée et la nouvelle mécanique de Newton, appartenait au naturaliste français René Descartes (1596 - 1650). Il a présenté un modèle théorique de l'organisme comme un automate fonctionnant mécaniquement. Grâce à cette compréhension, le corps vivant, qui était auparavant considéré comme gouverné par l'âme, fut libéré de son influence et de ses interférences ; les fonctions de la « machine corporelle », qui comprennent « la perception, l’impression des idées, la conservation des idées en mémoire, les aspirations internes… sont exécutées dans cette machine comme les mouvements d’une horloge ».
Plus tard, Descartes a introduit le concept de réflexe, qui est devenu fondamental en psychologie. Si Harvey a « retiré » l'âme de la catégorie des régulateurs des organes internes, alors Descartes l'a « supprimée » au niveau de l'organisme tout entier. Le schéma réflexe était le suivant. Une impulsion externe met en mouvement des particules légères ressemblant à de l'air, des « esprits animaux », transportées dans le cerveau à travers des « tubes » qui constituent le système nerveux périphérique, de là les « esprits animaux » sont réfléchis vers les muscles. Le schéma de Descartes, après avoir expliqué la force qui anime le corps, a découvert la nature réflexe du comportement.
L’une des œuvres les plus importantes de Descartes en psychologie s’intitule « Les Passions de l’âme ». Dans ce document, le scientifique a non seulement « privé » l'âme de son rôle royal dans l'Univers, mais l'a également « élevée » au niveau d'une substance égale aux autres substances de la nature. Il y a eu une révolution dans le concept de l'âme. Le sujet de la psychologie est devenu la conscience. Estimant que la machine du corps et la conscience occupée de ses propres pensées, idées et désirs sont deux entités (substances) indépendantes l'une de l'autre, Descartes était confronté à la nécessité d'expliquer comment elles coexistent chez une personne. L'explication qu'il propose s'appelle l'interaction psychophysique. C'était le suivant : le corps influence l'âme, éveillant en elle des passions sous forme de perceptions sensorielles, d'émotions, etc. L'âme, possédant la pensée et la volonté, influence le corps, le forçant à travailler et à changer de cap. L'organe où communiquent ces deux substances incompatibles est l'une des glandes endocrines - la « glande pinéale » (épiphyse).
La question de l’interaction de l’âme et du corps absorbe l’énergie intellectuelle de nombreux esprits depuis des siècles. Après avoir libéré le corps de l'âme, Descartes a « libéré » l'âme (psyché) du corps ; le corps ne peut que bouger, l'âme ne peut que penser ; le principe de fonctionnement du corps est un réflexe (c'est-à-dire que le cerveau reflète les influences extérieures) ; le principe du travail de l'âme est la réflexion (du latin - "revenir en arrière", c'est-à-dire que la conscience reflète ses propres pensées, idées, sensations).
Descartes a créé nouvel uniforme le dualisme sous la forme de la relation entre l'âme et le corps, divisait les sentiments en deux catégories : ceux enracinés dans la vie de l'organisme et ceux purement intellectuels. Dans son dernier ouvrage - une lettre à la reine suédoise Christine - il a expliqué l'essence de l'amour comme un sentiment qui a deux formes : la passion corporelle sans amour et l'amour intellectuel sans passion. Selon lui, seule la première se prête à une explication causale, puisqu'elle dépend de l'organisme et de la mécanique biologique ; le second ne peut être que compris et décrit. Descartes croyait que la science en tant que connaissance des causes des phénomènes était impuissante face aux manifestations les plus élevées et les plus significatives de la vie mentale d'un individu. Le résultat de son raisonnement similaire fut le concept de « deux psychologies » - explicative, faisant appel à des raisons liées aux fonctions du corps, et descriptive, consistant dans le fait que nous expliquons uniquement le corps, tandis que nous comprenons l'âme.
Des tentatives pour réfuter le dualisme de Descartes, pour affirmer l'unité de l'univers, pour mettre fin au fossé entre le physique et le spirituel, la nature et la conscience, ont été faites par plusieurs grands penseurs du XVIIe siècle. L'un d'eux était le philosophe hollandais Baruch (Benoît) Spinoza (1632-1677). Il a enseigné qu'il existe une substance éternelle – Dieu ou la Nature – dotée d'un nombre infini d'attributs (propriétés inhérentes). Parmi ceux-ci, croyait le philosophe, seuls deux sont ouverts à notre compréhension limitée : l'extension et la pensée ; De là, il est clair qu'il est inutile d'imaginer une personne comme le lieu de rencontre de deux substances : une personne est un être physique et spirituel intégral.
Une tentative de construire une doctrine psychologique sur l'homme en tant qu'être intégral est capturée dans son ouvrage principal - « L'éthique ». Il se donne pour tâche d'expliquer toute la variété des sentiments (affects) en tant que forces motivantes du comportement humain avec la précision et la rigueur des preuves géométriques. Il a été avancé qu’il existe trois forces motivantes : l’attraction, la joie et la tristesse. Il a été prouvé que de ces effets fondamentaux découlent toute la variété des états émotionnels ; dans le même temps, la joie augmente la capacité d’action du corps, tandis que la tristesse la réduit.
Spinoza a adopté du philosophe et mathématicien allemand Leibniz (1646-1716), qui a découvert le calcul différentiel et intégral, l'idée suivante de l'unité du physique et du mental. La base de cette unité est le principe spirituel. Le monde se compose d'innombrables entités spirituelles - les monades (du gr. monos - une). Chacun d’eux est « psychique », c’est-à-dire pas matériel (comme un atome), mais doté de la capacité de percevoir tout ce qui se passe dans l'Univers. L’activité imperceptible des « petites perceptions » – les perceptions inconscientes – se produit continuellement dans l’âme. Dans les cas où ils sont réalisés, cela devient possible du fait qu'un acte spécial - l'aperception - s'ajoute à la simple perception. Cela inclut l’attention et la mémoire. Ainsi, Leibniz a introduit le concept de psychisme inconscient.
À la question de savoir comment les phénomènes spirituels et physiques sont liés les uns aux autres, Leibniz a répondu par une formule connue sous le nom de parallélisme psychophysique. Selon lui, ils ne peuvent pas s’influencer mutuellement. La dépendance du psychisme aux influences corporelles est une illusion. L'âme et le corps effectuent leurs opérations de manière indépendante et automatique. Pourtant, la sagesse divine se reflète dans le fait qu’il existe entre eux une harmonie préétablie. elles sont comme deux horloges qui indiquent toujours la même heure, parce qu'elles fonctionnent avec la plus grande précision.
A la fin de cette section de psychologie, il faut mentionner le nom du philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679). Avant lui dans enseignements psychologiques le rationalisme régnait (du latin racio - raison). Hobbes a proposé de prendre l'expérience comme base de la connaissance. Ils opposaient le rationalisme à l'empirisme (du latin empirio - expérience). C'est ainsi qu'est née la psychologie empirique.
Au XVIIIe siècle en Europe, alors que le processus de renforcement des relations capitalistes se poursuivait, un nouveau mouvement, les Lumières, s’étendit et se renforça. Ses représentants croyaient raison principale tous les maux humains sont l'ignorance. On supposait qu'en luttant contre ce phénomène, la société se débarrasserait des désastres sociaux et des vices et que la bonté et la justice régneraient partout. Ces idées ont acquis des tonalités différentes selon les pays en raison du caractère unique de leur développement socio-historique. Ainsi, en Angleterre, I. Newton (1643-1727) crée une nouvelle mécanique, perçue comme modèle et idéal de connaissance exacte, comme triomphe de la raison.
Conformément à la compréhension de la nature de Newton, le médecin anglais Hartley (1705-1757) a expliqué le monde mental humain. Il l'a présenté comme un produit du travail du corps – une « machine vibrante ». Ce qui suit a été supposé. La vibration de l'éther externe à travers les vibrations des nerfs provoque des vibrations de la matière cérébrale, qui se transforment en vibrations des muscles. Parallèlement à cela, des « compagnons » mentaux de vibrations apparaissent, se combinent et se remplacent dans le cerveau - du ressenti au la pensée abstraite et des actions volontaires. Tout cela se déroule sur la base du droit des associations. Hartley comptait. que le monde mental humain se développe progressivement à la suite de la complication des éléments sensoriels primaires par des associations de contiguïté des éléments dans le temps. Par exemple, le comportement d'un enfant est régulé par deux forces de motivation : le plaisir et la souffrance.
La tâche de l'éducation, selon lui, revient à renforcer chez les gens des liens qui les détourneraient des actes immoraux et leur procureraient du plaisir dans les actes moraux. et plus ces liens sont forts, plus grandes sont les chances pour une personne de devenir une personne moralement vertueuse, et pour l'ensemble de la société, plus parfaites.
D'autres penseurs marquants des Lumières étaient C. Helvetius (1715-1771), P. Holbach (1723-1789) et D. Diderot (1713-1784). Défendant l'idée de l'émergence du monde spirituel à partir du monde physique, ils ont présenté « l'homme-machine » doté d'un psychisme comme un produit d'influences extérieures et d'histoire naturelle. Dans la dernière période des Lumières, le médecin-philosophe P. Cabanis (1757-1808) avançait l'idée selon laquelle la pensée est une fonction du cerveau.
Parallèlement, il part d'observations de l'expérience sanglante de la révolution, dont les dirigeants lui ont chargé de connaître la conscience du condamné, dont la tête a été coupée à la guillotine, de ses souffrances, dont les preuves pourraient être convulsions. Cabanis a répondu à cette question par la négative. Seule une personne dotée d’un cerveau est capable de penser. Les mouvements d’un corps sans tête sont de nature réflexive et ne sont pas conscients. La conscience est une fonction du cerveau. P. Cabanis considérait l'expression des pensées par des mots et des gestes comme des produits externes de l'activité cérébrale. Les produits externes de l’activité cérébrale comprennent l’expression des pensées sous forme de mots et de gestes. Derrière la pensée elle-même, selon lui, se cache l'inconnu processus nerveux, l'inséparabilité des phénomènes mentaux et du substrat nerveux. En défendant la nécessité de passer de l’étude spéculative à l’étude empirique de cette inséparabilité, il a préparé le terrain pour le mouvement de la pensée scientifique au siècle prochain.
Le penseur italien D. Vico (1668-1744) dans son traité « Fondements d'une nouvelle science de la nature générale des choses » (1725) avance l'idée que toute société traverse successivement trois époques : les dieux, les héros et les hommes. Quant aux propriétés mentales d'une personne, elles surviennent, selon D. Vico, au cours de l'histoire de la société. Il associe notamment l’émergence de la pensée abstraite au développement du commerce et de la vie politique. Le nom de D. Vico est associé à l'idée de pouvoir spirituel supra-individuel, caractéristique du peuple dans son ensemble et constituant la base fondamentale de la culture et de l'histoire.
En Russie, l'atmosphère spirituelle du siècle des Lumières a déterminé les vues philosophiques et psychologiques d'A.N. Radishchev (1749-1802). A.N. Radishchev cherchait la clé de la psychologie des gens dans les conditions de leur vie sociale (« Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou »), pour laquelle il fut condamné à mort, remplacé par l'exil en Sibérie.
Ainsi, au siècle des Lumières, deux directions sont apparues dans le développement des problèmes de connaissance psychologique : l'interprétation du psychisme en fonction d'une matière hautement organisée - le cerveau, qui a contribué à l'étude expérimentale de ces phénomènes qui étaient considérés comme le produit d'une âme désincarnée; la doctrine selon laquelle la psyché individuelle est déterminée par les conditions sociales, les mœurs, les coutumes et le monde spirituel des personnes motivées par leur propre énergie de créativité culturelle.
Bibliographie
Pour préparer ce travail, des matériaux ont été utilisés du site http://www.troek.net/
Par exemple, cela remonte à des milliers d’années. Le terme « psychologie » (du grec. psyché- âme, logos- doctrine, science) signifie « enseigner l’âme ». Les connaissances psychologiques se sont développées historiquement - certaines idées ont été remplacées par d'autres.
Bien entendu, l’étude de l’histoire de la psychologie ne peut se réduire à une simple liste de problèmes, d’idées et d’idées de diverses écoles de psychologie. Pour les comprendre, vous devez comprendre leur lien interne, la logique unifiée de la formation de la psychologie en tant que science.
La psychologie en tant que doctrine sur l'âme humaine est toujours conditionnée par l'anthropologie, la doctrine de l'homme dans son intégrité. Les recherches, les hypothèses et les conclusions de la psychologie, aussi abstraites et particulières qu'elles puissent paraître, impliquent une certaine compréhension de l'essence d'une personne et sont guidées par l'une ou l'autre image de celle-ci. À son tour, la doctrine de l'homme s'inscrit dans l'image générale du monde, formée sur la base d'une synthèse des connaissances et des attitudes idéologiques de l'époque historique. Par conséquent, l'histoire de la formation et du développement connaissances psychologiques est considéré comme un processus tout à fait logique associé à un changement dans la compréhension de l'essence de l'homme et à la formation sur cette base de nouvelles approches pour expliquer son psychisme.
Histoire de la formation et du développement de la psychologie
Idées mythologiques sur l'âme
L'humanité a commencé avec mythologique photos du monde. La psychologie doit son nom et sa première définition à mythologie grecque, selon lequel Eros, le dieu immortel de l'amour, tomba amoureux d'une belle mortelle, Psyché. L'amour d'Éros et de Psyché était si fort qu'Éros réussit à convaincre Zeus de transformer Psyché en déesse, la rendant immortelle. Ainsi, les amoureux étaient unis pour toujours. Pour les Grecs, ce mythe était une image classique du véritable amour comme réalisation la plus élevée. l'âme humaine. Par conséquent, Psycho - un mortel qui a acquis l'immortalité - est devenu le symbole d'une âme à la recherche de son idéal. En même temps, dans cette belle légende sur le chemin difficile d'Éros et de Psyché l'un vers l'autre, on discerne une réflexion profonde sur la difficulté d'une personne à maîtriser sa nature spirituelle, son esprit et ses sentiments.
Les Grecs de l’Antiquité ont d’abord compris le lien étroit entre l’âme et sa base physique. La même compréhension de ce lien peut être vue dans les mots russes : « âme », « esprit » et « respirer », « air ». Déjà dans les temps anciens, le concept de l'âme réunissait en un seul complexe ceux inhérents à la nature extérieure (l'air), au corps (la respiration) et à une entité indépendante du corps qui contrôle les processus de la vie (l'esprit de vie).
Dans les premières idées, l'âme était dotée de la capacité de quitter le corps pendant qu'une personne dort et de vivre sa propre vie dans ses rêves. On croyait qu'au moment de la mort, une personne quittait son corps pour toujours et s'envolait par la bouche. La doctrine de la transmigration des âmes est l’une des plus anciennes. Il a été présenté non seulement dans l'Inde ancienne, mais aussi dans La Grèce ancienne, notamment dans la philosophie de Pythagore et de Platon.
L’image mythologique du monde, où les corps sont habités par des âmes (leurs « doubles » ou fantômes) et où la vie dépend de l’arbitraire des dieux, règne dans la conscience publique depuis des siècles.
Connaissances psychologiques à l'époque antique
Psychologie comment rationnel la connaissance de l'âme humaine est née dans les profondeurs de l'Antiquité sur la base de la image géocentrique du monde, plaçant l'homme au centre de l'univers.
La philosophie antique a adopté le concept de l’âme de la mythologie précédente. Presque tous les philosophes anciens ont essayé d'exprimer à l'aide du concept d'âme le principe essentiel le plus important de la nature vivante, le considérant comme la cause de la vie et de la connaissance.
Pour la première fois, l'homme, son monde spirituel intérieur, devient le centre de la réflexion philosophique chez Socrate (469-399 av. J.-C.). Contrairement à ses prédécesseurs, qui s'occupaient principalement des problèmes de la nature, Socrate s'est concentré sur monde intérieur une personne, ses croyances et ses valeurs, ainsi que sa capacité à agir comme un être rationnel. Socrate a attribué le rôle principal dans la psyché humaine à l'activité mentale, qui a été étudiée dans le processus de communication dialogique. Après ses recherches, la compréhension de l'âme s'est remplie d'idées telles que « bien », « justice », « beau », etc., que la nature physique ne connaît pas.
Le monde de ces idées est devenu le noyau de la doctrine de l'âme du brillant élève de Socrate - Platon (427-347 av. J.-C.).
Platon a développé la doctrine de âme immortelle, habitant le corps mortel, le quittant après la mort et retournant à l'éternel suprasensible monde d'idées. L'essentiel pour Platon n'est pas dans la doctrine de l'immortalité et de la transmigration de l'âme, mais dans l'étude du contenu de ses activités(dans la terminologie moderne dans l'étude de l'activité mentale). Il a montré que activités internes douche et donne des connaissances sur réalité de l'existence suprasensible, le monde éternel des idées. Comment donc l'âme, qui est dans une chair mortelle, participe-t-elle à la paix éternelle des idées ? Toute connaissance, selon Platon, est mémoire. Avec un effort et une préparation appropriés, l’âme peut se souvenir de ce qu’elle a contemplé avant sa naissance terrestre. Il a enseigné que l’homme n’est « pas une plante terrestre, mais une plante céleste ».
Platon a été le premier à identifier une forme d'activité mentale comme la parole intérieure : l'âme réfléchit, s'interroge, répond, affirme et nie. Il fut le premier à tenter de révéler structure interneâmes, l'isolant composition triple: la partie la plus élevée est le principe rationnel, la partie médiane est le principe volitionnel et la partie inférieure de l'âme est le principe sensuel. La partie rationnelle de l'âme est appelée à harmoniser les motivations et impulsions inférieures et supérieures provenant de Différents composantsâmes. Des problèmes tels que le conflit des motivations ont été introduits dans le domaine de l'étude de l'âme et le rôle de la raison dans sa résolution a été examiné.
Disciple - (384-322 avant JC), en discutant avec son professeur, a ramené l'âme du suprasensible au monde sensoriel. Il a avancé le concept de l'âme comme fonctions d'un organisme vivant,, et non une entité indépendante. L'âme, selon Aristote, est une forme, une manière d'organiser un corps vivant : « L'âme est l'essence de l'être et la forme non pas d'un corps comme une hache, mais d'un corps naturel qui en lui-même a le début de mouvement et repos.
Aristote isolé dans le corps différents niveaux capacités d'activité. Ces niveaux de capacités constituent une hiérarchie de niveaux de développement de l'âme.
Aristote distingue trois types d'âmes : végétal, animal Et raisonnable. Deux d'entre eux appartiennent à psychologie physique, puisqu'ils ne peuvent exister sans matière, la troisième est métaphysique, c'est-à-dire l'esprit existe séparément et indépendamment du corps physique en tant qu'esprit divin.
Aristote fut le premier à introduire dans la psychologie l'idée de développement depuis les niveaux inférieurs de l'âme jusqu'à ses formes les plus élevées. De plus, chaque personne, en train de se transformer de bébé en être adulte, passe par les étapes de la plante à l'animal, et de là à l'âme rationnelle. Selon Aristote, l'âme, ou « psyché », est moteur permettre au corps de se réaliser. Le centre psychique est situé dans le cœur, où sont reçues les impressions transmises par les sens.
Lorsqu'il caractérise une personne, Aristote accorde la première place connaissance, pensée et sagesse. Cette attitude envers l'homme, inhérente non seulement à Aristote, mais aussi à l'Antiquité dans son ensemble, a été largement révisée dans le cadre de la psychologie médiévale.
La psychologie au Moyen Âge
Lorsqu'on étudie l'évolution des connaissances psychologiques au Moyen Âge, un certain nombre de circonstances doivent être prises en compte.
Psychologie comment région indépendante il n'y a eu aucune recherche au Moyen Âge. Les connaissances psychologiques étaient incluses dans l'anthropologie religieuse (l'étude de l'homme).
La connaissance psychologique du Moyen Âge reposait sur l'anthropologie religieuse, particulièrement développée par le christianisme, notamment par des « pères de l'Église » tels que Jean Chrysostome (347-407), Augustin Aurèle (354-430), Thomas d'Aquin (1225-1274). ), etc.
L'anthropologie chrétienne vient de image théocentrique monde et le principe de base du dogme chrétien - le principe du créationnisme, c'est-à-dire création du monde par l'esprit divin.
Il est très difficile pour la pensée scientifique moderne de comprendre les enseignements des Saints Pères, qui sont principalement symbolique personnage.
L'homme dans les enseignements des Saints Pères apparaît comme centralétant dans l'univers, le plus haut niveau dans l’échelle hiérarchique de la technologie, ceux. créé par Dieu paix.
L'Homme est le centre de l'Univers. Cette idée était également connue de la philosophie ancienne, qui considérait l’homme comme un « microcosme », un petit monde englobant l’univers entier.
L'anthropologie chrétienne n'a pas abandonné l'idée du « microcosme », mais les Saints Pères en ont considérablement modifié le sens et le contenu.
Les « Pères de l’Église » croyaient que la nature humaine est liée à toutes les principales sphères de l’existence. Avec son corps, l’homme est relié à la terre : « Et le Seigneur Dieu forma l’homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l’homme devint une âme vivante », dit la Bible. À travers les sentiments, une personne est connectée au monde matériel, à son âme - au monde spirituel, dont la partie rationnelle est capable de monter vers le Créateur lui-même.
L'homme, enseignent les saints pères, est de nature double : l'une de ses composantes est externe, corporelle, et l'autre est interne, spirituelle. L'âme d'une personne, nourrissant le corps avec lequel elle a été créée, se situe partout dans le corps et n'est pas concentrée en un seul endroit. Les Saints Pères introduisent une distinction entre l'homme « interne » et « externe » : « Dieu créé l'homme intérieur et aveugle externe; La chair a été façonnée, mais l’âme a été créée. »* Parlant langue moderne, homme extérieur est un phénomène naturel, et l'homme intérieur est un phénomène surnaturel, quelque chose de mystérieux, d'inconnaissable, de divin.
Contrairement à la manière intuitive-symbolique et spirituelle-expérientielle de comprendre l'homme dans le christianisme oriental, le christianisme occidental a suivi le chemin rationnel compréhension de Dieu, du monde et de l'homme, ayant développé un type de pensée aussi spécifique que scolastique(Bien sûr, avec la scolastique, des enseignements mystiques irrationnels existaient également dans le christianisme occidental, mais ils n'ont pas déterminé le climat spirituel de l'époque). L’appel à la rationalité a finalement conduit à la transition de la civilisation occidentale des temps modernes d’une vision théocentrique du monde à une vision anthropocentrique.
Pensée psychologique de la Renaissance et des Temps modernes
Mouvement humaniste né en Italie au XVe siècle. et répandue en Europe au XVIe siècle, elle fut appelée « Renaissance ». Faisant revivre l'ancienne culture humaniste, cette époque a contribué à la libération de toutes les sciences et de tous les arts des dogmes et des restrictions qui leur étaient imposées par les idées religieuses médiévales. En conséquence, les sciences naturelles, biologiques et médicales ont commencé à se développer très activement et à faire un pas en avant significatif. Un mouvement a commencé dans le sens de faire de la connaissance psychologique une science indépendante.
Énorme influence sur la pensée psychologique des XVIIe-XVIIIe siècles. assuré par la mécanique, devenue le leader des sciences naturelles. Image mécanique de la nature a déterminé une nouvelle ère dans le développement de la psychologie européenne.
Le début de l'approche mécanique pour expliquer les phénomènes mentaux et les réduire à la physiologie a été posé par le philosophe, mathématicien et naturaliste français R. Descartes (1596-1650), qui fut le premier à développer un modèle du corps comme un automate ou système qui fonctionne comme des mécanismes artificiels conformément aux lois de la mécanique. Ainsi, un organisme vivant, qui était auparavant considéré comme animé, c'est-à-dire doué et contrôlé par l'âme, il était libéré de son influence et de ses interférences déterminantes.
R. Descartes a introduit le concept réflexe, qui devint plus tard fondamental pour la physiologie et la psychologie. Conformément au schéma réflexe cartésien, une impulsion externe était transmise au cerveau, d'où se produisait une réponse qui mettait les muscles en mouvement. On leur a donné une explication du comportement comme un phénomène purement réflexif, sans référence à l'âme comme force motrice du corps. Descartes espérait qu'avec le temps, non seulement les mouvements simples - comme la réaction protectrice de la pupille à la lumière ou de la main au feu - mais aussi les actes comportementaux les plus complexes pourraient être expliqués par la mécanique physiologique qu'il avait découverte.
Avant Descartes, on a cru pendant des siècles que toute activité de perception et de traitement du matériel mental était réalisée par l'âme. Il a également prouvé que la structure corporelle est capable de faire face avec succès à cette tâche, même sans elle. Quelles sont les fonctions de l'âme ?
R. Descartes considérait l'âme comme une substance, c'est-à-dire une entité qui ne dépend de rien d’autre. L'âme a été définie par lui selon un seul signe : la conscience directe de ses phénomènes. Son but était la connaissance du sujet de ses propres actes et états, invisible pour quiconque. Ainsi, il y a eu un tournant dans le concept d'« âme », qui est devenu la base de la prochaine étape de l'histoire de la construction du sujet de la psychologie. Désormais ce sujet devient conscience.
Descartes, basé sur une approche mécaniste, a posé une question théorique sur l'interaction de « l'âme et du corps », qui est devenue plus tard un sujet de discussion pour de nombreux scientifiques.
Une autre tentative de construire une doctrine psychologique de l'homme en tant qu'être intégral a été faite par l'un des premiers opposants à R. Descartes - le penseur néerlandais B. Spinoza (1632-1677), qui considérait toute la variété des sentiments (affects) humains comme forces motrices du comportement humain. Il a étayé le principe scientifique général du déterminisme, qui est important pour comprendre les phénomènes mentaux : causalité universelle et explicabilité scientifique naturelle de tout phénomène. Il est entré dans la science sous la forme de la déclaration suivante : « L’ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l’ordre et la connexion des choses. »
Néanmoins, le contemporain de Spinoza, le philosophe et mathématicien allemand G.V. Leibniz (1646-1716) considérait la relation entre les phénomènes spirituels et physiques en se basant sur parallélisme psychophysiologique, c'est à dire. leur coexistence indépendante et parallèle. Il considérait la dépendance des phénomènes mentaux à l'égard des phénomènes physiques comme une illusion. L'âme et le corps agissent indépendamment, mais il existe entre eux une harmonie préétablie basée sur l'esprit divin. La doctrine du parallélisme psychophysiologique a trouvé de nombreux partisans au cours des années de formation de la psychologie en tant que science, mais elle appartient actuellement à l'histoire.
Une autre idée de G.V. Leibniz que chacune des innombrables monades (du grec. mono- unifié), qui constitue le monde, est « psychique » et doté de la capacité de percevoir tout ce qui se passe dans l'Univers, a trouvé une confirmation empirique inattendue dans certains notions modernes conscience.
Il convient également de noter que G.V. Leibniz a introduit le concept "inconscient" dans la pensée psychologique des temps modernes, désignant les perceptions inconscientes comme des « petites perceptions ». La conscience des perceptions devient possible du fait qu'un acte mental spécial est ajouté à la simple perception (perception) - l'aperception, qui inclut la mémoire et l'attention. Les idées de Leibniz ont considérablement changé et élargi l'idée de la psyché. Ses concepts de psychisme inconscient, de petites perceptions et d'aperception sont devenus solidement ancrés dans les connaissances scientifiques en psychologie.
Une autre direction dans le développement de la psychologie européenne moderne est associée au penseur anglais T. Hobbes (1588-1679), qui a complètement rejeté l'âme en tant qu'entité particulière et croyait qu'il n'y avait rien au monde à l'exception des corps matériels se déplaçant selon les lois. de la mécanique. Il a soumis les phénomènes mentaux à l'influence de lois mécaniques. T. Hobbes croyait que les sensations sont le résultat direct de l'influence des objets matériels sur le corps. Selon la loi de l'inertie, découverte par G. Galilée, les idées naissent des sensations sous la forme de leur trace affaiblie. Ils forment une séquence de pensées dans le même ordre dans lequel les sensations changent. Cette connexion fut appelée plus tard les associations. T. Hobbes a proclamé que la raison est un produit d'association, qui trouve sa source dans l'influence directe du monde matériel sur les sens.
Avant Hobbes, le rationalisme régnait dans les enseignements psychologiques (de lat. national- raisonnable). À partir de lui, l'expérience a été prise comme base de la connaissance. T. Hobbes opposait le rationalisme à l'empirisme (du grec. empire- expérience) dont il est issu psychologie empirique.
Dans le développement de cette direction, un rôle important a appartenu au compatriote de T. Hobbes, J. Locke (1632-1704), qui a identifié deux sources dans l'expérience elle-même : sentiment Et réflexion, par lequel j'entendais la perception interne de l'activité de notre esprit. Concept reflets solidement ancré en psychologie. Le nom de Locke est également associé à une méthode de connaissance psychologique telle que introspection, c'est à dire. introspection interne des idées, des images, des perceptions, des sentiments tels qu'ils apparaissent au « regard intérieur » du sujet qui l'observe.
À partir de J. Locke, les phénomènes deviennent le sujet de la psychologie conscience, qui donnent lieu à deux expériences - externeémanant des sens, et intérieur, accumulé par le propre esprit de l'individu. Sous le signe de cette image de la conscience a pris forme concepts psychologiques décennies suivantes.
Les origines de la psychologie en tant que science
Au début du 19ème siècle. de nouvelles approches de la psyché ont commencé à être développées, basées non pas sur la mécanique, mais sur physiologie, qui a transformé l'organisme en objet étude expérimentale. La physiologie a traduit les vues spéculatives de l'époque précédente dans le langage de l'expérience et a étudié la dépendance des fonctions mentales à l'égard de la structure des organes des sens et du cerveau.
Découvrir les différences entre les voies nerveuses sensorielles (sensorielles) et motrices (motrices) menant à moelle épinière, a permis d'expliquer le mécanisme de la connexion nerveuse comme "arc réflexe" l'excitation d'une épaule active naturellement et de manière irréversible l'autre épaule, générant une réaction musculaire. Cette découverte a prouvé la dépendance des fonctions de l’organisme en ce qui concerne son comportement dans l’environnement extérieur à l’égard du substrat corporel, perçu comme réfutation de la doctrine de l'âme en tant qu'entité incorporelle spéciale.
Étudiant l'effet des stimuli sur les terminaisons nerveuses des organes sensoriels, le physiologiste allemand G.E. Müller (1850-1934) a formulé la position selon laquelle aucune énergie autre que celle connue de la physique Tissu nerveux ne possède pas. Cette disposition a été élevée au rang de loi, à la suite de laquelle les processus mentaux se sont déplacés au même rang que le tissu nerveux qui les donne naissance, visible au microscope et disséqué au scalpel. Cependant, l'essentiel restait flou : comment le miracle de la génération de phénomènes psychiques s'était accompli.
Le physiologiste allemand E.G. Weber (1795-1878) a déterminé la relation entre le continuum de sensations et le continuum de stimuli physiques qui les provoquent. Au cours des expériences, il a été découvert qu'il existe une relation très définie (différente selon les organes des sens) entre le stimulus initial et le suivant, au cours de laquelle le sujet commence à remarquer que la sensation est devenue différente.
Les bases de la psychophysique en tant que discipline scientifique ont été posées par le scientifique allemand G. Fechner (1801 - 1887). La psychophysique, sans aborder la question des causes des phénomènes mentaux et de leur substrat matériel, a identifié des dépendances empiriques basées sur l'introduction de méthodes d'expérimentation et de recherche quantitative.
Les travaux des physiologistes sur l'étude des organes sensoriels et des mouvements ont été préparés par nouvelle psychologie, différente de la psychologie traditionnelle, qui est étroitement liée à la philosophie. Le terrain a été créé pour la séparation de la psychologie de la physiologie et de la philosophie en tant que discipline scientifique distincte.
Fin du 19ème siècle. Presque simultanément, plusieurs programmes visant à faire de la psychologie une discipline indépendante ont émergé.
Le plus grand succès revient à W. Wundt (1832-1920), un scientifique allemand venu de la physiologie à la psychologie et qui fut le premier à commencer à rassembler et à combiner dans une nouvelle discipline ce qui avait été créé par divers chercheurs. Appelant cette discipline psychologie physiologique, Wundt a commencé à étudier des problèmes empruntés aux physiologistes - l'étude des sensations, des temps de réaction, des associations, de la psychophysique.
Après avoir organisé le premier institut psychologique à Leipzig en 1875, V. Wundt décide d'étudier le contenu et la structure de la conscience sur une base scientifique en isolant les structures les plus simples de l'expérience interne, jetant ainsi les bases structuraliste approche de la conscience. La conscience était divisée en éléments psychiques(sensations, images), qui devient objet d'étude.
« L’expérience directe » était reconnue comme un sujet unique de la psychologie, étudié par aucune autre discipline. La méthode principale est introspection, dont l’essence était l’observation par le sujet des processus dans sa conscience.
La méthode d'introspection expérimentale présente des inconvénients importants, qui ont très vite conduit à l'abandon du programme d'étude de la conscience proposé par W. Wundt. L'inconvénient de la méthode d'introspection pour construire la psychologie scientifique est sa subjectivité : chaque sujet décrit ses expériences et sensations qui ne coïncident pas avec les sentiments d'un autre sujet. L’essentiel est que la conscience n’est pas composée d’éléments figés, mais qu’elle est en train de se développer et de changer constamment.
Vers la fin du 19ème siècle. L'enthousiasme que le programme de Wundt suscitait autrefois s'est tari et la compréhension du sujet de la psychologie qui y est inhérent a perdu à jamais sa crédibilité. De nombreux étudiants de Wundt ont rompu avec lui et ont emprunté une voie différente. Actuellement, la contribution de W. Wundt se manifeste dans le fait qu’il a montré quelle voie la psychologie ne devrait pas emprunter, car savoir scientifique se développe non seulement en confirmant des hypothèses et des faits, mais aussi en les réfutant.
Conscient de l'échec des premières tentatives de construction d'une psychologie scientifique, le philosophe allemand V. Dilypey (1833-1911) avance l'idée de « deux hésychologies » : expérimentale, liée dans sa méthode aux sciences naturelles, et une autre psychologie , qui, au lieu de l'étude expérimentale de la psyché, traite de l'interprétation de la manifestation de l'esprit humain. Il a séparé l'étude des liens entre les phénomènes mentaux et la vie physique de l'organisme de leurs liens avec l'histoire. valeurs culturelles. Il a appelé la première psychologie explicatif, deuxième - compréhension.
La psychologie occidentale au XXe siècle
Dans la psychologie occidentale du XXe siècle. Il est d'usage de distinguer trois écoles principales, ou, selon la terminologie du psychologue américain L. Maslow (1908-1970), trois forces : behaviorisme, psychanalyse Et psychologie humaniste. Au cours des dernières décennies, la quatrième direction de la psychologie occidentale s'est développée de manière très intensive : transpersonnel psychologie.
Historiquement, le premier était behaviorisme, qui tire son nom de sa compréhension proclamée du sujet de la psychologie - le comportement (de l'anglais. comportement - comportement).
Le fondateur du behaviorisme dans la psychologie occidentale est considéré comme le psychologue animalier américain J. Watson (1878-1958), puisque c'est lui qui, dans l'article « La psychologie telle que le voit le comportementaliste », publié en 1913, a appelé à la création d'une nouvelle psychologie, affirmant qu'après un demi-siècle d'existence en tant que discipline expérimentale, la psychologie n'a pas réussi à prendre la place qui lui revient parmi les sciences naturelles. Watson en voyait la raison dans une fausse compréhension du sujet et des méthodes de recherche psychologique. Le sujet de la psychologie, selon J. Watson, ne devrait pas être la conscience, mais le comportement.
La méthode subjective d’auto-observation interne devrait donc être remplacée méthodes objectives observation externe du comportement.
Dix ans après l’article fondateur de Watson, le behaviorisme commençait à dominer presque toute la psychologie américaine. Le fait est que l’orientation pragmatique de la recherche sur l’activité mentale aux États-Unis a été déterminée par les exigences de l’économie, puis par les moyens de communication de masse.
Le behaviorisme comprenait les enseignements d'I.P. Pavlov (1849-1936) sur le réflexe conditionné et commence à considérer le comportement humain du point de vue des réflexes conditionnés formés sous l'influence de l'environnement social.
Le schéma original de J. Watson, expliquant les actes comportementaux comme une réaction à des stimuli présentés, a été encore amélioré par E. Tolman (1886-1959) en introduisant un lien intermédiaire entre un stimulus venant de l'environnement et la réaction de l'individu sous la forme des objectifs de l'individu. , ses attentes, hypothèses et carte cognitive de la paix, etc. L'introduction d'un lien intermédiaire a quelque peu compliqué le schéma, mais n'en a pas modifié l'essence. L'approche générale du behaviorisme à l'égard de l'homme en tant que animal,se distingue par son comportement verbal, resté inchangé.
Dans l’ouvrage du behavioriste américain B. Skinner (1904-1990) « Beyond Freedom and Dignity », les concepts de liberté, de dignité, de responsabilité et de moralité sont considérés du point de vue du behaviorisme comme des dérivés du « système d’incitations ». des « programmes de renforcement » et sont considérés comme une « ombre inutile dans la vie humaine ».
L'impact le plus fort sur Culture occidentale fourni la psychanalyse, développée par Z. Freud (1856-1939). La psychanalyse a introduit dans la culture d'Europe occidentale et américaine les concepts généraux de « psychologie de l'inconscient », des idées sur les aspects irrationnels de l'activité humaine, les conflits et la fragmentation du monde intérieur de l'individu, le « caractère répressif » de la culture et de la société, etc. et ainsi de suite. Contrairement aux comportementalistes, les psychanalystes ont commencé à étudier la conscience, à construire des hypothèses sur le monde intérieur de l'individu et à introduire de nouveaux termes qui prétendent être scientifiques, mais ne peuvent être vérifiés empiriquement.
Dans la littérature psychologique, y compris la littérature pédagogique, le mérite de 3. Freud se voit dans son appel aux structures profondes du psychisme, à l'inconscient. La psychologie pré-freudienne prenait comme objet d’étude une personne normale, physiquement et mentalement saine, et accordait une attention particulière au phénomène de conscience. Freud, ayant commencé à explorer en tant que psychiatre le monde mental intérieur des individus névrosés, a développé une approche très simplifié un modèle de la psyché composé de trois parties - consciente, inconsciente et superconsciente. Dans ce modèle 3. Freud n'a pas découvert l'inconscient, puisque le phénomène de l'inconscient est connu depuis l'Antiquité, mais a troqué la conscience et l'inconscient : l'inconscient est une composante centrale du psychisme, sur lequel la conscience est construite. Il a interprété l'inconscient lui-même comme une sphère d'instincts et de pulsions, dont la principale est l'instinct sexuel.
Le modèle théorique du psychisme, développé en relation avec le psychisme des individus malades présentant des réactions névrotiques, a reçu le statut de modèle théorique général qui explique le fonctionnement du psychisme en général.
Malgré la différence évidente et, semble-t-il, même l'opposition des approches, le behaviorisme et la psychanalyse se ressemblent - ces deux directions ont construit des idées psychologiques sans recourir aux réalités spirituelles. Ce n'est pas pour rien que les représentants de la psychologie humaniste sont arrivés à la conclusion que les deux écoles principales - le behaviorisme et la psychanalyse - ne voyaient pas le spécifiquement humain chez l'homme, ignoraient les vrais problèmes de la vie humaine - les problèmes de bonté, d'amour, de justice, etc. comme le rôle de la moralité, de la philosophie, de la religion et n'étaient rien d'autre que « la calomnie d'une personne ». Tous ces problèmes réels sont considérés comme découlant d’instincts fondamentaux ou relations sociales et communications.
"La psychologie occidentale du XXe siècle", comme l'écrit S. Grof, "a créé une image très négative de l'homme - une sorte de machine biologique avec des impulsions instinctives de nature animale".
Psychologie humaniste représenté par L. Maslow (1908-1970), K. Rogers (1902-1987). V. Frankl (né en 1905) et d'autres se sont donné pour tâche d'introduire de vrais problèmes dans le domaine de la recherche psychologique. Les représentants de la psychologie humaniste sont considérés comme sains personnalité créative. L’orientation humaniste s’exprimait dans le fait que l’amour, la croissance créatrice, les valeurs supérieures et le sens étaient considérés comme des besoins humains fondamentaux.
L’approche humaniste s’éloigne plus que toute autre de la psychologie scientifique, attribuant le rôle principal à l’expérience personnelle d’une personne. Selon les humanistes, l’individu est capable d’estime de soi et peut trouver de manière autonome le chemin de l’épanouissement de sa personnalité.
Parallèlement à la tendance humaniste de la psychologie, le mécontentement à l'égard des tentatives visant à construire la psychologie sur la base idéologique du matérialisme scientifique naturel s'exprime par psychologie transpersonnelle, qui proclame la nécessité d'une transition vers un nouveau paradigme de pensée.
Le premier représentant de l'orientation transpersonnelle en psychologie est considéré comme le psychologue suisse K.G. Jung (1875-1961), bien que Jung lui-même qualifie sa psychologie non pas de transpersonnelle, mais d'analytique. Attribution de K.G. Jung des précurseurs de la psychologie transpersonnelle part du principe qu'il considérait qu'il était possible pour une personne de surmonter les frontières étroites de son « je » et de son inconscient personnel, et de se connecter avec le « je » supérieur, l'esprit supérieur, en proportion avec toute l'humanité et le cosmos.
Jung partagea les vues de Z. Freud jusqu'en 1913, date à laquelle il publia un article programmatique dans lequel il montrait que Freud avait complètement à tort réduit l'ensemble activité humaineà l’instinct sexuel biologiquement hérité, alors que les instincts humains ne sont pas biologiques, mais entièrement symboliques par nature. KG. Jung n'a pas ignoré l'inconscient, mais, en accordant une grande attention à sa dynamique, a donné une nouvelle interprétation, dont l'essence est que l'inconscient n'est pas un dépotoir psychobiologique de tendances instinctives rejetées, de souvenirs refoulés et d'interdictions subconscientes, mais un dépotoir créatif et raisonnable. principe qui relie une personne à toute l’humanité, à la nature et à l’espace. À côté de l'inconscient individuel, il existe également un inconscient collectif qui, de nature superpersonnelle et transpersonnelle, constitue la base universelle de la vie mentale de chaque personne. C'est cette idée de Jung qui a été développée en psychologie transpersonnelle.
Psychologue américain, fondateur de la psychologie transpersonnelle S. Grof affirme qu'une vision du monde fondée sur le matérialisme scientifique naturel, qui est depuis longtemps dépassée et est devenue un anachronisme pour la physique théorique du XXe siècle, continue d'être considérée comme scientifique en psychologie, au détriment de son développement futur. La psychologie « scientifique » ne peut pas expliquer la pratique spirituelle de guérison, de clairvoyance, la présence de capacités paranormales chez les individus et dans l'ensemble. groupes sociaux, contrôle conscient des états internes, etc.
Selon S. Grof, une approche athée, mécaniste et matérialiste du monde et de l’existence reflète une profonde aliénation du cœur de l’existence, un manque de véritable compréhension de soi et une suppression psychologique des sphères transpersonnelles de sa propre psyché. Cela signifie, selon les partisans de la psychologie transpersonnelle, qu'une personne s'identifie à un seul aspect partiel de sa nature - avec le « je » corporel et la conscience hylotropique (c'est-à-dire associée à la structure matérielle du cerveau).
Une telle attitude tronquée envers soi-même et sa propre existence est finalement lourde d'un sentiment de futilité de la vie, d'aliénation du processus cosmique, ainsi que de besoins insatiables, de compétitivité, de vanité, qu'aucune réalisation ne peut satisfaire. À l’échelle collective, une telle condition humaine conduit à une aliénation de la nature, à une orientation vers une « croissance sans limites » et à une fixation sur les paramètres objectifs et quantitatifs de l’existence. Comme le montre l’expérience, cette façon d’être au monde est extrêmement destructrice tant sur le plan personnel que collectif.
La psychologie transpersonnelle considère l'homme comme un être cosmique et spirituel, inextricablement lié à l'ensemble de l'humanité et de l'Univers, doté de la capacité d'accéder au champ d'information mondial.
Au cours de la dernière décennie, de nombreux travaux sur la psychologie transpersonnelle ont été publiés, dans des manuels et dans des manuels cette direction est présentée comme la dernière réalisation dans le domaine du développement de la pensée psychologique sans aucune analyse des conséquences des méthodes utilisées dans l'étude du psychisme. Les méthodes de la psychologie transpersonnelle, qui prétend comprendre la dimension cosmique de l’homme, ne sont cependant pas associées aux concepts de moralité. Ces méthodes visent la formation et la transformation d'états humains particuliers et modifiés grâce à l'utilisation dosée de médicaments, de divers types d'hypnose, d'hyperventilation, etc.
Il ne fait aucun doute que la recherche et la pratique de la psychologie transpersonnelle ont découvert le lien entre l'homme et le cosmos, l'émergence de la conscience humaine au-delà des barrières ordinaires, surmontant les limitations de l'espace et du temps au cours des expériences transpersonnelles, et prouvé l'existence même de la sphère spirituelle. , et beaucoup plus.
Mais en général, cette façon d’étudier le psychisme humain semble très désastreuse et dangereuse. Les méthodes de psychologie transpersonnelle visent à briser les défenses naturelles et à pénétrer dans l’espace spirituel de l’individu. Les expériences transpersonnelles se produisent lorsqu'une personne est intoxiquée par une drogue, l'hypnose ou une respiration accrue et ne conduisent pas à une purification spirituelle ni à une croissance spirituelle.
Formation et développement de la psychologie domestique
Le pionnier de la psychologie en tant que science, dont le sujet n'est pas l'âme ni même la conscience, mais le comportement mentalement régulé, peut à juste titre être considéré comme I.M. Sechenov (1829-1905), et non l'Américain J. Watson, puisque le premier, en 1863, dans son traité « Réflexes du cerveau » est arrivé à la conclusion que autorégulation du comportement le corps à travers les signaux fait l'objet de recherches psychologiques. Plus tard, I.M. Sechenov a commencé à définir la psychologie comme la science de l'origine de l'activité mentale, qui comprenait la perception, la mémoire et la pensée. Il croyait que activité mentale se construit selon le type de réflexe et comprend, suite à la perception de l'environnement et à son traitement dans le cerveau, la réponse de l'appareil moteur. Dans les travaux de Sechenov, pour la première fois dans l'histoire de la psychologie, le sujet de cette science a commencé à couvrir non seulement les phénomènes et processus de la conscience et de la psyché inconsciente, mais aussi l'ensemble du cycle d'interaction de l'organisme avec le monde. , y compris ses actions corporelles externes. Par conséquent, pour la psychologie, selon I.M. Sechenov, la seule méthode fiable est la méthode objective et non subjective (introspective).
Les idées de Setchenov ont influencé la science mondiale, mais elles ont été principalement développées en Russie dans les enseignements I.P. Pavlova(1849-1936) et V.M. Bekhterev(1857-1927), dont les travaux consacrent la priorité à l'approche réflexologique.
Pendant la période soviétique de l'histoire russe au cours des 15 à 20 premières années Pouvoir soviétique Un phénomène inexplicable, à première vue, a été découvert - un essor sans précédent dans un certain nombre de domaines scientifiques - physique, mathématiques, biologie, linguistique, y compris la psychologie. Par exemple, rien qu’en 1929, environ 600 titres de livres sur la psychologie ont été publiés dans le pays. De nouvelles orientations se dessinent : dans le domaine de la psychopédagogie - pédologie, dans le domaine de la psychologie du travail - psychotechnique, de brillants travaux ont été menés en défectologie, psychologie médico-légale, zoopsychologie.
Dans les années 30 la psychologie a reçu des coups écrasants par les résolutions du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union et par presque tous les concepts et concepts psychologiques de base. recherche psychologique en dehors du cadre des orientations marxistes étaient interdites. Historiquement, la psychologie elle-même a contribué attitude similaireà la recherche dans le domaine de la psychologie. Les psychologues - d'abord dans les études théoriques et dans les murs des laboratoires - semblaient relégués au second plan, puis niaient complètement le droit de l'homme à une âme immortelle et à une vie spirituelle. Puis les théoriciens ont été remplacés par des praticiens et ont commencé à traiter les gens comme des objets sans âme. Cette arrivée n’a pas été fortuite, mais préparée par un développement antérieur, dans lequel la psychologie a également joué un rôle.
Fin des années 50 – début des années 60. une situation s'est produite lorsque la psychologie s'est vu attribuer le rôle d'une section de physiologie supérieure activité nerveuse et un complexe de connaissances psychologiques dans la philosophie marxiste-léniniste. La psychologie était comprise comme une science qui étudie le psychisme, les modèles de son apparition et de son développement. La compréhension de la psyché reposait sur la théorie de la réflexion de Lénine. Le psychisme a été défini comme la propriété d’une matière hautement organisée – le cerveau – de refléter la réalité sous forme d’images mentales. La réflexion mentale était considérée comme une forme idéale d’existence matérielle. La seule base idéologique possible pour la psychologie était le matérialisme dialectique. La réalité du spirituel en tant qu'entité indépendante n'était pas reconnue.
Même dans ces conditions, des psychologues soviétiques comme S.L. Rubinstein (1889-1960), L.S. Vygotski (1896-1934), L.N. Léontiev (1903-1979), DN. Ouznadze (1886-1950), A.R. Luria (1902-1977) a apporté une contribution significative à la psychologie mondiale.
Dans l’ère post-soviétique, de nouvelles opportunités se sont ouvertes à la psychologie russe et de nouveaux problèmes sont apparus. Développement psychologie domestique V conditions modernes ne correspondait plus aux dogmes rigides de la philosophie dialectico-matérialiste, qui offre bien entendu la liberté de recherche créatrice.
Actuellement, il existe plusieurs orientations en psychologie russe.
Psychologie d'orientation marxiste. Bien que cette orientation ait cessé d'être dominante, unique et obligatoire, elle a formé pendant de nombreuses années les paradigmes de pensée qui déterminent la recherche psychologique.
Psychologie orientée vers l'Occident représente l'assimilation, l'adaptation, l'imitation des tendances occidentales en psychologie, qui ont été rejetées par le régime précédent. Habituellement, les idées productives ne naissent pas par le biais de l’imitation. De plus, les principaux courants de la psychologie occidentale reflètent le psychisme d'un Européen occidental, et non d'un Russe, d'un Chinois, d'un Indien, etc. Puisqu’il n’existe pas de psyché universelle, les schémas et modèles théoriques de la psychologie occidentale n’ont pas d’universalité.
Psychologie spirituelle, visant à restaurer la « verticale de l'âme humaine », est représenté par les noms des psychologues B.S. Bratusya, B. Nichiporova, F.E. Vasilyuk, V.I. Slobodchikova, vice-président. Zinchenko et V.D. Shadrikova. La psychologie spirituellement orientée est basée sur les valeurs spirituelles traditionnelles et la reconnaissance de la réalité de l'existence spirituelle.