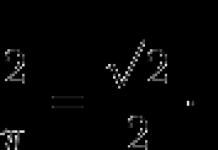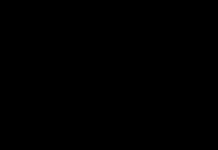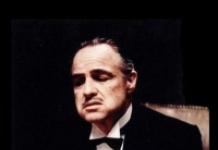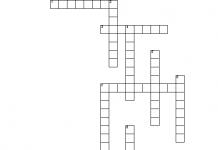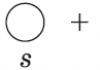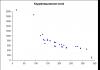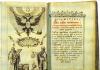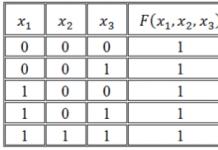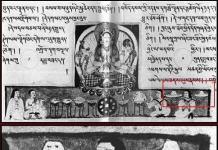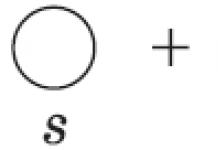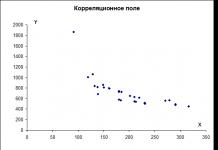L'analyse socio-psychologique du rôle social est d'une grande importance pour comprendre le comportement social de l'individu. Ce problème a donc attiré l'attention de nombreux chercheurs, non seulement interactionnistes, mais aussi représentants d'autres orientations, par exemple néo-comportementalistes (Thibault et Kelly), cognitivistes (Newcome), etc. En psychologie sociale américaine, il y avait déjà plusieurs centaines de recherches principalement empiriques, mais aussi théoriques dans ce domaine. Cette popularité des études de jeux de rôle s’explique par certains auteurs pour deux raisons. Premièrement, le problème du rôle présente de grandes opportunités pour la recherche théorique et, surtout, empirique. Deuxièmement, la théorie des rôles contient une approche de l’étude du comportement social d’un individu qui est absente des autres orientations théoriques de la psychologie sociale. Les plus célèbres dans ce domaine sont les travaux de psychologues sociaux et de sociologues impliqués dans les questions socio-psychologiques tels que T. Sarbin, I. Goffman, R. Linton, R. Merton, R. Rommetveit, N. Gross et d'autres.
Actuellement, comme le note à juste titre J. Hayes, il existe en sciences sociales deux types de théories des rôles, qu'il appelle structuralistes et interactionnistes. La théorie structuraliste des rôles est fermement ancrée dans des positions sociologiques. Les fondements théoriques de la théorie sociologique des rôles ont été posés par de nombreux auteurs - M. Weber, G. Simmel, T. Parsons et autres.Tous ont développé les problèmes du lien entre les individus et la société et l'influence de la société sur l'individu. La plupart de ces auteurs ont considéré les aspects objectifs des théories des rôles et n'ont pratiquement pas abordé ses aspects subjectifs. Seul Weber a noté un jour que la sociologie doit prendre en compte la motivation subjective de l'acteur pour expliquer son comportement [voir : Stryker, Stathem, 1985].
Les théories interactionnistes modernes des rôles s'appuient sur les concepts socio-psychologiques de J. Mead, associés au concept de « rôle », qu'il a introduit dans la psychologie sociale. Mead n'a pas défini le concept de rôle lors de la présentation de ses concepts, l'utilisant comme étant très amorphe et vague. En fait, le concept est emprunté au domaine du théâtre ou de la vie quotidienne, où il était utilisé comme métaphore pour désigner un certain nombre de phénomènes de comportement social, tels que l'apparition d'un comportement similaire chez diverses personnes se trouvant dans des circonstances similaires. Mead a utilisé ce terme lorsqu'il a développé l'idée de « prendre le rôle d'un autre » pour expliquer l'acte d'interaction entre les individus dans le processus de communication verbale.
Selon J. Mead, « accepter le rôle d'un autre », c'est-à-dire la capacité de se regarder de l'extérieur à travers les yeux d'un interlocuteur est une condition nécessaire à la mise en œuvre réussie de tout acte d'interaction entre les personnes. Comme exemple d'« acceptation du rôle d'un autre », Mead n'a utilisé que les jeux de rôle pour enfants, qu'il considérait comme l'un des moyens les plus importants de socialisation personnelle. Cela limite en fait son raisonnement sur le rôle social de l’individu. Plus tard, les concepts de « rôle » et de « rôle social » ont commencé à être largement utilisés et développés dans la sociologie et la psychologie sociale occidentales. L'anthropologue social R. Linton a apporté une contribution significative au développement de la théorie des rôles. Il a proposé ce que l'on appelle le concept de statut et de rôle. Selon Linton, des termes tels que « statut » et « rôle » sont très pratiques pour déterminer le lien d'un individu avec divers systèmes de société. Le statut, selon Linton, est la place qu’occupe un individu dans un système donné. Et il utilise le concept de rôle pour décrire l’ensemble des modèles culturels de comportement associés à un certain statut. Selon Linton, un rôle comprend ainsi les attitudes, les valeurs et les comportements prescrits par la société à chacune de toutes les personnes ayant un certain statut. Parce qu'un rôle représente un comportement externe, il s'agit d'un aspect dynamique du statut, quelque chose qu'un individu doit faire pour justifier le statut qu'il occupe.
Le concept de « rôle social » est très complexe, puisqu’un rôle est fonction de phénomènes d’ordre différent, de nature objective et subjective. L'approche des auteurs nationaux, reflétée dans un certain nombre d'ouvrages sur cette question [Bueva, 1968 ; Kohn, 1967 ; Shakurov, 1972, etc.], implique de l'entendre comme une fonction sociale, comme une unité inextricable d'un certain type d'activité et d'un mode de comportement correspondant développé dans une société donnée, qui sont en fin de compte déterminés par la place occupée par l'individu dans le système des relations sociales. De plus, si la méthode générale ou la norme de comportement pour l'interprète d'un rôle social particulier est fixée par la société, alors sa performance individuelle spécifique a une certaine coloration personnelle, qui révèle le caractère unique de chaque personne.
Ainsi, lorsqu'on étudie le rôle social, on peut mettre en évidence les aspects sociologiques et socio-psychologiques, qui sont étroitement liés. L'approche sociologique d'un rôle social, en règle générale, est liée à son côté impersonnel, substantiel et normatif, c'est-à-dire au type et au contenu de l'activité, à l'accomplissement prévu d'une certaine fonction sociale, ainsi qu'aux normes de comportement requises par la société pour l'accomplissement de cette fonction sociale. L'aspect socio-psychologique du rôle social est principalement associé à l'étude des facteurs subjectifs du rôle social, c'est-à-dire avec la divulgation de certains mécanismes socio-psychologiques et modèles de perception et d'exécution des rôles sociaux. Il est typique pour les interactionnistes d'attacher une importance particulière à l'aspect socio-psychologique de la théorie des rôles.
La complexité du phénomène du rôle social rend sa définition extrêmement difficile. Divers auteurs de psychologie sociale occidentale abordent ce problème de différentes manières. Ainsi, l'un des principaux spécialistes américains de la théorie des rôles, T. Sarbin, dans son article généralisateur sur cette question, rédigé conjointement avec V. Allen, préfère ne pas définir du tout la notion de « rôle », soulignant que cette métaphore est pratique pour l'analyse socio-psychologique de certains aspects du comportement social, et se réfère uniquement à l'étymologie du mot « rôle », tiré de l'attirail théâtral. D'autres auteurs tentent de trouver leurs propres définitions. Par exemple, la définition déjà mentionnée d'un rôle, proposée par R. Linton, est très célèbre : un rôle est un aspect dynamique du statut. On retrouve également la compréhension du rôle par Linton chez I. Goffman, qui définit un rôle social comme « l’exercice de droits et de responsabilités associés à un statut donné ». Un certain nombre d'auteurs critiquent la définition de Linton la jugeant vague et inexacte, mais eux-mêmes n'en proposent pas.
M. Deutsch et R. Krauss notent qu'en raison des différentes approches pour comprendre le rôle de la psychologie sociale, il est inapproprié d'essayer de rechercher une définition complète, mais il suffit d'indiquer les aspects du comportement social que la plupart des auteurs ont à l'esprit lorsqu'ils parlent du rôle. Se référant aux travaux de J. Thibault et G. Kelly, ainsi que de R. Rommetveit, ils soulignent les aspects suivants :
1. Rôle en tant que système d'attentes existant dans la société concernant le comportement d'un individu occupant une certaine position dans son interaction avec d'autres individus.
2. Rôle en tant que système d'attentes spécifiques envers soi-même d'un individu occupant une certaine position, c'est-à-dire comment il représente le modèle de son propre comportement en interaction avec d'autres individus.
3. Rôle comme comportement ouvert et observable d'un individu occupant un certain poste.
En d'autres termes, dans le premier cas, nous parlons des idées d'autrui sur la façon dont un individu occupant un certain poste devrait se comporter, dans le second, de sa propre idée sur la façon dont il devrait se comporter dans un poste particulier, et dans le troisième. - sur le comportement observé d'un individu occupant un certain poste en interaction avec d'autres personnes. Comme on peut le constater, dans la plupart des cas, le rôle d'un individu, vu socialement et psychologiquement, est associé à sa position et à son statut. Dans le même temps, le statut est souvent considéré par les interactionnistes non pas comme la position objective d'un individu dans un système de certaines relations sociales, mais avant tout comme une catégorie subjective, c'est-à-dire « un ensemble » ou « une organisation d'attentes de rôle », qui sont divisés en attentes-droits et attentes-responsabilités d'un individu lorsqu'il exerce un rôle particulier.
Cette interprétation révèle clairement l'approche subjectiviste de l'analyse des phénomènes sociaux caractéristique d'une orientation interactionniste, ignorant l'aspect substantiel du rôle en tant que type d'activité socialement utile et sa séparation des relations sociales objectives. Les représentants des théories des rôles font abstraction du fait que, comme le note à juste titre L.P. Bueva, les attentes en matière de rôle ne sont rien de plus qu'une expression subjective, « une forme idéale de relations sociales objectives existant dans la pratique sociale de la société » [Bueva, 1968]. Bien qu'une analyse socio-psychologique d'un rôle social implique avant tout de considérer les facteurs subjectifs du comportement de rôle, une véritable compréhension de l'essence de ces facteurs n'exige pas leur absolutisation, mais un lien étroit entre les aspects subjectifs du comportement de rôle et des relations sociales objectives, non ? ce sont ces derniers qui sont finalement décisifs | former dans la conscience publique des attentes, des demandes, des droits et des responsabilités, ainsi que des modes de comportement appropriés à un rôle particulier.
Un rôle, selon le concept moderne de comportement de rôle, est un mode de comportement défini par la société. Il se compose de deux variables : les attitudes psychologiques de base de notre « je » et les attentes des autres.
Bien que le comportement de rôle consiste généralement en un jeu de rôle conscient, dans certains cas, il est hautement conscient. Avec ce comportement, le joueur étudie constamment ses propres efforts et crée l’image souhaitée de lui-même. Dans tous les cas, la performance individuelle d'un rôle par une personne a une certaine « coloration personnelle », qui dépend à la fois de ses connaissances et de sa capacité à jouer un rôle donné, de son importance pour elle, de son caractère, de sa motivation, d'autres caractéristiques de la personnalité et des influences socioculturelles. .
Comme l'ont noté les chercheurs T.V. Kazakova et S.I. Raikov, chaque individu au cours de sa vie apprend à jouer divers rôles, maîtrisant ainsi les normes de la culture. La formation aux jeux de rôle, selon eux, comporte deux aspects :
1. Accomplir les devoirs et exercer les droits conformément au rôle joué.
2. Acquisition des attitudes, sentiments et attentes correspondant au rôle donné.
L’apprentissage des rôles sociaux ne peut être couronné de succès qu’avec une préparation cohérente à la transition d’un rôle à un autre tout au long de la vie de l’individu. Les études de pratique montrent que l’apprentissage des rôles se caractérise par une discontinuité, ce qui conduit à des tensions dans les rôles. La tension de rôle résulte d'une mauvaise compréhension du futur rôle, ainsi que d'une mauvaise préparation à celui-ci et, par conséquent, d'une mauvaise exécution de ce rôle. Une autre source de tensions liées aux rôles réside dans le fait que la préparation morale d’un individu à remplir des rôles comprend principalement des règles formelles de comportement social. Dans le même temps, l’enseignement de modifications informelles de ces règles qui existent réellement dans le monde qui nous entoure est souvent ignoré. En d’autres termes, les individus qui apprennent un certain rôle assimilent, en règle générale, une image idéale de la réalité environnante, et non une culture réelle et des interactions humaines réelles.
La régulation des rôles est une procédure formelle par laquelle une personne est déchargée de sa responsabilité personnelle quant aux conséquences de l'exercice d'un rôle particulier. En pratique, cela ressemble à une référence d'une personne à l'influence des organisations, en vertu desquelles elle est obligée d'agir d'une certaine manière.
En général, le comportement de rôle est déterminé par les facteurs suivants :
§ des changements socioculturels constants ;
§ les relations de l'individu avec les autres membres du groupe social auquel il appartient ;
§ l'assimilation par l'individu des valeurs et des normes socioculturelles, qui sont régulées principalement par la formation aux rôles ;
§ le statut social de l'individu dans la société ;
§ les attentes des autres par rapport à l'individu.
L'étude du comportement de rôle à travers les conditions socio-psychologiques a été réalisée par les auteurs de ces lignes auprès du personnel d'une des entreprises de la ville de Tambov et a permis d'identifier un certain nombre de conditions socio-psychologiques qui déterminent le comportement de rôle. Les auteurs ont combiné ces conditions en trois groupes.
1. Conditions déterminées par le processus de socialisation :
§ l'influence des stéréotypes sociaux (la présence d'un stéréotype social joue un rôle important dans l'évaluation par une personne du monde qui l'entoure, dans sa réponse à une réalité changeante, dans le processus de sa cognition) ;
§ l'influence des valeurs sociales qu'une personne acquiert au cours du processus de socialisation (les valeurs sociales sont des normes comportementales plus ou moins généralement acceptées, c'est-à-dire des croyances partagées par un groupe social sur les voies et moyens qui conduisent à atteindre un objectif ; les valeurs sociales répondent à la question de savoir comment se référer à ce qui est déjà et à ce qui pourrait être) ;
§ l'influence des normes sociales qu'une personne intériorise et met en œuvre dans son comportement de rôle.
2. Condition de tension de rôle (influence l'apparition ou l'élimination de la tension de rôle) :
§ l'influence du climat socio-psychologique de l'équipe, qui affecte le degré de confiance et d'exigence des membres du groupe les uns envers les autres, le degré de pression des managers sur les subordonnés, etc. ;
§ la pression des circonstances environnantes, qui conduit à des tensions et des conflits de rôles ;
§ interaction de la personnalité de l'interprète du rôle avec d'autres participants, car la notion de rôle inclut l'ensemble des attentes de chaque personne par rapport à la fois à son propre comportement et au comportement des autres personnes lors de l'interaction dans une certaine situation ;
§ le degré de correspondance entre les attentes des autres et ses propres idées sur soi-même et son rôle (plus ce degré de correspondance est élevé, plus le comportement de rôle est efficace) ;
§ correspondance du rôle existant d'une personne avec son potentiel personnel ;
§ le degré avec lequel un individu est conscient de ses rôles (dans quelle mesure une personne comprend les spécificités de son rôle, dans quelle mesure elle imagine la ligne de comportement qui lui convient, dans quelle mesure elle est interprétée par lui, dépend en grande partie de la qualité de son exécution).
3. Condition d'épanouissement du rôle :
§ activité de la personnalité (l'activité personnelle est comprise comme la capacité d'une personne à opérer des transformations socialement significatives, se manifestant par la créativité, le comportement de rôle, la communication ; l'activité de la personnalité dans le comportement de rôle peut s'exprimer dans le choix d'un rôle particulier, la conscience de la personne de son rôle, le choix d'un modèle pour l'exécuter, la soumission consciente de leur rôle, de leur comportement et des attentes des autres) ;
§ niveau de sens des responsabilités (la responsabilité détermine l'attitude de l'individu envers ses responsabilités de rôle, puisqu'elle sert de moyen de contrôle interne de la régulation interne du comportement de l'individu ;
§ capacité à s'adapter à des situations changeantes.
Ainsi, les jeux de rôle sont toujours de l'improvisation, puisant matière à la pratique sociale de la vie humaine avec l'introduction de trois éléments : fiction, vérité historique et réalité réelle. Le moment spontané unificateur des trois éléments est l’imagination.
Aux États-Unis d'Amérique, lors de la naissance du behaviorisme, a pris forme le concept de comportement de rôle développé par le philosophe George Mead. La direction fondée par Mead n'a pas de nom précis. Des termes tels que « théorie des rôles » ou « tradition de Chicago » sont parfois utilisés pour y faire référence (puisque ses dirigeants - Mead, Dewey et Park - travaillaient à l'Université de Chicago). Compte tenu du caractère unique de l'approche de Mead, nous appelons son concept la théorie du comportement de rôle.
Selon le béhaviorisme orthodoxe, le comportement est construit à partir de stimuli et de réactions dont la connexion est imprimée dans l'organisme individuel en raison de son effet bénéfique. Selon Mead, le comportement se construit à partir des rôles assumés par l'individu et « joués » par lui dans le processus de communication avec les autres participants à l'action de groupe.
Mead est parti de la position selon laquelle le sens d'un mot pour le sujet qui le prononce reste fermé jusqu'à ce que ce dernier assume le rôle de celui à qui il s'adresse, c'est-à-dire qu'il établisse une relation avec une autre personne. Passant des actions verbales aux actes sociaux réels, Mead a appliqué le même principe que dans l'interprétation de la communication verbale : une personne ne peut accomplir une action significative, toujours adressée aux personnes, sans assumer le rôle des autres et sans évaluer sa propre personne du point de vue de l'autre. point de vue des autres.
Assumer un rôle et le « jouer » (implicite ou explicite) est une relation, contrairement aux aspects de la réalité mentale qui sont enregistrés dans les catégories image – action – motif. L’inséparabilité des différents aspects de cette réalité détermine leur interconnexion interne.
L'attitude s'exprime dans des actions prescrites par le « scénario » du rôle et motivées par les intérêts des participants au processus social, et présuppose leur compréhension (représentée sous la forme d'une image) du sens et de la signification de ces actions. En d’autres termes, une relation est impossible sans une image, un motif, une action, tout comme elles sont impensables au niveau de l’existence humaine sans relation. C’est ainsi que les choses se passent en réalité. Mais pour que cette réalité se révèle à la pensée scientifique et en devienne le sujet, il a fallu une longue recherche. Au cours de la recherche, il a été possible de maîtriser les plus gros « blocs » du psychisme, notamment d'isoler l'attitude des autres catégories de manifestations psychiques et ensuite seulement de la corréler avec elles.
Déjà dans les années 50, le concept d'analyse transactionnelle d'E. Berne, populaire tant en Occident qu'en Russie, montrait une proximité avec la théorie du comportement de rôle. À partir des idées de la psychanalyse, E. Berne a identifié trois « états du moi » des personnes dans leurs relations les unes avec les autres (« adulte », « parent », « enfant »). Selon son concept, à chaque instant de la vie, chaque personne se trouve dans l'un des « états du moi » qui déterminent son attitude envers les autres. Le concept de « transaction » a été utilisé pour caractériser la relation des « états du moi » de la dyade entrant en communication. Lorsqu’il entre dans une relation et une interaction avec une autre personne, un individu se trouve dans l’un des « états du moi ». « Adulte » en tant qu'« état du moi » révèle la compétence, la rationalité, l'indépendance ; « parent » - autoritarisme, interdictions, sanctions, dogmes, conseils, préoccupations ; « l'état du moi » « enfant » contient des réactions affectives, de la spontanéité, de l'impulsivité. Dans différentes circonstances, un individu peut présenter différents « états du moi » et sur cette base se construisent ses relations avec les autres.
Parallèlement aux « it-states », E. Berne a introduit le concept de « jeu », en l'utilisant pour désigner diverses manières de manipuler les gens. Le concept d'analyse transactionnelle décrit de nombreux jeux à l'aide desquels les personnes nouant certaines relations tentent de contrôler le comportement de leurs partenaires.
En analyse transactionnelle, la théorie du comportement de rôle s’avère considérablement avancée et opérationnalisée, trouvant des applications en psychothérapie et en psychologie de l’enfant. Cependant, la nature sociale de la personnalité peut également être peu révélée par la théorie du comportement de rôle, ainsi que par la doctrine des « idées collectives ». Il est impossible de pénétrer dans cette nature en ignorant la pratique socio-historique. Tout comme Durkheim, avec son apsychologisme, qui s'est avéré inacceptable pour l'explication scientifique du comportement humain, nous a néanmoins incité à chercher des moyens de développer la catégorie de relation (l'analyse transactionnelle est indicative en ce sens), de même le manque de développement La définition de la catégorie de personnalité inhérente à la pensée juive a donné lieu à un mécontentement à l'égard du réductionnisme des rôles, ignorant le début de l'activité humaine. Il y avait un besoin croissant de séparer le (rôle) communicatif et personnel.
Il a fallu les efforts d'un grand nombre de scientifiques travaillant dans le domaine de la psychologie sociale pour trouver des solutions qui révéleraient l'essence des relations sociales interindividuelles et de la communication entre les personnes en relation avec la compréhension de la personnalité en tant que catégorie psychologique. Mais pour cela, il fallait que la psychologie sociale acquière le statut de discipline expérimentale.
La caractérisation d’un petit groupe comme un ensemble de sujets de communication présuppose sa considération comme un « système de systèmes ». Cela signifie qu'un petit groupe représente un système socio-psychologique spécifique qui intègre les individus en tant que « microsystèmes ».
L.P. Bueva, qui a proposé cette approche, considère la personnalité comme un système ouvert et dynamique. Il est difficile d'être en désaccord avec cela.
I. S. Kon comprend également la personnalité comme un système. Il estime qu'objectivement, le système de personnalité peut être décrit comme un ensemble de ses rôles sociaux. Selon I. S. Kohn,
« le concept de personnalité désigne une personne holistique dans l'unité de ses capacités individuelles et des fonctions sociales (rôles) qu'elle exerce. »
Les fonctions sociales révèlent son appartenance à un certain groupe social, elles enregistrent ses droits et responsabilités par rapport au groupe. La personnalité ne se limite pas à un seul rôle, la structure objective de la personnalité se révèle comme une totalité, l'intégrité de ses rôles dans la société.
Dans la littérature, on peut distinguer différents points de vue sur le comportement de rôle d’un individu. Chacun d'eux reflète une vision subjective de l'essence et du contenu du concept de « rôle ». Mais il est objectif qu’une théorie des rôles de la personnalité se soit développée en sociologie.
Selon V. A. Yadov, la théorie des rôles de la personnalité est une théorie dans laquelle une personnalité est décrite à travers des fonctions sociales et des modèles de comportement appris et acceptés par le sujet (intériorisés) ou forcés d'être exécutés (non intériorisés) - des rôles déterminés par le sujet. statut social de l'individu dans la société ou dans un groupe social.
La théorie des rôles de la personnalité est une intégration des acquis de la sociologie et de la psychologie sociale dans l'étude de la personnalité.
Les principales dispositions de la théorie des rôles de la personnalité ont été formées en psychologie sociale par J. Mead et en sociologie par l'anthropologue social R. Linton.
J. Mead accorde une attention particulière à « l'apprentissage des rôles », à la maîtrise des rôles dans les processus d'interaction interpersonnelle (interaction), en soulignant l'effet stimulant des « attentes de rôle » de la part des personnes « significatives » pour un individu donné avec lequel il entre en relation. communication.
R. Linton souligne tout d'abord le caractère socioculturel des prescriptions de rôles et leur lien avec la position sociale de l'individu, ainsi que le maintien des exigences de rôle par un système de sanctions sociales et de groupe.
Dans le cadre de la théorie des rôles de la personnalité, des phénomènes tels que
- « conflit de rôle » - l'expérience du sujet de l'ambiguïté ou de l'incohérence des exigences de rôle de la part des différentes communautés sociales dont il est membre ; ce qui crée une situation stressante ;
- « intégration et désintégration » de la structure des rôles de l'individu - en conséquence de l'harmonie ou du conflit des relations sociales.
Sur la base de cette théorie, A. A. Nalchadpsyan a développé le concept de comportement de rôle. De son point de vue, le comportement de rôle est le comportement d'un individu dans un groupe, déterminé par son statut et le rôle qu'il joue conformément à ce statut.
Le concept de rôle social associé à des normes et des attentes comprend les « blocages » suivants:
- le rôle représenté (le système d'attentes de l'individu et de certains groupes) ;
- rôle subjectif (ces attentes (attentes) qu'une personne associe à son statut, c'est-à-dire ses idées subjectives sur la façon dont elle devrait agir par rapport aux personnes ayant d'autres statuts) ;
- rôle joué (comportement observé d'une personne ayant un statut donné par rapport à une autre personne ayant un statut différent).
Le style de comportement de rôle est la « coloration personnelle » du jeu de rôle, en fonction du tempérament, du caractère, de la motivation et d'autres caractéristiques de l'individu, de ses connaissances et de ses compétences.
Le comportement de rôle d'un individu est bidimensionnel : ce sont des actions
- des exigences réglementaires (je suis dans le rôle suggéré par les circonstances),
- des réclamations personnelles (moi en tant que tel).
Le premier plan de comportement est une forme sociale d'actions de jeu de rôle. Le deuxième plan est une méthode psychologique de réalisation de soi du rôle.
- concept personnel ;
- les attentes en matière de rôle ;
- spécificité du rôle personnel ;
- stratégie personnelle pour la mise en œuvre du rôle ;
- programme cognitif personnel.
La notion de rôle social nécessite la compréhension des quatre points suivants :
- premièrement, que le rôle social est régi par certains droits et responsabilités tant dans la société dans son ensemble que dans les petits groupes dans lesquels l'individu est inclus à travers ses activités de la vie ;
- deuxièmement, que la personne elle-même a une opinion précise sur la manière dont elle remplira son rôle ;
- troisièmement, le fait que différents rôles ont une signification différente pour chaque individu ;
- quatrièmement, le fait que le rôle de l'individu se manifeste dans son comportement réel.
L'acceptation d'un rôle par un individu - en plus de dépendre de facteurs sociaux - dépend de son sexe, de son âge, des caractéristiques typologiques du système nerveux, de ses capacités, de son état de santé, etc.
Il existe une structure normative pour remplir un rôle social, constituée d'une description d'un comportement (correspondant à un rôle donné) ; prescriptions (exigences pour ce comportement); évaluation de la performance du rôle prescrit ; sanctions (en cas de violation des exigences prescrites). Chaque le système social a son propre « ensemble de rôles », qui est déterminé:
- premièrement, les attentes stables de la société ou d'un groupe concernant le comportement d'une personne ayant un certain statut ;
- deuxièmement, un ensemble d'orientations de valeurs de l'individu, appelé rôle « intériorisé » (accepté en interne) ;
- troisièmement, par le fait qu'il y a toujours des personnes dont le comportement et l'apparence intérieure sont considérés comme l'incarnation idéale du rôle et servent de modèles.
Remplir des rôles sociaux peut provoquer les conflits suivants:
- intrapersonnel (causé par des contradictions dans les exigences imposées au comportement d'un individu dans ses différents rôles sociaux).
- intra-rôle (résultat de contradictions dans les exigences relatives à l'accomplissement d'un rôle social par différents participants à l'interaction) ;
- rôle personnel (conséquence d'un écart entre les idées d'une personne sur elle-même et ses fonctions de rôle) ;
- innovant (en raison de l'écart entre les orientations de valeurs précédemment formées et les exigences de la nouvelle situation sociale).
Nous nous sommes toujours intéressés aux rôles communicatifs de l'individu : c'est leur analyse qui permet d'aborder un petit groupe comme un ensemble de sujets de communication. Mais il s’agit d’une approche de premier niveau, c’est-à-dire subjective. Dans ce cadre, nous avons développé une morphologie des rôles, comprenant
- stratégie de rôle (une manière de s'adapter à un partenaire de communication) ;
- tâche de rôle (objectif qui doit être atteint dans une situation problématique);
- programme de rôle (système d'actions ciblées et ordonnées);
- actions de rôle (moyens d'atteindre un objectif);
- compétence de rôle (connaissance des conditions d'action);
- liberté de rôle (possible et inacceptable lorsqu'on joue un rôle) ;
- humeur de rôle (état psycho-émotionnel correspondant à la situation d'interaction).
6. Théories des rôles de la personnalité
Théorie des rôles de la personnalité est une approche de l'étude de la personnalité, selon laquelle une personne est décrite à travers les fonctions sociales et les modèles de comportement qu'elle a appris et acceptés ou qu'elle est obligée d'accomplir - des rôles qui découlent de son statut social dans une société ou un groupe social donné . Les principales dispositions de la théorie des rôles sociaux ont été formulées par le psychologue social américain J. Mead, anthropologiste R. Linton. Le premier s'est concentré sur les mécanismes de « l'apprentissage des rôles », la maîtrise des rôles dans les processus de communication interpersonnelle (interaction), en soulignant l'effet stimulant des « attentes de rôle » de la part des personnes significatives pour l'individu avec qui il entre en communication. La seconde a attiré l'attention sur la nature socioculturelle des prescriptions de rôles et leur lien avec la position sociale de l'individu, ainsi que sur la finalité des sanctions sociales et de groupe. Dans le cadre de la théorie des rôles, les phénomènes suivants ont été identifiés expérimentalement : conflit de rôle - l'expérience du sujet d'ambiguïté ou de confrontation des exigences de rôle des différentes communautés sociales dont il est membre, ce qui crée une situation stressante ; l'intégration et la désintégration de la structure des rôles de l'individu sont des conséquences de l'harmonie ou du conflit des relations sociales.
Il existe des rôles sociaux de premier plan qui découlent de la structure sociale de la société, et des rôles qui surviennent de manière relativement arbitraire dans les interactions de groupe et impliquent une connotation sociale active pour leur mise en œuvre. Ces caractéristiques de l’approche des rôles sont présentées le plus clairement dans le concept du sociologue ouest-allemand R. Dahrendorf, considérer la personne comme un produit désindividualisé de prescriptions de rôles, ce qui, sous certaines conditions, reflète l'aliénation de l'individu.
Surmonter le caractère unilatéral de l'approche des rôles dans l'étude de la personnalité implique d'analyser ses propriétés.
Un rôle est le plus souvent compris comme une fonction sociale, un modèle de comportement, défini objectivement par la position sociale d'un individu dans le système de relations sociales ou interpersonnelles. L'exercice du rôle doit être conforme aux normes sociales acceptées et aux attentes des autres, quelles que soient les caractéristiques individuelles de l'individu.
Il existe diverses théories du comportement de rôle individuel (par exemple, le concept d'interactionnisme symbolique est associé à l'introduction par le psychologue américain J. Mead du concept d'« échange de symboles », qui s'exprime sous des formes verbales et autres par des idées sur le partenaire d'interaction et son attente de certaines actions de la part du sujet.
Extrait du livre Atelier sur la gestion des conflits auteur Emelianov Stanislav MikhaïlovitchThème 5. Théories du comportement personnel en conflit Lors de l'analyse d'un conflit et du choix de solutions adéquates pour gérer ce conflit, il est nécessaire de prendre en compte les modèles de comportement typiques des sujets personnels d'interaction conflictuelle. Ce sujet traite de certains
Extrait du livre Psychologie de la personnalité auteur Guseva Tamara Ivanovna6. Théories des rôles de la personnalité La théorie des rôles de la personnalité est une approche de l'étude de la personnalité, selon laquelle une personnalité est décrite à travers les fonctions sociales et les modèles de comportement qu'elle a appris et acceptés ou qu'elle est obligée d'accomplir - des rôles qui découlent de son
Extrait du livre Théories de la personnalité par Kjell LarryThéories de la personnalité Actuellement, il n'existe pas d'opinion généralement acceptée sur l'approche que les personnologues devraient adopter dans l'étude de la personnalité pour expliquer les principaux aspects du comportement humain. En fait, à ce stade du développement de la personnologie, divers
Extrait du livre Psychologie : Aide-mémoire auteur auteur inconnuComposantes de la théorie de la personnalité Comme nous l'avons déjà noté, les principales fonctions de la théorie sont d'expliquer ce qui est déjà connu et de prédire ce qui ne l'est pas encore. Outre les fonctions explicatives et prédictives de la théorie, il existe également des questions et des problèmes fondamentaux qui
Extrait du livre Théories de la personnalité et croissance personnelle auteur Frager RobertCritères d'évaluation des théories de la personnalité Avec autant de théories alternatives de la personnalité disponibles, comment évaluez-vous les mérites relatifs de chacune ? Comment décider, sans aborder leurs fonctions explicatives et prédictives, pourquoi une théorie est meilleure
Extrait du livre Psychologie générale auteur Chichkoedov Pavel Nikolaïevitch Extrait du livre Psychologie des capacités générales auteur Druzhinin Vladimir Nikolaevich (Docteur en psychologie)Une approche constructive de la théorie de la personnalité Nous abordons toutes les théories présentées dans ce livre de la manière la plus positive et la plus sympathique possible. Chaque chapitre a été lu et évalué par des théoriciens et des praticiens du système qui y est décrit, ce qui nous donne confiance dans
Extrait du livre Critères de personnalité normale et anormale en psychothérapie et conseil psychologique auteur Kapustin Sergueï AlexandrovitchThéories de la personnalité Avant Freud et d’autres grands théoriciens occidentaux de la personnalité, il n’existait pas de véritable théorie de la personnalité. On pensait que les troubles mentaux étaient le résultat d'une « possession étrangère » inexplicable chez des personnes autrement saines d'esprit,
Extrait du livre Psychologie. Personnes, concepts, expériences par Kleinman PaulÉlargir le cadre de la théorie de la personnalité Ces dernières années, les quatre approches suivantes de la nature et du fonctionnement humain sont devenues de plus en plus importantes : la psychologie cognitive, le mouvement du potentiel humain, la psychologie des femmes et
Extrait du livre Fondements de la psychologie auteur Ovsiannikova Elena AlexandrovnaChapitre 2 Théories du développement de la personnalité 2.1. Approches dans le cadre des concepts biogénétiques et sociogénétiques Développement de la psychologie de l'enfant à la fin du 19e – début du 20e siècle. était étroitement lié à la pédologie - la science des enfants, créée par le psychologue américain Grenville Stanley Hall
Extrait du livre de l'auteurThéories quotidiennes de la personnalité et idées sur l'intelligence La psychologie des capacités, que les psychologues-chercheurs le veuillent ou non, repose sur des idées quotidiennes ancrées dans la culture linguistique, tout comme la physique repose sur des connaissances physiques quotidiennes : l'eau.
Extrait du livre de l'auteurChapitre 3. Critère existentiel dans la théorie de la personnalité d'A. Adler La connaissance de la théorie de la personnalité d'A. Adler doit commencer par l'une de ses dispositions fondamentales, qui caractérise la vie humaine dans son ensemble comme un phénomène téléologique. Cela signifie que la nature humaine elle-même
Extrait du livre de l'auteurChapitre 4. Le critère existentiel dans la théorie de la personnalité de C. Jung. Les idées de C. Jung sur la personnalité sont basées sur ses idées plus générales sur la structure et le développement de la psyché humaine, qui, à leur tour, sont considérées par lui dans le contexte de l'évolution biologique et
Extrait du livre de l'auteurChapitre 5. Le critère existentiel dans la théorie de la personnalité de C. Rogers Dans la théorie de la personnalité de C. Rogers, le concept de réalisation de soi occupe une place clé. Le terme « réalisation de soi » consiste en une combinaison de deux mots : soi et réalisation. Le mot « actualisation » signifie, selon K. Rogers,
Extrait du livre de l'auteurThéories de la personnalité Plusieurs écoles scientifiques ont tenté d'étudier comment la personnalité se développe et se forme, et nous avons déjà discuté en détail de plusieurs de leurs théories. Il s'agit notamment de la psychologie humaniste (par exemple, la théorie de la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow), dans laquelle
Extrait du livre de l'auteur2.2. Théories psychologiques de la personnalité Au stade actuel de développement de la pensée psychologique, les secrets de la psyché humaine ne sont pas encore entièrement compris. Il existe de nombreuses théories, concepts et approches pour comprendre la personnalité et l'essence de la psyché humaine, chacun d'entre eux étant