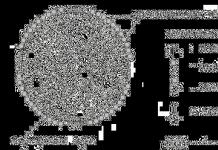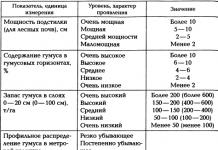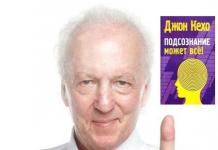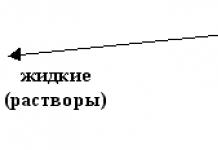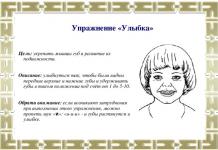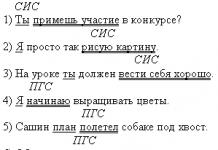L’Europe est en transition. Aux XVIe-XVIIe siècles. l'apparence prenait forme l'Europe moderne, il y a eu un basculement de la société traditionnelle vers la nouvelle société. Pendant reconstruction sociale Les normes habituelles des relations entre les gens sont violées, l'idée de « ce qui est bien et ce qui est mal » change, la croyance en un événement miraculeux, une surprise heureuse ou malheureuse et la capacité de mettre en œuvre les plans les plus audacieux augmentent. Et ce, sur plusieurs décennies du XVIe siècle. Les Européens ont pu voir comment le souverain de l'Espagne, l'ancienne périphérie sud-ouest de l'Europe, est devenu le dirigeant d'une puissance « dans laquelle le soleil ne se couche jamais », et ses sujets ordinaires F. Cortés et F. Pizarro ont réussi à capturer et subjuguer territoires d’outre-mer immenses et riches. Dans ces mêmes années, au sud-est du continent, sur les ruines empire Byzantin L'état des Turcs ottomans s'est rapidement développé. Dans ce contexte, les projets les plus audacieux ne semblaient pas fantastiques.
Origines de la guerre de Trente Ans. Dans la première moitié du XVIIe siècle. Le lieu idéal pour de tels projets était l’Europe centrale, dont les pays étaient entraînés dans une guerre prolongée depuis 1618. L'arène du conflit était les terres allemandes, et la raison en était les différences religieuses. Les Habsbourg, empereurs d’Allemagne, régnaient simultanément en Espagne et en Autriche. Les empereurs du Saint Empire romain germanique, né au Xe siècle, étaient choisis parmi les Habsbourg autrichiens.
Les Habsbourg furent les principaux défenseurs du catholicisme. La République tchèque (Bohême) était la partie la plus développée économiquement de leurs possessions. Mais de nombreux protestants vivaient sur ses terres. Et ils essayèrent de s'inviter un roi parmi les princes allemands protestants. Cela a conduit à un conflit armé qui a abouti à la guerre de Trente Ans (1618-1648).
Cardinal Armand-Jean
Duplessis, duc de Richelieu
Mélange d'intérêts religieux et politiques. Peu à peu, les pays voisins de l'Allemagne sont impliqués dans les hostilités : Danemark, Suède. Les sympathies religieuses et le désir de soutenir les autres croyants se mêlent aux intérêts politiques. Ainsi, la France se considérait comme une menace dans le fait qu'à ses frontières orientales et sud-ouest se trouvaient des États dirigés par une seule famille - la maison des Habsbourg. Par conséquent, le chef de facto du gouvernement français, le cardinal Richelieu, a jugé nécessaire de soutenir les opposants à l'empereur catholique allemand, bien qu'il soit lui-même catholique.
12 ans après le début de la guerre, au tournant des années 20 et 30, l’avantage était du côté des forces catholiques (impériales). Le commandant de l'empereur, le noble tchèque Albrecht Wallenstein (1583-1634), vainquit les défenseurs danois du protestantisme. La personnalité de cette personne traduit parfaitement « l’esprit du temps ». Ambitieux, cruel, déterminé, il était obsédé par la soif de richesse et de pouvoir, et il est difficile de dire ce qui était le plus important pour lui. Il offrit lui-même à l'empereur ses services de commandant. L'aspect le plus attrayant de cette proposition était la promesse du candidat au commandement de créer une armée capable de subvenir à ses propres besoins (aux dépens des civils sur les terres desquels elle était stationnée). Wallenstein a montré en pratique comment « la guerre peut nourrir la guerre ». Après avoir réuni sous son commandement une armée de 24 000 personnes, Wallenstein a fait preuve de brillants talents de leader.

Wallenstein.
Gravure sur cuivre
Il différait d'un commandant ordinaire d'une armée de mercenaires non seulement par l'ampleur de ses activités, mais également par le fait qu'il savait organiser ses activités avec soin et de manière globale. Ainsi, il sélectionna lui-même une composition d'officiers, les attacha solidement à des intérêts monétaires et organisa les activités de diverses manufactures en sa possession pour la production de munitions et d'équipements destinés aux besoins de l'armée. Les soldats et officiers étaient entièrement dévoués à leur commandant habile, courageux et généreux. Les succès militaires de Wallenstein sauvèrent le prestige de l'empire, mais sa volonté trop ouverte de pouvoir alarma l'empereur et son entourage. Par conséquent, après des opérations réussies contre les Danois, Wallenstein fut démis du commandement de l'armée qu'il avait créée au motif que le danger était passé. Wallenstein a fait preuve d'humilité, mais nourrissait un désir vindicatif de nuire à son maître ingrat.

Plans du roi suédois. A cette époque en Suède, l'énergique et entreprenant roi Gustav II Adolf (1594-1632) achevait la réorganisation de son armée, se demandant où envoyer cette machine militaire qu'il avait créée. Le roi suédois s'intéressait à la côte sud de la Baltique et aux possibilités de contrôle des routes commerciales. Richelieu, par l'intermédiaire de ses agents, poussa le roi de Suède à soutenir les protestants allemands. Le cardinal rusé pensait affaiblir la position de ses concurrents - les Habsbourg, et pour le roi suédois, le plus important était la transformation de la mer Baltique en un « lac intérieur » du royaume de Suède. En outre, il envisageait de créer un État en Europe centrale sous l'autorité de la couronne suédoise. Il est difficile de dire aujourd'hui quels étaient les objectifs spécifiques de Gustav Adolf ; il s'attendait très probablement à ce que « la guerre montre le plan ».
Armée suédoise. Au moment où l'armée suédoise débarqua sur le territoire allemand, sur la côte de Poméranie, le 6 juillet 1630, son commandant avait fait beaucoup pour garantir la réalisation de ses plans. L'armée suédoise était sensiblement différente des autres en termes d'organisation et même d'armes. Il était composé de Suédois et de Finlandais enrôlés. (Cette armée peut être considérée comme un prototype de l’armée nationale.)
Et l’armée de l’empereur, selon la tradition, était composée de mercenaires de différentes nationalités. L'armée suédoise comprenait également des mercenaires protestants écossais et tchèques, mais la principale force de frappe restait des unités suédo-finlandaises. Leurs soldats et officiers recevaient des salaires réguliers et il leur était strictement interdit d'opprimer et de voler la population civile. La violation de l'interdiction était strictement punie. Gustav Adolf a fourni à son armée une artillerie puissante, notamment de petits canons. Il s’agissait d’une innovation importante. Les soldats ont reçu des vêtements chauds, ce qui leur a permis de continuer lutte même dans heure d'hiver. Mais ensuite, avec l'arrivée du dégel d'automne et du froid, les armées en guerre étaient généralement placées dans leurs quartiers d'hiver et arrêtaient leurs opérations actives jusqu'à la chaleur printanière.

Guerriers suédois de l'époque de Gustave Adolf
(de gauche à droite) : mousquetaire, dragon,
cuirassier, piquier.
Offensive suédoise.À l'été 1630, le roi suédois entame sa marche victorieuse à travers le territoire des principautés allemandes. L'une après l'autre, plusieurs villes fortifiées importantes furent prises. Des victoires rapides et faciles ont glorifié le nom du roi suédois. Les protestants de toute l'Europe voyaient dans le monarque suédois l'incarnation de toutes les vertus chevaleresques, et Richelieu commençait à comprendre que le pouvoir qu'il avait suscité devenait incontrôlable.
L'armée impériale opposée aux Suédois était dirigée par le vieux commandant (il avait 70 ans) Johann Tilly. C'était un chef militaire aguerri, honnête à sa manière, sans aucun doute talentueux, fiable, responsable, mais qui manquait de cet éclat, de cette étincelle de talent militaire dont étaient dotés à la fois son adversaire Gustav Adolf et son rival Wallenstein. Les armées en guerre ont manœuvré pendant un certain temps à travers les terres de Poméranie, capturant et dévastant des villes et des villages, puis se sont déplacées vers le territoire de la Saxe, dont le dirigeant était un allié de Gustav Adolf. Les Suédois avaient besoin d'une grande bataille victorieuse et, si possible, le plus rapidement possible. Ils n'avaient nulle part où attendre des renforts, tandis que Tilly s'attendait à ce que des forces supplémentaires arrivent bientôt. L'électeur saxon est celui qui précipite le plus les événements, puisque ce sont ses terres qui sont ravagées par deux armées.
Lire aussi d'autres sujets Partie III ""Concert européen" : la lutte pour l'équilibre politique" rubrique « Ouest, Russie, Est dans les batailles du XVIIe – début du XVIIIe siècle » :
- 9. « Inondation suédoise » : de Breitenfeld à Lützen (7 septembre 1631-16 novembre 1632)
- L'Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Causes de la guerre de Trente Ans
- Bataille de Breitenfeld. Campagne d'hiver de Gustave Adolphe
- 10. Marston Moor et Nasby (2 juillet 1644, 14 juin 1645)
- Marston Moor. Victoire de l'armée parlementaire. La réforme de l'armée de Cromwell
- 11. « Guerres dynastiques » en Europe : la lutte « pour l'héritage espagnol » au début du XVIIIe siècle.
- 12. Les conflits européens deviennent mondiaux
- Guerre de Succession d'Autriche. Conflit austro-prussien
- Frédéric II : victoires et défaites. Traité d'Hubertusburg.
- 13. La Russie et la « question suédoise »
Causes de la guerre de Trente Ans (prolongée) (1618-1648).
L'arène du conflit était les terres allemandes, et la raison en était les différences religieuses. Les empereurs d’Allemagne furent les principaux défenseurs du catholicisme. La République tchèque était la partie la plus développée de leurs possessions, mais de nombreux protestants y vivaient. Et ils essayèrent de s'inviter un roi parmi les princes allemands protestants. Cela a conduit à un conflit armé qui a abouti à la guerre de Trente Ans.
Mélange d'intérêts religieux et politiques. Peu à peu, ils furent impliqués dans les hostilités pays voisins: Danemark, Suède. La France se considérait comme une menace dans la mesure où à ses frontières se trouvaient des États sous domination allemande. Par conséquent, le chef, le cardinal Richelieu, a soutenu les opposants à l'empereur catholique allemand, bien qu'il soit lui-même catholique. 12 ans après le début de la guerre, l’avantage était du côté des forces catholiques. Le commandant de l'empereur, le noble tchèque Albrecht Wallenstein (1583-1634), vainquit les défenseurs danois du protestantisme.
À cette époque, en Suède, l’énergique et entreprenant roi Gustav II Adolf (1594-1632) achève la réorganisation de son armée, se demandant où diriger cette machine militaire qu’il a créée. Il s'intéressait à la côte baltique et aux possibilités de contrôle des routes commerciales. Richelieu, par l'intermédiaire de ses agents, poussa le roi de Suède à soutenir les protestants allemands. Le cardinal rusé songea à affaiblir la position de ses concurrents, les Habsbourg. L'armée suédoise est allée en Allemagne. Ses soldats et officiers recevaient des salaires réguliers et il leur était strictement interdit d'opprimer et de voler la population civile. La violation de l'interdiction était strictement punie. Gustav Adolf a fourni à son armée une artillerie puissante, notamment de petits canons. Il s’agissait d’une innovation importante. Les soldats recevaient des vêtements chauds, ce qui leur permettait de continuer à combattre même en hiver. Le roi suédois conquit les terres allemandes. Des victoires rapides et faciles ont glorifié le nom du roi suédois. Les protestants de toute l'Europe voyaient dans le monarque suédois l'incarnation de toutes les vertus chevaleresques, et Richelieu commençait à comprendre que le pouvoir qu'il avait suscité devenait incontrôlable. En conséquence, les projets de restauration catholique se sont effondrés.
La guerre se termine par la Paix de Westphalie en 1648.. L'Espagne a reconnu l'indépendance des Pays-Bas. Aussi, selon ce document, les pays qui ont gagné la guerre de Trente Ans - la France et la Suède - ont été nommés garants de la paix.
- L'Empire versa à la Suède une indemnité s'élevant à 5 millions de thalers ; il reçut l'île de Rügen, la Poméranie occidentale et une partie de la Poméranie orientale, la ville de Wismar, l'évêché de Verden et l'archevêché de Brême.
- La signature de la Paix de Westphalie permet à la France de recevoir les possessions des Habsbourg situées en Alsace, mais sans la ville de Strasbourg, ainsi que la souveraineté sur plusieurs évêchés de Lorraine.
- l'empereur allemand a perdu une partie importante de ses anciens droits. Les princes sont devenus indépendants et ont pu participer à la prise de décision concernant le déclenchement de la guerre et la conclusion de la paix, leur département était chargé de déterminer le montant des impôts et l'adoption des lois dans l'Empire romain en dépendait en grande partie.
De belles découvertes géographiques.
- la découverte de l'Amérique par H. Colomb a marqué le début de larges connexions entre les terres ouvertes et l'Europe
- Les voyages de Vasco de Gama sur les côtes de l'Inde
- Le voyage de F. Magellan autour du monde.
De grandes découvertes géographiques sont devenues possibles grâce aux progrès significatifs dans le développement de la science et de la technologie en Europe. La doctrine de la sphéricité de la Terre s'est répandue et les connaissances dans le domaine de l'astronomie et de la géographie se sont développées. Les instruments de navigation (boussole) ont été améliorés et un nouveau type de voilier est apparu : la caravelle.
- . En 1488, Bartolomeu Dias atteint le cap de Bonne-Espérance en Afrique australe.
Les connaissances acquises par les Portugais à la suite de leurs voyages ont donné aux marins d'autres pays des informations précieuses sur le flux et le reflux, la direction des vents et des courants, et ont permis de créer des cartes plus précises sur lesquelles les latitudes, les lignes des tropiques et les l'équateur a été tracé.
Le XVIe siècle est un siècle de grands changements et bouleversements spirituels, culturels, politiques et religieux dans la vie de l'Europe.
Vers la fin du XVe siècle. La culture de la Renaissance (Renaissance), née dans les cités italiennes au 14ème siècle, s'est répandue dans d'autres pays d'Europe occidentale.
Les processus turbulents de cette époque ont provoqué de profonds changements dans l’idéologie de la société d’Europe occidentale.
Les représentants de l'humanisme opposaient les sciences et l'éducation laïques à l'érudition ecclésiastique et scolastique. Les sciences laïques (humanitaires) n'étudiaient pas Dieu avec ses hypostases, mais l'homme, ses relations avec les autres et ses aspirations, en utilisant non pas un syllogisme appliqué de manière scolastique, mais l'observation, l'expérience, des évaluations et des conclusions rationalistes.
Humanisme XV-XVI siècles. n’est pas devenu un mouvement qui a conquis les larges masses populaires. La culture de la Renaissance était la propriété d'une couche relativement restreinte Des gens éduqués différents pays L'Europe, liée par des intérêts scientifiques, philosophiques et esthétiques communs, communiquant en utilisant la langue européenne commune de l'époque - le latin. La plupart des humanistes avaient une attitude négative envers les mouvements religieux, y compris ceux de réforme, dont les participants, à leur tour, ne reconnaissaient que la forme religieuse de l'idéologie et étaient hostiles au déisme et à l'athéisme.
L'imprimerie, inventée au milieu du XVe siècle, a joué un rôle important dans la large diffusion des idées religieuses et laïques. et a été largement utilisé au 16ème siècle.
L'enseignement de N. Machiavel sur l'État et la politique.
L'un des premiers théoriciens de la nouvelle ère fut l'Italien Niccolo Machiavel (1469-1527). Machiavel pendant longtempsétait un fonctionnaire de la République florentine ayant accès à un certain nombre de secrets d'État. La vie et l'œuvre de Machiavel remontent à la période du début du déclin de l'Italie, jusqu'au XVIe siècle. autrefois le pays le plus avancé d’Europe occidentale. Les écrits de Machiavel ont jeté les bases de l’idéologie politique et juridique du New Age. Son enseignement politique était affranchi de la théologie ; il est basé sur l’étude des activités des gouvernements contemporains, de l’expérience des États du monde antique et des idées de Machiavel sur les intérêts et les aspirations des participants à la vie politique.
Machiavel considérait l'État (quelle que soit sa forme) comme une sorte de relation entre le gouvernement et ses sujets, basée sur la peur ou l'amour de ces derniers. L'État est inébranlable si le gouvernement ne suscite pas de conspirations et de troubles, si la peur de ses sujets ne se transforme pas en haine et l'amour en mépris.
Machiavel se concentre sur la capacité réelle du gouvernement à commander à ses sujets. Le livre "Le Souverain" et d'autres ouvrages contiennent un certain nombre de règles, des recommandations pratiques basées sur son idée des passions et des aspirations des gens et groupes sociaux, en utilisant des exemples de l'histoire et de la pratique contemporaine des États italiens et autres.
Après avoir écrit le traité « Le Prince » (1512), Machiavel devient une célébrité européenne. Une renommée très ambiguë le hante : d'une part, N. Machiavel a formulé le sujet de la science politique, mais il est condamné pour avoir créé une œuvre blasphématoire (à philosophie antichrétienne).
Selon lui, il y a trois forces dans l’histoire : Dieu, le Destin et la Grande Personnalité. Machiavel fut le premier à s'intéresser au rôle de la personnalité dans l'histoire.
Les principales caractéristiques de son enseignement :
1. Humanisme : "Une personne peut tout faire : changer la volonté de Dieu, changer son destin, une personne peut être grande même dans le crime. Une personne peut changer le cours de l'histoire."
2. Anti-fatalisme : le désir de changer son destin.
3. Réalisme. Décrit ce qui est là.
L'essence du traité « Le Souverain » est la doctrine de la politique.
A) La politique est une science expérimentale sur l’état réel des choses. Il étudie le monde du pouvoir tel qu'il est.
B) La politique est la science des moyens de s'emparer et de conserver le pouvoir. Le premier formule la notion de pouvoir. Le pouvoir est un état de domination et de soumission.
B) La politique est un type déterminé activité humaine. L’objectif est toujours le même : soutenir et offrir du pouvoir.
D) La politique est une sphère immorale particulière de la vie publique ; dans la lutte pour le pouvoir, on ne peut pas se laisser guider par des critères moraux. Le jugement moral ne peut pas être utilisé pour évaluer les actions politiques.
D) La politique est autonome par rapport à la religion.
E) La politique est un domaine où chaque fin justifie les moyens.
G) La politique est un art. La politique ne s’enseigne pas, la personnalité est d’une importance primordiale. Il n’existe pas de moyens permanents de réussite en politique. Le choix des moyens dépend de la situation.
Bases du pouvoir :
1. Fondations matérielles - force. De nombreuses armées fidèles. L'homme politique lui-même doit avoir les principes d'un commandant.
2. Le pouvoir doit avoir un soutien social : le peuple. (Machiavel recommande de s'appuyer sur le peuple ; il vaut mieux exterminer l'aristocratie.)
3. Raisons psychologiques(sentiments). Le peuple devrait aimer et (plus) craindre le dirigeant. Il existe des sentiments psychologiques qui nuisent au pouvoir : la haine et le mépris. Vous ne pouvez pas voler les gens. Le mépris est causé par l'inactivité du dirigeant, sa lâcheté. La politique du « juste milieu ». Le dirigeant doit apprendre à être méchant (la capacité de mentir, de tuer). Le dirigeant doit apparaître comme un grand homme.
Machiavel considérait la sécurité de l'individu et l'inviolabilité de la propriété comme le but de l'État et la base de sa force. La chose la plus dangereuse pour un dirigeant, répétait inlassablement Machiavel, est d'empiéter sur la propriété de ses sujets - cela suscite inévitablement la haine (et vous ne volerez jamais autant qu'il ne reste plus un couteau). Machiavel appelait l'inviolabilité de la propriété privée, ainsi que la sécurité de l'individu, les bienfaits de la liberté et considérait le but et la base de la force de l'État.
Machiavel reproduit les idées de Polybe sur l'émergence de l'État et le cycle des formes de gouvernement ; A la suite des auteurs anciens, il privilégie une forme mixte (monarchie, aristocratie et démocratie).
La religion doit être l’un des attributs de l’État et doit avoir le statut d’État. Le mal du christianisme pour l'État, parce que faiblesse de la valeur étatique dans l'État.
Idéal politique (double).
1. La plus optimale est la République florentine.
2. Dans le traité « Le Prince », la monarchie absolue est la meilleure forme de gouvernement. La création d'un État italien unifié justifiait tous les moyens nécessaires.
Les travaux de Machiavel ont eu une influence considérable sur le développement ultérieur de l’idéologie politique et juridique. Ils formulaient et justifiaient les principales revendications du programme de la bourgeoisie : l'inviolabilité de la propriété privée, la sécurité des personnes et des biens, la république comme meilleur moyen d'assurer les « bienfaits de la liberté », la condamnation de la noblesse féodale, la subordination des la religion à la politique et à un certain nombre d'autres. Les idéologues les plus perspicaces de la bourgeoisie ont hautement apprécié la méthodologie de Machiavel, en particulier la libération de la politique de la théologie, l'explication rationaliste de l'État et du droit et le désir de déterminer leur lien avec les intérêts du peuple.
10 questions. La doctrine de Jean Bodin sur l'État et le droit.
J. BODIN (1530-1596). Avocat et homme politique, il fut élu du tiers état aux États généraux. C'est un théoricien de l'absolutisme en France. Il est le créateur du droit de l'État. "6 livres sur la république." Pour la première fois, il établit le concept de souveraineté comme un élément obligatoire de l'État.
État- le droit de contrôler de nombreuses familles, investies du pouvoir suprême.
1) L'État agit conformément à la justice, aux lois naturelles et divines.
2) La famille est la base principale de l'État. Le pouvoir domestique s’apparente au pouvoir politique, mais il gouverne le domaine privé, tandis que le gouvernement politique régit la propriété commune. Mais ce pouvoir ne doit pas absorber la vie familiale et la propriété privée. Le pouvoir familial doit être uni et appartenir au mari. Il s'est opposé à l'esclavage.
3) Pouvoir suprême - constante Et absolu. Une personne en autorité peut faire n’importe quelle loi ; elle est soumise à la loi divine et naturelle et est au-dessus des lois humaines.
La structure du pouvoir suprême (forme de gouvernement) :
1) Monarchie
2) Aristocratie
3) Démocratie
Concernant les formes perverties, Boden note qu’il s’agit de qualités différentes des mêmes formes de pouvoir, mais qu’elles ne sont en aucun cas indépendantes. Il rejette également les formes mixtes, car ils perdent face à l’unité du pouvoir.
Boden croyait que la monarchie- meilleure forme. D’autres formes de gouvernement ne peuvent exister que dans les petits États. La monarchie doit certainement être héréditaire et transmise par primogéniture. La succession au trône par une femme n'est pas autorisée car elle est contraire à la loi naturelle. Le partage du pouvoir de l'État entre plusieurs héritiers n'est pas non plus autorisé. Le pouvoir du monarque n'est limité que par la loi divine et naturelle.
Pour maintenir le calme dans l’État, le dirigeant doit se tenir au-dessus des intérêts du parti, et cela ne peut être réalisé que dans une monarchie.
Bodin apprécie hautement le rôle des États généraux, qui représentent les intérêts des trois classes et freinent la volonté du pouvoir suprême de recourir à l'arbitraire et de rendre publics les abus. La prérogative des États généraux de consentir à de nouveaux impôts est particulièrement importante, car Vous ne pouvez pas prendre la propriété d'autrui sans le consentement de son propriétaire. Bodin se contredit donc sur cette question.
Les changements politiques dans l’État ne doivent pas être opérés d’un seul coup. Parmi toutes les raisons qui conduisent aux révolutions, Boden donne la première place à la répartition inégale des richesses.
Considère la religion du point de vue de l'État et des avantages de l'État. Il a jugé nécessaire d'interdire tous les débats sur la religion, car ils ébranlent la vérité dans les esprits et engendrent la discorde. Le pouvoir de l’État doit s’élever au-dessus des différences religieuses et maintenir un équilibre entre elles. Vous ne pouvez forcer personne à croire, c'est-à-dire Boden défend la liberté de conscience.
"Théorie du climat et du sol." La fécondité affecte la différence de droits, car les habitants des terres arides sont plus entreprenants, enclins à l'artisanat et aux arts. Les habitants des terres fertiles n’ont pas de telles motivations. Tout cela se reflète dans structure de l'État: les courageux habitants du Nord et les montagnards ne peuvent supporter aucun gouvernement autre que le régime populaire ou établir des monarchies électives. Les habitants choyés du sud et des plaines se soumettent facilement à l'autorité d'un seul souverain.
…………………….
La théorie de la souveraineté des États. Doctrine politique de J. Bodin
Les guerres de religion ont considérablement entravé le développement de l'industrie et du commerce ; La France se divisait en plusieurs camps hostiles et belligérants.
Jean Bodin (1530-1596) défend l'absolutisme et critique les monarchomaques à l'époque des guerres de religion. Avocat de formation, député du tiers état aux États généraux de Blois, Bodin s'oppose à la décentralisation féodale et au fanatisme religieux. Dans l'essai « Six livres sur l'État » (publié dans Français en 1576, en latin pour toute l'Europe en 1584), Bodin fut le premier à formuler et à largement justifier le concept de souveraineté comme fonctionnalité essentielleÉtat : « La souveraineté est le pouvoir absolu et permanent de l’État… Le pouvoir absolu sur les citoyens et les sujets, non lié par aucune loi. »
Le pouvoir de l'État est permanent et absolu ; c'est la puissance la plus élevée et indépendante tant à l'intérieur du pays que dans les relations avec les puissances étrangères. Au-dessus du détenteur du pouvoir souverain se trouvent seulement Dieu et les lois de la nature.
La souveraineté, selon Bodin, signifie avant tout l'indépendance de l'État vis-à-vis du pape, de l'Église, de l'empereur allemand, des domaines, d'un autre État. La souveraineté en tant que pouvoir suprême comprend le droit de faire et d'abroger des lois, de déclarer la guerre et de faire la paix, de nommer de hauts fonctionnaires, d'exercer la Cour suprême, le droit de grâce, le droit de frapper des pièces de monnaie, d'établir des poids et mesures et de percevoir des impôts.
Dans sa doctrine de l’État, Boden suit en grande partie Aristote, mais non pas l’Aristote déformé et mystifié par la scolastique médiévale, mais le véritable Aristote, interprété à la lumière de l’histoire ultérieure des institutions politiques et juridiques.
Boden définit l’État comme l’administration légale de nombreuses familles et de ce qu’elles ont en commun, sur la base du pouvoir souverain. L’État est précisément une gouvernance légale, conforme à la justice et aux lois de la nature ; par la loi, il diffère, comme l'a noté Cicéron, d'une bande de voleurs ou de pirates, avec lesquels on ne peut pas conclure d'alliances, conclure des accords, faire la guerre ou faire la paix, et qui ne sont pas soumis aux lois générales de la guerre.
Boden considère la famille comme le fondement et la cellule de l'État. L’État est un ensemble de familles et non d’individus ; s’ils ne sont pas unis en familles, ils mourront, mais les gens qui composent l’État ne meurent pas. Comme Aristote, il distingue trois types de relations de pouvoir au sein de la famille : conjugales, parentales et seigneuriales. Contrairement à Aristote, Bodin n’était pas partisan de l’esclavage. Il considérait l'esclavage pas toujours naturel, source de troubles et de troubles dans l'État. Boden prônait l'abolition progressive des relations de dépendance féodale proches de l'esclavage là où elles existaient encore.
Bodin est l'un des premiers critiques de l'utopie. Approuvant certaines réflexions de « l’inoubliable chancelier d’Angleterre T. More » sur l’ordre étatique de l’utopie, Boden conteste obstinément son idée principale. Un État fondé sur la communauté de biens, écrivait Bodin, « serait directement opposé aux lois de Dieu et de la nature ». La propriété privée est liée aux lois de la nature, puisque « la loi naturelle interdit de prendre ce qui appartient à autrui ». « L’égalité de propriété est désastreuse pour les États », répétait inlassablement Bodin. Il existe des riches et des pauvres dans chaque État ; si vous essayez de les égaliser, d’invalider les obligations, d’annuler les contrats et les dettes, « alors vous ne pouvez vous attendre qu’à la destruction complète de l’État, car tous les liens qui unissent une personne à une autre sont perdus ».
Boden attachait une importance primordiale à la forme de l'État. Il rejette la division généralisée des formes étatiques entre correctes et incorrectes, car elle n'exprime qu'une évaluation subjective des États existants. Les partisans du régime d’une seule personne l’appellent « monarchie », les opposants l’appellent « tyrannie ». Les partisans du pouvoir minoritaire appellent ce pouvoir « aristocratie », ceux qui n'en sont pas satisfaits - « oligarchie », etc. Pendant ce temps, raisonnait Bodin, l'essence de la question réside uniquement dans la question de savoir à qui appartient la souveraineté, le pouvoir réel : un, quelques-uns ou la majorité. Sur la même base, Bodin nie la forme mixte de l'État : le pouvoir ne peut pas être divisé « également », certains éléments auront une importance décisive dans l'État ; qui possède autorité suprême faire des lois, c'est l'État dans son ensemble.
Boden avait une attitude négative envers la démocratie : dans un État démocratique, il y a beaucoup de lois et d'autorités, mais la cause commune est en déclin ; la foule, le peuple, ne peut rien établir de bon, persécute les riches, déracine et expulse les meilleurs, élit le pire.
Bodin n'approuvait pas non plus l'aristocratie, un État où le pouvoir appartient à un collège de nobles : parmi les aristocrates personnes intelligentes peu, ce qui entraîne une stupide règle de majorité ; la prise de décision est associée à la discorde, à la lutte des partis et des groupes ; l'État ne réprime pas assez énergiquement l'indignation du peuple, toujours en rébellion contre les nobles. Pour les mêmes raisons, une aristocratie est impensable dans un grand État.
Boden considérait la monarchie comme la meilleure forme d'État. Le monarque, aussi naturellement que le dieu de l'Univers, commande à ses sujets sans interférence ; il possède un pouvoir propre (acquis d'abord par la force, puis transféré par droit d'héritage).
Se référant à la raison et à l’histoire, Bodin a écrit qu’au départ, tous les États ont été créés par la conquête et la violence (et non par un accord volontaire, comme le prétendaient certains combattants du tyran). À la suite d'une guerre juste, des États maîtres (patrimoniaux) sont apparus, dans lesquels le monarque règne sur ses sujets en tant que père de famille. Telles sont les monarchies de l’Orient.
En Europe, raisonnait Bodin, les États maîtres se sont transformés en « monarchies légales », dans lesquelles le peuple obéit aux lois du monarque et le monarque obéit aux lois de la nature, laissant la liberté naturelle et la propriété aux sujets. Le monarque ne doit pas violer les « lois de Dieu et les lois de la nature », qui sont apparues avant tous les États et sont inhérentes à tous les peuples. Le monarque, selon Bodin, doit être fidèle à sa parole, respecter les traités et promesses, les règles relatives à la succession au trône, l'inaliénabilité des biens de l'État, respecter la liberté personnelle, relations de famille, la religion (plus il y en a, mieux c'est - il y aura moins de possibilité de créer des factions belligérantes influentes), l'inviolabilité de la propriété.
Boden a contesté l'opinion largement répandue parmi les combattants du tyran selon laquelle la monarchie devrait être électorale : pendant la période électorale, les troubles, la discorde et les conflits civils sont inévitables ; le monarque élu ne se soucie pas des biens communs, puisqu'on ne sait pas qui lui succédera sur le trône ; La monarchie héréditaire, également traditionnelle en France, ne présente pas ces défauts (les combattants de la tyrannie ont tenté de prouver qu'avant les monarques étaient élus).
Bodin considérait la meilleure monarchie royale - un État dans lequel le pouvoir suprême (souveraineté) appartient entièrement au monarque et la gestion du pays (la procédure de nomination aux postes) est complexe, c'est-à-dire combinant des principes aristocratiques (pour un certain nombre de postes, principalement à la cour et dans l'armée, le roi ne nomme que des nobles) et démocratiques (certains postes sont accessibles à tous).
Question 11. Le socialisme utopique en Angleterre au XVIe siècle. (« Utopie » de T. More).
Initialement, les idées du socialisme étaient enveloppées dans les pensées des auteurs éthiques chrétiens sur le royaume de Dieu. Comment l'idée complète s'est développée aux XVIe et XVIIe siècles. C’est l’époque de l’émergence de nouvelles formes d’exploitation capitalistes.
T. MOR (1478-1535) le fondateur de l'idée. En 1516 fut publié le « Livre d’Or, aussi utile qu’amusant, sur la meilleure structure de l’État et sur la nouvelle île de l’utopie ». Thomas More est avocat de formation ; « Utopia » a été créé par lui lors d'un voyage en Flandre dans le cadre de l'ambassade.
« Utopie » est traduit du grec par « un lieu qui n'existe pas ». Partie 1 - critique des vices politiques et sociaux des États européens modernes. La deuxième partie concerne l'île inexistante d'Utopia.
Indique un grand nombre de nobles qui volent le peuple, les autorités, au lieu de punir les coupables, attaquent les pauvres avec des lois sanglantes. L’État est une conspiration des riches qui défendent leur bien-être sous le couvert de l’État. La propriété privée est mauvaise.
L'île de l'Utopie n'est pas loin de l'Amérique, sur laquelle 54 villes vivent dans un communisme complet. La famille est l'unité sociale de base. En ville, la famille exerce un certain métier. Dans une famille de village il y a 40 adultes (en ville - de 10 à 16 personnes), si un enfant veut s'adonner à un autre métier, il doit être adopté par une autre famille.
Autour de la ville se trouvent des champs cultivés un par un par les habitants. Une partie des citadins s'y installe, laissant la place à ceux qui, après 2 ans de travail aux champs, reviennent en ville. Tous les produits fabriqués sont transportés vers des maisons publiques, d'où le chef de famille reçoit tout le nécessaire pour la famille. Ils déjeunent dans des salles à manger communes. Journée de travail 6 heures.
L’augmentation de la productivité et de l’abondance s’explique par :
1. L'absence de désœuvrés (riches, guerriers, mendiants)
2. Les femmes travaillent comme les hommes
3. Les fonctionnaires et ceux appelés à s'engager dans la science sont exemptés du travail physique. S'ils ne se justifient pas, ils sont renvoyés au travail physique.
4. Il y a moins de besoins eux-mêmes, car il n'y a pas de caprices vides de sens ni de besoins imaginaires. Tout le monde porte les mêmes vêtements, les maisons sont tirées au sort ; l'or et l'argent ne sont conservés qu'en cas de guerre extérieure.
Il n'y a pas de communauté d'épouses. Les mariages sont strictement protégés par la loi et sont indissolubles. Le divorce est possible en cas d'adultère du conjoint ou de difficultés de caractère insupportables. La personne responsable du divorce ne peut pas se remarier. Une insulte à l’union matrimoniale est l’esclavage à vie.
Un travail désagréable est effectué par des esclaves et des personnes dévouées. Esclaves - ceux reconnus coupables d'un crime et rachetés à l'étranger, condamnés à mort, ainsi que les prisonniers de guerre capturés les armes à la main.
La gouvernance de 54 villes s'effectue sur une base élective. Tous les fonctionnaires sont élus pour 1 an à l'exception du prince qui est élu à vie. Les affaires importantes de la ville sont décidées par l'Assemblée des fonctionnaires, et parfois par l'Assemblée populaire.
30 familles élisent phylarque. A la tête des 10 phylarques se tient protophylarque.
Chef d'état prince et C enat(situé dans la capitale pour résoudre les affaires générales) trois députés de chaque ville.
Les religions des utopistes sont différentes, mais elles convergent toutes vers le culte d’une seule divinité. Il y a peu de lois, pas d'avocats.
La structure sociale de l’utopie repose sur 2 principes qui étaient niés dans le monde antique : l'égalité des personnes et le caractère sacré du travail.
1. Faites correspondre la date et l'événement.
1-c, 2-d, 3-a, 4-d, 5-b
2. Les conséquences de l'idée de Luther de justification par la foi n'incluent pas :
5 - Les conséquences de l'idée de Luther de justification par la foi n'incluent pas la pratique de la vente d'indulgences.
3. Déterminez quelles caractéristiques s'appliquent à Martin Luther et lesquelles à Jean Calvin.
Martin Luther - e, b, a
Jean Calvin - c, d, d
4. Établir une correspondance entre les termes et leurs définitions.
1-b, 2-d, 3-d, 4-a, 5-c
5. Les manifestations de la Contre-Réforme ne comprennent pas :
4 – Brûler sur le bûcher de Miguel Servet
6. Faites correspondre la date et l'événement.
1-b, 2-c, 3-a, 4-d
7. Déterminez lequel des énoncés suivants s’applique au règne d’Henri 4 et lequel s’applique à Louis 14.
Henri IV Bourbon - a, b
Louis 14 - d, b
8. Grâce à l'argent entrant dans le trésor américain, les dirigeants espagnols ont pu :
Page 34
9. Sur les raisons du déclin de l'économie espagnole au XVIIe siècle. n'est pas applicable:
10. Faites correspondre la date et l'événement.
1-b, 2-a, 3-d, 4-c
11. Les raisons de la lutte de libération des Pays-Bas contre l'Espagne ne comprennent pas :
2 - rentable position géographique Pays-Bas.
12. Sur les raisons du « miracle économique » néerlandais du XVIIe siècle. n'est pas applicable:
3 – de riches ressources naturelles
13. Pour la « nouvelle noblesse » en Angleterre des XVIe et XVIIe siècles. pas typique :
5 - la volonté, avant tout, de chercher des sources de revenus dans le service royal ;
6 - désir d'acquérir de l'influence au parlement.
Page 35
14. Faites correspondre la date et l'événement.
1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-d, 6-a
15. Déterminez lesquels des problèmes énumérés qui se posaient en Angleterre à la veille de la révolution de 1640-1660 concernaient les sphères de la politique, de l'économie et de la religion.
Politique - a, b, d
Économie - d, c, b
Religion - e, c, d
16. Établir une correspondance entre la date d'adoption du document et son titre.
1-d, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b
Page 36
17. Établir une correspondance entre le titre du document et son contenu.
1-d, 2-a, 3-d, 4-c, 5-b, 6-d
18. Déterminez lequel des énoncés suivants s'applique au règne de Ferdinand 1er de Habsbourg et lequel s'applique au règne de son petit-fils Rodolphe 2.
Ferdinand - a, d, c, f
Rodolphe - c, a, b, d
19. Faites correspondre la date et l'événement.
1-d, 2-c, 3-b, 4-a, 5-d
Page 37
20. Guerres italiennes 1494-1559. ont été réalisés :
4 – Espagne et France
21. Les causes de la guerre de Trente Ans ne comprennent pas :
22. Quels facteurs se rapportent à Érasme de Rotterdam, lesquels – à Niccolò Machiavel, et lesquels – à Thomas More.
Erasmus de Rotterdam - b, d
Niccolo Machiavel - a, g
Thomas More - v, e
23. Quels faits concernent Miguel de Cervantes et lesquels concernent William Shakespeare.
Miguel de Cervantès - a, b, d
William Shakespeare - c, d, f
Page 38
24. Quelles déclarations font référence à Rembrandt Harmens van Rijn et lesquelles font référence à Diego Velazquez.
Rembrandt Harmens van Rijn - d, a, v
Diego Velazquez - b, d, f
25. Selon quel principe les lignes sont-elles compilées ?
1 – Artistes de la Renaissance
2 – Artistes de la Renaissance du Nord
3 – les plus grands représentants du style baroque
4 – ère du classicisme (théâtre)
26. Établir une correspondance entre les noms des scientifiques des XVIe-XVIIe siècles. et les découvertes qu'ils ont faites.
Changements en Europe aux XVIe et XVIIe siècles :
1) Les bases du mode de production capitaliste étaient posées. Des usines sont construites parce que le capital libre et les travailleurs salariés sont apparus.
2) Les grandes découvertes géographiques ont apporté des revenus fabuleux à l'Europe. Le développement du commerce international a renforcé l'économie.
3) La nécessité d'un nouveau police étrangère(expansion coloniale). Renforcé gouvernement central, est en cours d'installation en Europe absolutisme(une forme de gouvernement dans laquelle le monarque a un pouvoir illimité).
4) Les premières révolutions bourgeoises ont lieu, qui mèneront à la chute de l'autocratie, les premières républiques bourgeoises sont établies, dans lesquelles les droits de l'homme et les libertés sont respectés.
5) L'influence de l'Église a été affaiblie, ce qui a entraîné un développement rapide de l'éducation, de la science, de la philosophie, de l'art et de la littérature.
Modernisation- c'est le renouvellement des moyens de production en lien avec le progrès technique, l'émergence de nouvelles technologies, machines et mécanismes.
Renaissance(Renaissance) est une ère de la culture européenne où la culture du Moyen Âge est remplacée par la culture des temps modernes. L'intérêt pour l'Antiquité, l'architecture des palais, les vacances joyeuses, etc., est ravivé depuis le XVe siècle.
Réformation(traduit par transformation) est un mouvement religieux de masse en Europe visant à transformer le christianisme catholique.
Idéologues - Martin Luther (1483-1546) et Jean Calvin (1509 - 1564).
Ils s'opposaient au rôle médiateur de l'Église entre Dieu et l'homme, contre les impôts ecclésiastiques et la propriété foncière monastique. À la suite de la réforme, un nouveau mouvement apparaîtra église chrétienne- Le protestantisme, qui s'est imposé comme religion d'État dans la plupart des pays européens : Allemagne, Angleterre, France et Navarre (mouvement huguenot), Suisse, Hollande, Danemark, Suède, etc.
Question 2. La transition de la société traditionnelle à la société industrielle en Europe aux XVIe et XVIIe siècles.
L'Europe occidentale est la première civilisation dans laquelle les premières relations bourgeoises sont nées, se sont renforcées et ont remporté la victoire, c'est-à-dire un changement de formation s'est produit - du féodalisme au capitalisme (et si nous utilisons une approche civilisationnelle - une transition d'une société traditionnelle à une société industrielle). Ils sont apparus pour la première fois en grand villes commerçantes Italie à la fin du XIVe siècle. Aux XVe-XVIe siècles. s'est répandu dans de nombreux pays d'Europe occidentale : Allemagne, France, Angleterre, Espagne et Portugal. Au fil du temps, ce processus a touché la majeure partie du monde.
1) Société traditionnelle caractérisé par la prédominance de l’agriculture rurale de subsistance et de l’artisanat primitif. Dans de telles sociétés, la voie extensive du développement et le travail manuel prédominent. La propriété appartient à la communauté ou à l'État. La propriété privée n'est ni sacrée ni inviolable. Structure sociale la société traditionnelle est une société de classe, stable et immobile. Il n'y a pratiquement aucune mobilité sociale. Le comportement humain dans la société est régi par les coutumes, les croyances et les lois non écrites. La sphère politique est dominée par l’Église et l’armée. La personne est complètement étrangère à la politique. Le pouvoir lui semble avoir une plus grande valeur que le droit et la loi. La sphère spirituelle de l’existence humaine a la priorité sur la sphère économique.
2)B société industrielle La base est l’industrie basée sur les machines et la voie du développement intensif prévaut. Une croissance économique stable s'accompagne d'une augmentation du revenu réel par habitant. Dans le domaine social, c'est important la mobilité sociale. Le nombre de paysans diminue fortement et l'urbanisation est en cours. De nouvelles classes émergent : le prolétariat industriel et la bourgeoisie. Les humains se caractérisent par des signes d’individualisme et de rationalisme. Il y a une sécularisation de la conscience. Dans le domaine politique, le rôle de l'État augmente et un régime démocratique émerge progressivement. La société est dominée par le droit et le droit.
Signes de féodalité :
- agriculture de subsistance, travail manuel;
- la présence de deux classes - les seigneurs féodaux et paysans dépendants;
- les seigneurs féodaux possèdent les moyens de production, les paysans possèdent personnellement les outils et accomplissent diverses tâches en faveur des seigneurs féodaux.
Signes du capitalisme :
- relations marchandise-argent, travail mécanique ;
- la présence de deux classes : la bourgeoisie et le prolétariat ;
- La bourgeoisie possède les moyens de production, le prolétariat est personnellement libre et est contraint de vendre sa capacité de travail.
Question 3. Grandes découvertes géographiques et début de l’expansion coloniale européenne.
Les navigateurs les plus célèbres et leurs découvertes.
1) Bartolomeo Dias (1488) – Portugais.
Il fut le premier Européen à contourner l’Afrique jusqu’en Inde.
2) Christophe Colomb (1492)
Découverte de l'île d'Haïti (Cuba), de San Salvador et de la mer des Sargasses. Il fut déclaré roi des terres annexées en Amérique.
3) Amérigo Vespucci (1499-1504)
Il fut le premier à deviner que l'Amérique n'est pas l'Inde, mais un nouveau continent et découvrit le Brésil.
4) Vasco de Gama (1497-1498)
J'ai voyagé en Inde à travers l'Afrique. Grâce à lui, la colonisation portugaise de l'Inde commence.
5) Ferdinand Magellan (1519-1521)
Premier tour du monde.
6) Hernan Cortes - conquistador espagnol, conquérant du Mexique (1519-1521). Il a traité brutalement les tribus indiennes.
7) Ermak, Vasily Polyakov, Semyon Dejnev, Erofey Khabarov (1581-1640) -
développement de la Sibérie.
8) Guillaume Barents (1596-1597)
Découverte de la mer de Barents et de l'île du Spitzberg.
Le sens des grandes découvertes géographiques :
1) Percée dans l’économie.
2) Nouveau en culture, zoologie, botanique, ethnographie.
3) De nouveaux produits alimentaires apparaissent : pommes de terre, maïs, tomates, tabac, café, cacao, chocolat, cola et caoutchouc.
Question 4. L'Europe au XVIIe siècle : État et pouvoir. Diplomatie. Système de coalition.
Que se passait-il en Europe au XVIIe siècle ?
La formation d'États centralisés, les guerres de religion, la famine, les révolutions. La première révolution bourgeoise a eu lieu en Hollande en 1566. En conséquence, la Hollande, qui était une colonie espagnole, a obtenu son indépendance, a créé un parlement et est devenue le meilleur pays européen en matière de commerce et de construction navale.
La dynastie des Valois règne, mais tous les rois – François II et Charles Ier – ne règnent pas longtemps et meurent sans enfants. En 1572, à l'initiative de la reine mère Catherine de Médicis, eut lieu la Nuit de la Saint-Barthélemy, au cours de laquelle tous les huguenots (protestants) venus à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois furent tués. Après la mort du dernier roi de la dynastie des Valois, Henri III, mort jeune et sans enfant, la dynastie prend fin.
Les rois de France les plus célèbres
Henri IV de Navarre (1594-1610) devient roi de France et fonde la nouvelle dynastie des Bourbons. Son fils Louis XIII (1610-1643) dissout le parlement – les États généraux. Sous lui, le pays était dirigé par un brillant homme politique qui a assuré la prospérité de la France - le cardinal Richelieu. Louis XIV (1643-1715) bâtit Versailles et renforça l'absolutisme. Son fils Louis XV (1715 – 1774) poursuit sa politique. Son petit-fils Louis XVI fut exécuté par les Jacobins en janvier 1793. En octobre de la même année, son épouse Marie-Antoinette est exécutée.
Allemagne.
Le berceau de la Réforme : Martin Luther et Jean Calvin, les idéologues du protestantisme, ont vécu en Allemagne.
La guerre la plus célèbre du XVIIe siècle fut la guerre de Trente Ans, à laquelle participèrent tous les pays européens. (1618-1648).
Question 5. Révolution anglaise (1640-1649).
En 1640, l’Angleterre était une puissance leader et possédait une marine de premier ordre. Les nobles voulaient le transfert du pouvoir législatif au Parlement, qui fut dissous par le roi Charles Ier en 1628. Le soulèvement fut dirigé par Oliver Cromwell, qui créa une armée parlementaire, vainquit les troupes royales et captura le roi Charles Ier, qui fut exécuté par le tribunal en 1649.
L'Angleterre est devenue une république. Cromwell présida le Haut Conseil et fut Lord Protecteur jusqu'à sa mort en 1658. Le fils d'Oliver Cromwell ne parvient pas à conserver le pouvoir et la guerre civile recommence en Angleterre.
En 1688, un coup d'État a eu lieu en Angleterre, établissant une monarchie constitutionnelle avec un pouvoir limité du roi. Le souverain de Hollande, Guillaume d'Orange, fut élu roi.
Question 6.« Absolutisme éclairé » en Autriche, Prusse, Russie.
« L'absolutisme éclairé » est une forme de gouvernement des XVIIe et XVIIIe siècles, dans laquelle le monarque a le pouvoir absolu, mais dans ces États, les gens se sentent libres. La presse imprime presque librement. Beaucoup apparaissent les établissements d'enseignement, Académie des Sciences. Financé Recherche scientifique et expéditions. Empereurs et impératrices correspondaient avec les philosophes et éclaireurs les plus célèbres (Voltaire, Denis Diderot).
Exemples : Autriche (Marie-Thérèse (1765-1780)), Prusse (Frédéric II (1740-1786)), France (Louis XIV (1643-1715)), Russie (Catherine II (1762-1796)).
Question 7. Siècle des Lumières : Théorie de l’égalité sociale. Culte de la Raison.
Le siècle des Lumières est le XVIIIe siècle qui a donné à l’Europe la liberté d’expression et l’épanouissement de la philosophie, de la science, de la culture et de l’éducation.
Aux XVIe-XVIIIe siècles. Les découvertes géographiques élargissaient constamment les horizons des Européens : le monde s'étendait rapidement. Si au 15ème siècle. Les terres bien connues en Europe s'étendaient de l'Inde à l'Irlande, puis au début du XIXe siècle, les Espagnols, les Anglais, les Néerlandais et les Français possédaient le monde entier. La série de découvertes exceptionnelles commencées par Nicolas Copernic s'est poursuivie avec les travaux d'Isaac Newton, qui a formulé la loi de la gravitation universelle. Grâce à leurs travaux, à la fin du XVIIe siècle. l'ancienne image du monde est devenue hier, même aux yeux des gens ordinaires : la Terre - le centre biblique de l'univers - du centre de l'Univers est devenue l'un des rares satellites du soleil ; le Soleil lui-même s’est avéré n’être qu’une des étoiles qui complètent le Cosmos sans fin.
C'est comme ça que je suis né science moderne. Il rompit le lien traditionnel avec la théologie et proclama comme fondements l’expérimentation, le calcul mathématique et l’analyse logique. Cela a conduit à l'émergence d'une nouvelle science mondiale, dans laquelle les concepts d'« esprit », de « nature », de « loi naturelle » sont devenus les principaux. Désormais, le monde est perçu comme un gigantesque mécanisme complexe fonctionnant selon les lois exactes de la mécanique (ce n'est pas un hasard si les montres mécaniques étaient une image favorite dans les écrits des hommes politiques, des biologistes et des médecins au XVIIe et au début du XVIIIe siècle). . Dans un système qui fonctionnait si bien, il n’y avait presque pas de place pour Dieu. On lui a confié le rôle d’initiateur du monde, de cause profonde de toutes choses. Le monde lui-même, comme s'il avait reçu une impulsion, s'est ensuite développé de manière indépendante, conformément aux lois naturelles, que le Créateur a créées comme universelles, immuables et accessibles à la connaissance. Cette doctrine s'appelait déisme, eut de nombreux adeptes parmi les naturalistes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Mais l’étape la plus importante que la nouvelle philosophie a osée franchir a peut-être été la tentative d’étendre les lois en vigueur dans la nature à la société humaine. Une conviction a émergé et s'est renforcée : l'homme lui-même et la vie sociale sont soumis à des lois naturelles immuables. Il suffit de les découvrir, de les enregistrer et de parvenir à une exécution précise et universelle. Une voie a été trouvée pour créer une société parfaite construite sur des fondations « raisonnables » – la clé du bonheur futur de l’humanité.
La recherche des lois naturelles du développement social a contribué à l'émergence de nouveaux enseignements sur l'homme et l'État. L'un d'eux - théorie du droit naturel, développé par les philosophes européens du XVIIe siècle. T. Hobbes et D. Locke. Ils proclamèrent l’égalité naturelle des personnes, et donc le droit naturel de chacun à la propriété, à la liberté, à l’égalité devant la loi et à la dignité humaine. Sur la base de la théorie du droit naturel, une nouvelle vision de l'origine de l'État s'est formée. Le philosophe anglais Locke pensait que la transition de personnes autrefois libres vers la « société civile » était le résultat d'un « contrat social » conclu entre les peuples et les dirigeants. Ces derniers, selon Locke, sont transférés à une partie des « droits naturels » des concitoyens (justice, relations extérieures, etc.). Les dirigeants sont tenus de protéger d’autres droits : la liberté d’expression, de religion et le droit à la propriété privée. Locke a nié l’origine divine du pouvoir : les monarques doivent se rappeler qu’ils font partie de la « société civile ».
Toute une époque a commencé dans l’histoire de la culture occidentale, apportant avec elle une nouvelle compréhension du monde et de l’homme profondément différente de la compréhension médiévale. Elle a été nommée L'âge de l'illumination- au nom d'un puissant mouvement idéologique apparu au milieu du XVIIIe siècle. largement couvert les pays d'Europe et d'Amérique. Aux XVIIIe-XIXe siècles. elle a eu une forte influence sur la science, la pensée sociopolitique, l'art et la littérature de nombreux peuples. C'est pourquoi le XVIIIe siècle est entré dans l'histoire Âge de raison, âge des Lumières.
Ce mouvement était représenté par d'éminents philosophes, scientifiques, écrivains, hommes d'État et personnalités publiques différents pays. Parmi les éducateurs se trouvaient des aristocrates, des nobles, des prêtres, des avocats, des enseignants, des marchands et des industriels. Ils pouvaient avoir des points de vue différents, parfois opposés sur certains problèmes, appartenir à des religions différentes ou nier l'existence de Dieu, être de fervents républicains ou partisans de légères restrictions imposées à la monarchie. Mais ils étaient tous unis par des objectifs et des idéaux communs, une croyance en la possibilité de créer une société juste par des moyens pacifiques et non violents. "L'illumination des esprits", dont le but est d'ouvrir les yeux des gens sur les principes rationnels de l'organisation de la société, de faire progresser leur monde et eux-mêmes - telle est l'essence de l'illumination et sens principal activités des éducateurs.
Question 8. Progrès technologique et grande révolution industrielle en Europe au XVIIe siècle.
Les découvertes géographiques se poursuivent. Des villes, des usines, des usines sont construites, de nouvelles machines, une machine à vapeur, un convoyeur et d'autres innovations techniques apparaissent. Navires, nouvelles armes, tactiques de combat.
La révolution industrielle est une conséquence du progrès scientifique et technologique et développement socialÉtats européens, notamment l’Angleterre.
En historiographie, la révolution industrielle est comprise comme un ensemble de changements scientifiques, techniques, économiques, sociaux et politiques ou de changements profonds qui ont marqué le passage de l'étape de production manufacturière au système d'usine de production capitaliste ou socialiste, basé sur un système de production. machines ou technologie des machines. Grâce à la révolution industrielle, l’économie capitaliste de marché a reçu sa base technique. Il s'agit d'une société basée sur la propriété privée et économie de marché et la production capitaliste s'est finalement établie dans les pays où a eu lieu cette révolution. S'exprimant dans un langage marxiste, cette formation a reçu une base et a trouvé ses marques. La révolution industrielle a pris sa forme la plus clairement classique en Angleterre, à partir de laquelle tout le monde part comme étalon de mesure. Cela était dû au fait qu'en Angleterre les conditions nécessaires à cet effet étaient réunies plus tôt.
Les conditions scientifiques et techniques ont été abordées lors de la dernière conférence. C’est l’invention des machines de travail qui a donné naissance à la révolution industrielle à partir des années 1760.
Et les conditions socio-économiques sont : le développement de processus d’accumulation initiale de capital, ce qui signifie la formation de deux pôles. Pôle supérieur : capital qui nécessite son utilisation, sinon ce sera un « coffre de chevalier avare ». Et en dessous se trouvent d’énormes masses de moyens de production bon marché et des gens qui vendent leurs mains, leur travail.
Ce processus d'accumulation primitive a été le plus profond en Angleterre, à la suite de la dépaysantisation des campagnes, de l'enfermement et de la formation d'un marché foncier, conséquence de deux révolutions : la Grande et Glorieuse Révolution du XVIIe siècle.
En termes de degré de transformation de la société qu'ont subi les pays européens, les contemporains comparent très souvent ce coup d'État à une profonde révolution politique. Par conséquent, en historiographie, en plus du terme révolution industrielle, le terme révolution industrielle est souvent utilisé.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la révolution industrielle a commencé en Angleterre dans les années 60.
1769 Arkwright invente le moteur à eau et crée la première usine, employant plusieurs centaines de personnes. Et après 20 ans en Angleterre, où la population est d'environ 6 millions d'habitants, soit à la fin des années 1780 du XVIIIe siècle, 143 filatures similaires étaient en activité. Chacun d'eux tourne 700-800 et plus de gens. Il s’agit de tout le prolétariat industriel, principalement des femmes et des enfants pour l’instant.
L’invention du métier à tisser a conduit au développement non seulement de l’industrie de la filature du coton, mais également de l’industrie du tissage du coton. Il y a des progrès technologiques, des progrès dans industrie chimique, car les tissus doivent être blanchis, teints, etc.
L'invention de la machine à vapeur à double action de Watt, la version finale, qui a donné à l'Angleterre une augmentation de 11 % à la fin du XVIIIe siècle produit brut, entraîne une augmentation de la demande de métal, puisque les machines-outils et les machines à vapeur sont fabriquées à partir de métal. Ainsi, le progrès technique couvre les industries métallurgiques, ferreuses, non ferreuses, etc.
C’est ainsi qu’une révolution dans les transports s’amorce au début du XIXe siècle. Invention du transport à vapeur sur roues, bateau à vapeur. Le début de cette révolution conduit à l'émergence de centres industriels dans le pays, en Angleterre, puis dans d'autres pays, où ces usines sont concentrées, et la population active augmente, qui travaille 14 à 16 heures dans ces usines du matin au nuit. Le marché des produits agricoles est en croissance. Ainsi, autour de ces centres, comme Birmingham et Manchester en Angleterre, des zones de Agriculture, le jardinage, la production de viande et la production laitière qui approvisionnent ces villes en pleine croissance.
Les progrès de l'industrie en Angleterre, la demande mondiale pour ces machines et produits de l'industrie industrielle conduisent au fait que déjà dans le premier tiers du XIXe siècle, l'Angleterre est devenue « l'atelier du monde », fournissant des marchandises à l'ensemble du monde. de l'Europe et du monde entier.
La croissance de la puissance économique contribue à la puissance politique et militaire croissante de l’Angleterre. Tout cela conduit à un changement rapide de la démographie et de la géographie économique de l’Angleterre.
Démographie : la population des îles britanniques en 1756 était de 5 millions 590 000 personnes. Dans 100 ans – déjà environ 16 millions de personnes ! La vie est devenue meilleure et le processus a commencé. Et cela malgré le fait que l'Angleterre est constamment en guerre et qu'un énorme flux de migrants en provenance des îles britanniques va n'importe où pour une vie meilleure : vers l'Australie, les États-Unis, le Canada.
Changements géographiques : à partir de pratiquement rien, de lieux que seuls les gens connaissent
Question 9.Éducation aux États-Unis.
Éducation aux États-Unis.
À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis étaient constitués de 13 colonies indépendantes : les colonies du nord avaient développé leur production, les colonies du sud avaient une production de plantations avec du travail esclave. La cause de la guerre d’indépendance était la politique de pillage des colonies menée par l’Angleterre. En 1774, le premier congrès continental se réunit à Philadelphie et approuva la pétition pour l'indépendance. En réponse, l'Angleterre lança des opérations militaires, mais fut vaincue par les troupes de George Washington. En conséquence, l’Angleterre fut contrainte de reconnaître l’indépendance des États-Unis.
1781 - Articles de la Confédération, établissant une union de treize États.
1787 - adoption de la Constitution américaine (toujours en vigueur).
1791 - Déclaration des droits - les 10 premiers amendements à la Constitution contenant les droits et libertés de l'homme.
Question 10. Révolution française du XVIIe siècle.
Grande révolution bourgeoise (1789 - 1799)
Étapes de la révolution :
1) 14 juillet 1789 - prise de la Bastille. Le soulèvement s'étend à toute la France, le roi est arrêté.
3) Coup d'État et dictature jacobine 1793 : exécution du roi et de la reine. Massacres de nobles. Une guillotine est une machine spéciale pour couper les têtes. Jacobins - Danton, Robespierre, Marat, Desmoulins - chefs des Jacobins qui ont initié la terrible terreur. En 7 mois de 1793, 4 millions de personnes furent exécutées à Paris ! Tous les dirigeants jacobins furent ensuite exécutés.
4) Coup d'État du 9 thermidor. Définition du mode Répertoire. Accepté en France nouvelle constitution. Le pays est dirigé au lieu du Parlement par le Conseil des Cinq-Cents. La guerre continue.
5) Le coup d'État du 18 brumaire (9 novembre 1799) et l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte. Napoléon et ses gardes dispersèrent le Conseil des Cinq-Cents et dirigèrent le gouvernement provisoire. Trois consuls assurent la présidence : Napoléon Bonaparte, Roger Ducos et Sieyès. Bientôt, deux autres consuls transférèrent les pouvoirs d'urgence à Napoléon. Napoléon devint bientôt empereur, mais il conserva le Parlement, la constitution et toutes les réalisations démocratiques de la révolution.
LITTÉRATURE PRINCIPALE
1. Fortunatov V.V. "Histoire". Didacticiel. Norme de troisième génération. Pour bacheliers et spécialistes. SPb., PETER, 2014. 464 p. 1 exemplaire
2. Samygin P.S., Samygin S.I., Shevelev V.N. "Histoire". Didacticiel. M., NIC INFRA-M, 2013. 528 p. 1 exemplaire
3. Artemov V.V., Lubchenkov Yu.N. "Histoire de la Patrie de l'Antiquité à nos jours." Manuel pour les étudiants des établissements d'enseignement professionnel secondaire. M., Maison d'édition « Maîtrise », 2012. 360 p. 19 exemplaires
LITTÉRATURE SUPPLÉMENTAIRE
1. Apalkov V.S., Minyaeva I.M. "L'histoire de la patrie". Didacticiel. 2e édition. M., Alpha-M ; SIC INFRA-M, 2012. 544 p. 1 exemplaire
2. Kouznetsov I.N. "L'histoire de la patrie dans les tests - préparation à l'examen d'État unifié." Rostov-sur-le-Don, Phoenix, 2012. 224 p. 2 exemplaires
3. Moryakov V.I., Fedorov V.A., Shchetinov Yu.A. "Fondements du cours de l'histoire russe." Cahier de texte.
M., TK Welby, Maison d'édition Prospekt, 2013. 464 p. 1 exemplaire
4. Klyuchevsky V.O. " Cours complet L'histoire de la Russie dans un seul livre." M., AST ; Astrel-SPb., 2012. 510 p. 6 exemplaires
5. Soloviev S.M. "Histoire de la Russie depuis l'Antiquité". M., Eksmo, 2011. 1024 p. 8 exemplaires
6. Vassiliev L.S. " Histoire générale" Manuel en 6 volumes. M., lycée, 2010. Tome 1. 448 p. Tome 3. 606 p. 1 exemplaire
7. Boguslavski V.V. « Les dirigeants de la Russie : dictionnaire biographique ». M., OLMA PRESS Grande Couverture, 2012. 912 p. 2 exemplaires