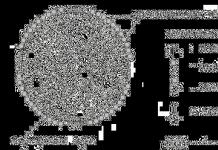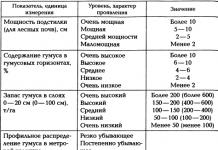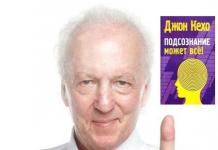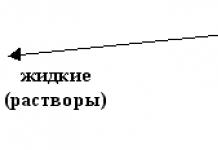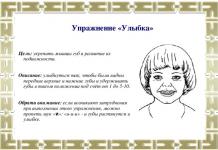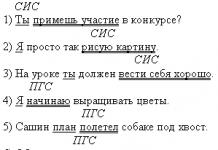Vladimir Dergachev
L'Empire austro-hongrois a existé de 1867 à 1918. et n'avait aucune possession à l'étranger. La population de l'empire en 1910 était de 52 millions d'habitants, dont 23,5% d'Autrichiens, 19,1% de Hongrois, 16,5% de Tchèques et de Slovaques, 10,5% de Serbes et de Croates, 10% de Polonais, 8% d'Ukrainiens et 8% de Roumains. 6,5%, Slovènes - 2,5% et autres 3,4%. L’Autriche-Hongrie multinationale, contrairement à l’ancien despotisme des Habsbourg, a été reconstruite en un État fédéral. Les Hongrois et les Polonais avaient le droit à l'autonomie gouvernementale. Le niveau de liberté politique en Autriche-Hongrie était impensable pour la Russie tsariste, mais les Slaves détestaient passionnément le « patchwork » et l’empire multitribal et s’enfuyaient vers leurs appartements nationaux à la première occasion. Pourquoi ce prototype de « maison commune européenne » s’est-il révélé fragile ?

L'Autriche-Hongrie se distinguait par une croissance économique modérée et était un État agraire-industriel moyennement développé doté d'un énorme appareil bureaucratique. Des événements caractéristiques ont eu lieu ici. Europe de l'Ouest processus de concentration de la production et du capital. L'empire était en avance sur la Grande-Bretagne et la France dans la production d'acier, mais sa puissance économique et militaire n'était pas comparable à celle des puissances mondiales. La principale caractéristique de l’économie impériale était l’autosuffisance. La production nationale n'a pas connu la concurrence internationale, ce qui n'a pas stimulé le développement de nouvelles technologies : de nombreux produits locaux étaient de qualité inférieure à ceux étrangers. Échange international peu développée, il existait une forte différenciation des niveaux de vie entre la capitale et les provinces. Ainsi, les salaires dans l'industrie à Vienne étaient deux fois plus élevés qu'en Galice.
La Vienne autrichienne conserve encore la splendeur de la capitale impériale de l'époque des Habsbourg. Stefan Zweig a écrit : « Dans presque aucune autre ville d'Europe la soif de culture n'était aussi passionnée qu'à Vienne... Les Romains fondèrent cette ville comme une citadelle, comme un avant-poste pour protéger la civilisation latine des barbares, et plus d'un millier de Des années plus tard, les murs furent brisés par le mouvement ottoman vers l'ouest. Ici se sont précipités les Nibelungen, ici une galaxie immortelle de musiciens a brillé sur le monde : Gluck, Haydn et Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann Strauss ; Tous les courants de la culture européenne ont convergé ici... »
L'Autriche-Hongrie, la plus grande force armée d'Europe, était juste derrière Empire russe. L'armée était composée de formations militaires mixtes et composition nationale, qui joua un rôle fatal dans le sort de l'empire. L’Autriche-Hongrie a survécu à l’ère napoléonienne et a résisté à l’assaut de fer de Bismarck, mais en 1918, elle s’est effondrée du jour au lendemain en États séparés, notamment multinationaux (Yougoslavie et Tchécoslovaquie).
L'effondrement de la double monarchie a été facilité par le rayonnement de l'esprit national, mais l'avenir des États nouvellement recréés n'était pas si rose. La renaissance de l’identité nationale n’a pas conduit à l’émergence de nouvelles puissances européennes faisant autorité. Un État national (par langue) est un phénomène plutôt rare dans l’histoire. La conscience nationale, selon Georgy Fedotov, s'efforce de perpétuer le chaos et n'est pas capable d'organiser le monde.
C'est ainsi que le Premier ministre anglais David Lloyd George (1863 - 1945) a décrit les conséquences de l'effondrement imprévu de l'Autriche-Hongrie et de l'anarchie en Europe centrale dans ses mémoires « La vérité sur les traités de paix » : « Aux auteurs Traité de Paris la question à résoudre n’était plus de savoir ce que les peuples libérés devraient recevoir en justice, mais ce qui exactement, dans l’intérêt de la simple justice, devrait être libéré de leurs griffes tenaces lorsqu’ils franchissaient les frontières de l’autodétermination nationale. Pendant que les délégués des grandes puissances discutaient des dispositions du traité de paix avec l'Allemagne, des dizaines de petites guerres se déroulaient en différents endroits de l'Europe et parfois avec une telle acharnement « comme si l'homme était redevenu barbare, comme aux jours difficiles de l'Allemagne ». Tamerlan et Attila. Les peuples nouvellement libérés de l'Europe du Sud étaient prêts à se ronger la gorge à la recherche des meilleurs morceaux de l'héritage des empires morts... La Pologne s'imaginait à nouveau comme la maîtresse indivise de l'Europe centrale. Le principe de l'autodétermination ne correspondait pas à son harcèlement. Elle a exigé que la Galice, l'Ukraine, la Lituanie et certaines parties de la Biélorussie... Le droit des peuples à déterminer eux-mêmes nationalité a été immédiatement rejetée par les dirigeants polonais. Ils affirmaient que ces différentes nationalités appartenaient aux Polonais par droit de conquête exercé par leurs ancêtres. Comme le vieux baron normand qui tirait son épée lorsqu'on lui demandait de justifier de ses droits sur le domaine, la Pologne brandissait l'épée de ses rois guerriers, qui rouille depuis des siècles dans leurs tombeaux... "
Les petits États nationaux d’Europe de l’Est n’ont pas réussi à s’intégrer avec succès dans l’économie européenne. Avant l'indépendance, les 3/4 étaient concentrés dans la seule République tchèque production industrielle L'Autriche-Hongrie et, selon un certain nombre d'indicateurs, la Tchécoslovaquie au début des années 20 était l'un des dix pays industriels les plus développés au monde. Cependant, l’intégration accélérée au capital européen fut suspendue par la crise économique de 1929.
Le célèbre penseur hongrois I. Bibo, dans son article « La pauvreté de l'esprit des petits États d'Europe de l'Est », a donné l'explication suivante aux problèmes de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie. Ces États ont dû se convaincre de leur incapacité à introduire une conscience nationale unique dans les territoires historiques dont ils héritaient en raison du multilinguisme de la population. Les pays qui se targuent de démocratie ont donné naissance à un monstre politique : le nationalisme antidémocratique. Le manque de certitude quant au statut territorial et la déformation de la culture politique ont eu l'impact le plus négatif sur les relations entre ces peuples.
Malgré les énormes différences entre l'Autriche-Hongrie et Union soviétique, les deux États fédéraux se sont effondrés en raison de la désunion nationale et d'une différenciation territoriale insurmontable des niveaux de vie
Avec l'acceptation accélérée des pays d'Europe de l'Est et du Sud-Est dans la « maison paneuropéenne », l'UE s'est transformée en une nouvelle version de la monarchie austro-hongroise avec une profonde différenciation des revenus et une explosion de rayonnement de l'esprit national. . Ce n’est pas un hasard si l’intérêt pour l’histoire du fédéralisme autrichien s’est intensifié en liaison avec l’expansion de l’Union européenne vers l’Est.
"Géopolitique des superpuissances"




Empires disparus
Irina Parasyuk (Dortmund)
« Les empereurs autrichiens et russes n'ont pas
il faut se détrôner
et ouvrir la voie à la révolution".
Archiduc François Ferdinand
Il est peu probable que le jeune étudiant serbe Gavrilo Princip connaisse le proverbe russe : « faire d’une pierre deux coups » ou le proverbe anglais « faire d’une pierre deux coups ». Ou la version allemande : « deux mouches avec un pétard ». Mais qui, sinon lui, a illustré cela de telle manière que le monde entier en a frémi...
Cpeut-être le plan le plus célèbre et le plus tragique de l'histoire (en fait, il y a eu sept plans)c n'a pas seulement frappé l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand et son épouse. Elle déclencha la Première Guerre mondiale et infligea également des blessures mortelles à quatre empires. Plus tard un bref délais ils ont, l'un après l'autre, disparu dans l'oubli... Ils étaient :
Empire allemand, 1871-1918
L'Empire russe est l'idée originale de Pierreje, 1721 - 1917
Empire ottoman, 1453-1922
Empire austro-hongrois, 1867-1918
Pasteur Ralph Waldo Emerson poète américain, philosophe et penseur, a dit un jour : « Au fond, il n’y a pas d’histoire ; il n’y a que des biographies… » Sans nier le caractère controversé d’une telle affirmation, parlons des personnages principaux du drame historique intitulé « Autriche-Hongrie ».
L'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais
C'est ainsi que Charles Quint de Habsbourg appelait ses possessions au XVIe siècle. Par une mauvaise ironie du sort, le soleil s'est couché sur l'Autriche-Hongrie sous le règne des Habsbourg, dont le nom était aussi Charles.
Combien étaient-ils là, les Habsbourg à différentes époques : la ligne Albertine, la ligne Léopoldine, la branche styrienne, la branche tyrolienne, la maison des Habsbourg-Lorraine...
De nombreux dirigeants européens étaient leurs ancêtres ou leurs descendants. Partout où ils régnaient... En Autriche - depuis 1282. Au Mexique - en 1864-1867. De 1438 à 1806, ils occupèrent le trône du Saint-Empire romain germanique.
Presque toujours, ils étaient hostiles et combattaient avec les Français - les Capétiens, les Valois, les Bourbons. On peut considérer que la conséquence de cette inimitié fut la proclamation de l'Empire autrichien par François II en 1804. Comme on dirait maintenant, pour maintenir la parité en Europe. Car au même moment Napoléon est sacré Empereur des France. Pourquoi les nobles Habsbourg étaient-ils pires que les Corses déracinés ?
François Joseph. Empire autrichien
Franz, décédé en 1835, fut remplacé par son fils Ferdinand Ier. Le 2 décembre 1848, il abdiqua du trône en faveur de son neveu François-Joseph, dont le titre complet sonnait très impressionnant : « Sa Majesté Impériale et Apostolique François-Josephje, par la grâce de Dieu, l'empereur d'Autriche, le roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Lombardie et vénitien, dalmate, croate, slave, galicien et lodomérien, illyrien, roi de Jérusalem, etc.
De cette liste loin d’être complète (j’ai omis 42 autres titres), il ressort clairement combien de peuples étaient sous la domination de l’Autriche. Différent par l'origine, la culture, la religion. Peut-être avaient-ils une chose en commun : la haine des Autrichiens. (Rappelons-nous « The Gadfly », notre livre préféré de l’enfance.)
François-Joseph, 18 ans, commença son règne avec la répression de la révolution hongroise de 1848-1849. Nicolas Ier l'y a aidé en envoyant le corps expéditionnaire russe de Paskevich en Autriche. Bien entendu, ce n’était pas une pure bénédiction… Le monarque russe, qui n’oubliait jamais la place du Sénat, craignait plus les troubles que la mort !
Un an plus tard, le « reconnaissant » François-Joseph écrit à sa mère : « M Nous pousserons la puissance et l’influence de la Russie jusqu’aux limites qu’elles ont dépassées. ... Lentement, de préférence sans que le tsar Nicolas ne s'en aperçoive, ... nous amènerons la politique russe à l'effondrement. Bien sûr, ce n’est pas bien de dénoncer de vieux amis, mais en politique, il est impossible de faire autrement… ».
Très peu de temps s'écoulera, et au début Guerre de Crimée Nicolas Ier comptera sur le soutien de François-Joseph, qu'il a récemment sauvé. Mais le 20 mai 1854, la Russie reçut un ultimatum de l'Autriche pour retirer les troupes russes de ce qu'on appelle. Principautés du Danube - Valachie et Moldavie. Une armée autrichienne de 330 000 hommes se tenait près des frontières russes. Fin juillet, la Russie a rempli cette exigence et les choses n’ont pas abouti à un conflit militaire. Mais l'Autriche a détourné une partie des forces russes vers elle-même. Cela a facilité le succès des armées anglo-françaises près de Sébastopol.
En laissant de côté la composante morale de l’équation (et existe-t-il une telle chose en politique ?!), nous constatons qu’en conséquence, l’Autriche s’est retrouvée sans allié puissant. Et lorsque la France et la Prusse soutiennent le royaume sarde dans la guerre contre l’Autriche, l’empire perd la Lombardie en 1860.
En 1866, l’Autriche entre en guerre contre la Prusse. Le 3 juillet 1866, les troupes prussiennes battent les Autrichiens à la bataille de Sadovaya. Le 26 juillet, Bismarck dicte les conditions de l'armistice. Et le 23 août 1866, la paix de Prague fut conclue. Selon lui, l'Autriche ne s'immisçait plus dans les affaires allemandes, reconnaissait la suprématie de la Prusse en Allemagne et s'engageait à payer des indemnités. Venise passe sous domination italienne.
François Joseph. Autriche-Hongrie
Il y a une belle histoire selon laquelle l'impératrice autrichienne Elisabeth, la célèbre Sissi, aimait la Hongrie. Sous son influence, François-Joseph, qui adorait son épouse, signa l'accord de 1867 et l'Empire autrichien devint une double Autriche-Hongrie.
Elizabeth aimait vraiment la Hongrie. Elle parlait parfaitement le hongrois, communiquait avec les dirigeants de l'opposition hongroise et portait souvent des costumes nationaux hongrois. Et l'empereur aimait beaucoup sa belle Sissi. Tout cela est vrai. Mais ce n’est bien entendu pas la raison de la création de l’Autriche-Hongrie.
L’Autriche s’est retrouvée acculée. D'une part, les guerres perdues avec la France, le Piémont et la Prusse. Confédération allemande hostile. Relations rompues avec la Russie. Pour l’essentiel, l’Autriche s’est retrouvée isolée.
D’un autre côté, c’est un grand pays multinational. Conditions de vie difficiles pour la majorité de la population. La noblesse nationale était mécontente des Habsbourg. Ici et là, on parle de fédéralisation de l’État, voire de séparation de ses différentes parties de l’Empire autrichien.

J'ai dû faire des concessions. Le 20 octobre 1860, une nouvelle constitution est apparue, dite. "Diplôme d'octobre". L'autonomie des régions a été restaurée et les droits des gouvernements locaux ont été élargis. L'Assemblée d'État hongroise a reçu le droit d'initiative législative et la langue hongroise sur le territoire de la Hongrie a été déclarée officielle. Mais les régions slaves de l’empire étaient mécontentes. Les troubles se sont également poursuivis dans la société hongroise. En un mot, nous étions en retard...
Le mouvement de protestation a été particulièrement fort en Hongrie. En janvier 1861, certaines régions (comitat) ont déclaré illégale le règne de François-Joseph en Hongrie. Et il est devenu clair qu’il fallait d’abord rechercher un compromis avec la Hongrie.
Le 15 mars 1867, un accord fut conclu entre François-Joseph Ier et la délégation hongroise dirigée par Ferenc Deák et Gyula Andrássy. L'Empire autrichien est devenu une double monarchie constitutionnelle d'Autriche-Hongrie, divisée en Transleithanie (terres de la couronne hongroise) et Cisleithanie (terres de la couronne autrichienne).
Le 8 juin, François-Joseph Ier est couronné roi de Hongrie à Budapest. L'Autriche et la Hongrie avaient des ministères communs des Finances, des Affaires étrangères et de l'Armée, ainsi qu'une armée et un drapeau. Chaque partie du pays avait sa propre constitution, son parlement et son gouvernement.
La Galice et la République tchèque ont obtenu une autonomie partielle. Les conditions de propriété qui permettaient de participer aux élections ont été abaissées, c'est-à-dire b Ô Un plus grand nombre de citoyens austro-hongrois ont obtenu le droit de vote. Des députés tchèques ont comparu au parlement autrichien. Dans les zones à population mixte, deux langues ont été introduites que les fonctionnaires devaient connaître. Toutes les confessions religieuses ont été déclarées égales.
Le procès par jury et la conscription universelle ont été introduits. Cela a renforcé l'armée. Les finances se sont renforcées. Construction les chemins de fer conduit à un boom industriel. Grand succès ont été réalisés dans les domaines de l'éducation, de la science et de l'art.
Il me semble que Strauss suffit à lui seul à glorifier à jamais l’Autriche-Hongrie. Mais il y avait aussi Dvorak, Liszt, Mahler, Smetana...
Il ne manquait plus que leur propre Maïakovski, qui aurait écrit quelque chose comme : « Nous disons Autriche-Hongrie, nous parlons de François-Joseph... » Car presque toute l'histoire de l'Empire austro-hongrois est liée à ce nom. Un de ses contemporains écrivait : « Il oubliait parfois les promesses qu'il avait faites, les obligations qu'il assumait, le devoir de sa haute position, mais il n'oubliait jamais une chose : qu'il était un Habsbourg. »
Il commença son règne par la répression de la révolution de 1848-1849. Il était très sceptique quant à la démocratie, au suffrage et à la constitution. Néanmoins, il donna une constitution à l'Autriche, et en 1867 aux Hongrois. Même si tout cela s’est fait sous la pression des circonstances, il était possible de réagir aux circonstances de différentes manières. Il semblerait que l’empereur ne souhaitait pas une répétition de 1848…
François-Joseph était connu comme une personne pleine de tact et de bon cœur, un monarque raisonnable et non tyrannique. Cependant, il était intolérant et impitoyable envers les hommes politiques qui ne lui convenaient pas d'une manière ou d'une autre. Il était considéré comme sage et capable d’écouter les opinions des autres. Cependant, l’écrivain autrichien Karl Kraus a écrit un jour : « Personne à son époque ne correspondait plus à l’image de la médiocrité. »
En 1853, le tailleur hongrois Janos Libeni se précipita avec un couteau sur le très jeune empereur de l'époque. La tentative a échoué. Le meurtrier potentiel a été pendu.
La marche de Johann Strauss « L'heureux sauvetage de l'empereur » a été jouée dans les salons viennois. Dans les rues de Vienne, les habitants ont chanté quelque chose de complètement différent à propos de l'exécution de Janos Libeni : « Punition pour cet acte, qui frappe si maladroitement ? » Cependant, tant que les gens chantent des chansons humoristiques, même celles au contenu séditieux, l'empereur peut dormir paisiblement...
Il s'est moqué très en colère de Franz Josef Hasek à Schweik. Et alors? J'avais le droit...
Aujourd'hui déjà, en 2009, un monument à François-Joseph a été inauguré à Tchernivtsi. Sous son règne, un moulin à vapeur, une usine de meubles, une cathédrale, un théâtre municipal, des écoles et une université, un tramway électrique et une liaison ferroviaire avec Lviv, un système d'approvisionnement en eau et un système d'égouts ont été construits à Tchernivtsi...
Mais il y avait autre chose. En 1914, des Bucoviniens et des Galiciens soupçonnés de sympathiser avec la Russie furent emmenés dans un camp de concentration dans la ville de Talerhof. Environ trois mille personnes y sont mortes et 20 mille autres sont rentrées chez elles handicapées. La mémoire de François-Joseph de chacun est donc différente...
François Joseph : « Rien ne m'a échappé dans cette vie »
C'est ce qu'il a dit après la mort de sa femme. Et quel beau début ce fut ! L’ère des diligences et des cabriolets. Le jeune empereur en uniforme brillant. Princesse amoureuse. Un mariage d'amour est rare pour la royauté. Trois filles. Le fils est l'héritier de la dynastie des Habsbourg.
À la fin de son règne, les avions volaient dans le ciel et les sous-marins sillonnaient les mers. Lui, qui se faisait appeler « le dernier monarque de la vieille école », a dirigé son empire pendant près de 68 ans.
Que de choses ont contenu ces longues années ! Guerres, soulèvements, tragédies familiales...
En 1867, son frère Maximilien est fusillé au Mexique.
En 1898, l'épouse de l'empereur Elisabeth est assassinée à Genève par l'anarchiste italien Luigi Lukeni.
Et 9 ans auparavant, le couple impérial avait connu terrible tragédie. En 1889, le prince héritier Rudolf, leur fils unique et héritier, se suicida au château de Mayerling. François-Joseph a écrit aux monarques européens que la cause de la mort du prince héritier était un coup de feu accidentel alors qu'il chassait. Et ce n’est qu’au pape Léon XIII qu’il a dit la vérité sur le suicide de son fils. Le neveu de François-Joseph, François Ferdinand, devint l'héritier du trône.
Et une autre tragédie fut la mort de son neveu en 1914. L'empereur entretenait une relation cool avec son neveu. Mais il semble que François-Joseph, 84 ans, croyait que François Ferdinand dirigerait dignement l'empire. Ou bien il pourra accomplir son ordre : « Si la monarchie est destinée à périr, qu’elle meure au moins avec honneur. »
À la fin de sa vie, François-Joseph se plaignit aux courtisans : « Tout le monde meurt, moi, le malheureux, je ne peux pas mourir... » Ce n'est pas l'empereur qui a dit cela, mais un homme solitaire. un vieil homme... Il mourut en novembre 1916 d'une pneumonie.
Franz Ferdinand. États-Unis de Grande Autriche
Demandez à n’importe qui : qui est François Ferdinand ? Très probablement, vous entendrez : « Celui qui a été tué à Sarajevo… » Quel dommage que Franz Ferdinand soit surtout connu pour sa mort. C'est comme s'il n'avait jamais vécu du tout...

Pendant ce temps, il était intelligent, travailleur et décisif homme d'État. Il a élaboré des projets de réformes sérieuses. Le destin ne lui a pas donné la possibilité de réaliser ses projets.
En Autriche-Hongrie, l’héritier était certainement considéré comme une figure forte. Ernst Körber, alors Premier ministre, a déclaré un jour : « Nous avons deux empereurs. »
Autour de l'Archiduc, il y avait, comme on dirait aujourd'hui, une équipe solide. C'étaient des militaires et des hommes politiques. Ils avaient leurs propres idées sur la réforme de la monarchie. Parlant langue moderne, un concept politique d'État de l'empire se développait, à la tête duquel François II devait se tenir - sous ce nom, François Ferdinand voulait monter sur le trône.
Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’imaginer Franz Ferdinand comme un internationaliste et un démocrate. (Même si lui, marié à une Tchèque, avait une réputation de « slavophile ».)
Dans le projet de manifeste sur l'accession de l'archiduc au trône, il était écrit : « Nos principes d'égalité des droits pour tous les peuples et toutes les classes correspondent à notre désir de garantir à chaque nationalité au sein de la monarchie la liberté de développement national, si le désir de cette liberté se réalise dans son cadre, la monarchie..» Autrement dit, un pas à droite, un pas à gauche... non, non !
En 1906, Franz Ferdinand et ses conseillers élaborèrent un plan visant à transformer l'Autriche-Hongrie en un État trinitaire : l'Autriche-Hongrie-Slavie. Ou les États-Unis de Grande Autriche. C’était le titre du livre du conseiller, avocat et homme politique de l’archiduc, le roumain d’origine Aurel Popovitch. Chaque grande nationalité devait bénéficier de l'autonomie. Et l’important, bien sûr, n’était pas l’amour de François Ferdinand pour les Slaves. Il espérait qu'après avoir obtenu leur autonomie, ils cesseraient de combattre les Habsbourg.
Les Hongrois étaient catégoriquement opposés au trialisme. Oui, oui, ces mêmes Hongrois épris de liberté, rebelles et révolutionnaires qui, avec les Allemands, représentaient 44% nombre total population et avait pouvoir politique dans l'état. A l'opposé, les Ukrainiens, les Polonais, les Tchèques, les Roumains... soit au total 11 groupes ethniques qui n'avaient quasiment aucun droit politique. Le Premier ministre hongrois, le comte István Tisza, a ouvertement menacé : « Si l’héritier du trône décide de mettre à exécution son plan, je déclencherai contre lui une révolution nationale magyar. »
Il y avait des rumeurs sur l'implication d'Istvan Tisa dans la préparation de la tentative d'assassinat à Sarajevo, mais elles restaient des rumeurs... Mais au fait, qui cherchait des preuves de cela ? Après tout, le meurtrier a été attrapé par la main, quoi d'autre...
Que se serait-il passé si François Ferdinand avait réalisé ses plans ? Malheureusement, il n'est pas possible de le savoir.
Mais une chose qu'il je n'aimais pas la Russie et les Russes, a prédit avec une précision absolue : « Je ne mènerai jamais de guerre contre la Russie. Je sacrifierai tout pour éviter cela, car la guerre entre l'Autriche et la Russie se terminerait soit par le renversement des Romanov, soit par le renversement des Habsbourg, soit peut-être par le renversement des deux dynasties..."
Autriche-Hongrie. Fin
On peut parler sans fin des raisons de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois : guerre, inflation, émeutes dans l'armée et la marine, crise économique, contradictions sociales, sentiments séparatistes, etc. et ainsi de suite.
Le 17 octobre 1918, le parlement hongrois dissout l'union avec l'Autriche et déclare l'indépendance du pays. Et c'est parti !
28 octobre - Tchécoslovaquie. 29 octobre - État des Slovènes, Croates et Serbes. 3 novembre - Ukrainien occidental République populaire. 6 novembre - Pologne. Et encore et encore...
Le Traité de Saint-Germain de 1918 met fin à l'histoire de l'Empire austro-hongrois.
P.. S. Lors du procès des participants au meurtre de Sarajevo, le terroriste Nedeljko Gabrinovic a déclaré : « Ne pensez pas du mal de nous. Nous n’avons jamais détesté l’Autriche, mais l’Autriche n’a pas pris la peine de résoudre nos problèmes. Nous aimions notre peuple. Les neuf dixièmes d’entre eux sont des agriculteurs esclaves vivant dans une pauvreté abjecte. Nous nous sommes sentis désolés pour eux. Nous vivions dans une atmosphère qui rendait le meurtre naturel..."
Rien ne justifie le terrorisme. Mais il serait probablement juste de réfléchir à ces mots. Hier et aujourd'hui...
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’Empire austro-hongrois disposait d’un potentiel économique, politique et militaire important. Comme vous le savez, le début du siècle a été caractérisé par une situation internationale tendue, dont la place centrale appartenait à l'Autriche-Hongrie, dans la mesure où elle incluait les territoires de la péninsule balkanique. Et comme vous le savez, les Balkans sont une « poudrière » de l’Europe. D'abord Guerre mondiale va commencer ici. Ses conditions préalables et ses contradictions sont apparues non seulement en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais, dans une large mesure, dans l'Empire austro-hongrois, qui était destiné non seulement à devenir un allié de la Triple Alliance, mais aussi à lutter contre l'Empire russe.
Situation politique interne dans l'empire
Pour mieux comprendre la situation en Autriche-Hongrie au début du XXe siècle, essayons de comparer les pays qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale au sein de différents blocs militaro-politiques. La comparaison la plus appropriée serait peut-être celle des empires austro-hongrois et russe.
La similitude de la situation est étonnante. Comme l’Empire russe, l’Autriche-Hongrie était un grand État continental qui, en termes de niveau de développement, n’était en rien inférieur (et même supérieur à certains égards) aux pays avancés d’Europe. L’Autriche-Hongrie, comme la Russie, était littéralement déchirée par des contradictions internes, principalement nationales.

Lutte nationale
La monarchie austro-hongroise comprenait de nombreuses nationalités et peuples. La lutte de ces petites nations (Polonais, Croates, Roumains, Serbes, Slovènes, Ukrainiens, Tchèques, Slovaques) pour l'autodétermination et l'expansion des droits administratifs et culturels a ébranlé très puissamment la stabilité de l'empire de l'intérieur. Il convient également de prendre en compte le fait que l'Autriche-Hongrie revendiquait une structure de gouvernement unique, fondée sur le pouvoir de deux monarques. Et cela a considérablement aggravé la situation politique intérieure.
Politique étrangère de l'État
Les intérêts géopolitiques de l’empire se concentraient sur la péninsule balkanique, et la Russie revendiquait également ces territoires. Ils étaient habités Peuples slaves, qui au début du siècle étaient sous le joug de l’Empire ottoman, éternel ennemi de l’Autriche-Hongrie et de la Russie. Mais les deux empires n'étaient pas d'accord avec une division équitable des Balkans, de sorte que le conflit entre les grandes puissances s'est approfondi chaque année, et ce n'est pas seulement l'Autriche-Hongrie qui l'a aggravé. L’Empire et la Russie ont attisé ce conflit de manière égale.
La Serbie est devenue une pomme de discorde inévitable entre les États. Renforcé lors des deux guerres balkaniques de 1912-1913. le royaume slave a créé de sérieux problèmes à l'Autriche-Hongrie en exprimant des idées d'indépendance. Cette politique du roi Peter Karadjordjevic de Serbie a été facilitée par la Russie, frère de longue date du peuple serbe. Face à cet état de choses, le gouvernement austro-hongrois ne pouvait compter que sur une solution énergique au problème.
L'armée et sa structure
Une tâche de politique étrangère d’un tel niveau de complexité a été confiée à l’armée impériale et royale d’Autriche-Hongrie. C’est ainsi qu’on appelait les forces armées de l’empire. L’armée, comme l’ensemble de l’État, était hétérogène. Il était composé d'Autrichiens, de Hongrois, de Croates, de Bosniaques et de représentants d'autres peuples du pays. Les forces austro-hongroises étaient divisées en quatre composantes : l'armée impériale et royale de la Landwehr, les troupes bosniaques-herzégovines, le Honved royal hongrois et les forces royales impériales. Tous disposaient respectivement d’organes d’administration militaire et territoriale. L'aspect territorial de l'armée a donné lieu à de nombreuses contradictions, puisque les gouvernements d'Autriche et de Hongrie ont contribué au développement de la Honved et de la Landwehr et, au contraire, ont tenté de priver le reste de l'armée.

Il y avait de nombreuses lacunes et contradictions dans le corps des officiers. Les académies militaires formaient des officiers dans l’esprit de traditions anciennes et dépassées. L'armée est devenue bureaucratique et n'a pu que mener des manœuvres, et non lutte. Il n’y avait pas de pensée militaire théorique et vivante dans l’armée. Et en général, de nombreux officiers étaient nationalistes et ardents anti-monarchistes.
Mais on ne peut pas parler uniquement de l’état négatif de l’armée austro-hongroise ; bien sûr, il y a eu forces. Les armées impériales et royales étaient particulièrement mobiles. Le petit territoire de l'empire et un réseau ferroviaire développé permettaient aux troupes de se déplacer plus rapidement que toutes les armées du continent. L'Autriche-Hongrie était juste derrière l'Allemagne en termes d'équipement technologique pour son armée. L’industrie de l’État, de par son développement, pourrait permettre un très bon approvisionnement de l’armée, même dans des conditions de guerre. Mais si la guerre avait été prolongée, tous les avantages auraient été perdus. De nombreux États européens se trouvaient dans une situation similaire, l’Autriche-Hongrie ne faisant pas exception. La Première Guerre mondiale, qui est sur le point de commencer, remettra tout à sa place.

L'Empire au début du XXe siècle
Ainsi, on peut affirmer que l’Empire austro-hongrois était en crise au début du XXe siècle, à la fois externe et interne. Au XIXe siècle, l’Autriche-Hongrie a pris pied sur la carte de l’Europe, mais n’a pas réussi à maintenir sa position de leader, ce qui a conduit à des contradictions croissantes dans la question nationale, dans les forces armées et dans les stratégies géopolitiques.
Politique de Charles Ier. Tentative de paix
La mort de François-Joseph fut sans aucun doute l’une des conditions psychologiques préalables à la destruction de l’Empire austro-hongrois. Il n'était pas un dirigeant exceptionnel, mais il devint un symbole de stabilité pour trois générations de ses sujets. De plus, le caractère de François-Joseph - sa retenue, son autodiscipline de fer, sa politesse et sa gentillesse constantes, sa vieillesse très respectée, soutenue par la propagande d'État - tout cela a contribué à la haute autorité de la monarchie. La mort de François-Joseph a été perçue comme un changement d'époque historique, la fin d'une période incroyablement longue. Après tout, presque personne ne se souvenait du prédécesseur de François-Joseph ; c’était il y a trop longtemps et presque personne ne connaissait son successeur.
Karl n'a pas eu de chance. Il a hérité d’un empire entraîné dans une guerre désastreuse et déchiré par des conflits internes. Malheureusement, comme son frère et adversaire russe Nicolas II, Charles Ier ne possédait pas les qualités nécessaires pour résoudre la tâche titanesque de sauver l'État. Il convient de noter qu’il avait de nombreux points communs avec l’empereur russe. Karl était un grand père de famille. Son mariage était harmonieux. Charles et la jeune impératrice Cita, issue de la branche parme des Bourbons (son père fut le dernier duc de Parme), s'aimaient. Et le mariage par amour était rare pour la plus haute aristocratie. Les deux familles ont eu de nombreux enfants : les Romanov ont eu cinq enfants, les Habsbourg - huit. Tsita était le principal soutien de son mari et avait une bonne éducation. C’est pourquoi les mauvaises langues disaient que l’empereur était « sous sa coupe ». Les deux couples étaient profondément religieux.
La différence était que Charles n'avait pratiquement pas le temps de transformer l'empire et que Nicolas II régna pendant plus de 20 ans. Cependant, Karl a tenté de sauver l'empire des Habsbourg et, contrairement à Nicolas, s'est battu jusqu'au bout pour sa cause. Dès le début de son règne, Charles tente de résoudre deux problèmes principaux : arrêter la guerre et procéder à la modernisation interne. Dans son manifeste à l’occasion de son accession au trône, l’empereur autrichien a promis de « rendre à mon peuple la paix bénie sans laquelle il souffre si cruellement ». Cependant, le désir d'atteindre son objectif le plus rapidement possible et le manque de l'expérience nécessaire ont joué une blague cruelle sur Karl : nombre de ses démarches se sont révélées mal pensées, hâtives et erronées.
Le 30 décembre 1916, à Budapest, Charles et Cita sont couronnés roi et reine de Hongrie. D'une part, Charles (tout comme le roi hongrois Charles IV) renforça l'unité de l'État dualiste. En revanche, s'étant privé de manœuvre, s'étant lié pieds et poings liés, Charles ne pouvait plus commencer à fédéraliser la monarchie. Le comte Anton von Polzer-Hoditz a préparé fin novembre un mémorandum dans lequel il proposait à Charles de reporter le couronnement à Budapest et de parvenir à un accord avec toutes les communautés nationales de Hongrie. Cette position était soutenue par tous les anciens camarades de l'archiduc François Ferdinand, qui souhaitaient mener une série de réformes en Hongrie. Cependant, Karl n'a pas suivi leurs recommandations, succombant à la pression de l'élite hongroise, en particulier du comte Tisza. Les fondations du royaume hongrois sont restées intactes.
Cita et Karl avec leur fils Otto le jour de leur couronnement en tant que monarques de Hongrie en 1916
Charles assume les fonctions de commandant suprême. Le « faucon » Konrad von Hötzendorff fut démis de ses fonctions de chef d'état-major et envoyé sur le front italien. Son successeur fut le général Artz von Straussenburg. Le ministère des Affaires étrangères était dirigé par Ottokar Czernin von und zu Hudenitz, représentant de l'entourage de Franz Ferdinand. Le rôle du ministère des Affaires étrangères s’est considérablement accru au cours de cette période. Chernin était une personne controversée. C'était un homme ambitieux, doué, mais quelque peu déséquilibré. Les vues de Tchernin représentaient un étrange mélange de loyalisme supranational, de conservatisme et de profond pessimisme quant à l'avenir de l'Autriche-Hongrie. L'homme politique autrichien J. Redlich a qualifié Tchernin d'« homme du XVIIe siècle qui ne comprend pas l'époque dans laquelle il vit ».
Tchernine lui-même est entré dans l'histoire avec une phrase pleine d'amertume sur le sort de l'empire : « Nous étions voués à la destruction et avons dû mourir. Mais nous pouvions choisir le type de mort – et nous avons choisi le plus douloureux.» Le jeune empereur a choisi Tchernine en raison de son attachement à l'idée de paix. "Une paix victorieuse est hautement improbable", a noté Tchernine, "un compromis avec l'Entente est nécessaire, il n'y a rien sur quoi compter pour des conquêtes".
Le 12 avril 1917, l'empereur autrichien Charles s'adressa à l'empereur Guillaume II dans une lettre mémorandum dans laquelle il notait que « chaque jour le sombre désespoir de la population devient plus fort... Si les monarchies des puissances centrales s'avèrent incapables de faire la paix dans les mois à venir, les peuples le feront - à travers leurs têtes... Nous sommes en guerre contre un nouvel ennemi, encore plus dangereux que l'Entente, contre la révolution internationale, dont la plus grande alliée est la faim.» Autrement dit, Karl a correctement noté le principal danger pour l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie - la menace d'une explosion interne, d'une révolution sociale. Pour sauver les deux empires, il fallait faire la paix. Karl proposa de mettre fin à la guerre, « même au prix de lourdes pertes ». Révolution de février en Russie et la chute de la monarchie russe ont fait une énorme impression sur l'empereur autrichien. L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ont suivi le même chemin désastreux que l’Empire russe.
Cependant, Berlin n’a pas tenu compte de cet appel de Vienne. De plus, en février 1917, l’Allemagne, sans en informer son allié autrichien, déclencha une guerre sous-marine totale. En conséquence, les États-Unis ont reçu une excellente raison d’entrer en guerre aux côtés de l’Entente. Réalisant que les Allemands croyaient toujours à la victoire, Charles Ier commença à chercher de manière indépendante un chemin vers la paix. La situation au front ne donnait à l'Entente aucun espoir de victoire rapide, ce qui augmentait les possibilités de négociations de paix. Le front de l'Est, malgré les assurances du gouvernement provisoire russe de poursuivre la « guerre jusqu'à une fin victorieuse », ne représentait plus une menace sérieuse pour les puissances centrales. Presque toute la Roumanie et les Balkans étaient occupés par les troupes des puissances centrales. Sur front occidental La lutte de position s'est poursuivie, saignant la France et l'Angleterre. Les troupes américaines commençaient tout juste à arriver en Europe et leur efficacité au combat était mise en doute (les Américains n'avaient aucune expérience d'une guerre de cette ampleur). Chernin a soutenu Karl.
Comme intermédiaire pour établir des relations avec l'Entente, Charles choisit son beau-frère, le frère de Zita, le prince Sixte de Bourbon-Parme. Avec son jeune frère Xavier, Sixte servit comme officier dans l'armée belge. C’est ainsi qu’a commencé « l’arnaque Siktus ». Sixte entretient des contacts avec le ministre français des Affaires étrangères J. Cambon. Paris posait les conditions suivantes : le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France, sans concessions à l'Allemagne dans les colonies ; le monde ne peut pas être séparé, la France assumera ses responsabilités envers ses alliés. Cependant, un nouveau message de Sixtus, envoyé après une rencontre avec le président français Poincaré, fait allusion à la possibilité d'un accord séparé. Le but principal La France subit une défaite militaire contre l’Allemagne, « séparée de l’Autriche ».
Pour condamner les nouvelles possibilités, Charles convoqua Sixte et Xavier en Autriche. Ils sont arrivés le 21 mars. Une série de rencontres entre les frères avec le couple impérial et Tchernin a eu lieu à Laxenberg près de Vienne. Tchernine lui-même était sceptique quant à l'idée d'une paix séparée. Il espérait une paix universelle. Tchernine pensait que la paix ne pouvait être conclue sans l'Allemagne et que le refus d'une alliance avec Berlin entraînerait des conséquences tragiques. Le ministre autrichien des Affaires étrangères a compris que l'Allemagne pourrait simplement occuper l'Autriche-Hongrie en cas de trahison. De plus, une telle paix pourrait conduire à une guerre civile. La plupart des Allemands et des Hongrois autrichiens pouvaient percevoir une paix séparée comme une trahison, et les Slaves la soutenaient. Ainsi, une paix séparée a conduit à la destruction de l’Autriche-Hongrie, tout comme la défaite de la guerre.
Les négociations à Laxenberg se terminèrent par le transfert d'une lettre de Charles à Sixte, dans laquelle il promettait d'user de toute son influence pour répondre aux demandes françaises concernant l'Alsace et la Lorraine. Dans le même temps, Charles promet de restaurer la souveraineté de la Serbie. En conséquence, Karl a commis une erreur diplomatique : il a présenté à ses ennemis des preuves documentaires irréfutables que la maison d'Autriche était prête à sacrifier l'Alsace et la Lorraine - l'une des principales priorités de l'Allemagne alliée. Au printemps 1918, cette lettre sera rendue publique, ce qui portera atteinte à l'autorité politique de Vienne, tant aux yeux de l'Entente que de l'Allemagne.
Le 3 avril 1917, lors d'une rencontre avec l'empereur allemand, Charles propose à Guillaume II d'abandonner l'Alsace et la Lorraine. En échange, l'Autriche-Hongrie était prête à céder la Galice à l'Allemagne et à accepter de faire du Royaume de Pologne un satellite allemand. Cependant, l’élite allemande n’a pas soutenu ces initiatives. Ainsi, la tentative de Vienne d’amener Berlin à la table des négociations a échoué.
L’arnaque Sixtus s’est également soldée par un échec. Au printemps 1917, le gouvernement de A. Ribot arrive au pouvoir en France, qui se méfie des initiatives de Vienne et propose de répondre aux exigences de Rome. Et selon le traité de Londres de 1915, l'Italie s'est vu promettre le Tyrol, Trieste, l'Istrie et la Dalmatie. En mai, Charles a laissé entendre qu'il était prêt à céder le Tyrol. Cependant, cela s’est avéré insuffisant. Le 5 juin, Ribot déclarait que « la paix ne peut être que le fruit de la victoire ». Il n’y avait personne d’autre à qui parler et rien d’autre à dire.

Ministre des Affaires étrangères de l'Autriche-Hongrie Ottokar Czernin von und zu Hudenitz
L'idée de démembrer l'Empire austro-hongrois
La Première Guerre mondiale fut totale et une intense propagande militaire n'avait qu'un seul objectif : la victoire complète et définitive. Pour l’Entente, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie représentaient le mal absolu, l’incarnation de tout ce qui était détesté par les républicains et les libéraux. Le militarisme prussien, l'aristocratie des Habsbourg, le réactionnaire et le recours au catholicisme devaient être déracinés. L’« Internationale Financière », qui soutenait les États-Unis, la France et l’Angleterre, voulait détruire les pouvoirs du monarchisme théocratique et de l’absolutisme médiéval. Les empires russe, allemand et austro-hongrois faisaient obstacle au nouvel ordre mondial capitaliste et « démocratique », où le grand capital – « l’élite dorée » – était censé régner.
La nature idéologique de la guerre est devenue particulièrement visible après deux événements survenus en 1917. La première fut la chute de l’Empire russe, de la maison des Romanov. L'Entente a acquis une homogénéité politique, devenant une alliance de républiques démocratiques et de monarchies constitutionnelles libérales. Le deuxième événement est l’entrée en guerre des États-Unis. Le président américain Woodrow Wilson et ses conseillers ont activement appliqué la volonté des dirigeants financiers américains. Et le principal « pied de biche » pour la destruction des vieilles monarchies était censé être le principe trompeur de « l’autodétermination des nations ». Lorsque les nations sont devenues officiellement indépendantes et libres, elles ont établi la démocratie, mais en fait, elles étaient les clients, les satellites des grandes puissances, les capitales financières du monde. Celui qui paie donne le ton.
Le 10 janvier 1917, la déclaration des puissances de l'Entente sur les objectifs du bloc incluait la libération des Italiens, des Slaves du Sud, des Roumains, des Tchèques et des Slovaques. Cependant, il n’était pas encore question de liquider la monarchie des Habsbourg. On parlait d'une large autonomie pour les peuples « défavorisés ». Le 5 décembre 1917, s'adressant au Congrès, le président Wilson annonçait sa volonté de libérer les peuples d'Europe de l'hégémonie allemande. À propos de la monarchie du Danube, le président américain a déclaré : « La destruction de l’Autriche ne nous intéresse pas. La façon dont elle se débarrasse d’elle-même n’est pas notre problème. Dans les célèbres 14 points de Woodrow Wilson, le point 10 concernait l'Autriche. Il a été demandé aux peuples d’Autriche-Hongrie d’offrir « les possibilités de développement autonome les plus larges possibles ». Le 5 janvier 1918, le Premier ministre britannique Lloyd George a déclaré dans une déclaration sur les objectifs militaires de l’Angleterre que « nous ne luttons pas pour la destruction de l’Autriche-Hongrie ».
Cependant, les Français étaient d’un avis différent. Ce n’est pas pour rien que Paris a soutenu dès le début de la guerre l’émigration politique tchèque et croato-serbe. En France, des légions furent constituées de prisonniers et de déserteurs - Tchèques et Slovaques, en 1917-1918. ils prirent part aux combats sur le front occidental et en Italie. A Paris, ils voulaient créer une « Europe républicanisée », ce qui était impossible sans la destruction de la monarchie des Habsbourg.
En général, la question de la division de l'Autriche-Hongrie n'a pas été annoncée. Le tournant s’est produit lorsque l’« arnaque Sixtus » a été révélée. Le 2 avril 1918, le ministre autrichien des Affaires étrangères Tchernin s'adressa aux membres de l'assemblée municipale de Vienne et, dans une certaine impulsion, reconnut que des négociations de paix étaient effectivement en cours avec la France. Mais l’initiative, selon Chernin, est venue de Paris et les négociations ont été interrompues, prétendument en raison du refus de Vienne d’accepter l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à la France. Indigné par ce mensonge évident, le Premier ministre français J. Clemenceau a répondu en affirmant que Tchernine mentait, puis a publié le texte de la lettre de Karl. La cour de Vienne fut frappée par une pluie de reproches d'infidélité et de trahison, selon lesquels les Habsbourg avaient violé le « commandement sacré » de la « loyauté teutonique » et de la fraternité. Bien que l’Allemagne elle-même ait fait de même et mené des négociations en coulisses sans la participation de l’Autriche.
Ainsi, Chernin a brutalement piégé Karl. La carrière du comte Tchernine s’est terminée ici : il a démissionné. L'Autriche a été frappée par une grave crise politique. Dans les cercles judiciaires, on parlait même d'une éventuelle démission de l'empereur. Les milieux militaires et les « faucons » austro-hongrois engagés dans une alliance avec l’Allemagne étaient furieux. L'Impératrice et la maison de Parme à laquelle elle appartenait étaient attaquées. Ils étaient considérés comme une source de mal.
Karl a été obligé de s'excuser auprès de Berlin, de mentir en disant que c'était un faux. En mai, sous la pression de Berlin, Charles signe un accord sur une union militaire et économique encore plus étroite des puissances centrales. L’État des Habsbourg est finalement devenu le satellite d’un État plus puissant. Empire allemand. Si nous imaginons une réalité alternative dans laquelle l’Allemagne gagnerait la Première Guerre mondiale, l’Autriche-Hongrie deviendrait alors une puissance de second ordre, presque une colonie économique de l’Allemagne. La victoire de l’Entente n’augure rien de bon non plus pour l’Autriche-Hongrie. Le scandale autour de « l’arnaque Sixte » a enterré la possibilité d’un accord politique entre les Habsbourg et l’Entente.
En avril 1918, le « Congrès des peuples opprimés » se tient à Rome. Des représentants de diverses communautés nationales d'Autriche-Hongrie se sont réunis à Rome. Le plus souvent, ces hommes politiques n'avaient aucun poids dans leur pays, mais ils n'hésitaient pas à parler au nom de leur peuple, à qui, en fait, personne ne l'interrogeait. En réalité, de nombreux hommes politiques slaves se contenteraient encore d’une large autonomie au sein de l’Autriche-Hongrie.
Le 3 juin 1918, l'Entente déclarait qu'elle considérait que l'une des conditions pour créer un monde juste était la création d'une Pologne indépendante, avec l'inclusion de la Galice. Le Conseil national polonais avait déjà été créé à Paris, dirigé par Roman Dmowski, qui, après la révolution en Russie, a changé sa position pro-russe en position pro-occidentale. Les activités des partisans de l’indépendance étaient activement parrainées par la communauté polonaise aux États-Unis. Une armée de volontaires polonaise est formée en France sous le commandement du général J. Haller. J. Pilsudski, réalisant dans quelle direction soufflait le vent, rompit les relations avec les Allemands et devint progressivement célèbre en tant que héros national du peuple polonais.
Le 30 juillet 1918, le gouvernement français reconnaît le droit des Tchèques et des Slovaques à l'autodétermination. Le Conseil national tchécoslovaque a été appelé à être l'organe suprême représentant les intérêts du peuple et le noyau du futur gouvernement de la Tchécoslovaquie. Le 9 août, le Conseil national tchécoslovaque a été reconnu comme futur gouvernement tchécoslovaque par l'Angleterre et le 3 septembre par les États-Unis. Le caractère artificiel de l’État tchécoslovaque ne dérangeait personne. Bien que les Tchèques et les Slovaques, mis à part leurs similitudes linguistiques, n'aient pas grand-chose en commun. Pendant de nombreux siècles, les deux peuples ont eu des histoires différentes et se trouvaient à des niveaux de développement politique, culturel et économique différents. Cela ne dérangeait pas l'Entente, comme beaucoup d'autres structures artificielles similaires, l'essentiel était de détruire l'empire des Habsbourg.
Libéralisation
La partie la plus importante de la politique de Charles Ier était la libéralisation de la politique intérieure. Il convient de noter que dans des conditions de guerre, cette décision n’était pas la meilleure. Dans un premier temps, les autorités autrichiennes sont allées trop loin dans la recherche d'« ennemis intérieurs », de répressions et de restrictions, puis elles ont entamé la libéralisation. Cela n'a fait qu'aggraver la situation interne du pays. Charles Ier, guidé par les meilleures intentions, a lui-même secoué le bateau déjà peu stable de l'empire des Habsbourg.
Le 30 mai 1917, le Reichsrat, le parlement autrichien, qui ne s'était pas réuni depuis plus de trois ans, fut convoqué. L'idée de la Déclaration de Pâques, qui renforçait la position des Allemands autrichiens en Cisleithanie, fut rejetée. Charles décida que le renforcement des Allemands autrichiens ne simplifierait pas la position de la monarchie, mais vice versa. De plus, en mai 1917, le Premier ministre hongrois Tisza, qui incarnait le conservatisme hongrois, fut démis de ses fonctions.
Convoquer le Parlement fut la grosse erreur de Charles. La convocation du Reichsrat fut perçue par de nombreux hommes politiques comme un signe de la faiblesse du pouvoir impérial. Les dirigeants des mouvements nationaux ont reçu une plateforme à partir de laquelle ils ont pu faire pression sur les autorités. Le Reichsrat s’est rapidement transformé en un centre d’opposition, essentiellement un organisme anti-étatique. Au fur et à mesure que les sessions parlementaires se poursuivaient, la position des députés tchèques et yougoslaves (ils formaient une seule faction) devint de plus en plus radicale. L'Union tchèque exigeait la transformation de l'État des Habsbourg en une « fédération d'États libres et égaux » et la création d'un État tchèque incluant les Slovaques. Budapest était indignée, car l'annexion des terres slovaques aux terres tchèques signifiait une violation de l'intégrité territoriale du royaume hongrois. Dans le même temps, les hommes politiques slovaques eux-mêmes attendaient de voir ce qui se passerait, ne préférant ni une alliance avec les Tchèques ni une autonomie au sein de la Hongrie. Ce n’est qu’en mai 1918 que l’accent fut mis sur une alliance avec les Tchèques.
L'amnistie annoncée le 2 juillet 1917, qui libéra les prisonniers politiques condamnés à mort, principalement des Tchèques (plus de 700 personnes), ne contribua pas au calme en Autriche-Hongrie. Les Allemands autrichiens et bohémiens ont été indignés par le pardon impérial accordé aux « traîtres », ce qui a encore aggravé les contradictions nationales en Autriche.
Le 20 juillet, sur l'île de Corfou, des représentants du Comité yougoslave et du gouvernement serbe ont signé une déclaration sur la création après la guerre d'un État qui comprendrait la Serbie, le Monténégro et les provinces d'Autriche-Hongrie habitées par les Slaves du Sud. Le chef du « Royaume des Serbes, Croates et Slovènes » devait être un roi de la dynastie serbe Karadjordjevic. Il convient de noter qu'à cette époque, le Comité slave du Sud n'avait pas le soutien de la majorité des Serbes, Croates et Slovènes d'Autriche-Hongrie. La plupart des politiciens slaves du sud en Autriche-Hongrie même préconisaient à cette époque une large autonomie au sein de la fédération des Habsbourg.
Cependant, à la fin de 1917, les tendances séparatistes et radicales l’emportèrent. A joué un certain rôle dans cela Révolution d'Octobre en Russie et le « Décret sur la paix » bolchevique qui appelait à « une paix sans annexions ni indemnités » et à la mise en œuvre du principe d’autodétermination des nations. Le 30 novembre 1917, l'Union tchèque, le Club des députés slaves du Sud et l'Association parlementaire ukrainienne ont publié une déclaration commune. Ils y exigeaient que des délégations de diverses communautés nationales de l'Empire austro-hongrois soient présentes aux négociations de paix à Brest.
Lorsque le gouvernement autrichien rejeta cette idée, un congrès des députés tchèques du Reichsrat et des membres des assemblées d'État se réunit à Prague le 6 janvier 1918. Ils adoptèrent une déclaration dans laquelle ils exigeaient que les peuples de l'empire des Habsbourg aient le droit à l'autodétermination et, en particulier, la proclamation d'un État tchécoslovaque. Le Premier ministre de Cisleithania Seidler a déclaré cette déclaration « un acte de trahison ». Cependant, les autorités ne pouvaient plus opposer au nationalisme que des déclarations bruyantes. Le train est parti. Le pouvoir impérial ne jouissait plus de son ancienne autorité et l’armée était démoralisée et ne pouvait résister à l’effondrement de l’État.
Catastrophe militaire
Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk est signé. La Russie a perdu un immense territoire. Les troupes austro-allemandes restèrent dans la Petite Russie jusqu'à l'automne 1918. En Autriche-Hongrie, ce monde était appelé «céréales», c'est pourquoi ils espéraient des approvisionnements en céréales de la Petite Russie-Ukraine, censés améliorer la situation alimentaire critique en Autriche. Cependant, ces espoirs ne se sont pas avérés justifiés. La guerre civile et les mauvaises récoltes dans la Petite Russie ont conduit au fait que l'exportation de céréales et de farine de cette région vers la Cisleithanie s'élevait à moins de 2,5 mille wagons en 1918. A titre de comparaison : environ 30 000 wagons ont été exportés de Roumanie et plus de 10 000 de Hongrie.
Le 7 mai, une paix séparée est signée à Bucarest entre les puissances centrales et vaincu Roumanie. La Roumanie a cédé la Dobroudja à la Bulgarie et une partie du sud de la Transylvanie et de la Bucovine à la Hongrie. En compensation, Bucarest reçut la Bessarabie russe. Cependant, dès novembre 1918, la Roumanie retourna dans le camp de l’Entente.
Lors de la campagne de 1918, le commandement austro-allemand espérait gagner. Mais ces espoirs furent vains. Les forces des puissances centrales, contrairement à l’Entente, s’épuisaient. En mars-juillet, l'armée allemande lance une puissante offensive sur le front occidental, remporte quelques succès, mais ne parvient pas à vaincre l'ennemi ni à percer le front. Les ressources matérielles et humaines de l'Allemagne s'épuisaient et le moral était affaibli. En outre, l'Allemagne a été contrainte de maintenir d'importantes forces à l'Est, contrôlant les territoires occupés, perdant ainsi d'importantes réserves qui pourraient être utiles sur le front occidental. En juillet-août a lieu la deuxième bataille de la Marne ; les troupes de l'Entente lancent une contre-offensive. L'Allemagne a subi une lourde défaite. En septembre, les troupes de l'Entente, dans une série d'opérations, éliminèrent les résultats des précédents succès allemands. En octobre - début novembre, les forces alliées libèrent la majeure partie du territoire français et une partie de la Belgique capturées par les Allemands. L'armée allemande ne pouvait plus combattre.
L'offensive de l'armée austro-hongroise sur le front italien échoue. Les Autrichiens attaquent le 15 juin. Cependant, les troupes austro-hongroises n'ont pu pénétrer que par endroits dans les défenses italiennes sur la rivière Piava. Après plusieurs troupes, les troupes austro-hongroises, ayant subi de lourdes pertes et démoralisées, se retirèrent. Les Italiens, malgré les demandes constantes du commandement allié, ne parviennent pas à organiser immédiatement une contre-offensive. L'armée italienne n'était pas dans les meilleures conditions pour avancer.
Ce n'est que le 24 octobre que l'armée italienne passe à l'offensive. Dans plusieurs endroits, les Autrichiens se sont défendus avec succès et ont repoussé les attaques ennemies. Cependant, le front italien s’est rapidement effondré. Sous l'influence des rumeurs et de la situation sur d'autres fronts, les Hongrois et les Slaves se sont rebellés. Le 25 octobre, toutes les troupes hongroises ont tout simplement abandonné leurs positions et se sont rendues en Hongrie sous prétexte de la nécessité de défendre leur pays, menacé par les troupes serbes de l'Entente. Et les soldats tchèques, slovaques et croates ont refusé de se battre. Seuls les Allemands autrichiens continuèrent à se battre.
Le 28 octobre, 30 divisions avaient déjà perdu leur capacité de combat et le commandement autrichien donna l'ordre d'une retraite générale. L'armée austro-hongroise, complètement démoralisée, s'enfuit. Environ 300 000 personnes se sont rendues. Le 3 novembre, les Italiens débarquent des troupes à Trieste. Les troupes italiennes occupèrent presque tout le territoire italien précédemment perdu.
Dans les Balkans, les Alliés passent également à l’offensive en septembre. L'Albanie, la Serbie et le Monténégro sont libérés. La Bulgarie a conclu une trêve avec l'Entente. En novembre, les Alliés envahissent l'Autriche-Hongrie. Le 3 novembre 1918, l'Empire austro-hongrois conclut une trêve avec l'Entente et le 11 novembre avec l'Allemagne. Ce fut une défaite totale.
Fin de l'Autriche-Hongrie
Le 4 octobre 1918, en accord avec l'empereur et Berlin, le ministre austro-hongrois des Affaires étrangères, le comte Burian, envoya une note aux puissances occidentales les informant que Vienne était prête à entamer des négociations basées sur les « 14 points » de Wilson, y compris la clause sur l'auto-détermination. -détermination des nations.
Le 5 octobre, l'Assemblée populaire de Croatie a été créée à Zagreb, qui s'est déclarée organe représentatif des terres yougoslaves de l'empire austro-hongrois. Le 8 octobre, à Washington, sur proposition de Masaryk, fut proclamée la Déclaration d'indépendance du peuple tchécoslovaque. Wilson a immédiatement reconnu que les Tchécoslovaques et l'Autriche-Hongrie étaient en guerre et que le Conseil tchécoslovaque était le gouvernement qui menait la guerre. Les États-Unis ne pouvaient plus considérer l’autonomie des peuples comme une condition suffisante pour conclure la paix. C'était une condamnation à mort pour l'empire des Habsbourg.
Du 10 au 12 octobre, l'empereur Charles reçut des délégations de Hongrois, de Tchèques, d'Allemands autrichiens et de Slaves du Sud. Les politiciens hongrois ne voulaient toujours pas entendre parler de la fédéralisation de l’empire. Karl a dû promettre que le prochain manifeste sur la fédéralisation n'affecterait pas la Hongrie. Et pour les Tchèques et les Slaves du Sud, la fédération ne semblait plus être le rêve ultime : l'Entente promettait davantage. Karl ne commandait plus, mais demandait et suppliait, mais il était trop tard. Karl a dû payer non seulement pour ses erreurs, mais aussi pour celles de ses prédécesseurs. L'Autriche-Hongrie était condamnée.
En général, on peut sympathiser avec Karl. C'était un homme inexpérimenté, gentil et religieux qui était en charge de l'empire et ressentait une terrible douleur mentale alors que son monde entier s'effondrait. Les peuples refusaient de lui obéir et rien ne pouvait être fait. L'armée aurait pu arrêter la désintégration, mais son noyau prêt au combat est mort sur les fronts et les troupes restantes se sont presque complètement désintégrées. Il faut rendre à Karl son dû, il s'est battu jusqu'au bout, et non pour le pouvoir, puisqu'il n'était pas une personne avide de pouvoir, mais pour l'héritage de ses ancêtres.
Le 16 octobre 1918, un manifeste sur la fédéralisation de l'Autriche (« Manifeste des peuples ») est publié. Cependant, le temps était déjà perdu pour une telle démarche. En revanche, ce manifeste nous a permis d’éviter l’effusion de sang. De nombreux officiers et fonctionnaires, élevés dans un esprit de dévouement au trône, purent sereinement commencer à servir les conseils nationaux légitimes, entre les mains desquels passa le pouvoir. Il faut dire que de nombreux monarchistes étaient prêts à se battre pour les Habsbourg. Ainsi, le « lion de l'Isonzo », le maréchal Svetozar Boroevich de Boina, disposait de troupes qui maintenaient discipline et loyauté envers le trône. Il était prêt à marcher sur Vienne et à l'occuper. Mais Karl, devinant les plans du maréchal, ne voulait pas d'un coup d'État militaire et du sang.
Le 21 octobre, l'Assemblée nationale provisoire de l'Autriche allemande est créée à Vienne. Il comprenait presque tous les députés du Reichsrat qui représentaient les districts germanophones de Cisleithanie. De nombreux députés espéraient que les districts allemands de l'empire effondré pourraient bientôt rejoindre l'Allemagne, achevant ainsi le processus de création d'une Allemagne unifiée. Mais cela était contraire aux intérêts de l'Entente et c'est pourquoi, sur l'insistance des puissances occidentales, la République autrichienne, déclarée le 12 novembre, est devenue un État indépendant. Charles annonça qu'il « se retirait du gouvernement », mais souligna que cela ne constituait pas une abdication du trône. Formellement, Charles restait empereur et roi, puisque le refus de participer aux affaires de l'État n'équivalait pas à un renoncement au titre et au trône.
Charles « suspendit » ses pouvoirs, espérant pouvoir regagner le trône. En mars 1919, sous la pression du gouvernement autrichien et de l’Entente, la famille impériale s’installe en Suisse. En 1921, Charles fit deux tentatives pour restaurer le trône de Hongrie, mais échoua. Il sera envoyé sur l'île de Madère. En mars 1922, Karl tomba malade d'une pneumonie due à l'hypothermie et mourut le 1er avril. Son épouse, Tsita, vivra toute une époque et mourra en 1989.
Le 24 octobre, tous les pays de l'Entente et leurs alliés ont reconnu le Conseil national tchécoslovaque comme gouvernement actuel du nouvel État. Le 28 octobre, la République tchécoslovaque (RSC) est proclamée à Prague. Le 30 octobre, le Conseil national slovaque a confirmé l'adhésion de la Slovaquie à la Tchécoslovaquie. En fait, Prague et Budapest se sont battus pour la Slovaquie pendant encore plusieurs mois. Le 14 novembre, l'Assemblée nationale s'est réunie à Prague et Masaryk a été élu président de la Tchécoslovaquie.
Le 29 octobre à Zagreb, l'Assemblée populaire s'est déclarée prête à prendre tout le pouvoir dans les provinces yougoslaves. La Croatie, la Slavonie, la Dalmatie et les terres des Slovènes ont fait sécession de l'Autriche-Hongrie et ont déclaré leur neutralité. Certes, cela n'a pas empêché l'armée italienne d'occuper la Dalmatie et zones côtières Croatie. L'anarchie et le chaos s'ensuivirent dans les régions yougoslaves. L'anarchie généralisée, l'effondrement, la menace de famine et la rupture des liens économiques ont contraint l'Assemblée de Zagreb à demander l'aide de Belgrade. En réalité, les Croates, les Bosniaques et les Slovènes n’avaient pas le choix. L’empire des Habsbourg s’effondre. Les Allemands autrichiens et les Hongrois ont créé leurs propres États. Il fallait soit participer à la création d'un État slave du sud commun, soit être victime des saisies territoriales de l'Italie, de la Serbie et de la Hongrie (éventuellement de l'Autriche).
Le 24 novembre, l'Assemblée populaire s'est adressée à Belgrade pour demander d'inclure les provinces yougoslaves de la monarchie du Danube dans le royaume serbe. Le 1er décembre 1918, la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (la future Yougoslavie) est annoncée.
Formé en novembre État polonais. Après la capitulation des puissances centrales, un double pouvoir est apparu en Pologne. Le Conseil de régence du Royaume de Pologne siégeait à Varsovie et le gouvernement populaire provisoire à Lublin. Józef Pilsudski, qui est devenu le leader généralement reconnu de la nation, a uni les deux groupes de pouvoir. Il est devenu le « chef de l’État » – le chef temporaire du pouvoir exécutif. La Galice est également devenue une partie de la Pologne. Cependant, les frontières du nouvel État ne furent déterminées qu’en 1919-1921, après Versailles et la guerre avec la Russie soviétique.
Le 17 octobre 1918, le Parlement hongrois rompt l'union avec l'Autriche et déclare l'indépendance du pays. Le Conseil national hongrois, dirigé par le comte libéral Mihaly Károlyi, a fixé la voie à suivre pour réformer le pays. Afin de préserver l'intégrité territoriale de la Hongrie, Budapest a annoncé qu'elle était prête à entamer immédiatement des négociations de paix avec l'Entente. Budapest a rappelé les troupes hongroises des fronts effondrés vers leur pays d'origine.
Les 30 et 31 octobre, un soulèvement éclate à Budapest. Des foules de milliers de citadins et de soldats revenant du front ont exigé le transfert du pouvoir au Conseil national. La victime des rebelles était l'ancien Premier ministre hongrois István Tisza, qui a été mis en pièces par des soldats dans sa propre maison. Le comte Károlyi devint Premier ministre. Le 3 novembre, la Hongrie conclut une trêve avec l'Entente à Belgrade. Cependant, cela n'a pas empêché la Roumanie de s'emparer de la Transylvanie. Les tentatives du gouvernement Károlyi pour parvenir à un accord avec les Slovaques, les Roumains, les Croates et les Serbes sur la préservation de l'unité de la Hongrie à la condition d'accorder une large autonomie à ses communautés nationales se sont soldées par un échec. Du temps a été perdu. Les libéraux hongrois ont dû payer pour les erreurs de l’ancienne élite conservatrice qui, jusqu’à récemment, ne voulait pas réformer la Hongrie.

Insurrection à Budapest le 31 octobre 1918
Le 5 novembre à Budapest, Charles Ier est déposé du trône de Hongrie. Le 16 novembre 1918, la Hongrie est déclarée république. Toutefois, la situation en Hongrie était difficile. D'une part, en Hongrie même, la lutte de diverses forces politiques s'est poursuivie - des monarchistes conservateurs aux communistes. En conséquence, Miklos Horthy est devenu le dictateur de la Hongrie, qui a dirigé la résistance à la révolution de 1919. En revanche, il était difficile de prédire ce qu’il resterait de l’ancienne Hongrie. En 1920, l'Entente retire ses troupes de Hongrie, mais la même année, le traité de Trianon prive le pays des 2/3 du territoire où vivaient des centaines de milliers de Hongrois et de la plupart des infrastructures économiques.
Ainsi, l'Entente, après avoir détruit l'Empire austro-hongrois, a créé une vaste zone d'instabilité en Europe centrale, où se sont libérés des griefs, des préjugés, une hostilité et une haine de longue date. La destruction de la monarchie des Habsbourg, qui agissait comme une force intégratrice, capable de représenter avec plus ou moins de succès les intérêts de la majorité de ses sujets, d'aplanir et d'équilibrer les contradictions politiques, sociales, nationales et religieuses, était un grand mal. À l’avenir, cela deviendra l’une des principales conditions préalables à la prochaine guerre mondiale.

Carte de l'effondrement de l'Autriche-Hongrie en 1919-1920.
Ctrl Entrer
Remarqué Y bku Sélectionnez le texte et cliquez Ctrl+Entrée
"Empire patchwork" Ayant perdu sa position de grande puissance après la défaite dans la guerre austro-prussienne de 1866, l'Autriche conclut un accord d'unification avec la Hongrie en 1867.
L'Autriche-Hongrie unie est devenue l'un des plus grands États d'Europe. En termes de territoire et de population, elle dépassait la Grande-Bretagne, l'Italie et la France. Au début du 20ème siècle. L'Autriche-Hongrie comprenait les territoires de l'Autriche, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Croatie, ainsi qu'une partie des territoires de la Roumanie, de la Pologne, de l'Italie et de l'Ukraine modernes. La capitale de l'Autriche, Vienne, était l'une des villes les plus anciennes, les plus peuplées et les plus riches d'Europe. La capitale de la Hongrie, Budapest, et ville principale Les Tchèques débarquent à Prague.
Contrairement à la plupart des États d’Europe occidentale, l’Autriche-Hongrie était un État multinational et était souvent qualifiée d’« empire patchwork ». Plus d'une douzaine de nationalités différentes vivaient sur le territoire de l'Autriche-Hongrie, et aucune d'entre elles ne représentait ne serait-ce qu'un quart de la population totale. Les plus nombreux étaient les Autrichiens (23,5 % de la population) et les Hongrois (19,1 %). Viennent ensuite les Tchèques et les Slovaques (16,5 %), les Serbes et les Croates (16,5 %), les Polonais (10 %), les Ukrainiens (8 %), les Roumains (6,5 %), les Slovènes, les Italiens, les Allemands et bien d'autres.
Certaines nationalités vivaient de manière plus ou moins compacte : par exemple, les Autrichiens en Autriche, les Hongrois en Hongrie, les Croates en Croatie, les Tchèques dans les pays tchèques, les Polonais et les Ukrainiens en Galicie, les Roumains et les Hongrois en Transylvanie. De nombreuses régions avaient une population mixte.
Aux différences nationales s'ajoutaient des différences religieuses : les Autrichiens, les Italiens et les Polonais professaient le catholicisme, les Tchèques et les Allemands le protestantisme, les Croates l'islam, les Ukrainiens l'orthodoxie ou l'uniatisme.
Selon les termes de l’accord de 1867 entre l’Autriche et la Hongrie, l’Autriche-Hongrie était considérée comme une « double monarques" Hongrois et Autrichiens. L'empereur autrichien François-Joseph était en même temps roi de Hongrie. Il avait le droit de promulguer des actes législatifs, approuvait la composition du gouvernement et était le commandant en chef de l'armée austro-hongroise unie. L'Autriche et la Hongrie avaient trois ministères communs : militaire, affaires étrangères et finances. L'Autriche et la Hongrie avaient leurs propres parlements et gouvernements, dont la composition était approuvée par l'empereur.
Il n'y avait pas de suffrage universel. Seuls les propriétaires de biens avaient le droit de voter ; le vote était ouvert. Dans les zones de résidence compacte de certaines nationalités (en Croatie, dans les pays tchèques, en Galice), leurs propres constitutions étaient en vigueur, il existait des parlements locaux et des organes d'autonomie gouvernementale. Dans ces domaines, selon la loi, l'enseignement en écoles primaires et la gestion des documents au sein des autorités locales devait être effectuée dans les langues nationales, mais cette loi était souvent violée.
La grande complexité de la composition nationale et religieuse, la position inégale de toutes les nationalités, à l'exception des Autrichiens et des Hongrois, ont donné naissance à divers mouvements nationaux dont les intérêts ne coïncidaient pas. De sérieuses contradictions existaient même entre les deux nations dominantes : les Autrichiens et les Hongrois. Une partie des cercles dirigeants hongrois préconisaient la liquidation de l'accord de 1867, la séparation de la Hongrie de l'Autriche et la déclaration de l'indépendance de la Hongrie. Les relations entre les autres nationalités étaient encore plus complexes. Les peuples qui n'avaient pas leur propre État étaient hostiles aux Autrichiens et aux Hongrois et, en même temps, entretenaient souvent des relations hostiles les uns avec les autres.
Le gouvernement austro-hongrois a cherché à réprimer le désir d’indépendance des nationalités opprimées. À plusieurs reprises, il a dissous les parlements et les gouvernements locaux, mais n’a pas réussi à mettre un terme aux mouvements nationaux. De nombreuses organisations nationalistes légales et illégales ont continué à opérer dans l’empire.
Développement socio-économique. En économie, l’Autriche-Hongrie était à la traîne des grandes puissances. Les pays les plus développés industriellement étaient l'Autriche et les terres tchèques situées dans la partie occidentale de l'Autriche-Hongrie. Il y avait là une grande industrie et des banques. Les six plus grands monopoles contrôlaient la production de presque tout le minerai de fer et 92 % de la production d'acier. L'entreprise métallurgique Skoda en République tchèque était l'une des entreprises les plus importantes de l'industrie militaire européenne. Dans d'autres régions de l'Autriche-Hongrie, la petite et moyenne industrie prédominait. La Hongrie, la Croatie, la Galice et la Transylvanie étaient des régions agricoles dotées d'une grande propriété foncière. Environ un tiers de toutes les terres cultivées appartenaient aux plus grands propriétaires, qui possédaient chacun plus de 1 000 hectares. Les paysans dépendaient des propriétaires fonciers et exploitaient souvent leurs fermes selon des méthodes traditionnelles dépassées.
Une particularité de l'économie austro-hongroise était le rôle important des capitaux étrangers. Les principales branches de l'industrie austro-hongroise : métallurgie, construction mécanique, pétrole, électrotechnique - étaient financées par des entreprises allemandes ou leur appartenaient. La capitale française occupe la deuxième place. Il possédait les usines Skoda, une partie des chemins de fer, des mines et des fonderies de fer.
La classe ouvrière d’Autriche-Hongrie était petite. Il s'est concentré principalement sur grandes villes Autriche et République tchèque, ainsi que dans la capitale de la Hongrie, Budapest. Les deux tiers de la population de l'Autriche-Hongrie vivaient à la campagne et s'adonnaient à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. Dans de nombreuses régions, les classes dirigeantes et exploitées appartenaient à des nationalités différentes. Les paysans croates, serbes et roumains travaillaient souvent pour des magnats hongrois, les paysans ukrainiens pour des propriétaires fonciers polonais. Cette situation a encore compliqué les relations nationales et intensifié l’hostilité nationale.
Crise de l'Empire austro-hongrois. Au début du 20ème siècle. L'Empire austro-hongrois traversait une profonde crise politique provoquée par la montée des mouvements ouvriers et de libération nationale. Après la publication en Russie du manifeste du tsar le 17 (30 octobre 1905), qui promettait les libertés démocratiques et la convocation de la Douma d'État, la direction du Parti social-démocrate autrichien a appelé les travailleurs à mener des actions de masse en faveur du suffrage universel. . Début novembre 1905, à Vienne et à Prague, les ouvriers descendent dans les rues, organisent des manifestations, organisent des grèves, construisent des barricades et affrontent la police. Le gouvernement autrichien fit des concessions et annonça le 4 novembre 1905 son accord pour l'introduction du suffrage universel. En février 1907, une nouvelle loi électorale fut adoptée, qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Autriche, accordait le droit de vote à tous les hommes de plus de 24 ans.
Les événements en Hongrie se sont développés différemment. Une loi de réforme du suffrage a été introduite au parlement hongrois en 1908, mais elle accordait le droit de vote uniquement aux hommes alphabétisés, les propriétaires fonciers recevant deux voix. Ce n’est qu’en 1910 que le gouvernement hongrois a promis d’introduire le suffrage universel, mais n’a pas tenu sa promesse.
La place principale dans la vie politique de l'Autriche-Hongrie à cette époque était occupée par les questions de politique étrangère. Les cercles dirigeants, en particulier le soi-disant « parti militaire », dirigé par l'ardent commandant en chef adjoint militariste, héritier du trône de l'archiduc François Ferdinand, cherchaient à s'étendre dans les Balkans. En octobre 1908, le gouvernement annonce l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, anciennes provinces turques peuplées principalement de Serbes et de Croates, à l'Autriche-Hongrie.
L'annexion de la Bosnie-Herzégovine a provoqué des protestations parmi la population de ces provinces et a conduit à une forte escalade des contradictions entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Le « Parti de la guerre » a lancé une campagne de propagande contre la Serbie et a commencé à se préparer à une guerre « préventive » (de précaution) avec elle.
De leur côté, les organisations nationalistes serbes et croates opérant en Autriche-Hongrie ont lancé une lutte pour la libération de la Bosnie-Herzégovine et la création d'un État yougoslave unifié dirigé par la Serbie. Dans le but de réprimer les mouvements nationaux des peuples habitant l'Autriche-Hongrie, le gouvernement a décidé de dissoudre certains gouvernements locaux. En 1912, le Parlement croate fut dissous et la constitution suspendue. En 1913, le même sort fut réservé au Parlement tchèque. En 1914, le gouvernement dissout le Parlement autrichien. En conséquence, les contradictions nationales et de classe sont devenues encore plus aiguës.