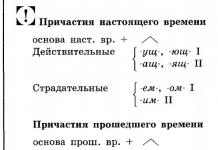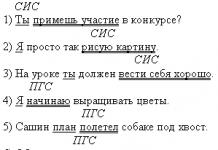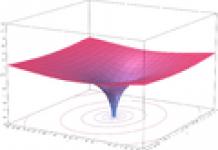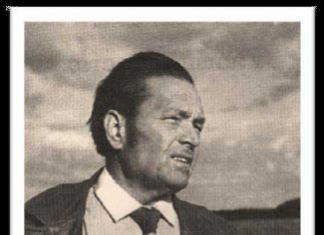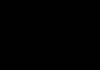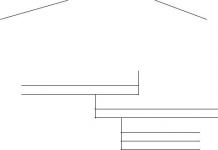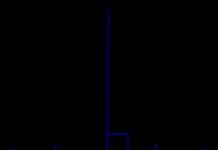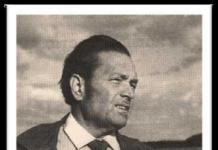Activités de Babur en Asie centrale. Babur, le fondateur de l'empire moghol en Inde, était un Turc Chagatai1. Il était un descendant de Timur dans la lignée masculine directe et, du côté de sa mère, il pouvait prétendre descendre de Gengis Khan.
Son père, Umar Sheikh Mirza, dirigeait Ferghana. Babur est né à Fergana en février 1483. Son père mourut en 1494 et il succéda à la principauté de son père à l'âge de onze ans.
Babur s'est développé exceptionnellement rapidement. Ses oncles paternels aînés et plus jeunes moururent peu après l'un l'autre ; des querelles éclatèrent à propos de la possession de Samarkand, conquise par Babur en 1497, alors que le vainqueur avait à peine quinze ans. Peu de temps après, il perdit cette capitale de l'Asie centrale, entièrement occupé à maintenir son pouvoir à Fergana. Il reconquit ensuite Samarkand, mais cela entraîna un affrontement avec Shey-bani Khan, le chef des nomades ouzbeks, qui battit Babur aux batailles de Sar-i-Pul et d'Akhsi et le chassa de Samarkand et de Fergana.
Ces défaites ont fait de Babur un vagabond, « se déplaçant », comme il l’écrit dans son autobiographie, « d’une case à l’autre, comme un roi d’échecs ». Il réussit à s'emparer de Kaboul en 1504, y renversant l'usurpateur. Ainsi, les circonstances ont attiré l'attention de Babur vers le sud-est. Cependant, Babur a eu une autre opportunité de rétablir sa position en Asie centrale. Sheybani Khan, comme Gengis Khan et Timur, semblait s'efforcer de conquérir le monde. Il s'est attiré l'inimitié de Shah Ismail, le dirigeant safavide de l'empire perse rétabli. Shah Ismail a complètement vaincu Sheibani Khan et l'a tué. Babur, apparemment, a envoyé des cadeaux à Shah Ismail, qu'il considérait comme un hommage. Shah Ismail, en tant que champion du chiisme, a accepté de restaurer Babur à Samarkand et à Boukhara, mais il a apparemment insisté pour que Babur accepte de promouvoir la propagation des doctrines chiites. Bien qu'affaiblis par la mort de Sheybani Khan, les Ouzbeks résistèrent à Babur et celui-ci ne put occuper Samarkand. L'armée perse fut vaincue à la bataille de Gaj Davan ; Les Perses attribuèrent la défaite à la défection de Babur.
Les activités de Babur en dehors de l'Inde ont considérablement influencé ses activités en Inde. Dans les batailles de Panipat et Khanua, nous voyons en Babur un guerrier établi qui a su endurer des épreuves difficiles, a appris le maniement des armes à feu grâce à ses relations avec les Perses et l'utilisation du tulughma (attaque de flanc) dans les guerres avec les Ouzbeks. La tactique ouzbèke consistait à contourner les flancs de l’ennemi et à attaquer simultanément dans une carrière furieuse devant et derrière l’ennemi. La combinaison efficace d'une cavalerie bien entraînée et de nouvelles armes à feu, ainsi que les brillantes tactiques qui ont assuré les victoires de Babur à Panipat et Khanua, étaient les fruits de son expérience en Asie centrale. Un autre facteur qui passe souvent inaperçu est
1 Chagatai était le deuxième fils de Gengis Khan.
HISTOIRE DE L'INDE
dans l'influence que la jeunesse turbulente et les aventures romantiques de Babur ont eu sur la politique moghole en Asie centrale à l'époque de ses successeurs.
Activités en Afghanistan. En avril 1512, les tentatives de Babur pour faire valoir ses prétentions en Asie centrale échouèrent complètement. Après cela, il a déménagé à Kaboul. Kandahar fut capturée en 1512. Les richesses de l’Inde occupaient déjà son esprit entreprenant et taquinaient son imagination. En 1516, il s'occupa de réorganiser l'armée, de fabriquer des canons et d'améliorer les tactiques nécessaires à l'utilisation des armes à feu.
Babur envahit l'Inde pour la première fois en 1519. Il s'est battu contre le Yusuf Zais. Une expédition fut également lancée contre Bijaur en 1520. Étant un descendant de Timur, Babur considérait le Pendjab comme sa possession héréditaire. En 1524, il franchit le col de Khyber, traversa Jhelum et Che-nab et s'approcha de Dibalpur, qu'il tenta de prendre d'assaut. Cependant, il a dû se retirer à Lahore et retourner à Kaboul. Il comptait sur l'aide de deux nobles mécontents de l'État de Lodi, Daulat Khan Lodi et Alam Khan Lodi, qui tournèrent leurs armes contre lui lorsqu'ils comprirent que son objectif était plus la conquête que le vol. Aujourd’hui, la situation a changé. Babur a commencé à se préparer à porter un coup dévastateur à l’État afghan affaibli de Delhi.
Première bataille de Panipat (1526). En novembre 1525, Babur quitta Kaboul et entra au Pendjab avec une armée de 12 000 personnes. Daulat Khan Lodi, qui lui résista, fut vaincu et se reconnut comme vassal de Babur. Du Pendjab, Babur s'est dirigé vers Delhi. Ibrahim Lodi est parti de Delhi pour le rencontrer. Ibrahim Lodi a été décrit par Babur comme « un jeune homme inexpérimenté qui marchait sans précaution, s’arrêtait ou battait en retraite sans aucun plan et entra dans la bataille sans réfléchir ». Une telle personne ne pouvait pas compter sur la victoire sur un guerrier aussi expérimenté que Babur.
La bataille décisive eut lieu le 21 avril 1526 à Panipat, où se décida si souvent le sort de l'Inde. En effet, si l'ennemi venant du nord-ouest ne pouvait être arrêté au col de Khyber, la zone située entre le Sutlej et le Jamna devenait inévitablement le champ de bataille. Étant donné que les rivières du Pendjab étaient guéables à de nombreux endroits en hiver, il était difficile de maintenir une ligne défensive sur la rivière. L'ennemi pourrait facilement le traverser en de nombreux endroits. Naturellement, le point de vue le plus proche pour une bataille décisive était les vastes plaines situées entre Sutlej et Jumna, où l'avantage numérique pouvait être mieux exploité et où l'armée en défense avait Delhi et Agra sur ses arrières.
Ibrahim mena une armée de quarante mille hommes à Panipat. Cependant, cette masse dense de troupes constituait une excellente cible pour les canons de Babur, qui étaient contrôlés par deux ustads (maîtres) spécialisés, Ali et Mustafa. Le terrain plat était bien adapté aux opérations de cavalerie et aux tactiques de flanc de Babur.
Babur a renforcé sa faible ligne avant en plaçant des chariots en rangée pour maintenir les Afghans le long d'un front étendu et ainsi s'assurer qu'il pourrait attaquer les flancs. Ibrahim fut complètement vaincu et le nombre d’Afghans tués fut énorme. Les compétences militaires de Babur et l'excellente interaction de sa cavalerie et de son artillerie lui apportèrent un succès complet. Immédiatement après, il occupa Delhi et Agra. La générosité envers ses partisans et les riches cadeaux offerts à ses amis à Samarkand, Kashgar, Khorasan, Perse et Kaboul ont rendu le nom de Babur célèbre dans des pays lointains, ont créé le désir de l'imiter et l'ont aidé à reconstituer son armée. Il a également réussi à convaincre ses partisans de rester en Inde.
LA LUTTE DES AFGHANS ET DES MOGHALS POUR LE POUVOIR
Rajput et résistance afghane - Batailles de Khanua et Gogra. Deux
Les ennemis que Babur a dû combattre pour assurer sa domination dans l'Hindoustan étaient les Afghans de l'est et les Rajputs sous la direction de Rana Sangram Singh, le dirigeant de Mewar. Les Afghans de l'est, dirigés par Yasir Khan Lohani et Maaruf Farmuli, se sont dispersés lorsque les troupes du fils aîné de Babur, Humayun, sont apparues contre eux. Pendant les huit mois qui se sont écoulés après la défaite d'Ibrahim à Panipat, le pouvoir de Babur s'est étendu d'Attock au Bihar. Multan fut également annexé à ses domaines.
Au sud, le domaine de Babur s'étendait jusqu'à Kalpi et Gwalior. Mais il fallait faire face au danger qui menaçait du Rajputana. Babur a parfaitement compris qu'il lui faudrait rencontrer un guerrier éprouvé. Rana Sanga avait déjà eu affaire à Babur. Ce dernier s'est plaint qu'il y avait un accord entre lui et les Rana selon lequel les Rana attaqueraient Agra lorsque Babur marcherait sur Delhi. Les Rana, à leur tour, se plaignirent qu'en violation de l'accord précédent, Babur avait capturé Kalpi, Dholpur et Biana. Le Sanga a reconnu le sultan Mahmud Lodi, soutenu par les Afghans à l’ouest, comme le prétendant légitime au trône de Delhi.
Le différend entre Babur et les Rana fut résolu lors de la bataille de Khanua (27 mars 1527). La cavalerie Rajput n'a pas pu résister au feu écrasant de Mustafa, la bataille a été acharnée car les Rajputs étaient en infériorité numérique. Mais l’artillerie joue un rôle décisif. Les Rajputs et leurs alliés afghans furent complètement vaincus. La bataille de Khanua a empêché les Rajputs d'établir leur pouvoir dans le nord de l'Inde sur les ruines du sultanat de Delhi. Suite à cela, Medini Rai, l'un des chefs militaires les plus éminents du Rana Sanga, qui commandait l'importante forteresse de Chanderi à Malwa, fut vaincu. Rana mourut le cœur brisé en 1528.
S'étant débarrassé de la menace des Rajputs, Babur se tourna vers l'est contre les Afghans. Les Afghans étaient hostiles les uns aux autres. Les affrontements entre les maisons de Lohani et de Lodi ont porté préjudice aux intérêts afghans. En 1529, le sultan Mahmud Lodi a réuni une partie importante des Afghans sous sa direction. Babur s'est dirigé vers l'est en passant par Allahabad, Bénarès et Ghazipur. Jalal-ud-din Bahar Khan Lohani se soumit à lui. Babur a occupé le Bihar. L'armée de Nusrat Shah, le sultan du Bengale, venue au secours des Afghans, résiste à Babur sur les rives de Gogra. Babur a brillamment effectué la traversée sous un feu nourri. L'armée du Bengale s'enfuit en désarroi. Nusrat Shah a fait la paix avec les Moghols. D’autres dirigeants afghans se sont également soumis. Ainsi, la bataille de la rivière Gogra (6 mai 1529) détruisit, au moins pour un temps, la possibilité d'un renouveau politique pour les Afghans.
Évaluation des activités de Babur. Babur est décédé le 26 décembre 1530. Il semblerait que dans les derniers jours de sa vie, un complot ait été organisé dans le palais pour éliminer son fils aîné Humayun. Si une telle conspiration avait réellement eu lieu, elle se terminerait par un échec complet et Humayun succédait calmement à Babur. Babur, en tant que dirigeant, n'avait pas de capacités exceptionnelles. Il était avant tout un guerrier. L'ancien système de gestion formé spontanément qui existait avant lui a été préservé sous lui. Il a laissé à son fils un vaste empire (s'étendant de l'Amou-Daria au Bihar), qui n'était pas uni et ne pouvait être maintenu que par la force militaire. L’historien anglais Len Poole a décrit à juste titre Babur comme « un lien intermédiaire entre l’Asie centrale et l’Inde, entre les hordes sauvages et l’organisation impériale de l’administration, entre Tamerlan et Akbar ».
HISTOIRE DE L'INDIEN
Autobiographie de Babur. Babur avait de bonnes compétences littéraires et écrivait bien en farsi et en turc. La source la plus importante de nos informations sur ses activités est son excellente autobiographie, initialement écrite en turc, puis réécrite par son fils Humayun et traduite en farsi sous Akbar. Comme le souligne l'historien anglais Elphinstone, «ses mémoires contiennent une description détaillée de la vie du grand monarque turc ainsi que l'expression de ses opinions et sentiments personnels, sans déguisement ni dissimulation, ainsi que par une franchise et une franchise ostentatoires. Son style est simple et masculin, mais aussi vivant et imaginatif. Comme dans un miroir, l’autobiographie de Babur reflète ses compatriotes et contemporains, leur apparence, leurs coutumes, leurs aspirations et leurs actions. À cet égard, c'est presque le seul exemple de véritable description historique en Asie : Babur représente l'apparence, les vêtements, les goûts et les habitudes de chacun et décrit les pays, leur climat, leur paysage, leur économie, leurs œuvres d'art et leur artisanat. Cependant, ce qui donne à l’œuvre son plus grand charme, c’est le caractère de l’auteur lui-même. Il est gratifiant, au milieu de la froideur pompeuse de l’histoire asiatique, de rencontrer un dirigeant qui pouvait pleurer et nous raconter combien il a pleuré la mort d’un camarade de son enfance.»
Dans la revue proposée, préparée à partir de documents provenant de publications indiennes, ainsi que de la publication française « L'Empire indien des Grands Moghols » (« L'Inde impériale des grands moghols » (1997) et d'une publication de l'ONU, nous parlerons de les Grands Moghols - la célèbre dynastie de l'Inde.
Les deux principales attractions indiennes - les cartes de visite du pays - le Taj Mahal à Agra et le Fort Rouge à Delhi sont également celles construites par les Moghols.
Page 1. : Vue générale des Moghols ;
Page 2 : L'héritage de Shah Jahan : le paradis et l'enfer de Jahan – le Fort rouge de Delhi et Shahjahanabad – Old Delhi (publication indienne et ONU) ;
Page 3 : Mausolée Humayun - un monument d'amour et frère aîné du Taj Mahal, et plus tard témoin de la finale de l'histoire des Grands Moghols (publication indienne) ;
Page 4 : « Il voulait reposer dans un tombeau « en plein air, sans aucune superstructure et sans portier ». Tombeau à Kaboul de Babur, le premier empereur moghol (publication indienne) ;
Page 5 : Influence des Moghols et de l'Islam sur le style et l'art indiens (publication indienne) ;
I. La voie indienne des Grands Moghols
Une page d'une des publications citées ici, à savoir un article d'un magazine pour les pays étrangers publié par le ministère indien des Affaires étrangères en plusieurs langues, dont le russe - le magazine "India Perspectives: Articles "Padshahnama: A Visual Display of Mughal Splendor " (sept.
Une page d'une des publications citées ici, à savoir un article d'un magazine destiné aux pays étrangers, publié par le ministère indien des Affaires étrangères en plusieurs langues, dont le russe - le magazine "India Perspectives: Articles "Padshahnama: A Visual Display of Mughal Splendeur" (septembre 1997, russe).).
Cet article rappelle le « Padshahnama » - un récit historique de toute une vie avec des images sur les 10 premières années du règne de l'un des empereurs moghols, Shah Jahan. Voir notre revue.
Les empereurs moghols, qui cherchaient à légitimer leur pouvoir, ont toujours souligné leur affiliation à Gengis Khan et à Timur.
Une miniature moghole de 1630 montre Timur (au centre) donnant la couronne à Babur. Ce qui ne pourrait pas arriver dans la réalité, car... Babur est né près de 80 ans après la mort de Timur (à savoir en 1483, tandis que Timur est mort en 1405).
(Vignette : Victoria and Albert Museum, Londres).
1.1 Les Grands Moghols - les bases d'abord
Ici, nous parlerons de les origines des Grands Moghols, puis, dans les sections suivantes de la revue, nous passerons à des détails intéressants sur les personnages individuels et l'héritage de la dynastie moghole .
Bien que les Grands Moghols soient les descendants de Timur (Tamerlan), le futur fondateur de la grande dynastie moghole, Babur, initialement en 1494-1504. n'était qu'un modeste dirigeant de Fergana (sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel), une entité étatique dépassée par ses voisins et qui avait presque oublié son grand passé timuride.
Timur est un dirigeant turc proto-ouzbek qui, plusieurs générations avant Babur, fonda son propre État turc sur les ruines de l'ulus mongol du deuxième fils de Gengis Khan, Chagatai (sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel). Dans le même temps, le pouvoir nominal de la branche Chagatai des khans mongols a continué d'exister pendant un certain temps après la création de l'État turc en Ouzbékistan, et Timur est même devenu lié aux Mongols.
L'arrière-arrière-petit-fils de Timur, Babur, qui était également du côté de sa mère (à la suite des mariages dynastiques des Timurides avec la noblesse mongole) un descendant probable de Gengis Khan (d'où le nom de la future dynastie - les Grands Moghols), à l'âge de 21 ans, il fut chassé avec ses troupes de l'Asie centrale vers l'Afghanistan par un autre seigneur féodal genghiside-turc Sheybani, qui à son tour fonda sa dynastie ouzbèke sur l'ancien territoire de Babur.
Après s'être établi à Kaboul et en être devenu le dirigeant (de 1504 à 1526), Babur partit à la conquête de l'Inde, où les conquérants extraterrestres musulmans-afghans qui avaient précédemment capturé l'Inde régnaient et fondaient le sultanat de Delhi - le tout premier grand État islamique. dans l'histoire de l'Inde.
Babur a réussi à vaincre l'État de ces coreligionnaires - le sultanat de Delhi et a fondé l'empire moghol en Inde.
Nom propre de l'empire moghol Mughal, et dans la première période Gurkāni (du mongol « gendre du khan », allusion à la parenté des khans mongols et des Timurides, dont descendait la dynastie de Babur).

Le premier Grand Mogol est Babur. Une ancienne miniature moghole, issue de celles conservées à la British Library de Londres.
« Zahir ad-Din Muhammad Babur, le dernier des Timurides, est né en 1483 à Andijan (Chagatai ulus).
Alors que Babur n'avait que 11 ans, il hérita de son père Fergana, une petite possession en Transoxiane.
Les tribus ouzbèkes, qui combattirent les Timurides tout au long du XVe siècle, purent créer un État assez puissant en Transoxiane. Le sage homme politique ouzbek Khan Sheybani a tenté de toutes ses forces d'évincer les Timurides de Transoxiane afin de renforcer son pouvoir sur cette partie de l'Asie centrale.
Babur a vaincu ses adversaires à plusieurs reprises et est entré pour la deuxième fois à Samarkand, où il a été accueilli par des foules en liesse.
À propos de son entrée dans la ville en 1504, Babur écrit :
« La ville dormait encore. Les marchands me regardaient depuis les fenêtres de leurs maisons, ils me reconnaissaient et me félicitaient de ma victoire. La population de la ville a été prévenue à l'avance de mon arrivée. Une joie incroyable régnait parmi la population turque. Les Ouzbeks ont été tués à coups de bâton dans la rue, comme des chiens enragés.» Fin de citation.
Mais le succès fut de courte durée. Les Ouzbeks ont infligé une défaite brutale. Babur, qui n'avait que 21 ans, a été contraint de quitter l'Ouzbékistan.
Le regard de Babur était désormais tourné vers l'Afghanistan. En 1504, Babur parvient à prendre Kaboul, après quoi il prend le titre de padishah (terme persan équivalent au titre arabe de sultan)...
L'édition française moderne « L'Empire indien des Grands Moghols » (L'inde impériale des grands moghols, 1997) écrit :
« Étant un homme modeste et simple de nature, Babur préférait le monde de la nature sauvage aux riches chambres de la cour du sultan. Babur était un croyant ; Il a reçu une bonne éducation et aimait la poésie, il traduisait lui-même des ouvrages de droit et de théologie et composait des poèmes en persan.
À partir de 1520, Babur commença à publier ses mémoires franches, Baburnama, ce qui était très inhabituel pour les dirigeants de cette époque.
Bien que le persan ait longtemps été la langue culturelle de l'Asie centrale, "Baburnama" a été écrit dans la langue maternelle de l'auteur, le dialecte Chagatai de la langue turque.
Plus de « Baburnama » (mémoires de Babur) :
À propos de la mort de la mère de Babur :
« Au mois de Muharram (ici : du 4 juin au 4 juillet), ma mère Kutluk Nigar Khanum a souffert du hasbeh (rougeole). Ils lui ont ouvert le sang, mais il n’y en avait pas assez. Il y avait un médecin du Khorasan avec elle, il s'appelait Seyid. Selon la coutume du Khorasan, il donna une pastèque à la malade, mais comme apparemment son heure était venue, six jours plus tard, samedi, elle reposa à la miséricorde d'Allah..."
À propos du premier voyage infructueux à Samarkand :
« Tout d’abord, lorsque j’ai pris Samarkand, j’avais dix-neuf ans ; J'ai vu peu de batailles et je n'avais aucune expérience. Deuxièmement, mon adversaire était un homme très expérimenté, qui avait assisté à de nombreuses batailles et était vieux de plusieurs années, comme Sheybani Khan ; troisièmement, pas une seule personne ne nous est venue de Samarkand ; bien que les habitants de la ville fussent disposés à mon égard, personne ne pouvait y penser par peur de Sheibani Khan ; quatrièmement, mon ennemi était dans la forteresse, et la forteresse fut prise, et l'ennemi fut mis en fuite ; cinquièmement, je m'étais déjà approché de Samarkand une fois avec l'intention de capturer la ville et j'avais permis aux ennemis de le découvrir ; Quand je suis venu une deuxième fois, le Seigneur m'a aidé et Samarkand a été conquise.
À propos des activités en Afghanistan :
« Nous avons quitté Kaboul pour voler (aux Afghans) les Giljay… »
À propos des qualités combattantes des Indiens :
"Bien que certains habitants de l'Hindoustan soient doués pour couper au sabre, la plupart d'entre eux sont complètement dépourvus du don et de la capacité de se battre, et n'ont aucune idée de la manière d'agir et de se comporter en tant que commandant."
De l'histoire de la façon dont les partisans du sultanat de Delhi, contre lequel il s'est battu, ont tenté d'empoisonner Babur :
« Un dégustateur indien local, un chashnigir, a donné un morceau de poison à l'un des cuisiniers hindoustani qui se trouvait dans notre cuisine et lui a promis quatre parganas s'il mettait du poison dans ma nourriture.
A la suite de l'esclave avec lequel le poison avait été transféré au chashnihir, les conspirateurs envoyèrent un autre esclave pour voir si le premier esclave lui avait transféré le poison ou non.
Heureusement, Chanshigir n'a pas jeté le poison dans le chaudron, mais l'a jeté sur le plat.
Il n'a pas jeté de poison dans le chaudron pour la raison que j'ai fermement dit à nos dégustateurs - les Bakauls - de se méfier des hindoustani, et ils ont goûté la nourriture lorsque la nourriture était bouillie dans le chaudron.
Quand on me servait à manger, nos malheureux bakauls étaient distraits par quelque chose ; le cuisinier posa de fines tranches de pain sur un plat en porcelaine et versa sur le pain moins de la moitié du poison contenu dans le papier.
Au-dessus du poison, il plaça de la viande frite dans l'huile. Si le cuisinier avait versé du poison sur la viande ou l'avait jeté dans le chaudron, cela aurait été mauvais, mais il était confus et a renversé plus de la moitié du poison dans la cheminée.
Je me suis fortement appuyé sur le plat de lièvre, et j'ai aussi dévoré pas mal de carottes frites ; De la nourriture hindoustanie empoisonnée, je n'ai mangé que quelques morceaux posés sur le dessus.
J'ai pris la viande frite et je l'ai mangée, mais je n'ai ressenti aucun mauvais goût. Puis j'ai avalé deux morceaux de bœuf séché et j'ai commencé à me sentir malade...
Avant, je ne vomissais jamais après avoir mangé, même en buvant, je ne me sentais pas malade.
Le doute a éclaté dans mon cœur.
J'ai ordonné que le cuisinier soit arrêté et j'ai ordonné de donner ce que j'avais expulsé au chien et de le garder.
Le lendemain matin, peu avant le premier quart, la chienne se sentait très mal, son ventre semblait gonflé.
Peu importe combien ils lui jetaient des pierres, peu importe combien ils la jetaient partout, elle ne se relevait pas.
Jusqu'à midi le chien était dans cette position, puis il s'est relevé mais n'est pas mort...
Plusieurs gardes du corps ont également mangé cette nourriture. Le lendemain matin, ils vomissaient aussi beaucoup, on se sentait même très mal ; en fin de compte, tout le monde a été sauvé.
Deux hommes et deux femmes impliqués dans le complot ont été interpellés et interrogés. Ils m'ont raconté avec tous les détails comment cela s'est passé...
J'ai ordonné que Chashnigir soit coupé en morceaux, j'ai ordonné que le cuisinier soit écorché vif ; Parmi les femmes, l’une a été jetée aux pieds d’un éléphant, une autre a été abattue avec un fusil et j’ai ordonné l’arrestation de la troisième. Elle aussi deviendra prisonnière de sa cause et recevra la rétribution qui lui est due...
Samedi, j'ai bu une tasse de lait, lundi, j'ai également bu une tasse de lait et j'ai bu de l'argile de phoque plus diluée et un puissant antidote à base de plantes, le teryak. Le lait m'a fait du bien.
Bientôt, j'ai craché une sorte de substance noire, très noire, semblable à de la bile brûlée.
Grâce à Allah, il n'y a désormais aucune trace de la maladie. Jusqu’à présent, je ne savais pas très bien que la vie était si précieuse. Il y a un hémistiche :
Quiconque a atteint l’heure de la mort connaît la valeur de la vie.
Chaque fois que je me souviens de ce terrible incident, je m'énerve involontairement. Par la grâce du grand Seigneur, il m'est arrivé de retrouver la vie. Dans quelle langue vais-je lui exprimer ma gratitude ?
La dynastie moghole régnait sur la majeure partie de l'Indede 1526 à 1858, jusqu'à l'arrivée des Britanniques dans le pays et la fondation de l'Inde britannique, qui à son tour fut remplacée dans ces territoires par l'Inde et le Pakistan modernes.
Comme la dynastie du précédent sultan de Delhi, les Grands Moghols en Inde ont toujours représenté une dynastie étrangère de dirigeants turcophones et iraniens dans une vaste mer de groupes ethniques et de confessions indiennes locales. ovation.
Cependant, au fil du temps, le nouvel élément turco-iranien-musulman est devenu partie intégrante de l’Inde. L'existence même, en particulier, du sultanat de Delhi et de l'État moghol dans l'espace indien a changé l'Inde, même si les auteurs indiens modernes préfèrent dire que cette Inde a changé tous les conquérants.
Les Grands Moghols, leur cour et leur armée, parlaient à l'origine des dialectes turcs et iraniens, adoptés en Asie centrale et en Afghanistan, c'est-à-dire territoires d'où ils sont originaires, ils utilisaient également l'arabe – la langue de leur religion – l'islam.
Par la suite, la coexistence des conquérants musulmans-turcs-perses sous le sultanat de Delhi et l'empire moghol avec la population indigène de l'Inde a conduit à l'émergence progressive d'une nouvelle langue - l'urd. à- un mélange de dialectes turcs, iraniens et hindi avec un mélange d'arabe.
Dans le Pakistan moderne, État créé par les musulmans indiens lors de la partition de l’Inde britannique, l’ourdou (avec l’anglais) est la langue officielle.
En Inde, environ 500 millions de personnes sur 1 milliard 210 millions parlent l'ourdou. sa population (2011). L'ourdou a un statut officiel dans les États indiens suivants : Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Jammu-et-Cachemire, Bengale occidental et dans la capitale Delhi. L'ourdou est désormais appelé la langue des musulmans indiens.
L'intégration du régime moghol dans la société indienne a été facilitée par le fait qu'au début de leur règne, les Moghols ont mené une politique de tolérance envers la foi de leurs sujets indiens.

La naissance du futur Grand Mogul Jahangir (règle de 1605 à 1627). Miniature moghole 1610-1615. de la biographie de Jahangir « Jahangirname ».
En 1562, Akbar épousa la fille de Raja Amber Mariam, qui en 1569 donna naissance à son fils Jahangir.
Ainsi, la dynastie Rajput est finalement devenue liée à la dynastie Moghole.
Les princesses Rajput en poste à la cour moghole furent autorisées, à leur demande, à pratiquer leur foi hindoue dans un petit temple spécialement construit.
Le grand empereur moghol est devenu particulièrement célèbre pour sa tolérance envers les hindous.
Akbar, dans sa tolérance, a même tenté de créer une nouvelle foi basée sur l'islam, le zoroastrisme et l'hindouisme. Il affirmait : « Seule est vraie la foi qui est approuvée par la raison » et « De nombreux imbéciles, fans des traditions, prennent la coutume de leurs ancêtres comme une indication de la raison et se condamnent ainsi à la honte éternelle. » ()
Akbar a activement nommé des seigneurs féodaux hindous à des postes élevés. Sous lui, l’empire connut une prospérité sans précédent.

La très importante population musulmane de l'Hindoustan s'est facilement soumise aux conquérants, mais les adeptes de l'hindouisme, par exemple la noblesse militaire hindoue des Rajputs, se sont activement opposés au nouveau régime.
Le dirigeant Rajput de la principauté de Mewar au Rajasthan, Rana Sanga, est devenu son principal adversaire pour la première fois après la conquête de l'Inde par Babur.
Une guerre éclata entre Rana Sanga et le nouveau souverain de Delhi, qui se termina par la victoire de ce dernier à la bataille de Khanua (mars 1527).
Au cours de la conquête, Babur a déclaré une guerre sainte contre les infidèles, élargissant les frontières du nouvel État et réprimant les soulèvements qui éclataient constamment.
Cependant, Babur a également essayé de faire preuve de tolérance.
Ici, dans une miniature moghole tirée de la biographie de Babur « Baburnama », le souverain rend une visite de bienvenue aux ermites ascétiques indiens.
En général, Babur n'aimait pas trop l'Inde. Il ressentait la nostalgie des montagnes d'Asie centrale et disait que « dans les villes indiennes, il n'y a pas d'eau vive du tout », et c'est pourquoi à Agra, où Babur a déplacé la capitale de Delhi, ce grand magnat a construit de nombreux jardins.
Vidéo: Le monde coloré de l’empereur Akbar :Le long métrage indien épique et coloré Jodha et Akbar (2007) dépeint le règne de l'empereur Akbar. Nous présentons ici quelques scènes.
Tout d’abord, Akbar visite incognito les pâtés de maisons et les magasins d’Agra. Il apprend le coût élevé et le fait que par rapport aux hindous, ses ancêtres - les dirigeants moghols, connus pour être musulmans, après la conquête de l'Inde, ont établi une taxe spéciale sur les non-Russes pour le droit de visiter les temples hindous. .
Lors d'une cérémonie au palais, Akbar abolit l'impôt, malgré le fait que le clergé musulman s'y oppose. Vient ensuite une scène impressionnante d'Akbar faisant l'éloge de ses serviteurs avec des chants et des danses auxquelles participent des centaines de personnes. Les sujets chantent :
"Vive l'Empereur, notre Dieu,
Les mots ne suffisent pas pour vous féliciter.
Vous êtes la fierté de l'Inde, vous êtes notre vie et notre âme !
Louange à notre Seigneur, votre religion est amour.
Vous gouvernez un million de cœurs. »
Vient ensuite la scène de préparation à la distribution de l'aumône, lorsqu'Abar est pesé sur des balances spéciales, et de l'or et des bijoux égaux à son poids seront distribués en aumône.
Notez que Jodha dans le film est le nom de la princesse hindoue fictive qu'Akbar a épousée. Bien qu'Akbar soit effectivement marié à une princesse hindoue Rajput.
empereurAkbar mourut de dysenterie le 27 octobre 1605."Avec ayant créé pendant plus de 50 ans de règne un grand empire comparable à l'État safavide en Perse et à l'Empire ottoman turc » , note mélancoliquement l'édition française moderne de L'Inde impériale des grands moghols (1997).
D'autres empereurs de la grande dynastie moghole ont périodiquement mené une politique stricte de rejet de la foi de leurs sujets indiens, pour laquelle, par exemple, le musulman zélé et ascétique - l'empereur moghol - est devenu particulièrement célèbre.
1.2. Les six empereurs les plus célèbres de la dynastie moghole

L'illustration montre les six premiers dirigeants de la dynastie moghole. Ils sont représentés sous forme de miniatures de style indo-islamique, datant pour la plupart de leur vivant.
De gauche à droite, en commençant par la rangée du haut :
Fondateur de la dynastie Babur ;
le deuxième empereur Humayun, qui a failli perdre son empire ;
Le troisième empereur, qui mena une politique de tolérance envers tous ses sujets et renforça l'empire - Akbar ;
Le quatrième empereur et père de Shah Jahan est Jahangir ;
Le cinquième empereur est le bâtisseur du Taj Mahal, Shah Jahan ;
Le sixième empereur et fils de Shah Jahan et de Mumtaz, qui a radicalement changé la politique de tolérance éclairée des Moghols, est un musulman fanatique - l'empereur Aurangzeb, qui a emprisonné son père.
En conclusion de cette partie sur la dynastie moghole, nous donnerons une liste des années de règne des six premiers et plus célèbres empereurs moghols, et parlerons également du titre des Grands Moghols. Donc:
1 . Babur (Babur, Zahir ad-din Muhammad) : 1526-1530 ( Le nom Babur est traduit de l'arabe. signifie "léopard");
2 . Humayun ((Humayun, Nasir-ud-din Muhammad) : 1530-1540 et après avoir reconquis ses possessions 1555-1556 ( le nom Humayun traduit du persan. signifie "heureux"), était le fils de Babur ;
3 . Akbar (Abul Fatah Jalaluddin Muhammad) : 1556-1605 ( Le nom Akbar est traduit de l’arabe. signifie "super"), était le fils de Humayun ;
4 . Jahangir (Jahangir, Abul-Fath Nur ad-din) : 1605-1627 ( le nom Jahangir traduit du persan. signifie « Conquérant du monde »), était le fils d'Akbar ;
5 . Shah Jahan, Shihab ad-din Muhammad Khurram : 1628-1658 ( le nom Shah Jahan traduit du persan. signifie « Seigneur, roi du monde »), était le fils de Jahangir ;
6 . Aurangzeb (Abul-Muzaffar Muhyi ad-din Muhammad Aurangzeb) : 1659-1707 ( Le nom Aurangzeb signifie « ornement du trône » en persan., contrairement aux empereurs moghols mentionnés ci-dessus, Aurangzeb est mieux connu sous son nom, et non sous son nom de trône adopté. Alamgir I (« conquérant de l'univers »), était le fils de Shah Jahan ;
Le 17e (et si l'on compte les dirigeants contestés, alors le 20e) et dernier empereur de la dynastie moghole fut (Bahadur, Siraj ud-Din Abu-l-Muzaffar Muhammad Zafar), règne (mais nominal, sous domination britannique) : 1837 -1858 (le nom Bahadur signifie « héros »), était un lointain descendant de Babur ;
Notons qu'il était d'usage pour les empereurs moghols d'adopter des noms pompeux « parlants » lors de leur accession au trône.
1.3. Titre moghol
Le nom propre du titre des empereurs de la grande dynastie moghole est padishah, ou plutôt Padshah-i-Ghazi.
Le titre "padishah" vient des mots persans "pati" - "seigneur" et "shah" - "souverain", en d'autres termes, il s'avère que "seigneur des rois", "roi des rois"). Ghazi signifie « guerrier de l’Islam ». Ainsi le titre Padshah-i-Ghazi signifie « souverain, chef des rois et guerrier de l’Islam ».
Padshah-i-Ghazi est le titre principal de tous les empereurs de la dynastie moghole, depuis Babur jusqu'à la toute fin de la dynastie en 1858.
Dans le même temps, le titre de Padshah-i-Ghazi pour un certain nombre d'empereurs moghols (mais pas pour le fondateur de la dynastie Babur) fut complété par le titre de Shahanshah (« roi des rois »), proche dans le sens de « seigneur des rois » et sa version étendue Shahanshah-i-Sultanate-ul-Hindia-wa-l-Mughaliya, qui peut être traduit par « roi des rois de l'Inde moghole ». Ce dernier titre en Occident était traduit par Padishah de l'Hindoustan, ou empereur de la grande dynastie moghole, ou simplement Grand Mogol.
Les empereurs de la dynastie moghole avaient également un certain nombre d'autres titres supplémentaires : Les premiers Moghols : al-Sultan al-Azam (« grand sultan ») et l'ancien titre Chingid al-Khakan al-Mukarram (lit. « khagan vénéré »). ; Akbar a aussi Amir al-Muminin (« commandant des fidèles »), Zillullah (« ombre d'Allah »), Abul-Fath (« Père des victoires »), Jalal ad-din (« grandeur de la foi ») ; Le titre de padishah de Shah Jahan a été complété par le titre similaire Shahanshah (« roi des rois »). Shah Jahan a également utilisé le titre Abul Muzaffar (« victorieux ») Malik-ul-Sultanat (« roi des rois »), Ala Hazrat (« respecté »), Sahib-i-Qaran-e-Sani « seigneur qui rayonne la lumière directrice » ) .
Titre de Babur : al-Sultan al-Azam wa-l-Khakan al-Mukkarram Padshah-i-Ghazi ;
Titres d'Akbar : Amir al-Muminin Zillullah, Abul-Fath Jalal ad-din Padshah-i-Ghazi Shahanshah-i-Sultanate-ul-Hindia-wa-l-Mughali et un certain nombre d'autres ;
Titre de Shah Jahan : Shahanshah as-Sultan al-Azam wa-l-Khakan al-Mukkarram Malik-ul-Sultanate Ala Hazrat Abul-Muzaffar Sahib-i-Qaran-e-Sani, Padshah-i-Ghazi, Zillullah, Shahanshah- i-Sultanate-ul-Hindia-wa-l-Mughaliya et plusieurs autres ;
1. 4 Capitale des Grands Moghols
Comme l’écrit la publication française moderne sur l’histoire des Grands Moghols, L’Inde impériale des grands moghols (1997) :
« Les Grands Moghols utilisaient plusieurs villes comme capitale. Il s'agissait de Delhi, Agra, Lahore et de la nouvelle forteresse de Delhi - Shahjahanabad. Parfois, le tribunal se déplaçait à Kaboul ou à Fatehpur Sikri.
Par exemple, l’empereur Akbar visitait souvent Fatehpur, car c’était sur la route d’Agra à Ajmir, qui était le centre indien du soufisme. Un jour, l'empereur, qui n'espérait plus avoir un jour un fils, fut prédit qu'il aurait bientôt un héritier. Et en effet, un miracle s'est produit : en 1569, le prince Salim (le futur empereur moghol Jahangir) est né. Après cela, Akbar a décidé de quitter Agra, ce qui lui a rappelé des problèmes familiaux, et a déménagé la capitale à Fatehpur Sikri. Le choix d'un nouveau site devait également symboliser une rupture avec la tradition des prédécesseurs d'Akbar, qui régnaient soit à Delhi, soit à Agra.
En 1585, Akbar, fondé sur des intérêts stratégiques, déménagea sa résidence à Lahore.
Contrairement à ses prédécesseurs, Jahangir n’a pas construit de nouvelles capitales. Agra et Lahore sont restées les principales villes de l'empire, même si les menaces extérieures et les troubles politiques internes ont parfois forcé Jahangir à déplacer sa cour à Kaboul, Ajmir ou Mandu. Le Cachemire et la ville de Srinagar sont devenus une station balnéaire pour Jahangir.
Voulant perpétuer son nom, Shah Jahan, ayant accédé au trône impérial, entame une construction active : sous lui, l'apparence des deux principales villes de l'État : Agra et Lahore, change sérieusement. De plus, afin de déplacer le centre de l'empire vers la capitale de son ancêtre Humayun, Shah Jahan a ordonné la construction d'une nouvelle forteresse à Delhi - Shahjahanabad. Elle a été fondée en 1639 et en 1648 la construction de la ville fortifiée fut achevée.
Aurangzeb a déplacé la capitale à Aurangabad, qui y est restée pendant un certain temps. Fin de citation.
II. Chronique du règne des Grands Moghols : De Babur à Jahangir

Grand Moghol Jahangir.
Lors de la cérémonie d'initiation en tant que padishah, Selim prit le nom de Jahangir, c'est-à-dire « conquérant du monde », qui symbolisait les revendications mogholes à la domination mondiale.
Une miniature mongole de 1640 montre Jahangir menant un lion (symbole de la dynastie moghole), accompagné de son vizir (représenté à droite).
Cette miniature est conservée à l'Institut d'études orientales de Saint-Pétersbourg.
1526 Victoire de Babur à la bataille de Panipat (villages au nord de Delhi) contre le sultan du sultanat de Delhi, Ibrahim Lodi.
À Agra, Babur a rencontré son fils Humayun, qui lui a remis ce qu'il avait capturé ici. (Koh-i-Noor, lit. du pers. « montagne de lumière »), dont la valeur a été estimée à une somme suffisante pour subvenir aux besoins du monde entier pendant deux jours et demi.
Cependant, Babur a refusé un cadeau aussi coûteux et a restitué le diamant à Humayun, qui en est ensuite devenu propriétaire.
1526-1530 Le règne de Babur en Inde. Babur était avant tout un conquérant, pas un dirigeant.
Il a réussi à étendre le territoire de son nouvel empire, mais n'a en même temps entrepris aucune réforme..
Le pays a conservé la division en provinces (pargana), adoptée sous le sultanat de Delhi, où régnaient des gouverneurs semi-autonomes dotés de leur propre armée ;
Babur se distinguait par sa tolérance religieuse, même s'il considérait ses conquêtes comme dédiées à Allah.. Babur n'a gouverné l'Inde que quatre ans ; il est mort peu de temps après.
1530-1540 Premier règne de Humayun.
En octobre 1530, Humayun tomba gravement malade. Les médecins de la cour se préparaient déjà à annoncer la mort du fils du souverain et héritier du trône, mais Babur lui-même mourut subitement.
À partir de 1520, Humayun régna comme gouverneur de la province du Badakhshan. Il était fidèle à Babur et ne s'est jamais rebellé contre lui. Selon la légende, Babur a imploré la vie de Humayun avec sa mort.
À propos des premières dynasties musulmanes de l'Inde (avant les Moghols)
« Dès le début du VIIIe siècle, l'islamisation de la Perse et des peuples nomades turcs d'Asie centrale s'accélère. Tombées sous la domination des conquérants musulmans, les tribus turques adoptèrent leur culture arabo-persane.
Cavaliers habiles et excellents archers, les nomades faisaient partie de l'armée du califat de Bagdad. Sur cette base, certains historiens concluent que même si le pouvoir politique est resté entre les mains des Arabes et des Perses, la puissance militaire du monde musulman est passée aux Turcs. L'affaiblissement du califat de Bagdad au Xe siècle a conduit à l'émergence de nombreux pays indépendants. États et principautés d'Asie centrale, leur modèle administratif a été construit à l'instar de celui persan.
Au début du XIe siècle, le commandant musulman Mahmud Ghaznavi (de Ghazni, en Afghanistan. Site approx.) conquit certaines régions du nord de l'Inde et y fonda la ville de Lahore en 1022, qui devint la première capitale de la dynastie musulmane.
À la fin du XIIe siècle, le souverain de la petite principauté d'Asie centrale de Gur, située entre Ghazni et Herat, Ghiyas ud-din Muhammad Ghuri envahit le territoire de l'État Ghaznavid et le détruisit.
À partir de 1191, Muhammad Ghuri commença à étendre son influence en Inde., qui a conduit à un affrontement avec Prithviraja III (Rai Pithora dans la tradition persane), devenu un symbole de la résistance hindoue (Rai Pithora dirigeait le territoire des États indiens modernes du Rajasthan et de l'Haryana, sa capitale était Delhi. Remarque site Internet). Malgré la victoire de Tarain (1191), le dirigeant musulman dut mener une lutte acharnée pour renforcer son pouvoir en Inde.
Après avoir capturé Delhi, Muhammad Guri a transféré les terres conquises aux Turcs mu esclave-gulam (du mot arabe « gulam » - esclave ou garçon) et le chef militaire Qutb-ud-din Aibek, après quoi il retourna à Gur. Après la mort de Muhammad Ghuri en 1206, Ktgb ud-din Aibek se proclama sultan de l'Inde, marquant ainsi le début de la dynastie dite des esclaves.
Le sultanat de Delhi dépendait théoriquement du califat de Bagdad, mais déjà au milieu du XIIIe siècle, il acquit son indépendance. À partir de ce moment, le sultanat de Delhi a pratiquement perdu le contact avec le Moyen-Orient, berceau de l'Islam.
La « dynastie des esclaves » (1206-1290) a été remplacée par la dynastie Khilji (1290-1320). Le sultan Ala ud-din (1296-1316) glorifie la dynastie Khilji, dont le règne s'avère néanmoins de courte durée. Durant cette période (début du XIVe siècle), le Bengale était sous la domination de représentants de la noblesse turque, dont beaucoup ont fui les Mongols vers l'Inde.
La dynastie Tughlaq supplanta les Khilji en 1320. Les sultans de cette dynastie marquèrent le début de l’expansion de l’influence musulmane vers le sud de l’Inde. En 1328, Muhammad Shah Tughlaq (1325-1351) déplaça la capitale de Delhi à Devagiri, qui fut rebaptisée Daulatabad. Cependant, le sultan ne parvint pas à prendre pied dans le Deccan et, en 1337, il retourna dans l'ancienne capitale.
En 1347, la ville de Daulatabad se sépara du sultanat de Delhi et l'ancien chef militaire Ala ud-din Bahman, devenu fondateur de la dynastie bahmanide, fut proclamé souverain du Deccan (le plateau au centre de l'Hindoustan).
Les Bahmanides ont réussi à maintenir le contrôle sur la majeure partie du Deccan pendant plus d'un siècle. Mais au XVe et au début du XVIe siècle, le sultanat bahmanide s'est divisé en plusieurs royaumes : Bijapur, Ahmadnagar et Bidar. Bijapur et Golkoda sont devenus célèbres pour leur richesse.
A la fin du XIVe siècle, l'État Tughlaq, en proie à l'anarchie, ne parvient pas à résister à la nouvelle invasion des musulmans venus d'Asie centrale sous la direction du grand conquérant Timur.
La dynastie Tughlaq ne s'est jamais remise de la campagne de Timur. En 1414, la dynastie Sayyid accède au pouvoir. Au début des années 50 du XVe siècle, la dynastie Sayyid était finalement tombée en déclin ; Bahlul Khan Lodi a acquis une influence significative à la cour de Delhi. En 1451, il devient sultan du sultan de Delhi, fondant la dynastie qui porte son nom.
Après la mort de Bahlul en 1489, son fils Sikandar Shah accède au pouvoir, réussissant à vaincre la résistance de certains courtisans.
En 1517, Ibrahim Shah Lodi monta sur le trône de Delhi. Ce sultan a activement lutté contre la rébellion et la rébellion des seigneurs féodaux, il a même mené une campagne réussie contre la ville de Jaunpur, où régnait l'un de ses proches parents.
Cependant, ni les victoires militaires ni les représailles brutales n’ont contribué à renforcer l’unité du sultanat, qui restait encore une entité très lâche. C’est ce qui a largement prédéterminé l’effondrement du sultanat de Delhi.
L'oncle d'Ibrahim, Alam Khan, qui luttait pour le pouvoir, entra en correspondance avec le dirigeant de Kaboul, Babur, l'exhortant à débarrasser l'Inde de la tyrannie d'Ibrahim.
Babur, qui n'attendait qu'une telle opportunité, envahit le territoire du sultanat de Delhi. En 1524, son armée traverse l'Indus et assiège Lahore. Lorsque la ville fut prise, Babur marcha vers Delhi. »
L'Inde musulmane avant l'arrivée des Moghols (Chronologie)
711-713 La conquête de la région du Sind (qui fait aujourd'hui partie du Pakistan) par les musulmans, à savoir Muhammad bin Qasim, le commandant du califat arabe de la dynastie omeyyade, âgé de 18 ans, et donc l'arrivée de l'islam en Inde.
998-1030 Conquête de Delhi et du nord de l'Inde (par le souverain afghan de la dynastie turque) Mahmud de Ghaznev Et
1022 Fondation de Lahore par Mahmud de Ghazni
1175-1193 Conquête du Sind, du Pendjab et de Delhi par l'armée de (un autre dirigeant afghan de la dynastie perso-tadjik) Muhammad Ghor
1204 Conquête du Bengale par le sultanat de Delhi
1210-1290 Une dynastie d'anciens esclaves (ghulams) règne sur le sultanat de Delhi
1290-1320 Dynastie Khilji du sultanat de Delhi
1320-1414 Dynastie Tukluq du sultanat de Delhi
1398 Campagne de Timur (Tamerlan) en Inde
1414-1451 Dynastie Sayyid dans le sultanat de Delhi
1451-1526 Dynastie Lodi du sultanat de Delhi
1498 L'arrivée des Portugais à Calcutta
(D'après l'édition française moderne L'Inde impériale des grands moghols (1997).
Site Web préparé
Humayun, connu pour sa gentillesse et sa miséricorde, respectait les coutumes turco-mongoles de ses ancêtres, il accepta donc de partager le pouvoir avec ses frères.
Ainsi, il fut proclamé padishah et ses frères reçurent à leur disposition des zones distinctes de l'empire : Kamran - Kaboul et Pendjab, et Askari et Hindal - jangirs (lotissements) sur le territoire au nord-est de Delhi.
Le jeune empire était en danger : les dirigeants afghans, rajpoutes et indiens, se rendant compte qu'il n'y avait pas d'unité dans l'État de Humayun, augmentèrent constamment la pression politique et militaire.
Le Gujarat se sépara immédiatement et son sultan Bahadur Shah (1526-1537) se tourna vers les Portugais pour obtenir de l'aide dans la lutte contre les Moghols.
Cependant, cette démarche ne l'a pas aidé à remporter la victoire : il a perdu la guerre et a été contraint de se cacher dans la colonie portugaise de Diu, tandis que Humayun occupait la capitale du Gujarat, Ahmedabad.
Bientôt, Bahadur Shah, avec le soutien des Portugais, put récupérer ses possessions, et ainsi le Gujarat fut complètement perdu, et la dynastie Ahmad des Shahs y fut à nouveau établie.
A l'est, au Bihar et au Bengale, l'empereur Humayun affronte un redoutable ennemi - Sher Shah Suri, "sher" traduit par "lion") de la dynastie pachtoune Sur, qui avait servi son père Babur lors de la conquête du sultanat de Delhi.
Shere Khan (il ne fut proclamé Sher Shah qu'en 1540) ne s'entendit pas avec la noblesse turco-mongole de Babur et partit servir l'un des dirigeants afghans de l'Inde orientale.
Profitant du fait que Humayun était occupé à lutter pour le contrôle de l'Inde occidentale (Gujarat), Shere Khan prit possession du Bengale. Humayun décide d'en finir avec son dangereux rival et lance une attaque contre la capitale du Bengale, Gaur, forçant Shera Khan à se retirer dans la forteresse de montagne de Rohtas.
Cependant, l'indécision et les conditions météorologiques défavorables ont empêché Humayun de capitaliser sur son succès.
Shere Khan lance une attaque surprise contre les troupes de Humayun et leur inflige une lourde défaite, obligeant l'empereur à abandonner l'armée et à fuir.
Après cette victoire, Shere Khan fut couronné sous le nom de Sher Shah Sur, ce qui marqua la victoire temporaire du clan afghan dans la lutte pour le pouvoir sur l'Hindoustan.
Le jeune souverain de Perse, Shah Tahmasp, a fourni un refuge à Humayun et une nouvelle armée à l'ancien empereur, car il le considérait comme un allié potentiel dans la lutte contre les Turcs et les Ouzbeks.
En échange d'une aide pour Après la restitution de ses biens perdus, Tahmasp a exigé que Humayun se convertisse au chiisme (Humayun, comme tous les Grands Moghols, était un musulman sunnite), et en plus, il a cédé Kandahar, qui était alors sous le règne de Kamran, le frère de Humayun.
Humayun accepta la première condition concernant la religion, mais n'abandonna pas Kandahar, où il commença à se gouverner lui-même après des représailles contre son frère (Kamran fut aveuglé et envoyé à La Mecque).
1540- 1545 Règne de Sher Shah (Sher Khan) Sur.
1555-1556 Retour de Humayun en Inde.
La mort accidentelle de Sher Shah dans une explosion de poudre à canon en 1545 met fin au règne de ce grand souverain, qui poursuivait une politique de tolérance religieuse tout en unifiant l'Inde.
Ses héritiers n'avaient pas le talent dont leur père était doté et ne pouvaient donc pas maintenir le contrôle de l'État, déchiré par une lutte continue pour le pouvoir. Le fils de Sher Khan, Sur Islam Shah, devenu dirigeant de Delhi après la mort de son père, mourut en 1554.
Humayun, qui régnait alors à Kaboul, n’attendait qu’un moment opportun pour mettre fin à la dynastie afghane Suri en Inde.
Ainsi, Humayun commença sa campagne en capturant Lahore, qui protégeait la route de Delhi. Et en juillet 1555, le dirigeant autrefois exilé entra à Delhi.
1556-1605 Le règne d'Akbar(accède au trône à l'âge de 14 ans).
Akbar, le fils de Humayun, est né le 15 octobre 1542 dans la forteresse d'Umarkot, située à la frontière avec le désert du Thar.
Akbar, qui a passé la majeure partie de son enfance dans des déplacements sans fin, a cependant reçu une excellente éducation et une bonne formation physique. Le garçon a fait preuve d'une capacité et d'une diligence considérables dans l'étude des métiers militaires, mais la science était un peu plus difficile pour lui.
En 1554, Akbar était déjà un véritable guerrier et participa directement à la campagne de son père en Inde.
La guerre fut un succès et Humayun redevint le dirigeant du nord de l'Inde. Mais après sa mort inattendue en 1556 (Humayun mourut d'un traumatisme crânien, quelques jours après l'avoir subi, en trébuchant dans un escalier raide), Akbar fut proclamé empereur.
1561-1577 L'expansion de l'empire sous Akbar et l'annexion du Bengale (où les dirigeants afghans étrangers ont continué à régner), du Rajasthan (où les Rajputs hindous avaient auparavant régné sur plusieurs principautés désunies) et du Gujarat (où la dynastie indo-musulmane qui s'était séparée de le sultanat de Delhi avait déjà gouverné)
1571 Fondation de Fatehpur Sikri (la nouvelle capitale d'Akbar près d'Agra (aujourd'hui dans l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde)
1572-1580 Les grandes réformes d'Akbar:
1. Diviser le pays en provinces et abolir les postes héréditaires de gouverneurs ;
2. Introduction d'un système fiscal ordonné, indépendant des gouverneurs locaux ;
3. Création d'un gouvernement collégial de quatre ministres au lieu d'un vizir ;
4. Privation de l'Islam comme religion d'État, suppression de l'impôt sur les non-croyants - jizya et la proclamation du persan comme langue nationale ;
5. Construction du réseau routier et renforcer la sécurité routière par la création de postes douaniers ;
6. Remplacement du calendrier musulman par le calendrier zoroastrien.
Akbar était d'abord un musulman sunnite, mais il fut ensuite fasciné par l'idée de développer sa propre doctrine du din-i illahi (en arabe pour « foi divine »), qui était à la fois une croyance en l'islam, le christianisme, l'hindouisme et l'hindouisme. Zoroastrisme et pratique de rituels individuels de ces religions.
1585-1598 Le séjour d'Akbar à Lahore
1600 Création de la Compagnie des Indes orientales par charte royale britannique pour faire du commerce en Inde
1602 Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales
Partie II de la chronologie moghole :
(La chronologie utilise les données de L’Inde impériale des grands moghols (1997)
III. Shah Jahan sur fond de Taj Mahal et de ses proches

Le symbole le plus célèbre de l'héritage des Grands Moghols et de Shah Jahan est le Taj Mahal sur la rivière Jamna (Yamuna), un affluent du Gange à Agra.
Vue aérienne.
Lorsque le futur Shah Jahan naquit en 1592, son grand-père, l'empereur Akbar, avait déjà conquis tout le nord de l'Inde, il fut si heureux de la naissance de son troisième petit-fils qu'il lui donna le nom de Khurram, qui signifiait (« Joie »). , écrit une publication française moderne sur l'histoire des Grands Moghols L'inde impériale des grands moghols.
Le fils aîné de Shah Jahan, Dara Shikoh (1615-1659), passe du temps dans son harem, avec sa femme à ses côtés.
D'après un tableau peint vers 1630-1640.
La relation de Khurram avec son père, Jahangir, qui succéda à Akbar sur le trône impérial, était plutôt confiante, mais il reprochait souvent à son père son addiction au vin. Khurram était le bras droit et l'héritier de Jahangir, mais à partir de 1623 un conflit éclata entre lui et l'empereur.
L'émergence de cette querelle a également été facilitée par les intrigues de l'épouse de Jahangir, Nur-Jahan, qui, voulant conserver le pouvoir même après la mort de son mari, s'est appuyée sur le faible prince Shahryar. Jahangir a cédé à la pression de sa femme et a commencé à favoriser son plus jeune fils,
À l'automne 1627, alors que Jahangir était mourant, diverses factions politiques commencèrent à se battre pour la victoire de leurs candidats dans la lutte pour le trône.
Khurram, qui se trouvait alors dans le Deccan, reçut de Jahangir l'ordre de regagner la capitale. En novembre, après avoir appris la mort de Jahangir, Shahryar se proclame empereur et prend possession de toutes les richesses de la capitale, Lahore. Khurram, qui bénéficiait d'un large soutien au sein de l'armée, était confiant dans sa victoire. Il a ordonné de renverser Shahryar et de s'occuper du reste des prétendants au trône. Nur Jahan fut écartée du pouvoir et vécut ses jours dans le calme de sa résidence privée (elle mourut en 1645).

Dans une miniature moghole datant de ca. 1725, représente l'épouse de l'empereur Jahangir, l'impérieuse Nur Jahan, que les historiens opposent généralement au pouvoir politique boudé de Mumtaz Mahal.
Il est intéressant de noter que dans cette miniature, Nur Jahan est représentée par un artiste qui a vécu avec elle au siècle suivant, sous la forme d'une fille de vertu presque facile. Selon une version, elle aurait commencé sa vie en tant que captive d'un harem, même si, par origine, elle appartenait à une famille noble.
Khurram, prit le nom de Shah Jahan dès son accession(rappelez-vous, les années de son règne étaient de 1628 à 1658).
Il mena des campagnes de conquête sur le plateau du Deccan, dans l'Hindoustan, contre des principautés musulmanes indépendantes (à propos des conquêtes de Shah Jahan dans la nôtre). Il est également revenu à une politique plus dure envers les non-croyants par rapport à la ligne d’Akbar.
Toutes les tentatives des Rajputs hindous de résister au nouveau gouvernement ont été rapidement réprimées. De plus, malgré son attachement au sunnisme, l'empereur a décidé de limiter les fonctionnaires musulmans qui recevaient des pouvoirs trop larges.
De plus, en 1632, en raison du mécontentement croissant des musulmans orthodoxes, l'empereur fut contraint d'ordonner la destruction de certains temples hindous, notamment à Bénarès, afin de s'assurer à nouveau le soutien de l'aile conservatrice des musulmans. Quelque temps plus tard, des mosquées furent érigées sur le site des sanctuaires hindous détruits.
Shah Jahan a même tenté d'interdire aux hindous de pratiquer certaines pratiques religieuses, comme l'incinération des corps des morts.
L'empereur abandonne la politique de tolérance et de tolérance, les persécutions commencent pour des raisons religieuses : désormais, les hindous doivent porter des tuniques boutonnées à gauche, et les musulmans doivent boutonner leurs vêtements à droite. Shah Jahan a annulé de nombreuses réformes d'Akbar, telles que l'introduction de la foi divine et l'instauration de la prosternation obligatoire devant le trône impérial...
Shah Jahan a restauré le vieux Delhi au statut de capitale d'Agra, qui avait été la capitale sous son père, Jahangir. Shah Jahan commença également à construire une magnifique ville fortifiée (aujourd'hui le Fort Rouge) dans la banlieue de Delhi.
Mais tout cela n’aurait guère glorifié Shah Jahan parmi ses descendants autant qu’aujourd’hui.
Shah Jahan est entré dans l'histoire pour une raison complètement différente - grâce à la construction du Taj Mahal (traduit du persan par « Couronne des palais »), un tombeau en l'honneur de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, et aussi parce qu'à la fin de sa vie, il a été renversé par son fils Aurangzeb.
Habituellement, à ce stade des histoires sur Shah Jahan, de nombreuses sources écrivent que le grand magnat déchu Shah Jahan a été contraint dans les dernières années de sa vie et jusqu'à sa mort, alors qu'il était en état d'arrestation, de contempler son chef-d'œuvre - le Taj Mahal - à travers les barreaux. de la fenêtre.
Mais, par exemple, dans celui que nous donnons matériel de l'auteur indien Appasami Moo Rugayan déclare qu'Aurangzeb gardait son père au Fort Rouge à Delhi. Et le Taj Mahal, comme vous le savez, est situé à Agra, à plusieurs centaines de kilomètres de Delhi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un Fort Rouge là-bas - beaucoup plus grand que celui de Delhi, également construit par l'empereur moghol, mais pas par Shah Jan, mais par son grand-père Akbar.
ET Sur la base de ce qui précède, la plupart des auteurs qui citent peut-être la légende de l'empereur moghol déchu contemplant depuis son donjon sa création architecturale, construite en l'honneur du grand amour, confondent simplement le Fort Rouge d'Agra et de Delhi. Cependant, il convient de noter que sous les Grands Moghols, le Fort Rouge de Delhi s'appelait un peu différemment - "Lal Haveli", qui peut être traduit par "Pavillon Rouge", et Delhi elle-même s'appelait Shahjahanabad.
Dans le même temps, la publication française moderne et réputée sur l’histoire des Grands Moghols, L’Inde impériale des grands moghols, que nous avons citée, insiste sur le fait que Shah Jahan a été emprisonné précisément dans le Fort Rouge d’Agra.

Quant à la relation entre Shah Jahan et Mumtaz Mahal, elles étaient, même selon les biographies de toute une vie, vraiment incroyablement romantiques.
Malgré le fait que Mumtaz Mahal a eu 18 grossesses, soit Elle était presque toujours enceinte ; cela ne l'empêchait pas d'accompagner son noble époux lors des campagnes militaires et même lors du soulèvement de ce dernier, toujours en qualité de prince, contre Jahangir.
Dans le même temps, on pense que Mumtaz Mahal n’a pas lutté pour le pouvoir politique, étant en cela le contraire de l’épouse bien-aimée de Jahangir, Nur Jahan (la belle-mère de Shah Jahan).
Jahan, selon les chroniques, a rencontré Mumtaz Mahal, en tant que prince, lors d'une attraction impromptue - un bazar organisé par les dames de la cour dans le palais d'Agra en l'honneur du Nouvel An musulman.
Arjumand Banu Begum, comme on appelait alors Mumtaz Mahal, était la fille d'un dignitaire persan de la cour moghole. Elle est née à Agra et était la nièce de l'impératrice Nur Jahan, l'épouse déjà mentionnée de l'empereur Jahangir.
La vie à la cour de l'un des Moghols les plus célèbres - Shah Jahan, qui a construit le Taj Mahal.
Ces miniatures ont été peintes par des artistes de la cour pour le « Padshahname » - un récit historique sur les 10 premières années du règne de Shah Jahan, préparé sur les instructions de Jahan lui-même, en particulier par Abdul Hamid Lahori.
Voici une illustration du magazine India Perspectives.
La miniature intitulée par les auteurs du « Padshahname » « L'empereur, entouré d'une aura divine, est pesé contre l'or et l'argent... » montre le moment de la soi-disant cérémonie. La « pesée de l'empereur moghol » eut lieu le 23 octobre 1632 au Diwan-i-Khass (« Salle des audiences privées »), l'ancienne résidence impériale.
La « Cérémonie de pesée de l'empereur moghol » avait lieu deux fois par an - le jour de son anniversaire selon le calendrier solaire et lunaire. Cette cérémonie fut l'un des plus grands événements de la vie de cour tout au long de l'année.
Lors de la cérémonie de pesée, une quantité d'or, d'argent et d'autres bijoux égale au poids de la règle était disposée sur le deuxième plateau de la balance. Ces bijoux étaient ensuite distribués aux pauvres. Ici, nous voyons des danseurs de cour et des musiciens.
On peut également voir dans la galerie à gauche de l'empereur un ensemble de musiciens connus sous le nom de nawbat, qui jouaient des « devises musicales » spéciales lors de toutes les apparitions officielles du Grand Mogol.
L'une des copies du Padshahname a été présentée au monarque anglais George III en 1799 par l'un des dirigeants indiens locaux.
Entre autres choses, le mariage de Shah Jahan avec un parent puissant, Nur Jahan, qui a eu une énorme influence sur Jahangir, a été politiquement bénéfique. Cela a permis au prince de repousser ses frères de l'accès à Jahangir et de s'établir comme héritier du trône.
Il est intéressant de noter que la vingtième épouse de Jahangir, qui devint plus tard la plus importante dans les affaires du palais, Nur Jahan, était, selon une version, initialement une simple concubine du harem, capturée presque comme un trophée de guerre, et seulement ensuite une impératrice, grâce à l'influence de sa fille sur l'empereur, son père Itimad-ad-Daud devint plus tard le premier ministre sous Jahangir.
Selon une autre interprétation, Nur Jahan était une personne tout à fait digne. Laquelle a simplement été temporairement retirée du palais en raison de son mariage. La publication française moderne L'Inde impériale des grands moghols, qui adhère à cette version (qui qualifie cependant le père de Nur Jahan d'aventurier), écrit à propos de Nur :
« En 1611, l'empereur Jahangir tomba amoureux d'une jeune Perse nommée Mihr un-Nisa, qu'il connaissait depuis son enfance. Cette jeune fille épousa l'un des dignitaires moghols et quitta Agra avec lui pour le Bengale. Cependant, la mort subite de son mari lui permet de réintégrer la cour de la capitale et, quelques mois plus tard, elle devient l'épouse de Jahangir. Après cela, ils ont commencé à l'appeler Nur Mahal, ce qui signifiait « Lumière du palais », et un peu plus tard - Nur Jahan, c'est-à-dire « Lumière du monde ». Son entourage immédiat comprenait son père Itimad ud-Daula, un aventurier devenu premier ministre sous Jahangir, et son frère Azaf Khan.
L'augmentation de l'influence perse a contribué à la propagation de l'islam orthodoxe dans l'empire moghol. Jahangir, opposé aux conflits religieux, n’a pas tenté d’empêcher cela. L'empereur était le fils d'une princesse Rajput ; s'il ordonnait la destruction des temples hindous, ce n'était que pour des raisons politiques. De plus, il s'intéressait au christianisme et recevait souvent des missionnaires jésuites à Agra. On pense qu’il voulait même se faire baptiser et se convertir au catholicisme, mais il a décidé de ne pas le faire, pour ne pas devenir dépendant du Portugal.
Nous avons déjà évoqué la fin de Nur Jahan au début de cette section, où nous avons décrit les circonstances de l’accession au pouvoir de Shah Jahan.
Revenant au sujet de Shah Jahan et de Mumtaz, notons que le grand amour n'a pas empêché Jahan de prendre plusieurs autres épouses pendant la vie et après la mort de Mumtaz Mahal.
Mais le fait même de la construction du magnifique Taj Mahal indique que Shah Jahan a été vraiment bouleversé par la mort prématurée (à la suite d'une autre naissance) de Mumtaz Mahal. Ce n’est pas pour rien qu’il lui a donné ce surnom qui signifie en persan « l’élue du palais ». Également du vivant de Mumtaz, l’empereur ordonna qu’elle reçoive le titre de « la plus vertueuse ».
Après la mort de Mumtaz, Shah Jahan a réussi à lui construire un tombeau - un magnifique Taj Mahal blanc comme neige, rose dans les rayons du soleil levant et argenté au crépuscule. Il l'a construit sur plusieurs décennies.
Mais Shah Jahan n'a pas eu le temps de construire son propre tombeau, qui, selon les chroniqueurs, était censé être une copie du Taj Mahal situé en face, mais uniquement noire.
Shah Jahan, comme vous le savez, a été renversé par son fils Aurangzeb. Et puis parlons des circonstances du renversement de Shah Jahan.
Une miniature de la biographie « Padshahname » montre la vie à la cour de Shah Jahan.
Illustration tirée du magazine India Perspectives.
« Au cours de la trentième année de son règne, Shah Jahan tomba gravement malade. Ayant appris cela, ses quatre fils se sont battus pour le trône.
Senior - Dara Shikoh (son nom est traduit du persan par Darius le Magnifique, ), - et avait auparavant participé au gouvernement, était considéré comme l'héritier officiel. À cette époque, il était gouverneur du Pendjab et était très populaire parmi la population. Shikokh avait une apparence attrayante, était un homme instruit et s'intéressait aux enseignements religieux hindous de la bhakti et du soufisme, la direction mystique de l'Islam. Peu à peu, il entre lui-même dans la secte soufie, qui se distingue par son attachement au principe de tolérance religieuse.
De nombreux dignitaires n'aimaient pas cela, car ils craignaient que, devenu empereur, Dara Shikoh ne soit pas un ardent défenseur des intérêts de la population musulmane de l'Hindoustan. Le prince avait un caractère complexe : il ne supportait pas les critiques et n'abandonnait jamais ses décisions. Grâce à sa détermination, Shikoh parvient à prendre le contrôle d'une partie de l'appareil administratif.
Ses frères - Shah Shuja et Murad Bakhsh - étaient à bien des égards inférieurs à Dara Shikoh. Shah Shuja, cependant, devint gouverneur du Bengale. Contrairement à son frère aîné, Shuja était un adepte de l'islam traditionnel.
Quant à Murad Bakhsh, il fut un excellent chef militaire, grâce auquel il put prendre possession de l'une des principales provinces de l'Inde, le Gujarat. Mais sa soif et son penchant pour la débauche ont fait douter de sa capacité à devenir un bon empereur.
Le plus jeune et le plus ambitieux des quatre frères était sans aucun doute Aurangzeb. Il faisait constamment des campagnes militaires et n'aimait pas la vie de cour, méprisait ses frères et ses dignitaires, qui ne s'intéressaient qu'à l'intrigue et au plaisir.
Enfant, il s'est intéressé à la lecture de textes musulmans. En grandissant, il est devenu un ardent défenseur de l'islam sunnite, les croyants voyaient donc en lui un véritable combattant pour la foi.
Le talentueux commandant Aurangzeb réussit à capturer Agra et, en juin 1658, il ordonna que son père Shah Jahan soit emprisonné (sous prétexte de maladie et d'incapacité présumée de ce dernier) dans la Forteresse Rouge d'Agra, où il passa les huit dernières années de sa vie. vie », écrit la publication française L'Inde impériale des grands moghols (1997) et poursuit :
« Shah Shuja, effrayé, s'est enfui en Birmanie, mais le dirigeant local, Magh Raja, a refusé de l'aider. Poursuivi par les partisans d'Aurangzeb, Shah Shuja se cacha dans la jungle (il mourut bientôt en Birmanie, tué par l'un des dirigeants locaux).
Murad Bakhsh se proclame empereur, puis Aurangzeb l'invite à des négociations au cours desquelles Murad est enivré et jeté en prison (il est exécuté en 1661).
Mais le rival le plus dangereux d'Aurangzeb restait Dara Shikoh. Shikoh a tenté de se rendre au Sind, où il espérait recevoir l'aide des Perses. Seule la trahison d'un des princes mit fin à ses prétentions au pouvoir. Dara Shikoh et son fils ont été capturés et envoyés à Aurangzeb à Delhi.
Des représentants du clergé musulman ont condamné Shikokh à mort pour hérésie. L'un des anciens esclaves du prince lui coupa la tête et son corps fut jeté près de la tombe de Humayun. Le fils de Shikokh, Suleiman, a été jeté en prison. Ainsi Aurangzeb réussit à devenir l’empereur moghol.
Aurangzeb a déplacé la capitale à Aurangabad (aujourd'hui dans l'État du Maharashtra), où il a vécu alors qu'il était encore prince avec rang de gouverneur du Deccan. (Le tombeau d’Aurangzeb se trouve également à Aurangabad).
Quant à Shah Jahan, après huit ans d'arrestation, comme déjà mentionné, il est mort de maladie, et sur ordre d'Aurangzeb, il a été enterré dans le Taj Mahal - le tombeau de Mumtaz Mahal - Mumtaz, qui était aussi la mère d'Aurangzeb.
IV. Chronique du règne des Grands Moghols : De Jahangir au dernier Grand Moghol Bahadur II Shah
1605-1627 Le règne de Jahangir. Jahangir, connu sous le nom de Salim avant son accession, s'est rebellé contre Akbar et s'est proclamé padishah, forçant son père à interrompre la guerre dans le Deccan et à retourner à Agra. Akbar a envoyé son courtisan Abul-Fazl chez son fils pour entamer des négociations avec lui. Cependant, le prince s'était toujours méfié du ministre préféré de son père, alors il tendit une embuscade et tua le plus proche conseiller d'Akbar. En apprenant cela, Akbar fut choqué, il maudit son fils et voulut faire de son petit-fils Kusrau, le fils aîné de Salim, l'héritier, mais mourut bientôt de desentry.
Contrairement à ses prédécesseurs, Jahangir n'a pas mené une politique active de conquête., il préférait profiter d'une vie prospère. Jahangir suivait strictement la routine quotidienne établie par la cérémonie, ce qui l'empêchait également de prendre une part active au commandement de l'armée. De plus, l'apathie naturelle était renforcée par une tendance à l'alcool.
Le pouvoir de l'empereur reposait sur la peur de son mécontentement et de ses terribles représailles. Les Européens arrivant à la cour moghole étaient étonnés de la cruauté des châtiments, dont les plus courants étaient l'arrachage des yeux et l'empoisonnement.
1611 Jahangir épouse Nur Jahan
1628-1658 Règne de Shah Jahan
1631 Mort de Mumtaz Mahal
1631- 1648 Construction du Taj Mahal(Tombeau de Mumtaz Mahal)
1635- 1636 Golconde et Bijapur deviennent des sultanats dépendants de l'empire auprès des dynasties musulmanes locales.
Les sultanats de Golconde et de Bijapur (comme Berar, Ahmednagar, Bidar) étaient les premières parties du tout premier État musulman du sud de l'Inde - Bahmani, fondé en 1347 dans l'ouest du Deccan par des chefs militaires qui se sont rebellés contre le sultanat de Delhi. Ayant consacré de nombreuses années de sa vie aux guerres dans le Deccan, Shah Jahan chercha à poursuivre dans cette région la politique dont les principes furent définis par Akbar et Jahangir. Il s’agissait d’établir la domination moghole sur les principautés musulmanes indépendantes de cette région, formées à partir des ruines du sultanat de Delhi.
L'empereur Shah Jahan n'a pas cherché à conquérir Golconde et Bijapur par la force, son objectif était uniquement l'assujettissement politique.
Grâce à la trahison du fils d'Ambar, le chef militaire des armées du sultan, les troupes de Shah Jahan ont réussi à vaincre et à soumettre le sultanat d'Amadnagar, ce que Jahangir n'a pas pu faire. En 1635, le sultanat de Golconde, qui n'avait plus la force de résister aux Moghols, reconnut également la suprématie de l'empereur.
Après un certain temps, le sultanat de Bijapur s'est reconnu comme dépendant de l'empereur, car il n'était pas prêt pour une longue confrontation.
En 1646, Shah Jahan, profitant des conflits intestins des Ouzbeks, tenta en vain de reconquérir Samarkand, la patrie historique des Timurides.
1638-1648 Construction de Shahjahanabad(aujourd'hui le quartier du vieux Delhi), la nouvelle capitale de Shah Jahan.
1657-1658 La lutte entre les fils de Shah Jahan pour la succession pendant la maladie de leur père. Aurangzeb remporte ce combat, exécute les frères séparément et renverse en 1658 Shah Jahan, le plaçant en état d'arrestation, où il passe les huit derniers jours de sa vie.
1658-1707 Règne d'Aurangzeb. Malgré le mécontentement croissant des hindous et des chiites, l’empereur mise toujours sur un retour à l’islam sunnite.
De 1668 à 1669, Aurangzeb a pris un certain nombre de mesures pour rapprocher la législation actuelle de la loi islamique traditionnelle et aggraver la situation de la population non musulmane de l'Inde. Des décrets ont été adoptés interdisant la construction de temples hindous, la représentation de musique nationale, la danse et la consommation de boissons alcoolisées. L'empereur refusa de porter des vêtements indiens (cette tradition existait depuis l'époque d'Akbar).
Aurangzeb mène des guerres acharnées contre les Marathes, dirigés par le jeune commandant talentueux Shivaji.(a vécu de 1630 à 1680, à partir de 1674, il fut le dirigeant de l'État de Maratha qu'il créa (l'État moderne du Maharashtra). Les Marathes sont une tribu indienne issue de la population rurale du sud de l'Hindoustan. Ils agissaient régulièrement comme alliés des sultans de Ahmednagar et Bijapur, qui ont combattu les Moghols. Avant Après son ascension, Shivaji était au service du sultan de Bijapur, mais devenant dirigeant et commandant de sa propre armée, il défia les conquérants musulmans : les sultans du sud de l'Inde et les Moghols. .
Shivaji était partisan des méthodes cruelles, il n'hésitait pas à détruire les villes et villages qui refusaient de se soumettre à lui. Après la mort de Shivaji en 1680, son fils Shambaji poursuivit l'œuvre de son père.
Dans le même temps, d'autres opposants à l'empire moghol se renforçaient - les paysans - les Jats de Mathura et les Sikhs du Pendjab, devenus ennemis des padishahs après l'exécution de leur chef religieux Arjun sur ordre de Jahangir.
Les Rajputs du Rajasthan ont également manifesté leur mécontentement.
1659-1665 Aurangzeb introduit à nouveau la taxe Jizya sur ses sujets d'autres confessions avec l'activité accrue des Britanniques, des Français et des Portugais en Inde, qui mènent des campagnes locales de conquête dans certains territoires de l'Inde, agrandissant leurs comptoirs commerciaux.
1686-1687 L'annexion par Aurangzeb des sultanats musulmans de Bijapur et de Golconde (voir ci-dessus).
1707-1712 Règne de l'empereur moghol Bahadur I Shah. Le deuxième fils d'Aurangzeb, qui gagna les guerres dynastiques après la mort de son père. Pendant le court règne de Bahadur I Shah (1707-1712), les réformes nécessaires n'ont pas été réalisées ; de nombreuses campagnes militaires n'ont fait que ruiner complètement le trésor public, déjà vide sous Aurangzeb. La noblesse se détourna de l'empereur, estimant qu'il ne pouvait plus sauver l'État.
L'affaiblissement de l'empire a permis aux Rajputs hindous de renforcer leur position. Le Raja de Jodhpur, renversé par Aurangzeb, expulsa les gouverneurs moghols et prit le pouvoir dans la principauté entre ses propres mains. Raja Amber a tenté d'organiser une rébellion, mais Bahadur I Shah l'a réprimée.
En 1709, les deux dirigeants récalcitrants acceptèrent à nouveau la domination moghole.
La principale raison de l’échec des Rajputs dans la lutte pour l’indépendance était leur réticence à s’unir les uns aux autres. Dans le même temps, ils réussirent à agrandir le territoire de leurs possessions, même si la suprématie formelle des Moghols resta.
1712-1713 Règne de l'empereur moghol Jahandar Shah. Durant cette période, pour la première fois, l'empereur moghol renonce à un pouvoir illimité, ce qui accroît sérieusement l'influence du vizir (premier ministre) et conduit à l'instauration d'un certain double pouvoir. Le ministre a tenté de faire la paix avec les Jats, les Marathes, les Sikhs et les Rajputs. Jahandar Shah déchu a été étranglé en prison sur ordre de son parent Farrukhiyar, qui est devenu le prochain empereur moghol. V.
1713-1719 Règne de l'empereur moghol Farrukhiyar (Faruk Siyyar)). Farooq Siyyar a combattu avec succès contre les Sikhs qui ont envahi le Pendjab. Il accède au pouvoir grâce à des guerres dynastiques réussies, mais en 1719 il est renversé par ses plus proches confidents, connus sous le nom de frères Said : les généraux de l'empire moghol depuis l'époque de l'empereur Aurangzeb, Said Hassan Ali Khan Barkha et Said Abdullah Khan Barkha. . Farouk Siyar a été emprisonné, aveuglé et affamé, et deux mois plus tard, il a été étranglé..
Au cours de ce règne, l'affaiblissement supplémentaire du pouvoir central a conduit au renforcement des dirigeants locaux, qui ont commencé à percevoir des impôts en leur faveur. L'empereur ne recevait plus d'argent de la population ; Ainsi, l'ordre établi par Babur et Akbar a été violé.
Les différences ethniques et religieuses ont contribué à la croissance du séparatisme au sein de la noblesse, dont la majorité n'était plus des Perses et des Turcs, mais des Indiens convertis à l'islam. Peu à peu, les aristocrates acquièrent une totale indépendance et ne prennent plus en compte les intérêts de l'empire.
1719-1748 Règne de l'empereur moghol Muhammad Shah.
En 1739, l'armée perse, dirigée par le dirigeant turc de ce pays, Nadir Shah, envahit l'Hindoustan.
Lors de la bataille de Karnal (dans l'actuel État indien de l'Haryana), les Moghols furent vaincus, malgré le fait qu'ils alignèrent une armée de 100 000 hommes contre les 55 000 soldats de Nadir. L'armée de Nadir Shah, qui occupait Delhi, a réprimé les protestations populaires et a pillé la ville.
Dans le même temps, l'armée moghole rendit Delhi sans combat et, même au début, des négociations cordiales eurent lieu entre les deux empereurs. Mais bientôt des rumeurs se sont répandues dans tout Delhi selon lesquelles Nadir Shah avait été tué. Les habitants de Delhi ont commencé à attaquer les Perses et ont tué 900 soldats persans. Un massacre commence au cours duquel 30 000 civils meurent également. Le massacre fut stoppé par le vizir du Grand Mogol.
Muhammad Shah a dû marier sa fille à son plus jeune fils Nadir Shah et se séparer de nombreuses richesses. Deux mois plus tard, Nadir Shah retourne en Perse, emportant avec lui les trésors pillés des Moghols, dont le célèbre . Le souverain perse a justifié son invasion en affirmant que l'empereur moghol ne prenait aucune mesure contre les rebelles de Kandahar, mais en même temps, lui, Nadir, était prétendument fidèle aux Grands Moghols.
Après le sac de Delhi, Muhammad Shah et son entourage ne pouvaient plus faire face aux menaces internes ou externes.
Les Afghans en profitèrent et occupèrent pendant quelque temps les régions du nord-ouest de l'Inde (Pendjab, Cachemire et Multan).
1748-1754 Règne de l'empereur moghol Ahmad Shah Bahadur. Cet empereur de 29 ans a été destitué et aveuglé par Imad ul-Mulk, le neveu du pro-Maratha Nizam d'Hyderabad. Ahmad Shah a passé les 20 années suivantes de sa vie en prison, où il est mort sous le règne de l'empereur moghol Shah Alam II. Parmi les circonstances les moins tristes de la vie d'Ahmad Shah Bahadur figure sa brève victoire sur le dirigeant afghan Ahmad Shah Durrani.
1754-1759 Règne de l'empereur moghol Alamgir II. Cet empereur moghol se distinguait par sa piété et il prit son nom en l'honneur du même fervent musulman et de son arrière-grand-père - le Grand Moghol Aurangzeb, dont le deuxième prénom était Alamgir.
B Le futur Alamgir II, alors appelé Aziz ad-Din, passa la majeure partie de sa vie en prison. Il était le fils de l'empereur moghol Jahandar Shah, qui régna en 1712-1713. Après le renversement de Jahandar Shah, Aziz ad-Din a été capturé par son parent. — par le nouvel empereur Farruxiyar, et un an après avoir été emprisonné, alors qu'il n'avait que seize ans, il fut aveuglé. Le futur Alamgir II fut en prison pendant quarante ans de 1713 à 1754. À l'âge de 55 ans, Aziz al-Din est libéré par Imad ul-Mulk, neveu du Nizam d'Hyderabad, qui avait renversé le précédent Grand Moghol, Ahmad Shah, avec le soutien des princes Maratha.
Sur la base des particularités de sa biographie, pendant son règne, Alamgir II commença à dépendre d'Imad ul-Mulk, qui devint son vizir.
En 1755, après la mort du vice-roi moghol du Pendjab, Muin-ul-Mulk, sa veuve Mughlam Begum chercha désespérément l'aide du dirigeant afghan Ahmad Shah Durrani pour tenter d'arrêter les rebelles sikhs dans les régions orientales.
En 1757, Ahmad Shah Durrani s'empara de Delhi et lors de cette capture, Alamgir II resta à Delhi. Dans le même temps, Algamir II est également contraint de faire des concessions territoriales aux Afghans. Dans le même temps, l'empereur, avec l'aide des Afghans, espère freiner les Marthas et n'est pas contre le mariage du fils de treize ans d'Ahmad Shah Durrani Timur avec sa fille. Imad ul-Mulk, craignant le renforcement des Afghans et la perte de son influence (bien qu'à cette époque il n'était plus vizir) et de sa vie, organisa le meurtre du Grand Mogol, envoyant des assassins l'attaquer sous le couvert de pieux des ermites. Dans cette tentative d'assassinat, Imad ul-Mulk s'est appuyé sur le chef Maratha (voir ci-dessus) Sadashivrao Bhao.
Algamir II a intuitivement tenté de restaurer un régime centralisé et, en tant que personne, il se distinguait par une morale démocratique.
1757 Victoire britannique au Bengale à la bataille de Plassey (Broadswords). Au cours de cette bataille, les Britanniques et leurs troupes de cipayes indigènes ont vaincu l'armée du Nawab du Bengale. Au Bengale, notamment à Calcutta, fondée par les Britanniques, se trouve le tout premier comptoir commercial de la Compagnie des Indes orientales.
Nommé par les Moghols, le nabab était le chef de la région. Cependant, au moment de la bataille, les nababs étaient déjà presque totalement indépendants des empereurs moghols. Cependant, après la bataille de Plassey, les Moghols perdirent finalement leur influence au Bengale et les nababs commencèrent à être établis par les Britanniques.
1759-1806 Règne de l'empereur moghol Shah Alam II. Ce deuxième fils d'Alamgir II, ayant quitté Delhi en 1758 et devenu empereur moghol en 1759, il craignit de retourner dans sa capitale Delhi jusqu'en 1772, craignant ses courtisans et dirigeants voisins.
Il cède le Bengale, l'Orissa et le Bihar aux Britanniques.
DANS 1784g. Shah Alam II s'est tourné vers le puissant dirigeant de Gwalior, Madgava Rao de la dynastie Maratha Sindia, pour obtenir son soutien. En mars 1785g. Madgava Rao arrive à Delhi et prend le commandement de l'armée de Shah Alam. En novembre 1787, Madgave Rao subit une défaite militaire face aux Afghans sous le commandement du dirigeant afghan Ghulam Qadir Khan.
En 1788, Ghulam Qadir Khan et son armée capturèrent Delhi, et au même moment, un Ghulam Qadir Khan ivre tira l'empereur de soixante ans par la barbe, exigeant que Shah Alam II lui remette les trésors, et fouetta même le padishah. Shah Alam II est emprisonné, les yeux arrachés et battu. Les Afghans ont également battu les membres de sa famille. Le padishah est libéré par Madgave-Rao Sindia.
En mars 1789. Ghulam Kadir Khan a été vaincu par l'armée de Medgav Rao et pendu après de graves tortures. Shah Alam II a été rétabli sur le trône.
La capitale du Grand Mogol resta sous la domination des Marathes jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque ces derniers furent finalement vaincus par les Britanniques. En septembre 1803. Delhi était occupée par le commandant en chef anglais, Lord Gerard Lake. Le vieux et faible Shah Alam passa sous la protection des Britanniques. 23 mai 1805. Le padishah s'est vu attribuer une allocation permanente de -120 000 livres sterling. À partir de ce moment-là, il cessa d'être suzerain et ne dirigea même plus les territoires dont il recevait des revenus. s. Seul le Fort Rouge de Delhi restait à la disposition de Shah Alam.. Hors de ses murs, l'administration de la ville et de ses environs était entre les mains du résident anglais. Dans le même temps, Shah Alam II pourrait encore être intitulé padishah.
1806-1837 Règne d'Akbar II. Tout au long de son règne, cet avant-dernier empereur moghol fut assigné à résidence par les Britanniques à sa résidence.
1813 La destruction du monopole de la Compagnie des Indes orientales sur le commerce en Inde, avec cette décision le gouvernement britannique est passé à un gouvernement direct en Inde, donnant à la société les fonctions d'administrateur des territoires indiens.
Les États indiens, victimes de guerres intestines sans fin, ne voulaient pas comprendre la gravité de la menace anglaise, écrit une publication française moderne. L'Inde impériale des grands moghols (1997). Seul Tipu Sultan, le dirigeant du petit État de Mizor, tenta de résister aux Britanniques. Il fut vaincu et mourut en 1799 lors de la bataille de Srirangapatnam. Ainsi, dès la fin du XVIIe siècle, la puissante Compagnie britannique des Indes orientales, sous la direction de Richard Wellesley, commença à mener une politique de saisies territoriales en Inde. Pour assurer le succès de leur expansion, les Britanniques ont contribué à diviser la société indienne, en subventionnant divers groupes séparatistes et en affaiblissant les États. Face à une résistance obstinée, les Britanniques ont utilisé les méthodes les plus brutales pour la réprimer, souligne l'auteur français de la publication mentionnée. .
En 1818, les troupes britanniques vainquirent finalement les Marathes. À partir de ce moment, le gouvernement britannique, utilisant la Compagnie des Indes orientales à ses propres fins, a effectivement pris le contrôle de l'ensemble du territoire de l'Hindoustan, à l'exception du Pendjab, dans lequel l'État sikh était alors dirigé par Ranjit Singh. Après sa mort en 1839, l'État s'est effondré, ce dont les Britanniques et les Britanniques ont profité pour capturer le Pendjab en 1849.
1837-1858 Règne de Bahadur II Shah, dernier empereur moghol(cm. ). Cet empereur a également passé tout son règne en résidence surveillée britannique..
1849 Conquête du Pendjab par les Britanniques. Un État sikh indépendant a existé pendant un certain temps au Pendjab, né de l'affaiblissement du pouvoir des Grands Moghols.
1858 Révolte des cipayes (troupes locales anglaises). Ils ont décidé d'utiliser l'empereur moghol impuissant Bahadur II Shah, assigné à résidence à Delhi sous l'administration britannique, contre les Britanniques, proclamant le rétablissement de son pouvoir. Le soulèvement est réprimé. Bahadur II Shah s'exile en Birmanie. La dynastie moghole cesse d'exister.
1877 La reine britannique Victoria est proclamée impératrice des Indes.
(Chronologie d'après L'Inde impériale des grands moghols (1997)
V. Dynastie moghole : Chute
L'une des figures les plus tragiques parmi les empereurs moghols lors du déclin de leur pouvoir est Shah Alam II.
Ce deuxième fils de l'empereur Alamgir II quitta Delhi en 1758 et devint empereur moghol en 1759. Cependant, il craignit de retourner dans sa capitale Delhi jusqu'en 1772. Shah Alam II ne craignait pas principalement les Britanniques, mais les seigneurs féodaux indiens et les dirigeants indigènes des pays voisins.
Shah Alam II avait sous les yeux l'exemple de son père - Aziz ad-Din (Alamgir II) - lui-même fils d'un autre empereur moghol Jahandar Shah.
Aziz ad-Din a été capturé par son parent, le nouvel empereur moghol Farrukhiyar, et un an après avoir été en prison, alors qu'il n'avait que seize ans, il a été aveuglé. Après cela, Aziz ad-Din fut en prison pendant quarante ans, de 1713 à 1754. Aziz ad-Din devint ensuite brièvement empereur, mais fut bientôt assassiné par son propre ancien vizir.
Et peu importe à quel point son fils Shah Alam II avait peur de répéter l'expérience de son père, il n'a pas fait beaucoup mieux :
En 1788, l'empereur moghol Shah Alam II, âgé de soixante ans, fut tiré par la barbe, fouetté puis aveuglé par le dirigeant afghan Ghulam Qadir Khan, qui cherchait des trésors moghols puis attaqua Delhi.
En septembre 1803, Delhi fut occupée par le commandant en chef anglais, Lord Gerard Lake. Vieux, aveugle et fragile, Shah Alam II passe sous la protection des Britanniques.
Le 23 mai 1805, le padishah reçut une allocation permanente de 120 000 livres sterling. A partir de ce moment, il cessa d'être suzerain et ne gouverna même plus les territoires dont il tirait des revenus.
Shah Alam II n'avait à sa disposition que le Fort Rouge de Delhi et le titre de padishah.
Cependant, les Britanniques ont peut-être sauvé la vie de Shah Alam II.
On ne sait pas ce qui l'aurait attendu s'il était resté un jouet entre les mains de ses propres seigneurs et sujets féodaux, ainsi que de divers dirigeants indigènes.
Ici, dans une miniature de 1800, Shah Alam II regarde avec des yeux aveugles - peu après avoir été aveuglé par le dirigeant afghan Ghulam Qadir Khan, mais déjà rétabli sur le trône par son allié, qui a chassé Ghulam - le dirigeant de Gwalior Madgave Rao de la dynastie Maratha de Sindia.
Il ne restait que quelques années avant que les Britanniques n’occupent Delhi. Déjà sous le protectorat anglais après Shah Alam II, deux autres Grands Mogols étaient sur le trône et la dynastie a existé sous le patronage des Britanniques pendant plus de 50 années suivantes.
Parlons d'abord du Mogholempereursla période de déclin de la dynastie, puis sur les circonstances de sa chute.
Après le dernier empereur célèbre de la dynastie moghole, le sixième consécutif - Aurangzeb (décédé, rappelons-le, en 1707), neuf autres empereurs ont régné, voir notre chronologie et ). Cependant les derniers empereurs moghols ont commencé à ressembler de plus en plus à des victimes.
Trois d'entre eux furent tués (deux étranglés), un mourut en prison et quatre de ces neuf derniers empereurs furent également aveuglés (en d'autres termes, leurs yeux furent arrachés). L'un de ces Moghols a également été tiré par la barbe et fouetté. Finalement, on fut contraint dans sa propre capitale de donner le fameux Trône du Paon à l'envahisseur. Les deux derniers empereurs moghols ont passé tout leur règne (plusieurs décennies) en résidence surveillée.
Alors rappelons-nous :
En 1713, le Moghol Jahandar Shah fut étranglé en prison sur ordre de son parent Farrukhiyar, qui devint le prochain empereur moghol.
En 1719, l'empereur moghol Farooq Siyyar, mentionné ci-dessus, fut emprisonné par des courtisans conspirateurs, où il fut aveuglé et affamé, puis étranglé deux mois plus tard.
En 1739, le grand magnat Muhammad Shah dut marier sa fille au plus jeune fils du souverain perse qui avait capturé Delhi, Nadir Shah, et se séparer de beaucoup de richesses. Deux mois après le raid sur Delhi, Nadir Shah retourna en Perse, emportant avec lui les trésors pillés par les Moghols, dont le célèbre trône du paon.
En savoir plus sur le trône du paon moghol :
En 1754, l'empereur moghol Ahmad Shah Bahadur, âgé de 29 ans, fut destitué et aveuglé par Imad ul-Mulk, le neveu du Nizam hindou pro-Maratha d'Hyderabad. Ahmad Shah a passé les 20 années suivantes de sa vie en prison, où il est mort sous le règne de l'empereur moghol Shah Alam II.
En 1714, le futur Grand Mogol Alamgir II, alors appelé Aziz ad-Din, est emprisonné. Il était le fils de l'empereur moghol Jahandar Shah, qui régna en 1712-1713. Après le renversement de Jahandar Shah, Aziz ad-Din fut capturé par son parent, le nouvel empereur Farrukhiyar, et un an plus tard, après avoir été en prison, alors qu'il n'avait que seize ans, il fut aveuglé. Après cela, Aziz ad-Din fut en prison pendant quarante ans - de 1713 à 1754, jusqu'à ce qu'il soit libéré par le seigneur féodal Imad ul-Mulk, déjà mentionné ici, qui avait auparavant renversé l'empereur moghol Ahmad Shah Bahadur. Cependant, peu de temps après, Alamgir II a été tué sur ordre d'Imad ul-Mulk.
En 1788, l'empereur moghol Shah Alam II, âgé de soixante ans, fut tiré par la barbe, fouetté puis aveuglé par le dirigeant afghan Ghulam Qadir Khan, qui attaquait alors Delhi.
En 1806-1837 Akbar II et en 1837-1858 Bahadur II Shah a passé tout son règne en résidence surveillée britannique.
Cependant, il convient de noter que, semble-t-il, les empereurs moghols impuissants sous les Britanniques (c'est-à-dire les empereurs Akbar II et Bahadur II Shah) ont vécu plus en sécurité que leurs prédécesseurs immédiats lors du déclin de la dynastie, même si, contrairement à ces derniers, ils avaient encore un certain pouvoir. Les empereurs moghols sous tutelle anglaise n’ont pas été tués ni eu les yeux arrachés. Les Britanniques versèrent une pension aux deux derniers Grands Moghols et les traitèrent avec respect et étiquette.
Le 12 septembre 1857, le magazine français L'Illustration (publié à Paris de 1843 à 1944) publia un article (pour coïncider avec la mutinerie des cipayes) sur le précédent voyage de son journaliste en Inde dans les années 1840. L'article s'intitulait "Voyage au pays des Grands Moghols", il décrivait entre autres la rencontre du journaliste du magazine et du grand empereur moghol Bahadur II Shah. Dans les années 1840, rappelons-le, Delhi était déjà occupée par les Les Britanniques et l'empereur vivaient dans le Fort Rouge de Delhi, n'exerçant que des fonctions cérémonielles, sous la protection des troupes anglaises.
Voici des extraits de la publication :
"11 novembre 1842. J'ai rencontré le commandant de la forteresse où habite l'empereur, un capitaine anglais que je connais. Il m'a invité à monter dans sa calèche à deux roues. J'ai été d'accord; En passant sous les murs du Fort Rouge de Delhi, nous avons entendu le bruit lointain des timbales et autres instruments. C'était le cortège impérial qui rentrait au palais.
« Passons par ici », m'a dit le capitaine en désignant une immense porte sous laquelle apparaîtrait un éléphant légèrement plus gros qu'une souris. " Dépassons la première voiture avec les courtisans, puis nous verrons tout le cortège. " À peine dit que c'était fait. Nous nous sommes arrêtés sous un arbre branchu et avons commencé à observer ce qui se passait.
Le bruit des timbales et des autres instruments augmenta rapidement. Mais il faisait presque nuit lorsque les premiers cavaliers apparurent enfin, franchirent la porte et s'enfoncèrent plus profondément dans la forteresse. Après les cavaliers, apparurent des brancards et des charrettes tirées par des bœufs ; puis une foule de musiciens passa en jouant de divers instruments : trompettes, timbales, flûtes.
Et soudain, à la lueur des torches, nous aperçumes un vieillard sec, au visage sévère, assis sur un trône à dais porté par des serviteurs. C'était l'empereur. Il était suivi de vingt éléphants, les uns portant sur le dos des maisons dorées, les autres portant des musiciens. Peut-être faudrait-il rendre justice aux musiciens de l'empereur : ils sont payés pour leur travail ; leur zèle se manifestait par une sorte de fureur démoniaque.
Après les éléphants, qui avaient une apparence triste et une démarche triste et lente (un trait caractéristique de ces animaux), plusieurs autres cavaliers en retard montaient avec des drapeaux. Puis il y eut un silence.
Je n'ai pas dit que l'empereur, qui était assis sur le trône, tenait dans ses mains un bâton à extrémité recourbée. Dans la lumière crépusculaire des torches, l'empereur ressemblait à une momie ; il semblait que son visage était noir.
Le dernier empereur moghol Bahadur II Shah (Siraj ud-Din Abu-l-Muzaffar Muhammad Zafar, alias Zafar Bahadur) et ses deux fils.
D'après une peinture moghole de 1838.
(Quelques jours plus tard, il y a eu une audience).
L'Empereur était un vieillard pitoyable ; il ne pouvait supporter toutes les cérémonies nécessaires que sous l'influence de l'opium.. Il était assis sur le trône et il essayait de prendre les mesures nécessaires...
Le trône était une plate-forme surélevée en marbre entourée d'une balustrade. Plusieurs serviteurs âgés se tenaient près de l'empereur ; ils étaient mal habillés et semblaient négligés. Deux jeunes hommes gardaient l'empereur.
L'empereur avait un air fou. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange ou devenaient ternes ; il me semblait qu'il tremblait tout le temps... Ses vêtements étaient en tissu velours couleur peau de léopard. À plusieurs endroits, il était décoré de rayures de fourrure de zibeline. Son visage et ses mains étaient secs et émaciés, son nez pointu, ses joues enfoncées et son manque de dents étaient frappants, sa barbe était d'une couleur très étrange : rouge-noir avec une teinte violette. Ce vieillard pitoyable que j'ai vu sur le trône à Delhi était l'empereur Bahadur II Shah, descendant du grand Timur (Tamerlan). Fin de citation.
Le Fort Rouge de Delhi déjà mentionné, dont nous parlerons en détail sur la deuxième page de cette revue, tombait périodiquement en ruine après la fin du règne de son célèbre fondateur Shah Jahan, cependant, il a vu de nombreuses autres personnalités célèbres et un nombre d'événements importants dans ses murs.
C'est ici, en 1857-1858, que le dernier empereur moghol Bahadur II Shah, qui avait vécu sa vie de dirigeant impuissant sous l'administration anglaise. Au moins Bahadur II Shah ne s'est pas opposé à une telle tentative.
Rappelons qu'en 1803 les Britanniques prirent le contrôle de Delhi et que les empereurs Akbar II (1806-1837) et Bahadur II Shah (1837-1858) n'avaient un véritable pouvoir que sur le territoire de la Forteresse Rouge, dans laquelle ils étaient sous assignation à domicile .
Comme l'écrit le français publication sur l'histoire des Grands Moghols L'inde impériale des grands moghols (1997), la raison du soulèvement était la menace d'envoyer des cipayes servir en Angleterre et l'utilisation de nouvelles armes lubrifiées avec de la graisse de porc ou de vache, qui c'est-à-dire des substances dont l'utilisation était interdite aux musulmans et aux Indiens. Pour exprimer leur protestation contre les autorités britanniques, les cipayes proclamèrent Bahadur II Shah empereur souverain de l'Inde.
11 mai 1857. Les rebelles se sont renforcés à Delhi, tout en forçant l'empereur moghol à signer une proclamation dans laquelle le padishah annonçait la restauration du pouvoir des Grands Moghols et appelait tous les Indiens à s'unir pour lutter pour leur patrie et leur foi.
Les fils de Bahadur Shah ont obtenu des postes importants dans l'armée des cipayes.
Après l'échec du soulèvement, Bahadur Shah a témoigné qu'il était entièrement entre les mains des cipayes.
« Tous les documents, dit-il, que les cipayes jugeaient nécessaires étaient rédigés sur leurs ordres. Après cela, ils m'ont été amenés et forcés de les sceller... Souvent, ils scellaient les enveloppes vides et non remplies... Chaque fois que le prince Mirza Mughal, Mirza Khair Sultan ou Abubakr m'apportaient des pétitions, ils étaient invariablement accompagnés de commandants cipayes, qui apportaient les ordres qu'ils désiraient, déjà écrits sur des feuilles de papier séparées, et les obligeaient à les réécrire de ma propre main... J'étais à la merci des soldats, et ils ont utilisé la force pour faire quoi. ils ont aimé."
Au cours des actions des cipayes, un massacre à grande échelle d'Européens a été perpétré dans des villes en proie à des troubles. Mais le soulèvement a échoué, la mosquée principale et une partie du Fort Rouge de Delhi (Shahjahanabad), lors de la répression des troubles, ont même été la cible de tirs d'artillerie britannique.
Le dernier empereur moghol Bahadur Shah en mai 1858, immédiatement après son procès et avant de partir en exil en Birmanie.
La photographie a été prise à Delhi par deux photographes : le photographe professionnel Charles Shepherd, fondateur du studio photo Shepherd & Robertson en Inde, et le passionné de photographie militaire Robert Christopher Tytler.
Cette photographie de Bahadur Shah est la seule photographie survivante du dirigeant. Et comme l’année de l’invention de la photographie est considérée comme 1839 et que Bahadur Shah était déjà un empereur moghol depuis 1837, c’est probablement la seule photographie d’un empereur moghol qui nous soit parvenue.
La photographie fait partie de la collection de la British Library.
Pour empêcher de nouvelles protestations, les Britanniques ont emprisonné l'empereur. En septembre 1858, Bahadur II Shah fut capturé et accusé de trahison et d'organisation de révoltes. Certains de ses enfants et petits-enfants furent exécutés et l'empereur lui-même fut condamné à l'exil et se rendit à Rangoon, la capitale de ce qui était alors la Birmanie britannique, où il mourut cinq ans plus tard à l'âge de 87 ans.
Il convient de noter que Bahadur Shah se cachait dans à Delhi, qui est également abordé dans une section distincte de cette revue. On peut dire que c'est dans le tombeau de Hamayun que s'est terminée l'histoire du règne des empereurs moghols..
Le droit de Babur d’être reconnu comme conquérant oriental n’a pas besoin de confirmation particulière : du côté de son père, il descendait de Timur, du côté de sa mère de Gengis Khan. Parmi ces deux-là, Babur était le plus fier de sa relation avec Timur, qu'il considérait comme un Turc. À cette époque, le mot « Mongol » signifiait la même chose que « barbare » et s'appliquait principalement aux représentants des tribus sauvages du nord et de l'est de la Transoxiane, qui étaient encore nomades. En revanche, les nobles représentants des tribunaux hautement culturels créés par les héritiers de Timur dans les territoires de l'Afghanistan et de l'Ouzbékistan actuels préféraient se qualifier de Turcs. Babur aurait probablement été choqué d'apprendre que la dynastie qu'il a fondée en Inde serait connue dans le monde entier sous le nom de Moghols, une version légèrement modifiée du mot persan Mughul pour les Mongols.
En fait, Timur était probablement un Mongol, même si les Turcs et les Mongols étaient tellement mélangés dans sa région qu'il était absurde d'essayer de faire une distinction claire entre eux. Les deux peuples venaient à peu près de la même région de Mongolie (la même que les Huns), mais les Turcs ont émigré vers l'ouest plusieurs siècles plus tôt que les Mongols et se sont donc installés plus tôt et sont devenus civilisés. Les Mongols les plus sauvages, suivant leurs traces, conquirent d'abord les Turcs et apprirent ensuite d'eux. Timur lui-même venait de la tribu des Turcs Barlas, mais on pense que les Barlas étaient à l'origine des Mongols qui ont adopté les Turcs - la langue que Babur parlait et écrivait et qui est restée jusqu'en 1760 la langue privée de la famille royale moghole, notamment dans les cas où il était nécessaire de mener des conversations secrètes. Comme l'une des preuves de l'impossibilité de séparer les Turcs des Mongols dans la généalogie de Babur, on peut citer ce qui suit : les Barlas étaient une branche des Turcs Chagatai, et ces derniers avaient une contradiction dans leur nom propre, car Chagatai était le fils du Mongol Gengis Khan. Il convient également d'ajouter que les gens déterminaient souvent leur origine en fonction des conditions et des exigences de l'époque. Timur, par exemple, souhaitait surtout être considéré comme étroitement associé aux Mongols et était très fier de son titre de guragan - gendre de la famille royale mongole - qu'il avait acquis en épousant une princesse descendante de Gengis Khan. La généalogie gravée sur sa tombe à Samarkand retrace méticuleusement ses origines à son ancêtre commun avec Gengis Khan, Buzanchar, né d'une jeune fille légendaire d'un rayon de lune.
Les événements survenus au cours du siècle qui suivit la mort de Timur conduisirent Babur à désirer être considéré comme un Turc, mais après cent ans de domination réussie de l'Inde par ses descendants, qui portaient le titre de Moghol, il devint à nouveau très à la mode d'être considéré comme Mongol. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les visiteurs européens croyaient que le mot « Mogul » signifiait simplement « circoncis » ; en d’autres termes, ils l’ont utilisé à l’égard de l’ensemble de l’élite musulmane dirigeante, sans distinction. Quant à ceux qui visitèrent l'Inde plus tard, dans la seconde moitié du même siècle, ils associèrent ce nom à la couleur de la peau blanche et emportèrent avec eux des histoires sur les Indiens de la catégorie des serviteurs de l'empereur qui épousèrent des filles du Cachemire dans l'espoir que leur les enfants seraient suffisamment légers pour passer pour des Moghols. Finalement, la boucle fut bouclée et, en 1666, il fut rapporté que les empereurs avaient adopté le titre de Moghol « pour la plus grande gloire de la dynastie – afin de convaincre les gens qu'ils descendaient de la lignée de Gengis Khan ». En fin de compte, malgré les objections antérieures de Babur, l’Europe reconnut qu’il était juste d’attribuer à la dynastie moghole et à son dirigeant, dont la richesse semblait dépasser les rêves les plus fous de la bourgeoisie de Londres et d’Amsterdam, le titre de Grand Moghol.
Babur est né le 14 février 1483. Son père Omar Cheikh était le dirigeant de Fergana, une petite mais riche province à l'est de Samarkand, et en 1494, à l'âge de onze ans, le jeune prince, par un étonnant accident, devint l'héritier du trône. Son père, que Babur décrit comme « un homme de petite taille et à la silhouette rondelette, avec une barbe fournie et un visage charnu », était un colombophile enthousiaste. Autrefois, dans la forteresse délabrée d'Aksi, un souverain obèse nourrissait ses oiseaux dans un pigeonnier construit sur le mur entourant le palais, tout au bord du gouffre. Soudain, il y a eu un effondrement et « Omar Cheikh Mirza a volé avec ses pigeons et son pigeonnier et s'est transformé en faucon ».
Babur se retrouvait désormais l'un des nombreux petits dirigeants d'un conglomérat de provinces dirigées par ses oncles ou ses cousins germains et germains. Tous ces princes font remonter leurs origines à Timur. Chacun d'eux croyait qu'il n'avait pas moins de droits sur les propriétés appartenant à leur famille au siècle dernier que n'importe quel autre. Leur impitoyable ancêtre commun a conquis des terres s’étendant de Delhi à la Méditerranée et du golfe Persique à la Volga, mais le territoire que tous ses descendants contrôlaient collectivement était beaucoup plus petit. Samarkand, la capitale de Timur, était située à l'extrême nord de cette région. À cent cinquante milles à l’ouest de Samarkand se trouvait Boukhara, et à environ deux cents milles à l’est se trouvait la verte et agréable vallée de Fergana, « regorgeant de céréales et de fruits », comme l’écrivait Babur lui-même, et où, selon ses propres mots : « les faisans étaient si gros et si gras que, comme le prétendait la rumeur, quatre ne pouvaient pas en manger un seul, cuit avec des légumes et du riz. La partie nord du domaine timuride était connue sous le nom de Transoxiane parce que la rivière Oke, aujourd'hui appelée Amou-Daria et séparant l'Union soviétique et l'Afghanistan, coulait au sud de celle-ci. Et au sud de l'Oxus se trouvaient le reste des possessions timurides, plus étendues mais moins hospitalières que la Transoxiane. Après avoir surmonté les cols difficiles de l'Hindu Kush et parcouru encore deux cents milles, on pouvait arriver à Kaboul, et les pentes occidentales des montagnes, descendant progressivement, se transformaient en plaines séchées au soleil, parmi lesquelles se trouvait la grande et belle oasis d'Herat. . Ces terres, difficilement comparables en taille à celles conquises par Timur, mais néanmoins égales en superficie à l'Espagne et au Portugal réunis, étaient considérées par les princes timourides du XVIe siècle comme les leurs. Mais ils n'étaient unis que par la conviction que dans chacune des possessions petites et instables, le trône devait être occupé par les Timurides. La question de savoir qui devait s'asseoir sur quel trône était une cause constante d'affrontements militaires entre eux. Le droit appartenait à chacun de naissance, mais seule la capture pouvait l'affirmer.
Dans les possessions des Timurides, il y avait plusieurs villes fortifiées d'une certaine force et importance ; Dans chacune de ces villes, de belles maisons aux toits de tuiles ont été construites et dans chacune il y avait une couche de marchands prospère. Les trois plus grandes étaient Samarkand, Boukhara et Herat. Celui qui a régné à Samarkand, Boukhara et Herat a pu établir un certain mode de vie, en soutenant l'agriculture et l'artisanat. Ayant atteint au moins une stabilité relative, ces dirigeants ont commencé à montrer l'amour caractéristique des Timurides pour la peinture et la poésie, l'architecture et les jardins. Quant aux deux derniers, il y avait des jardins partout où vivait le prince, que ce soit un belvédère ou une tente. L'architecture était plutôt un hommage au patronage de la religion et des scientifiques. Timur a construit des tombeaux, des mosquées et de magnifiques établissements d'enseignement à Samarkand - des madrassas, mais pas des palais. Il y avait une maison pour lui dans la citadelle fortifiée au centre de la ville, mais lorsqu'il se trouvait dans sa capitale entre les campagnes, Timur, comme ses courtisans, préférait vivre dans l'un des beaux jardins. Il en était de même à Hérat qui, après la mort du souverain, devint le véritable centre de la culture timouride. Les princes timourides restaient en fait les nomades les plus civilisés. Être chez eux signifiait pour eux installer leur campement dans un environnement aimé et agréable.
Avec de telles coutumes, il était étonnamment facile de prendre la route. La richesse du prince consistait en les objets qu'il aimerait emporter avec lui sur la route - des tentes riches savamment confectionnées, des tapis de sol chauds et joliment décorés, des appuis-tête recouverts de soie et garnis de cordons, des plats et des gobelets en or et en argent, et plus encore. des chevaux, de puissantes bêtes de somme, des armures fiables, des épées et des arcs. Les objets de luxe tels que les manuscrits, les bijoux, les petits objets d'art et les dessins (presque toujours réalisés pour être inclus dans des livres) étaient en effet également facilement transportables. La force militaire était représentée principalement par des mercenaires, pour la plupart des chefs de petites tribus avec des détachements de leurs proches ; ils étaient attirés vers la bannière du prince à la fois par sa noblesse et par l'espoir de récompenses et de butin de guerre. Chacun avait ses propres chevaux et armes, leur loyauté dépendait des résultats, et ils avaient une tendance remarquable à changer de maître si cela leur promettait de plus grands avantages. Si le prince s'installait dans une région prospère, il satisfaisait alors ses besoins immédiats et ceux de son peuple en nourriture et en vêtements chauds en fourrure en imposant des devoirs appropriés aux agriculteurs locaux. Très souvent, les réserves alimentaires étaient reconstituées en pillant les propriétés voisines et en volant des moutons et des chèvres, qui étaient abattus selon les besoins. C’était un monde dans lequel la roue de la Fortune effectuait des tours étonnamment brusques et rapides. Il y avait des moments où Babur prenait possession de la grande Samarkand et y vivait, et il lui arrivait aussi d'errer pendant des mois, sans abri, avec une poignée de partisans. En d’autres termes, des changements soudains se sont produits de manière inexplicable et parfois irréversible. Mais dans le cadre de l’existence nomade, les deux extrêmes n’étaient que le meilleur et le pire exemple d’une telle vie.
De toutes les villes et forteresses appartenant à cette famille, Samarkand, la capitale de Timur lui-même, resta toujours aux yeux de ses descendants la récompense la plus brillante. Babur dans son Fergana était un voisin de Samarkand, et dans la dixième et la vingtaine de sa vie, il était possédé par un désir passionné de prendre possession de cette ville. Au début de son règne, Babur eut la première brillante occasion de faire une telle tentative. En six mois, deux dirigeants de Samarkand moururent l'un après l'autre, une guerre civile éclata et, en 1496, Babur se dirigea vers l'ouest pour assiéger la célèbre ville. Il n'avait que treize ans. Sous les murs de la ville, il découvre deux de ses cousins poursuivant les mêmes objectifs. Il s'est avéré que l'un d'eux voulait simplement kidnapper la fille qu'il aimait et qui vivait à Samarkand. Ils ont uni leurs forces, mais l'hiver est arrivé à Samarkand et ils ont été contraints de battre en retraite. Seul l'amant a atteint son objectif. Mais au printemps suivant Babur revint, et après un siège de sept mois, en novembre 1497, et à l'âge de quatorze ans, il entra en triomphe dans la ville si richement ornée par son célèbre ancêtre.
Il se mit aussitôt à inspecter et à mesurer à pas la longueur des remparts de sa nouvelle possession. Leur longueur s'est avérée être de dix mille mètres. Babur a visité la tombe de Timur ; Il a également inspecté les madrasas richement carrelées construites sur trois côtés de la place ouverte par Timur et son petit-fils Oulougbek, ainsi que le célèbre observatoire dans lequel Oulougbek a construit un quadrant géant et, avec l'aide de ce quadrant, a compilé le catalogue d'étoiles le plus complet connu à l'époque. temps. Tous ces bâtiments ont survécu jusqu'à nos jours et sont à différents stades de destruction ou de restauration, mais le principal objet d'intérêt de Babur, comme on peut le deviner, était les magnifiques jardins entourant la ville fortifiée. Il ne mentionne pas moins de neuf jardins, dont certains avec de beaux pavillons dans la partie centrale. L’un de ces bâtiments était décoré de fresques représentant les victoires de Timur, l’autre de panneaux de porcelaine exportés de Chine. Si l’on ajoute à ces trésors culturels les bazars riches et bruyants et les citadins « fidèles et respectueux des lois », il n’est pas surprenant de voir à quel point cette ville a répondu aux attentes de Babur. « Peu de villes dans le monde habité, écrira-t-il plus tard, sont aussi agréables que Samarkand ».
Mais il ne jouit de son pouvoir que pendant trois mois délicieux. Une suite d'événements typique l'a privé de Samarkand presque aussi vite qu'il l'avait conquise. Les partisans de Babur, désillusionnés par les maigres récompenses dans une ville qui avait été grandement appauvrie par la guerre civile et le siège, l'abandonnèrent bientôt, y compris, à la grande surprise et au grand dam du jeune dirigeant, ceux en qui il avait le plus confiance. Au même moment, la noblesse de Fergana, ayant appris que Babur s'était établi à Samarkand, décida de plaire à un autre prince et de confier le pouvoir sur la majeure partie de la province au demi-frère cadet de Babur, Jahangir, douze ans. En février 1498, Babur entreprit une campagne pour sauver la situation, mais dès son départ, il perdit Samarkand et arriva trop tard à Fergana pour la tenir. Il passa le reste de l'hiver dans la petite forteresse de Khodjent, le seul endroit où il se sentait en sécurité. «Cela m'a eu un effet très dur», écrira-t-il plus tard, loin de son pays natal, dans son nouvel empire en Inde, en évoquant le garçon de quatorze ans dont la chance lui a presque complètement tourné le dos en Transoxiane. "Je n'ai pas pu résister à des larmes amères." La remarquable autobiographie de Babur, basée sur les notes qu'il a prises tout au long de sa vie, bien que le livre entier ait été écrit principalement ces dernières années en Inde, donne un récit vivant de ce qu'il appelle lui-même « le temps sans trône », lorsqu'il errait avec un groupe. d'aventuriers en quête de nourriture, de moyens et de royaume. Il appartient rarement à une personne dotée d'un esprit aussi raffiné de décrire une existence sauvage, combinant incroyablement la romance et la saleté de la vie. Babur raconte comment lui et ses partisans, au nombre de deux à trois cents, utilisaient Khodjent comme base pour des raids nocturnes sur les forteresses et les villages voisins - et dans cette région très particulière, chaque village, comme le dit Babur, avait ses propres fortifications militaires. Quittant leur camp au milieu de la journée, ils pouvaient parcourir à cheval une quarantaine de milles dans toutes les directions possibles, dans l'espoir de lancer une attaque à la faveur de l'obscurité. Puis ils assemblèrent les échelles et les placèrent tranquillement contre les murs, dans l'espoir de pouvoir entrer inaperçus. Le plus souvent, ils ont été remarqués et ont été contraints de rentrer chez eux complètement épuisés et sans proie. Mais il arrivait aussi qu'ils parvenaient à se faufiler tranquillement dans le village, puis ils se battaient dans les rues étroites, brandissant des épées et tirant à l'arc, jusqu'à ce que le village reconnaisse les nouveaux propriétaires, et cela, en règle générale, se produisait assez rapidement. C'était une existence prédatrice et la mort n'était pas considérée comme inhabituelle. La possibilité de rencontrer une bande de rivaux sur le chemin du retour était grande, et une telle rencontre se terminait presque toujours par un massacre sanglant. Les têtes des morts étaient coupées et emportées, attachées à la selle, comme trophées. La remarque de Babur caractérise avec précision le caractère commun de la cruauté. «Augan-Birdi est revenu à l'heure du petit-déjeuner», écrit-il. « Il a maîtrisé un Afghan et lui a coupé la tête, mais il l’a laissé tomber quelque part en cours de route. »
Lorsque Babur reprit finalement les terres de Fergana à son jeune frère, le côté le plus noble de la vie lui redevint accessible. Sa mère et d'autres femmes de sa famille rejoignirent Babur - l'isolement du harem permettait aux femmes de se déplacer entre les parties belligérantes inaperçues et en toute sécurité, et après chaque coup d'État, il devint coutume d'attendre que leur prince reprenne le trône pour ensuite le rejoindre. lui . Maintenant qu'il avait déjà seize ans, sa première femme arriva pour se présenter à lui. Comme beaucoup d’autres, elle était la cousine de Babur et leurs pères s’étaient mis d’accord sur le mariage plusieurs années plus tôt. Babur, selon sa propre déclaration, "n'était pas opposé à elle" et seulement à cause de la modestie d'une vierge, il ne rendait visite à sa fiancée dans sa tente qu'une fois tous les dix ou quinze jours. Cependant, plus tard, écrit-il, « quand même ma première attirance n'a pas survécu », le délai est passé à quarante jours, puis après l'arrivée de sa mère, qui l'a harcelé en lui demandant de rendre visite à la fille.
En fait, les sentiments de Babur étaient dirigés vers un autre objet. Dans ses dernières années, il condamna strictement les relations homosexuelles entre ses proches, mais son premier amour - non partagé - fut un jeune homme d'un comptoir commercial du camp, et Babur le décrit avec presque la même subtilité d'introspection que Proust. Il errait dans les jardins au clair de lune, tête et pieds nus, rêvant et écrivant de la poésie, mais lorsqu'il rencontra son amour, lorsque, par exemple, en compagnie d'amis, il tourna au coin et se retrouva face à face avec le jeune homme, il tomba dans l'embarras et n'osa pas le regarder. Dans les rares occasions où un jeune homme lui était envoyé pour quelque chose, la situation était complètement mauvaise : « Dans ma joie et mon excitation, je n'étais pas en mesure de le remercier d'être venu vers moi, et comment pourrais-je lui reprocher de partir ? Dans son journal, Babur a souligné son intention de « s’en tenir à la vérité dans tous les cas et de décrire les événements tels qu’ils se sont produits ». Et je pense qu'il était fidèle à son idéal.
En février 1500, deux ans après que Babur eut quitté Samarkand, il avait pris tellement de terres à son frère que Fergana était prêt à conclure un traité. Chacun des princes reçut le pouvoir sur la moitié de Fergana, mais ils durent unir leurs forces pour rendre Samarkand ; dès que Babur réaffirme ses droits sur Samarkand, Fergana passe entièrement à Jahangir. Ainsi, l’honneur et l’ambition sont devenus des incitations à s’unir dans la lutte pour le retour de Samarkand. Au cours d'un siècle, la ville a changé de nombreuses fois de mains, mais toujours d'un Timuride à l'autre. Or, en cette même année 1500, il fut capturé par un dangereux parvenu, un étranger qui envahit le nid des Timurides. Son nom était Sheibani Khan, et cet homme allait avoir une influence toujours croissante sur le monde de Babur au cours des dix prochaines années. Il a commencé sa vie comme Babur, en tant que descendant insignifiant d'une famille noble devenu aventurier dans les terres au nord de la Transoxiane parmi les Mongols et les tribus turques connues sous le nom d'Ouzbeks, mais son propre esprit agressif, combiné à la férocité de ses semblables. les membres des tribus ont exercé une forte pression sur ses voisins et les terres qu'elle occupait se sont progressivement étendues vers le sud.
Babur espérait que les habitants de Samarkand ne seraient pas trop enthousiasmés par leurs nouveaux et stupides maîtres et que s'il entrait dans la ville, la population le soutiendrait. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'un de ses lancers soudains de nuit ait été couronné de succès. Sheibani Khan campa près des murs de la ville dans l'un des jardins, ne s'attendant pas à un éclair, et sous le couvert de l'obscurité, soixante-dix ou quatre-vingts guerriers de Babur réussirent à placer des échelles contre le mur de la ville en face de la soi-disant grotte des amoureux et les grimpèrent inaperçus. . Ils se précipitèrent vers la Porte Turquoise, tuèrent les gardes, détruisirent le château avec une hache et ouvrirent la porte à Babur et au reste des soldats, qui étaient moins de deux cents. Les habitants de la ville dormaient encore. Quelques commerçants du bazar passèrent la tête par les portes de leurs magasins, reconnurent Babur et lui firent signe qu'ils priaient pour lui. Babur se rendit directement à la madrasa Oulougbek, au centre-ville, et installa son quartier général sur le toit. Des citadins influents se sont empressés d'exprimer ici leur respect, reconnaissant sagement à la fois le véritable prince Timuride et le fait accompli. Pendant ce temps, les guerriers de Babur et la foule de la ville, s'unissant, massacrèrent les Ouzbeks dans les rues, réglant ainsi leurs comptes avec environ cinq cents ennemis. Lorsque la nouvelle du désastre inattendu parvint au camp de Sheibani Khan, la ville lui était déjà fermement fermée.
Tout au long de l'hiver 1500, Babur était totalement en sécurité à Samarkand, mais au printemps Sheibani Khan revint et assiégea la ville. Babur installa de nouveau ses tentes sur le toit de la madrasa et depuis cette position avantageuse dirigea les opérations militaires. Il rapporte qu'il a réussi à atteindre une cible d'ici avec une arbalète lorsqu'un groupe d'Ouzbeks a infiltré la ville et a tenté de s'emparer de son quartier général. Cependant, Shaybani Khan souhaitait avant tout affamer la garnison. Les habitants de Babur furent bientôt contraints de manger de la viande d'âne et de chien, particulièrement interdite aux musulmans, et les chevaux durent être soumis à un régime à base de feuilles d'orme et de bois finement haché et trempé. De plus en plus de soldats et de chefs militaires, y compris là encore les amis de confiance de Babur, comme cela a été découvert le matin, ont réussi à sauter par-dessus les remparts défensifs pendant la nuit par groupes de deux ou trois et à disparaître. En fin de compte, Babur a été contraint de conclure «quelque chose comme une trêve» avec Sheybani Khan, aux termes de laquelle il a donné sa sœur aînée Khan-zada comme épouse à l'Ouzbek, comme on appelait souvent le khan guerrier. Et un jour, vers minuit, Babur, sa mère et ses partisans ont quitté la ville.
Babur, qui a conquis Samarkand à deux reprises, n'avait que dix-huit ans. Cette fois, sa chance semblait s'être finalement détournée de lui. Il est allé rendre visite à certains de ses proches, notamment à ses oncles mongols vivant au nord de Tachkent, et les proches l'ont accueilli - à moins qu'il n'en manifeste le désir et n'ait la possibilité de les chasser de chez eux. Mais Babur n'a pas toléré la position humiliée de l'invité pauvre. Avec l'aide de ses oncles, il captura à nouveau une partie de Fergana, mais fut très vite privé de ce qu'il avait réalisé sous la pression des forces supérieures de Sheibani Khan. En 1504, les Ouzbeks étaient fermement établis à Fergana et continuaient de tenir Samarkand, tandis que Babur, se retirant devant lui, se sentait plus seul et impuissant que jamais. Le nombre de ses partisans tomba à deux ou trois cents. Dans le passé, il avait eu un certain succès avec moins d'hommes, mais à sa grande humiliation, maintenant presque tous étaient à pied, vêtus d'habits paysans et armés uniquement de bâtons. Il n'y avait que deux tentes pour tout le détachement. La propre tente de Babur pouvait encore offrir une protection suffisante contre les intempéries, mais il l'a perdue au profit de sa mère. Il utilisait lui-même un dais de feutre ouvert sous lequel il pouvait tenir sa cour. "Il m'est venu à l'esprit", écrivit-il plus tard, "que je ne conseillerais à personne d'errer de montagne en montagne sans abri et sans abri."
Cependant, le nombre de ses partisans augmenta à nouveau, progressivement et presque constamment - le prince doué de pur sang timouride, bien que contraint de passer l'hiver en compagnie de bergers de chèvres, fut tôt ou tard retrouvé par des soldats mécontents de leur sort, assoiffés de quelque chose de nouveau, avec lequel ils pourraient fonder leurs espoirs. Babur était un dirigeant plus populaire que la plupart des autres parce qu'il avait découvert depuis longtemps - et l'avait noté dans son journal - que dans ce monde de loyauté inconstante, une réputation durable de justice et d'honnêteté vaut bien plus qu'un entraînement continu à la terreur et à la cruauté. Mais même si, à la suite d'un processus naturel, sa force a encore augmenté, Babur s'est avéré assez sage pour ne plus entrer en conflit avec Sheibani. Il était clair que le moment était venu pour lui de chercher fortune ailleurs.
Par un caprice du destin, Kaboul était pour ainsi dire vacante à cette époque. Située à trois cents milles de Fergana, au-delà des cols escarpés de l’Hindu Kush, elle a toujours semblé une terre lointaine. Jusqu'en 1501, elle était gouvernée par l'un des oncles de Babur, mais pendant les troubles qui commencèrent lorsqu'il mourut, laissant un jeune fils comme unique héritier, un certain dirigeant sans lien de parenté de Kandahar entra dans la ville. Kaboul avait non seulement l'avantage d'être éloignée des possessions de Sheibani, mais elle en était également séparée par des montagnes, et Babur, indigné qu'une autre possession légitime des Timurides soit tombée aux mains d'un étranger, pouvait la revendiquer avec un droit bien fondé - ainsi Il est fondé que lorsqu'en 1504, avec les forces qu'il avait rassemblées alors qu'il avançait vers le sud, il partit en campagne, l'usurpateur se retira de la ville avec seulement une apparence de résistance.
Ainsi, le tournant le plus important dans la vie de Babur s'est avéré être l'un des plus faciles. Kaboul resta sa base jusqu'à la fin de ses jours. Il est entouré de chaînes de montagnes rocheuses qui s'élèvent de la plaine comme le dos écailleux de dinosaures antédiluviens. La chaîne de montagnes la plus proche de la ville fortifiée fut fortifiée dans sa partie supérieure, et à ses pieds Babur, à sa grande joie, découvrit de beaux jardins, bien arrosés par des sources et un canal. Les jardins contenaient d'excellents fruits et du miel, de bonnes herbes et un climat qui lui était bénéfique. Babur s'est retrouvé pour la première fois dans un monde véritablement multinational car Kaboul, comme Kandahar au sud, servait de poste commercial important sur les routes caravanières reliant l'Inde à la Perse, à l'Irak et à la Turquie à l'ouest, et au nord - via Samarkand. - même avec la Chine. À Andijan, la plus grande ville de Fergana, sa ville natale, tout le monde parlait turc ; À Kaboul, Babur a découvert au moins douze langues parlées : l'arabe et le persan venaient de l'ouest, l'hindi de l'est, le turc et le mongol du nord, et plusieurs autres dialectes locaux étaient utilisés. Babur rapporte même avec une certaine révérence que chaque année, au moins dix mille chevaux traversaient Kaboul pour se rendre en Inde et autant dans la direction opposée. C'était un flux incessant de tissus, de sucre, d'épices et d'esclaves. Les commerçants s'attendaient à des bénéfices d'au moins quatre cents pour cent, et malgré le fait qu'une partie des marchandises tombait entre les mains de voleurs de route et qu'une taxe était perçue pour un passage en toute sécurité, ce chiffre n'était pas excessif. Le district de Kaboul lui-même n’était en aucun cas riche et ne pouvait soutenir tous les guerriers de Babur, mais celui-ci comblait ce déficit par des raids réguliers sur les terres voisines et revenait parfois avec pas moins de cent mille moutons volés.
Même lorsqu'il était en Inde et se préparait à transférer le trône de l'empire à ses fils, Babur continuait à considérer Kaboul comme sa maison. Ici, il se sentait à l'aise et pouvait établir une vie culturelle à la cour, ce qui avait toujours été un aspect important de l'idéal timouride. Se reposant pour la première fois après huit années d'anxiété et de campagnes presque continues, il s'est engagé dans l'agriculture, plantant des plantations de bananes et de canne à sucre dans la région et inculquant l'amour du jardinage qu'il a porté tout au long de sa vie. Mais parmi tous les nombreux jardins qu’il a plantés, son préféré était celui à flanc de colline à Kaboul. C'est ici qu'il a légué pour s'enterrer.
En tant que lieu de stabilité inattendue dans un monde troublé, la cour de Babur est devenue un refuge pour les princes timurides persécutés qui se retiraient devant Sheibani. L'un de ces exilés, le cousin de Babur, le sultan Said Khan, a décrit ce refuge comme "l'île de Kaboul, que Babar Padshah a réussi à protéger des chocs violents provoqués par les tempêtes des événements" et a affirmé que les deux années et demie passées là-bas étaient " le plus libre de soucis et de chagrins que tous les autres dans ma vie... Je n'ai même pas souffert de maux de tête, sauf lorsque je buvais beaucoup de vin, je n'ai jamais été bouleversé ou triste, sauf lorsque j'étais envahi par le désir de les boucles de ma bien-aimée..." . Un jeune cousin, Haydar, est arrivé à Kaboul à l'âge de neuf ans et a également été profondément impressionné par les coutumes auxquelles Babur adhérait. Haïdar reçut de riches cadeaux dignes d'un garçon de son âge : un encrier orné de pierres précieuses, un tabouret incrusté de nacre et un abécédaire. Plus tard, Haidar écrivit avec gratitude que Babur « m’a toujours encouragé à étudier, soit avec des promesses affectueuses, soit avec de graves menaces ».
Haydar a également écrit que son éducation comprenait « l'art de la calligraphie, la lecture, l'écriture de poésie, l'écriture de lettres, le dessin et la décoration de manuscrits... des métiers tels que la sculpture de sceaux, la fabrication de bijoux, la fabrication de selles et d'armures, la fabrication de flèches, de fers de lance et de couteaux... ... des instructions dans des domaines d'État tels que les accords importants, l'élaboration de plans de guerre et de raids, ainsi que l'entraînement au tir à l'arc, à la chasse, à l'entraînement des faucons et à tout ce qui est utile au gouvernement du pays.
Ce cercle donne une bonne idée des plaisirs et des activités sérieuses à la cour des Timurides, et Babur lui-même avait désormais du temps libre pour s'adonner à son talent poétique, ce qui lui a valu la renommée, comme le prétend Haydar, pas le dernier poète écrivant en turc. . La langue turque est telle que la versification s'apparente plus à l'art de composer des mots croisés qu'à la poésie à laquelle nous sommes habitués. Babur, par exemple, au cours d'une de ses maladies, s'amusait à écrire un quatrain et à le transformer de cinq cent quatre manières différentes. Les courts poèmes de Babur sont dispersés dans les pages de ses mémoires, mais ils n'ont pour la plupart aucun sens en traduction, car ils s'appuient sur des constructions verbales qui leur permettent de construire des mots si complexes qu'ils font paraître les conglomérats allemands les plus complexes aussi simples que deux plus deux. Donnons juste un exemple : biril signifie « être donné », birilish - « se donner l'un à l'autre », plus précisément « se donner », birilishtur - « forcer à se donner », mai signifie négation, dur - présent du verbe, man - première personne du singulier, et birilishturalmaidurman signifie "Je ne peux pas les forcer à se donner l'un à l'autre".
À cette époque, il n'existait qu'une seule cour timouride de plus, plus importante que celle de Babur. C'était Herat, qui devint une ville d'importance artistique sous le fils préféré de Timur, Shahrukh, et atteignit son apogée pendant la vie de Babur, lorsque les activités du cercle des maîtres d'art étaient dirigées par le grand Behzad, le miniaturiste le plus influent de Herat. et écoles persanes. Mais en 1507, Herat tomba aux mains de Shaybani Khan, quelques mois seulement après que Babur eut rendu visite à ses illustres parents et passé quarante jours heureux à inspecter les magnifiques bâtiments qu'ils avaient érigés. Le premier qu'il mentionne est Gazurga, où, bien sûr, il souhaitait principalement voir les belles tombes en marbre de nombreux Timurides, ses proches, dans une grande niche au fond de la cour, pleine de paix et de tranquillité. La prise d'Hérat par Shaybani Khan plaça Babur dans la position honorable mais aussi difficile du seul Timuride assis sur un trône digne de respect, et il prit le titre de padishah, revendiquant ainsi, dans une certaine mesure, des droits équitables à la place de chef du clan timouride.
Il semblait plus que probable que Sheibani poursuivrait son expansion et, après avoir dépassé les montagnes, atteindrait tôt ou tard Kaboul via Kandahar, mais, heureusement, il commit l'erreur d'affronter le puissant Shah Ismail, fondateur de la dynastie safavide en Perse. . Un échange insultant de cadeaux diplomatiques, au cours duquel Sheibani envoya au Shah un bol de mendicité en bois et reçut en retour un rouet, conduisit naturellement à la guerre. Mais Sheybani a rencontré un adversaire de taille, tant en termes de niveau de ressources militaires que de maîtrise des tactiques militaires. À la suite d'une série de ruses, Sheybani fut pris dans une embuscade en 1510 et conduit à un abattoir. Son corps fut démembré et envoyé dans différentes régions de Perse pour être exposé au public, et son crâne, serti d'or, fut transformé en gobelet, que le Shah lui-même utilisait volontiers.
La bonne nouvelle fut bientôt suivie par le retour à Babur de sa sœur Khanzada, la veuve de Sheibani, que Shah Ismail libéra et envoya avec une escorte honoraire et des cadeaux coûteux à Kaboul pour son frère. C'était le premier contact diplomatique de Babur avec la Perse, et il était destiné à conduire à un nouvel épisode finalement désagréable dans sa vie. Ses pensées étaient toujours tournées vers Samarkand, et il devint vite évident que le Shah l'aiderait volontiers à reconquérir la capitale de ses ancêtres, mais à une condition extrêmement difficile : Babur devait accepter l'interprétation chiite de l'Islam. Dès le premier siècle de l'existence de cette religion, une confrontation s'engage entre chiites et sunnites, ou musulmans orthodoxes, à laquelle se considéraient tous les Timurides, y compris Babur. Le schisme dogmatique remonte à un désaccord survenu dans les années qui ont suivi la mort de Mahomet sur la question de savoir qui devrait être le successeur légitime du prophète en tant qu'imam et si ce poste pouvait être électif ou strictement limité, comme le croyaient les chiites, aux descendants du prophète par l'intermédiaire de son imam. gendre Ali. Au cours des siècles suivants, le chiisme fut particulièrement associé à la Perse et sa propagation devint un sujet de fierté à la fois nationale et religieuse, d'autant plus que la nouvelle dynastie safavide propagea ce sens de l'islam avec un zèle accru, puisqu'il faisait remonter ses origines à Musa al-Kazim, le septième des douze imams chiites. Le fanatisme de Shah Ismail correspondait à ses revendications territoriales, et le Shah espérait profiter des droits légaux de Babur sur Samarkand comme moyen d'annexer la région à son empire. En échange d'une assistance militaire, Babur a accepté de frapper des pièces au nom d'Ismail et de mentionner le nom du Shah dans le khutb, et comme il s'agissait de deux symboles indispensables de la souveraineté, Babur s'est en fait transformé en un vassal dirigeant Samarkand au volonté du Shah perse. Mais depuis que Babur a été autorisé à frapper sa propre pièce et à mentionner son nom dans la khutbah de Kaboul, il a apparemment décidé, loin du fanatisme, qu'il n'avait rien à perdre en retournant au moins par un détour vers sa bien-aimée Samarkand, et a accepté, complètement déraisonnable, les conditions du Shah .
Babur repart en campagne vers le nord et, avec l'aide de nouveaux alliés, chasse tout d'abord les Ouzbeks de Boukhara. Pour les habitants de Transoxiane, ce fut un acte de libération. Leur prince bien-aimé, le vrai Timuride, retourna à son héritage. Les citadins et les villageois l'ont accueilli et à Boukhara, il a renvoyé avec beaucoup de tact son armée perse avant de faire une entrée cérémonielle à Samarkand en octobre 1511 après dix ans d'absence. Les étals des bazars étaient drapés de brocart d'or et ornés d'images pittoresques, et des gens de toutes classes se pressaient dans les rues en criant leurs salutations. Une seule chose semblait ridicule : Babur lui-même, habillé dans un style chiite, entouré de citadins sunnites enthousiastes. Mais même le jour de la grande joie, cela n’a pas été pris en compte. Les gens croyaient que dès qu'il s'asseyait en toute sécurité sur le trône, il se débarrasserait immédiatement de ses vêtements détestés et méchants, mais ils ont été trompés dans leurs attentes. Haydar, le cousin de Babur, qui était avec lui à cette époque, explique que Babur considérait les Ouzbeks encore trop forts pour pouvoir les affronter sans l'aide du Shah. Mais il s'est mis dans une position intolérable. Babur a refusé d'aller jusqu'à persécuter les sunnites, ce qui était exactement ce que voulait le Shah ; cependant, après avoir ouvertement démontré sa volonté de coopérer avec les chiites, Babur perdit bientôt le soutien de la population de Samarkand. En conséquence, huit mois plus tard, les Ouzbeks reprirent la ville.
Les historiographes de la cour des descendants de Babur en Inde ont estimé que sa tentative à trois reprises de conserver Samarkand était la plus grande bénédiction de Dieu, et sa dernière aventure avec les Perses, leur semblait-il, a finalement changé la direction de ses aspirations ambitieuses - il a cessé de penser au nord. et tourna son regard vers l'est. Il avait déjà tenté de pénétrer sur le territoire indien par le col de Khyber afin de se sentir plus en confiance vis-à-vis de Sheibani Khan ; De plus, il considérait l'Hindoustan, et en particulier le Pendjab, comme Samarkand, comme étant de droit. Son esprit revenait constamment à la conquête éclair de l'Inde par Timur en 1399. Khizr Khan, que Timur a laissé pour gouverner le Pendjab en tant que vassal, devint plus tard le sultan de Delhi et fonda la dynastie Sayyid, mais malgré cela, il affirma ouvertement sa loyauté envers la maison de Timur, refusant de s'appeler Shah, et sous le fils de Timur Shahrukh, il a affirmé qu'il était l'Inde et n'était qu'un vice-roi. Ce fait revêtait une importance particulière pour Babur et, se préparant déjà activement à la capture de l'Hindoustan, il envoya un ambassadeur auprès du sultan Ibrahim à Delhi « au nom de la préservation de la paix » et proposa probablement l'échange le plus optimiste de l'histoire. "Je lui ai envoyé un autour des palombes de chasse", écrit Babur dans ses mémoires, "et je lui ai demandé les terres qui dépendaient des Turcs depuis l'Antiquité".
Babur n'était pas pressé de lancer une invasion. Il continua obstinément à renforcer ses forces à Kaboul et se préoccupa personnellement - sans doute avec la même énergie qu'il avait consacrée à son jeune cousin Haidar - de l'éducation de ses propres fils. Humayun est né en 1508, et les deux autres, Kamran et Askari, respectivement en 1509 et 1516 ; en 1519, la nouvelle de la naissance du plus jeune parvint à Babur alors qu'il effectuait une campagne préparatoire dans l'Hindoustan, et c'est pourquoi le garçon reçut le nom de Hindal.
Les actions préparatoires de Babur comprenaient la capture de Kandahar, une forteresse forte importante pour lui du point de vue de la protection de Kaboul de l'ouest tandis qu'il s'enfonçait lui-même plus profondément dans les terres de l'Hindoustan, mais il lui fallut encore trois étés consécutifs avant d'obtenir une puissante citadelle. recouverte par une haute chaîne de montagnes, lui tomba sous la main en 1522. Une autre partie des préparatifs importants de Babur était destinée à être décisive. Entre 1508 et 1519, il est impossible de le dire avec certitude, car ses archives ont été perdues pendant assez longtemps, Babur a acquis le premier lot de canons et l'artilleur expérimenté Usta Ali était avec les canons. Babur profita ainsi de l'amère défaite subie par son voisin Shah Ismail, dont la magnifique cavalerie galopa vers les Turcs en 1514 et fut détruite par de nouvelles armes. Le Shah importa immédiatement de l'artillerie et des artilleurs turcs pour son armée, et Babur décida qu'il serait tout à fait raisonnable de suivre son exemple. Lorsqu'il reprend ses archives en 1519, la bouche d'Ali agit déjà du côté de Babur dans une petite escarmouche locale, et Babur dresse un tableau déchirant de membres de la tribu adverse, qui n'avaient jamais vu de canon, riant du rugissement des armes à feu qui n'avaient jamais vu de canon. tirer des flèches et répondre à ce bruit par des gestes obscènes. À cette époque, les canons en Inde n'étaient utilisés que sur la côte ouest et tiraient sur les navires turcs et portugais, mais dans le nord, dans les plaines de l'Hindoustan, ils n'étaient utilisés avec aucun effet jusqu'à ce que Babur les traîne le long des cols de montagne. Kaboul. L'aide de la bouche d'Ali et de ses outils fut donc si efficace.
Babur commença sa cinquième et dernière campagne dans l'Hindoustan en octobre 1525, se déplaçant vers le sud et l'est avec douze mille guerriers. Juste à cette époque, des troubles commencèrent dans le sultanat de Delhi, des groupes de plus en plus nombreux s'opposèrent au sultan Ibrahim, et jusqu'à la toute fin février 1526, alors que Babur avait déjà avancé loin au Pendjab, il ne rencontra pas de résistance sérieuse jusqu'à ce qu'Ibrahim envoie son armée. le rencontrer . Babur confia le commandement de l'aile droite de l'armée à Humayun, dix-sept ans, et le prince fut victorieux, capturant une centaine de prisonniers et sept ou huit éléphants. "Usta Ali, avec ses fusiliers à mèche, a reçu l'ordre de tirer sur tous les prisonniers en guise d'avertissement", a écrit Babur. "C'était le premier acte de Humayun, sa première expérience de combat et un merveilleux présage." L'exemple donné par l'exécution des prisonniers n'était probablement pas une simple manifestation de cruauté, puisque Babur se souciait généralement de pacifier les ennemis vaincus. L'essence de la tâche de ce premier peloton d'exécution, qui utilisait de la poudre coûteuse là où il aurait été plus facile de s'en sortir avec une épée, était différente : il s'agissait d'une manifestation démoralisante, dont la nouvelle parviendrait certainement à l'armée d'Ibrahim et convaincrait tous ses membres. guerriers du pouvoir magique de la nouvelle arme.
Les deux armées se retrouvent face à face à Panipat à la mi-avril. Les forces de Babur semblent avoir augmenté jusqu'à vingt-cinq mille hommes grâce aux renforts pendant la campagne, mais l'armée d'Ibrahim aurait compté cent mille hommes et mille éléphants. Babur a préparé une tête de pont, qui est devenue courante pour lui en Inde au cours des années suivantes, mais il admet qu'il l'a empruntée à la pratique turque - d'ailleurs, la même année, les canons turcs de Soliman le Magnifique se sont dirigés loin vers l'ouest, en Europe et en Turquie, après la bataille de Mogacs, elle subjugua la Hongrie. Babur ordonna à ses hommes de rassembler autant de charrettes que possible. Ils rassemblèrent sept cents pièces et les attachèrent ensemble avec des lanières de cuir brut. À cause de cette barrière, la bouche d'Ali et ses tirailleurs ont dû tirer sur la cavalerie ennemie, comme les Turcs l'ont fait lors de la guerre contre les Perses en 1514, et trois siècles plus tard, les pionniers d'Amérique du Nord l'ont fait lors de la lutte contre les Indiens. Il a fallu plusieurs jours à Babur pour forcer Ibrahim à lancer une attaque sur les positions préparées, et quand il a finalement réussi le 20 avril, l'armée d'Ibrahim, comme prévu, s'est arrêtée sous le feu des mousquets derrière la clôture, tandis que la cavalerie de Babur l'a inondée de flèches. les deux flancs. La bataille brûlante s'est poursuivie jusqu'à midi et la victoire est revenue à Babur. Environ vingt mille personnes sont mortes dans l'armée indienne, dont le commandant lui-même. En signe de respect pour Ibrahim, Babur a ordonné de l'enterrer sur le lieu de la bataille, et sa tombe est toujours intacte à Panipat. Mais pour commémorer sa victoire, Babur - et c'était typique de lui - n'érigea pas un autre monument à Panipat, mais ordonna de planter un beau jardin.
Le même jour, Babur envoya Humayun avec un petit détachement pour garder les trésors d'Agra, qui était la capitale de la dynastie Lodi depuis 1502. Le lendemain matin, Babur partit avec le reste de son armée vers Delhi et atteignit la ville en trois jours. Il a immédiatement commencé à faire du tourisme comme d'habitude et a célébré l'événement en buvant de l'arak avec des amis sur un bateau sur la Jumna. Il resta à Delhi assez longtemps pour qu'une khutbah soit lue à la mosquée le vendredi suivant mentionnant son nom ; il se déclara ainsi empereur de l'Hindoustan, car écouter calmement la khutba au nom du souverain signifiait une reconnaissance tacite de l'autorité de ce souverain par le peuple. Babur se rendit ensuite à Agra, et à l'occasion de son arrivée, son fils lui présenta un magnifique diamant, offert à Humayun par la famille du Raja de Gwalior ; les membres de cette famille se réfugièrent dans la forteresse d'Agra et Humayun prit leur protection. Le Raja lui-même est mort avec Ibrahim à Panipat. Cette affaire a toujours suscité une certaine controverse, mais on peut affirmer avec une certitude presque totale que cette pierre est le fameux « Kohinoor », mentionné pour la première fois dans l'histoire. "Humayun me l'a donné à mon arrivée à Agra", a écrit Babur. "Je viens de lui rendre la pierre", ajoute-t-il avec désinvolture, même s'il a déjà calculé que la pierre vaut la même valeur que "de la nourriture pour deux jours et demi pour le monde entier". Plus tard, Humayun a donné le diamant au Shah persan Tahmasp, qui l'a envoyé en cadeau au Nizam Shah dans le Deccan, et de là, la pierre, par un itinéraire inconnu, a retrouvé son chemin vers le trésor moghol de l'empereur Shah Jahan. Comme tous les autres bijoux moghols, le roi perse Nadir Shah en a pris possession lorsqu'il a pillé Delhi en 1739. C'est lui qui a donné à la pierre le nom de Koh-i-Noor, c'est-à-dire Montagne de Lumière. Du petit-fils de Nadir Shah, elle passa à la famille régnante de Kaboul, puis à Rajit Singh, le célèbre dirigeant sikh du Pendjab, et lorsque le Pendjab fut annexé par les Britanniques en 1849, la pierre fut remise au Haut-Commissaire. , Sir John Lawrence, qui n'était si visiblement pas intéressé par les acquisitions pour l'empire, qu'il a porté le bijou dans la poche de son gilet pendant six semaines, l'oubliant. Finalement, il envoya la pierre à la reine Victoria et arriva juste à temps pour devenir l'objet principal de la Grande Exposition de 1851 et finir ensuite dans la Tour de Londres, d'où rien ne disparaît.
Le déclin de la dynastie Lodi semblait complet. Il est vrai que la mère d’Ibrahim a daigné accepter l’aide gracieusement offerte par Babur, même si plus tard elle a presque réussi son intention de détruire le conquérant en soudoyant le cuisinier qui avait mélangé du poison dans sa nourriture. Mais Babur était surtout préoccupé par d’autres préoccupations urgentes. La majeure partie de son armée, effrayée par l’arrivée de la saison chaude en Inde, a cherché à retourner rapidement dans la fraîcheur de l’été de Kaboul, nourrissant l’espoir que la campagne en cours n’était qu’un raid prolongé comparable à la campagne de Timur. Même Alexandre le Grand, qui était beaucoup plus éloigné de son pays natal, fut contraint de rebrousser chemin immédiatement après avoir traversé l'Indus en raison du mécontentement de ses troupes. Cependant, Babur, après avoir convoqué un conseil militaire, s'adressa alors à l'armée avec un avertissement qui combinait brillamment encouragement et ridicule, et cela eut l'effet escompté.
Le danger immédiat contre lequel Babur avait besoin du soutien de toutes ses forces militaires était l'unification des Rajputs sous la direction de Rana Sanga de Chitor. Au cours des dix années précédentes, les princes indiens du territoire du Rajasthan ont créé cette association dans le but d'agir ensemble contre Ibrahim et de le priver du pouvoir sur Delhi et sur tout l'Hindoustan, mais Babur était en avance sur eux. Ils se préparaient désormais à agir contre lui. Babur fut à nouveau en infériorité numérique dans les mêmes proportions que sous Panipat, et ses hommes, déjà mécontents de la perspective d'un long séjour en Inde, furent encore plus démoralisés par les rumeurs sur le courage invincible des Rajputs. Mais Babur profita du fait que ses soldats étaient confrontés à une bataille contre les infidèles, la première en trente années de combat. Au cours d'une cérémonie très théâtrale, il interdit la consommation de vin, ordonnant qu'un lot de boissons fraîchement livré de Ghazna soit versé sur le sol et que ses coupes d'or et d'argent soient brisées en morceaux, distribuées en aumône aux pauvres. Incités par cet exemple, les hommes de Babur ont juré sur le Coran qu'aucun d'entre eux « ne tournerait le dos à l'ennemi et ne combattrait jusqu'à ce que la vie quitte son corps ». Les deux armées se rencontrèrent le 16 mars 1527 près de Khanwa, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Agra, et après une bataille décidément plus brutale qu'à Panipat, Babur remporta finalement la bataille, prenant sur lui le fier titre de « ghazi » - guerrier. foi de l'Islam.
Cette victoire lui donna un pouvoir incontesté sur le centre de l'Hindoustan, et il l'étendit de la manière la plus simple en accordant à ses nobles les régions qui n'avaient pas encore été conquises et en les envoyant là-bas pour s'y proclamer dirigeants. Babur a donné à ses fils les provinces les plus éloignées du désormais principal centre de son activité à Agra. Kandahar a été confié aux soins de Kamran ; Askari est allé au Bengale ; Humayun est devenu le dirigeant de la province la plus reculée - le Badakhshan, perdue parmi les montagnes au nord de Kaboul. Babur lui-même, tout comme ses compagnons, aspirait au climat et aux célèbres fruits de Kaboul : l'un des moments les plus heureux pour lui fut celui où, immédiatement après son retour à Agra, à la fin de la campagne suivante, on lui présenta le premier grappes de raisin et les premiers melons cultivés dans l'Hindoustan importés sous sa commande, à partir de vignes de Kaboul et de graines livrées de là. Cependant, il resta dans ses nouvelles possessions et consacra du temps à de courtes campagnes pour apaiser les troubles locaux.
Babur était incroyablement satisfait du développement de son artillerie, en particulier des énormes mortiers qu'Ali commença à fabriquer pour lui. Il a laissé une description remarquable de la première opération de casting, à laquelle il s'est empressé d'assister. Usta Ali a construit huit fours de coulée autour d'un cercle ; De chacun de ces fours, le métal en fusion était censé s'écouler dans un moule placé au centre, mais en raison d'une malheureuse erreur de calcul, les fours étaient vides avant que le moule ne soit rempli. Usta Ali était tellement bouleversé qu'il a voulu se jeter dans le métal liquide, "mais nous l'avons calmé, lui avons revêtu une robe d'honneur et l'avons ainsi libéré de la honte de l'échec". Cette attitude magnanime typique de Babur face à un oubli évident doit être appréciée. Deux jours plus tard, lorsque les pièces moulées purent être ouvertes, ils découvrirent que la chambre pour les obus de pierre, c'est-à-dire le canon de mortier, s'avérait excellente, et Ali annonça joyeusement que la chambre pour la charge de poudre pouvait être fabriquée séparément. et attaché au pistolet. Trois mois plus tard, lorsque ce mortier fut testé pour la première fois, Babur était ravi de pouvoir lancer une bombe de pierre à près d'un kilomètre et demi. La formation de gaz en poudre à haute pression dans le canon d'une arme à feu pour un tel tir était une entreprise non moins dangereuse pour ceux qui se trouvaient derrière l'arme que pour ceux qui servaient de cible au tir. Ceci, en particulier, a été démontré par le premier essai d'un autre mortier: il a explosé et huit personnes se trouvant à proximité ont été tuées. De plus, cette arme ne pouvait pas être qualifiée de tir rapide, et Ali était heureux s'il parvenait à tirer douze obus de mortier en une journée. Cependant, malgré les dangers et les retards, Babur aimait être présent à cette action passionnante de tir, qu'il s'agisse du siège d'une forteresse comme Chanderi, ou d'une tentative de couler des navires ennemis sur le Gange. Une entrée typique dans les mémoires se lit comme suit : « Pendant la prière de midi, un homme sortit de la bouche d'Ali et dit que la pierre était prête. Quelle sera la commande ? L’ordre était le suivant : tirez sur cette pierre et tenez la suivante jusqu’à ce que j’arrive.
Au cours de ses voyages à travers le pays, Babur montra un vif intérêt pour les détails matériels de ses nouvelles possessions. A Chanderi, dont il dut prendre d'assaut et capturer la forteresse tenue par le puissant général Rana Sangi en 1528, Babur fut très impressionné par le fait que toutes les maisons étaient construites en pierre et que « celles appartenant aux personnes les plus influentes étaient décorées de pierres précieuses ». sculptures élaborées »; plus tard cette année-là, à Gwalior, il admira le palais de Raja Man Singh, construit vingt ans plus tôt et composé de « magnifiques bâtiments en pierre de taille », dont les murs extérieurs étaient décorés de tuiles colorées et les dômes de cuivre étaient dorés. La seule chose que Babur n'aimait pas à Gwalior étaient les figures jaïns sculptées dans la roche au pied de la forteresse au siècle précédent. "Ces idoles", écrit l'empereur, "sont représentées nues, avec leurs organes reproducteurs exposés... J'ai, pour ma part, ordonné leur destruction." En fait, seuls les visages et les organes génitaux notoires ont été détruits, et les restaurateurs modernes étaient en partie d'accord avec Babur, ne restaurant que les visages. Mais Babur avait certainement raison dans son évaluation de ce qu'il a vu dans la forteresse, et ses héritiers ont accepté le point de vue de leur ancêtre. L'architecture indienne de Gwalior préfigure le style d'Akbar à Fatehpur Sikri avec ses poutres sculptées et ses consoles en grès rouge et, un demi-siècle plus tard, les magnifiques carrelages des murs de la forteresse de Lahore, ainsi que les dômes dorés d'Agra.
Babur avait maintenant le temps de noter ses impressions. Dans les jardins, créés par sa volonté pour rappeler les joies de Kaboul et pour se protéger de la chaleur estivale, il a travaillé sur ses mémoires. Sa fille Gulbadan, alors âgée de six ans, a décrit plus tard comment il s'occupait de ses papiers dans le jardin construit à Sikri, et Babur lui-même nous a laissé une histoire très mémorable sur l'incident au cours duquel un orage a éclaté et la tente dans sur lequel il travaillait s'est effondré sur sa tête : « Toutes les feuilles de notes et le livre étaient trempés, ils ont été rassemblés avec beaucoup de difficulté. Nous les avons placés entre les plis d'un tapis de laine pris sur le trône, puis nous avons posé le tout sur le trône et l'avons pressé dessus avec un tas de couvertures. Malgré l’humidité, ils allumèrent un feu et Babur « contourna le feu jusqu’à ce que toutes les feuilles et le livre soient secs à la lumière du jour ».
Il était occupé à cette époque à donner des entrées fragmentaires, qui ressemblaient à un journal intime, à une forme narrative, mais il trouvait également le temps de rédiger une description magnifique et très détaillée de quarante pages de sa nouvelle possession, l'Hindoustan. Dans ce livre, il explique le système social et le système des castes, parle des caractéristiques géographiques du pays et de son histoire de ces dernières années ; s'émerveille des méthodes de comptage et de lecture du temps, de l'abondance des artisans indiens et bien plus encore, mais son principal intérêt est la flore et la faune du pays, qu'il observe avec le soin d'un naturaliste né et les décrit comme un véritable artiste - un intérêt et un don hérité en totalité par son arrière-petit-fils Jahangir. Babur identifie et décrit, par exemple, cinq espèces de perroquets ; il déclare avec une étonnante observation scientifique que le rhinocéros ressemble « plus à un cheval qu'à tout autre animal » (selon les zoologistes modernes, seuls deux sous-ordres de l'ordre des Perissodactyla survivent, l'un contenant des rhinocéros, l'autre des chevaux). Dans d'autres parties du livre, il admire les couleurs changeantes d'un troupeau d'oies sauvages volant au-dessus de l'horizon, ou admire les belles feuilles d'un pommier. La sensibilité avec laquelle Babur parle des expériences amoureuses se ressent dans ses observations de la nature.
Le précieux manuscrit, récupéré et séché après un orage, était pratiquement terminé en 1530 et occupait une place de choix dans la bibliothèque familiale en pleine expansion. La collecte et la préservation des manuscrits étaient une tradition timouride. Babur en a amené beaucoup avec lui en Inde, et lorsqu'il a pris possession de la forteresse de Lahore, son premier acte a peut-être été de visiter la bibliothèque de Ghazi Khan, où il a lui-même sélectionné des livres inestimables et les a envoyés à ses fils. Humayun, qui vingt-cinq ans plus tard commenta lui-même les mémoires de son père, emportait partout avec lui la bibliothèque familiale et ne se séparait pas de certains de ses livres préférés, même au combat ; il est possible que de grands passages des mémoires de Baburl aient été perdus au cours de ces déménagements. Sous le patronage actif d'Akbar, la collection de manuscrits est devenue l'une des meilleures au monde. Le texte manuscrit des mémoires de Babur est aujourd'hui perdu, mais il est rapporté que le livre se trouvait dans la bibliothèque royale sous le règne de Shah Jahan et y resta presque certainement jusqu'au sac de Delhi en 1739 lors de l'invasion de Nadir Shah ou même jusqu'à la rébellion de 1857, au cours de laquelle la collection de manuscrits fut complètement dispersée.
La position de padishah, que Babur s'était déclaré à Kaboul, puisqu'il restait le seul prince de la dynastie timouride à détenir le trône, était désormais plus sûre et légitime que jamais, et Babur pouvait célébrer solennellement sa suprématie. La rumeur s'est répandue que tous les descendants de Timur et de Gengis Khan, ainsi que tous ceux qui avaient servi Babur dans le passé, devraient venir à Agra et « recevoir les faveurs qui leur sont dues ». À la fin de 1528, apparemment, un nombre considérable de personnes acceptèrent l'invitation à une magnifique célébration. Les invités les plus importants étaient assis dans un pavillon spécialement construit pour cette occasion en demi-cercle d'une centaine de mètres de long, avec Babur au centre, et les deux événements principaux - la consommation de nourriture et la remise des cadeaux - se déroulaient sous l'accompagnement constant de combats entre animaux, spectacles de lutte, danses et acrobaties. L'or et l'argent coulaient comme une rivière des mains des invités de Babur sur un tapis spécialement posé à cet effet, et il présenta à son tour des cadeaux royaux, particulièrement appréciés en de telles occasions - des ceintures d'épée et des vêtements d'honneur, pour une chose ou une robe de les mains de l'empereur sont un signe visible et tangible de son affection. Parmi les invités importants venus de pays lointains figuraient des envoyés des anciens ennemis de Babur, les Ouzbeks, dont la présence était en partie flatteuse pour le nouvel empereur, mais non seulement des personnalités célèbres reçurent la récompense : des flotteurs, des tireurs de mousquet, un dresseur de guépards et même plusieurs paysans. de Transoxiane - tous ont soutenu Babur dans les « temps sans trône » et sont maintenant venus chercher leur récompense. Tout le monde a été respecté et tout le monde a reçu des cadeaux. Cette grande fête marquait le point culminant d'une période de générosité, de patience et de tolérance spectaculaires, dont Babur jouissait ouvertement dans ses nouvelles possessions, si riches en comparaison avec la petite Kaboul provinciale. « Les trésors des cinq rois lui sont allés », écrivit plus tard Gulbadan, « et il les a tout distribués ». Il rendit froidement le Kohinoor à Humayun. Il envoya des tas des bijoux les plus magnifiques aux femmes de sa famille à Kaboul. Tout cela était très attrayant, mais à courte vue, et même avant le festival, les ressources étaient si épuisées que les officiers reçurent l'ordre de restituer un tiers de leurs salaires au trésor. L'empire hérité de Humayun avait trop peu de moyens pour rembourser cet argent.
Babur n'avait que quarante-cinq ans, mais il était extrêmement souvent malade. Sa santé n'a jamais été bonne - ses souvenirs regorgent de mentions de maladies alarmantes et de médicaments encore plus alarmants - de plus, Babur, comme beaucoup de membres de sa famille, était un gros buveur, et les interdictions coraniques sur l'alcool avaient exactement le même effet. Le dix-huitième amendement américain. Babur explique à un moment donné dans ses mémoires que, ayant décidé d'abandonner le vin à l'âge de quarante ans, il « boit désormais de manière excessive, même si moins d'un an s'est écoulé » ; les pages de son livre regorgent de descriptions de la façon dont lui et d’autres persuadent ou trompent les gens pour qu’ils boivent de l’alcool. Pour beaucoup, cela semblait être une expérience de sensations exceptionnellement agréables ; c'est comparable à l'attitude de certains puritains envers le sexe. L'une des histoires passionnantes préférées raconte l'histoire d'un certain émir cruel qui tortura sa pieuse sœur en l'enfermant dans une pièce et en ne lui donnant ni nourriture ni boisson ordinaire, mais seulement du vin ; elle refusa et était prête à accepter le martyre, mais l'émir lui versa de force du vin dans la bouche pour ajouter du dégoût au tourment. À propos, Babur lui-même préférait une drogue, majun, comme il l'appelle, à l'alcool, et dans ses descriptions de ses sensations agréables, il est très proche des temps modernes ; "Sous son influence, de magnifiques champs de fleurs sont apparus devant nous... nous nous sommes assis sur une colline près du camp et avons admiré la vue." Mais bien sûr, il serait exagéré de lui donner le surnom de toxicomane ou d'alcoolique - sans parler de tout le reste, il y avait trop d'ordre dans ses loisirs : samedi, dimanche, mardi et mercredi étaient consacrés au vin, le les trois jours restants de la semaine à Majun. Ses maladies - abcès constants, sciatique, écoulement purulent des oreilles et hémoptysie - s'expliquent principalement par la dure vie de ses jeunes années.
Il était à noter qu'après son arrivée en Inde, il commençait à tomber malade beaucoup plus souvent, peut-être à cause de l'âge, peut-être à cause du climat, mais cette circonstance a sans aucun doute influencé la décision de Humayun de se précipiter du Badakhshan à Agra, contrairement aux ordres qui lui avaient été donnés en 1529 année. La raison immédiate en était la nouvelle selon laquelle certains des plus proches conseillers de Babur envisageaient de contourner Humayun et ses frères en décidant de l'affaire en faveur d'un certain Mahdi Khoja, justement leur oncle, devenu tel à la suite de leur mariage. Au cours des événements, l'oncle a perdu tout soutien en raison de son comportement arrogant, mais Humayun, et non son père, est rapidement tombé gravement malade. La tradition associe une histoire touchante à la réponse de Babur à la maladie de son fils. Alors qu’il était assis avec des sages sur les rives de la Jumna, on lui conseilla d’« acheter » la vie de Humayun au destin, en lui donnant en échange ce qu’il possède de plus précieux. Les conseillers pensaient à "Kohinoor" (la légende ne tient pas compte du fait que la pierre appartenait à Humayun), mais Babur comprit cela comme la nécessité de sacrifier sa propre vie. Il fit trois fois le tour du lit du malade, s'adressant bruyamment à Dieu avec cette proposition, et le même jour, Humayun commença à se rétablir, et Babur tomba malade d'une fièvre dont il mourut bientôt. Peut-être que Babur a accompli ce rituel bien connu dans les pays de l'Est, mais le transfert instantané de la maladie d'une personne à une autre, qui est l'essence principale de l'histoire racontée, n'est pas confirmé par les faits. Plusieurs mois se sont écoulés entre la guérison de Humayun et la maladie finale de Babur, qui fut en effet de très courte durée.
Humayun, à qui un messager a été envoyé à Sambhal, s’est avéré être le seul fils suffisamment proche pour se rendre au lit de malade de son père. L'empereur, dans son oubli mourant, répétait constamment le nom de Hindal, onze ans, qui se dirigeait vers lui depuis Lahore, mais ce n'était clairement pas de nature politique, mais exprimait seulement le désir de voir Benjamin de leur famille, puisque Babur demandait encore et encore quelle taille le garçon avait maintenant atteint et examinait soigneusement les vêtements préparés pour le prince. Il semble bien clair que si Babur partageait dans une certaine mesure les doutes de ses confidents sur la capacité de Humayun à diriger l'empire, il était néanmoins ferme dans son intention de laisser le trône à son fils aîné.
L'Empereur meurt le 26 décembre 1530. Le chemin de la vie de Babur, avec tous ses hauts et ses bas, depuis le petit Ferghana jusqu'à l'Hindoustan, lui a assuré à lui seul sa place de membre junior dans la ligue de ses grands ancêtres Timur et Gengis Khan, mais le soin et l'intégrité avec lesquels il raconte son odyssée personnelle va d'un voleur de sang royal, prêt pour toute aventure, à l'empereur, regardant avec un étonnement ravissant tous les détails de ses possessions, lui donnant une dignité supplémentaire que très peu de personnages de ce genre ont pu atteindre. Son livre lui-même est devenu une source d’inspiration puissante et bénéfique pour ses héritiers. Fervents lecteurs de l’histoire familiale, ils y trouvent le reflet le plus personnel de leurs propres coutumes. Avec un respect indéniable, ils imitèrent délibérément Babur. Jahangir a écrit un livre très similaire sur sa propre vie ; Shah Jahan a volontairement copié le geste de Babur en versant du vin sur le sol à la veille de la bataille décisive. Plus important encore, plusieurs générations de Moghols ont suivi le concept de gouvernement de Babur, qui, selon les normes de l'époque, était résolument libéral. Dans ses mémoires, il répète à plusieurs reprises et de manière convaincante que les opposants vaincus sont plus enclins à la paix qu'à l'hostilité s'ils sont ensuite sagement contrôlés, et que les associés du dirigeant devraient être strictement et strictement empêchés de traiter de manière injustifiée la cruauté envers la population locale. C’était un postulat qui joua un rôle important dans les grands jours de l’empire moghol.
Babur a d'abord été enterré à Agra, dans un jardin au bord de la Jumna, mais il a exprimé sa volonté dans son testament que son dernier lieu de repos soit son jardin bien-aimé à Kaboul. Le corps de Babur est resté à Agra pendant au moins neuf ans, mais entre 1540 et 1544, il a été transporté à Kaboul depuis l'Hindoustan, alors gouverné par Sher Shah, le conquérant de Humayun. La tombe de Kaboul est située dans un jardin sur une pente en escalier, sur une haute terrasse, où Babur aimait s'asseoir, profitant du paysage de son petit royaume, qu'il a toujours considéré comme sa maison. Deux de ses enfants, Hindal et Khanzada, sont enterrés à proximité sur la même terrasse. Certains de ses descendants, les Moghols, firent de pieux ajouts au tombeau de Babur. Jahangir a installé une stèle de marbre à la tête d'une simple dalle de pierre, Shah Jahan - une élégante clôture également en marbre, et a ordonné la construction d'une mosquée en marbre blanc sur la terrasse inférieure. L'ensemble aurait pu constituer un merveilleux mémorial extérieur, mais malheureusement quelques responsables actuels ont décidé de protéger le marbre durable en construisant une superstructure absurdement incompatible au-dessus du mémorial, ressemblant à une gare routière coûteuse avec un toit de tuiles rouges en pente et une lucarne. - tout cela contrairement à la volonté de l'empereur clairement exprimée dans sa volonté de ne pas ériger de toit sur sa tombe. Babur, qui, comme Jahangir, était le jardinier le plus passionné parmi les Moghols, aurait été profondément déçu par l'état actuel de ses terrasses, négligées et réservées en partie à des constructions provisoires et à une immense piscine en béton. Aujourd’hui, comme probablement au cours des deux derniers siècles, la note romantique de Babur à propos de la tombe de son jardin bien-aimé est oubliée. Mais nul doute que tôt ou tard, avec la croissance constante du tourisme dans tout l’ancien empire moghol, Kaboul trouvera judicieux de lui rendre hommage.
Fondation de l'empire moghol. Campagnes militaires de Babur
Babur, Zahireddin Muhammad (1483-1530), fondateur du pouvoir moghol en Inde, qui dura plus de deux siècles (1526-1761). Du côté paternel - un descendant de Timur, du côté maternel, peut-être, de Gengis Khan. Cet homme est entré dans l'histoire du monde en tant que fondateur de la plus grande puissance des XVIe et XVIIIe siècles sur le territoire de l'Inde et de l'Afghanistan - l'empire moghol. Cet empire s'appelait Mogul parce que son créateur était le petit-fils de Tamerlan, qui, à son tour, était un lointain descendant de Gengis Khan, c'est-à-dire un Mongol. Les Grands Moghols est le nom donné à la dynastie fondée par cet homme.
Son nom est Babur. Babur signifie « lion ». Et le nom original était Zahireddin Muhammad. À l'âge de onze ans, il hérite de son père la Principauté de Fergana. Expulsés d'Asie centrale par les tribus turques venues de Sibérie (les ancêtres des Ouzbeks). En 1504, avec l'aide de son parent, le souverain d'Herat, il occupa Kaboul, où il commença à créer une armée forte, recrutée parmi les Afghans et les Gakars originaires d'Asie centrale. Suite à cela, il tenta en vain de capturer Samarkand, l'ancienne capitale de Timur.
Décidant que ce n'est qu'en conquérant l'Inde qu'il deviendrait le chef d'un État puissant, Babur lança en 1518 et 1524 des attaques contre le Pendjab. Le gouverneur du Pendjab, Daulat Khan, étant en inimitié avec le sultan Ibrahim Lodi, qui régnait à Delhi, a initialement soutenu les actions de Babur, estimant que lui, comme Timur, écraserait le sultanat de Delhi et rentrerait chez lui, et que le trône de Delhi serait vacant. . Mais Babur, après avoir occupé Lahore en 1524, entreprend l'année suivante, à la tête d'une armée forte de 12 000 hommes, une nouvelle campagne. Daulat Khan s'est opposé à lui, mais a été vaincu. La bataille décisive avec l'armée forte de 40 000 hommes du sultan Ibrahim Lodi eut lieu en avril 1526 dans la plaine de Panipat (sur la route du Pendjab à Delhi). L'armée de Babur avait une supériorité écrasante en artillerie et créait habilement des abris pour ses canons à partir de chariots attachés avec des ceintures. En outre, il adopta la tactique consistant à envelopper les flancs ennemis avec la cavalerie mongole. Tout cela prédéterminait la victoire éventuelle de Babur ; la route de Delhi lui était désormais ouverte. Cependant, le dirigeant de Mewar, Raja Sangram Singh, se tenait sur son chemin, qui rassembla une armée de milliers de personnes parmi les détachements de cavalerie de plusieurs princes Rajput. La bataille des Rajputs avec Babur eut lieu en mars 1527 à Khanua. Une fois de plus, la supériorité de Babur en artillerie fut décisive pour l'issue de la bataille. Ces deux victoires signifiaient l'établissement virtuel de la domination de Babur dans le nord de l'Inde. Par la suite, son État s'est étendu jusqu'au cours inférieur du Gange, à l'est, à la suite de la défaite des dirigeants afghans du Bihar et du Bengale en mai 1529.
Une partie des troupes afghanes de l'armée de Babur sont rentrées chez elles, chargées de butin. Les guerriers restés en Inde reçurent des parcelles de terre de Babur en guise de primes de service. Ces nouveaux propriétaires fonciers engageaient comme gestionnaires des Indiens qui connaissaient bien les coutumes de leur pays. Babur n'a pas eu le temps d'achever la formation de l'appareil administratif fiscal et du système de gouvernement centralisé. Ces problèmes ont été résolus par ses successeurs.
Babur était un commandant et un homme politique exceptionnel. Sentant la précarité de sa situation dans un pays conquis à la culture unique, il tente de mieux connaître les coutumes et les spécificités locales. Des sources notent son éducation, son observation et sa capacité à apprécier l'art. Il s'intéressait à l'histoire, à la culture des peuples d'Asie centrale, d'Afghanistan et d'Inde, à la flore et à la faune de ces pays. Babur est connu comme un merveilleux poète qui a écrit en langues jagatai et tadjike, en tant qu'auteur des mémoires « Babur-name ». Bien qu'il méprisait quelque peu les hindous en les qualifiant d'« infidèles », il faisait preuve d'une certaine tolérance à leur égard et ne persécutait que ceux d'entre eux qui le traitaient avec méchanceté.
Avant sa mort, Babur a partagé ses biens entre ses fils, laissant la principale partie indienne du territoire de l'État à l'aîné - Humayun - et ordonnant aux autres, qui ont reçu le Pendjab, Kaboul et Kandahar, de lui obéir.
Conquête de l'IndeL'un des scientifiques indiens, Tripathi Ram Prosad, évaluant cette victoire de Babur à Panipat, a écrit que « la victoire à Panipat de Zahireddin Muhammad Babur a jeté les bases du grand empire moghol (c'est-à-dire Baburid) en Inde, qui dans sa splendeur, sa puissance et la culture restait le plus grand empire du monde musulman et pouvait même rivaliser avec l’Empire romain. »
Cependant, afin de consolider enfin la victoire à Panipat, Babur devait poursuivre sa lutte politique et mener une politique interne qui lui permettrait de gagner la sympathie et la faveur des habitants des villes et villages de l'Inde. L'une des manifestations de cette politique fut la publication d'un décret supprimant la taxe tamga prélevée sur le commerce.
Dans "Babur-nama", on trouve sa description la plus détaillée d'une autre bataille de Babur à Sikri avec Rano Sangram Singh, qui eut lieu le 13 mars 1527. Rano Sangram et ses alliés : Hasan Khan Mewati - le souverain de Dungarpur, Rawal Udi Sang Bagari, Rai Chandraban Chauhan, le fils du dirigeant Chandari - Bhupat Rao, et bien d'autres n'ont pas pu résister aux tactiques militaires de Babur. La manœuvre de tulgam qu'il a exécutée avec succès, c'est-à-dire une attaque soudaine de l'arrière et des flancs de l'ennemi, ainsi qu'une frappe d'artillerie, décidèrent du sort de la bataille de Sikri. En décrivant cette bataille, Babur analyse objectivement les faiblesses et les forces de son adversaire, sans oublier de rendre hommage à la bravoure et au courage de son ennemi, Rano Sangram Sinha.
Comme on le sait, la situation en Inde est devenue politiquement relativement stable après la troisième bataille de Babur à Gogra, qui a eu lieu le 6 mai 1529 et s'est terminée par la victoire complète de Babur et une défaite majeure des seigneurs féodaux afghans et bengals. La bataille de Gogra fut la troisième et dernière victoire qui fit de Babur le maître absolu de l'Inde du Nord. Ses données sur les principautés indépendantes du Gujarat, Malwa, Mewar, Bengale, Deccan et Bijanagar sont très précieuses. Babur mentionne au passage le Cachemire et le Sind. Babur, pendant son séjour en Inde, a eu une bonne occasion de communiquer avec la population indigène du pays. Ses pouvoirs et son autorité s'étendaient de Kaboul au Bihar, couvrant la plupart des oasis agricoles densément peuplées du nord de l'Inde. Une analyse des données de Babur concernant la géographie de l'Inde montre que Babur distingue très clairement trois bassins : le bassin de l'Indus, le Gange et un affluent du Gange. "Ces montagnes situées au nord de l'Hindoustan, les Indiens appellent Salavak Parbat. Dans la langue indienne, sava est un quart, lak est cent mille, parbat est une montagne ; il s'avère", écrit Babur, "un quart et cent mille montagnes, c'est-à-dire vingt-cinq mille montagnes.
Politique intérieure et étrangère de Babur en IndeMalgré son très court règne en Inde (1526-1530), Babur réussit dans une certaine mesure à unifier le pays féodal fragmenté et à mettre en œuvre des mesures aussi importantes que la rationalisation des relations terre-eau et du système fiscal. Sur ses ordres, des mosquées furent améliorées, des bâtiments à des fins diverses furent érigés, des bains furent construits, des puits furent creusés, etc. Dans les grandes villes de l'Inde - Delhi, Agra, Lahore, Devalpur - Babur a aménagé des jardins et des parcs avec des plantes ornementales. Il est caractéristique que lors de la planification des jardins, Babur ait utilisé le système charbagh d'Asie centrale. Du « Babur-nama », on apprend qu'en 1526 à Panipat, Babur, en l'honneur de la victoire sur Ibrahim Lodi, a aménagé un grand jardin appelé Kaboul-bakht, qui, apparemment, était sa première construction sur le territoire indien. Dans les jardins aménagés en Inde, Babur a d'abord appliqué l'expérience de la culture des melons et des raisins d'Asie centrale (un cépage appelé Anguri Samarkandi, c'est-à-dire les raisins de Samarkand, est encore cultivé en Inde).
Dans ses activités, Babur a constamment poursuivi l'objectif d'améliorer les grandes villes indiennes sous son contrôle. La disposition et l'architecture des bâtiments publics et privés, leur conception extérieure et intérieure, qui rappellent beaucoup le style d'Asie centrale, se sont organiquement combinées en même temps avec la forme et le style indiens, ce qui a conduit au contact de deux cultures - indienne et centrale. Asiatique. Ce processus s'est développé sous les successeurs de Babur, ce qui est particulièrement visible dans le style des grands bâtiments construits par ses descendants dans le nord de l'Inde.
Cependant, non seulement l'interpénétration et l'influence mutuelle de deux cultures - l'Asie centrale et l'Inde - sont caractéristiques du règne de Babur en Inde, mais aussi une certaine transformation de certaines institutions féodales inhérentes aux deux pays au Moyen Âge (par exemple, la institutions de Tarkhan, Suyurgal, etc.). Tout cela se reflète bien dans Babur-nama.
En Inde, Babur cherchait constamment à renforcer les liens commerciaux et économiques avec l'Asie centrale, l'Afghanistan et l'Iran, qui furent interrompus après la défaite de Babur en 1511 lors de la bataille avec Ubaydulla Khan à Quli Malik, près de Boukhara. Le firman spécial (décret) de Babur sur la mesure de la distance entre Agra et Kaboul, sur l'amélioration des caravansérails, la construction de puits spéciaux sur les routes commerciales, l'approvisionnement en fourrage et en nourriture pour les voyageurs a été créé dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires commercial du pays. , normalisant le système des relations extérieures avec les autres pays.
Créativité de BaburBabur a également écrit un traité de poétique ; présentation sous forme poétique du fiqh (loi islamique) et de son propre développement de l'alphabet - « Khatti Baburi » (« L'alphabet de Babur »). "Hatti Baburi" a été créé sur la base d'anciennes écritures turques et a été simplifié dans son style (par rapport à l'écriture arabe complexe).
Babur a écrit cette œuvre dans l'ancienne langue ouzbèke (turc). Comme en témoignent les sources historiques primaires écrites en Inde au Moyen Âge, le rôle de la vieille langue ouzbèke - la langue d'Alisher Navoi, Babur et de ses successeurs - était perceptible au cours de cette période. L'ancienne langue ouzbèke, ainsi que la langue persane (dari) et l'ourdou, ont joué un rôle important dans le développement de l'art et de la littérature en Inde aux XVIe et XVIIe siècles. et occupait une place de choix. De nombreux représentants de la science historique et de la littérature du cercle restreint de Babur - Khoja Kalan, Cheikh Zain, Turdibek Khaksar, Bayram Khan et d'autres ont également écrit leurs œuvres en vieille langue ouzbèke. Non seulement « Babur-name » et le traité « Mubayin » ont été écrits dans l'ancienne langue ouzbèke, mais aussi un divan poétique, conventionnellement appelé par nous « divan indien », compilé par Babur lui-même, actuellement conservé à Rampur dans la bibliothèque du Nabab indien.
Babur ressentait un immense amour pour sa patrie, l’Asie centrale, et l’Afghanistan, qui est devenu sa deuxième patrie. Il a toujours vécu avec l'espoir de rentrer chez lui. Dans l'anthologie des poètes "Makalat-i Shuora", publiée à Karachi par Alisher Kanig Tatavi, a été conservé le dernier poème de Babur en persan, peu connu même des érudits, dans lequel il écrit :
Je n’ai jamais rencontré le bonheur de ma vie ; je suis devenu associé au malheur.
Dans tous les domaines - une erreur de calcul, pour tout je suis devenu responsable de tout.
Après avoir quitté mon pays natal, j'ai erré vers l'Hindoustan et j'ai été à jamais enduit du goudron noir de la honte. (traduit par L. Penkovsky)
Peu importe où je vais, la tristesse m'accompagne partout, j'emporte mon malheur partout, mon sort est triste.
Et des centaines de soucis douloureux, et des milliers d'adversités - La part qui m'opprime n'est donnée à personne d'autre ! Je suis séparé de mon luminaire, je brûle dans le creuset des tourments, Mon cœur brûle de toutes parts, mon âme est épuisée.
Quand tu es sombre à cause de la souffrance, ne partage pas ton malheur, Ne pleure pas en public, Babur, ils trouvent ta douleur drôle ! (traduit par S. Severtsev)
Cependant, Babur n'a jamais réussi à réaliser son rêve. Des informations assez détaillées sur les derniers mois de la vie de son père ont été laissées par la fille de Babur, Gulbadan-begim, dans son livre « Humayun-name ». Babur, sauvant le fils gravement malade de Humayun, selon le rituel, fit trois fois le tour du lit du malade, disant en même temps qu'il prenait sur lui la maladie de Humayun. Bientôt, Humayun commença à se rétablir, mais Babur tomba malade et mourut trois mois plus tard. C'est la version romantique de la mort de Babur, laissée aux eaux par sa fille.
Plus de quatre siècles et demi se sont écoulés depuis la mort de Babur, pleins de contradictions et de luttes sociales aiguës des peuples d'Asie centrale, d'Afghanistan, d'Iran et d'Inde. Cela fait longtemps. Mais le nom de Babur - un historien, un artiste de mots talentueux, un commandant et un homme d'État habile - est immortel. "La mémoire de l'humanité est économique ; de la grande abondance d'images, de noms et d'actes émergents, elle ne stocke plus tard que ceux qui contiennent encore quelque chose d'important et de nécessaire à la vie. Elle généralise avec confiance, selon un instinct indubitable, en stockant fermement ce qui est nécessaire. alors que c'est nécessaire, et balayant tout le reste comme des déchets dans le fleuve de l'oubli. » C’est l’œuvre de Babur « Babur-name » qui a résisté à l’épreuve du temps.
La nouvelle édition de "Babur-name" dans son pays natal, en Ouzbékistan, est un hommage au profond respect pour son talent et à la haute reconnaissance de sa contribution scientifique au développement de la littérature et de l'historiographie nationales. Cette publication ne poursuit pas uniquement des objectifs scientifiques, elle s'adresse à un large public dans le seul but de lui faire découvrir le brillant héritage de Zahireddin Babur.
"Nom Babur"Grâce à ses capacités exceptionnelles, Babur est entré dans l'histoire non seulement en tant que commandant et dirigeant fondateur de la dynastie Baburide en Inde, mais également en tant que scientifique et poète, qui a laissé un riche héritage littéraire et scientifique créatif dans le domaine de la jurisprudence musulmane. Il est l'auteur d'œuvres lyriques originales (ghazals, rubai), de traités sur la jurisprudence musulmane (« Mubayin »), de poétique (« Aruz risolasi »), de musique, d'affaires militaires, ainsi que d'un alphabet spécial « Khat-i Baburiya ».
Cependant, la place centrale dans l'œuvre de Babur est occupée par un monument littéraire inestimable de la prose en langue ouzbek - son œuvre historique « Nom de Babur ». Le livre a été achevé en Inde, il est principalement de nature autobiographique et reflète l'histoire des peuples d'Asie centrale, d'Afghanistan et d'Inde à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.
"Il était le plus grand, mais bien plus humain que tous les autres conquérants orientaux... et quoi que les gens puissent penser de lui à d'autres égards, nous ne pouvons penser à lui autrement qu'avec une profonde sympathie pour ce géant généreux et sociable...", note V. N. Moreland dans son livre « Le système agraire de l’Inde musulmane ».
Les mérites de Babur en tant qu'historien, géographe, ethnographe, prosateur et poète sont actuellement reconnus par la science orientale mondiale.
L'intérêt pour ce livre est en grande partie dû aux qualités personnelles très extraordinaires de l'auteur lui-même - Zahireddin Muhammad Babur, le fondateur du vaste empire baburide en Inde, qui a duré plus de trois siècles, jusqu'au début du XIXe siècle.
Dans sa capitale Agra, Babur rassembla autour de lui de nombreux écrivains, poètes, artistes, musiciens et scientifiques remarquables, auxquels il accorda une grande attention. Babur mourut le 26 décembre 1530. Quelque temps après la mort de Babur, sa dépouille fut transférée d'Agra à Kaboul, dans un jardin de campagne, aujourd'hui connu sous le nom de Bagh-i-Babur (Jardin de Babur).
Dans son livre « Babur-name », Babur décrit en détail les grandes villes d'Asie centrale, du Khorasan, de l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Inde. Ses données sur Fergana, Andijan, Samarkand, Boukhara, Kaboul, Ghazni, Balkh, Badakhshan, Delhi, Devalpur, Lahore sont inestimables, car l'auteur donne une idée de la situation géographique de ces villes, de leur rôle commercial et économique dans le l'économie féodale de cette époque. En comparant les données de Babur avec les informations ultérieures des historiens, on peut imaginer la croissance et le développement de ces villes au cours des siècles suivants. Parmi les villes d'Asie centrale décrites par Babur, une place particulière est occupée par ses villes natales de l'héritage de Fergana : Andijan, Aksy, Kasan, Osh, Kanibadam, Isfara, Margilan, Khojent, Uzgen, dont il revient en détail sur les caractéristiques. . Parmi elles, Babur met particulièrement en avant les villes d'Andijan et d'Osh. Décrivant Andijan, qui fut la capitale de l'héritage de Fergana, Babur note qu'il y a là beaucoup de pain, des fruits en abondance, des melons, de bons raisins ; Il n'y a pas de meilleures poires que celles d'Andijan.
La description par Babur des routes caravanières menant de Kaboul non seulement vers l'Inde, mais aussi vers l'Asie centrale, avec les caractéristiques des sentiers de montagne menant aux cols les plus importants, coïncide complètement avec les descriptions topographiques du XIXe siècle, faisant admirer les connaissances colossales de l'auteur. C’est pourquoi A. Borns, qui s’est rendu à Kaboul en 1882, après avoir visité la tombe de Babur, a écrit qu’il avait un profond respect pour la mémoire de Babur, qui s’est encore accru depuis qu’il a lu les notes curieuses (c’est-à-dire le nom de Babur).
« Babur-Nama » reflète parfaitement les descriptions de la nature, de la faune et de la flore de l'Asie centrale, de l'Afghanistan et de l'Inde ; ses observations topographiques, toponymiques et ethnographiques de l'Afghanistan et de l'Inde sont si précises et imaginatives que dans leur signification elles ne sont en rien inférieures aux données de célèbres voyageurs européens des XIVe-XXe siècles et, au contraire, dans de nombreux cas même surpassez-les avec une présentation plus détaillée et fiable. Il écrit : "Les montagnes d'Anderab, de Khost et de Badakhshan sont toutes couvertes de genévriers, regorgent de sources et s'élèvent doucement ; l'herbe des montagnes, des collines et des vallées est la même et bonne. Il y a surtout de l'herbe de butekah. C'est très herbe appropriée pour les chevaux... », « ... les montagnes Nijraw, Lamganata, Bajaura et Sawada sont des montagnes où il y a beaucoup de pins, de pins, de chênes, d'oliviers et de lentisques ; l'herbe là-bas n'est pas comme sur ces montagnes - épaisse et haute, mais c'est une herbe inutile ; elle ne convient pas aux chevaux et aux moutons".
Décrire la géographie de l'Inde ; Babur écrit que "de nombreuses rivières prennent leur source dans ces montagnes et coulent profondément dans l'Hindoustan. Au nord de Sinhind, six rivières coulent, commençant dans ces montagnes : Sind, Bahad, Chenab, Ravi, Biyah et Satlaj. Dans les environs de Multan, elles fusionnent toutes et coulent de cet endroit nom commun Sindh. Le Sindh coule vers l'ouest, traverse la région de Tata et se jette dans la mer d'Oman. Il existe d'autres rivières dans l'Hindoustan en plus de ces six, comme le Juin, le Gange, le Rahab, le Gumti, Ghaghar, Siru, Gandak et bien d'autres grands fleuves, qui rejoignent tous le fleuve Gange et sont également appelés Gange. Ce fleuve coule vers l'est, traverse le Bengale et se jette dans l'océan. Les sources de ces rivières se trouvent dans le Salawak Parbat montagnes.
Babur, décrivant en détail l'Hindoustan, admire sa nature, compare les diverses caractéristiques de ce pays avec sa patrie d'Asie centrale : "C'est un pays étonnant ; en comparaison avec nos terres, c'est un monde différent. Montagnes, rivières, forêts, les villes, les régions, les animaux, les plantes, les forêts, les gens, la langue, les pluies et les vents, tout y est différent du nôtre. Bien que les régions chaudes adjacentes à Kaboul ressemblent à certains égards à l'Hindoustan, elles ne le sont pas à d'autres égards : une fois que vous traversez le fleuve Sind, les terres et l'eau, les arbres, les pierres, les gens et les coutumes - tout devient comme dans l'Hindoustan. Décrivant la vie politique en Inde, Babur donne des données fragmentaires sur l'histoire de l'Inde au XIe siècle, tout en couvrant en détail l'histoire de l'Inde du XVe au début du XVIe siècle.
« Babur-nama » contient de nombreuses données factuelles sur l'ethnographie : des descriptions intéressantes des différents vêtements des hindous, de leur système de castes, des coutumes, du mode de vie du peuple et de la noblesse féodale. Par exemple, le « Babur-nama » décrit les vêtements pour hommes hindous - dhoti, les vêtements pour femmes - saris, que Babur appelle le terme langut d'Asie centrale et décrit en détail la façon dont ils sont habillés. Des informations similaires ne sont pas contenues dans d'autres chroniques historiques et constituent des données historiques et ethnographiques précieuses. Il note principalement des traits directement d’origine indienne. Par exemple, la méthode d’extraction du jus de datte et de fabrication du vin de palme (tari) en Inde, totalement inconnue en Asie centrale. Babur décrit également le merveilleux fruit de la mangue, qui l'a beaucoup impressionné.
Du monde animal, l'auteur décrit des éléphants, des rhinocéros, des paons, des perroquets et autres. Babur est émerveillé par la beauté de ces oiseaux. Parmi les fleurs, Babur mentionne la fleur rouge des lauriers roses de Gwalior, qu'il a apportés à Agra et qu'il a ordonné de replanter dans son jardin de Zarafshan. La fleur « nilupar », qu'il a décrite en détail dans « Babur-nama », a également attiré son attention. Il note notamment les propriétés de l'aléandre et du jasmin. À propos du jasmin, il écrit que cette fleur est plus grande et que son odeur est plus forte que celle de l'Asie centrale.
La troisième et dernière partie de "Babur-name", bien que principalement consacrée à la description des événements politiques survenus dans le nord de l'Inde qui ont eu lieu à partir du jour de la première campagne de Babur en Inde dans le but de prendre le pouvoir au sultan Ibrahim (1517-1526) jusqu'au jour de la mort de Babur, contient également de nombreuses informations intéressantes sur la vie politique, économique et culturelle des peuples de l'Inde dans le passé, décrit les villes de l'Inde, révèle de nombreuses relations socio-économiques et ethno-culturelles spécifiques uniquement de ses peuples. Babur couvre en détail l'histoire du règne de la dynastie Lodienne en Inde, dont le représentant, comme on appelle Suli, se trouvait à Panipat, le 21 avril 1526. La bataille se termina par la victoire complète de Babur, grâce à son vaste expérience en tant qu'homme d'État, ainsi que grâce à l'utilisation d'armes à feu pour la première fois en Inde .
Babur considérait son travail comme un guide pour gouverner l'État, dont les dispositions étaient censées contribuer non seulement à une stabilisation significative du système fiscal de l'État, mais, par conséquent, à améliorer la situation des masses et à les protéger des excès des seigneurs féodaux. Babur dédia cette œuvre à son fils Humayun, son héritier, futur deuxième souverain de l'Inde en 1530-1556.
À propos de ce monument, devenu depuis longtemps un symbole de l'Inde, le grand écrivain et poète indien Rabindranath Tagore a dit : « Que cette seule larme - le Taj Mahal - glisse à jamais, scintillant sur la joue du ciel. Créateur! Tu as su enchanter le temps avec la magie de la beauté et tisser une guirlande qui revêtait la mort sans forme d'une forme immortelle... »
Le Taj Mahal est un monument devenu symbole du grand amour. Construit en Inde près de la ville d'Agra, dont le nom évoque des histoires semi-fées pleines d'aventures mystérieuses, le temple fait aujourd'hui partie de la ville. La vie trépidante et chaotique de la ville contraste fortement avec le mirage séduisant du Taj Mahal.
LES GRANDS MOGHALS
L'histoire de ce monument étonnant a commencé il y a plusieurs siècles. En 1526, Shah Babur bat le sultan de Delhi et fonde l’empire moghol. Cet empire n’a pas duré longtemps, seulement 180 ans. La gloire du luxe et de la richesse de la cour du Grand Moghol, leur pouvoir, ont atteint nos jours dans les contes de fées, les légendes et même les romans policiers.
La dynastie moghole a donné à l'Inde six grands dirigeants dont les noms sont vénérés à ce jour : Shah Babur, Shah Humayun, Shah Akbar, Shah Jahangir, Shah Jahan. Le fondateur de la dynastie, Shah Babur, était l'une des personnes les plus intéressantes de son époque. Il descendait du côté paternel de Timur et du côté maternel de Gengis Khan. Lorsqu’il devint dirigeant de Samarkand, il n’avait que onze ans. Plus d'une fois, il perdit le trône et le retrouva, passant sa jeunesse sur le champ de bataille. Ayant mûri, il partit en guerre contre Kaboul et, l'ayant conquise, envahit l'Inde. Sa petite armée, mais bien entraînée et armée des dernières technologies, a facilement vaincu des hordes entières et a apporté la victoire à Babur. Il dirigea l’Inde pendant quatre ans. Ce règne fut mouvementé. Cependant, Shah a trouvé le temps de s'engager dans l'art et la littérature. Il a écrit un livre de souvenirs. Il montre l’Inde telle qu’il la voyait :
« L’Empire de l’Hindoustan est vaste, densément peuplé et riche. À l'est, au sud et même à l'ouest, il est baigné par le Grand Océan. La capitale de tout l'Hindoustan est Delhi. C'est un pays merveilleusement beau. Cela représente un monde complètement différent de celui de nos pays. Ses montagnes et ses rivières, ses forêts et ses plaines, ses animaux et ses plantes, ses habitants et leur langue, ses vents et ses pluies - tout ici a un caractère différent... Même les reptiles ici sont différents... Le principal avantage de l'Hindoustan est que le pays est grand et qu'il y a une abondance d'or et d'argent... Un autre avantage de l'Hindoustan est qu'il y a un nombre incalculable et infini de travailleurs de toutes professions et spécialités. Pour tout travail et toute profession, il y a toujours de nombreuses personnes prêtes, à qui ce métier et ce métier ont été transmis de père en fils de siècle en siècle.
Babur est mort en 1530, et voici ce qu'on dit de sa mort : lorsque Shah a eu 49 ans, son fils, Humayun, est tombé malade. Les médecins ont dit que quelqu'un devait sacrifier sa vie pour que le patient guérisse. Et puis le père a offert sa vie en échange. Humayun s'est rétabli, mais Babur est décédé quelques jours plus tard.

Un pouvoir énorme est allé à Humayun. Le royaume moghol s'étendait du golfe du Bengale à l'est jusqu'à Kandigarh à l'ouest et du Deccan au sud jusqu'au Tibet au nord. C'était le plus grand royaume qui ait jamais existé en Inde. Mais le fils de Babur était un faible guerrier, il ne parvint pas à défendre le trône et fut renversé. Errant dans des endroits reculés, il a connu des difficultés. Dans le désert du Rajasthan, est né le fils de Humayun, Akbar, le plus grand des dirigeants de l'Inde, dont la gloire a éclipsé la gloire de son arrière-grand-père. Il succéda à son père et à son grand-père sur le trône à l'âge de treize ans et dirigea l'Inde pendant environ un demi-siècle.
Akbar était un dirigeant sage. Il a déployé de nombreux efforts pour éviter toute hostilité entre les représentants des différentes confessions, a renforcé l'État et a attiré de nombreux grands maîtres à sa cour.
Le fils du célèbre Akbar, Jahangir, hérita du trône de son père.
Chacun des Grands Moghols cherchait à renforcer le pouvoir de l'État grâce à des mariages politiques avantageux. Le premier mariage de Shah Jahangir était pour des raisons politiques, et la deuxième fois, il épousa la belle et bien-aimée Nur Jahan, la veuve de l'un de ses généraux.

HISTOIRE D'AMOUR
Et maintenant, nous serons transportés à Agra, dans le palais onirique des Grands Moghols, construit par la volonté d'Akbar. C'est ici que commence l'histoire du Taj Mahal. Ici, une fois par an seulement, un marché spécial était ouvert pour les habitants du harem de Jahangir Shah. Les marchands exposaient leurs plus belles marchandises ce jour-là, jour de la grande fête. Les visages des femmes étaient ouverts au regard des hommes. Nous préparons depuis longtemps ce jour, le jour de la liberté et du bonheur. Ce jour-là, l'amour et l'aventure ont commencé.
Ce jour-là, le fils bien-aimé et héritier de Shah Jahangir, le prince Khurram, âgé de seize ans, regarda dans l'un des magasins et vit la belle Arjuman. La beauté de la jeune fille frappa le prince. Comme dans un brouillard, il posa une question insignifiante, reçut une réponse humoristique et partit.
Et le lendemain, toute la cour fut secouée par la nouvelle que le prince voulait épouser la belle Arjuman. À cette époque, se marier par amour était chose inouïe. Cependant, lorsque le jeune prince annonça son intention, Jahangir Shah l'autorisa à se marier, mais après cinq ans.

C'était en 1607. Et cinq ans plus tard, lorsque les astrologues furent convaincus de la disposition favorable des étoiles, le prince épousa Arjuman. À cette époque, le prince possédait un grand harem de cinq mille beautés, mais Arjuman devint son épouse bien-aimée.
Le mariage émerveilla le royaume par sa splendeur et donna naissance à de nombreuses légendes. Le prince Khurram et Jahangir ont caracolé au centre du cortège nuptial. Derrière eux marchait un cortège de courtisans, qui portaient de riches vêtements brodés d'or. Chaque centimètre des vêtements du prince, qu'il a fallu six ans pour broder, était parsemé de belles pierres précieuses. Le cortège était suivi d'acrobates et de musiciens. Les éléphants dispersaient des pièces d'or pour les mendiants et les enfants. Le souverain Jahangir, admirant la beauté de sa belle-fille, lui donna un nouveau nom : Mumtaz Mahal, qui signifiait « la seule du palais ». Le poète de la cour a exprimé le charme de sa beauté dans les vers suivants : « La lune, touchant son visage, a honte. Car elle surpasse même la lumière des étoiles.
L'éducation de Mumtaz Mahal se limitait à la lecture du Coran. Mais, dotée d’un esprit naturel, elle a travaillé dur et a pu devenir la plus proche conseillère de son mari. Elle est devenue célèbre pour sa charité, distribuant de l'argent et de la nourriture aux pauvres, attirant l'attention du souverain sur les besoins des veuves et des orphelins. Ses activités ont contribué à la croissance de la popularité du gouvernement. Dans tout son travail, elle était aidée par Sati un-Nissa, sa femme de chambre la plus proche.
En grandissant, le prince Khurram est devenu général dans l'armée de son père et a remporté de nombreuses batailles, mais pendant tout ce temps, il attendait le trône. A la cour moghole, l'héritier n'était pas le fils aîné, mais celui qui pouvait conquérir le trône. De nombreux frères du prince Khurram sont morts dans cette lutte. Il a lui-même tenté à plusieurs reprises de renverser son père. Lorsque, après l'un de ces complots, l'armée moghole se lança à sa poursuite, son amant le suivit.

En 1627, Jahangir mourut d'une quinte de toux à l'âge de cinquante-neuf ans. Deux jours plus tard, la lutte pour le trône divisait le pays tout entier en plusieurs camps. Le prince Khurram, futur Shah Jahan, avec l'aide de son beau-père, gagna le trône. Ses deux frères ont été exécutés et sa belle-mère, Nur Jahan, a été emprisonnée à Lahore. Le 4 février 1628, le prince Khurram est couronné.
Les célébrations du couronnement ont été très magnifiques et ont éclipsé toutes les précédentes. Les serviteurs portaient des plateaux de diamants entre les invités. Mais les cadeaux présentés à la reine étaient particulièrement luxueux. Les éléphants étaient chargés de bols taillés dans des pierres précieuses, de poignards dont les fourreaux étaient constellés de pierres précieuses, de harnais turcs et d'étoffes brodées d'or et de perles. Plusieurs petites principautés ont été présentées en cadeau à Mumtaz Mahal.
Les partisans du Shah n’ont pas non plus été oubliés. Ils reçurent tous des éléphants, des esclaves et d'autres récompenses.
Shah Jahan a poursuivi la conquête de l'Inde commencée par ses ancêtres. Mais les sentiments du Shah pour la reine n’ont fait que se renforcer au fil des années. Shah Jahan n'a pas cessé de couvrir la reine de bijoux et des roses lui ont été envoyées depuis les meilleurs jardins du pays. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il accompagnait la reine dans les jardins de Shalimar.
En dix-neuf ans, Mumtaz a donné naissance à quatorze enfants à son mari. Et comme le Shah était constamment en guerre, les enfants naissaient sous des tentes, entre les batailles. En 1630, au cours de la troisième année de son règne, Mumtaz Mahal, comme d'habitude, accompagna son mari dans une campagne contre le Deccan. La reine a courageusement enduré toutes les épreuves malgré le fait qu'elle attendait un autre enfant. Mais la santé de la reine s’est tellement détériorée que Shah Jahan a été contraint d’arrêter les hostilités. Peu de temps avant sa mort, la reine a exprimé sa dernière volonté : ériger un monument symbolisant leur amour.

Après sa mort, Shah s'est enfermé loin de tout le monde, même des membres de sa famille. Quelques jours plus tard, il a quitté son confinement volontaire, mais en est ressorti complètement grisonnant. À partir de ce moment-là, il n’a plus jamais mis de vêtements formels.
Il existe une légende selon laquelle le Shah, assis sur son célèbre trône dans l'une des pièces du Fort Rouge, eut une vision d'un bâtiment fabuleux dans la fenêtre. Lorsqu'il essaya de le décrire aux architectes, ceux-ci furent ravis. Le lieu de la vision était précisément dans le jardin du Raja Taj Sith. Le Raja voulait faire don de ces terres au Shah, mais les dogmes de l'Islam interdisaient la construction d'une mosquée sur les terres données. Le Shah a donc acheté ce terrain pour quatre résidences royales.
Quelques mois plus tard, le corps de Mumtaz Mahal fut transporté à Agra, où une chapelle funéraire fut construite dans le jardin du Raja Taj Sith. Cette chapelle subsiste dans la partie ouest du parc.
Chaque vendredi, le Shah visitait l'enterrement. Toute la famille a prié avec lui. Des centaines de femmes et d'hommes munis de bols de prière sont venus lire le Coran. Le premier anniversaire de sa mort, une célébration a eu lieu au cours de laquelle cinquante mille roupies ont été distribuées uniquement en aumône. Tout au long de la vie de Shah Jahan, l'anniversaire de la mort de Mumtaz Mahal a été célébré en grande pompe et avec splendeur.

MONUMENT
Les architectes ont commencé à développer la structure et, après de nombreux essais et erreurs, son modèle est finalement apparu. Il était si cher au Shah que pendant sa construction, il fut conservé dans le trésor moghol.
Dans le jardin du Taj Sith, une zone a été clôturée au bord de la rivière Jamna. En vingt-deux ans, vingt mille ouvriers ont construit la création parfaite. Des forces gigantesques ont été impliquées dans la construction du complexe. Les femmes travaillaient à égalité avec les hommes. Les ouvriers qui ont construit le monument recevaient un salaire généreux de 100 roupies par mois et les artisans 1 000. La richesse, le respect et la liberté créaient une atmosphère étonnamment propice à la créativité.
Un chemin de terre et de mortier de dix-sept kilomètres s'étend à travers Agra jusqu'au chantier de construction. Des files d'éléphants et de taureaux le parcouraient, tirant des blocs de marbre. Ils ont été installés sur place à l'aide de dispositifs spéciaux.

Aujourd’hui encore, il semble incroyable que les fondations et la plate-forme surplombant la rivière aient été achevées en seulement quatre ans. Les premiers à être achevés furent le mausolée lui-même et les deux mosquées sur ses côtés. Ensuite, les minarets et enfin la porte principale et les bâtiments de service.
Les travaux de finition ont duré six ans. Les matériaux de finition ont été livrés de divers endroits. Du Rajasthan a été importé du Rajasthan un marbre blanc lumineux avec une structure caractéristique, différent du bleuâtre italien et du japonais jaunâtre. C'est ce qui fait que la structure brille différemment selon l'éclairage. Le marbre jaune provenait des rives de la Narmada, une rivière du centre de l’Inde. Il a été acheté avec une taxe spécialement introduite de 40 roupies sur la superficie de chaque cour. Le marbre noir, quasiment inconnu en Inde, était acheté au double du prix. Le cristal a été importé de Chine et le lapis-lazuli du Sri Lanka. Le jaspe a été importé du Pendjab, les agates du Yémen et les coraux d'Arabie. Les bijoutiers indiens offraient des grenats et les marchands des diamants. L'onyx a été importé de Perse et la calcédoine exquise d'Europe. De la ville morte de Fatupur Sikri, située près d'Agra, l'ancienne capitale des Moghols, construite sur un site déserté depuis plusieurs années et abandonné par ses habitants, 114 000 blocs de grès ont été apportés.
De petites briques spécialement préparées pour le Taj donnaient de la stabilité au monument.
En 1643, l'ensemble du complexe avec jardins, portes, zone commerciale et caravansérail fut achevé.
Même aujourd'hui, la conception du Taj est une œuvre d'ingénierie étonnante. Les murs supportent une charge de blocs carrés de sept tonnes. Le monolithe du dôme pèse 12 000 tonnes. L'ensemble du mausolée repose sur des structures voûtées renforcées par des ceintures de pierre. Les hauts piliers sont fixés à la base en pierre avec des boulons en cuivre.

Des dalles spéciales protégeaient le monument des inondations. L'idée de l'architecte était que la rivière servirait de cadre au Taj. La structure de plusieurs voûtes, situées juste en amont, obligeait la rivière, connue pour ses crues fréquentes, à couler dans un ruisseau peu profond. Au XXe siècle, la rivière a débordé à plusieurs reprises, mais le monument n'a pas été endommagé.
Pendant la domination moghole, l’Inde est devenue le centre de la créativité artistique de l’Est. Les meilleurs artistes et artisans sont réunis ici. Des artistes de toutes les régions d'Asie ont été impliqués dans la construction, ce qui a fait d'Agra un centre de créativité architecturale. Un célèbre architecte est arrivé de Turquie pour superviser la construction des dômes.
Pendant très longtemps, le nom de l’architecte qui a construit le complexe est resté secret. Ce n’est qu’en 1930 qu’un manuscrit fut découvert qui nommait le légendaire Ahmad Ustad, surnommé Nadir el-Asr, ce qui signifiait « Miracle du siècle ». Ingénieur, astronome, géomètre, mathématicien et astrologue à la cour de Shah Jahan, il fut le plus grand architecte. On sait peu de choses sur lui. Avant de déménager à Lahore, sa famille vivait à Herat. Après le déménagement, son père Ustad Ahmad est allé travailler pour Abd-al Karim, l'architecte en chef de Shah Jahangir. Les trois fils, sous la direction de leur père, ont construit le Taj Mahal.
Shah Jahan prévoyait de créer un mausolée symétrique de l'autre côté de la rivière Jamna, exactement de la même forme et de la même taille, mais en marbre noir. Il était censé être relié au temple blanc par un pont d'argent. Cependant, déjà lors de la construction du Taj Mahal, le trésor public était vide et l’idée du Shah ne s’est pas réalisée. Et bientôt le pouvoir sur l’État fut usurpé par Aurangdeb, le fils de Shah Jahan. Ce fut le dernier des dirigeants légendaires. Cependant, son intolérance religieuse, qui le distinguait grandement de ses grands ancêtres Babur et Akbar, conduisit à l'affaiblissement de l'empire. Après un certain temps, l'État s'est divisé en principautés, puis les Britanniques ont établi leur domination ici.

Durant cette période, de nombreux grands monuments furent détruits et les musées du Royaume-Uni furent décorés de nombreux reliefs de temples indiens. Le Taj Mahal a heureusement survécu, même s’il a été pillé en 1764.
PARADIS
...Palais de perles parmi
jardins et canaux d'eau, où
pieux et béni
peut vivre éternellement.
L'ensemble, selon le plan de l'architecte, se composait d'un mausolée, d'une mosquée et d'un pavillon de réunions. Tous étaient situés sur une plate-forme massive et allongée faite de dalles de grès rouge, et à côté du sud se trouvait un vaste parc - "Cherbak", entouré sur trois côtés par un mur, avec une porte au milieu de chaque côté. .
L'architecte a préparé le spectateur à percevoir l'ensemble du complexe. L'ensemble s'ouvre progressivement. De loin, le temple apparaît comme un mirage. Après quelques marches, l'ensemble de dômes en forme d'oignon du temple central s'ouvre. Le mausolée est situé au centre d'une terrasse de marbre blanc au fond d'un long jardin au bord de la rivière. De l’autre côté se trouvent des champs de blé.
L'entrée du complexe du mausolée est fermée par des portes massives en grès rouge. Ils atteignent trente mètres de hauteur. À travers leur dentelle rouge, on aperçoit la structure en marbre blanc. Aux coins de la porte se trouvent des tours rondes surmontées de pavillons « chagri » en forme de dôme. Héritant des traditions des artisans persans, les créateurs des portes les ont décorées des plus beaux motifs calligraphiques. Ce dessin illusoire est formé par l’écriture merveilleuse qui recouvre la porte. Il fait écho aux écrits qui courent sur les arches du mausolée. L'une des inscriptions indique que Shah Jahan a basé le mémorial sur l'idée musulmane du paradis : "... un palais de perles parmi des jardins et des canaux d'eau, où les pieux et les bienheureux peuvent vivre pour toujours".
L'image du paradis était répandue dans l'art moghol. La belle porte était l’entrée du paradis et était perçue comme « une ouverture de pierre à une musique figée ».
Les portes sont recouvertes de décorations en cuivre, mais il fut un temps où elles brillaient d'argent au clair de lune, encadrant le mausolée blanc comme neige.
L'entrée de l'allée centrale s'ouvrait par la haute arche du portail. Pelouses vertes, chemins d'eau symétriques avec fontaines dirigeant leurs jets vers le haut, tout ici est comme dans un paradis musulman. Les tours élancées des minarets se reflétaient dans la surface des canaux. L'eau provient d'un puits très profond. Aujourd’hui, il n’y en a pas assez et c’est très salé.

L'allée centrale traverse tout le parc et se rapproche du bâtiment du mausolée. Sa hauteur totale atteint soixante-quinze mètres.
Le mausolée lui-même change d'apparence tout au long de la journée en fonction de la couleur du ciel, qui passe du gris-bleu le matin et du blanc éblouissant pendant la journée au gris lilas au coucher du soleil.
À droite et à gauche du Taj se trouvent le temple de Sati un-Nissa, la servante bien-aimée, et la mosquée - le mesjid. Les deux bâtiments sont rouges. Ils sont exactement les mêmes, surmontés de trois dômes, et les fins motifs blancs sont impressionnants sur la surface rouge. Le bâtiment de la mosquée se trouve du côté ouest. Il fait face à la Mecque. L'autre bâtiment ne peut pas être utilisé pour les prières car il n'est pas orienté vers la Mecque. Il sert donc d'hôtel aux pèlerins. Chaque vendredi, la mosquée prend vie. Namaz est exécuté ici. Sur 500 lieux de prière décorés, sont posés des tapis spéciaux sur lesquels les fidèles s'inclinent vers la Mecque.
En plus de la porte centrale, quatre autres portes (et quatre est un nombre sacré pour les musulmans) mènent au mausolée. À côté de la porte, appelée katra, se trouvaient autrefois des boutiques d'artisans. Au nord-est de la porte Katra Gilal vivaient des artisans qui fabriquaient divers encens à partir de fleurs. La porte Katra Reshma doit son nom à la maison d'un marchand de soie. Katra Omar Khana au nord-ouest et Katra Yoguda au sud-est portent probablement le nom des personnes qui y ont servi.
Les minarets à trois étages aux balcons ornés (marbre incrusté d'ardoise noire) sont aujourd'hui fermés au public.

Il n'y a pas de sépulture sous les deux pierres tombales supérieures ; la véritable tombe est enfermée au fond de la crypte. Malgré la grande taille de la sépulture, elle s'intègre bien dans le complexe. Les chambres funéraires supérieures sont entourées de huit chambres vides – quatre octogonales et quatre rectangulaires. Ces pièces vides soulagent le poids du dôme. La simplicité de leur décoration est en harmonie avec le cénotaphe. Les murs des chambres sont recouverts de plâtre poli de cinq centimètres d'épaisseur. Il se compose de citron vert blanc, de poussière de marbre, de sucre, de petits pois noirs turcs, de blanc d'œuf et d'une substance visqueuse spéciale - le jus d'un fruit indien. Malheureusement, l’un des composants de ce plâtre reste inconnu à ce jour. Cette composition avait un effet particulier : elle refroidissait le marbre, qui surchauffait sous une chaleur extrême.
Sous le dôme principal se trouve la chambre funéraire octogonale du Shah
Jahana et Mumtaz Mahal. Le passage de l'espace terrestre du complexe au monde spirituel fait partie de la magie du Taj. Auparavant, la salle funéraire n'était éclairée que par la lumière du soleil et la lune filtrant à travers la décoration en marbre au-dessus. De petits morceaux de mica remplissent les trous du palais des miroirs, donnant l’effet d’un éclairage blanc laiteux et le gardant frais. Cette lumière d'Eine Mahal fait écho à l'intérieur en marbre.
Dès le début, le cénotaphe était recouvert d'une clôture en or incrustée de pierres précieuses. En 1642, cette barrière fut remplacée par un écran spécial. Mosaïques de fleurs et d'arabesques, sculptures en pierre, bas-reliefs et belles incrustations de marbre noir décorant le paravent rappellent que le Taj, conçu comme un palais, a été construit comme un ornement. La réalisation de cet écran de pierre a duré dix ans. Sur la tombe elle-même, 99 paroles du prophète Mahomet, bordées de pierres précieuses, scintillent.
Les tombes supérieures, avec trente-cinq variantes de pierres rares, sont bien plus magnifiques que les inférieures. La mosaïque décorant le cénotaphe contient des mots bénissant le Shah et Shaheen et maudissant tous les non-croyants.
Des milliers de couleurs différentes sont disposées en mosaïques. On dit que les chambres restantes étaient destinées aux proches parents du Shah. Auparavant, les salles funéraires étaient recouvertes de tapis sur lesquels les mollahs s'asseyaient et priaient.
Le coût du temple au XVIIe siècle était estimé à cinq millions de roupies. Un peu plus tard, un autre chiffre est apparu : trente millions.
Cependant, il était reconnu à l’époque, et nous comprenons aujourd’hui, qu’estimer le coût du Taj Mahal est aussi fou que vouloir déterminer le coût d’un milliard d’étoiles.