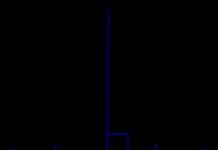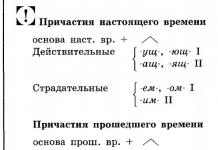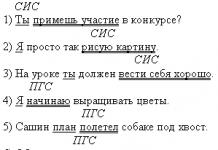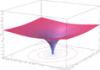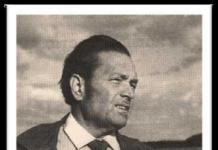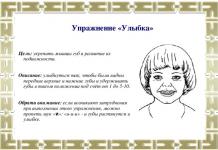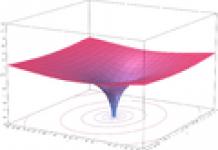Capitaine Kopeikine - le héros d'une nouvelle sur un officier, un héros Guerre patriotique 1812, qui y perdit sa jambe et son bras et devint un voleur faute d'argent. Dans les versions du « Conte », la fuite de K.K. vers l’Amérique était supposée, d’où il envoya une lettre à Alexandre Ier sur le sort des blessés et reçut un gracieux rescrit du souverain. La nouvelle (dans son style « conte de fées », comiquement verbeux) est racontée dans le 10e chapitre du poème par le maître de poste Ivan Andreich.
La raison de l’histoire est simple. Les responsables de la ville, intrigués par les rumeurs concernant Chichikov, un acheteur d'âmes mortes, discutent de qui il pourrait être. Soudain, après de longues querelles de tous, le maître de poste s'exclame avec inspiration : « Ceci, messieurs, mon monsieur, n'est autre que le capitaine Kopeikin ! - et propose d'écouter une histoire sur lui, qui, "d'une certaine manière, est tout un poème". Le roman de Gogol est également nommé poème ; ainsi le maître de poste parodie involontairement l'auteur des « Âmes mortes » lui-même, et son « L'histoire du capitaine Kopeikin » est le roman dans son ensemble. Mais c'est une parodie particulière, drôle et sérieuse à la fois ; il relie en un seul nœud littéraire tous les sujets discutés par les fonctionnaires - sur le meurtre, sur un contrefacteur, sur un voleur en fuite - et sert à bien des égards de clé à tout le texte de Dead Souls.
Il s'avère que K.K. a été blessé près de Krasny ou près de Leipzig (c'est-à-dire dans l'une des batailles clés grande guerre) et devint invalide jusqu'aux ordres d'après-guerre d'Alexandre Ier sur le sort des blessés. Le père ne peut pas nourrir K.K. ; il va chercher la faveur royale à Saint-Pétersbourg, qui, selon la description du maître de poste, acquiert des traits semi-fables - « la fabuleuse Schéhérazade », « Sémiramis ». Dans la description du luxe royal de Saint-Pétersbourg, montré à travers les yeux du héros qui l'a vu pour la première fois (« une agitation notable passe comme de l'éther mince »), et surtout dans la description du bâtiment gouvernemental sur les quais du Palais , l'image de Saint-Pétersbourg et du palais, tels que Vakula le forgeron les voit dans l'histoire "La nuit avant Noël". Mais si là-bas le héros a eu une chance vraiment fabuleuse, alors ici une visite au « ministre ou noble », chez qui les traits du comte Arakcheev peuvent facilement être discernés, ne donne à K.K. que de faux espoirs.
Après avoir dîné joyeusement à la taverne, comme « à Londres » (vodka, côtelettes aux câpres, poularde) et après avoir dépensé presque tout l'argent, K.K. revient au Palais pour l'aide promise - pour entendre ce qu'il entendra désormais tous les jours : attendez. Avec un « bleu » dans sa poche, désespéré, humilié, comme seul un mendiant au milieu du luxe universel peut être humilié, K.K. « un diable obsessionnel » fait irruption auprès du Noble Ministre et lui demande hardiment de l'aider. En réponse à cela, "lui, le serviteur de Dieu, a été saisi, mon monsieur, dans une charrette" - et avec un courrier, il a été expulsé de la capitale. Livré dans sa lointaine province, K.K., selon le maître de poste, s'est exclamé : « Je trouverai les moyens ! » - et sombre dans « une sorte d’oubli ». Et deux mois plus tard, une bande de voleurs est apparue dans les forêts de Riazan, dont le chef n'était autre... - et ici on rappelle au narrateur que Chichikov a les bras et les jambes en place. Le maître de poste se frappe le front avec la main, se traite de veau, tente en vain de s'en sortir (en Angleterre, la mécanique est si parfaite que des jambes de bois peuvent le faire) - en vain. L'histoire de K.K. semble disparaître dans le sable, sans rien clarifier sur la question de savoir qui est Chichikov.
Mais l’image de K.K. semble seulement aléatoire, « sans foi ni loi », insérée, et la légende à son sujet n’est en aucun cas motivée par l’intrigue.
Le thème d'un noble mendiant, un capitaine sans le sou, qui « l'a obtenu de Dieu sait où », apparaît déjà dans le 6ème chapitre, où l'avide Pliouchkine se plaint à Chichikov de son voisin-capitaine, qui aime venir lui rendre visite. « Un proche dit : « Il n’y a probablement rien à la maison, donc il chancelle. » Mais plus tôt encore, Chichikov lui-même, quittant Nozdryov, le «trouva» mentalement, tout comme un cocher voyou se fait parer par «un capitaine expérimenté et qui a beaucoup voyagé». Plus tard, au chapitre 10, pendant sa maladie, Chichikov se laissera pousser la barbe, comme K.K., au chapitre 11, le nom de K.K. semble « revenir » accidentellement dans la consigne de vie du père de Chichikov : « sauvez un Kopek ». Quant à l'image du « voleur », même dans le 9e chapitre, « juste une dame agréable » et « une dame agréable à tous égards » suggèrent chez Chichikov quelqu'un « comme Rinald Rinaldin », le célèbre héros du roman de X. Vulpius sur voleur.
Le grade militaire de capitaine selon le tableau des grades correspondait au grade civil de conseiller titulaire, et cela unit en même temps le malheureux K.K. avec d'autres personnages « humiliés et insultés » dans les histoires socio-fantastiques de Gogol, les conseillers titulaires Poprishchin (« Notes d'un fou ») et Akakiy Akakievich Bashmachkin (« Pardessus »), et le contraste avec eux. Au moins - "Bash-Machkin. Car dans la fonction publique, ce grade ne donnait pas de noblesse, et dans la noblesse militaire était assurée par le grade de premier officier en chef. Le fait est que, contrairement à son prototype folklorique, les chansons de héros à propos du "voleur Kopeikin", ainsi que de nombreux personnages handicapés de la prose et de la poésie russes d'après-guerre, ainsi que de leur prédécesseur littéraire commun - le soldat de l'idylle "Jambe de bois" de S. Gesner - noble de K.K., officier. S'il est un voleur, puis noble. Ce détail renforce considérablement la tragédie de son histoire; il relie l'image de K.K. avec les plans de Pouchkine pour le roman sur le "Pelham russe", sur le gentleman voleur ("Dubrovsky"). Et cela aussi - sur un ton parodique, niveau réduit - réduit à dénominateur commun toutes les nombreuses associations littéraires qui entourent l'image romane de Chichikov.
Dans l'histoire de K.K., comme dans un tour de passe-passe, des rumeurs trop diverses sur Chichikov convergent ; mais de nouvelles versions, encore plus incroyables, de ce qui s'est passé en émanent. Les responsables se demandent si Chichikov est Napoléon, délibérément libéré par les Britanniques de l'île de Sainte-Hélène afin d'indigner la Russie. (Encore une fois, le maître de poste, qui a servi dans la campagne de 1812 et « a vu » Empereur français, assure à ses interlocuteurs que Napoléon « n'est en aucun cas plus grand que Chichikov » et que sa silhouette n'est pas différente de lui.) De Chichikov-Napoléon s'ensuit une progression sémantique naturelle vers le thème de Chichikov-Antéchrist ; Les fonctionnaires s'arrêtent là et, se rendant compte qu'ils ont menti, ils font venir Nozdryov.
Et plus leurs comparaisons deviennent absurdes, plus leurs hypothèses et leurs « parallèles historiques » sont impensables, plus l'idée clé de l'auteur du 1er volume de « Dead Souls » est clairement révélée. L’époque napoléonienne fut l’époque du dernier triomphe du mal romantique, puissant et impressionnant ; le nouveau mal « monétaire », « penny » d'acquisition injuste, personnifié par l'homme résolument moyen et « rien » Chichikov, peut finalement s'avérer invisible pour le monde écrasant, et donc un phénomène particulièrement dangereux de l'Antéchrist de l'Antichrist. époque bourgeoise. Et cela se produira certainement si le renouveau moral de chaque personne individuellement et de l'humanité dans son ensemble n'a pas lieu.
Le Conte du Capitaine Kopeikin s'intègre harmonieusement dans le fil du récit de Dead Souls. Le héros de l'histoire est un capitaine à la retraite, invalide, incapable de subvenir à ses besoins, et se rend dans la capitale pour toucher une pension. Entre-temps, la demande qu'il a soumise à la commission compétente est examinée depuis longtemps par les responsables. Je perds patience Capitaine Kopeikine soulève une rébellion contre l’appareil bureaucratique d’État.A noter que le capitaine Kopeikin a décidé d'obtenir une pension d'invalidité selon la procédure établie :
« Le capitaine Kopeikin a décidé... de déranger les autorités... Il a demandé où aller. ... Je suis allé à la commission», le capitaine organise une solution à son problème.
Après avoir contacté la commission compétente, le capitaine attend un rendez-vous avec le chef dans l'ordre de la file d'attente générale :
« Le patron sort. ... S'approche de l'un, puis de l'autre : « Pourquoi es-tu, pourquoi es-tu, que veux-tu, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, mon monsieur, à Kopeikin », le chef des visiteurs se promène successivement.
Après avoir entendu le capitaine à la retraite, le chef de la commission l'assure que l'Etat veillera à la sécurité de la personne handicapée :
« Rassurez-vous, vous ne serez pas abandonné. Et si tu n’as rien avec quoi vivre, alors c’est parti, dit-il, autant que je peux », aide le patron au vétéran.
Lorsque Kopeikin exprime son mécontentement du fait qu'il doit attendre trop longtemps pour obtenir une solution à sa question, le chef de la commission rappelle au visiteur que l'État protégera les droits de l'ancien combattant :
"Car il n'y a jamais eu d'exemple en Russie où une personne qui apportait... des services à la patrie se retrouvait sans charité."
Le capitaine Kopeikin raconte à la commission ses services rendus à la patrie, exigeant le respect du vétéran :
"Un tel, dit-il, j'ai versé du sang, j'ai perdu... un bras et une jambe, je ne peux pas travailler", le handicapé prouve son droit à l'aide.
A noter que le chef de la commission est un homme respectable qui s'adresse avec respect à tous les visiteurs :
« Le patron sort. ... En face, pour ainsi dire... enfin, selon le rang,... avec le rang... c'est l'expression, vous savez. En tout, il se comporte comme un métropolitain », a déclaré le fonctionnaire à l’air respectable.
A noter également que pour résoudre son problème, le capitaine Kopeikin recourt à l'aide des autorités. Ainsi, le chef de la commission est investi d’un pouvoir considérable. Lorsqu'il constate qu'un visiteur dépasse ses limites, il use de son influence pour rétablir l'ordre :
"Le patron voit : il faut recourir à... des mesures strictes", le fonctionnaire est contraint d'user de son autorité.
Le chef de la commission, contraint d'user du pouvoir, donne l'ordre d'escorter le présomptueux capitaine :
« Appelez, dit-il, un coursier, escortez-le jusqu'à son domicile ! - a ordonné le fonctionnaire.
Ainsi, le héros du « Conte du capitaine Kopeikin » a un désir de sécurité, d'ordre, de respect et de pouvoir, qui correspond aux besoins du type organisateur. Pendant ce temps, le capitaine Kopeikin se retrouve dans une situation dangereuse, créant le chaos, faisant preuve d'un manque de respect et se sentant impuissant. Les héros des œuvres de Pouchkine ont des caractéristiques similaires : « L'histoire du village de Goryukhin », « La scène des temps chevaleresques » et « Le conte de l'ours ».
En effet, ayant perdu un bras et une jambe, le vétéran est incapable de se nourrir, et risque donc de mourir de faim :
"Je n'ai rien pour te nourrir, j'imagine - j'arrive à peine à me procurer du pain moi-même", son père jette l'homme handicapé à la merci du destin.
A titre de comparaison, le maître de poste, au nom duquel l'histoire est racontée, s'expose dans une certaine mesure au danger en racontant publiquement l'histoire du capitaine peu fiable Kopeikin :
"C'est ainsi qu'a commencé le maître de poste, malgré le fait qu'il n'y avait pas un seul monsieur dans la pièce, mais six", risque le maître de poste, qui sera dénoncé.
Le capitaine Kopeikin se comporte parfois comme un homme excentrique avec un désordre dans la tête :
"Nayan est comme ça, ça n'a aucun sens, tu sais, mais il y a beaucoup de lynx."
Se retrouvant dans la capitale, le capitaine à la retraite ne put résister à de nombreuses tentations et se lança bientôt dans une folie :
"Je suis allé à la taverne Palkinsky pour boire un verre de vodka,... A Londres... J'ai demandé une bouteille de vin, le soir je suis allé au théâtre - en un mot, j'ai bu à ma guise, pour ainsi dire. ... Entre-temps, il a dilapidé, notez-le, près de la moitié de l'argent en une journée!»
Après avoir passé pas mal de temps dans la capitale, le capitaine, au lieu d'attendre son tour dans l'ordre établi, a semé le chaos dans l'espace d'accueil :
« Ça a fait tellement de bruit, ça a époustouflé tout le monde ! Il a commencé à ébrécher et à clouer toutes ces secrétaires là-bas… Il y a eu une telle émeute. Que veux-tu que nous fassions avec un tel diable ? - le capitaine crée le désordre dans la commission.
Le capitaine Kopeikin, tout en exigeant le respect de ses droits, fait en même temps preuve d'un manque de respect envers les membres de la commission :
"Oui, dit-il, vous êtes des vendeurs de lois, dit-il !" Le capitaine insulte les officiels.
Pendant ce temps, le chef de la commission ne fait pas de cérémonie avec l'homme grossier :
«Le voici, serviteur de Dieu, dans une charrette et avec un courrier», est expulsé le capitaine.
Dans le même temps, le chef de la commission a honnêtement averti le vétéran qu'il était impuissant à satisfaire toutes ses demandes :
"Nous ne pouvons rien faire concernant votre cas sans l'autorisation des plus hautes autorités", - il n'est pas du ressort du fonctionnaire de résoudre rapidement le problème.
Le capitaine Kopeikin se rend compte que les autorités étaient impuissantes à l'aider rapidement :
"Le voici sorti du porche comme un hibou, comme un caniche que le cuisinier aurait arrosé d'eau, la queue entre les jambes et les oreilles tombantes", tombèrent les mains du capitaine.
Comme les personnages de Pouchkine, le capitaine Kopeikin se distingue non seulement par un certain ensemble d'aspirations, mais aussi par les moyens d'atteindre ses objectifs.
Ainsi, convaincu que les autorités sont obligées de protéger les intérêts légitimes d'une personne handicapée, Kopeikin est confiant en son pouvoir :
"Eh bien, il pense ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, et j'y vais, dit-il, je vais lever toute la commission, tous les patrons", le capitaine décide d'atteindre les sommets du pouvoir : "D'accord, dit-il, Je trouverai les moyens !
Entre-temps, le président de la commission représentant les autorités demande au pétitionnaire de respecter les règles générales :
"Vous ne voulez pas vous contenter de ce qu'ils vous donnent et attendre sereinement", lui exhorte le patron du capitaine à faire preuve d'humilité.
Se retrouver dans la capitale Empire russe, un capitaine à la retraite s'étonne de Saint-Pétersbourg, qui surpasse toutes les autres villes :
"Le capitaine Kopeikin s'est soudainement retrouvé dans une capitale qui, pour ainsi dire, n'a rien de comparable au monde !" - la supériorité du capital est soulignée.
Après avoir postulé auprès d'institutions publiques réputées, le capitaine à la retraite ressent d'abord l'insignifiance de sa propre personne :
"Je me suis pressé là-bas dans un coin pour ne pas le pousser avec mon coude", se comporte modestement Kopeikin dans la salle de réception.
En essayant de résoudre le problème du pétitionnaire de la manière prescrite, le chef de la commission le prend sous son contrôle :
"D'accord, dit-il, viens me voir un de ces jours", l'appelle le patron du capitaine pour surveiller la résolution du problème.
Pendant ce temps, le capitaine Kopeikin ignore l'ordre existant, négligeant les appels des fonctionnaires :
« Mais Kopeikin... s'en fout. "Ces mots sont comme des pois contre le mur", le vétéran ignore les commentaires.
Se sentant protégé par sa position de handicapé, le capitaine s'en prend à tous ceux qui se présentent sous son bras :
«J'ai donné une fessée à tout le monde. Alors, un fonctionnaire... est arrivé d'un département même complètement étranger - lui, mon monsieur et lui ! - Kopeikin exprime son indignation sur un inconnu.
Le capitaine Kopeikin exige de lui verser immédiatement une récompense substantielle, prétextant que pendant son séjour dans la capitale, ses exigences se sont accrues :
«Je ne peux pas, dit-il, m'en sortir d'une manière ou d'une autre. "J'ai besoin, dit-il, de manger une côtelette, une bouteille de vin français, de me divertir, d'aller au théâtre, vous savez", Kopeikin trouve une excuse.
L'analyse du personnage du capitaine Kopeikin montre qu'il a des besoins organisationnels qui distinguent les personnages des œuvres de Pouchkine : « L'histoire du village de Goryukhin », « Une scène des temps chevaleresques » et « Le conte de l'ours ». Comme les héros de Pouchkine, le capitaine de Gogol, Kopeikin, se caractérise par des manières caractéristiques d'atteindre ses objectifs, associées à des traits de caractère.
Le capitaine Kopeikin veut assurer son avenir. Au risque de mourir de faim, il recourt à la protection de l'État. Convaincu qu'en tant que personne handicapée, il est protégé par la loi, le capitaine atteint son objectif, se cachant parfois derrière des excuses, parfois s'en prenant aux autres.
Le capitaine Kopeikin s'adresse à la commission compétente conformément à la procédure établie. Contrôlant l'avancée de sa question, le capitaine ne trouve rien de mieux que de semer le chaos dans la zone d'accueil. Dans le même temps, le personnage traitait les avertissements des fonctionnaires avec dédain.
Le capitaine Kopeikin exige le respect pour ses services rendus à la patrie. Frappé par la supériorité du capital et de ses institutions étatiques, le personnage ressent d'abord l'insignifiance de sa personne. Cependant, le capitaine se livre bientôt à un traitement irrespectueux envers les fonctionnaires qui retardent la résolution de son problème.
Pour résoudre son problème, le personnage recourt à l'aide des autorités. Pendant ce temps, les autorités sont impuissantes à aider rapidement l’ancien combattant. Convaincu que l'État est obligé de défendre les droits des anciens combattants et des personnes handicapées, le capitaine Kopeikin a confiance en son pouvoir et refuse d'obéir aux règles générales.
Il ne serait guère exagéré de dire que « L'histoire du capitaine Kopeikin » représente une sorte de mystère au sein de « Dead Souls ». Tout le monde le ressent de manière latente. Le premier sentiment que le lecteur éprouve en la rencontrant est un sentiment de perplexité : pourquoi Gogol a-t-il eu besoin de cette « anecdote » assez longue racontée par le malheureux maître de poste, qui n'avait apparemment aucun rapport avec l'action principale du poème ? Est-ce vraiment juste pour montrer l’absurdité de l’hypothèse selon laquelle Chichikov n’est « autre que le capitaine Kopeikin » ?
Généralement, les chercheurs considèrent le Conte comme une « nouvelle insérée » dont l’auteur a besoin pour dénoncer les autorités de la capitale et expliquent son inclusion dans « Âmes mortes« Le désir de Gogol d'élargir la portée sociale et géographique du poème, de donner à l'image de « toute la Russie » l'exhaustivité nécessaire. «... L'histoire du capitaine Kopeikin<...>extérieurement presque sans rapport avec le principal scénario poèmes », écrit S. O. Mashinsky dans son commentaire. - Du point de vue de la composition, cela ressemble à un roman encart.<...>L’histoire, pour ainsi dire, couronne tout le terrible tableau de la Russie, de la bureaucratie et de la police locales, peint dans « Âmes mortes ». L’incarnation de l’arbitraire et de l’injustice n’est pas seulement le gouvernement provincial, mais aussi la bureaucratie de la capitale, le gouvernement lui-même. » Selon Yu. V. Mann, l'une des fonctions artistiques du Conte est « d'interrompre le plan « provincial » avec le plan métropolitain de Saint-Pétersbourg, incluant les plus hautes sphères métropolitaines de la vie russe dans l'intrigue du poème.
Cette vision du Conte est généralement acceptée et traditionnelle. Dans l’interprétation d’E. N. Kupreyanova, l’idée d’en faire l’une des « histoires de Saint-Pétersbourg » de Gogol est poussée à sa conclusion logique. L’histoire, estime le chercheur, « a été écrite comme une œuvre indépendante et n’a été insérée que plus tard dans Dead Souls ». Cependant, avec une interprétation aussi « autonome », il reste flou question principale: quelle est la motivation artistique pour inclure le Conte dans le poème ? De plus, le plan « provincial » est constamment « interrompu » dans « Dead Souls » par celui de la capitale. Cela ne coûte rien à Gogol de comparer l'expression réfléchie du visage de Manilov avec une expression que l'on peut trouver « sauf chez un ministre trop intelligent », de noter au passage qu'un autre « est même un homme d'État, mais en réalité il s'avère être un parfait Korobochka », passer de Korobochka à sa « sœur » aristocratique, et des dames de la ville de NN aux dames de Saint-Pétersbourg, etc. et ainsi de suite.
Soulignant le caractère satirique du Conte, son orientation critique vers les « sommets », les chercheurs font généralement référence au fait qu'il a été interdit par la censure (cela, en fait, le doit en grande partie à sa réputation d'ouvrage fortement accusateur). Il est généralement admis que sous la pression de la censure, Gogol a été contraint d'étouffer les accents satiriques du Conte, d'affaiblir sa tendance politique et sa sévérité - « jeter tous les généraux », rendre l'image de Kopeikin moins attrayante, etc. Dans le même temps, on peut entendre une déclaration selon laquelle le Comité de censure de Saint-Pétersbourg « a exigé des corrections importantes » au Conte. "A la demande de la censure", écrit E. S. Smirnova-Chikina, "l'image d'un officier héroïque, d'un voleur rebelle a été remplacée par l'image d'un bagarreur effronté...".
Toutefois, ce n’était pas tout à fait le cas. Censeur A.V. Nikitenko, dans une lettre datée du 1er avril 1842, a informé Gogol : « L'épisode de Kopeikin s'est avéré totalement impossible à manquer - aucun pouvoir ne pouvait le protéger de sa mort, et vous-même, bien sûr, conviendrez que j'avais rien à faire ici." . Dans la copie censurée du manuscrit, le texte du Conte est barré du début à la fin à l'encre rouge. La censure a interdit l'intégralité du Conte et personne n'a demandé à l'auteur de le refaire.
Gogol, comme on le sait, attachait une importance exceptionnelle au Conte et percevait son interdiction comme un coup irréparable. "Ils ont jeté tout un épisode de Kopeikin, qui m'était très nécessaire, encore plus qu'ils (les censeurs) ne le pensent. - V.V.). J'ai décidé de ne le rendre en aucune façon", rapporta-t-il le 9 avril 1842 à N. Ya. Prokopovitch. D’après les lettres de Gogol, il ressort clairement que le Conte n’était pas du tout important pour lui à cause de ce à quoi les censeurs de Saint-Pétersbourg attachaient de l’importance. L'écrivain va sans hésiter modifier tous les passages supposés « répréhensibles » qui pourraient provoquer le mécontentement du censeur. Expliquant dans une lettre à A.V. Nikitenko du 10 avril 1842 la nécessité de Kopeikin dans le poème, Gogol fait appel à l'instinct artistique du censeur. « … J'avoue que la destruction de Kopeikin m'a beaucoup dérouté. C'est l'un des meilleurs endroits. Et je suis incapable de combler avec quoi que ce soit le trou visible dans mon poème. Toi-même, doué de goût esthétique<...>vous voyez que cette pièce est nécessaire, non pas pour enchaîner les événements, mais pour distraire un instant le lecteur, pour remplacer une impression par une autre, et celui qui est artiste dans l'âme comprendra que sans lui une forte le trou reste. Je me suis dit : peut-être que la censure avait peur des généraux. J'ai refait Kopeikin, j'ai tout jeté, même le ministre, même le mot « Excellence ». A Saint-Pétersbourg, faute de tout le monde, il ne reste qu'une seule commission temporaire. J’ai mis davantage l’accent sur le caractère de Kopeikin, il est donc désormais clair que c’est lui-même qui est la cause de ses actes, et non le manque de compassion des autres. Le chef de la commission le traite même très bien. En un mot, tout est maintenant sous une forme telle qu'aucune censure stricte, à mon avis, ne peut rien trouver de répréhensible à aucun égard » (XII, 54-55).
En essayant d'identifier le contenu sociopolitique du Conte, les chercheurs y voient une exposition de l'ensemble de la machine d'État de la Russie, jusqu'aux plus hautes sphères gouvernementales et au tsar lui-même. Sans parler du fait qu'une telle position idéologique était tout simplement impensable pour Gogol, le Conte « résiste » obstinément à une telle interprétation.
Comme cela a été noté plus d'une fois dans la littérature, l'image du capitaine Kopeikin par Gogol remonte à une source folklorique - des chansons folkloriques de voleurs sur le voleur Kopeikin. L'intérêt et l'amour de Gogol pour l'écriture de chansons folkloriques sont bien connus. Dans l'esthétique d'un écrivain, les chansons sont l'une des trois sources de l'originalité de la poésie russe, dont les poètes russes devraient s'inspirer. Dans les « Notes de Saint-Pétersbourg de 1836 », appelant à la création d'un théâtre national russe et à la représentation des personnages sous leur « forme répandue à l'échelle nationale », Gogol a exprimé un jugement sur utilisation créative traditions folkloriques de l'opéra et du ballet. « Guidé par une lisibilité subtile, le créateur de ballet peut en tirer (danses folkloriques, nationales. - V.V.) autant qu'il veut déterminer les personnages de ses héros dansants. Il va sans dire qu’après en avoir saisi le premier élément, il peut le développer et voler incomparablement plus haut que son original, tout comme un génie musical crée tout un poème à partir d’une simple chanson entendue dans la rue » (VIII, 185).
«Le Conte du capitaine Kopeikin», issu littéralement d'une chanson, était l'incarnation de cette pensée gogolienne. Ayant deviné « l’élément de caractère » de la chanson, l’écrivain, selon ses propres mots, « le développe et vole incomparablement plus haut que son original ». Voici l'une des chansons du cycle sur le voleur Kopeikin.
Le voleur Kopeikin se prépare
A l'embouchure glorieuse du Karastan.
Lui, le voleur Kopeikin, s'est couché le soir,
Vers minuit, le voleur Kopeikin s'est levé,
Il s'est lavé avec la rosée du matin,
Il s'essuya avec un mouchoir en taffetas,
J'ai prié Dieu du côté est.
« Levez-vous, chers frères !
Frères, j'ai fait un mauvais rêve :
C'est comme si moi, un brave garçon, je marchais au bord de la mer,
J'ai trébuché avec mon pied droit,
Pour le petit arbre, pour le nerprun.
N'est-ce pas toi, petite épave, qui m'as écrasé :
La tristesse-chagrin assèche et détruit le bon garçon !
Vous vous jetez, frères, dans la lumière du bateau,
Ramez, les garçons, ne soyez pas timides,
Sous les mêmes montagnes, sous les Serpents !
Ce n'est pas le serpent féroce qui sifflait,
L'intrigue de la chanson du voleur sur Kopeikin est enregistrée en plusieurs versions. Comme c'est généralement le cas dans l'art populaire, tous les exemples connus aident à comprendre caractère général travaux. Le motif central de ce cycle de chants est le rêve prophétique d'Ataman Kopeikin. Voici une autre version de ce rêve, préfigurant la mort du héros.
C'était comme si je marchais au bout d'une mer bleue ;
Comment la mer bleue a tout secoué,
Le tout mélangé à du sable jaune ;
J'ai trébuché avec mon pied gauche,
J'ai attrapé un petit arbre avec ma main,
Pour un petit arbre, pour un nerprun,
Pour le tout en haut :
Le sommet du nerprun s'est cassé,
Le chef des voleurs, Kopeikin, comme il est représenté dans la tradition des chansons folkloriques, "a trébuché avec son pied, a attrapé un petit arbre avec sa main". Ce détail symbolique, peint dans des tons tragiques, est le principal trait distinctif cette image folklorique.
Gogol utilise le symbolisme poétique de la chanson pour décrire l'apparence de son héros : « son bras et sa jambe ont été arrachés ». Lors de la création d'un portrait du capitaine Kopeikin, l'écrivain ne fournit que ce détail, reliant le personnage du poème à son prototype folklorique. Il convient également de souligner que dans l’art populaire, arracher le bras et la jambe de quelqu’un est considéré comme une « plaisanterie » ou un « choyer ». Le Kopeikin de Gogol n'évoque pas du tout une attitude de pitié envers lui-même. Ce visage n'est en aucun cas passif, pas passif. Le capitaine Kopeikin est avant tout un voleur audacieux. En 1834, dans l'article « Regard sur la formation de la Petite Russie », Gogol écrivait à propos des cosaques désespérés de Zaporozhye, « qui n'avaient rien à perdre, pour qui la vie était un sou, dont la volonté violente ne pouvait tolérer les lois et les autorités.<...>Cette société a conservé tous les traits qui servent à décrire une bande de voleurs... » (VIII, 46-48).
Créé selon les lois de la poétique des contes de fées (accent sur le vivant familier, appel direct au public, utilisation d’expressions populaires et de techniques narratives), le Conte de Gogol nécessite une lecture appropriée. Sa forme de conte de fées se manifeste clairement dans la fusion des principes poétiques et folkloriques populaires avec l'événement historique concret et réel. La rumeur populaire sur le voleur Kopeikin, qui pénètre profondément dans la poésie populaire, n'est pas moins importante pour comprendre la nature esthétique du Conte que l'affectation chronologique de l'image à une certaine époque - la campagne de 1812.
Telle que présentée par le maître de poste, l'histoire du capitaine Kopeikin est avant tout le récit d'un incident réel. La réalité ici est réfractée à travers la conscience du héros-conteur qui, selon Gogol, incarne les traits de la pensée populaire et nationale. Événements historiques, ayant une importance nationale et nationale, ont toujours donné naissance à toutes sortes d'histoires et de légendes orales parmi le peuple. Dans le même temps, les images épiques traditionnelles ont été repensées de manière particulièrement créative et adaptées aux nouvelles conditions historiques.
Passons donc au contenu du Conte. L'histoire du maître de poste au sujet du capitaine Kopeikin est interrompue par les paroles du chef de la police : « Permettez-moi, Ivan Andreevich, car le capitaine Kopeikin, vous l'avez dit vous-même, a perdu un bras et une jambe, et Chichikov a... » À cette raison raisonnable remarque, le maître de poste « s'est cogné la main aussi fort qu'il a pu sur le front », se qualifiant publiquement devant tout le monde de veau. Il ne pouvait pas comprendre comment une telle circonstance ne lui était pas venue à l'esprit au tout début de l'histoire, et il a admis que le dicton était absolument vrai : un Russe est fort avec le recul » (VI, 205).
D'autres personnages du poème, mais avant tout Pavel Ivanovitch Chichikov lui-même, sont abondamment dotés de la « vertu russe racine » - un esprit arriéré, « captivant » et repentant. Gogol avait sa propre attitude particulière envers ce proverbe. Il est généralement utilisé dans le sens de « je m’en suis rendu compte, mais c’est trop tard » et la force est considérée avec le recul comme un vice ou une lacune. DANS Dictionnaire explicatif V. Dahl on trouve : « Le Rusak est fort avec son dos (avec le recul) » ; « Intelligent, mais rétrograde » ; "Je suis intelligent avec le recul." Dans ses « Proverbes du peuple russe », nous lisons : « Tout le monde est intelligent : certains d'abord, d'autres plus tard » ; « On ne peut pas arranger les choses avec le recul » ; "Si seulement j'avais à l'avance la sagesse qui vient après." Mais Gogol connaissait aussi une autre interprétation de ce dicton. Ainsi, le célèbre collectionneur de folklore russe de la première moitié du XIXe siècle, I. M. Snegirev, y voyait une expression de la mentalité caractéristique du peuple russe : « Qu'un Russe, même après une erreur, puisse reprendre ses esprits et reprendre ses esprits, c'est ce que dit son propre proverbe : « Un Russe est fort avec le recul. » ; "C'est ainsi que les proverbes russes eux-mêmes expriment la mentalité caractéristique du peuple, la manière de juger, la particularité du point de vue<...>Leur base fondamentale est l’expérience héréditaire séculaire, ce recul dont le Russe est fort… »
Gogol a montré un intérêt constant pour les œuvres de Snegirev, ce qui l'a aidé à mieux comprendre l'essence de l'esprit national. Par exemple, dans l'article «Quelle est finalement l'essence de la poésie russe…» - ce manifeste esthétique unique de Gogol - la nationalité de Krylov s'explique par la mentalité nationale et originale particulière du grand fabuliste. Dans la fable, écrit Gogol, Krylov « savait devenir le poète du peuple. C'est notre forte tête russe, le même esprit qui s'apparente à l'esprit de nos proverbes, le même esprit avec lequel le Russe est fort, l'esprit de conclusions, ce qu'on appelle l'esprit postérieur » (VI, 392).
L’article de Gogol sur la poésie russe lui était nécessaire, comme il l’admettait lui-même dans une lettre à P. A. Pletnev en 1846, « pour expliquer les éléments de la personne russe ». Dans les pensées de Gogol sur les destins autochtones, son présent et son avenir historique, « le recul ou l'esprit de conclusions finales, dont l'homme russe est principalement doté avant les autres », est cette « propriété fondamentale de la nature russe » qui distingue les Russes des autres peuples. Avec cette propriété de l'esprit national, qui s'apparente à l'esprit proverbes populaires, « qui a su tirer de si grandes conclusions des pauvres, insignifiants de leur temps<...>et qui parlent seulement des énormes conclusions qu'un Russe moderne peut tirer de la vaste époque actuelle dans laquelle sont tracés les résultats de tous les siècles » (VI, 408), Gogol a relié le haut destin de la Russie.
Lorsque les suppositions pleines d'esprit et les suppositions judicieuses des fonctionnaires sur l'identité de Chichikov (ici le « millionnaire », le « fabricant de faux billets » et le capitaine Kopeikin) atteignent le point du ridicule - Chichikov est déclaré déguisé en Napoléon - le l'auteur semble protéger ses héros. «Et dans la chronique mondiale de l'humanité, il y a de nombreux siècles entiers qui, semble-t-il, ont été barrés et détruits comme inutiles. De nombreuses erreurs ont été commises dans le monde que, semble-t-il, même un enfant n'aurait pas commises aujourd'hui » (VI, 210). Le principe d’opposer « les siens » et « les leurs », clairement perceptible du premier au dernière page"Dead Souls" est soutenu par l'auteur en opposant le recul russe aux erreurs et aux illusions de toute l'humanité. Les possibilités inhérentes à cette propriété « proverbiale » de l'esprit russe auraient dû être révélées, selon Gogol, dans les volumes ultérieurs du poème.
Le rôle idéologique et compositionnel de ce dicton dans le plan de Gogol aide à comprendre le sens du « Conte du capitaine Kopeikin », sans lequel l'auteur ne pourrait imaginer le poème.
L'histoire existe en trois éditions principales. Le second est considéré comme canonique, non censuré, et est imprimé dans le texte du poème dans toutes les éditions modernes. L’édition originale diffère des suivantes principalement par sa fin, qui raconte les aventures de voleur de Kopeikin, sa fuite à l’étranger et une lettre de là au tsar expliquant les motifs de ses actes. Dans les deux autres versions du Conte, Gogol se limitait à laisser entendre que le capitaine Kopeikin était devenu le chef d'un gang de voleurs. Peut-être l’auteur avait-il prévu des difficultés dues à la censure. Mais ce n’est pas la censure, je pense, qui a été la raison du rejet de la première édition. Dans sa forme originale, le Conte, bien qu'il précise idée principale l'auteur ne correspondait cependant pas pleinement à l'intention idéologique et artistique du poème.
Dans les trois éditions bien connues du Conte, immédiatement après avoir expliqué qui était le capitaine Kopeikin, il y a une indication de la principale circonstance qui a forcé Kopeikin à lever des fonds pour lui-même : « Eh bien, alors non, vous savez, de tels ordres avaient encore été fait pour les blessés; ce type de capital handicapé était déjà constitué, on peut l'imaginer, d'une certaine manière, bien plus tard » (VI, 200). Ainsi, le capital handicapé, qui subvenait aux blessés, a été créé, mais seulement après que le capitaine Kopeikin lui-même ait trouvé des fonds pour lui-même. De plus, comme il ressort de l’édition originale, il prend ces fonds dans la « poche de l’État ». La bande de voleurs, dirigée par Kopeikin, se bat exclusivement avec le trésor. « Il n'y a pas de passage sur les routes, et tout cela, en fait, pour ainsi dire, s'adresse uniquement au gouvernement. Si une personne passe par ici pour un besoin personnel, eh bien, elle demandera seulement : « Pourquoi ? » - et continuera son chemin. Et dès qu'il y a du fourrage, des provisions ou de l'argent du gouvernement, en un mot tout ce qui porte, pour ainsi dire, le nom du trésor, il n'y a pas de descendance ! (VI, 829).
Constatant « l'omission » de Kopeikine, le tsar « donna les instructions les plus strictes pour former un comité dans le seul but d'améliorer le sort de tous, c'est-à-dire des blessés... » (VI, 830). Plus haut autorités gouvernementales en Russie, et en premier lieu le tsar lui-même, sont capables, selon Gogol, de tirer les bonnes conclusions, de prendre une décision sage et juste, mais pas immédiatement, mais « plus tard ». Les blessés ont été soignés d'une manière qui n'était possible dans aucun « autre État éclairé », mais seulement lorsque le tonnerre avait déjà frappé... Le capitaine Kopeikin est devenu un voleur non pas à cause de l'insensibilité des hauts fonctionnaires, mais parce que cela est C'est déjà le cas en Russie, tout est arrangé, tout le monde est fort avec le recul, à commencer par le maître de poste et Chichikov et en terminant par le souverain.
Lors de la préparation d'un manuscrit pour publication, Gogol se concentre principalement sur « l'erreur » elle-même, et non sur sa « correction ». Ayant abandonné la fin de l'édition originale, il conserva le sens du Conte dont il avait besoin, mais en changea l'accent. Dans la version finale, la forteresse est présentée rétrospectivement, conformément au concept artistique du premier volume, sous sa forme négative et ironiquement réduite. La capacité de l'homme russe, même après une erreur, à tirer les conclusions nécessaires et à se corriger devrait, selon Gogol, être pleinement réalisée dans les volumes suivants.
Le concept général du poème a été influencé par l’implication de Gogol dans la philosophie populaire. La sagesse populaire ambiguë. Le proverbe vit sa vie réelle et authentique non pas dans des recueils, mais dans un discours populaire vivant. Sa signification peut changer selon la situation dans laquelle il est utilisé. Le caractère véritablement populaire du poème de Gogol ne réside pas dans l'abondance des proverbes, mais dans le fait que l'auteur les utilise conformément à leur existence parmi le peuple. L’évaluation par l’écrivain de telle ou telle « propriété de nature russe » dépend entièrement de situation spécifique, dans lequel cette « propriété » se manifeste. L'ironie de l'auteur ne porte pas sur la propriété elle-même, mais sur son existence réelle.
Il n’y a donc aucune raison de croire qu’en refaisant le Conte, Gogol ait fait des concessions significatives à la censure. Nul doute qu’il n’a pas cherché à présenter son héros uniquement comme une victime d’injustice. Si une « personne importante » (ministre, général, chef) est coupable de quoi que ce soit devant le capitaine Kopeikine, c'est uniquement parce que, comme Gogol l'a dit à une autre occasion, il n'a pas « bien compris sa nature et sa situation ». Un des caractéristiques distinctives La poétique de l'écrivain est la netteté des personnages. Les actions et les actions extérieures des héros de Gogol, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ne sont qu'une expression extérieure de leur essence intérieure, des propriétés de la nature, du caractère. Lorsque Gogol écrivait le 10 avril 1842 à P. A. Pletnev qu'il « avait amélioré plus fortement le caractère de Kopeikin, de sorte qu'il est maintenant clair qu'il était lui-même la cause de tout et qu'ils l'ont bien traité » (ces mots furent presque littéralement répétés dans le lettre citée de A V. Nikitenko), il ne s'agissait alors pas d'un remaniement radical de l'image pour satisfaire aux exigences de la censure, mais d'un renforcement des traits de caractère de son héros qui étaient en lui au départ.
L'image du capitaine Kopeikin, qui, comme d'autres images de Gogol, est devenue un nom familier, est fermement entrée dans la littérature et le journalisme russes. Dans la nature de sa compréhension, deux traditions se sont développées : l'une dans les travaux de M. E. Saltykov-Shchedrin et F. M. Dostoïevski, l'autre dans la presse libérale. Dans le cycle de Shchedrin " Des gens cultivés" (1876) Kopeikin apparaît comme un propriétaire terrien borné de Zalupsk : « Ce n'est pas pour rien que mon ami, le capitaine Kopeikin, écrit : « N'allez pas à Zalupsk ! » Nous, mon frère, avons tellement de gens maigres et durs maintenant – tout notre club culturel a été gâté !’” . F. M. Dostoïevski interprète également l’image de Gogol dans un esprit nettement négatif. Dans le « Journal d'un écrivain » de 1881, Kopeikin apparaît comme un prototype des « industriels de poche » modernes. "... De nombreux capitaines de Kopeikin étaient terriblement divorcés, dans d'innombrables variantes<...>Et pourtant, ils s’en prennent au Trésor et au domaine public.»
D'un autre côté, dans la presse libérale, il y avait une tradition différente - "une attitude sympathique envers le héros de Gogol en tant que personne luttant pour son bien-être contre une bureaucratie inerte et indifférente à ses besoins". Il est à noter que des écrivains aussi différents dans leur orientation idéologique que Saltykov-Shchedrin et Dostoïevski, qui ont également adhéré à des styles artistiques différents, interprètent l'image du capitaine de Gogol Kopeikin dans la même clé négative. Il serait erroné d'expliquer la position des écrivains par le fait que leur interprétation artistique reposait sur une version du Conte adoucie par les conditions de censure, et que Shchedrin et Dostoïevski étaient inconnus de son édition originale qui, selon l'opinion générale des chercheurs, se distinguait par la plus grande acuité sociale. En 1857, N. G. Chernyshevsky, dans une revue des Œuvres et lettres collectives posthumes de Gogol, publiées par P. A. Kulish, a entièrement réimprimé la fin du Conte, publié pour la première fois à l'époque, en la concluant par les mots suivants : « Oui, qu'il en soit ainsi C'est peut-être le cas, mais c'est lui qui, le premier, nous a présenté sous notre forme actuelle… »
Le point, apparemment, est différent. Chtchedrine et Dostoïevski ont senti dans le Kopeikine de Gogol les nuances et les traits de son personnage qui échappaient aux autres et, comme cela s'est produit plus d'une fois dans leur œuvre, ils ont « redressé » l'image et aiguisé ses traits. La possibilité d'une telle interprétation de l'image du capitaine Kopeikin réside sans aucun doute en lui-même.
Ainsi, « L'histoire du capitaine Kopeikin », racontée par le maître de poste, démontrant clairement le proverbe « Un homme russe est fort avec le recul », l'a naturellement et organiquement introduit dans le récit. Avec un changement inattendu dans son style narratif, Gogol oblige le lecteur à trébucher sur cet épisode, à y retenir son attention, montrant ainsi clairement que c'est là la clé pour comprendre le poème.
La méthode de Gogol pour créer des personnages et des images dans ce cas fait écho aux paroles de L. N. Tolstoï, qui appréciait également les proverbes russes et, en particulier, les recueils de I. M. Snegirev. Tolstoï avait l’intention d’écrire une histoire en utilisant un proverbe comme germe. Il en parle, par exemple, dans l'essai « Qui devrait apprendre à écrire de qui, les enfants des paysans de nous ou nous des enfants des paysans ? » : « Depuis longtemps, la lecture du recueil de proverbes de Snegirev est l'une des mes choses préférées - pas les activités, mais les plaisirs. Pour chaque proverbe, j'imagine des gens parmi le peuple et leurs affrontements au sens du proverbe. Parmi les rêves irréalisables, j’ai toujours imaginé une série d’histoires ou de peintures écrites sur la base de proverbes.
Originalité artistique"Le conte du capitaine Kopeikin", selon le maître de poste, "en quelque sorte un poème entier", aide à comprendre la nature esthétique des "âmes mortes". En créant sa création - un poème véritablement populaire et profondément national - Gogol s'est appuyé sur les traditions de la culture poétique populaire.