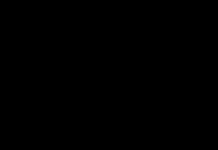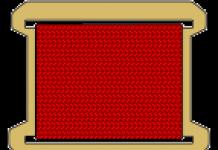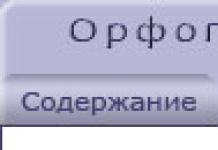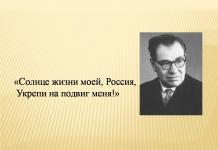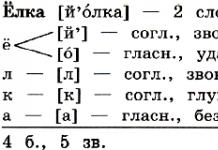Les premières tentatives de collectivisation ont été faites par le gouvernement soviétique immédiatement après la révolution. Cependant, à cette époque, il y avait des problèmes bien plus graves. La décision de procéder à la collectivisation en URSS fut prise lors du XVe Congrès du Parti en 1927.
Collectivisation- le processus de regroupement des exploitations paysannes individuelles en fermes collectives (fermes collectives en URSS). Elle a été réalisée en URSS à la fin des années 1920 - début des années 1930 (1928-1933) (la décision sur la collectivisation a été prise lors du XVe Congrès du PCUS (b) en 1927), dans les régions occidentales de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Moldavie. , en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, la collectivisation a été achevée en 1949-1950.
Le 5 janvier 1930, une résolution fut adoptée par le Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l’Union, proclamant la « collectivisation complète » et la « liquidation des koulaks en tant que classe ». Le principal moyen de forcer les paysans à s'unir dans des fermes collectives était la menace de « dékoulakisation » (selon certaines sources, nombre total les « dépossédés » ont atteint 10 millions).
La famine de 1932-1933 joua un rôle important dans la victoire finale du régime sur la paysannerie. Cela a été causé par la politique de l'État, qui a confisqué toutes les céréales du village (le nombre minimum de victimes de la famine était d'environ 2,5 millions de personnes).
Famine de 1932-33
Forte hausse des exportations de céréales
Méthodes violentes de collectivisation
Une forte augmentation des achats de céréales par l'État, jusqu'à la saisie des fonds d'amorçage
Une forte réduction du cheptel et de la récolte brute de céréales
Objectif de la collectivisation- établissement de relations de production socialistes dans les campagnes, élimination de la production marchande à petite échelle pour résoudre les difficultés céréalières et fournir au pays la quantité nécessaire de céréales commercialisables
Les raisons de la collectivisation étaient avant tout :
1) la nécessité d'investissements importants dans l'industrie pour réaliser l'industrialisation du pays ;
2) la « crise des achats de céréales » à laquelle les autorités ont été confrontées à la fin des années 20.
La collectivisation des exploitations paysannes a commencé en 1929. Au cours de cette période, les impôts sur les exploitations individuelles ont été considérablement augmentés. Le processus de dépossession a commencé - privation de propriété et, souvent, déportation de paysans riches. Il y a eu un massacre massif de bétail - les paysans ne voulaient pas le donner aux fermes collectives. Les membres du Politburo qui s'opposaient aux pressions sévères exercées sur la paysannerie (Rykov, Boukharine) furent accusés de déviation vers la droite.
En 1929, l’article de Staline « L’année du grand tournant » parut dans le journal Pravda et le cap fut fixé pour la création de fermes collectives et l’élimination des koulaks en tant que classe. En janvier 1930, une résolution du Comité central du Parti communiste bolchevik de toute l'Union fixa des délais pour la collectivisation des régions. Pour l’ensemble du pays, cette tâche aurait dû être résolue d’ici la fin du premier plan quinquennal. Mais rien n’a été dit sur les moyens de collectivisation et sur le sort des koulaks. Les autorités locales ont alors commencé à recourir à la violence.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une collectivisation complète, cet obstacle devait être « levé ». Le 30 janvier 1930, le Politburo du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union adopta une résolution « Sur les mesures visant à éliminer les fermes koulaks dans les zones de collectivisation complète ».
Mais, selon Staline, le processus n’allait pas assez vite. Au cours de l'hiver 1930, le Comité exécutif central panrusse décida de procéder à une collectivisation complète. Agriculture en URSS dans les plus brefs délais, dans un délai de 1 à 2 ans. Les paysans ont été contraints de rejoindre des fermes collectives sous la menace d'être dépossédés. La saisie du pain du village provoqua une terrible famine en 1932-33, qui éclata dans de nombreuses régions de l'URSS. Durant cette période, selon des estimations minimales, 2,5 millions de personnes sont mortes.
En conséquence, la collectivisation a porté un coup dur à l’agriculture. La production céréalière a diminué, le nombre de vaches et de chevaux a diminué de plus de 2 fois. De la dépossession massive (au moins 10 millions de personnes ont été dépossédées entre 1929 et 1933) et de l’entrée dans les fermes collectives, seules les couches les plus pauvres des paysans ont bénéficié. La situation dans les zones rurales ne s'est quelque peu améliorée qu'au cours de la période du 2ème Plan quinquennal. La mise en œuvre de la collectivisation est devenue l'une des étapes importantes de l'approbation du nouveau régime.
"Bunger 100%"
Au printemps 1930, il devint évident que la collectivisation menaçait un désastre. Le 2 mars, Staline a publié l'article « Vertiges du succès », dans lequel il accusait les dirigeants locaux d'être responsables des échecs et condamnait les « excès ». En réponse, les paysans ont commencé à quitter en grand nombre les fermes collectives.
Résultats
1) en 1932-1933. vers les régions les plus productrices de céréales du pays, principalement vers l'Ukraine, la région de Stavropol, Caucase du Nord, la famine est arrivée, plus de 3 millions de personnes sont mortes. Bien que les exportations de céréales du pays et le volume des approvisionnements gouvernementaux aient augmenté régulièrement ;
2) en 1933, plus de 60 % des paysans étaient regroupés dans des fermes collectives et en 1937, environ 93 %. La collectivisation fut déclarée achevée ;
3) la collectivisation a porté un coup dur aux campagnes russes (réduction de la production céréalière, du nombre de têtes de bétail, des rendements et des superficies ensemencées). Dans le même temps, les achats publics de céréales ont été multipliés par 2 et les impôts sur les fermes collectives ont été multipliés par 3,5. Dans cette contradiction se cache une véritable tragédie de la paysannerie russe ;
4) les grandes exploitations techniquement équipées présentaient des avantages. Mais les fermes collectives, qui restaient formellement des associations coopératives volontaires, se sont en fait transformées en entreprises agricoles d'État ayant des objectifs de planification stricts et soumises à une gestion directive ;
5) les kolkhoziens n'ont pas reçu de passeport pendant la réforme, ce qui les a en fait rattachés aux kolkhozes et les a privés de liberté de mouvement ;
6) l'industrialisation s'est faite aux dépens de l'agriculture ;
7) la collectivisation a transformé les fermes collectives en fournisseurs fiables et inconditionnels de matières premières, de nourriture, de capital et de main d’œuvre ;
8) la couche sociale des paysans individuels avec sa culture et ses valeurs morales a été détruite.
24. Les principales périodes de la Grande Guerre Patriotique, bilan des principaux événements sur les fronts. Le sens et le prix de la victoire peuple soviétique sur le fascisme.
En bref (2 pages)
Histoire des Grands Guerre patriotique est divisé en trois étapes : 1) 22 juin 1941 – 19 novembre 1942, c'est-à-dire depuis l'attaque allemande contre l'URSS jusqu'au début de la contre-offensive troupes soviétiques près de Stalingrad - perturbation de la guerre éclair, créant les conditions d'un changement radical de la guerre ; 2) 17 novembre 1942 - décembre 1943 - tournant radical au cours de la Seconde Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, le transfert de l'initiative stratégique à l'armée soviétique se termine par le franchissement du Dniepr et la libération de Kiev ; 3) 1944 - 9 mai 1945, expulsion complète des envahisseurs du territoire de l'URSS, libération Armée soviétique pays d'Europe centrale et du Sud-Est, la défaite finale et la capitulation de l'Allemagne nazie.
Principales périodes de la guerre :
À l'aube du dimanche 22 juin 1941, l'armée allemande, composée d'environ 5,5 millions de personnes et composée de représentants de 12 pays, franchit la frontière de l'État soviétique. Europe de l'Ouest. Fin septembre, l’ennemi était déjà près de Moscou. Évaluant un retrait aussi rapide de l'Armée rouge, les historiens soulignent un certain nombre de raisons : la défaite des cadres de commandement de l'armée avant la guerre ; la conviction de Staline qu'Hitler ne risquerait pas de combattre sur deux fronts dans un avenir proche ; le manque de préparation des troupes soviétiques à la défense ; la domination de la doctrine idéologique selon laquelle l’Armée rouge ne combattra qu’en territoire étranger et avec « peu de sang » ; une erreur de calcul dans l'évaluation de la direction de l'attaque principale : elle était attendue sur la tête de pont sud-ouest.
Les réalisations les plus importantes de la première étape de la guerre furent l'organisation de la contre-offensive de l'Armée rouge près de Moscou le 6 décembre 1941 et la création à la fin de 1942 d'une supériorité des produits militaires soviétiques sur les produits militaires allemands. Fin 1941, 12,4 millions de personnes furent évacuées vers l'Est, 2 593 entreprises furent délocalisées, dont 1 523 grandes. La tragédie des premières années de la guerre fut le problème des prisonniers de guerre soviétiques. La plupart d’entre eux, soit environ trois millions de personnes, furent capturés en 1941. L'ordonnance n° 270 a déclaré tous les soldats de l'Armée rouge capturés comme traîtres.
Les batailles les plus importantes :
Bataille de Moscou 1941-1942 (Konev, Boudienny, Joukov) La bataille comporte deux étapes principales : défensive (30 septembre - 5 décembre 1941) et offensive (5 décembre 1941 - 20 avril 1942). Dans la première étape, l'objectif des troupes soviétiques était la défense de Moscou, dans la seconde, la défaite des forces ennemies avançant vers Moscou.
Événements principaux histoire militaire sont devenues les victoires des troupes soviétiques à Stalingrad, Koursk, Orel et Kiev. A ce stade, une énorme aide a été fournie à l'armée d'active mouvement partisan. Pendant toute la guerre, 6 000 détachements de partisans ont été créés et le nombre de leurs participants était d'environ 1 million de personnes. Du 28 novembre au 1er décembre 1943, une réunion des chefs d'État de trois États – l'URSS, les États-Unis et l'Angleterre – a eu lieu à Téhéran, qui a adopté la « Déclaration sur les actions communes dans la guerre contre l'Allemagne et la coopération d'après-guerre ». des trois pouvoirs.
Principales batailles :
Bataille de Stalingrad 1942-1943 (Joukov, Voronov, Vatoutine) Opérations défensives (17 juillet - 18 novembre 1942) et offensives (19 novembre 1942 - 2 février 1943) menées par les troupes soviétiques afin de défendre Stalingrad et de vaincre un important groupe stratégique ennemi opérant dans la direction de Stalingrad.
Bataille de Koursk 1943 (Joukov, Konev, Vatoutine, Rokossovsky) Opérations défensives (5-23 juillet) et offensives (12 juillet-23 août) menées par les troupes soviétiques dans la région de Koursk pour perturber une offensive majeure des troupes allemandes et vaincre le groupement stratégique ennemi. Après la défaite de ses troupes à Stalingrad, le commandement allemand envisageait de mener une opération offensive majeure dans la région de Koursk (Opération Citadelle).
3)
Libération du territoire de l'URSS et des pays européens. Victoire sur le nazisme en Europe (janvier 1944 - mai 1945).
Au cours de la dernière étape de la Seconde Guerre mondiale, au cours de dix opérations militaro-stratégiques, les troupes soviétiques ont atteint les frontières de l'URSS dès l'été et ont entamé une marche victorieuse à travers l'Europe. En février 1945, une nouvelle réunion au sommet eut lieu à Yalta. Une décision y fut prise sur l'organisation de l'ONU et l'entrée de l'URSS dans la guerre avec le Japon après la défaite de l'Allemagne. Le 16 avril 1945 commençait l’opération militaire la plus ambitieuse de la Seconde Guerre mondiale, Berlin. Le 25 avril, les troupes soviétiques et américaines se rencontrent sur l'Elbe. Le 30 avril, le Reichstag est pris. Le 9 mai, la Grande Guerre Patriotique prend fin.
Les opérations les plus importantes :
Opération biélorusse (23 juin - 29 août 1944). Nom de code : Opération Bagration. Il s'agit de l'une des plus grandes opérations offensives stratégiques entreprises par le haut commandement soviétique dans le but de vaincre le groupe d'armées nazi Centre et de libérer la Biélorussie.
Opération Berlin 1945 (Staline, Joukov, Rokossovsky) Stratégique final offensant, menée par les troupes soviétiques du 16 avril au 8 mai 1945. Les objectifs de l'opération étaient de vaincre le groupe de troupes allemandes défendant en direction de Berlin, de capturer Berlin et d'atteindre l'Elbe pour s'unir aux forces alliées. en direction de Berlin, les troupes du groupe de la Vistule et du groupe du Centre sous le commandement du colonel général G. Heinritz et du maréchal F. Scherner occupaient la défense.
Informations complètes sur toute la guerre avec contexte :
L'Allemagne avant la guerre :
À la suite de la mondialisation crise économique Le parti national-socialiste NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs allemands) est arrivé au pouvoir en Allemagne et a lancé des préparatifs intensifs pour se venger de la défaite de la Première Guerre mondiale. Les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale (États-Unis, Grande-Bretagne et France), avec leur politique de non-intervention, ont contribué au fait que l'Allemagne a cessé de se conformer aux restrictions imposées à la croissance de son potentiel militaire par le Traité de Versailles. L’Allemagne est entrée sans opposition dans la Rhénanie démilitarisée et a utilisé la force militaire en Espagne pour soutenir le putsch fasciste. Les sociétés américaines et britanniques ont activement investi dans l’économie allemande et ont effectivement contribué à la création du puissant potentiel militaro-économique de l’Allemagne nazie.
En mars 1938, l’Allemagne annexa l’Autriche (Anschluss) et le traité de Munich fut conclu en septembre de la même année entre l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre et la France. Les accords de Munich ont permis aux nazis d'occuper la Tchécoslovaquie (avec la participation de la Pologne).
En août 1939, l’URSS conclut un pacte de non-agression avec l’Allemagne, connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop (des accords similaires avaient déjà été conclus par l’Allemagne avec la Pologne et certains autres pays européens). Selon les protocoles secrets du pacte (publiés en 1948 à partir d'une copie et en 1993 à partir de l'original), l'URSS et l'Allemagne se partagèrent les zones d'influence en Europe de l'Est : l'URSS reçut l'Estonie, la Lettonie, la Finlande et la Bessarabie et l'est de la Pologne. (jusqu'à la Vistule), Allemagne - Lituanie et Pologne occidentale (en septembre, la Lituanie a été échangée contre la voïvodie de Lublin en Pologne).
Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, l’Allemagne occupa la partie occidentale de la Pologne et l’URSS la partie orientale (Ukraine occidentale et Biélorussie occidentale). En 1940-1941 L'Allemagne a capturé la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, une partie de la France, le Danemark, la Norvège, la Yougoslavie et la Grèce (partagés avec l'Italie) ; conclu des alliances militaires avec la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie. De son côté, l'URSS a annexé les pays baltes, la province finlandaise de Vyborg, la Bessarabie et la Bucovine. La militarisation de l'économie et de toute la vie de l'Allemagne, la saisie de l'industrie et des réserves de matières premières stratégiques d'autres pays, l'utilisation forcée de main-d'œuvre bon marché des États occupés et alliés ont considérablement accru la puissance militaro-économique de l'Allemagne nazie.
L'URSS avant la guerre :
Grâce à l’industrialisation accélérée des années 1930, une puissante industrie lourde a été créée en URSS, dont l’industrie de défense. Cependant, pour la production d'acier, de fonte, de charbon, d'électricité, la plupart des produits chimiques Union soviétique inférieur à l'Allemagne. L’écart s’est encore creusé après que l’industrie de presque toute l’Europe occidentale et centrale soit tombée entre les mains du Troisième Reich.
Malgré son développement rapide, l’URSS était à la traîne de l’Allemagne dans de nombreux domaines techniques. Cela était particulièrement vrai pour les communications et les radars, la construction navale, les fusées et l'industrie automobile. La majorité de la population soviétique (environ 66 pour cent) était encore une paysannerie avec un niveau d'éducation assez faible - contrairement à l'Allemagne longtemps urbanisée et industrialisée.
Et, bien que la production de certains types équipement militaire(chars, avions, pièces d'artillerie), l'URSS était supérieure à l'Allemagne, l'équipement technique global des troupes soviétiques était inférieur à celui des troupes allemandes, notamment en communications, optique moderne, véhicules lourds (y compris ceux nécessaires au transport des chars) , et du matériel d'ingénierie.
La puissance de défense a été affectée négativement par les répressions contre l'état-major de commandement de l'Armée rouge, les erreurs de calcul dans le développement militaire, dans la détermination du moment probable du déclenchement de la guerre et, surtout, la concentration de la majeure partie de l'armée à la nouvelle frontière de l'État. .
Au cours de la première moitié de 1941, les services de renseignement soviétiques ont constamment signalé une attaque allemande imminente, mais les dirigeants soviétiques ont ignoré ces avertissements, car ils contenaient des informations contradictoires (et, comme l'ont montré les recherches modernes, parfois fausses), et en partie de fausses conclusions ont été tirées. d'informations correctes et justes (les fausses conclusions du chef des services de renseignement, Golikov, sont devenues largement connues). Le traité de paix avec l'Allemagne, ainsi que les déclarations constantes de l'armée allemande sur le débarquement imminent sur les îles britanniques, laissaient espérer qu'il n'y aurait pas de guerre en 1941. Contrairement à toutes les autres campagnes offensives allemandes, la guerre contre l’URSS n’a pas été précédée d’exigences politiques. Staline pensait que l’Allemagne n’attaquerait pas simplement parce qu’elle n’avait aucune chance de vaincre l’URSS.
Le 18 juin 1941, la flotte et les troupes frontalières de l'URSS sont mises en alerte. Un ordre similaire aux forces terrestres de l'Armée rouge n'a été donné que le 21 juin.
La théorie de la préparation d'une attaque contre l'Allemagne par Staline a été exprimée pour la première fois par Hitler dans un discours sur le début d'une attaque contre l'URSS, adressé aux Allemands. Dans les années 90, elle est devenue un sujet de discussion parmi les historiens professionnels grâce à la publication de livres de Viktor Suvorov, dans lesquels l'auteur prouvait activement la théorie de la guerre préventive. Cependant, comme l’ont montré des recherches plus approfondies, les écrits de Souvorov contiennent de nombreuses fraudes, fausses citations et absurdités techniques.
La transition vers une collectivisation complète s'est déroulée dans le contexte un conflit armé sur le chemin de fer de l'Est chinois et le déclenchement de la crise économique mondiale, qui a suscité de sérieuses inquiétudes parmi la direction du parti quant à la possibilité d'une nouvelle intervention militaire contre l'URSS.
Dans le même temps, certains exemples positifs d'agriculture collective, ainsi que les succès dans le développement de la coopération des consommateurs et de l'agriculture, ont conduit à une évaluation pas tout à fait adéquate de la situation actuelle de l'agriculture.
Depuis le printemps 1929, des événements ont été organisés dans les campagnes visant à augmenter le nombre de fermes collectives - en particulier les campagnes du Komsomol « pour la collectivisation ». En RSFSR, l'institut des commissaires agricoles a été créé ; en Ukraine, une grande attention a été accordée au patrimoine préservé guerre civile komnezamam (analogue au kombed russe). Principalement grâce au recours à des mesures administratives, il a été possible d'obtenir une augmentation significative des fermes collectives (principalement sous la forme de TOZ).
Le 7 novembre 1929, le journal Pravda n° 259 publiait l'article de Staline « L'année du grand tournant », dans lequel 1929 était déclarée l'année d'un « tournant radical dans le développement de notre agriculture » : « La présence de une base matérielle pour remplacer la production koulak a servi de base au tournant de notre politique à la campagne. Nous avons déménagé à Dernièrement de la politique visant à limiter les tendances exploiteuses des koulaks à la politique d’élimination des koulaks en tant que classe. Cet article est reconnu par la plupart des historiens comme le point de départ d’une « collectivisation complète ». Selon Staline, en 1929, le parti et le pays ont réussi à franchir un tournant décisif, notamment dans la transition de l'agriculture « d'une agriculture individuelle petite et arriérée à une agriculture collective grande et avancée, à la culture en commun de la terre, à des stations de machines et de tracteurs, aux artels, aux fermes collectives, s'appuyant sur les nouvelles technologies, et enfin aux fermes d'État géantes, armées de centaines de tracteurs et de moissonneuses-batteuses.
La situation réelle dans le pays est cependant loin d’être aussi optimiste. Selon le chercheur russe O.V. Selon Khlevnyuk, la marche vers une industrialisation accélérée et une collectivisation forcée « a en fait plongé le pays dans un état de guerre civile ».
Dans les campagnes, les approvisionnements forcés en céréales, accompagnés d'arrestations massives et de destructions de fermes, conduisent à des émeutes dont le nombre à la fin de 1929 se compte par centaines. Ne voulant pas céder la propriété et le bétail aux fermes collectives et craignant la répression à laquelle étaient soumis les paysans riches, les gens ont abattu le bétail et réduit les récoltes.
Entre-temps, le plénum de novembre (1929) du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union adopta une résolution « Sur les résultats et les tâches ultérieures de la construction de fermes collectives », dans laquelle il notait que le pays avait entamé un vaste projet de construction de fermes collectives. la reconstruction socialiste des campagnes et la construction d'une agriculture socialiste à grande échelle. La résolution indiquait la nécessité d'une transition pour achever la collectivisation dans certaines régions. Lors du plénum, il a été décidé d'envoyer 25 000 travailleurs urbains (soit vingt-cinq mille personnes) dans des fermes collectives pour un travail permanent afin de « gérer les fermes collectives et les fermes d'État établies » (en fait, leur nombre a par la suite presque triplé, s'élevant à plus de 73 mille).
Créé le 7 décembre 1929 par le Commissariat du Peuple à l'Agriculture de l'URSS sous la direction de Ya.A. Yakovlev a été chargé de « diriger concrètement les travaux de reconstruction socialiste de l'agriculture, en dirigeant la construction des fermes d'État, des fermes collectives et des MTS et en unifiant le travail des commissariats agricoles républicains ».
Les principales actions actives pour mener à bien la collectivisation ont eu lieu en janvier - début mars 1930, après la publication de la résolution du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union du 5 janvier 1930 « Sur le rythme de la collectivisation et les mesures de aide de l’État à la construction de fermes collectives. La résolution fixait pour objectif d'achever la collectivisation d'ici la fin du plan quinquennal (1932), tandis que dans des régions céréalières aussi importantes que la Basse et la Moyenne Volga et le Caucase du Nord - déjà à l'automne 1930 ou au printemps de 1931.
La « collectivisation apportée aux localités » s'est cependant déroulée conformément à la vision de l'un ou l'autre responsable local - par exemple, en Sibérie, les paysans ont été massivement « organisés en communes » avec socialisation de toute la propriété. Les districts se faisaient concurrence pour savoir qui recevrait rapidement un plus grand pourcentage de collectivisation, etc. Diverses mesures répressives ont été largement utilisées, que Staline a critiqué plus tard (en mars 1930) dans son célèbre article « Vertiges du succès » et qui ont ensuite été appelées « de gauche » (par la suite, l'écrasante majorité de ces dirigeants ont été condamnés comme « espions trotskystes »).
Cela a provoqué une vive résistance de la part de la paysannerie. Selon les données de différentes sources, donné par O.V. Khlevnyuk, en janvier 1930, 346 manifestations de masse ont été enregistrées, auxquelles ont participé 125 000 personnes, en février - 736 (220 000), au cours des deux premières semaines de mars - 595 (environ 230 000), sans compter l'Ukraine, où 500 ont été plongés dans des troubles colonies. En mars 1930, en général, en Biélorussie, dans la région centrale de la Terre noire, dans la région de la Basse et de la Moyenne Volga, dans le Caucase du Nord, en Sibérie, dans l'Oural, dans les régions de Léningrad, de Moscou, de l'Ouest, d'Ivanovo-Voznessensk, en en Crimée et en Asie centrale, 1 642 soulèvements paysans de masse, auxquels ont participé au moins 750 à 800 000 personnes. En Ukraine, à cette époque, plus d’un millier de colonies étaient déjà en proie à des troubles. Dans la période d’après-guerre en Ukraine occidentale, le processus de collectivisation s’est heurté à l’opposition de la clandestinité de l’OUN.
- Le 2 mars 1930, la lettre de Staline « Le vertige du succès » fut publiée dans la presse soviétique, dans laquelle la responsabilité des « excès » de la collectivisation était imputée aux dirigeants locaux.
- Le 14 mars 1930, le Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union adopta une résolution « Sur la lutte contre les distorsions de la ligne de parti dans le mouvement kolkhozien. » Une directive gouvernementale a été envoyée aux localités pour adoucir le cap face à la menace d'une « large vague de soulèvements paysans rebelles » et de la destruction de « la moitié des travailleurs de base ». Après l’article sévère de Staline et la traduction en justice de dirigeants individuels, le rythme de la collectivisation a ralenti et les fermes collectives et les communes artificiellement créées ont commencé à s’effondrer.
De la coopération à la collectivisation complète forcée.
Lors de la modernisation de l'industrie, les dirigeants soviétiques ont été confrontés à trois problèmes difficiles : le manque de fonds, de matières premières et de main-d'œuvre pour le développement de l'industrie. Ces problèmes pouvaient être résolus aux dépens de la paysannerie, qui constituait alors l'écrasante majorité de la population du pays. V. Lénine a vu une issue à cette situation dans la coopération, qui est une forme familière de coopération paysanne depuis l'époque pré-révolutionnaire. Son avantage était qu'il permettait de combiner les intérêts personnels avec ceux de l'État, et sa complexité était d'introduire un nouveau contenu socialiste dans les formes traditionnelles de coopération.
Le système de gestion rurale, formé dans les années 1920, reposait sur les principes de coopération volontaire et assurait, dans une certaine mesure, un équilibre entre le développement de l'industrie nationalisée et le secteur agricole propriétaire sans procéder à une collectivisation à grande échelle. En 1927, seulement 3 % des exploitations paysannes étaient regroupées en artels et communes agricoles.
Lors du XVe Congrès du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union en 1927, des décisions furent prises pour mettre en œuvre un processus de coopération lent, progressif et volontaire (production, consommation, crédit et autres types). Cependant, la pratique dictait un rythme rapide et des mesures strictes. Au fil du temps, J. Staline et son entourage sont devenus de plus en plus convaincus que les problèmes de l'industrialisation pouvaient être plus facilement résolus en s'appuyant non pas sur 25 à 30 millions de fermes individuelles, mais sur 200 à 300 000 fermes collectives.
L'impulsion pour accélérer la collectivisation a été la crise des approvisionnements en céréales de 1928, qui, selon I. Staline, a été causée par le sabotage des paysans. Dans cette situation, le dirigeant a décidé que pour « sauter » dans l’industrialisation, il était nécessaire d’établir un contrôle politique et économique strict sur la paysannerie. Pour la première fois depuis 1921, date à laquelle la politique du « communisme de guerre » fut abolie, des méthodes coercitives furent utilisées contre les paysans.
Dans le premier plan quinquennal de l'URSS, il était prévu de regrouper 18 à 20 % des exploitations paysannes dans des fermes collectives, et en Ukraine - 30 %. Cependant, des appels à une collectivisation forcée et complète se sont rapidement fait entendre.
Le mot d'ordre d'une collectivisation complète forcée a été proclamé lors du plénum de novembre (1929) du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union. V. Molotov et L. Kaganovitch ont insisté pour que le projet soit achevé d'ici un an. Le 5 janvier 1930, le Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union a adopté une résolution intitulée "Sur le rythme de la collectivisation et les mesures d'aide de l'État à la construction de fermes collectives". En Ukraine, selon ce décret, il était prévu d'achever la collectivisation à l'automne 1931 ou au printemps 1932. Le 24 février 1930, S. Kosior, pour plaire à J. Staline, signa une lettre d'instructions du Comité central du Parti communiste (b)U aux organisations locales du parti, selon lesquelles l'Ukraine devrait être collectivisée « d'ici l'automne 1930 ».
Pendant la période de formation et de développement de l'État soviétique, dont l'histoire a commencé avec la victoire des bolcheviks pendant Révolution d'Octobre, il y avait de nombreux projets économiques à grande échelle, dont la mise en œuvre a été réalisée au moyen de mesures coercitives sévères. L'un d'eux est la collectivisation complète de l'agriculture, dont les objectifs, l'essence, les résultats et les méthodes sont devenus le sujet de cet article.
Qu’est-ce que la collectivisation et quel est son objectif ?
La collectivisation complète de l'agriculture peut être brièvement définie comme le processus généralisé de fusion de petites exploitations agricoles individuelles en grandes associations collectives, abrégées en fermes collectives. En 1927 eut lieu la prochaine édition, au cours de laquelle fut fixée la voie à suivre pour la mise en œuvre de ce programme, qui fut ensuite exécuté dans la majeure partie du pays par
Une collectivisation complète, de l'avis de la direction du parti, aurait dû permettre au pays de résoudre le problème alimentaire alors aigu en réorganisant les petites exploitations appartenant aux paysans moyens et pauvres en grands complexes agricoles collectifs. En même temps, on envisageait la liquidation totale des koulaks ruraux, déclarés ennemis des réformes socialistes.
Raisons de la collectivisation
Les initiateurs de la collectivisation voyaient le principal problème de l'agriculture dans sa fragmentation. De nombreux petits producteurs, privés de la possibilité d'acheter technologie moderne, la plupart d'entre eux utilisaient un travail manuel inefficace et peu productif dans les champs, ce qui ne leur permettait pas d'obtenir des rendements élevés. La conséquence en fut une pénurie toujours croissante de denrées alimentaires et de matières premières industrielles.
Pour résoudre ce problème vital, une collectivisation complète de l'agriculture a été lancée. La date du début de sa mise en œuvre, généralement considérée comme le 19 décembre 1927 - jour de l'achèvement du XVe Congrès du PCUS (b), est devenue un tournant dans la vie du village. Un violent effondrement de l’ancien mode de vie vieux de plusieurs siècles a commencé.

Fais ça - je ne sais pas quoi
Contrairement à ce qui s'était passé en Russie réformes agraires Comme celles réalisées en 1861 par Alexandre II et en 1906 par Stolypine, la collectivisation menée par les communistes n'avait ni un programme clairement développé ni des moyens spécifiquement désignés pour sa mise en œuvre.
Le congrès du parti a donné des instructions pour un changement radical de la politique en matière d'agriculture, puis les dirigeants locaux ont été obligés de le mettre en œuvre eux-mêmes, à leurs risques et périls. Même leurs tentatives de contacter les autorités centrales pour obtenir des éclaircissements ont été réprimées.
Le processus a commencé
Néanmoins, le processus, qui a commencé avec le congrès du parti, a commencé et a couvert dès l'année suivante une partie importante du pays. Bien que l'adhésion officielle aux fermes collectives ait été déclarée volontaire, leur création a été réalisée dans la plupart des cas par le biais de mesures administratives et coercitives.
Déjà au printemps 1929, des commissaires agricoles apparurent en URSS - des fonctionnaires qui se rendirent sur le terrain et, en tant que représentants du plus haut pouvoir d'État, surveillèrent les progrès de la collectivisation. Ils furent aidés par de nombreux détachements du Komsomol, également mobilisés pour réorganiser la vie du village.

Staline à propos du « grand tournant » dans la vie des paysans
Le jour du 12e anniversaire de la révolution, le 7 novembre 1928, le journal Pravda publia un article de Staline, dans lequel il déclarait qu'un « grand tournant » était survenu dans la vie du village. Selon lui, le pays a réussi à accomplir transition historique de la production agricole à petite échelle à l’agriculture avancée, sur une base collective.
Il cite également de nombreux indicateurs spécifiques (pour la plupart exagérés), indiquant qu’une collectivisation complète a apporté partout un effet économique tangible. À partir de ce jour, les éditoriaux de la plupart des journaux soviétiques furent remplis d’éloges sur la « marche victorieuse de la collectivisation ».
La réaction des paysans face à la collectivisation forcée
Le tableau réel était radicalement différent de celui que les organes de propagande essayaient de présenter. La confiscation forcée des céréales des paysans, accompagnée d’arrestations généralisées et de destructions de fermes, a plongé le pays dans une nouvelle guerre civile. Au moment où Staline parlait de la victoire de la réorganisation socialiste des campagnes, des incendies brûlaient dans de nombreuses régions du pays. soulèvements paysans, à la fin de 1929, ils se comptaient par centaines.
Dans le même temps, la production agricole réelle, contrairement aux déclarations de la direction du parti, n’a pas augmenté mais a chuté de manière catastrophique. Cela était dû au fait que de nombreux paysans, craignant d'être classés comme koulaks et ne voulant pas céder leurs biens à la ferme collective, réduisaient délibérément les récoltes et massacraient le bétail. Ainsi, la collectivisation complète est avant tout un processus douloureux, rejeté par la majorité. résidents ruraux, mais réalisé par des méthodes de coercition administrative.

Tentatives d'accélérer le processus
Dans le même temps, en novembre 1929, il fut décidé d'intensifier le processus en cours de restructuration de l'agriculture et d'envoyer dans les villages 25 000 ouvriers parmi les plus conscients et les plus actifs pour gérer les fermes collectives qui y étaient créées. Cet épisode est resté dans l’histoire du pays sous le nom de mouvement des « vingt-cinq mille ». Par la suite, lorsque la collectivisation prit une ampleur encore plus grande, le nombre d’envoyés municipaux tripla presque.
Un élan supplémentaire au processus de socialisation des exploitations paysannes a été donné par la résolution du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union du 5 janvier 1930. Il indiquait des délais précis dans lesquels la collectivisation complète devait être achevée dans les principales zones arables du pays. La directive prescrivait leur transfert définitif vers une forme de gestion collective d'ici l'automne 1932.
Malgré le caractère catégorique de la résolution, comme auparavant, elle n'a donné aucune explication spécifique sur les méthodes d'implication des masses paysannes dans les fermes collectives et n'a même pas donné définition préciseà ce qui devait finalement être une ferme collective. Du coup, chaque patron local était guidé par sa propre idée de cette forme d'organisation du travail et de la vie inédite.
Arbitraire des autorités locales
Cet état de fait est devenu la cause de nombreux cas d'autonomie locale. Un tel exemple est la Sibérie, où les fonctionnaires locaux, au lieu de fermes collectives, ont commencé à créer certaines communes avec la socialisation non seulement du bétail, de l'équipement et des terres arables, mais aussi de tous les biens en général, y compris les effets personnels.
Dans le même temps, les dirigeants locaux, en compétition les uns avec les autres pour obtenir les pourcentages de collectivisation les plus élevés, n'ont pas hésité à recourir à des mesures répressives brutales contre ceux qui tentaient d'échapper à la participation au processus en cours. Cela a provoqué une nouvelle explosion de mécontentement, qui a pris dans de nombreuses régions la forme d’une rébellion ouverte.

Famine résultant de la nouvelle politique agricole
Néanmoins, chaque district recevait un plan spécifique pour la collecte des produits agricoles destinés à la fois au marché intérieur et à l'exportation, dont la mise en œuvre était personnellement responsable de la direction locale. Chaque livraison incomplète était considérée comme un signe de sabotage et pouvait avoir des conséquences tragiques.
Pour cette raison, une situation s'est produite dans laquelle les chefs de district, craignant leur responsabilité, ont forcé les kolkhoziens à remettre à l'État toutes les céréales disponibles, y compris le fonds de démarrage. La même situation a été observée dans l'élevage, où tous les bovins reproducteurs ont été envoyés à l'abattoir à des fins de déclaration. Les difficultés étaient également aggravées par l'extrême incompétence des dirigeants des fermes collectives, dont la plupart venaient au village à l'appel du parti et n'avaient aucune idée de l'agriculture.
En conséquence, la collectivisation complète de l'agriculture ainsi réalisée a conduit à des interruptions de l'approvisionnement alimentaire des villes et dans les villages - à une faim généralisée. Elle fut particulièrement destructrice à l’hiver 1932 et au printemps 1933. Dans le même temps, malgré les erreurs de calcul évidentes des dirigeants, les organes officiels ont imputé ce qui se passait à certains ennemis qui tentaient d'entraver le développement de l'économie nationale.
Élimination de la meilleure partie de la paysannerie
Un rôle important dans l'échec réel de la politique a été joué par l'élimination de la soi-disant classe des koulaks - des paysans riches qui ont réussi à créer des fermes solides pendant la période de la NEP et qui ont produit une part importante de tous les produits agricoles. Naturellement, cela n'avait aucun sens pour eux de rejoindre des fermes collectives et de perdre volontairement les biens acquis grâce à leur travail.

Étant donné qu'un tel exemple ne cadrait pas avec le concept général d'organisation de la vie du village et qu'eux-mêmes, de l'avis de la direction du parti du pays, empêchaient l'implication des paysans pauvres et moyens dans les fermes collectives, une décision a été prise pour éliminer eux.
Une directive correspondante a été immédiatement publiée, sur la base de laquelle les fermes koulaks ont été liquidées, tous les biens ont été transférés à la propriété des fermes collectives et eux-mêmes ont été expulsés de force vers les régions de l'Extrême-Nord et Extrême Orient. Ainsi, la collectivisation complète dans les régions céréalières de l'URSS s'est déroulée dans une atmosphère de terreur totale contre les représentants les plus performants de la paysannerie, qui constituaient le principal potentiel de main-d'œuvre du pays.
Par la suite, un certain nombre de mesures prises pour remédier à cette situation ont permis de normaliser partiellement la situation dans les villages et d'augmenter significativement la production de produits agricoles. Cela permit à Staline, lors du plénum du parti tenu en janvier 1933, de déclarer la victoire complète des relations socialistes dans le secteur des fermes collectives. Il est généralement admis que ce fut la fin de la collectivisation complète de l'agriculture.
Comment est née la collectivisation ?
La preuve la plus éloquente en est les données statistiques publiées au cours des années de perestroïka. Ils sont étonnants même s’ils semblent incomplets. Il ressort clairement d'eux que la collectivisation complète de l'agriculture a abouti aux résultats suivants : au cours de sa période, plus de 2 millions de paysans ont été déportés, le point culminant de ce processus étant survenu en 1930-1931. lorsqu'environ 1 million 800 000 résidents ruraux ont été soumis à une réinstallation forcée. Ce n’étaient pas des koulaks, mais pour une raison ou une autre, ils se trouvaient impopulaires dans leur pays natal. En outre, 6 millions de personnes ont été victimes de famine dans les villages.

Comme mentionné ci-dessus, la politique de socialisation forcée des fermes a conduit à des protestations massives parmi les habitants des zones rurales. Selon les données conservées dans les archives de l'OGPU, rien qu'en mars 1930, il y a eu environ 6 500 soulèvements et les autorités ont utilisé les armes pour en réprimer 800.
En général, on sait que cette année-là, plus de 14 000 soulèvements populaires ont été enregistrés dans le pays, auxquels ont participé environ 2 millions de paysans. À cet égard, on entend souvent l’opinion selon laquelle une collectivisation complète ainsi réalisée peut être assimilée au génocide de son propre peuple.
L’année 1929 marque le début de la collectivisation complète de l’agriculture en URSS. Dans le célèbre article d'I.V. "L'année du grand tournant" de Staline, la construction accélérée de fermes collectives a été reconnue comme la tâche principale, dont la solution en trois ans fera du pays "l'un des pays les plus producteurs de céréales, sinon le plus producteur de céréales du monde". le monde." Le choix s'est porté sur la liquidation des exploitations agricoles individuelles, la dépossession, la destruction du marché des céréales et la nationalisation effective de l'économie villageoise.
La conviction croissante que l’économie suit toujours la politique et que l’opportunisme politique est supérieur aux lois économiques. Telles sont les conclusions que la direction du Parti communiste de toute l'Union a tirées de l'expérience de la résolution des crises d'approvisionnement en céréales de 1926-1929. L’essence de la crise de l’approvisionnement en céréales était que les paysans individuels réduisaient l’approvisionnement en céréales de l’État et perturbaient les objectifs prévus : les prix d’achat fixes étaient trop bas et les attaques systématiques contre les « villages mangeurs de monde » n’encourageaient pas l’expansion des superficies ensemencées. et une augmentation des rendements. Le parti et l'État considéraient les problèmes, de nature économique, comme politiques. Les solutions proposées étaient appropriées : interdiction du libre-échange des céréales, confiscation des réserves de céréales, incitation des pauvres contre les riches du village. Des résultats convaincus de l'efficacité des mesures violentes.
En revanche, l’industrialisation accélérée qui s’amorce nécessite des investissements colossaux. Leur principale source était reconnue comme la campagne, qui, selon les plans des promoteurs de la nouvelle ligne générale, était censée approvisionner sans interruption l'industrie en matières premières et les villes en nourriture pratiquement gratuite.
La politique de collectivisation a été menée dans deux directions principales :
- - consolidation des fermes individuelles en fermes collectives
- - dépossession
Les fermes collectives étaient reconnues comme la principale forme d'association d'exploitations individuelles. Ils socialisèrent la terre, le bétail et l'équipement. La résolution du Comité central du Parti communiste de toute l'Union du 5 janvier 1930 a établi un rythme de collectivisation vraiment rapide : dans les principales régions productrices de céréales (région de la Volga, Caucase du Nord), elle devait être achevée en un an ; en Ukraine, dans les régions des terres noires de Russie, au Kazakhstan - pendant deux ans ; dans d'autres domaines - dans un délai de trois ans. Pour accélérer la collectivisation, des travailleurs urbains « idéologiquement instruits » ont été envoyés dans les villages (d'abord 25 000 personnes, puis 35 000 autres). Les hésitations, les doutes et les élans spirituels de paysans individuels, pour la plupart liés à leur propre ferme, à la terre, au bétail (« Je reste dans le passé avec un pied, je glisse et je tombe avec l'autre », Sergueï Yesenin écrit à une autre occasion), ont été simplement vaincus - par la force. Les autorités punitives ont privé ceux qui persistaient de leur droit de vote, confisqué leurs biens, les ont intimidés et les ont arrêtés.
Une analyse véridique des leçons du passé aidera à résoudre les problèmes d'aujourd'hui, notamment celui de l'essor de l'économie rurale. Aujourd'hui, peut-être, l'essentiel est de redonner au paysan la position de propriétaire de la terre, perdue les années précédentes, d'éveiller un sentiment d'amour pour elle, une confiance en l'avenir. Diverses formes de contrat, de location et d'arrangements développement social les villages sont appelés à garantir leur réussite pour relever ces défis.
L'éventail des questions liées à l'histoire de la collectivisation est très large. Voici le développement de l'agriculture dans les conditions de la NEPA, et la stratification de la paysannerie, la préservation des koulaks parmi eux d'un côté, les pauvres et les ouvriers agricoles de l'autre, et le développement de la coopération et la lutte interne du parti. autour de questions liées aux voies et au rythme des transformations socialistes, et bien plus encore.
À la fin des années 1920, aucun économiste ne doutait peut-être que la paysannerie de notre pays était destinée à suivre la voie de la coopération. Ils ont tous reconnu le caractère inévitable et progressiste de la transition de l’agriculture vers la voie de la production coopérative. Mais même parmi les agraires marxistes, il y avait des opinions très contradictoires sur ce que devrait être un village coopératif et sur la manière de transformer un paysan d’agriculteur individuel en un « coopérateur civilisé ». Ces différends reflétaient l'incohérence des réalités conditions économiques coopération qui s'est développée dès la fin des années 20 en URSS.
Dans les années 1920, il y a eu en effet un essor notable de l’économie paysanne, témoignant des résultats bénéfiques de la nationalisation des terres, de la libération des paysans de l’oppression des propriétaires terriens et de l’exploitation par le grand capital, ainsi que de l’efficacité de la nouvelle politique économique. En trois ou quatre ans, les paysans ont rétabli l'agriculture après de graves dévastations. Cependant, en 1925-1929. La production céréalière a fluctué à des niveaux légèrement supérieurs aux niveaux d'avant-guerre. La croissance de la production industrielle s’est poursuivie, mais elle a été modérée et non durable. Le cheptel a augmenté à un bon rythme : de 1925 à 1928, d'environ 5 pour cent par an. Bref, la petite agriculture paysanne n’a nullement épuisé ses possibilités de développement. Mais, bien entendu, ils étaient limités du point de vue des besoins d’un pays engagé sur la voie de l’industrialisation.
Le XVe Congrès du Parti communiste de toute l’Union, tenu en décembre 1927, proclama une « voie vers la collectivisation ». En ce qui concerne les campagnes, cela signifiait la mise en œuvre d'un système très diversifié de mesures visant à accroître la production de la masse multimillionnaire des exploitations paysannes, à accroître leur production commercialisable et à les intégrer dans le courant du développement socialiste. Cela a été pleinement assuré sur le chemin de leur coopération.
Objectifs de la collectivisation en URSS :
- - liquidation des koulaks en tant que classe
- - socialisation des moyens de production
- - gestion agricole centralisée
- - augmenter l'efficacité du travail
- - obtenir des fonds pour l'industrialisation du pays
La crise des approvisionnements en céréales à la fin de 1927 est le résultat des fluctuations du marché et non du reflet de la crise de la production agricole, et encore moins de la crise sociale des campagnes. Ce qui s'est passé?
Pourquoi les prix du pain ont-ils augmenté sur le marché privé ? Bien que la récolte brute de céréales en 1928 ait été légèrement supérieure à celle de 1927, les mauvaises récoltes en Ukraine et dans le Caucase du Nord ont entraîné une récolte de seigle et de blé d'environ 20 % en moins qu'en 1927/28.
Peut-être que toutes ces circonstances n'auraient pas eu un impact aussi notable sur la situation des achats de céréales sans deux facteurs. La première est que, bien que la réduction du chiffre d'affaires prévu des céréales et de la taille de l'approvisionnement prévu en pain pour la population urbaine ait été insignifiante, cela s'est produit dans des conditions de croissance rapide de l'industrie et de la taille de la population urbaine, qui avait une demande croissante. pour l'alimentation. C’est ce qui a fait monter en flèche les prix sur le marché privé. La seconde est la réduction des exportations de céréales, associée à une grave pénurie de ressources pour le marché intérieur, qui en 1928/29 ne représentaient que 3,27 % du niveau de 1926/27.
Les exportations de céréales ont pratiquement perdu toute importance réelle, provoquant d'extrêmes tensions dans la balance des paiements. Les céréales étant une ressource d'exportation importante, fournissant une part importante des devises étrangères, le programme d'importation de machines et d'équipements, et essentiellement le programme d'industrialisation, a été compromis.
Bien entendu, la réduction des achats de céréales par l'État a constitué une menace pour les projets de construction industrielle, a compliqué la situation économique, a aggravé conflits sociaux aussi bien en ville qu'à la campagne. Au début de 1928, la situation était devenue très compliquée et exigeait une approche équilibrée. Mais le groupe stalinien, qui venait d'obtenir la majorité dans la direction politique, n'a fait preuve ni d'un sens politique ni d'une compréhension des principes de Lénine en matière de politique envers la paysannerie en tant qu'alliée de la classe ouvrière dans la construction du socialisme. De plus, elle a décidé d'abandonner directement ces principes, d'abandonner la NEP et de recourir largement aux mesures d'urgence, c'est-à-dire à la violence contre la paysannerie. Le signé I.V. Staline a publié des directives menaçant les dirigeants du parti et exigeant « de remettre sur pied les organisations du parti, en leur faisant remarquer que la question des achats est l'affaire du parti tout entier », qu'« en Travaux pratiques dans le village, l'accent est désormais mis sur la lutte contre le danger koulak.
Les marchés ont commencé à être fermés, des perquisitions ont été effectuées dans les ménages paysans et les propriétaires non seulement de réserves spéculatives de céréales, mais aussi d'excédents très modérés dans les exploitations paysannes moyennes ont été traduits en justice. Les tribunaux prenaient automatiquement des décisions sur la confiscation des excédents de céréales commercialisables et des stocks nécessaires à la production et à la consommation. Le matériel était souvent confisqué. Les arrestations administratives et les emprisonnements prononcés par les tribunaux complètent le tableau de l'arbitraire et de la violence commis dans les campagnes au cours de l'hiver et du printemps 1928 et 1929. En 1929, jusqu'à 1 300 révoltes de « koulaks » furent enregistrées.
L'analyse de l'origine de la crise des approvisionnements en céréales et des moyens de la surmonter était au centre des plénums d'avril et de juillet du Comité central du Parti communiste de l'Union en 1928. Lors de ces plénums, des différences fondamentales dans les positions de Boukharine et Staline a révélé les solutions qu'il proposait aux problèmes qui se posaient. Les propositions de Boukharine et de ses partisans pour sortir de la situation créée par la crise de l'approvisionnement en céréales, sur la voie de la NEPA, en abandonnant les mesures « d'urgence », en maintenant le cap vers l'amélioration de l'économie paysanne et le développement des formes de coopération commerciale et de crédit, en augmentant prix du pain, etc.) ont été rejetés comme une concession koulak et une manifestation d'opportunisme de droite.
La position de Staline reflétait la tendance à une accélération inconsidérée de la collectivisation. Cette position était basée sur le mépris des sentiments des paysans, ignorant leur manque de préparation et leur réticence à abandonner leur propre petite agriculture. La justification « théorique » de l'accélération de la collectivisation était l'article de Staline « L'année du grand tournant », publié dans la Pravda le 7 novembre 1929. L'article déclarait qu'il y avait eu un changement d'humeur de la paysannerie en faveur du collectif. fermes et, sur cette base, se propose d'achever la collectivisation le plus rapidement possible. Staline a assuré avec optimisme que sur la base du système des fermes collectives, notre pays deviendrait en trois ans le pays le plus producteur de céréales au monde, et en décembre 1929, Staline s'est adressé aux agraires marxistes en appelant à créer des fermes collectives et à éliminer les koulaks. en tant que classe, ne pas admettre les koulaks dans les fermes collectives et les déposséder, ce qui fait partie intégrante de la construction des fermes collectives. En ce qui concerne la production agricole, les prévisions de Staline ne ressemblent plus à une exagération, mais à un fantasme arbitraire, à des rêves qui ignorent complètement les lois de l'économie agricole, relations sociales villages et psychologie sociale de la paysannerie. Trois ans plus tard, alors que l’échéance pour tenir les promesses de Staline concernant la transformation de l’URSS en la puissance la plus productrice de céréales approchait, la famine faisait rage dans le pays, faisant des millions de morts. Nous ne sommes pas devenus le pays le plus producteur de céréales, ou du moins l’un des pays les plus producteurs de céréales au monde, ni dix ans plus tard – avant la guerre, ni 25 ans plus tard – à la fin du règne de Staline.
L'étape suivante vers l'intensification de la course au « taux de collectivisation » a été franchie lors du plénum de novembre du Comité central du Parti communiste de toute l'Union de la même année 1929. La tâche d'une « collectivisation complète » était déjà fixée « pour les régions individuelles ». .» Les messages des membres du Comité central et les signaux des localités concernant la précipitation et la coercition dans l'organisation des fermes collectives n'ont pas été pris en compte. Les recommandations de la Commission du Politburo du Comité central du Parti communiste de toute l'Union sur les questions de collectivisation ont tenté d'introduire des éléments de raison et de compréhension de la situation actuelle. Le projet de résolution qu'elle a élaboré propose de résoudre le problème de la collectivisation de « la grande majorité des exploitations paysannes » au cours du premier plan quinquennal : dans les principales régions céréalières en deux à trois ans, dans la zone de consommation en trois à quatre ans. . La commission a recommandé que la principale forme de construction de fermes collectives soit considérée comme un artel agricole, dans lequel « les principaux moyens de production (la terre, les outils, les ouvriers, ainsi que le bétail productif commercialisable) sont collectivisés, tout en maintenant, sous ces conditions, la propriété privée par le paysan de petits outils, de petit bétail, de vaches laitières, etc., lorsqu'ils répondent aux besoins de consommation de la famille paysanne.
Le 5 janvier 1930, le Comité central du Parti communiste de toute l'Union adopta une résolution « Sur le rythme de la collectivisation et les mesures d'aide de l'État à la construction de fermes collectives ». Comme proposé par la commission, les régions céréalières ont été divisées en deux zones en fonction de l'achèvement de la collectivisation. Mais Staline a apporté ses propres amendements et les délais ont été fortement réduits. Le Caucase du Nord, la Basse et la Moyenne Volga étaient censés achever la collectivisation « à l'automne 1930 ou, en tout cas, au printemps 1931 », et le reste des régions céréalières - « à l'automne 1931 ou, en en tout cas, au printemps 1932. » (voir tableau n° 1).
Tableau N°1
Un délai aussi court et la reconnaissance de la « concurrence socialiste dans l'organisation des kolkhozes » étaient en totale contradiction avec l'instruction sur l'inadmissibilité de « toute sorte de « décret » venant d'en haut du mouvement kolkhozien ». Bien que la résolution qualifie l'artel de forme la plus courante de fermes collectives, elle n'était qu'une transition vers la commune. Les dispositions sur le degré de socialisation du bétail et du matériel, sur la procédure de constitution des fonds indivisibles, etc. ont été exclues. À la suite du traitement de Staline, la disposition a été exclue du projet de résolution selon laquelle le succès de la collectivisation serait évalué par le Comité central non seulement par le nombre de fermes réunies en coopératives, « mais principalement sur la base de la mesure dans laquelle une région particulière pourra, sur la base d'une organisation collective des moyens de production et du travail, étendre réellement la superficie cultivée, augmenter les rendements des cultures et augmenter la production animale. Cela a créé des conditions favorables à la course à la « couverture à cent pour cent » au lieu de faire de la collectivisation un moyen d’accroître l’efficacité de la production agricole.
Sous une forte pression d'en haut, non seulement dans les régions céréalières avancées, mais aussi dans le centre de Tchernozem, dans la région de Moscou et même dans les républiques de l'Est, des décisions furent prises pour achever la collectivisation « lors de la campagne des semailles du printemps 1930 ». » Le travail d'explication et d'organisation parmi les masses a été remplacé par des pressions brutales, des menaces, des promesses démagogiques.
Ainsi, la création de fermes collectives et la dépossession sur la base d'une collectivisation complète ont été proclamées. Les critères de classification d'une ferme comme ferme koulak étaient définis de manière si large que les grandes exploitations et même les paysans pauvres pouvaient y être inclus. Cela a permis aux autorités d'utiliser la menace de dépossession comme principal levier pour créer des fermes collectives, organisant la pression des couches déclassées du village sur le reste de celui-ci. La dépossession était censée démontrer aux plus inflexibles l'inflexibilité des autorités et la futilité de toute résistance. La résistance des koulaks, ainsi que d'une partie des paysans moyens et des pauvres, à la collectivisation fut brisée par les mesures de violence les plus sévères. On ne sait pas encore combien de personnes sont mortes du côté des « dépossédés », à la fois dans le processus de dépossession lui-même et à la suite de l'expulsion vers des zones inhabitées.
Les sources historiques fournissent des données différentes sur le nombre d'exploitations agricoles dépossédées et expulsées. Les données suivantes sont citées : à la fin de 1930, environ 400 000 fermes ont été dépossédées (c'est-à-dire environ la moitié des fermes koulaks), dont environ 78 000 ont été expulsées vers certaines régions, selon d'autres données - 115 000. Bien que Le 30 mars 1930, le Politburo du Comité central du Parti communiste de toute l'Union du Parti communiste russe a adopté une résolution visant à mettre fin à l'expulsion massive des koulaks des zones de collectivisation totale et a ordonné qu'elle ne soit effectuée que sur une base individuelle ; le le nombre de ménages expulsés en 1931 a plus que doublé - pour atteindre près de 266 000.
Les dépossédés ont été divisés en trois catégories. Le premier comprenait des « activistes contre-révolutionnaires » - des participants à des manifestations antisoviétiques et anti-fermes collectives (ils ont eux-mêmes été arrêtés et jugés, et leurs familles ont été expulsées vers des régions reculées du pays). Le deuxième groupe comprend « de grands koulaks et d’anciens semi-propriétaires qui se sont activement opposés à la collectivisation » (ils ont été expulsés avec leurs familles vers des zones reculées). Et enfin, le troisième - «le reste des koulaks» (ils ont été réinstallés dans des colonies spéciales situées dans les zones de leur résidence précédente). L'établissement des listes de poings de la première catégorie a été réalisé exclusivement par le département local du GPU. Des listes de koulaks des deuxième et troisième catégories étaient dressées localement, en tenant compte des « recommandations » des militants villageois et des organisations de ruraux pauvres, ce qui ouvrait la porte à toutes sortes d'abus et à des règlements de comptes anciens. Qui doit être classé parmi les koulaks ? Poing de la « deuxième » ou de la « troisième » catégorie ? Les critères antérieurs, que les idéologues du parti et les économistes avaient travaillé à développer au cours des années précédentes, ne convenaient plus. Pendant année précédente il y avait un appauvrissement important des koulaks en raison de l'augmentation constante des impôts. L'absence de manifestations extérieures de richesse a incité les commissions à se tourner vers les listes d'impôts conservées dans les conseils de village, souvent périmées et inexactes, ainsi que vers les informations de l'OGPU et les dénonciations.
En conséquence, des dizaines de milliers de paysans moyens ont été dépossédés. Dans certaines régions, entre 80 et 90 % des paysans moyens ont été condamnés comme « membres des subkoulaks ». Leur principal défaut était de s’éloigner de la collectivisation. La résistance en Ukraine, dans le Caucase du Nord et dans le Don (même des troupes y furent envoyées) était plus active que dans les petits villages de la Russie centrale.
Les koulaks et les paysans moyens expulsés, qui n'étaient pas des criminels (du moins les membres de leur famille ne l'étaient pas), ont été soumis à des sanctions pénales - la déportation - de manière extrajudiciaire. Ce fut la première vague de répression massive illégale. Les exilés, bien qu'une grande partie d'entre eux aient été envoyés dans des zones inhabitées et souvent jetés à la merci du sort, recevaient néanmoins, en règle générale, un prêt de démarrage (reconnu plus tard comme gratuit) et d'autres fonds pour leur établissement. De plus, ils ont été envoyés à des travaux assez durs où il n'y avait pas assez de mains - à l'exploitation forestière, à l'extraction de tourbe, aux mines, aux mines, aux travaux de construction.
Si nous abordons la question de la dépossession d’un point de vue purement économique, en laissant de côté pour l’instant les problèmes sociaux, juridiques, politiques et moraux, nous pouvons alors immédiatement prêter attention à deux points.
La dépossession signifiait l'éloignement du village d'un élément qui, bien que contenant un potentiel capitaliste, possédait les compétences de gestion culturelle. Même jetés dans des zones reculées, difficiles et inhabitées, d'anciens colons spéciaux ont pu créer des fermes collectives dans un délai étonnamment court, ce qui s'est avéré avancé. Parmi eux sont venus des leaders talentueux de la production collective.
Le montant des dépenses liées à l'expulsion et à la réinstallation des koulaks expulsés était à peine couvert par les biens qui leur avaient été confisqués.
On aurait tort de nier la présence dans les campagnes de cette époque de partisans de la collectivisation, de véritables passionnés, combattants des kolkhozes. Ils étaient représentés par les pauvres et une partie de la classe moyenne. Sans leur soutien actif, ni la collectivisation ni la liquidation des koulaks n’auraient été tout simplement impossibles. Mais même le plus fervent partisan de l'agriculture collective ne pouvait pas comprendre et accepter la violence bureaucratique généralisée qui a fait irruption dans le village au cours de l'hiver 1929/30.
Dans son article « Le vertige du succès », paru dans la Pravda du 2 mars 1930, Staline condamnait de nombreux cas de violation du principe du volontariat dans l'organisation des kolkhozes, « décret bureaucratique du mouvement des kolkhozes ». Il a critiqué le « zèle » excessif en matière de dépossession, dont de nombreux paysans moyens ont été victimes. Le petit bétail, la volaille, le matériel, les bâtiments étaient souvent soumis à une socialisation. Il fallait arrêter ce « vertige du succès » et mettre fin aux « fermes collectives de papier, qui n'existent pas encore dans la réalité, mais dont on ignore l'existence ». sont un tas de résolutions vantardes. Cependant, l'article ne comportait absolument aucune autocritique et toute la responsabilité des erreurs commises incombait aux dirigeants locaux. La question d’une révision du principe même de la collectivisation ne se pose nullement. L'effet de cet article, suivi par la résolution du Comité central du 14 mars « Sur la lutte contre la distorsion de la ligne de parti dans le mouvement kolkhozien », a eu un impact immédiat. Alors que les cadres locaux du parti étaient dans le désarroi complet, un exode massif des paysans des fermes collectives a commencé (5 millions de personnes rien qu'en mars).
Les résultats de la première étape de collectivisation complète exigeaient une analyse véridique, tirant les leçons des « excès » et de la « lutte contre les excès », renforçant et développant les fermes collectives qui survivraient dans des conditions de véritable liberté de choix pour le paysan. Cela signifie surmonter complètement les conséquences du « grand tournant » du style stalinien, en choisissant les voies de la transformation socialiste de l’agriculture fondées sur la restauration des principes de la NEPA et de toute la diversité des formes de coopération.
Bien sûr, des ajustements ont été apportés, du moins dans un premier temps. Les leviers économiques ont commencé à être utilisés plus activement. Les principales forces du parti, de l'État et des organisations publiques ont continué à se concentrer sur la résolution des problèmes de collectivisation. L'ampleur de la reconstruction technique dans l'agriculture s'est accrue, principalement grâce à la création de machines d'État et de stations de tracteurs. Le niveau de mécanisation du travail agricole a considérablement augmenté. En 1930, l'État apporta une grande aide aux fermes collectives ; elles bénéficièrent d'importants avantages fiscaux. Mais pour les agriculteurs individuels, les taux d'imposition agricoles ont été augmentés et des taxes uniques n'ont été introduites que pour eux. Le volume des marchés publics a également augmenté et ils sont devenus obligatoires. Tous ces changements, même favorables, ne donnent pas une idée de l'essence des changements dans la paysannerie elle-même.
Ayant succombé aux appels à adhérer aux fermes collectives et à socialiser les moyens de production, elle s'est en fait trompée, puisqu'elle s'est aliénée des moyens de production et a perdu tous ses droits sur ceux-ci. Un coup dur a été porté au sentiment de propriété des paysans, puisque les paysans ont été privés du droit de disposer des résultats de leur travail - produits manufacturés, dont le sort a commencé à être décidé par le parti local et les autorités soviétiques. Le kolkhozien a même perdu le droit de décider de manière indépendante où il souhaite vivre et travailler, ce qui nécessite l'autorisation des autorités. Les fermes collectives elles-mêmes, ayant perdu la plupart des propriétés d'un artel agricole, se sont transformées en une entreprise unique subordonnée aux autorités locales et au parti.
À la fin de l'été 1931. les approvisionnements en céréales ont commencé à faiblir : les recettes céréalières ont diminué. En raison du système de passation des marchés publics en vigueur, le spectre de la famine planait sur plusieurs régions du pays. Les problèmes sont survenus parce que le pain a été confisqué de force et, en fait, « sous la moustache », dans les fermes collectives et les fermes individuelles afin de remplir les tâches irréalistes de développement industriel arbitrairement établies par la direction stalinienne en 1930.
Il fallait de la monnaie pour acheter du matériel industriel. On ne pouvait l'obtenir qu'en échange de pain. Entre-temps, une crise a éclaté dans l’économie mondiale et les prix des céréales ont fortement chuté. Cependant, les dirigeants staliniens n’ont même pas pensé à réviser l’objectif d’un « bond » industriel insoutenable pour le pays. Les exportations de céréales à l'étranger augmentaient. Malgré les mauvaises récoltes dans les principales régions céréalières du pays, qui ont souffert de la sécheresse, une quantité record de céréales a été retirée lors des achats de céréales (22,8 millions de tonnes), dont 5 millions ont été exportées en échange de matériel (de 1931 à 1936, la moitié de tout l'équipement importé en URSS était origine allemande). La confiscation forcée d'un tiers (et dans certaines fermes collectives jusqu'à 80 %) de la récolte ne pouvait que perturber complètement le cycle de production. Il convient de rappeler que dans le cadre de la NEP, les paysans ne vendaient que 15 à 20 % de la récolte, laissant 12 à 15 % pour les semences, 25 à 30 % pour l'alimentation du bétail et les 30 à 35 % restants pour leur propre consommation.
À l'été 1931, une règle fut établie selon laquelle les salaires en nature dans les fermes collectives dépassaient une certaine norme les produits n'étaient pas achetés, mais payés en argent. Cela équivalait essentiellement à l'introduction de vivres rationnés pour les kolkhoziens, surtout compte tenu des difficultés financières de nombreuses exploitations agricoles qui n'étaient pas en mesure d'effectuer des paiements en espèces notables. En raison de la situation actuelle, au cours de l'automne et de l'hiver 1931/32, il y eut un deuxième exode des paysans des fermes collectives. La transition inorganisée des résidents ruraux vers l'industrie et la construction s'est fortement intensifiée. En 1932, le système de passeport, aboli par la révolution, a été introduit, qui a établi un contrôle administratif strict sur le mouvement de la main-d'œuvre dans les villes, et en particulier des villages vers les villes, transformant le collectif en les agriculteurs dans une population sans passeport.
Dans les fermes collectives, qui se trouvaient dans un environnement de difficultés alimentaires extrêmes et n'étaient absolument pas intéressées économiquement par la vente de céréales, les tentatives de résoudre elles-mêmes le problème alimentaire par tous les moyens, y compris illégaux, se sont généralisées. Les cas de vol de céréales, de dissimulation à la comptabilité, de battage volontairement incomplet, de dissimulation, etc. se sont généralisés. Des tentatives ont été faites pour distribuer du pain à l'avance pour les jours de travail, pour le dépenser comme dépenses pour la restauration publique pendant la récolte.
Il a été décidé d'augmenter le faible taux d'approvisionnement en céréales dans les zones les plus touchées par la sécheresse en recourant à la répression. Ils ont recherché les « organisateurs du sabotage » des achats de céréales et les ont traduits en justice. Dans les zones qui ne pouvaient pas faire face aux achats, la livraison de toutes les marchandises a été complètement interrompue. Les fermes collectives en retard ont été inscrites sur un « tableau noir », leurs prêts ont été recouvrés plus tôt que prévu et leur composition a été purgée. Cela a encore fragilisé la situation économique déjà difficile de ces exploitations. De nombreux kolkhoziens ont été arrêtés et expulsés. Pour réaliser le plan, toutes les céréales sans exception ont été exportées, y compris les semences, le fourrage et distribuées pour les jours ouvrables. Les fermes collectives et d'État qui remplissaient le plan étaient soumises à des missions répétées pour la livraison de céréales.
À l'été 1932 Le village de la ceinture céréalière de la Russie et de l’Ukraine, après un hiver à moitié affamé, en est ressorti physiquement affaibli. 7 août 1932 La loi sur la protection de la propriété socialiste, rédigée par Staline lui-même, est adoptée. Il a introduit « la peine de mort pour le vol des biens des fermes collectives et des coopératives comme mesure de répression judiciaire ». protection sociale- exécution avec confiscation de tous les biens et, dans des circonstances atténuantes, remplacement par une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans avec confiscation de tous les biens. " L'amnistie pour des cas de ce genre était interdite. Conformément à la loi du 7 août, des dizaines Des milliers de kolkhoziens ont été arrêtés pour avoir coupé sans autorisation un petit nombre d'épis de seigle ou de blé. Le résultat de ces actions a été une terrible famine, qui a tué 4 à 5 millions de personnes, principalement en Ukraine. La famine de masse a conduit à une troisième vague de fuite des fermes collectives. Il y a eu des cas d'extinction de villages entiers.
La tragédie kazakhe occupe une place particulière parmi les crimes commis par les dirigeants staliniens contre le peuple. Dans les régions céréalières du Kazakhstan, la situation était la même que dans les autres régions mentionnées ci-dessus : la confiscation forcée des céréales tant dans les fermes collectives que dans les fermes individuelles a condamné plusieurs milliers de personnes à la famine. Le taux de mortalité était particulièrement élevé dans les colonies de colons spéciaux de la région de Karaganda. Les familles dépossédées amenées ici pour développer le bassin houiller n'avaient ni équipement ménager, ni nourriture, ni logement décent.
La course inconsidérée aux taux de collectivisation, comme nous l’avons déjà mentionné, a eu partout des conséquences désastreuses. Mais dans les régions où les formes d’économie sont les plus arriérées, elles ont acquis un caractère carrément destructeur. Une telle catastrophe a frappé les zones d'élevage nomade du Kazakhstan et de plusieurs autres républiques et régions.
Les conséquences de l'arbitraire administratif furent particulièrement désastreuses, non seulement dans la culture céréalière, mais dans l'élevage. Depuis 1931 Les dirigeants de Staline ont commencé à se procurer de la viande en utilisant les mêmes méthodes que celles utilisées pour l'approvisionnement en céréales. De la même manière, des « tâches planifiées » qui ne correspondaient pas aux capacités réelles ont été lancées, qui ont été « éliminées » sans pitié. Il en résulte une dégradation de l’élevage et une détérioration des conditions de vie des populations. Les dégâts causés à la production animale ont entravé le développement de l’agriculture pendant des décennies. La restauration du cheptel au niveau de la fin des années 20 n'a eu lieu que dans les années 50.
Échecs de la politique économique 1929-1932 dans le village ont été l'une des principales raisons de l'échec des tentatives visant à mettre en œuvre le premier plan quinquennal plus tôt que prévu. La principale raison de la dégradation de la production agricole en 1929-1932 n'était même pas les excès lors de certaines campagnes de masse, mais l'approche administrative et bureaucratique générale de l'établissement de relations économiques avec l'agriculture. Les excès étaient finalement une conséquence inévitable de cette approche de l’économie rurale. L’essentiel était que la collectivisation n’ait pas créé un système de coopérateurs civilisés à la campagne. La ferme collective des années 1930, dans ses caractéristiques les plus essentielles, n'était pas une ferme coopérative.
Les caractéristiques d'une coopérative (et alors souvent formellement) ont été conservées principalement dans l'organisation interne du kolkhoz, par exemple, la présence d'une assemblée générale des kolkhoziens, la possibilité de quitter le kolkhoz ainsi que certains moyens de production, régulation de l'ordre et du niveau des salaires, etc. Mais la ferme collective en tant qu'unité de production n'avait pratiquement pas l'indépendance économique caractéristique des entreprises coopératives. De plus, il n'a pas perdu cette indépendance en tant que maillon subordonné d'un système coopératif plus large qui régulerait et planifierait l'offre et la vente, la transformation des produits agricoles, le financement, les services agronomiques et techniques des machines. La ferme collective s'est avérée être intégrée à la hiérarchie administrative rigide de la planification étatique de la production et de l'approvisionnement en produits agricoles, ce qui a pratiquement transformé la propriété coopérative en une fiction.
Dans le système administratif existant, les fermes collectives se trouvaient coincées dans un étau bureaucratique beaucoup plus serré que les entreprises d'État. Ces dernières étaient au moins formellement autonomes et fonctionnaient dans des conditions d'autosuffisance, tandis que celles qui étaient planifiées et non rentables utilisaient des subventions gouvernementales. Il n'y avait et ne pouvait rien y avoir de tel dans le mécanisme économique existant, même pour les fermes collectives les plus avancées et les plus performantes.
Une partie de la production agricole collective - le secteur socialisé - était entièrement dédiée à répondre aux besoins de l'approvisionnement centralisé de l'État en produits agricoles. Les livraisons de produits du secteur socialisé s'effectuaient sur la base de saisies quasi gratuites, car les prix d'achat des céréales, qui restaient approximativement au niveau de 1929 et couvraient alors à peine les coûts de production, se révélèrent fictifs dans les années 30 en raison à l'augmentation considérable du coût de la production céréalière. Il est impossible d'établir exactement l'ampleur de l'écart entre les prix et les coûts de production, puisque le calcul des coûts de production dans les fermes collectives n'a pas été effectué depuis le début des années 30, c'est-à-dire Peu importe combien les céréales coûtaient à la ferme collective, l’essentiel était qu’il livrait tout ce qu’il était censé faire. Dans le plan de production de la ferme collective, ils étaient principalement indicateurs naturels, en termes financiers, bien sûr, monétaires, mais ce plan ne contenait pas d'évaluation d'une partie importante des produits de la ferme collective et des coûts de sa production.
Des estimations approximatives, y compris des comparaisons avec le niveau des coûts de production des fermes d'État, montrent que les coûts dépassaient d'environ 2 à 3 fois les prix d'achat des céréales. Le rapport prix-coût était encore pire pour les produits de l’élevage. Dans le même temps, les prix d'achat des cultures industrielles étaient économiquement justifiés, contraints par une pénurie presque catastrophique de matières premières.
Ces circonstances nous ont obligés à prendre des mesures d'urgence pour améliorer les conditions économiques des producteurs de cultures industrielles afin d'éviter la menace de fermeture de l'industrie légère. Pour les producteurs de céréales, de pommes de terre, de légumes, de viande et de produits laitiers, la production est restée évidemment non rentable.
Le processus de production dans les fermes collectives a été soutenu de différentes manières. Certaines fermes collectives, obligées de payer pour la fourniture des moyens de production, de créer des fonds de semences et de fourrage, ont couvert les coûts de production en réduisant fortement les salaires des kolkhoziens. La source de couverture des pertes était donc une partie du produit nécessaire fabriqué dans l’économie socialisée. La planification des achats a placé certaines exploitations agricoles dans des conditions particulièrement préférentielles, ce qui a permis de réaliser pleinement les plans de livraison de céréales et d'autres produits, leur laissant entre les mains des fonds naturels assez importants. En règle générale, c'est à partir de ces fermes qui ne donnaient que des excédents de produits à l'État que les fermes collectives ont progressé avec haut niveau salaires. Certaines exploitations ont reçu une aide financière, technique, semencière et fourragère gratuite de l’État.
Mais le secteur public des fermes collectives ne pouvait pas assurer la reproduction de la main-d'œuvre. Il n'existe pas de chiffres précis à ce sujet, mais les kolkhoziens tiraient pas moins de 60 % de leurs revenus de parcelles subsidiaires personnelles, bien qu'ils soient soumis aux impôts et aux apports en nature. Ainsi, l'économie de la ferme collective a acquis une ressemblance suspecte avec certaines caractéristiques d'un domaine féodal. Le travail des kolkhoziens a acquis une division claire : dans une ferme publique, un kolkhozien travaille pour l'État presque gratuitement ; dans une ferme privée, un kolkhozien travaille pour lui-même. Ainsi, la propriété sociale, non seulement dans l’esprit du kolkhozien, mais aussi dans la réalité, s’est transformée pour lui en la propriété « d’État » de quelqu’un d’autre. Le système d’arbitraire bureaucratique dans la gestion agricole a triomphé. Ce système a donné lieu à des moments de dégradation de l'agriculture de l'URSS et à une détérioration de l'approvisionnement alimentaire de la population, tant en ville qu'à la campagne.
Le début du deuxième plan quinquennal a été extrêmement difficile pour l'agriculture. Surmonter la situation de crise a demandé énormément d’efforts et de temps. La restauration de la production agricole a commencé entre 1935 et 1937. Les récoltes ont commencé à augmenter, le cheptel a repris sa croissance et les salaires ont augmenté. Les résultats du rééquipement technique de l'agriculture ont également eu un impact. En 1937 le système de stations de machines et de tracteurs (MTS) desservait les neuf dixièmes des fermes collectives. Toutefois, l’augmentation de la production au cours de ces trois années n’a pas compensé les pertes des deux premières années. Selon le décret du 19 janvier 1933, les marchés publics sont devenus une taxe obligatoire prélevée par l'État et non soumise à révision par les collectivités locales. Mais en réalité, sans réduire le montant des cotisations à l'État, le décret n'a fait qu'aggraver le sort des paysans. En plus de la taxe, les kolkhoziens étaient obligés de payer en nature les services qui leur étaient fournis par l'intermédiaire de MTS. Cette collecte très importante assurait au moins 50 % des achats de céréales dans les années 1930. De plus, l'État assumait entièrement le contrôle de la taille des superficies ensemencées et des récoltes dans les fermes collectives, malgré le fait que, comme le supposait leur charte, elles n'étaient subordonnées qu'à l'assemblée générale des kolkhoziens. Le montant de l'impôt de l'État a été déterminé en fonction du résultat souhaité et non sur la base de données objectives.
Enfin, afin de combler toute lacune par laquelle les produits pourraient échapper au contrôle de l'État, un décret fut publié en mars 1933 selon lequel, jusqu'à ce que la région respecte le plan d'approvisionnement en céréales, 90 % des céréales battues étaient remises à l'État et le Les 10 % restants sont répartis entre les kolkhoziens à titre d'avance pour le travail. L'ouverture des marchés agricoles collectifs, légalisée à l'été 1932 afin d'atténuer la situation alimentaire catastrophique dans les villes, dépendait également de la capacité des fermes collectives de la région à réaliser le plan.
Quant à la collectivisation des exploitations paysannes individuelles, qui étaient au nombre d'environ 9 millions au début du deuxième plan quinquennal, les événements de 1932-1933. il a en fait été suspendu. Les opinions se répandaient au sein du parti quant à la nécessité d’une révision sérieuse. Des recommandations ont notamment été formulées sur l'extension des parcelles subsidiaires personnelles des kolkhoziens et sur la stimulation des exploitations agricoles individuelles.
Mais le 2 juillet 1934, une réunion sur les questions de collectivisation eut lieu au Comité central du Parti communiste de toute l'Union, au cours de laquelle Staline prononça un discours. Il annonça le début d'une nouvelle et dernière étape de collectivisation. Il a été proposé de lancer une « offensive » contre l’agriculteur individuel en augmentant la pression fiscale, en limitant l’utilisation des terres, etc. En août-septembre 1934 Les taux d'imposition agricole pour les agriculteurs individuels ont été augmentés et, en outre, une taxe unique a été introduite pour eux, et les normes de livraison obligatoire de produits à l'État ont été augmentées de 50 % par rapport aux agriculteurs collectifs. Pour les propriétaires privés, il n'y avait que trois moyens de sortir de cette situation : aller en ville, rejoindre une ferme collective ou devenir ouvrier salarié dans une ferme d'État. Lors du deuxième congrès des kolkhoziens (essentiellement des militants des kolkhozes), tenu en février 1935, Staline déclara fièrement que 98 % de toutes les terres cultivées du pays étaient déjà une propriété socialiste.
Aussi en 1935. l'État a confisqué plus de 45 % de tous les produits agricoles du village, soit trois fois plus qu'en 1928. La production céréalière a diminué, malgré l'augmentation des superficies ensemencées, de 15 % par rapport à au cours des dernières années PNÉ La production animale représentait à peine 60 % du niveau de 1928.
En cinq ans, l’État a réussi à mener une « brillante » opération d’extorsion de produits agricoles, en les achetant à des prix dérisoires. bas prix, couvrant à peine 20 % du coût. Cette opération s’est accompagnée d’un recours sans précédent à des mesures coercitives, qui ont contribué au renforcement du caractère bureaucratique du régime. La violence contre les paysans a permis d'affiner les méthodes de répression qui ont ensuite été appliquées à d'autres groupes sociaux. En réponse à la coercition, les paysans travaillaient de plus en plus mal, car la terre, par essence, ne leur appartenait pas.
L'État devait surveiller de près tous les processus de l'activité paysanne, qui à tout moment et dans tous les pays étaient menés avec beaucoup de succès par les paysans eux-mêmes : labourer, semer, récolter, battre, etc. Privées de tout droit, d'indépendance et de toute initiative, les fermes collectives étaient vouées à la stagnation. L’expérience historique montre que, sur la base des méthodes et des résultats des transformations socialistes, il n’était guère possible de choisir une pire option. La voie probable du village est la création volontaire par les paysans eux-mêmes de diverses formes d'organisation de la production, libres des diktats de l'État, construisant leurs relations avec l'État sur la base de relations égales, avec le soutien de l'État, en tenant compte les conditions du marché.
Le système de commandement et de bureaucratie de gestion des fermes collectives a survécu jusqu'à ce jour. Cela est en fait devenu un frein au développement de la production agricole collective et à la réalisation de son potentiel. Il faut aussi chercher une explication aux raisons pour lesquelles l'agriculture est en retard par rapport aux besoins du pays, ainsi qu'à la fuite des paysans des terres et à la désolation des villages. La reconnaissance de diverses organisations coopératives de fermiers et d'autres citoyens, des fermes paysannes individuelles et des parcelles subsidiaires personnelles comme formes de gestion égales, au même titre que les fermes collectives, les fermes d'État et les entreprises d'État de transformation, est d'une importance fondamentale. Libérés du contrôle bureaucratique, principalement de l'ingérence dans les activités de production et dans la gestion des produits, des revenus et des biens en général, ils seront en mesure d'utiliser de la manière la plus complète et la plus efficace toutes les forces et moyens disponibles pour stimuler l'agriculture et relancer les campagnes sur de nouvelles bases. . Une condition nécessaire formation nouveau système les relations professionnelles sont gratuites activité créative les masses, leur initiative dans la recherche de nouvelles formes de régulation économique.
Les premières tentatives de collectivisation ont été faites par le gouvernement soviétique immédiatement après la révolution. Cependant, à cette époque, il y avait des problèmes bien plus graves. La décision de procéder à la collectivisation en URSS a été prise lors du XVe Congrès du Parti en 1927. Les raisons de la collectivisation étaient avant tout :
- la nécessité d'investissements massifs dans l'industrie pour industrialiser le pays ;
- et la « crise de l’approvisionnement en céréales » à laquelle les autorités ont été confrontées à la fin des années 20.
La collectivisation des exploitations paysannes a commencé en 1929. Au cours de cette période, les impôts sur les exploitations individuelles ont été considérablement augmentés. Le processus de dépossession a commencé - privation de propriété et, souvent, déportation de paysans riches. Il y a eu un massacre massif de bétail - les paysans ne voulaient pas le donner aux fermes collectives. Les membres du Politburo qui s'opposaient aux pressions sévères exercées sur la paysannerie ont été accusés de déviation vers la droite.
Mais, selon Staline, le processus n’allait pas assez vite. Au cours de l'hiver 1930, le Comité exécutif central panrusse a décidé de procéder à la collectivisation complète de l'agriculture en URSS le plus rapidement possible, dans un délai d'un à deux ans. Les paysans ont été contraints de rejoindre des fermes collectives sous la menace d'être dépossédés. La saisie du pain du village provoqua une terrible famine en 1932-33. qui a éclaté dans de nombreuses régions de l'URSS. Durant cette période, selon des estimations minimales, 2,5 millions de personnes sont mortes.
En conséquence, la collectivisation a porté un coup dur à l’agriculture. La production céréalière a diminué, le nombre de vaches et de chevaux a diminué de plus de 2 fois. Seules les couches de paysans les plus pauvres ont bénéficié de la dépossession massive et de l’adhésion aux fermes collectives. La situation dans les zones rurales ne s'est quelque peu améliorée qu'au cours de la période du 2ème Plan quinquennal. La mise en œuvre de la collectivisation est devenue l'une des étapes importantes de l'approbation du nouveau régime.
La collectivisation en URSS : raisons, modalités de mise en œuvre, résultats de la collectivisation
Collectivisation de l'agriculture en URSS- est l'unification des petites exploitations paysannes individuelles en grandes exploitations collectives grâce à la coopération productive.
Crise d'approvisionnement en céréales de 1927-1928 les projets d’industrialisation menacés.
Le XVe Congrès du Parti communiste de toute l'Union a proclamé la collectivisation comme la tâche principale du parti dans les campagnes. La mise en œuvre de la politique de collectivisation s'est traduite par la création généralisée de fermes collectives, qui bénéficiaient d'avantages en matière de crédit, de fiscalité et de fourniture de machines agricoles.
Objectifs de la collectivisation :
- accroître les exportations de céréales pour assurer le financement de l'industrialisation ;
- mise en œuvre de transformations socialistes dans les campagnes ;
- assurer l'approvisionnement des villes en forte croissance.
Le rythme de la collectivisation :
- printemps 1931 - principales régions céréalières ;
- printemps 1932 - Région centrale de Tchernozem, Ukraine, Oural, Sibérie, Kazakhstan ;
- fin 1932 - autres régions.
Lors de la collectivisation de masse, les fermes koulaks ont été liquidées – dépossession. Les prêts ont été arrêtés et les impôts sur les ménages privés ont été augmentés, les lois sur la location de terres et l'embauche de main-d'œuvre ont été abolies. Il était interdit d'admettre les koulaks dans les fermes collectives.
Au printemps 1930, des manifestations contre les fermes collectives commencèrent. En mars 1930, Staline publia l'article Vertiges dus au succès, dans lequel il accusait les autorités locales de collectivisation forcée. La plupart des paysans ont quitté les fermes collectives. Cependant, dès l'automne 1930, les autorités reprirent la collectivisation forcée.
La collectivisation s'est achevée au milieu des années 30 : 1935 dans les fermes collectives - 62 % des exploitations, 1937 - 93 %.
Les conséquences de la collectivisation ont été extrêmement graves :
- réduction de la production brute de céréales et du cheptel ;
- la croissance des exportations de pain ;
- famine massive 1932 - 1933 dont plus de 5 millions de personnes sont mortes ;
- l'affaiblissement des incitations économiques au développement de la production agricole ;
- l'aliénation des paysans de la propriété et des résultats de leur travail.
Résultats de la collectivisation
J'ai déjà évoqué plus haut le rôle de la collectivisation complète et ses erreurs de calcul, ses excès et ses erreurs. Je vais maintenant résumer les résultats de la collectivisation :
1. Élimination des riches agriculteurs - koulaks avec partage de leurs biens entre l'État, les fermes collectives et les pauvres.
2. Débarrasser le village des contrastes sociaux, du striping, du cadastre, etc. La socialisation définitive d’une immense part de terres cultivées.

3. Commencer à doter l’économie rurale de fonds économie moderne et communications, accélérant l’électrification rurale
4. Destruction de l'industrie rurale - le secteur de la première transformation des matières premières et des aliments.
5. Restauration d'une communauté rurale archaïque et facile à gérer sous la forme de fermes collectives. Renforcer le contrôle politique et administratif sur la classe la plus nombreuse, la paysannerie.
6. La dévastation de nombreuses régions du Sud et de l’Est – la majeure partie de l’Ukraine, le Don et la Sibérie occidentale – lors de la lutte pour la collectivisation. Famine de 1932-1933 – « situation alimentaire critique ».
7. Stagnation de la productivité du travail. Déclin à long terme de l’élevage et aggravation du problème de la viande.
Les conséquences destructrices des premiers pas de la collectivisation ont été condamnées par Staline lui-même dans son article « Vertiges du succès », paru en mars 1930. Dans ce document, il condamne de manière déclarative la violation du principe du volontariat lors de l'inscription dans les fermes collectives. Cependant, même après la publication de son article, l'inscription dans les fermes collectives est restée pratiquement forcée.
Les conséquences de l’effondrement de la structure économique vieille de plusieurs siècles du village ont été extrêmement graves.
Les forces productives de l’agriculture furent minées pendant des années : en 1929-1932. le nombre de bovins et de chevaux a diminué d'un tiers, celui des porcs et des moutons de plus de moitié. La famine qui frappe le village affaibli en 1933 tué plus de cinq millions de personnes. Des millions de personnes dépossédées sont également mortes de froid, de faim et de surmenage.
Et en même temps, bon nombre des objectifs fixés par les bolcheviks ont été atteints. Malgré le fait que le nombre de paysans ait diminué d'un tiers et la production brute de céréales de 10 %, ses achats d'État en 1934 par rapport à 1928 doublé. L'indépendance vis-à-vis de l'importation de coton et d'autres matières premières agricoles importantes a été acquise.
En peu de temps, le secteur agricole, dominé par des éléments à petite échelle et mal contrôlés, s'est retrouvé en proie à une centralisation, une administration, des ordres stricts et s'est transformé en une composante organique d'une économie directive.
L’efficacité de la collectivisation a été mise à l’épreuve au cours de la Seconde Guerre mondiale, dont les événements ont révélé à la fois la puissance de l’économie d’État et ses vulnérabilités. L'absence d'importantes réserves alimentaires pendant la guerre était une conséquence de la collectivisation - l'extermination du bétail collectivisé par les agriculteurs individuels et l'absence de progrès dans la productivité du travail dans la plupart des fermes collectives. Pendant la guerre, l’État a été contraint d’accepter l’aide de l’étranger.
Dans le cadre de la première mesure, une quantité importante de farine, de conserves et de graisses est entrée dans le pays, principalement en provenance des États-Unis et du Canada ; la nourriture, comme d'autres biens, était fournie par les alliés sur l'insistance de l'URSS dans le cadre du prêt-bail, c'est-à-dire en fait, à crédit avec paiement après la guerre, à cause de laquelle le pays s'est retrouvé endetté pendant de nombreuses années.
Initialement, on supposait que la collectivisation de l'agriculture se ferait progressivement, à mesure que les paysans prendraient conscience des avantages de la coopération. Cependant, la crise des approvisionnements en céréales de 1927/28 ont montré que le maintien des relations marchandes entre ville et campagne dans le contexte d’une industrialisation en cours est problématique. La direction du parti était dominée par les partisans de l'abandon de la NEP.
Réaliser une collectivisation complète a permis de siphonner les fonds des campagnes pour les besoins de l'industrialisation. À l'automne 1929, les paysans commencèrent à être chassés de force dans les fermes collectives. La collectivisation complète s'est heurtée à la résistance des paysans, à la fois actifs sous forme de soulèvements et d'émeutes, et passifs, qui se sont exprimés dans la fuite des habitants du village et la réticence à travailler dans les fermes collectives.
La situation dans le village s'est tellement aggravée qu'au printemps 1930, les dirigeants furent contraints de prendre des mesures pour éliminer les « excès du mouvement kolkhozien », mais le cours vers la collectivisation se poursuivit. La collectivisation forcée a affecté les résultats de la production agricole. Les conséquences tragiques de la collectivisation incluent la famine de 1932.
Fondamentalement, la collectivisation a été achevée à la fin du premier plan quinquennal, lorsque son niveau a atteint 62 %. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 93 % des exploitations agricoles étaient collectivisées.
Développement économique de l'URSS en 1928-1940.
Au cours des années des premiers plans quinquennaux, l’URSS a réalisé une percée industrielle sans précédent. Le produit social brut a été multiplié par 4,5 et le revenu national par plus de 5. Le volume total de la production industrielle est 6,5 fois supérieur. Dans le même temps, on constate des disproportions notables dans le développement des industries des groupes A et B. La production agricole a en fait marqué le pas.
Ainsi, grâce à « l’offensive socialiste », au prix d’énormes efforts, des résultats significatifs ont été obtenus dans la transformation du pays en une puissance industrielle. Cela a contribué à accroître le rôle de l’URSS sur la scène internationale.
Sources : historykratko.com, zubolom.ru, www.bibliotekar.ru, ido-rags.ru, prezentacii.com

Basilic mortel
Le basilic est un énorme serpent, également connu sous le nom de « roi des serpents », qui vit des centaines d’années. Très fort...