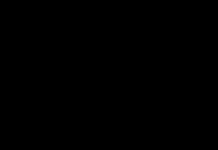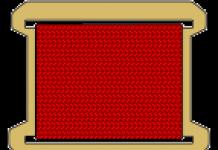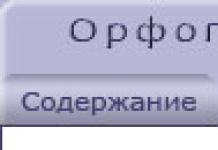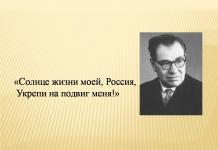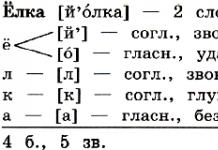Le livre présente de la manière la plus complète les réalisations classiques et les plus récentes des principales sections de la psychologie cognitive - perception, mémoire, pensée, intelligence artificielle. problèmes théoriques la psychologie cognitive et ses aspects appliqués. Le livre peut constituer un bon outil pédagogique pour les étudiants de diverses spécialités (à la fois humanitaires et techniques) liées à divers types d'activité humaine dans la technologie moderne, pour les psychologues, les professeurs de psychologie, d'ergonomie et psychologie de l'ingénieur, ainsi que pour les développeurs de logiciels et de systèmes informatiques dotés d'un comportement intelligent.
Chapitres/Paragraphes
Introduction à la psychologie cognitive
Psychologie cognitiveétudie comment les gens obtiennent des informations sur le monde, comment ces informations sont représentées par les humains, comment elles sont stockées en mémoire et converties en connaissances, et comment ces connaissances influencent notre attention et notre comportement. La psychologie cognitive couvre toute la gamme des processus psychologiques : de la sensation à la perception, en passant par la reconnaissance des formes, l'attention, l'apprentissage, la mémoire, la formation de concepts, la pensée, l'imagination, la mémorisation, le langage, l'émotion et les processus de développement ; il couvre tous les domaines de comportement possibles. Le cours que nous avons suivi – un cours visant à comprendre la nature de la pensée humaine – est à la fois ambitieux et passionnant. Puisque cela nécessite un très large éventail de connaissances, le champ des études sera vaste ; et puisque ce sujet implique d’examiner la pensée humaine sous de nouvelles perspectives, il est probable que votre vision de l’essence intellectuelle de l’homme changera radicalement.
Ce chapitre s'intitule « Introduction » ; cependant, dans un sens, tout ce livre est une introduction à la psychologie cognitive. Ce chapitre donne un aperçu de la psychologie cognitive, y compris un aperçu de son histoire et des théories qui expliquent comment la connaissance est représentée dans l'esprit humain.
Avant d’aborder certains aspects techniques de la psychologie cognitive, il sera utile de mieux comprendre les hypothèses que nous faisons lorsque nous traitons l’information. Pour illustrer la façon dont nous interprétons les informations visuelles, prenons un exemple d’événement courant : un conducteur demandant son chemin à un policier. Bien que participant ici processus cognitif cela peut paraître simple, mais en réalité ce n'est pas le cas.
L'épisode entier décrit n'aurait pas pris plus de deux minutes, mais la quantité d'informations perçues et analysées par ces deux personnes est tout simplement incroyable. Comment un psychologue devrait-il considérer un tel processus ? Une sortie est simplement dans le langage stimulus-réponse (S-R) : par exemple, un feu de circulation (stimulus) et un virage à gauche (réponse). Certains psychologues, en particulier les représentants de l'approche behavioriste traditionnelle, estiment que l'ensemble de la séquence d'événements peut être décrit de manière adéquate (et beaucoup plus détaillée) en ces termes. Cependant, bien que cette position soit séduisante par sa simplicité, elle ne parvient pas à décrire les systèmes cognitifs impliqués dans un tel échange d’informations. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier et d’analyser des composantes spécifiques du processus cognitif, puis de les intégrer dans un modèle cognitif plus large. C’est dans cette perspective que les psychologues cognitifs explorent les manifestations complexes du comportement humain. Quels éléments spécifiques un psychologue cognitif identifierait-il dans l’épisode ci-dessus, et comment les percevrait-il ? Nous pouvons commencer par quelques hypothèses sur les caractéristiques cognitives que possèdent le policier et le conducteur. Le côté gauche du tableau 1 répertorie les propositions pertinentes et le côté droit montre les sujets de psychologie cognitive associés à ces propositions.
Tableau 1
Performance cognitive proposée| Caractéristique | Thème en psychologie cognitive |
| Capacité à détecter et interpréter des stimuli sensoriels | Détection signaux sensoriels |
| Tendance à se concentrer sur certains stimuli sensoriels et à en ignorer d’autres | Attention |
| Connaissance détaillée caractéristiques physiques environnement | Connaissance |
| La capacité d'abstraire certains éléments d'un événement et de combiner ces éléments dans un plan bien structuré qui donne un sens à l'épisode entier | La reconnaissance de formes |
| Capacité à extraire le sens des lettres et des mots | Lecture et traitement des informations |
| Capacité à conserver de nouveaux événements et à les intégrer dans une séquence continue | Mémoire à court terme |
| La capacité de former une image d’une « carte cognitive » | Images mentales |
| Chaque participant comprend le rôle de l'autre | Pensée |
| Capacité à utiliser des « astuces mnémotechniques » pour rappeler des informations | Mnémoniques et mémoire |
| Tendance à stocker les informations linguistiques en termes généraux | Abstraction des énoncés vocaux |
| Capacité à résoudre des problèmes | Résolution de problème |
| Capacité générale à agir de manière significative | Intelligence humaine |
| Comprendre que la direction du mouvement peut être recodée avec précision dans un ensemble d’actions motrices complexes (conduire une voiture) | Langage/comportement moteur |
| La capacité de récupérer rapidement de la mémoire à long terme des informations spécifiques nécessaires à une application directe dans la situation actuelle | Memoire à long terme |
| Capacité à transmettre des événements observés dans la langue parlée | Retravailler la langue |
| Savoir que les objets ont des noms spécifiques | Mémoire sémantique |
| Ne pas agir parfaitement | Oubli et ingérence |
Approche informationnelle
Les dispositions ci-dessus peuvent être combinées dans un système plus vaste, ou modèle cognitif. Le modèle couramment utilisé par les psychologues cognitifs est appelé MODÈLE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION.
Dès le début de notre étude des modèles cognitifs, il est important de comprendre leurs limites. Les modèles cognitifs qui s'appuient sur le modèle de traitement de l'information sont des constructions heuristiques utilisées pour organiser le corpus de littérature existant, stimuler la poursuite des recherches, coordonner les efforts de recherche et faciliter la communication entre les scientifiques. Il existe une tendance à attribuer aux modèles une plus grande rigidité structurelle que ne peuvent l’étayer les preuves empiriques.
Le modèle de traitement de l'information est utile pour les tâches ci-dessus ; cependant, d'autres modèles ont été développés pour mieux refléter les progrès de la psychologie cognitive. Je vous présenterai des modèles alternatifs si nécessaire. Le modèle de traitement de l'information suggère que le processus cognitif peut être décomposé en un certain nombre d'étapes, chacune représentant une unité hypothétique comprenant un ensemble d'opérations uniques effectuées sur les informations d'entrée. On suppose qu'une réponse à un événement (par exemple, une réponse : « Oh, oui, je sais où se trouve cette exposition ») est le résultat d'une série de telles étapes et opérations (par exemple, la perception, l'encodage de l'information, la mémoire) récupération, formation de concepts, jugement et énoncés de formation). Chaque étape reçoit les informations de l'étape précédente, puis exécute les étapes appropriées. cette étape opérations. Étant donné que tous les composants du modèle de traitement de l'information sont liés d'une manière ou d'une autre à d'autres composants, il est difficile de déterminer avec précision Première étape; mais par commodité on peut considérer que toute cette séquence commence avec l'arrivée de stimuli externes.
Ces stimuli – les caractéristiques de l'environnement dans notre exemple – ne sont pas représentés directement dans l'esprit du policier, mais ils sont convertis en symboles significatifs, ce que certains spécialistes des sciences cognitives appellent des « représentations internes ». Au niveau le plus bas, l’énergie lumineuse (ou sonore) émanant d’un stimulus perçu est convertie en énergie neuronale, qui à son tour est traitée via les étapes hypothétiques décrites ci-dessus pour former une « représentation interne » de l’objet perçu. Le policier comprend cette représentation interne qui, combinée à d’autres informations contextuelles, permet de répondre à la question.
Le modèle de traitement de l’information a soulevé deux questions importantes qui ont suscité une controverse considérable parmi les psychologues cognitifs : Par quelles étapes passe l’information lors du traitement ? Et sous quelle forme l'information est présentée dans l'esprit humain? Bien qu’il n’y ait pas de réponse facile à ces questions, une grande partie de ce livre porte sur les deux, il est donc bon de les garder à l’esprit. Entre autres choses, les psychologues cognitifs ont tenté de répondre à ces questions en intégrant dans leurs recherches des méthodes et des théories de disciplines psychologiques spécifiques ; certains d’entre eux sont décrits ci-dessous.
Domaine de la psychologie cognitive
La psychologie cognitive contemporaine emprunte des théories et des méthodes à 10 grands domaines de recherche (Figure 1) : perception, reconnaissance de formes, attention, mémoire, imagination, langage, psychologie du développement, raisonnement et résolution de problèmes, intelligence humaine et intelligence artificielle ; Nous considérerons chacun d’eux séparément.

Riz. 1. Principales orientations de recherche en psychologie cognitive.
Perception
La branche de la psychologie directement concernée par la détection et l’interprétation des stimuli sensoriels est appelée psychologie perceptuelle. Grâce aux expériences sur la perception, nous connaissons bien la sensibilité corps humain aux signaux sensoriels et, plus important encore pour la psychologie cognitive, à la manière dont ces signaux sensoriels sont interprétés.
La description donnée au policier dans la scène de rue ci-dessus dépend largement de sa capacité à « voir » caractéristiques essentielles environnement. Mais la « vision » n’est pas une chose simple. Pour que les stimuli sensoriels soient perçus - dans notre cas, ils sont majoritairement visuels - ils doivent avoir une certaine ampleur : pour que le conducteur puisse effectuer la manœuvre décrite, ces signes doivent avoir une certaine intensité. De plus, la scène elle-même est en constante évolution. Au fur et à mesure que la position du conducteur change, de nouveaux panneaux apparaissent. Les caractéristiques individuelles revêtent une importance primordiale dans le processus de perception. Les panneaux varient en couleur, position, forme, etc. De nombreuses images changent constamment pendant la conduite, et afin de transformer leurs instructions en actions, le conducteur doit rapidement ajuster son comportement.
Des études expérimentales sur la perception ont permis d'identifier de nombreux éléments de ce processus ; Nous en rencontrerons quelques-uns dans le prochain chapitre. Mais la recherche sur la perception ne peut à elle seule expliquer de manière adéquate les actions attendues ; d'autres systèmes cognitifs tels que la reconnaissance des formes, l'attention et la mémoire sont également impliqués.
La reconnaissance de formes
Les stimuli environnementaux ne sont pas perçus comme des événements sensoriels uniques ; le plus souvent, ils sont perçus comme faisant partie d’un modèle plus vaste. Ce que nous ressentons (voir, entendre, sentir ou goûter) fait presque toujours partie d’un ensemble complexe de stimuli sensoriels. Ainsi, lorsqu'un policier dit à un automobiliste de « passer le passage à niveau en passant devant le lac... à côté de l'ancienne usine », ses propos décrivent des objets complexes (passage à niveau, lac, ancienne usine). À un moment donné, le policier décrit l'affiche et suppose que le conducteur est compétent. Mais réfléchissons au problème de la lecture. La lecture est un effort volontaire complexe dans lequel le lecteur doit construire un image mentale d'un ensemble de lignes et de courbes qui en elles-mêmes n'ont aucun sens. En organisant ces stimuli pour former des lettres et des mots, le lecteur peut alors en récupérer le sens dans sa mémoire. L’ensemble de ce processus, effectué chaque jour par des milliards de personnes, ne prend qu’une fraction de seconde et est tout simplement stupéfiant si l’on considère le nombre de systèmes neuroanatomiques et cognitifs impliqués.
Attention
Le policier et le conducteur sont confrontés à une multitude d’indices environnementaux. Si le conducteur y prêtait attention à tous (ou presque), il ne se rendrait certainement jamais à la quincaillerie. Bien que les humains soient des créatures qui collectent des informations, il est clair que, dans des conditions normales, nous sélectionnons très soigneusement la quantité et le type d’informations à prendre en compte. Notre capacité à traiter l’information est évidemment limitée à deux niveaux : sensoriel et cognitif. Si nous sommes exposés à trop d’indices sensoriels à la fois, nous risquons de devenir « surchargés » ; et si nous essayons de traiter trop d’événements en mémoire, une surcharge se produit également. La conséquence peut être un dysfonctionnement.
Dans notre exemple, le policier, comprenant intuitivement que s'il surcharge le système, le résultat en souffrira, ignore de nombreux signes que le conducteur remarquerait certainement. Et si l’illustration à côté du texte du dialogue est une représentation précise de la carte cognitive du conducteur, alors le conducteur est vraiment désespérément confus.
Mémoire
Un policier pourrait-il décrire la route sans utiliser sa mémoire ? Bien sûr que non; et cela est encore plus vrai de la mémoire que de la perception. Et en fait, mémoire et perception travaillent ensemble. Dans notre exemple, la réponse du policier était le résultat de deux types de mémoire. Le premier type de mémoire contient des informations temps limité– assez longtemps pour poursuivre une conversation. Ce système de mémoire stocke les informations pendant une courte période jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une nouvelle. La conversation entière aurait duré environ 120 secondes et il est peu probable que le policier et le conducteur en conservent tous les détails pour toujours. Cependant, ces détails ont été stockés en mémoire suffisamment longtemps pour que chacun puisse stocker la séquence d'éléments qui composent le dialogue, et Quelque partie ces informations pourraient être stockées dans leur mémoire permanente. Cette première étape de la mémoire est appelée mémoire à court terme (STM), et dans notre cas il s'agit d'un type spécial appelé mémoire de travail.
En revanche, une grande partie du contenu des réponses du policier provient de sa mémoire à long terme (LTM). La partie la plus évidente ici est sa connaissance de la langue. Il n'appelle pas le lac un citronnier, le site d'exposition un parc de pneus ou la rue un terrain de basket-ball ; il extrait des mots de son DVP et les utilise plus ou moins correctement. Il y a d'autres signes qui indiquent que Fiberboard était impliqué dans sa description : « ... rappelez-vous, ils avaient l'Expo 84. » Il était capable de reproduire en une fraction de seconde des informations sur un événement survenu il y a plusieurs années. Cette information ne provenait pas d’une expérience perceptuelle directe ; il était stocké dans des panneaux de fibres avec une somme énorme d'autres faits.
Cela signifie que les informations dont dispose le policier sont obtenues à partir de la perception, du KVP et du DVP. De plus, nous pouvons conclure qu'il était une personne réfléchie, puisque toutes ces informations étaient présentées par lui sous la forme d'un diagramme qui « avait du sens ».
Imagination
Pour répondre à cette question, le policier a construit une image mentale de l'environnement. Cette image mentale a pris la forme d'une carte cognitive : c'est-à-dire une sorte de représentation mentale de nombreux bâtiments, rues, panneaux routiers, feux de circulation, etc. Il a pu extraire des caractéristiques significatives de cette carte cognitive, les organiser dans une séquence significative et transformer ces images en informations linguistiques qui permettraient au conducteur de construire une carte cognitive similaire. Cette carte cognitive reconstruite donnerait alors au conducteur une image claire de la ville, qui pourrait ensuite se traduire par l'acte de conduire une voiture le long d'un itinéraire spécifique.<…>.
Langue
Pour répondre correctement à la question, le policier devait avoir une connaissance approfondie de la langue. Cela implique de connaître les noms corrects des points de repère et, tout aussi important, de connaître la syntaxe du langage - c'est-à-dire règles pour l'agencement des mots et les connexions entre eux. Il est important de reconnaître ici que les séquences verbales données ne satisfont peut-être pas le professeur de philologie pédant, mais en même temps elles véhiculent un message. Presque chaque phrase contient des règles grammaticales importantes. Le policier n'a pas dit : « ils sont au service économique » ; il a dit : « Eh bien, c’est dans leur département économique », et nous pouvons tous comprendre ce qu’il veut dire. En plus de construire des phrases grammaticalement correctes et de sélectionner les mots appropriés dans son vocabulaire, le policier devait coordonner les réponses motrices complexes nécessaires pour transmettre son message.
La psychologie du développement
Il s'agit d'un autre domaine de la psychologie cognitive qui a été étudié de manière assez intensive. Les théories et expériences récemment publiées en psychologie cognitive du développement ont considérablement élargi notre compréhension du développement des structures cognitives. Dans notre cas, nous ne pouvons que conclure que les locuteurs partagent une expérience de développement qui leur permet de (plus ou moins) se comprendre.<…>.
Réflexion et formation de concepts
Tout au long de notre épisode, le policier et le conducteur font preuve de capacité à réfléchir et à former des concepts. Lorsqu'on a demandé au policier comment se rendre à Pay-Pack, il a répondu après quelques étapes intermédiaires ; question du policier : « Savez-vous où se trouve le cirque ? montre que si le conducteur connaissait ce point de repère, il pourrait facilement être dirigé vers Pay-Pack. Mais comme il ne le savait pas, le policier a proposé un autre plan pour répondre à la question. De plus, le policier était apparemment confus lorsque le chauffeur lui a dit que l'University Motel possédait une magnifique bibliothèque. Les motels et les bibliothèques sont généralement des catégories incompatibles, et un policier qui en sait autant que vous pourrait demander : « De quel genre de motel s'agit-il ? Enfin, l'utilisation de certains mots (comme « passage à niveau », « ancienne usine », « clôture en fer ») indique qu'il s'est formé des concepts proches de ceux du conducteur.
Intelligence humaine
Le policier et le conducteur avaient des hypothèses sur leurs renseignements respectifs. Ces hypothèses incluaient, sans toutefois s'y limiter, la capacité de comprendre un langage ordinaire, de suivre des instructions, de traduire des descriptions verbales en actions et de se comporter selon les lois de sa culture.<…>.
Intelligence artificielle
Notre exemple n’a pas de lien direct avec l’informatique ; Cependant, un domaine spécialisé de l'informatique appelé Intelligence artificielle (IA), qui vise à modéliser les processus cognitifs humains, a eu un impact énorme sur le développement des sciences cognitives - d'autant plus que les programmes informatiques d'intelligence artificielle nécessitaient de connaître la manière dont nous traitons l'information. Sujet pertinent et assez passionnant<…>aborde la question de savoir si un « robot parfait » peut imiter le comportement humain. Imaginons, par exemple, une sorte de super-robot maîtrisant toutes les capacités humaines liées à la perception, à la mémoire, à la pensée et au langage. Comment répondrait-il à la question du chauffeur ? Si le robot était identique à la personne, alors ses réponses seraient identiques, mais imaginez la difficulté de développer un programme qui ferait une erreur - tout comme le policier ("vous tournez à gauche") - et ensuite, remarquant cette erreur , corrige ça lui plairait (« non, à droite »)<…>.
Renouveau de la psychologie cognitive
À partir de la fin des années 1950, les intérêts scientifiques se sont à nouveau concentrés sur l’attention, la mémoire, la reconnaissance de formes, l’imagerie, l’organisation sémantique, les processus linguistiques, la pensée et d’autres sujets « cognitifs » autrefois considérés comme inintéressants pour la psychologie expérimentale sous la pression du behaviorisme. Alors que les psychologues tournaient de plus en plus leur attention vers la psychologie cognitive, que de nouvelles revues et groupes scientifiques étaient organisés et que la psychologie cognitive renforçait encore sa position, il est devenu clair que cette branche de la psychologie était très différente de celle qui était en vogue dans les années 1930 et 1940. Parmi les facteurs les plus importants qui ont déterminé cette révolution néocognitive figurent les suivants :
L’« échec » du behaviorisme. Le behaviorisme, qui étudiait généralement les réactions externes aux stimuli, n’a pas réussi à expliquer la diversité du comportement humain. Ainsi, il est devenu évident que les processus mentaux internes indirectement liés aux stimuli immédiats influencent le comportement. Certains pensaient que ces processus internes pouvaient être identifiés et intégrés dans théorie générale psychologie cognitive.
L'émergence de la théorie de la communication. La théorie de la communication a inspiré des expériences en matière de détection de signaux, d'attention, de cybernétique et de théorie de l'information, c'est-à-dire dans des domaines essentiels à la psychologie cognitive.
Linguistique moderne. L'éventail des questions liées à la cognition comprenait de nouvelles approches du langage et des structures grammaticales.
Étude de la mémoire. La recherche sur l’apprentissage verbal et l’organisation sémantique a fourni une base solide aux théories de la mémoire, conduisant au développement de modèles de systèmes de mémoire et à l’émergence de modèles testables d’autres processus cognitifs.
Informatique et autres avancées technologiques. L'informatique et surtout l'une de ses branches - l'intelligence artificielle (IA) - nous ont obligés à reconsidérer les postulats de base concernant le traitement et le stockage de l'information en mémoire, ainsi que l'apprentissage des langues. De nouveaux dispositifs expérimentaux ont considérablement élargi les capacités des chercheurs.
Depuis premiers concepts représentation des connaissances et jusqu'à des recherches récentes, on pensait que les connaissances reposaient fortement sur les apports sensoriels. Ce thème nous est venu des philosophes grecs et des scientifiques de la Renaissance jusqu'aux psychologues cognitifs modernes. Mais les représentations internes du monde sont-elles identiques à ses propriétés physiques ? Il est de plus en plus évident que de nombreuses représentations internes de la réalité ne sont pas identiques à la réalité externe elle-même. ils ne sont pas isomorphes. Le travail de Tolman avec des animaux de laboratoire suggère que les informations sensorielles sont stockées sous forme de représentations abstraites.
Une approche un peu plus analytique du thème des cartes cognitives et des représentations internes a été adoptée par Norman et Rumelhart (1975). Dans le cadre d'une expérience, ils ont demandé aux résidents d'une résidence universitaire de dessiner un plan aérien de leur maison. Comme prévu, les étudiants ont pu identifier les éléments en relief des détails architecturaux : la disposition des pièces, les principaux équipements et les accessoires. Mais il y a aussi eu des omissions et de simples erreurs. Beaucoup ont représenté le balcon au ras de l’extérieur du bâtiment, même s’il en dépassait. À partir des erreurs détectées dans l’agencement d’un bâtiment, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la représentation interne de l’information par une personne. Norman et Rumelhart ont conclu :
« La représentation des informations en mémoire n’est pas une reproduction exacte de la vie réelle ; il s'agit en fait d'une combinaison d'informations, d'inférences et de reconstructions basées sur la connaissance des bâtiments et du monde en général. Il est important de noter que lorsque l’erreur a été signalée aux élèves, ils ont tous été très surpris de ce qu’ils avaient eux-mêmes dessiné.
Ces exemples nous ont présenté un principe important de la psychologie cognitive. Le plus évident est que nos idées sur le monde ne sont pas nécessairement identiques à son essence réelle. Bien entendu, la représentation de l’information est liée aux stimuli que reçoit notre appareil sensoriel, mais elle subit également des changements importants. Ces changements, ou modifications, sont évidemment liés à nos expériences passées, qui ont donné naissance à un réseau riche et complexe de nos connaissances. Ainsi, les informations entrantes sont abstraites (et dans une certaine mesure déformées) puis stockées dans le système de mémoire humaine. Ce point de vue ne nie pas que certains événements sensoriels sont directement analogues à leurs représentations internes, mais il suggère que les stimuli sensoriels peuvent subir, et subissent souvent, au cours du stockage, des abstractions et des modifications qui sont fonction des connaissances riches et étroitement liées précédemment. structuré.<…>.
Le problème de la manière dont la connaissance est représentée dans l’esprit humain est l’un des plus importants en psychologie cognitive. Dans cette section, nous abordons certaines questions directement liées à celui-ci. Des nombreux exemples déjà donnés et bien d'autres qui nous attendent, il s'ensuit clairement que notre représentation interne de la réalité présente certaines similitudes avec la réalité externe, mais lorsque nous abstrayons et transformons des informations, nous le faisons à la lumière de notre expérience antérieure.
Un scientifique peut choisir une métaphore qui lui convient pour construire ses concepts de la manière la plus élégante possible. Mais un autre chercheur pourrait prouver que ce modèle est incorrect et exiger qu’il soit révisé, voire abandonné. Parfois, un modèle peut être si utile comme cadre de travail que, même s’il est imparfait, il trouve un soutien. Par exemple, bien que la psychologie cognitive postule les deux types de mémoire décrits ci-dessus – à court terme et à long terme – il existe certaines preuves<…>qu’une telle dichotomie dénature le système de mémoire réel. Cependant, cette métaphore est très utile pour analyser les processus cognitifs. Lorsqu'un modèle perd sa pertinence en tant qu'outil analytique ou descriptif, il est tout simplement abandonné.<…>.
L'émergence de nouveaux concepts au cours d'observations ou d'expérimentations est l'un des indicateurs du développement de la science. Un scientifique ne change pas la nature - enfin, peut-être dans un sens limité - mais l'observation de la nature change les idées qu'il se fait à son sujet. Et nos idées sur la nature guident à leur tour nos observations ! Les modèles cognitifs, comme d'autres modèles de science conceptuelle, sont une conséquence des observations, mais dans une certaine mesure, ils sont aussi le facteur déterminant des observations. Cette question est liée au problème déjà évoqué : sous quelle forme l’observateur représente la connaissance. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreux cas où les informations contenues dans la représentation interne ne correspondent pas exactement à la réalité externe. Nos représentations perceptuelles internes peuvent déformer la réalité. La « méthode scientifique » et les instruments de précision sont un moyen d’examiner de plus près la réalité extérieure. En fait, des tentatives sont en cours pour représenter ce qui est observé dans la nature sous la forme de constructions cognitives qui seraient des représentations précises de la nature et en même temps compatibles avec le bon sens et la compréhension de l'observateur.<…>
La logique de la science conceptuelle peut être illustrée par l'exemple du développement des sciences naturelles. Il est généralement admis que la matière est constituée d'éléments qui existent indépendamment de leur observation directe par l'homme. Cependant, la façon dont ces éléments sont classés a un impact énorme sur la façon dont les scientifiques perçoivent le monde physique. Dans une classification, les « éléments » du monde sont divisés en catégories « terre », « air », « feu » et « eau ». Lorsque cette taxonomie alchimique archaïque a cédé la place à une vision plus critique, les éléments oxygène, carbone, hydrogène, sodium et or ont été « découverts » et il est devenu possible d'étudier les propriétés des éléments lorsqu'ils se combinent les uns avec les autres. Des centaines de lois différentes ont été découvertes concernant les propriétés des composés fabriqués à partir de ces éléments. Étant donné que les éléments se combinaient apparemment de manière ordonnée, l’idée est née que les éléments pourraient être disposés selon un motif spécifique qui donnerait un sens aux lois disparates de la chimie atomique. Le scientifique russe Dmitri Mendeleev a pris un jeu de cartes et y a écrit les noms et les poids atomiques de tous les éléments alors connus - un sur chacun. En disposant ces cartes de cette façon encore et encore, il a finalement abouti à un diagramme significatif, connu aujourd'hui sous le nom de tableau périodique des éléments.
La nature, y compris la nature cognitive humaine, existe objectivement. La science conceptuelle est construite par l’homme et pour l’homme. Les concepts et modèles construits par les scientifiques sont des métaphores qui reflètent la nature « réelle » de l’univers et sont exclusivement des créations humaines. Ils sont le produit d’une pensée qui peut refléter la réalité.
Ce qu’il a fait est un exemple approprié de la façon dont l’information naturelle est structurée par la pensée humaine de manière à être à la fois une représentation précise de la nature et susceptible d’être comprise. Il est toutefois important de rappeler que la disposition périodique des éléments a donné lieu à de nombreuses interprétations. L'interprétation de Mendeleïev n'était pas la seule possible ; peut-être qu'elle n'était même pas la meilleure ; il ne présentait peut-être même pas une disposition naturelle des éléments, mais la version proposée par Mendeleïev aidait à comprendre une partie du monde physique et était évidemment compatible avec la « vraie » nature.
La psychologie cognitive conceptuelle a beaucoup en commun avec le problème résolu par Mendeleïev. L’observation brute de la manière dont les connaissances sont acquises, stockées et utilisées manque de structure formelle. Les sciences cognitives, comme les sciences naturelles, nécessitent des cadres à la fois intellectuellement compatibles et scientifiquement valides.
Modèles cognitifs
Comme nous l’avons déjà dit, les sciences conceptuelles, y compris la psychologie cognitive, sont de nature métaphorique. Les modèles de phénomènes naturels, en particulier les modèles cognitifs, sont des idées abstraites utiles dérivées d'inférences fondées sur des observations. La structure des éléments peut être représentée sous la forme d’un tableau périodique, comme l’a fait Mendeleïev, mais il est important de rappeler que ce schéma de classification est une métaphore. Et l’affirmation selon laquelle la science conceptuelle est métaphorique ne diminue en rien son utilité. En effet, l’un des objectifs de la construction de modèles est de mieux comprendre ce qui est observé. Mais la science conceptuelle sert à autre chose : elle donne au chercheur un certain cadre dans lequel des hypothèses spécifiques peuvent être testées et qui lui permet de prédire des événements à partir de ce modèle. Le tableau périodique remplissait ces deux objectifs avec beaucoup d’élégance. En se basant sur la disposition des éléments qu'il contient, les scientifiques pourraient prédire avec précision lois chimiques connexions et substitutions, au lieu de mener des expériences interminables et compliquées avec réactions chimiques. De plus, il est devenu possible de prédire des éléments encore inconnus et leurs propriétés en l’absence totale de preuves physiques de leur existence. Et si vous aimez les modèles cognitifs, n'oubliez pas l'analogie avec le modèle Mendeleïev, car les modèles cognitifs, comme les modèles des sciences naturelles, sont basés sur la logique inférentielle et sont utiles pour comprendre la psychologie cognitive.
En bref, les modèles sont basés sur des inférences tirées d'observations. Leur objectif est de fournir une représentation intelligible de la nature de ce qui est observé et d’aider à faire des prédictions dans l’élaboration d’hypothèses. Examinons maintenant plusieurs modèles utilisés en psychologie cognitive.
Commençons notre discussion sur les modèles cognitifs par une version assez grossière qui divise tous les processus cognitifs en trois parties : détection des stimuli, stockage et transformation des stimuli, et développement des réponses :

Ce modèle plutôt sec, proche du modèle S-R évoqué précédemment, a souvent été utilisé sous une forme ou une autre dans les idées antérieures sur les processus mentaux. Et bien qu'il reflète les principales étapes du développement de la psychologie cognitive, il contient si peu de détails qu'il est difficilement capable d'enrichir notre « compréhension » des processus cognitifs. Il est également incapable de générer de nouvelles hypothèses ou de prédire un comportement. Ce modèle primitif est similaire aux anciennes idées de l’univers composé de terre, d’eau, de feu et d’air. Un tel système représente certes une vision possible des phénomènes cognitifs, mais il ne rend pas compte avec précision de leur complexité.
L’un des premiers modèles cognitifs, et le plus fréquemment cité, concerne la mémoire. En 1890, James élargit le concept de mémoire, en la divisant en mémoire « primaire » et « secondaire ». Il a proposé que la mémoire primaire traite des événements passés, tandis que la mémoire secondaire traite des traces permanentes et « indestructibles » de l’expérience. Ce modèle ressemblait à ceci :

Plus tard, en 1965, Waugh et Norman proposèrent une nouvelle version du même modèle qui s'avéra largement acceptable. C’est compréhensible, cela peut servir de source d’hypothèses et de prédictions, mais c’est aussi trop simplifié. Est-il possible de l’utiliser pour décrire tous les processus de la mémoire humaine ? À peine; et le développement de modèles plus complexes était inévitable. Une version modifiée et étendue du modèle de Waugh et Norman est présentée dans la Fig. 2. Notez qu'il a été ajouté nouveau système stockage et plusieurs nouveaux moyens d’information. Mais même ce modèle est incomplet et nécessite d’être élargi.
Au cours de la dernière décennie, la construction de modèles cognitifs est devenue un passe-temps favori des psychologues, et certaines de leurs créations sont vraiment magnifiques. Habituellement, le problème des modèles trop simples est résolu en ajoutant un autre « bloc », un autre chemin d'information, un autre système de stockage, un autre élément qui mérite d'être vérifié et analysé. De tels efforts créatifs semblent bien justifiés à la lumière de ce que nous savons désormais de la richesse du système cognitif humain.
Vous pouvez maintenant conclure que l'invention de modèles en psychologie cognitive est devenue incontrôlable comme l'apprenti sorcier. Ce n'est pas tout à fait vrai, car il s'agit d'une tâche très vaste - c'est-à-dire analyse de la manière dont l'information est découverte, représentée, convertie en connaissances et comment ces connaissances sont utilisées - que peu importe à quel point nous limitons nos métaphores conceptuelles à des modèles simplifiés, nous ne serons toujours pas en mesure d'expliquer de manière exhaustive l'ensemble du domaine complexe de la psychologie cognitive<…>.

On peut bien entendu affirmer que cette séquence de transformations commence avec la connaissance du sujet par le sujet, ce qui lui permet d’orienter sélectivement son attention vers certains aspects. stimuli visuels et ignorer les autres aspects. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le policier décrit la route au conducteur, s'arrêtant principalement là où le conducteur devra passer, et ne prête pas attention (au moins active) aux autres signes : maisons, piétons, soleil et autres. Repères.
« Ainsi, par exemple, le policier a dû se rappeler pendant un certain temps que le chauffeur cherchait « Pay-Pack », qu'il savait où se trouvait l'exposition, et même (au moins jusqu'à la fin de sa question « Dans quel motel étiez-vous ") que le chauffeur séjourne dans un motel. De même, le chauffeur doit se rappeler pendant un moment qu'il existe deux magasins Pay-Pack (ne serait-ce que pour répondre qu'il a besoin de celui qui vend des fournitures de plomberie) ; que le Le policier lui a demandé s'il savait s'il se trouvait là où se trouvait l'Expo, s'il devait passer devant le vieux moulin, etc.
Un certain nombre de théoriciens estiment que certaines structures, par exemple linguistiques, sont universelles et innées.
Selon Solso, la science conceptuelle est une science dont le sujet est constitué de concepts et de constructions théoriques, et non de la nature physique, comme dans les sciences naturelles. Le concept de science conceptuelle est plus étroit que le concept de sciences humaines, qui comprend la psychologie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, etc. La science conceptuelle se rapproche le plus de notre terme « méthodologie de la science », science de la science. - Environ. Éd.
Certains philosophes soutiennent que la science conceptuelle et les modèles cognitifs sont prévisibles au motif que la nature est structurée et que le rôle du scientifique est précisément de découvrir la structure « la plus profonde ». Je ne souscrirais pas à une telle déclaration.
Préface à l'édition russe
Préface
Chapitre 1 Introduction
- Approche informationnelle
- Domaine de la psychologie cognitive
- Perception
- La reconnaissance de formes
- Attention
- Mémoire
- Imagination
- La psychologie du développement
- Réflexion et formation de concepts
- Intelligence humaine
- Intelligence artificielle
- Contexte de la psychologie cognitive moderne
- Représentation des connaissances : période ancienne
- Représentation des savoirs : période médiévale
- Représentation des savoirs : début du XXe siècle
- Renouveau de la psychologie cognitive
- Sciences conceptuelles et psychologie cognitive
- Modèles cognitifs
PREMIÈRE PARTIE Détection et interprétation des signaux sensoriels
Chapitre 2. Détection du signal tactile
- Sensation et perception
- Seuil
- Théorie de la détection des signaux
- Concept d’observateur et de seuil
- Théorie de la communication et théorie de l'information
- Volume de perception
- Rangement emblématique
- Effet du délai d'instruction sur la reproduction
- Capacité
- Icônes et iconoclastes
- Stockage écho
- Fonctions des stockages tactiles
Chapitre 3 : Reconnaissance de formes
- Approches de la reconnaissance visuelle des formes
- Principes de la Gestalt
- Principes de traitement de l'information : « bottom-up » et « top-down »
- Comparaison avec la norme
- Analyse détaillée
- Comparaison de prototypes
- Le rôle de l'observateur dans la reconnaissance des formes
Chapitre 4. Attention
- Conscience
- Conscience et spécificité hémisphérique
- Bande passante et sélectivité de l'attention
- Signaux auditifs
- Repères visuels
- Modèles d'attention sélective
- Modèle avec filtration (Broadbent)
- Modèle diviseur (Treisman)
- Modèle de pertinence (Deutsch/Norman)
- Évaluation des modèles d'attention
- Excitation et attention
- Éveil et attention dans le cadre de l’activité
- Contrôle et attention
- Traitement automatique
DEUXIÈME PARTIE Mémoire
Chapitre 5. Modèles de mémoire
- Histoire courte
- Structure de la mémoire
- Deux magasins de mémoire
- La place de la mémoire dans la sphère cognitive
- Modèles de mémoire
- Modèle Waugh et Norman
- Modèle Atkinson et Shifrin
- Niveaux de lecture (RU)
- Niveaux de traitement (TP)
- Effet d’auto-référence (ERE)
- Mémoire épisodique et sémantique, selon Tulving
Chapitre 6. Mémoire : structures et processus
- Mémoire à court terme
- Volume de KVP
- Informations de codage dans KVP
- Reproduire les informations du KVP
- Memoire à long terme
- Panneaux de fibres : structure et rangement
- Mémoire à très long terme (ULTM)
- Oubli
Chapitre 7. Organisation sémantique de la mémoire
- Théories de l'organisation sémantique
- Modèle de cluster
- Modèle de groupe
- Modèles de réseau
- L'associationnisme et son développement
- Lecture gratuite : les clusters, selon Bousfield
- Variables organisationnelles (Bauer)
- Modèles cognitifs de mémoire sémantique
- Modèles de groupe
- Modèle de caractéristiques sémantiques comparatives
- Modèles de réseau
- Réseaux propositionnels
- Élinor
TROISIEME PARTIE Mnémoniques et images
Chapitre 8. Mnémoniques et mémoire
- Systèmes mnémoniques
- Méthode de placement
- Système de suspension de mots
- Méthode mots clés
- Organigrammes
- Jouer des numéros
- Jouer des noms
- Jouer des mots
- Capacités mnémoniques
- Organisation
- La médiation
- Des mnémonistes exceptionnels
- Gregor von Feinegl
- "S." (S.D. Shereshevsky)
- "V.P."
- Autre
Chapitre 9. Images mentales
- Revue historique
- Quantification
- Approche cognitive
- Hypothèse de double codage
- Hypothèse conceptuelle-propositionnelle
- Équivalence fonctionnelle
- Théorie radicale de l’image
- Contre les images mentales
QUATRE PARTIE Langage et développement cognitif
Chapitre 10. Langue, section : mots et lecture
- Premiers systèmes d'écriture
- Volume de perception
- Présentation tachistoscopique des lettres et des mots
- Traitement de texte
- Théorie de l'information
- Familiarité, fréquence des mots et reconnaissance des mots
- Influence du contexte
- Reconnaissance de mots
- Logogène de Morton
- Tâches lexicales
- Orthographe et intention
- Compréhension
- Connaissance et compréhension du texte
- "Soap Opera" et "Voleurs"
- Modèle de compréhension, selon Kinch
- Représentation propositionnelle du texte et de la lecture
Chapitre 11. Langage, section : structure et abstractions
- Hiérarchie linguistique
- Phonèmes Morphèmes
- Syntaxe
- Grammaire des transformations
- Aspects psycholinguistiques
- Capacités innées et influences environnementales
- Hypothèse de la relativité linguistique
- Abstraction des idées linguistiques
- Coder et oublier le langage « naturel »
- Abstraction non verbale
- Syntaxe musicale
- "Langage" du mouvement
Chapitre 12. Développement cognitif
- Assimilation et accommodement : Jean Piaget
- Principes généraux
- Stade sensorimoteur
- Stade préopératoire (jusqu'à années)
- Stade des opérations spécifiques (de à années)
- Stade des opérations formelles (adolescence et âge adulte)
- Critique des vues de Piaget
- La raison dans la société : Lev Vygotski
- Vygotski et Piaget
- Développement de la pensée et internalisation de la parole
- Approche informationnelle
- Développement des compétences en acquisition d’informations
- Mémoire (de travail) à court terme
- Cognition" ordre supérieur"chez les enfants
- Formation d'un prototype chez les enfants
CINQUIÈME PARTIE Pensée et intelligence - naturelles et artificielles
Chapitre 13. Réflexion, section : formation des concepts, logique et prise de décision
- Pensée
- Formation de concepts
- Exemples de problèmes conceptuels
- Maîtriser les règles
- Association
- Tester des hypothèses
- Logiques
- Pensée formelle
- Faire des décisions
- Raisonnement inductif
- Estimation de probabilité
- Cadre de solutions
- Représentativité
- Etude du comportement animal
- Théorème de Bayes et prise de décision
- Prise de décision et rationalité
- Aspects ethniques de la pensée
- Pensée formelle
- Faire des décisions
Chapitre 14. Réflexion, section : résolution de problèmes, créativité et intelligence humaine
- Résolution de problème
- Intelligence artificielle (IA) et résolution de problèmes
- Représentation interne et résolution de problèmes
- Création
- Processus créatif
- Analyse de la créativité
- Intelligence humaine
- Problème de définition
- Analyse factorielle de l'intelligence
- Théories cognitives de l'intelligence
Chapitre 15. Intelligence artificielle
- Les origines de l'intelligence artificielle
- Machines et esprits : le jeu de l’imitation et la salle chinoise
- "Jeu d'imitation" ou "Test de Turing"
- "Chambre chinoise"
- Réfutation de la salle chinoise
- Quel type d'ordinateur est une personne ?
- Perception et intelligence artificielle
- Reconnaissance de ligne
- La reconnaissance de formes
- Reconnaissance de formes complexes
- Perception visuelle « compétente » dans les machines
- Mémoire et intelligence artificielle
- Systèmes de mémoire passive
- Systèmes actifs mémoire
- Langage et intelligence artificielle
- Résolution de problèmes et intelligence artificielle
- Échecs informatiques
- URZ - Résolveur de problèmes universel
- Robots
Annexe : de la dernière édition
Glossaire des termes
Index des sujets
Littérature
Littérature supplémentaire en russe
Préface
Pour les étudiants
Ceux d’entre nous qui étudient la psychologie cognitive depuis plus de 10 ans ont été témoins de nombreuses avancées passionnantes. Certaines d’entre elles ont été réalisées à l’aide d’un certain nombre d’ordinateurs et d’autres appareils sophistiqués qui ont considérablement accéléré notre étude des propriétés de la pensée humaine. Et certaines de ces avancées sont dues à des techniques expérimentales inventives et à des théories audacieuses qui ont rapproché notre quête de la compréhension de la manière dont nous, les humains, percevons, stockons les informations et pensons. C’était une période passionnante pour étudier la psychologie cognitive. Mais aussi impressionnantes que soient les dernières réalisations, il se pourrait bien que « le meilleur soit encore à venir » !
J'espère qu'à partir de ce livre, vous pourrez en apprendre davantage sur les chemins empruntés par nous, psychologues cognitifs ; J'espère qu'il présente avec précision les meilleures idées, théories et expériences ; qu'il vous préparera à remporter de nouveaux succès. Peut-être que certains étudiants décideront de travailler en psychologie cognitive, et je serai ravi si ce livre vous encourage à poursuivre le travail que nous avons commencé. Enfin, je suis intéressé par vos réflexions sur ce livre et j'apprécierais vos commentaires et commentaires.
Pour les enseignants
Envisageant une révision de l'édition 1979 de ma « Psychologie cognitive » ; Au départ, je pensais que cette tâche serait moins difficile que d'écrire le livre original. Mais au cours de la dernière décennie, les résultats de nombreuses expériences créatives ont été publiés et le domaine de la psychologie cognitive lui-même a changé à bien des égards. Ce qui était prévu comme une légère révision de l’édition de 1979 s’est avéré une tâche difficile.
Dans cette édition j'ai essayé de conserver le meilleur de ce qu'il y avait dans la précédente, tout en ajoutant nouveau matériel, et déplacer l’orientation du livre pour refléter les changements survenus dans le domaine. Trois caractéristiques de l'édition originale n'ont pas changé. Il me tenait avant tout à cœur de conserver son caractère exhaustif. À mesure que le domaine de la psychologie cognitive et des domaines connexes s’est élargi, cette tâche s’est révélée plus difficile que je ne le pensais au départ. J'ai essayé de présenter les recherches et les idées du « mainstream », mais j'ai dû m'écarter ici et là vers des sujets d'intérêt particulier. Bien qu'il existe un besoin d'ouvrages spécialisés écrits « d'un point de vue spécifique », je crois que de nombreux éducateurs accueilleront favorablement un ouvrage général sur la psychologie cognitive : peu d'auteurs ont entrepris d'en écrire un. Deuxièmement, la plupart des chapitres commencent par bref aperçu, dédié au contexte de la question. Je crois que « dans un domaine en évolution aussi rapide que la psychologie cognitive, il sera important que les étudiants connaissent un peu l'histoire de chaque sujet afin de pouvoir comprendre les nouveaux éléments dans le contexte des événements passés. Et troisièmement, comme dans la première édition , le matériel est présenté selon une approche informationnelle en perspective.
À certains égards, cette édition diffère considérablement. Premièrement, le matériel est organisé différemment. Dans la première édition, les chapitres étaient divisés en trois sections. Il y a cinq sections dans cette édition : « Détection et interprétation des signaux sensoriels », « Mémoire », « Mnémoniques et imagerie », « Langage et développement de la cognition » et « Pensée et intelligence - naturelles et artificielles ». Deuxièmement, dernier sujet, appelé « cognition d'ordre supérieur » dans la première édition, a été considérablement développé, ajoutant deux chapitres sur la réflexion pour refléter les changements dans le domaine. Deux sections principales sur la prise de décision et l'intelligence humaine ont également été ajoutées ici (Partie V). Troisièmement, la liste de références déjà longue a été complétée par des centaines de nouveaux articles et certaines publications qui n'étaient plus pertinentes ont été exclues. Enfin, quelques modifications didactiques ont été apportées. Chaque chapitre est précédé de résumé son contenu, et chaque chapitre se termine par un résumé rigoureux, une liste de termes clés et des lectures recommandées. Un glossaire de termes indispensable a également été ajouté. Ces changements ont été demandés par les étudiants et je pense qu'ils renforceront l'utilité de ce livre en tant qu'outil pédagogique.
En écrivant un livre complet sur la psychologie cognitive, j'ai essayé de le rendre attrayant pour les enseignants qui préfèrent choisir leurs sujets préférés lors de la création de cours semestriels. Vous pouvez bien sûr inclure les 15 chapitres dans un seul cours, mais la plupart des enseignants m'ont dit qu'ils ne choisissaient que quelques chapitres. J'ai essayé d'écrire de manière à pouvoir omettre certains chapitres sans perdre l'intégrité du livre.
Beaucoup ont contribué à ce livre, et c'est avec plaisir que je me souviens d'eux ici. J'ai grandement bénéficié des commentaires de nombreux étudiants qui ont utilisé ce livre dans mes cours et partout dans le monde. Les commentaires de leur part ont été grandement appréciés et je voudrais remercier chacun d’eux individuellement, mais cela aurait rendu le livre beaucoup plus long ! Mes collègues et assistants venus de lieux aussi éloignés que l'Université d'État de Moscou (URSS) et l'Université de Saint-Pétersbourg. Idaho (à Moscou, Idaho) ; Université de Londres à Oxford, Land University en Suède ; L'Université de Stanford et l'Université du Nevada-Reno ont toutes apporté un soutien utile à ce livre. Richard Griggs de l'Université de Floride ; Ronald Hopkins de l'Université de l'État de Washington ; Joseph Philbrick de l'Université polytechnique de l'État de Californie ; William A. Johnston de l'Université de l'Utah ; Keith Rayner de l'Université du Massachusetts Amherst ; Albrecht Inhoff de l'Université du New Hampshire et Arnold D. Well de l'Université du Massachusetts à Amherst ont révisé les versions préliminaires de ce livre et ont fourni des commentaires perspicaces. Les évaluateurs originaux ont également eu un impact, et je les remercie tous. Mike Fried a travaillé dur sur le guide pédagogique et Tom Harrington a été le confident de certaines de mes idées les plus folles et la source de bien d'autres. Je veux me souvenir d'une personne en particulier. Ruth Condrey de l'Université du Nevada-Reno m'a aidé pratiquement tout au long de la préparation de la deuxième édition, en fournissant des critiques approfondies des manuscrits, en rédigeant des ébauches du résumé et du dictionnaire et en m'encourageant à terminer « notre » livre. Je remercie tout le monde et exprime ma gratitude.
Robert L. Solso
Université du Nevada-Reno
ARTICLE D'INTRODUCTION (DES RÉDACTEURS DE TRADUCTION)
La psychologie cognitive dans le contexte de la psychologie
La psychologie n'est pas unitaire. La diversité la rend durable, infinie, indestructible et attrayante. Ceci est enseigné par l’expérience de son histoire et de l’état actuel. Mais tout aussi indéracinable est le désir de nombreux scientifiques, courants, théories et écoles scientifiques d’unité, de recherche d’un principe unique sur la base duquel toute la richesse de la vie mentale d’une personne pourrait s’expliquer. Psychologiquement, de telles ambitions sont tout à fait compréhensibles : un mauvais soldat est celui qui ne veut pas devenir général. Mais d’un point de vue historique, elles sont, pour le moins, injustifiées. Pas tellement en mémoire longue histoire la psychologie (après son autonomisation de la philosophie) les principes d'association, de gestalt, de réflexe, de réaction, de comportement, d'activité, de conscience, d'attitude, etc. La nomination de chacun d'eux s'est accompagnée de l'élaboration d'une méthodologie et d'un méthodes expérimentales recherche à l'aide de laquelle l'augmentation s'est produite savoir scientifique et de plus en plus de faits nouveaux furent obtenus, caractérisant à un degré ou à un autre la vie mentale. Au fil du temps, le pouvoir explicatif du principe s'est évaporé et les méthodes et les faits sont restés dans l'arsenal de la psychologie. Les schémas explicatifs ont également été conservés, mais non pas en tant que schémas universels, mais en tant que schémas particuliers, qui conviennent assez bien à leur place. On ne peut pas dire que ce processus soit terminé. Cela continue, tout comme se poursuivent les tentatives très instructives de définition de l'essence de l'homme en monosyllabes : homo habilis, homo faber, homo sapiens, roseau pensant, homo humanus, homo sovieticus, etc. L'ambition qui a accompagné par exemple le développement du principe d'activité (ou approche activité, théorie psychologique activités) en Russie. Et en Occident, la psychologie dite humaniste est née et se développe de manière tout aussi ambitieuse - on pourrait penser qu'avant tout, la psychologie était non humaniste (ou anti-humaniste ?!). De même, la psychologie qui existait avant que le principe d’activité ne soit avancé ne mérite en aucun cas le qualificatif de « non-activité » ou d’« inactif ». À propos, le merveilleux philosophe russe V.F. Asmus a trouvé une sorte de prolégomène à la psychologie de l'activité non pas chez Marx, mais chez M.Yu. Lermontov. La psychologie cognitive trouve ses racines dans le principe cartésien du cogito ergo sum. À proprement parler, les premières études expérimentales sur la mémoire de G. Ebbinghaus peuvent être attribuées à la psychologie cognitive. Et dans le domaine de la psychologie de la pensée, il existe de nombreuses recherches qui sont nettement « plus cognitives » qu’en psychologie cognitive. L'essentiel n'est pas dans le nom, mais dans la réalité du fait qu'il y a près de quatre décennies, D. Sperling a mené des études remarquables sur la mémoire iconique, a trouvé une explication à un certain nombre de paradoxes connus depuis longtemps des psychologues, et cela a marqué le début d'une des domaines les plus puissants et les plus influents non seulement de la psychologie, mais aussi de la science en général. Aujourd’hui, il n’existe pas seulement la psychologie cognitive, mais aussi les sciences cognitives. Quant au nom, il est inutile de discuter avec la langue : elle vit selon ses propres lois, mais n'importe quel nom est utile pour accepter les voiles cum grana. Dans les nouvelles orientations et théories scientifiques, ce qui est intéressant n'est pas tant le nom, ni même l'appareil conceptuel utilisé, mais le champ de significations et de significations formées ou générées par celles-ci. Il est important quel est le rapport entre les connaissances conservatrices et dynamiques, les méthodes, le rapport entre les connaissances formelles et vivantes. Existe-t-il des métaphores vivantes dans la théorie, dont chacune vaut une douzaine de concepts morts ? Tous les candidats à une théorie n'ont pas de connaissances vivantes et de métaphores vivantes, même si ce sont elles qui déterminent le potentiel explicatif ou la zone de son développement proximal. Pour l’avenir, nous dirons que le potentiel explicatif et la zone de développement proximal en psychologie cognitive sont assez vastes. Malgré toute l'internationalité de la psychologie en tant que telle, la psychologie cognitive offre une bonne occasion de noter les différences entre les États-Unis, les Européens et les Européens. science russe. Les Américains partent de faits, de données et, après avoir mené des milliers d’études, évoluent lentement vers des concepts et des théories. Les Européens partent de concepts et de théories et vont aux faits, aux données. Malgré leurs relations mutuellement ironiques, les Américains et les Européens se rencontrent quelque part à mi-chemin et finissent par mener à bien le projet, le rendre opérationnel ou, comme ils disaient en URSS, « mettre en pratique les acquis scientifiques ». En Russie, on commence par le sens, on l'ouvre vraiment, puis on l'abandonne, invoquant des malentendus ou des « difficultés objectives », qui n'ont jamais manqué dans ce pays. Si ce sens à moitié dévoilé parvient à l’Occident (ce qui arrive le plus souvent avec un long retard, qui diminuera lorsqu’il sera transporté sur un « navire philosophique » ou lors de la prochaine vague d’émigration), alors l’Occident le rappelle, pour action. Ce fut le cas par exemple de l’idée de L.S. Vygotsky sur la zone de développement proximal et avec bien d'autres idées de Vygotsky, Luria, Bakhtin, Bernstein. Les scientifiques occidentaux ont encore de nombreuses découvertes à faire. Aujourd’hui, par exemple, ils portent un intérêt croissant aux œuvres de G.G. Shpet sur la psychologie, la linguistique, l'esthétique... Le livre de Robert Solso, dont la traduction est proposée au lecteur russophone, est un excellent exemple de la pensée psychologique américaine - claire comme les yeux d'un bébé ; haut comme le ciel ; simple comme la vie; pratique, comme n’importe quel Américain. L'auteur a donné au livre une double orientation. D'une part, c'est un fascinant Didacticiel pour les étudiants en psychologie et ses diverses applications. En revanche, il contient une analyse large éventail problèmes et perspectives de la science psychologique, qui présente un grand intérêt non seulement pour les psychologues. Traduit en russe, le terme « cognitif » signifie « cognitif ». La psychologie cognitive est la psychologie des processus cognitifs (sensation, perception, attention, mémoire, pensée). Cependant, nous avons conservé le son anglais non seulement parce qu’il était déjà établi, mais aussi pour deux autres raisons. Premièrement, la séparation des processus cognitifs en un groupe spécial de phénomènes psychologiques est considérée par beaucoup comme insatisfaisante, car d'un dispositif didactique, elle est devenue un dogme théorique qui empêche de voir le contenu cognitif dans d'autres actes mentaux (outre ceux mentionnés). (par exemple, dans l'objectif actions exécutives , dans les expériences esthétiques). Deuxièmement, dans le contexte de l’histoire de la psychologie américaine, le terme « cognitif » a un sens supplémentaire qui manque au sens européen du terme. Le fait est qu’aux États-Unis, la psychologie cognitive est apparue et s’est développée comme une alternative au behaviorisme, qui a dominé la psychologie américaine pendant des décennies et qui reposait, à ses débuts, principalement sur des observations empiriques et des expériences sur des animaux inférieurs. Le behaviorisme orthodoxe a exclu la catégorie du mental de son vocabulaire, se limitant à l'analyse des stimuli externes et des réponses motrices. L’adjectif « cognitif » est un vaccin contre les interprétations exclusivement comportementales et réflexologiques de la vie mentale. R. Solso parle de tout cela en analysant les origines de la « révolution cognitive ». Notons que les Américains n'ont pas connu de révolution dans notre compréhension du mot (avec critiques subversives, accusations éthiques et contraires à l'éthique, campagne bruyante, résolutions des conseils académiques et autres mesures administratives). Les scientifiques qui n'étaient pas d'accord avec le behaviorisme ont travaillé tranquillement et paisiblement, et ce en 1967. Le livre de W. Neisser "Cognitive Psychology" est paru, qui a donné le nom à une nouvelle direction de la pensée psychologique. Ainsi, le behaviorisme - avec ou sans ajout de néo-isme - n'est pas mort et se fait périodiquement sentir, mais sur un pied d'égalité avec les autres mouvements. Lors de l'analyse des conditions historiques qui ont préparé l'émergence de la psychologie cognitive, le fait que celui-ci ait été précédé d'un travail intensif sur la mesure du temps de réaction d'une personne, lorsqu'en réponse aux signaux entrants, elle doit appuyer le plus rapidement possible sur le bouton correspondant, reste dans l'ombre. . De telles mesures ont été effectuées il y a longtemps, dans les laboratoires de W. Wundt. Mais maintenant, ils ont acquis une signification différente. Un paradigme expérimental simple de mesure du temps de réaction s'est avéré être un modèle très fructueux d'un type d'activité d'opérateur dans le contrôle de systèmes automatisés. Par conséquent, le financement de ces travaux n’a posé aucun problème et ils ont littéralement rempli le vaste espace psychologique des États-Unis. La situation de mesure du temps de réaction permet d'analyser les processus complexes se produisant dans les autorités supérieures du cerveau (une sorte de « processeur central ») lorsque les signaux sensoriels « commutent » vers des commandes motrices qui contrôlent la réponse motrice. Ce n'est pas un hasard si nous mettons des guillemets : on ne peut parler ici de basculement que dans le sens le plus abstrait, sans entrer dans les détails de ce processus. En réalité, la situation est bien plus compliquée, et cela a été brillamment démontré dans les travaux de F. Donders, P. Fitts, W. Hick, D. Hyman, R. Effron et de nombreux autres auteurs. Avec une réponse rapide, l’action d’une personne, de la perception du signal d’entrée à la réponse du moteur en sortie, dure plusieurs dixièmes voire millièmes de seconde. Et ce qui se passe dans le « processeur central » est décrit dans plusieurs pages de texte. L'objectivité de l'analyse a été assurée par l'utilisation d'éléments de la théorie de la communication, en particulier la mesure de l'entropie de Shannon, pour évaluer la quantité d'informations contenues dans une séquence de signaux. La précision des mesures et la variété des situations ont été créées grâce à l'utilisation d'appareils électroniques et d'éléments informatiques. Outre un certain nombre de lois déjà devenues classiques établissant un lien entre la quantité d'informations transmises et le temps de réponse, des faits fondamentaux ont été découverts qui indiquent une influence significative facteurs subjectifs pour le travail du "processeur central". Il s'agit de non seulement sur l'anticipation des signaux, les attitudes et les états fonctionnels d'une personne, mais aussi sur son travail complexe pour extraire des informations « cachées » contenues dans une séquence d'événements. Dans le contexte de ces travaux, le terme « probabilité subjective » est apparu, et les termes probabilités « conditionnelles » et « inconditionnelles » ont acquis une signification psychologique supplémentaire. Le facteur psychologique le plus important s'est avéré être la « signification » du signal d'entrée, qui impose des restrictions importantes sur le fonctionnement des lois de transmission de l'information à travers les « canaux de communication » dans les systèmes vivants. Sur fond d'énorme matériel expérimental sur la mesure des temps de réaction et son interprétation polyvalente, reflétant des points de vue différents et parfois opposés non seulement des psychologues, mais aussi des ingénieurs (il suffit de rappeler la longue discussion sur la nature monocanal de l'être humain). opérateur), le postulat behavioriste sur le lien direct et immédiat entre stimulus et réaction a perdu tout attrait. Au contraire, l'expérience initialement très réussie d'application des méthodes de la théorie de l'information à l'analyse de phénomènes subjectifs a attiré l'attention de nombreux psychologues américains sur la catégorie et la réalité de la psyché. Il est impossible d'ignorer une autre circonstance injustement oubliée qui a précédé l'émergence de la psychologie cognitive et qui a influencé d'une manière ou d'une autre la formation de son « apparence extérieure ». Vraiment, caractéristique Le produit scientifique des cognitivistes réside dans ses contours visibles et stricts sous forme de figures géométriques ou de modèles. Ils sont extraordinairement beaux (regardez le livre de R. Solso), et si vous lisez les commentaires qui les accompagnent, ils sont très convaincants. Ils vous emmènent toujours quelque part plus loin, dans les profondeurs de la mer de la science, car presque tous les modèles ont un élément peu ou pas du tout inexploré qui contient " secret principal". Ces modèles sont constitués de blocs (R. Solso utilise souvent l'expression « boîtes dans la tête »), dont chacun strictement fonction spécifique . Les connexions entre les blocs indiquent le chemin des informations de l'entrée à la sortie du modèle. La représentation du fonctionnement d'un certain mécanisme ou dispositif fonctionnel (pas nécessairement réel, mais aussi hypothétique) sous la forme d'un tel modèle a été empruntée par les scientifiques cognitifs aux ingénieurs, en particulier à la théorie et à la pratique alors bien développées de l'automatique. systèmes de contrôle ou systèmes de suivi. Ce que les ingénieurs appelaient des organigrammes, les scientifiques cognitifs l’appelaient des modèles, en les accompagnant souvent (et non sans raison) de l’adjectif « hypothétique ». Mais la première expérience d'application des méthodes de la théorie de la régulation automatique à l'analyse de l'activité humaine a été obtenue avant même la formation de la psychologie cognitive en tant que direction indépendante, presque simultanément avec les travaux sur la mesure du temps de réaction. Nous parlons des activités d'un opérateur humain de systèmes de suivi semi-automatiques. La personne a été incluse dans le système, pour l'analyse duquel un appareil mathématique bien développé a été utilisé, y compris une modélisation géométrique. Il semblait tout naturel d'utiliser cet appareil en relation avec le lien humain, pour analyser le travail dont dans ces conditions il n'existait aucun appareil compatible avec les modèles mathématiques. Dans les travaux brillants de D. Adams et Poulton, consacrés à l'activité d'un opérateur humain dans les systèmes de suivi, des problèmes purement psychologiques ont été résolus qui n'avaient pas de conception strictement mathématique (cela, bien entendu, ne s'applique pas aux méthodes de mesure objective résultats d'activité dont l'équipement mathématique était très impressionnant). Les ingénieurs E. Krendel et D. McRur ont été les premiers à commencer à combler le vide. Après avoir décomposé l'acte moteur en une série d'opérations avec des paramètres clairement définis (le nombre d'opérations et le nombre de paramètres continuent d'augmenter à ce jour), ils ont montré comment les fonctions de transfert d'un opérateur humain peuvent être calculées dans diverses conditions de suivi. (Un peu plus tard, la méthode de la fonction de transfert a été appliquée pour la première fois par Campbell et Robson à l'analyse de la perception visuelle.) Les modèles d'opérateurs humains poussaient comme des champignons après la pluie. Presque toutes les revues de psychologie étaient inondées d’articles sur le pistage. Il existait même une revue spéciale Perseptuelle et motricité, dont la moitié (comme son nom l'indique) était consacrée à ce sujet. L'opérateur humain a été représenté sous la forme d'un schéma fonctionnel (avec de nombreuses options pour chaque cas spécifique), similaire à un schéma fonctionnel typique d'un système de suivi. De nombreux ingénieurs, dès qu’ils ont entendu parler de l’existence de l’homme, ont commencé à en construire des modèles. Les cognitivistes n’ont emprunté que la méthode géométrique pour représenter leurs connaissances, laissant de côté les exercices à fonctions de transfert. Pour étudier le comportement du système de suivi, un ensemble de signaux standards est utilisé. Parmi elles, les plus courantes sont les oscillations sinusoïdales et les impulsions courtes (simples ou consécutives). Les mêmes signaux (c'est-à-dire uniquement leur forme) sont également utilisés en psychologie expérimentale. Un analogue d'une impulsion rectangulaire est une courte exposition d'une image test présentée à l'observateur à l'aide d'un tachistoscope (R. Solso donne Description détaillée techniques de tachistoscopie). Auparavant, le tachistoscope était principalement utilisé dans les études de perception visuelle. Avec le développement de la technologie électronique et surtout la technologie informatique la capacité de manipuler la nature des images présentées et leur dynamique temporelle s'est considérablement développée. Cela a permis d'utiliser la méthode de la tachistoscopie dans la recherche mémoire à court terme, pensée, attention - les principaux domaines de la psychologie cognitive. L'émergence des nouvelles technologies a créé un nouvel environnement visuel pour une personne, a fourni un nouveau matériel pour son activité intellectuelle, et tout cela se prêtait à une évaluation quantitative et à une manipulation précise. L’échelle de temps de l’activité humaine réelle et des procédures expérimentales utilisées pour l’étudier a également considérablement changé. Il fallait percevoir plus vite et plus, penser plus vite, prendre des décisions plus vite et réagir plus vite en réponse. Apparemment, c’est la raison pour laquelle l’élément des cognitivistes est l’intervalle de temps de la milliseconde. Déjà des mesures du temps de réaction ont montré qu'en peu de temps l'infini s'ouvre. Les toutes premières expériences avec lesquelles a débuté la psychologie cognitive l’ont encore confirmé. Il semblait que tout était concentré dans un petit laps de temps ressources intellectuelles personne. Et l’intellect lui-même s’est déplacé de sa localisation traditionnelle dans le cerveau vers la périphérie (voir R. Solso sur les registres sensoriels, la mémoire iconique). Il faut dire franchement que les psychologues européens, notamment soviétiques, habitués à des procédures expérimentales longues et souvent épuisantes, avaient une attitude très méfiante et sceptique à l'égard des premiers succès des psychologues cognitifs. Il y a eu des accusations de suranalyse, de mécanisme et de réductionnisme. Le principal inconvénient de l'approche informationnelle (principale méthode des cognitivistes) a été considéré comme le principe du traitement séquentiel de l'information, même si ce reproche doit plutôt être attribué à l'appareil analytique utilisé qu'à ses objectifs ultimes . Néanmoins, à la faculté de psychologie de l'Université de Moscou, il y avait des passionnés qui non seulement ont repris la nouvelle direction, mais ont également considérablement élargi la portée de son existence (voir, par exemple, les travaux de V.P. Zinchenko avec les employés du département de psychologie de l'ingénieur). G.G. Vuchetich, N.D. Gordeeva, A.B. Leonova, A.I. Nazarov, S.K. Sergienko, Y.K. Strelkov, G.N. Solntseva, etc.). Il est maintenant devenu évident que la principale réalisation de la psychologie cognitive a été le développement de méthodes expérimentales pour étudier la microstructure et la microdynamique des processus mentaux, sans que toute version de la macrostructure du mental semble spéculative et peu convaincante. La psychologie cognitive n’est plus un phénomène purement américain. Ses idées et ses méthodes se répandent dans le monde entier et, en interaction avec d'autres traditions nationales, donnent naissance à de nouvelles pousses. Ainsi, l'analyse microstructurale et microdynamique de l'action, développée dans notre pays, est le résultat d'une symbiose de la physiologie de l'activité, de l'activité et des paradigmes cognitifs dans l'étude de la motricité. Grâce à cela, la micro et la macrostructure de l'action ont commencé à être considérées non pas comme des entités distinctes, dont l'étude nécessite des approches fondamentalement différentes et incompatibles, mais comme les attributs d'un tout unique qui forme l'essence de l'intrapsychique. La psychologie cognitive se modifie et se développe sous l'influence des idées européennes. Ce livre, peut-être pour la première fois dans le contexte de la psychologie cognitive, présente une présentation des principales dispositions des théories de J. Piaget et L.S. Vygotsky et leur lien avec la méthodologie cognitive sont décrits. (Bien sûr, même en dehors de ce contexte, ces théories sont largement connues des psychologues américains.) Le livre de U. Neisser « Cognition and Reality » contient une analyse critique de l'état de la psychologie cognitive et décrit ses perspectives, qui sont à bien des égards en accord avec l’approche activité. Bien sûr, dans le mouvement inverse des traditions américaines et européennes, tout n’est pas simple et fluide. L'élargissement du domaine de la psychologie cognitive (il s'est déjà étendu aux problèmes de l'intelligence artificielle) conduira tôt ou tard à la question de l'adéquation de l'approche informationnelle pour étudier l'interaction des micro et macrostructures. Apparemment, nous devrions parler ici non pas tant de l'inapplicabilité de l'approche informationnelle en général, mais des limites de son action (pouvoirs) sur le territoire de la psyché. Les modèles cognitifs supposent la continuité des transformations de l'information de l'entrée à la sortie du système, tout comme cela se produit en technologie : en passant successivement par différents blocs, le signal électrique modifie ses paramètres, acquérant la forme requise en sortie. Tout est ici très simple : les blocs système communiquent entre eux dans le même langage : le langage des signaux électriques. Mais les signaux électriques ne sont pas le langage des mouvements, tout comme ils ne sont pas le langage de la pensée, de l’attention ou des émotions. Fonctionner dans divers sous-systèmes du renseignement différentes langues. Ce fait important se reflète dans un seul modèle proposé par N.A. Bernstein, - modèles du servomécanisme d'un acte moteur. Il dispose d’un bloc spécial pour transcoder les corrections sensorielles en commandes musculaires. Et c'est un analogue de la traduction d'informations d'une langue à une autre. SUR LE. Bernstein a déclaré directement et avec une juste prudence qu'aujourd'hui (c'était au début des années 60) on ne peut plus rien dire sur le fonctionnement de l'unité de transcodage, reportant ainsi cette décision à l'avenir. Il semble cependant que l’avenir l’ait oublié. Est-ce parce que ses habitants ont cessé d’être polyglottes même dans leur propre pensée ? L’enthousiasme actuel de la communauté scientifique (et pas seulement psychologique) concernant le fait établi de longue date de l’asymétrie des hémisphères gauche et droit du cerveau ne peut pas être expliqué rationnellement. Mais en plus des mots et des images, les humains ont des langages de mouvements, d'attitudes, d'actions, de gestes, de signes, de symboles, de métaphores et de structures sémantiques profondes ; Il existe aussi des métalangages de sens. On peut objecter : est-il vraiment possible de système nerveux Existe-t-il un autre moyen de transmettre des informations que les signaux électriques ? Ou encore : la transformation de l’information ne doit-elle pas être considérée comme une traduction d’une langue à une autre ? Concernant la première question, selon les données neurophysiologiques modernes, le sort impulsion électrique transmis le long d'un nerf dépend de l'état du champ dans lequel se trouve la cellule nerveuse recevant cette impulsion, et le champ lui-même est créé par l'activité d'ensembles cellulaires qui ont une grande variété de configurations et remplissent les mêmes fonctions différentes. Il existe également des voies neurohumorales pour la circulation de l’information dans tout le corps. Ainsi, ni une impulsion nerveuse ni une séquence d'impulsions ne peuvent être considérées comme les seuls porteurs d'informations dans le système nerveux central. Mais c’est la réponse pour les ingénieurs intéressés par la structure de la « machine humaine ». Les partisans de l’approche informationnelle stipulent dès le début (on rencontre également une telle réserve dans le livre de R. Solso) que leurs modèles ne sont pas des formations neuronales, que les blocs ne sont pas des mécanismes nerveux et que les connexions entre blocs ne sont pas des voies neuronales. Leur objection est plus probablement similaire à la deuxième des questions posées. Et il faut répondre par la négative : la traduction d’une langue dans une autre ne crée pas d’informations fondamentalement nouvelles. Au contraire, sa tâche est de transmettre le contenu du texte original de manière aussi complète et précise que possible. Et pour ce faire, vous devez faire abstraction des informations (le son ou l'orthographe spécifique des mots) et passer à un système de significations et de significations. Ici, nous n'avons pas une transition directe d'un type d'information à un autre (c'est-à-dire un recodage lui-même), mais une transition médiée par diverses actions de l'information aux significations et aux significations, et d'elles - à nouveau à l'information, mais sous une forme différente. En termes simples, le sens, bien sûr, est enraciné dans l'être, mais il ne s'agit pas d'une traduction de l'être dans le langage du sens, mais d'une extraction, d'une extraction du sens de l'être - s'il l'a. Ainsi, dans le flux d'informations, il existe un écart, un « écart » rempli de significations et de significations, ces dernières agissant comme médiateurs des transitions informationnelles. Ici, nous ne pouvons parler de transformations de l'information que de manière très abstraite, en oubliant ou (ce qui arrive le plus souvent) en ne connaissant pas la chose la plus importante - le processus d'exploitation avec des significations et des significations. L’inclusion du sens et des opérateurs de sens dans les modèles cognitifs, y compris la signification des significations et la compréhension des significations, est une question d’avenir. Les ingénieurs n'ont été confrontés que récemment aux problèmes de transformations sémantiques liés à la création de systèmes quasi-intelligents. Et ici, les psychologues n'étaient pas très en avance, sachant quoi ne pas faire, mais ne sachant pas comment faire ce qu'il fallait faire. Le fait est que la triade de la cognition, constituée de l'interaction de trois composantes - acquérir, structurer et exploiter les connaissances - a n’a été étudié que partiellement en psychologie. Nous en savons beaucoup sur la formation de concepts individuels et actions mentales, sur la formation d'images visuelles, sur structure psychologique activités et actions, mais nous ne savons presque rien de la structure et du fonctionnement des connaissances dans les domaines cognitifs, dans les domaines des significations, des significations, des métaphores qui ne sont pas réductibles à des concepts. Le vide est rempli d’anciennes catégories logiques formelles, modifiées de manière méconnaissable par de nouveaux noms. Modèle de cluster, modèle de réseau, réseaux propositionnels, scripts et procédures, modèles associatifs - tels sont les types de modèles d'organisation sémantique décrits en détail dans le livre de R. Solso. Ils ne peuvent sembler nouveaux et originaux qu'à ceux qui ne connaissent pas les fondements de la logique formelle, qui n'ont rien entendu des discussions de longue date sur le problème de la relation entre le logique et le psychologique dans la pensée humaine. Notons qu'il est nécessaire de se tourner vers des questions psychologiques lors de la création de systèmes quasi-intelligents, non pas pour construire des copies artificielles ou même des analogues de l'intelligence naturelle, mais pour ne pas répéter les erreurs du passé dans des développements coûteux et trompeusement tentants. L’intelligence naturelle et artificielle n’ont qu’une seule frontière commune : les problèmes de la triade de la cognition. Résoudre ces problèmes dans la technologie et dans sciences humaines sera différent, et il ne peut pas être le même en raison de la différence dans les supports matériels des deux. De cette fatalité naturelle des différences surgit un problème dérivé (et non séparé ou indépendant !) de l'interaction entre l'homme et la technologie, et non pas sous son aspect philosophique traditionnel (comme, par exemple, chez N.A. Berdiaev), mais sous l'aspect nouveau de ses solutions concrètes et techniques. Ici s'ouvre un nouveau domaine d'activité pour l'ergonomie, qui a déjà accumulé de l'expérience dans la résolution de tels problèmes. Une autre considération sur les modèles cognitifs qui est d'une importance fondamentale, mais absente des travaux de R. Solso. Dans ces modèles, il n’existe aucune source d’auto-propulsion du système d’expérience subjective. Ils reposent sur le postulat de l'influence d'un stimulus extérieur sur des registres sensoriels (sortes de porteurs de perception). Ensuite, selon W. Neisser, il y a des transformations d'information, puis encore des transformations d'information, etc. Le modèle est mort tant qu’il n’y a pas de stimulus externe. Mais c'est un pas en arrière même par rapport aux dispositifs techniques les plus simples. Dans le cadre d'un tel paradigme passif-réflexif, les transitions d'une forme de représentation des connaissances à une autre dans le système d'expérience subjective, forces motrices du développement de ce système lui-même, restent inexplicables. Le plus souvent, ces questions restent en dehors du cadre de l’étude des processus cognitifs. L'inconvénient du paradigme passif-réflexif est qu'il n'y a aucun chemin allant du système d'expérience subjective à deux autres systèmes tout aussi importants dans vie humaine systèmes - au système de conscience et au système d'activité (la définition de la conscience dans le dictionnaire terminologique de R. Solso ne résiste à aucune critique, et il a mentionné pour la première fois l'influence de l'activité lors de la présentation du concept de L.S. Vygotsky). Pendant ce temps, l’action est par nature système ouvert, ouvert non seulement à l’influence de l’environnement sur l’organisme, mais aussi à l’influence de l’organisme sur l’environnement. Il s’agit d’un système en mouvement constant et qui ne peut donc jamais être identique à lui-même. L’interaction entre un organisme et l’environnement (même informationnelle) ne peut se produire en dehors de l’action. C'est en lui que se forme un système de valeurs et de significations objectivement remplies, qui se reflète ensuite dans la conscience de l'individu et constitue tout son monde subjectif, mais pas sous la forme de contenus de mémoire morts récupérés par une demande extérieure (comme dans un ordinateur), mais sous la forme d'une image du monde (au sens d'A.N. Léontiev), qui a accumulé en elle l'énergie cinétique de l'action qui la forme. L'énergie potentielle d'une image (énergie eidétique ou entéléchie) est capable d'émission spontanée et se transforme en énergie cinétique d'une nouvelle action. Cet échange énergétique constant est la source de l'auto-propulsion, de l'auto-développement d'un organisme vivant, sans lequel aucun environnement extérieur n'est capable de le sortir de l'état de mort spirituelle, d'indifférence et de vide. La vie spirituelle ne commence pas par l'échange d'informations, mais par le début d'une action cognitive et en même temps passionnée, affective et volontaire, qui conduit finalement à une « action intelligente » (pas seulement au sens théologique). Lorsque la psychologie cognitive apprendra à prendre en compte et à étudier tout cela, elle deviendra simplement la psychologie - la science de l'âme, vers laquelle évoluent lentement mais sûrement tous les domaines de la science psychologique qui se respectent. Après tout, le mot psychologie se suffit à lui-même ; il caractérise de manière exhaustive notre science. Tout adjectif à ce mot indique la partialité des orientations scientifiques, de certaines théories ou la modestie des affirmations de leurs auteurs (même si trop d'entre eux ignorent ces derniers). Le développement de la psychologie cognitive a commencé avec l'étude déjà mentionnée de la mémoire iconique par J. Sperling. Malgré le débat long et encore inachevé sur les mécanismes de « l'icône », le fait même de son existence ne fait aucun doute. La technique méthodologique de reproduction partielle selon les instructions post-stimulus a montré que le volume de stockage est trois à quatre fois supérieur au volume de reproduction, qui a été utilisé pour juger du volume de perception, d'attention et de mémoire à court terme pendant plus d'un an. siècle. Les recherches de Sperling ne sont pas le fruit de certains nouvelle fonctionnalité (néoplasme, artefact, artefact, etc.), comme ce fut le cas, par exemple, dans l'étude d'A.N. Léontiev et A.V. Zaporozhets sur la formation de la capacité des sujets testés à distinguer les couleurs de la peau de la paume. Il s’agit de l’identification de capacités jusqu’alors inconnues de notre mémoire. De même, la vitesse de numérisation des documents alphabétiques et numériques s'est avérée être de 100 à 120 caractères par seconde. De plus, on peut débattre longtemps pour savoir s'il s'agit d'une analyse ou d'un filtrage, mais le fait demeure un fait. Cela peut facilement se répéter, même si pour la personne moyenne, cela ressemble à un phénomène paranormal. En effet, il est difficile d'admettre que la présence d'un registre sensoriel, d'une mémoire iconique, est le grand mnémoniste Shereshevsky (décrit par A.R. Luria), assis à l'intérieur de chacun de nous. Mais cette mémoire absolue, heureusement pour nous, se caractérise par une durée de stockage plus courte que la sienne. Et bon nombre de ces faits ont été obtenus dans un laps de temps relativement court. Sans les prendre en compte et sans les expliquer, la psychologie générale et expérimentale dans son sens habituel ne peut exister et se développer davantage. La principale réalisation de la psychologie cognitive est la création d'une sorte de sondes à l'aide desquelles il est possible de sonder les formes internes d'activité mentale qui ne sont pas adonnées à l'observation et à l'auto-observation. Après de telles investigations, des hypothèses sont construites sur l'image interne de sa structure ou son modèle d'actes cognitifs, qui sont ensuite testées à nouveau, puis de nouveaux modèles sont construits. L’expérimentation en psychologie cognitive a acquis un caractère « industriel ». Consciemment ou inconsciemment, la psychologie cognitive n'a pas suivi la voie de la microscopie des architectures spatiales immobiles, mais la voie de la microscopie du temps, la microscopie du « chronotope » (c'est ainsi que A.A. Ukhtomsky caractérisait en 1927 les premières réalisations de N.A. Bernstein dans le domaine de la psychologie cognitive). domaine de la biomécanique des mouvements, en les comparant avec les réalisations de Leeuwenhoek et Malpighi). Ainsi, la psychologie cognitive est déjà entrée dans le corps de la psychologie, et aucune autre direction psychologique ne peut ignorer ses réalisations. Une autre chose concerne les schémas explicatifs, qui, en science psychologique, sont toujours insuffisants. Ce qui vient d’être dit ne doit en aucun cas être considéré comme une critique de la psychologie cognitive ou de l’auteur du livre du même nom. Il faut plutôt exprimer sa satisfaction (ou son compliment) du fait que R. Solso souligne à plusieurs reprises le caractère hypothétique, voire métaphorique, des modèles proposés par les psychologues cognitifs. Cela suscite le respect de leurs auteurs, et les modèles, les modèles, les modèles... commencent à être perçus avec plus de confiance que les mots, les mots, les mots. .. Et pas seulement parce que progressivement il y a à la fois un échange et un enrichissement mutuel de métaphores cognitives et informatiques. Il y a également une augmentation des connaissances psychologiques. Par conséquent, ce qui a été dit dans cet essai introductif est une anticipation des problèmes auxquels la psychologie cognitive (et la psychologie en général) sera confrontée dans un avenir proche, et des souvenirs de l'héritage que nous ont laissé nos inoubliables professeurs.
V.P. Zinchenko A.I. Nazarov
PRÉFACE À L'ÉDITION RUSSE
Il y a vingt ans, je suis arrivé en Russie pour la première fois depuis Helsinki et, sur la route de Saint-Pétersbourg (alors Léningrad) et de Moscou, je me suis arrêté pour prendre mon petit-déjeuner à Vyborg. Comme j'avais digéré ce repas depuis longtemps, je me souviens avoir pensé au sort qui m'attendait : j'avais une idée assez faible de l'endroit où cette excursion me mènerait et de la durée de mon voyage. Bien sûr, je ne pensais pas qu’un livre sur la psychologie cognitive, qui était alors seulement en projet, serait un jour traduit en russe.
Je suis retourné en Russie en 1981 dans le cadre du programme Fulbright et j'ai enseigné la psychologie cognitive à l'Université de Moscou. Université d'État. À cette époque, la première édition de Cognitive Psychology avait été publiée. J'ai utilisé cette publication dans ma classe et un petit nombre d'exemplaires de ce livre ont été distribués en Union soviétique (à l'époque). Je me souviens de plus d'une occasion où, en arrivant dans une ville isolée, quelqu'un m'a remis un exemplaire de « Psychologie cognitive » et m'a demandé de dédicacer le « précieux » livre. Dans chacun de ces cas, c'est moi qui ai reçu cet honneur bien plus que l'heureux propriétaire du livre. Rester à Moscou à cette époque s'est avéré très intéressant pour moi et m'a apporté une grande satisfaction, car j'ai vu de mes propres yeux à quoi ressemblait la vie en Russie. J'ai vécu dans le bâtiment principal de l'université sur les collines Lénine, j'ai pris le métro, j'ai mangé et bu avec des étudiants de Moscou et mes collègues, j'ai visité des appartements et des datchas russes, j'ai été au théâtre et à l'opéra, j'ai fait de longues promenades dans les parcs et les rues. de nombreuses villes et faisaient la queue pour acheter tout ce dont vous avez besoin pour survivre dans cette métropole enchanteresse. J'ai également pu me familiariser avec la culture, la littérature, la musique, la vie sociale, la politique, la science et la psychologie russes du point de vue des Russes d'origine. Parfois, il me semble, j'ai même réussi à croiser un regard fugace de la mystérieuse « âme russe ». Cette période d'errance a été remplie de voyages dans des villes et villages charmants, où j'ai toujours été accueilli favorablement, sinon sans curiosité, par des collègues généreux et attentionnés et de nouveaux amis. Je pense souvent à l’endroit où se trouvent actuellement ces amis et collègues et à la façon dont mes conférences et mes articles ont affecté leur vie. Bien sûr, ils m’ont influencé ainsi que la façon dont j’ai vu et commencé à comprendre la vie, la culture et la science en Russie.
L'année suivante, après avoir terminé mes fonctions d'enseignant à l'Université d'État de Moscou, j'ai été de nouveau invité à Moscou à l'Académie des sciences et j'ai passé environ six mois à l'Institut de psychologie - l'Institut « Lomov », comme on l'appelait. Ici, j'ai eu à nouveau l'occasion de connaître la Russie de première main et de créer nouveau cercle amis et collègues. Mon enthousiasme pour la diffusion des sciences cognitives dans votre pays est resté débridé pendant plus de deux décennies, et lorsque les droits de traduction de mon livre « Psychologie cognitive » en russe ont été demandés, mon enthousiasme pour ce projet n'a connu aucune limite. Entre les mains de la majorité des personnes alphabétisées de cette planète, un tel livre peut faire tellement de choses que je n'aurais pas pu accomplir au cours d'une douzaine de ma vie. C'était un rêve devenu réalité.
J'exprime ma sincère gratitude à ceux qui ont travaillé sur cette traduction. Je voudrais souligner le brillant travail de N.Yu. Spomior de l'Académie russe de l'éducation sur la traduction du livre, ainsi que sur le travail hautement professionnel du professeur V.P. Zinchenko et le Dr A.I. Nazarova.
Souvent, l'auteur s'adresse à un public inconnu et ne peut qu'imaginer qui sont ses lecteurs et dans quelles circonstances son livre est lu. Cela est particulièrement vrai pour les ouvrages traduits publiés dans un autre pays. J'espère revenir bientôt en Russie et rencontrer face à face certains de ceux qui le liront. Et notre dialogue ne sera plus entravé par les barrières politiques, le temps et la distance qui empêchaient la communication bilatérale dans le passé. Je vous invite donc à écrire avec vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, et les circonstances dans lesquelles vous lisez ce livre.
Je vous suis reconnaissant de m'avoir permis d'entrer dans le temple de votre esprit et j'espère que ce livre sera une nouvelle étape pour nous dans le long et chemin épineuxà l'harmonie internationale, à la sagesse mentale et à l'illumination personnelle.
Robert L. Solso
Département de psychologie
Université du Nevada, Reno
Reno, NV 89557 États-Unis
E-mail: [email protégé]
Nous ne pouvons pas offrir la possibilité de télécharger le livre sous forme électronique.
Nous vous informons qu'une partie de la littérature en texte intégral sur des sujets psychologiques et pédagogiques est contenue dans la bibliothèque électronique MSUPE sur http://psychlib.ru. Si la publication est dans le domaine public, l'enregistrement n'est pas requis. Quelques livres, articles, manuels méthodologiques, les mémoires seront disponibles après inscription sur le site de la bibliothèque.
Les versions électroniques des œuvres sont destinées à être utilisées à des fins éducatives et scientifiques.
Cognition(du latin cognitif - connaissance) est le résultat psychologique de plusieurs processus à la fois, à savoir la perception, l'apprentissage et la réflexion. Le terme « cognition » a été utilisé pour la première fois dans la littérature populaire anglaise en 1602. C'est de là que vient le nom de cette branche de la psychologie.
Une branche spéciale de la psychologie s'occupe du processus de cognition - psychologie cognitive. En tant qu'indépendant direction scientifique elle est apparue au début des années 1960. contrairement au behaviorisme dominant aux États-Unis à cette époque. Il était incapable de décrire la conversation la plus simple entre un touriste à la recherche du monument culturel dont il avait besoin et un habitant local lui expliquant le chemin à parcourir. Alors que les behavioristes réduisaient toute diversité à la plus simple procédure « stimulus-réponse », qui n’expliquait pas vraiment grand-chose, les cognitivistes construisaient des modèles plus complexes et plus adéquats. Ils ont suggéré que toute réaction, même la plus élémentaire, à un événement (par exemple, la réponse : « Oh, oui, je sais où se trouve cette exposition ») est le résultat de toute une série d'étapes et d'opérations, par exemple la perception , codage d'informations, reproduction d'informations à partir de la mémoire, formation de concepts, formation de jugement et d'énoncés.
Le développement de la psychologie cognitive a été préparé par les travaux de Max Wertheimer, Wolfgang Keller, Kurt Koffka dans le domaine de la psychologie Gestalt, qui ont souligné le rôle de la perception dans l'apprentissage, ainsi que par les travaux de K. Lewin et E. Tolman, qui a montré la dépendance du comportement humain à l'égard de sa représentation subjective de la réalité environnante - les cartes cognitives de Jean Piaget et Lev Vygotsky, qui ont étudié le développement intellectuel des enfants. Son fondateur est considéré comme le psychologue américain Ulric Neisser, dont le livre (Cognitive Psychology, 1967) a ouvert un nouveau champ de recherche et donné le nom à toute une branche de la connaissance.
La psychologie cognitive étudie la manière dont les individus acquièrent des informations sur le monde qui les entoure, comment ces informations sont codifiées, comment elles sont stockées en mémoire et comment elles sont converties en connaissances, qui à leur tour influencent le comportement. Il couvre toute la gamme des processus psychologiques - de la sensation à la perception, en passant par la reconnaissance des formes, l'attention, l'apprentissage, la mémoire, la formation des concepts, la pensée, l'imagination, la mémorisation, le langage, l'émotion et les processus de développement ; il couvre tous les domaines de comportement possibles. Selon R. Solso, la psychologie cognitive moderne emprunte des théories et des méthodes à 10 domaines principaux de recherche : perception, reconnaissance de formes, attention, mémoire, imagination, fonctions du langage, psychologie du développement, pensée et résolution de problèmes, intelligence humaine et intelligence artificielle.
Initialement, la tâche principale de la psychologie cognitive était d'étudier les transformations de l'information sensorielle à partir du moment où un stimulus frappe les surfaces du récepteur jusqu'à la réception de la réponse (D. Broadbent, S. Sternberg). Les chercheurs sont partis de l'analogie entre les processus de traitement de l'information chez l'homme et dans un appareil informatique. De nombreux composants structurels (blocs) des processus cognitifs et exécutifs ont été identifiés, dont la mémoire à court et à long terme (J. Sperling, R. Atkinson), le rôle décisif de la connaissance dans le comportement du sujet a été montré (U. Neisser ), l'étude de l'intelligence (J. Piaget, J. Bruner, J. Fodor). La question centrale devient l’organisation des connaissances dans la mémoire du sujet, y compris la relation entre les composantes verbales et figuratives dans les processus de mémorisation et de pensée (G. Bauer, A. Paivio, R. Shepard). Les théories cognitives des émotions sont également intensément développées (S. Schechter). différences individuelles (L. Eysenck) et personnalité (J. Kelly. M. Mahoney).
Méthode principale est une analyse de la microstructure d’un processus psychologique particulier. De nombreux principes de psychologie cognitive sous-tendent la psycholinguistique moderne.
La psychologie cognitive étudie comment les gens reçoivent des informations sur le monde, comment ces informations sont représentées par une personne, comment elles sont stockées en mémoire, converties en connaissances, qui influencent ensuite notre attention et notre comportement. De nombreuses études ont permis de comprendre le rôle déterminant de la connaissance dans le comportement du sujet. De ce fait, il a été possible de poser la question de l'organisation des connaissances dans la mémoire du sujet, y compris la relation entre les composantes verbales (verbales) et figuratives dans les processus de mémorisation et de réflexion (G. Bauer, A. Paivio, R. Shepard).
La psychologie cognitive influence toutes les branches de la psychologie, avec un accent majeur sur l'apprentissage. L'ensemble du processus éducatif est analysé selon D. P. Ozbel, J. Bruner. La psychologie cognitive montre qu'un apprentissage efficace n'est possible que lorsque du nouveau matériel, associé aux connaissances et compétences existantes, est inclus dans la structure cognitive existante.
Un modèle couramment utilisé par les psychologues cognitifs est appelé modèle de traitement de l’information. Les modèles cognitifs qui s'appuient sur le modèle de traitement de l'information sont utilisés pour organiser le corpus de littérature existant, stimuler la poursuite des recherches, coordonner les efforts de recherche et faciliter la communication entre les scientifiques.
Traitement de l'information est l’approche principale de la psychologie cognitive. Dans ce cas, le système cognitif humain est considéré comme un système doté de dispositifs de saisie, de stockage et de sortie d'informations, en tenant compte de son débit. Il n'est pas surprenant que ce modèle rappelle beaucoup une machine bien connue - un ordinateur.
Afin de comprendre les mécanismes de collecte d'informations, vous devez comprendre le système d'interprétation des signaux sensoriels et apprendre à reconnaître des modèles. La reconnaissance de formes consiste à faire correspondre des stimuli à ce qui est stocké à long terme (mémoire). Par exemple, une personne ne connaît pas beaucoup de marques de voitures, mais lorsqu'elle voit une voiture, son cerveau identifie inconsciemment qu'il s'agit d'une voiture. Il ne connaît peut-être pas la marque, mais il dira avec assurance qu'il s'agit d'une voiture.
La psychologie cognitive part du fait que la cognition en général et la perception en particulier sont des formes d'activité. Cette activité est réalisée à l'aide d'un type particulier d'outils psychologiques (moyens), que Neisser appelle schémas ou cartes cognitives.
Carte cognitive- une image d'un environnement spatial familier. En psychologie, ils créent des cartes divers degrés communauté, « échelle » et organisation, distinguent une carte de chemin comme une représentation séquentielle des connexions entre les objets le long d'un certain itinéraire, et une carte d'ensemble comme une représentation simultanée de la localisation spatiale des objets. Pour les étudier, différentes techniques sont utilisées : du simple croquis à la mise à l'échelle multidimensionnelle, qui permet de restituer la structure de l'image en fonction des résultats d'estimations métriques ou ordinales des distances entre les points de la carte. Ces études ont révélé une tendance à surestimer les distances connues et à sous-estimer les distances inconnues, à redresser les courbes avec dans une faible mesure courbure, se rapprochant des intersections des perpendiculaires. Le fait que les points cartographiques appartiennent à des unités taxonomiques différentes peut également contribuer aux distorsions. En particulier, la distance entre les villes situées dans un même pays apparaît plus petite que la distance entre les villes différents pays, même si en fait ils sont égaux.
Le terme « carte cognitive » a été introduit par E. Tolman, et W. Neisser l'a compris comme synonyme du mot « schéma indicatif », soulignant qu'il s'agit d'une structure active visant à rechercher des informations, et pas seulement une image mentale de l'environnement, qui « peut être examiné à loisir. » avec l'œil intérieur.
En analysant le comportement des rats dans un labyrinthe, Tolman est arrivé à la conclusion qu'en parcourant un labyrinthe, un rat forme une structure spéciale, que l'on peut appeler une carte cognitive de l'environnement. "Et c'est cette carte approximative, indiquant les chemins (itinéraires) et les lignes de comportement ainsi que les interrelations des éléments environnementaux, qui détermine en fin de compte le type de réponses, le cas échéant, que l'animal fera finalement."
Les cartes cognitives se trouvent non seulement chez les adultes qui ont la parole et la conscience, mais même chez les jeunes enfants qui peuvent se déplacer avec succès dans leur maison, du moins dans les pièces qu'ils visitent souvent et où se trouvent les objets qui sont importants pour eux. En ce sens, une carte des transports en commun vers un magasin ou un bureau publiée sur Internet est une carte cognitive. Le scientifique anglais K. Eden a proposé d'utiliser des cartes cognitives pour la prise de décision et la prise de décision collectives4. DANS psychologie moderne En pédagogie, une carte cognitive est un graphe orienté arbitrairement signé, qui peut être considéré comme un protocole du processus de réflexion, de compréhension des alternatives de vie et de ses propres positions dans le cadre d'une situation de « prise de décision ».
Ainsi, une carte cognitive peut être comprise comme une description schématique et simplifiée de la vision du monde d’un individu, ou plus précisément, un fragment de celle-ci lié à une situation problématique donnée. Psychologues Dernièrement utiliser ce terme dans un sens étroit, uniquement pour décrire les relations spatiales. Selon la juste remarque de Yu. M. Plotinsky, le terme « carte cognitive » est très étroitement lié à l'image du monde.
Le philosophe français Nicolas Malebranche (1638-1715) appelait celles qui établissent des liens logiques entre les phénomènes les vraies sciences, et appelait toutes les autres « popimatia » (je-sais-tout).
Psychothérapie cognitive- une méthode psychothérapeutique développée par A. T. Beck. Il soutient que la connaissance est raison principale l'émergence d'émotions, y compris négatives, qui, à leur tour, déterminent le sens d'un comportement holistique. Des réponses aux questions « comment je me vois ? », « quel avenir m'attend ? » et "qu'est-ce que le monde? ne sont pas toujours administrés de manière adéquate. Par exemple, un patient déprimé se considère comme un être bon à rien et sans valeur, et son avenir lui apparaît comme une suite interminable de tourments. De telles évaluations ne correspondent pas à la réalité, mais le patient n'est pas pressé de les vérifier, craignant la confirmation de ses craintes.
On pense que l’essor de la psychologie cognitive est dû à la fascination générale pour les idées de la cybernétique dans les années 1960. C'est à cette époque que furent conçus les premiers ordinateurs électroniques - ce qui jusqu'alors était totalement inconnu. inconnu des gens. L’« intelligence » de l’ordinateur a bien sûr donné naissance à l’idée de comparer le travail du cerveau avec celui d’un ordinateur. Ainsi, la perception est devenue un processus de saisie d'informations dans le cerveau-ordinateur, la mémoire est devenue un mécanisme de stockage d'informations dans les cellules mémoire du cerveau, la pensée est devenue un processus de traitement de l'information, résultat du travail de certains programmes dans le cerveau-ordinateur.
Les psychologues ont été les premiers à considérer l'homme comme un système cybernétique doté de circuits d'information de contrôle. La recherche était basée sur la « métaphore informatique » - une analogie entre la transformation de l'information dans un appareil informatique et la mise en œuvre de processus cognitifs chez l'homme. De nombreux composants structurels (blocs) des processus cognitifs et exécutifs, principalement la mémoire, ont été identifiés (R. Atkinson).
Recherche en psychologie et en éthique communication d'entreprise, menées dans les pays occidentaux, s'appuient sur certaines dispositions du droit général et la psychologie sociale lors de la résolution de problèmes théoriques et méthodologiques. À cette fin, les principes fondamentaux de domaines tels que le behaviorisme, la psychologie cognitive, la psychologie Gestalt, la théorie des champs, la psychanalyse, la psychologie humaniste et l'interactionnisme sont utilisés. Cette révolution générale des vues et des conceptions fondamentales sur l'essence, le sujet et les méthodes de la science psychologique, qui a maintenant pris des formes particulièrement nettes et vivantes en Russie, ne peut bien sûr passer sans laisser de trace et inaperçue pour l'ensemble du domaine appliqué de la psychologie. . Si dans le domaine de la connaissance théorique il y a un effondrement radical des concepts et des idées anciens, une restructuration fondamentale des idées et des méthodes, alors dans les disciplines appliquées, représentant des branches du tronc commun, de même ces processus douloureux et fructueux de destruction et de restructuration du le système scientifique tout entier sont inévitables. La restructuration des idées psychologiques qui s'opère aujourd'hui provoque directement un changement radical dans les vues scientifiques sur l'essence même de la psychologie. processus pédagogique. On peut dire qu'ici, pour la première fois, l'éducation se révèle dans sa véritable essence scientifique, que pour la première fois ici, l'enseignant trouve le terrain pour parler non pas de suppositions et de métaphores, mais du sens exact et des lois scientifiques du travail éducatif.
1. Caractéristiques de l'essence du behaviorisme en tant que science qui étudie le comportement de manière objective
Le behaviorisme est une direction de la psychologie du XXe siècle, qui considère que le sujet de la psychologie est le comportement, qui est compris comme un ensemble de réactions physiologiques d'un individu à des stimuli externes. behaviorisme (de mot anglais comportement) ou la psychologie comportementale. Son prémisse expérimentale a commencé l'étude du comportement animal menée par E. Thorndike (1874-1949). Beaucoup de ses découvertes ont été prises en compte pour expliquer le comportement humain. Il pensait que la pédagogie devait être basée sur la psychologie du comportement. E. Thorndike est le fondateur de la psychologie comportementale et de la psychologie objective. Il considère la psyché et le comportement humains comme un système de réactions du corps à des stimuli internes et externes.
En 1913, John Watson (1878-1958) formule les principes fondamentaux de la psychologie comportementale. Le principe principal n’est pas de s’étudier soi-même, mais d’étudier le comportement d’un voisin. De cette façon, une personne explique son propre comportement. Watson croyait que l'étude de soi est une évaluation subjective et que le behaviorisme examine les phénomènes psychologiques de manière objective. Par conséquent, il faut étudier le comportement des autres personnes et leurs réactions aux influences environnementales, c'est-à-dire des incitations. C’est l’essence et le sens du behaviorisme. Beaucoup de ses dispositions expliquent l’influence de facteurs externes sur le comportement, les activités et la communication interpersonnelle des personnes.
Les behavioristes ont étudié le comportement et l'activité. L'activité - externe et interne - était décrite à travers le concept de « réaction », qui incluait les changements dans le corps qui pouvaient être enregistrés par des méthodes objectives - cela inclut les mouvements et, par exemple, l'activité sécrétoire.
Comme méthode descriptive et explicative, D. Watson a proposé Diagramme S-R, selon lequel l'impact, c'est-à-dire le stimulus (S) donne lieu à un certain comportement de l'organisme, c'est-à-dire réaction (r) et, surtout, dans les idées du behaviorisme classique, la nature de la réaction est déterminée uniquement par le stimulus. À cette idée était associé programme scientifique Watson - apprenez à gérer le comportement. En effet, si la réponse est déterminée par le stimulus, il suffit alors de sélectionner les bons stimuli pour obtenir le comportement souhaité. Par conséquent, il est nécessaire de mener des expériences visant à identifier les modèles par lesquels se forment les connexions stimulus-réaction, d'organiser une surveillance attentive des situations et d'enregistrer les manifestations comportementales en réponse à l'influence d'un stimulus.
Les principes du behaviorisme classique semblent simplifiés. La pratique expérimentale ultérieure n'a pas confirmé la validité du schéma original comme universel : en réponse au même stimulus, différentes réactions peuvent suivre, et la même réaction peut être stimulée par différents stimuli. La dépendance de la réponse au stimulus n’a pas été remise en question ; cependant, la question s'est posée de savoir s'il existe quelque chose qui détermine la réaction, en plus du stimulus, ou plus précisément, en interaction avec lui. Les chercheurs qui ont développé les idées de Watson ont proposé d'introduire un exemple supplémentaire dans l'argument. Habituellement désigné par le concept de « variables intermédiaires », c'est-à-dire certains événements dans le corps qui sont affectés par le stimulus et qui, n'étant pas une réaction au sens strict (puisqu'ils ne peuvent pas être enregistrés objectivement), déterminent également la réponse. (Diagramme S-O-R).
L'un des behavioristes les plus faisant autorité est B. Skinner, qui a suggéré que le comportement peut être construit sur un principe différent, à savoir déterminé non pas par le stimulus précédant la réaction, mais par les conséquences probables du comportement. Cela ne signifie pas la liberté de comportement (même si dans le cadre de son approche le problème de « l'auto-programmation » humaine est abordé) ; En général, cela signifie qu'après avoir vécu une certaine expérience, un animal ou une personne aura tendance à la reproduire si elle a eu des conséquences agréables, et à l'éviter si les conséquences ont été désagréables. En d’autres termes, ce n’est pas le sujet qui choisit le comportement, mais les conséquences probables du comportement qui contrôlent le sujet.
En conséquence, le comportement peut être manipulé en récompensant (c'est-à-dire en renforçant positivement) certains comportements et en les rendant ainsi plus susceptibles de se produire ; C’est la base de l’idée d’apprentissage programmé proposée par Skinner, qui prévoit une maîtrise « pas à pas » d’une activité avec un renforcement pour chaque étape.
Une direction particulière dans le cadre du behaviorisme est le sociobehaviorisme, qui s'est formé le plus activement dans les années 60. Ce dont nous avons parlé est nouveau dans l'idée qu'une personne peut maîtriser un comportement non pas par ses propres essais et erreurs, mais en observant les expériences des autres et les renforcements qui accompagnent tel ou tel comportement (« apprentissage par observation », « apprentissage sans essai" Cette différence importante suppose que le comportement humain devient cognitif, c'est-à-dire comprend une composante cognitive indispensable, notamment symbolique. Ce mécanisme s'avère être le plus important dans le processus de socialisation ; sur sa base, des méthodes de mise en œuvre d'un comportement agressif et coopératif se forment, ce qui peut être illustré par l'expérience du principal psychologue de cette direction, le Canadien Albert Bandura.
Les représentants du néobehaviorisme Edward Chase Tolman (1886-1959) et Clark Leonard Hall (1884-1952) ont tenté d'expliquer du point de vue de la méthodologie du behaviorisme activité mentale personne. Ils ont inventé le concept de « médiateurs » – des processus internes se produisant entre le stimulus et la réponse. Dans le même temps, ils sont partis du fait que pour les « médiateurs invisibles », il devrait y avoir les mêmes indicateurs objectifs que ceux utilisés lors de l'étude des stimuli et des réactions accessibles à l'observation externe. Cependant, leur concept s’est avéré peu convaincant d’un point de vue scientifique et a largement perdu de son influence. Il y a eu un retour au behaviorisme classique, notamment exprimé dans les travaux de Burres Frederick Skinner (né en 1904).
2. Principes de base de la psychologie cognitive. Théories cognitives.
Les positions des behavioristes ont été critiquées par les représentants de la psychologie cognitive. Ils partent du fait que le comportement humain est déterminé à la fois par l'influence des conditions environnementales sur lui et par ses capacités mentales. Le mot « cognition » vient du latin cogponsere et signifie connaître, savoir.
Cette direction a été lancée par les recherches de U. Neisser. Les idées de la psychologie cognitive, qui révèle le rôle de la conscience des gens dans leur comportement, ont également été étayées par les travaux des psychologues américains J. Kelly, J. Rotter, A. Bandura et d'autres représentants de cette direction. Le principal problème pour eux est « l’organisation des connaissances dans la mémoire du sujet ». Ils croient que les connaissances d'une personne sont organisées en certains schémas conceptuels au sein desquels elle pense et agit. On soutient que « la perception, la mémoire, la pensée et autres les processus cognitifs sont déterminées par des schémas de la même manière que la structure de l’organisme par génotype.
Approche cognitive dans l'étude du comportement humain conscient, il y a le désir de comprendre comment nous déchiffrons les informations sur la réalité et les organisons afin de faire des comparaisons, de prendre des décisions ou de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés à chaque minute.
La psychologie des constructions personnelles est l'une des variantes de l'approche cognitive de l'étude du comportement, développée dans la théorie de George Kelly (1905-1967). Son principe initial est que différentes personnes perçoivent et évaluent différemment les phénomènes de la réalité et, en relation avec cela, prennent des décisions différentes et alternatives qui leur permettent d'accomplir leurs tâches urgentes. Cette approche est qualifiée d’alternative constructive. Le scientifique justifie la proposition sur la nature sélective du comportement humain, qui, parmi un certain nombre de possibilités alternatives, choisit celles qui sont assez spécifiques, de son point de vue les plus optimales dans une situation donnée. Dans ce cas, une personne agit comme un chercheur qui avance diverses sortes d'« hypothèses de travail » concernant la réalité et le choix d'une option possible pour son comportement. Cette approche permet non seulement de se comporter correctement sur le moment, mais aussi d'anticiper le cours des événements, ainsi que de contrôler son comportement. En même temps, il « contrôle les événements en fonction des questions posées et des réponses trouvées. Selon J. Kelly, toute personne comprend et évalue les phénomènes de l'environnement extérieur et détermine les options de sa maîtrise en fonction des schémas ou modèles conceptuels qu'elle construit, qu'il appelle constructions personnelles. Il caractérise une construction personnelle comme « une manière stable par laquelle une personne comprend certains aspects de la réalité en termes de similitude et de contraste ».
Kelly note que si telle ou telle construction personnelle ou schéma conceptuel se justifie lors de l'évaluation de la réalité et du choix d'une action par telle ou telle personne, alors il en part plus loin. Dans le cas contraire, il la rejette et en construit une autre. Il est souligné que les constructions personnelles ne sont pas encombrées de manière chaotique dans la conscience d’une personne, mais sont organisées d’une certaine manière et fonctionnent dans un système particulier. Nous parlons de leur organisation hiérarchique, ou « pyramidale », de sorte que certains d’entre eux sont « dans une position subordonnée », tandis que d’autres sont dans une position « subordonnée » par rapport aux autres parties du système.
La thèse est largement étayée selon laquelle le système de constructions personnelles (schémas conceptuels), formés au cours du processus d'interaction consciente d'une personne avec l'environnement naturel et social externe, détermine ses larges possibilités alternatives dans le choix de ses actions et élargit ainsi l'étendue de sa liberté. . Dans la théorie des constructions de personnalité de J. Kelly, « les gens sont présentés comme libres et dépendants de leur propre comportement ». Un certain nombre de points importants ont été soulignés par A. Bandura et J. Rotter dans le cadre de leur approche socio-cognitive de l'étude de la psyché humaine et de son comportement.
L'apprentissage par observation est l'idée principale de la théorie d'Albert Bandura (né en 1925). Le fait est que capacités de réflexion une personne se développe en observant des phénomènes dans l'environnement externe, notamment social. Et il agit conformément à ses observations. Bandura justifie la capacité humaine. Vers une autorégulation, notamment, pour garantir que, lorsqu’on agit en fonction de la situation, on tienne compte de la nature de l’influence de ses actions sur les autres et de leurs réactions possibles à ces actions. Ainsi, il devient possible de prévoir les conséquences de ses propres actions et de réguler et modifier son comportement en conséquence.
En plus des observations, le scientifique attribue une grande importance dans le comportement conscient d'un individu à des manifestations de la conscience d'une personne telles que l'attention et les motivations qui l'incitent à agir dans un sens ou dans l'autre. Nous parlons de motivation incitative pour le comportement des personnes, découlant de leurs besoins, intérêts, objectifs, etc. En évaluant les expériences passées de réussites et d'échecs dans le but d'atteindre les résultats souhaités, une personne construit elle-même son comportement en fonction de ses besoins et de ses intérêts.
Sans aucun doute, A. Bandura « donne la priorité à la réflexion consciente sur les déterminants inconscients du comportement ». En d’autres termes, il place des objectifs significatifs avant son instinct ou son intuition. Cela augmente la possibilité de maîtrise de soi dans le comportement et les activités des personnes, notamment en tenant compte de la mesure dans laquelle le comportement d’une personne répond aux conditions de l’environnement extérieur et de son efficacité pour son affirmation sociale. Le problème de l'élaboration d'un programme de maîtrise de soi et de sa mise en œuvre est posé et résolu.
Dans sa théorie de l'apprentissage social, Julian Rotter (né en 1916) explore le problème de l'influence des facteurs sociaux sur le développement du psychisme humain, principalement ses relations avec les autres. L’influence des situations sociales sur le développement de la conscience et de la conscience de soi d’une personne, y compris la formation de motivations conscientes pour son comportement, est explorée.
J. Rotter a introduit dans la science de la psychologie de la personnalité le concept de potentiel comportemental, qui exprime la probabilité de l'un ou l'autre comportement en fonction de la nature de l'influence de facteurs sociaux externes sur celui-ci. En cela, il est d'accord avec l'opinion de A. Bandura, qui affirme que la conscience d'une personne, qui détermine son comportement, se forme dans une large mesure sous l'influence de circonstances extérieures, principalement sociales. Dans le même temps, le rôle de ces circonstances dans la formation des objectifs d'activité et de l'ensemble du système de motivation interne d'une personne est indiqué.
Conclusion
Approche comportementale de la personnalité, portée par B.F. Skinner fait référence aux actions manifestes des gens en fonction de leurs expériences de vie. Skinner a soutenu que le comportement est déterministe, prévisible et contrôlé par l'environnement. Il a catégoriquement rejeté l'idée de facteurs internes « autonomes » comme cause des actions humaines et a négligé l'explication physiologique et génétique du comportement. Skinner a identifié deux principaux types de comportement : le comportement du répondant, qui est une réponse à un stimulus familier, et le comportement opérant, qui est déterminé et contrôlé par le résultat qui le suit. Le travail de Skinner se concentre presque entièrement sur le comportement opérant. Dans le conditionnement opérant, l’organisme agit sur son environnement pour produire un résultat qui affecte la probabilité que le comportement se répète. Une réponse opérante suivie d'un résultat positif a tendance à se répéter, tandis qu'une réponse opérante suivie d'un résultat négatif a tendance à ne pas se répéter. Selon Skinner, le comportement peut être mieux compris en termes de réactions à l'environnement.
Il est assez difficile de parler de la psychologie comme d'une science unique au stade actuel : chaque direction propose sa propre compréhension de la vie mentale, propose ses propres principes explicatifs et, par conséquent, concentre les efforts sur l'analyse de certains aspects de ce qu'elle comprend comme réalité mentale. Dans le même temps, on a assisté récemment à une convergence d'un certain nombre de directions - ou du moins à une tendance vers une plus grande tolérance les unes envers les autres, ce qui signifie la possibilité d'un dialogue et d'un enrichissement mutuel.
Bibliographie
- Psychologie et éthique de la communication d'entreprise : un manuel pour les étudiants universitaires / Ed. V.N. Lavrinenko. - 5ème éd., - M. : UNITY-DANA, 2006.
- Nemov R.S. Psychologie : Manuel destiné aux étudiants des établissements pédagogiques supérieurs. En 2 livres - M. : Lumières - Vlados, 1994.
- Petrovsky A.V., Yaroshevsky M.G. Psychologie : Manuel pour les étudiants des établissements d'enseignement pédagogique supérieur - M. : Académie, 1998.
- Dictionnaire psychologique (Ed. Zinchenko V.P., Meshcheryakova B.G. - M. : Pédagogie - Presse, 1999.
" Principales orientations
Psychologie cognitive (cognitivisme)
La psychologie cognitive est une branche de la science psychologique moderne qui étudie les processus cognitifs. Elle trouve son origine dans les travaux de Wolfgang Köhler (1917) sur les singes et dans les observations de Jean Piaget sur le développement de l'intelligence des enfants (1927).
Elle a pris forme en tant que domaine indépendant dans les années 1950 et au début des années 1960, lorsque D. Miller et D. Bruner ont créé le premier Centre de recherche cognitive à l’Université Harvard en 1960.
Des représentants bien connus du cognitivisme sont également R. Atkinson, L. Festinger, D. Kelly et d'autres.
Les principales conditions préalables à son apparition :
- l'incapacité du behaviorisme et de la psychanalyse à expliquer le comportement humain sans faire appel à des éléments de conscience ;
- développement de systèmes informatiques et cybernétiques;
- développement de la linguistique moderne.
Les réalisations les plus célèbres de la psychologie cognitive :
- la théorie de l'attribution causale (la théorie selon laquelle les gens expliquent le comportement des autres) ;
- théorie des constructions personnelles de D. Kelly (affirme que chaque événement est reconnu et interprété personnes différentes différemment, puisque chaque individu est doté d’un système unique de constructions ou de schémas).
Le mot « cognitif » vient de Verbe latin coghoscere - savoir.
Cognition est une désignation collective des efforts délibérés déployés pour trouver, reconnaître, reconnaître, comprendre, distinguer, classer, discuter des objets, ainsi que les traiter, c'est-à-dire les modifier par des opérations mentales (de la concrétisation à l'abstraction).
Les psychologues qui se sont unis autour de cette approche soutiennent qu'une personne n'est pas une machine qui réagit aveuglément et mécaniquement aux stimuli ( facteurs internes ou des événements dans le monde extérieur). Au contraire, l'esprit humain dispose de bien plus : analyser des informations sur la réalité, faire des comparaisons, prendre des décisions, résoudre les problèmes qui se posent à lui à chaque minute.
Ainsi, le cognitivisme repose sur l'interprétation d'une personne comme un être qui comprend, analyse, car il se trouve dans le monde de l'information qui doit être comprise, évaluée et utilisée.
Autrement dit, la psychologie cognitive est différente des théories comportementales" stimulus - réponse" en ce sens qu'elle ne suppose pas une direction unilinéaire de causalité du comportement, mais est guidée par la théorie de l'autorégulation et de l'auto-organisation des systèmes étudiés. De là, on distingue d'autres paradigmes méthodologiques du cognitivisme, visant des connexions systémiques complexes dans le processus de cognition.
Les principaux objets d'étude sont les processus cognitifs tels que la perception, la mémoire, la pensée, l'attention, l'imagination et la parole. La reconnaissance de formes, l’intelligence artificielle et humaine sont également des domaines d’intérêt de la psychologie cognitive.
Représentants :
Jean Piaget.
Sujet d'étude.
Dépendance du comportement du sujet aux processus cognitifs.
La tâche de la psychologie cognitive était d'étudier le traitement de l'information à partir du moment où elle atteint les surfaces réceptrices jusqu'à ce que la réponse soit reçue.
Une personne n'est pas une machine qui réagit aveuglément et mécaniquement à des facteurs internes ou à des événements du monde extérieur ; au contraire, l'esprit humain est capable de faire plus : analyser des informations sur la réalité, faire des comparaisons, prendre des décisions, résoudre les problèmes auxquels il est confronté à chaque instant. minute.
Le développement de l'intelligence d'un enfant résulte d'une recherche constante d'équilibre entre ce que l'enfant sait et ce qu'il s'efforce de savoir.
Les actions extérieures peuvent être différentes, puisque les pensées et les sentiments étaient différents.
Pratique.
Développement de programmes de formation destinés à développer l'intelligence et l'examen scientifique des témoignages.
Travail, analyse, création de théorie appliquée.
Contribution.
Introduction des notions de mémoire à court terme et à long terme.
Il existe une variabilité interne dans les schémas d’interprétation personnels actualisés dans des situations spécifiques, ce qui amène les gens à prédire de manière inexacte leur propre comportement futur.
Psychologie humaniste.
Représentants :
Opport, Murray, Murphy, May, Maslow, Rogers.
Sujet d'étude.
Une personnalité unique et inimitable, en constante création, consciente de son but dans la vie.
Etudes santé personnalités harmonieuses qui ont atteint le summum du développement personnel, le summum de la « réalisation de soi ».
Principes théoriques de base.
Basé sur la hiérarchie des besoins humains.
Réalisation de soi.
Conscience de sa propre valeur.
Besoins sociaux.
Besoins de fiabilité.
Besoins physiologiques fondamentaux.
L’inadéquation de la recherche animale à la compréhension humaine.
Utilisation pratique.
La psychologie humaniste est une direction moderne de la science psychologique.
Certaines techniques et concepts s'appliquent. Aujourd'hui c'est:
Personnalité de base holistique qui se réalise.
Étapes de dégradation de la personnalité.
Rechercher le sens de la vie.
Contribution.
La psychologie humaniste s'oppose à la construction de la psychologie sur le modèle des sciences naturelles et soutient qu'une personne, même en tant qu'objet de recherche, doit être étudiée en tant que sujet actif, évaluant la situation expérimentale et choisissant une méthode de comportement.
Psychologie transpersonnelle.
Représentants :
K. Jung, R. Assagioli, A. Maslow, S. Groff.
Sujet d'étude.
Accorder une grande attention à l’inconscient et à sa dynamique.
La psyché est l'interaction de composants conscients et inconscients avec un échange continu entre eux.
Les études transpersonnelles modifient les états de conscience, dont les expériences peuvent conduire une personne à un changement de valeurs fondamentales, à une renaissance spirituelle et à l'acquisition de l'intégrité.
Principes théoriques de base.
Les complexes sont un ensemble d'éléments mentaux (idées, opinions, attitudes, croyances) réunis autour d'un noyau thématique et associés à certains sentiments.
Structure de la personnalité :
conscience
inconscient individuel
inconscient collectif
Utilisation pratique.
Les traumatismes psychologiques et physiques vécus par une personne tout au long de sa vie peuvent être oubliés au niveau conscient, mais sont stockés dans la sphère inconsciente du psychisme et affectent le développement de troubles émotionnels et psychosomatiques.
Manipulation sensible du nouveau-né, reprise de l'interaction symbiotique avec la mère, temps suffisant consacré à l'établissement d'une connexion - tels sont probablement les facteurs clés qui peuvent neutraliser les méfaits du traumatisme à la naissance.
La psyché humaine est essentiellement proportionnelle à l’Univers tout entier et à tout ce qui existe.
Contribution.
La principale caractéristique distinctive de l’Approche Trans est le modèle l'âme humaine, qui reconnaît « l’importance des dimensions et des possibilités spirituelles et cosmiques pour l’évolution de la conscience ».