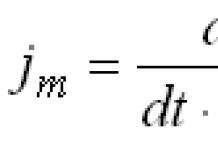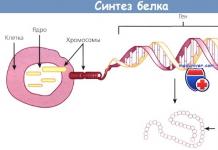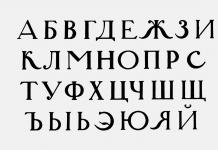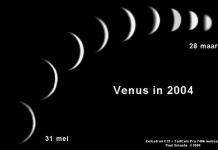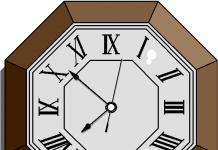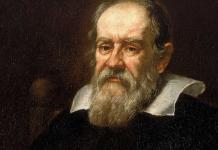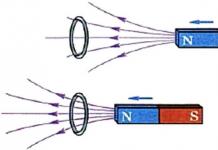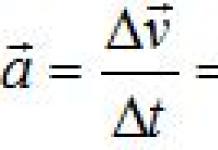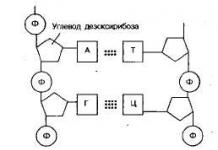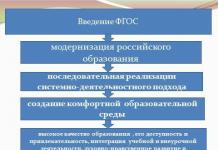La naissance des enfants est une joie, et dans la famille impériale c'est une double joie, surtout si un garçon naît, puisque les garçons assuraient la « stabilité » de la dynastie régnante. En général, depuis l'époque de Paul Ier, qui avait quatre fils, le problème de l'héritier s'est posé tout au long du XIXe siècle. N'était pas pertinent pour la famille impériale. Il y avait toujours une « réserve » le long d'une ligne descendante directe, qui permettait au pays de remplacer les « retraités » par des moyens indolores. raisons diverses empereurs ou princes héritiers.
Toutes les impératrices russes ont accouché chez elles, c'est-à-dire dans les résidences impériales dans lesquelles elles se trouvaient au moment de leur naissance. En règle générale, lors de l'accouchement ou à proximité immédiate de la salle d'accouchement, tous les proches qui se trouvaient à proximité étaient présents. Et le mari a littéralement « tenu la main de sa femme » alors qu’il était à la maternité. Cette tradition remonte au Moyen Âge, afin de vérifier la véracité de la famille et de l'héritier.


À partir de Paul Ier, toutes les familles impériales eurent de nombreux enfants. Il ne pouvait être question de contrôle des naissances. Les impératrices, les princesses héritières et les grandes-duchesses ont accouché autant que « Dieu a donné ». Le père de famille exemplaire Nicolas Ier et sa femme ont eu 7 enfants, quatre fils et trois filles. Dans la famille d'Alexandre II et de l'impératrice Maria Alexandrovna, malgré la mauvaise santé de cette dernière, il y avait huit enfants - deux filles et six fils. Dans la famille Alexandra III et l'impératrice Maria Feodorovna eurent six enfants, dont l'un mourut en jeune âge. Il reste trois fils et deux filles dans la famille. Cinq enfants sont nés dans la famille de Nicolas II. Pour Nicolas, l'absence d'héritier pourrait avoir de graves conséquences politiques - de nombreux parents masculins issus des branches les plus jeunes de la dynastie des Romanov étaient prêts avec un grand désir à hériter du trône, ce qui ne convenait pas du tout aux époux royaux.

La naissance d'enfants dans la famille de Nicolas II.
La première naissance de l'impératrice Alexandra Feodorovna fut difficile. Le journal de Nikolaï mentionne l'heure - d'une heure du matin jusqu'à tard le soir, soit presque une journée. Comme l'a rappelé la sœur cadette du tsar, la grande-duchesse Ksenia Alexandrovna, « le bébé a été traîné avec des pinces ». Tard dans la soirée du 3 novembre 1895, l'Impératrice donne naissance à une fille que ses parents prénomment Olga. L'accouchement pathologique aurait été causé à la fois par la mauvaise santé de l'impératrice, qui avait 23 ans au moment de sa naissance, et par le fait qu'elle souffrait de douleurs sacro-lombaires dès l'adolescence. Les douleurs dans les jambes l'ont hantée toute sa vie. Par conséquent, les membres de la famille la voyaient souvent en fauteuil roulant. Après un accouchement difficile, l'Impératrice « ne s'est remise sur pied » que le 18 novembre et s'est immédiatement assise dans un fauteuil roulant. «Je me suis assis avec Alix, qui montait sur une chaise mobile et m'a même rendu visite.»

Grande-Duchesse Olga Nikolaïevna
L'Impératrice a accouché à nouveau moins de deux ans plus tard. Cette grossesse a également été difficile. Au début de la grossesse, les médecins craignaient une fausse couche, puisque les documents mentionnent silencieusement que l'impératrice ne s'est levée du lit que le 22 janvier 1897, c'est-à-dire J'y suis resté environ 7 semaines. Tatiana est née le 29 mai 1897 au palais Alexandre, où la famille a déménagé pour l'été. Le grand-duc Konstantin Konstantinovich a écrit dans son journal : « Le matin, Dieu a donné à Leurs Majestés... une fille. La nouvelle s'est répandue rapidement et tout le monde a été déçu car ils attendaient un fils.

Grande-Duchesse Tatiana Nikolaïevna
En novembre 1998, il s'est avéré que l'Impératrice était enceinte pour la troisième fois. Comme lors de son premier accouchement, elle s'assoit immédiatement dans une poussette, car elle ne peut pas marcher à cause de douleurs aux jambes, et se promène dans les couloirs du Palais d'Hiver « dans des fauteuils ». Le 14 juin 1899, la troisième fille, Maria, est née à Peterhof. La succession des filles dans la famille royale a provoqué un sentiment persistant de déception dans la société. Même les plus proches parents du tsar ont noté à plusieurs reprises dans leurs journaux que la nouvelle de la naissance d'une autre fille avait provoqué un soupir de déception dans tout le pays.

Grande-Duchesse Maria Nikolaïevna
Le début de la quatrième grossesse fut confirmé par les médecins du tribunal à l'automne 1900. L'attente devint insupportable. Dans le journal du grand-duc Konstantin Konstantinovich, il est écrit : « Elle est devenue très jolie... c'est pourquoi tout le monde espère avec impatience. Que cette fois il y aura un fils." Le 5 juin 1901, la quatrième fille du tsar, Anastasia, est née à Peterhof. Extrait du journal de Ksenia Alexandrovna : « Alix se sent bien - mais, mon Dieu ! Quelle déception! Quatrième fille !

Grande-Duchesse Anastasia Nikolaïevna
L'impératrice elle-même était désespérée. Sa cinquième grossesse a commencé en novembre 1901. Comme la famille royale associait cette grossesse exclusivement aux « laissez-passer » du médium de la cour Philippe, elle était cachée même aux proches. Sur la recommandation de Philippe, l'impératrice n'autorisa pas le personnel médical à lui rendre visite avant août 1902, c'est-à-dire presque jusqu'à la date d'échéance. Pendant ce temps, le travail n’a toujours pas eu lieu. Finalement, l'impératrice accepta de se laisser examiner. Après avoir examiné Alix, l'obstétricien Ott a annoncé que « l'Impératrice n'est pas enceinte et n'a jamais été enceinte ». Cette nouvelle a porté un coup terrible au psychisme d’Alexandra Fedorovna. L’enfant qu’elle portait depuis novembre n’existait tout simplement pas. Cela a été un choc pour tout le monde. Un message a été publié dans le Journal officiel du gouvernement selon lequel la grossesse de l'impératrice s'est terminée par une fausse couche. Après cela, la police a ordonné d'exclure de l'opéra "Tsar Saltan" les mots "la reine a donné naissance cette nuit-là soit à un fils, soit à une fille, ni à un chien, ni à une grenouille, mais à un animal inconnu".

L'impératrice avec le tsarévitch Alexeï
Il est paradoxal qu'après une grossesse infructueuse, l'impératrice n'ait pas perdu confiance en Philippe. En 1903, suivant les conseils de Philippe, toute la famille visita l’Ermitage de Sarov. Après avoir visité le village de Diveyevo, l'impératrice tomba enceinte pour la sixième fois. Cette grossesse s'est terminée par la naissance réussie du tsarévitch Alexei le 30 juillet 1904. Nicolas a écrit dans son journal : « Un grand jour inoubliable pour nous, au cours duquel la miséricorde de Dieu nous a si clairement visités. À 1,4 jours, Alix a eu un fils, qui a été nommé Alexei pendant la prière. Tout s’est passé remarquablement vite – du moins pour moi. L'Impératrice a donné naissance à un héritier très facilement, « en une demi-heure ». Dans son carnet, elle a écrit : « poids – 4660, longueur – 58, tour de tête – 38, poitrine – 39, le vendredi 30 juillet à 13h15 ». Dans le contexte de l'agitation festive, les parents royaux étaient préoccupés par l'apparition de signes alarmants d'une terrible maladie. Un certain nombre de documents indiquent que les parents ont appris l'hémophilie de l'héritier littéralement le jour de son anniversaire - le bébé a commencé à saigner de la plaie ombilicale.

Tsarévitch Alexeï
Igor Zimine, " Le monde des enfants résidences impériales. »
Nicolas II (Nikolai Alexandrovich Romanov), fils aîné de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna, est né 18 mai (6 mai, style ancien) 1868à Tsarskoïe Selo (aujourd'hui la ville de Pouchkine, district Pouchkine de Saint-Pétersbourg).
Immédiatement après sa naissance, Nikolaï fut inscrit sur les listes de plusieurs régiments de gardes et nommé chef du 65e régiment d'infanterie de Moscou. Le futur tsar a passé son enfance entre les murs du palais de Gatchina. Nikolai a commencé ses devoirs réguliers à l'âge de huit ans.
En décembre 1875 il a eu son premier rang militaire- enseigne, en 1880 il est promu sous-lieutenant, quatre ans plus tard il devient lieutenant. En 1884 Nikolai est entré dans le service militaire actif, en juillet 1887 l'année a commencé régulièrement service militaire dans le régiment Preobrazhensky et a été promu capitaine d'état-major ; en 1891, Nikolaï reçut le grade de capitaine et, un an plus tard, celui de colonel.
Se familiariser avec les affaires gouvernementales depuis mai 1889 il commence à assister aux réunions du Conseil d'État et du Comité des Ministres. DANS octobre 1890 année, je suis parti en voyage en Extrême-Orient. En neuf mois, Nikolai s'est rendu en Grèce, en Égypte, en Inde, en Chine et au Japon.
DANS avril 1894 Les fiançailles du futur empereur avec la princesse Alice de Darmstadt-Hesse, fille du grand-duc de Hesse, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre, ont eu lieu. Après s'être convertie à l'Orthodoxie, elle prit le nom d'Alexandra Feodorovna.
2 novembre (21 octobre, style ancien) 1894 Alexandre III est mort. Quelques heures avant sa mort, l'empereur mourant obligea son fils à signer le Manifeste lors de son accession au trône.
Le couronnement de Nicolas II a eu lieu 26 mai (14 style ancien) 1896. Le 30 (18 style ancien) mai 1896, lors de la célébration du couronnement de Nicolas II à Moscou, une bousculade s'est produite sur le champ de Khodynka au cours de laquelle plus d'un millier de personnes sont mortes.
Le règne de Nicolas II s'est déroulé dans une atmosphère de mouvement révolutionnaire croissant et de situation de politique étrangère compliquée (guerre russo-japonaise de 1904-1905 ; dimanche sanglant ; révolution de 1905-1907 ; Première Guerre mondiale ; révolution de février 1917).
Sous l'influence d'une forte mouvement social en faveur des changements politiques, 30 octobre (17 style ancien) 1905 Nicolas II a signé le célèbre manifeste « Sur l'amélioration de l'ordre public » : le peuple a obtenu la liberté d'expression, de presse, de personnalité, de conscience, de réunion et de syndicat ; La Douma d'État a été créée en tant qu'organe législatif.
Le tournant du destin de Nicolas II fut 1914- Début de la Première Guerre mondiale. 1er août (19 juillet, style ancien) 1914 L'Allemagne déclare la guerre à la Russie. DANS août 1915 Nicolas II a pris le commandement militaire (auparavant, ce poste était occupé par grand Duc Nikolaï Nikolaïevitch). Par la suite, le tsar passa la plupart de son temps au quartier général du commandant en chef suprême à Mogilev.
Fin février 1917 Les troubles ont commencé à Petrograd, qui se sont transformés en manifestations massives contre le gouvernement et la dynastie. La Révolution de Février a trouvé Nicolas II au siège de Moguilev. Ayant reçu la nouvelle du soulèvement de Petrograd, il décida de ne pas faire de concessions et de rétablir l'ordre dans la ville par la force, mais lorsque l'ampleur des troubles devint claire, il abandonna cette idée, craignant une grande effusion de sang.
À minuit 15 mars (2 style ancien) 1917 Dans le wagon-salon du train impérial, qui se trouvait sur les voies de la gare de Pskov, Nicolas II a signé un acte d'abdication, transférant le pouvoir à son frère le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch, qui n'a pas accepté la couronne.
20 mars (7 style ancien) 1917 Le gouvernement provisoire a émis un ordre d'arrestation du tsar. Le 22 (9e style ancien) mars 1917, Nicolas II et sa famille sont arrêtés. Pendant les cinq premiers mois, ils furent gardés à Tsarskoïe Selo, en août 1917 ils furent transportés à Tobolsk, où les Romanov passèrent huit mois.
D'abord 1918 Les bolcheviks ont forcé Nicolas à retirer les bretelles de son colonel (son dernier grade militaire), ce qu'il a perçu comme une grave insulte. En mai de cette année, la famille royale a été transportée à Ekaterinbourg, où elle a été placée dans la maison de l'ingénieur des mines Nikolai Ipatiev.
La nuit de 17 juillet (4 anciens) 1918 et Nicolas II, tsarine, leurs cinq enfants : filles - Olga (1895), Tatiana (1897), Maria (1899) et Anastasia (1901), fils - Tsarévitch, héritier du trône Alexei (1904) et plusieurs proches collaborateurs (11 personnes au total) , . La fusillade a eu lieu dans une petite pièce au rez-de-chaussée de la maison ; les victimes y ont été emmenées sous prétexte d'évacuation. Le tsar lui-même a été abattu à bout portant par le commandant de la maison Ipatiev, Yankel Yurovsky. Les corps des morts ont été emportés hors de la ville, aspergés de kérosène, ils ont essayé de les brûler, puis les ont enterrés.
Au début de 1991 La première requête a été déposée auprès du parquet municipal concernant la découverte de corps près d'Ekaterinbourg, montrant des signes de mort violente. Après de nombreuses années de recherches sur les restes découverts près d'Ekaterinbourg, une commission spéciale est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait bien des restes de neuf Nicolas II et de sa famille. En 1997 Ils ont été solennellement enterrés dans la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg.
En 2000 Nicolas II et les membres de sa famille ont été canonisés par l'Église orthodoxe russe.
Le 1er octobre 2008, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a reconnu le dernier tsar russe Nicolas II et les membres de sa famille comme victimes de répression politique illégale et les a réhabilités.
L'empereur Nicolas II et sa famille
Nikolai Alexandrovich Romanov, le fils aîné de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna, qui devint le dernier empereur de Russie sous le nom de Nicolas II, est né le 6 (18) mai 1868 à Tsarskoïe Selo, résidence royale de campagne près de Saint-Pétersbourg. .Pétersbourg.
Dès son plus jeune âge, Nikolai a ressenti une soif d'affaires militaires : il connaissait parfaitement les traditions du milieu des officiers et les règlements militaires, par rapport aux soldats, il se sentait comme un patron-mentor et n'hésitait pas à communiquer avec eux, endurait patiemment les inconvénients de la vie quotidienne de l'armée lors des rassemblements et des manœuvres du camp.
Immédiatement après sa naissance, il fut inscrit sur les listes de plusieurs régiments de gardes. Il a reçu son premier grade militaire - enseigne - à l'âge de sept ans, à douze ans, il a été promu sous-lieutenant et quatre ans plus tard, il est devenu lieutenant.
Le dernier empereur de Russie Nicolas II
En juillet 1887, Nikolaï commença son service militaire régulier dans le régiment Preobrazhensky et fut promu capitaine d'état-major. En 1891, il reçut le grade de capitaine et, un an plus tard, celui de colonel.
Des temps difficiles pour le pays
Nicolas devient empereur à l'âge de 26 ans ; le 20 octobre 1894, il accepte la couronne à Moscou sous le nom de Nicolas II. Son règne s'est produit pendant une période de forte aggravation de la lutte politique dans le pays, ainsi que de la situation de la politique étrangère : la guerre russo-japonaise de 1904-1905, le Dimanche sanglant, la Révolution de 1905-1907 en Russie, la Première Guerre mondiale. Guerre, révolution de février 1917.
Sous le règne de Nicolas, la Russie s'est transformée en un pays agraire et industriel, les villes se sont développées, des chemins de fer et des entreprises industrielles ont été construits. Nicolas a soutenu les décisions visant à la modernisation économique et sociale du pays : l'introduction de la circulation de l'or du rouble, la réforme agraire de Stolypine, les lois sur l'assurance des travailleurs, l'enseignement primaire universel et la tolérance religieuse.
En 1906, la Douma d'État, créée par le manifeste du tsar du 17 octobre 1905, commença à fonctionner. Pour la première fois dans l'histoire de la Russie, l'empereur commença à gouverner avec un organe représentatif élu par la population. La Russie a progressivement commencé à se transformer en une monarchie constitutionnelle. Cependant, malgré cela, l'empereur avait toujours d'énormes fonctions de pouvoir : il avait le droit de promulguer des lois (sous forme de décrets), de nommer un Premier ministre et des ministres responsables uniquement devant lui et de déterminer la marche à suivre. police étrangère. Il était le chef de l'armée, de la cour et du patron terrestre de l'Église orthodoxe russe.
L'impératrice Alexandra Feodorovna (née princesse Alice de Hesse-Darmstadt) était non seulement l'épouse du tsar, mais aussi une amie et une conseillère. Les habitudes, les idées et les intérêts culturels des époux coïncidaient largement. Ils se marièrent le 14 novembre 1894. Ils eurent cinq enfants : Olga (née en 1895), Tatiana (1897), Maria (1899), Anastasia (1901), Alexey (1904).
Le drame de la famille royale fut la maladie de leur fils Alexei - l'hémophilie. Comme déjà mentionné, cette maladie incurable a conduit à l'apparition dans la maison royale du « guérisseur » Grigori Raspoutine, qui a aidé à plusieurs reprises Alexei à surmonter ses attaques.
Le tournant du destin de Nicolas fut 1914 - le début de la Première Guerre mondiale. Le tsar ne voulait pas de guerre et essaya jusqu'au dernier moment d'éviter un affrontement sanglant. Cependant, le 19 juillet (1er août 1914), l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
En août 1915, pendant une période d'échecs militaires, Nicolas prit le commandement militaire et ne visita désormais la capitale qu'occasionnellement, passant la plupart de son temps au quartier général du commandant en chef suprême à Mogilev.
La guerre a exacerbé les problèmes internes du pays. Le tsar et son entourage ont commencé à être tenus pour principaux responsables des échecs militaires et de la longue campagne militaire. Des allégations de « trahison au sein du gouvernement » se sont répandues.
Renonciation, arrestation, exécution
Fin février 1917, des troubles éclatent à Petrograd qui, sans rencontrer d'opposition sérieuse de la part des autorités, se transforment quelques jours plus tard en manifestations de masse contre le gouvernement et la dynastie. Initialement, le tsar avait l'intention de rétablir l'ordre à Petrograd par la force, mais lorsque l'ampleur des troubles est devenue claire, il a abandonné cette idée, craignant une effusion de sang. Certains militaires de haut rang, membres de la suite impériale et personnalités politiques ont convaincu le roi que pour pacifier le pays, un changement de gouvernement était nécessaire et que son abdication était nécessaire. Le 2 mars 1917, à Pskov, dans le wagon-salon du train impérial, après de douloureuses réflexions, Nicolas signe un acte d'abdication, transférant le pouvoir à son frère le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch. Mais il n'accepte pas la couronne.
Le 9 mars, Nicolas et la famille royale sont arrêtés. Pendant les cinq premiers mois, ils furent sous garde à Tsarskoïe Selo ; en août 1917, ils furent transportés à Tobolsk. Six mois après la victoire Révolution d'Octobre En 1917, les bolcheviks transférèrent les Romanov à Ekaterinbourg. Dans la nuit du 17 juillet 1918, au centre d'Ekaterinbourg, dans le sous-sol de la maison de l'ingénieur Ipatiev, la famille royale est fusillée sans procès ni enquête.
La décision de tirer ancien empereur La Russie et sa famille ont été acceptées par le Comité exécutif de l'Oural - de sa propre initiative, mais avec la « bénédiction » réelle des autorités centrales soviétiques (dont Lénine et Sverdlov). Outre Nicolas II lui-même, sa femme, ses quatre filles et son fils Alexei, ainsi que le docteur Botkin et ses domestiques - un cuisinier, une femme de chambre et « l'oncle » d'Alexei (11 personnes au total) ont été abattus.
L'exécution a été dirigée par le commandant de la "Maison" but spécial» Yakov Yurovsky. Le 16 juillet 1918, vers minuit, il chargea le Dr Botkin de faire le tour des membres endormis de la famille royale, de les réveiller et de leur demander de s'habiller. Lorsque Nicolas II est apparu dans le couloir, le commandant a expliqué que les armées blanches avançaient sur Ekaterinbourg et que, afin de protéger le tsar et ses proches des bombardements d'artillerie, tout le monde était transféré au sous-sol. Sous escorte, ils ont été emmenés dans une pièce d'angle en demi sous-sol mesurant 6 mètres sur 5 mètres. Nikolai a demandé la permission d'emmener deux chaises au sous-sol - pour lui et sa femme. L'empereur lui-même portait son fils malade dans ses bras.
A peine étaient-ils entrés dans la cave qu'un peloton d'exécution apparut derrière eux. Yurovsky dit solennellement :
« Nikolaï Alexandrovitch ! Vos proches ont essayé de vous sauver, mais ils n’ont pas été obligés de le faire. Et nous sommes obligés de vous tirer dessus nous-mêmes… »
Il commença à lire le document du Comité exécutif de l'Oural. Nicolas II ne comprit pas de quoi ils parlaient et demanda brièvement : « Quoi ?
Mais ensuite, ceux qui sont venus ont levé les armes et tout est devenu clair.
« La tsarine et sa fille Olga ont essayé de faire le signe de croix », se souvient l'un des gardes, « mais elles n'ont pas eu le temps. Des coups de feu retentirent... Le tsar ne put résister à une seule balle de revolver et tomba en arrière avec force. Les dix personnes restantes sont également tombées. Plusieurs autres coups de feu ont été tirés sur ceux qui étaient allongés...
...La lumière électrique était obscurcie par la fumée. Les tirs se sont arrêtés. Les portes de la pièce ont été ouvertes pour permettre à la fumée de se dissiper. Ils ont apporté une civière et ont commencé à évacuer les cadavres. Lorsqu’une des filles a été placée sur une civière, elle a crié et s’est couvert le visage avec sa main. D'autres étaient également vivants. Il n'était plus possible de tirer avec les portes ouvertes, des coups de feu se faisaient entendre dans la rue. Ermakov a pris mon fusil avec une baïonnette et a tué tous ceux qui étaient en vie.
Le 17 juillet 1918, à une heure du matin, tout était fini. Les cadavres ont été sortis du sous-sol et chargés dans un camion arrivé à l'avance.
Le sort des restes
Selon la version officielle, le corps de Nicolas II lui-même, ainsi que les corps des membres de sa famille et de ses associés, ont été aspergés d'acide sulfurique et enterrés dans un lieu secret. Depuis lors, des informations contradictoires continuent d'être reçues sur le sort ultérieur de la dépouille auguste.
Ainsi, l'écrivain Zinaida Shakhovskaya, qui a émigré en 1919 et a vécu à Paris, a déclaré dans une interview avec un journaliste soviétique : « Je sais où les restes de la famille royale ont été emmenés, mais je ne sais pas où ils se trouvent maintenant. Sokolov, après avoir rassemblé ces restes dans plusieurs caisses, les remit au général Janine, chef de la mission française et commandant en chef des unités alliées en Sibérie. Janin les a emmenés avec lui en Chine, puis à Paris, où il a remis ces cartons au Conseil des ambassadeurs de Russie, créé en exil. Il comprenait à la fois des ambassadeurs royaux et des ambassadeurs déjà nommés par le Gouvernement Provisoire...
Initialement, ces restes étaient conservés dans la succession de Mikhaïl Nikolaïevitch Girs, nommé ambassadeur en Italie. Puis, lorsque Giers dut vendre le domaine, ils furent transférés à Maklakov, qui les plaça dans le coffre-fort d'une des banques françaises. Lorsque les Allemands occupèrent Paris, ils exigeèrent de Maklakov, le menaçant, de leur remettre la dépouille, au motif que la reine Alexandra était une princesse allemande. Il ne voulait pas, il a résisté, mais il était vieux et faible et a donné les reliques qui, apparemment, ont été emportées en Allemagne. Peut-être qu'ils se sont retrouvés chez les descendants hessois d'Alexandra, qui les ont enterrés dans un endroit secret..."
Mais l'écrivain Geliy Ryabov affirme que les restes royaux n'ont pas été exportés à l'étranger. Selon lui, il a trouvé le lieu de sépulture exact de Nicolas II près d'Ekaterinbourg et, le 1er juin 1979, avec ses assistants, il a illégalement retiré du sol les restes de la famille royale. Ryabov a emmené deux crânes à Moscou pour examen (à cette époque, l'écrivain était proche de la direction du ministère de l'Intérieur de l'URSS). Cependant, aucun des experts n'a osé étudier les restes des Romanov et l'écrivain a dû remettre les crânes dans la tombe non identifiée la même année. En 1989, Sergueï Abramov, spécialiste du Bureau des examens médico-légaux de la RSFSR, s'est porté volontaire pour aider Ryabov. Sur la base de photographies et de moulages de crânes, il a supposé que toutes les personnes enterrées dans la tombe ouverte par Ryabov étaient membres de la même famille. Deux crânes appartiennent à des jeunes de quatorze à seize ans (les enfants du tsar Alexeï et Anastasia), un appartient à une personne âgée de 40 à 60 ans, avec des traces d'un coup d'objet pointu (Nicolas II a été frappé à la tête avec un sabre par un policier fanatique lors d'une visite au Japon).
En 1991, les autorités locales d'Ekaterinbourg ont procédé de leur propre initiative à une nouvelle autopsie de la prétendue sépulture de la famille impériale. Un an plus tard, les experts ont confirmé que les restes retrouvés appartenaient aux Romanov. En 1998, ces restes ont été solennellement enterrés en présence du président Eltsine dans la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg.
Cependant, l'épopée avec la dépouille royale ne s'est pas arrêtée là. Depuis plus de dix ans, un débat est en cours parmi les scientifiques et les chercheurs sur l'authenticité des restes officiellement enterrés, les résultats contradictoires de nombreux examens anatomiques et génétiques étant discutés. De nouvelles découvertes de restes appartenant prétendument à des membres de la famille royale ou à leurs associés ont été signalés.
Versions du sauvetage des membres de la famille royale
En même temps, de temps en temps, des déclarations tout à fait sensationnelles sont faites sur le sort du tsar et de sa famille : aucun d’entre eux n’a été abattu et ils ont tous échappé, ou certains des enfants du tsar se sont échappés, etc.
Ainsi, selon une version, le tsarévitch Alexei est décédé en 1979 et a été enterré à Saint-Pétersbourg. Et sa sœur Anastasia a vécu jusqu'en 1971 et a été enterrée près de Kazan.
Ce n'est que récemment que la psychiatre Dalila Kaufman a décidé de révéler le secret qui la tourmentait depuis une quarantaine d'années. Après la guerre, elle travaille dans un hôpital psychiatrique à Petrozavodsk. En janvier 1949, un prisonnier y fut amené dans un état de psychose aiguë. Philippe Grigorievich Semenov s'est avéré être un homme d'une grande érudition, intelligent, parfaitement instruit et parlant couramment plusieurs langues. Bientôt, le patient de quarante-cinq ans a admis qu'il était le fils de l'empereur Nicolas II et l'héritier du trône.
Au début, les médecins ont réagi comme d’habitude : syndrome paranoïaque avec folie des grandeurs. Mais plus ils parlaient avec Philippe Grigorievich, plus ils analysaient attentivement son amère histoire, plus ils étaient surmontés de doutes : les paranoïaques ne se comportent pas ainsi. Semionov ne s'est pas excité, n'a pas insisté de son propre chef et n'a pas participé à des disputes. Il ne voulait pas rester à l'hôpital et se faciliter la vie à l'aide d'une biographie exotique.
Le consultant de l'hôpital à l'époque était le professeur de Leningrad Samuil Ilitch Gendelevich. Il avait une excellente compréhension de toutes les subtilités de la vie de la cour royale. Gendelevich a soumis l'étrange patient à un véritable examen : il l'a « pourchassé » dans les chambres du Palais d'Hiver et les résidences de campagne, vérifiant les dates de son homonyme. Pour Semenov, cette information était élémentaire, il répondit instantanément et avec précision. Gendelevich a procédé à un examen personnel du patient et a étudié ses antécédents médicaux. Il a noté la cryptorchidie (testicule non descendu) et l'hématurie (présence de globules rouges dans l'urine) - une conséquence courante de l'hémophilie dont, comme on le sait, le tsarévitch souffrait dans son enfance.
Enfin, la ressemblance extérieure de Philippe Grigorievich avec les Romanov était tout simplement frappante. Il ressemblait particulièrement non pas à son « père » - Nicolas II, mais à son « arrière-arrière-grand-père » Nicolas Ier.
Voici ce que le mystérieux patient lui-même a dit de lui-même.
Lors de l'exécution, une balle du KGB l'a touché à la fesse (il avait une cicatrice à l'endroit correspondant), il est tombé inconscient et s'est réveillé dans une cave inconnue, où un homme le soignait. Quelques mois plus tard, il transporta le tsarévitch à Petrograd, l'installa dans un hôtel particulier de la rue Millionnaya dans la maison de l'architecte Alexandre Pomerantsev et lui donna le nom de Vladimir Irin. Mais l'héritier du trône s'est échappé et s'est porté volontaire pour l'Armée rouge. Il a étudié à l’école des commandants rouges de Balaklava, puis a commandé un escadron de cavalerie dans la première armée de cavalerie de Boudionny. Il a participé aux batailles avec Wrangel et a vaincu les Basmachi en Asie centrale. Pour son courage, le commandant de la cavalerie rouge Vorochilov a remis un certificat à Irina.
Mais l'homme qui l'a sauvé en 1918 a retrouvé Irina et a commencé à le faire chanter. J'ai dû m'approprier le nom de Philip Grigorievich Semenov, un parent décédé de sa femme. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut Plekhanov, il devient économiste, voyage sur les chantiers de construction, modifiant constamment son inscription. Mais l'escroc a de nouveau retrouvé sa victime et l'a forcé à lui donner de l'argent du gouvernement, pour lequel Semionov a été condamné à 10 ans de camp.
À la fin des années 90, à l'initiative du journal anglais Daily Express, son fils aîné Yuri a fait un don de sang pour des tests génétiques. Elle a été réalisée au laboratoire d'Aldermasten (Angleterre) par le Dr Peter Gil, spécialiste de la recherche génétique. L'ADN du « petit-fils » de Nicolas II, Yuri Filippovich Semenov, et du prince anglais Philip, parent des Romanov par l'intermédiaire de la reine Victoria d'Angleterre, a été comparé. Sur les trois tests, deux coïncidaient, et le troisième s'est avéré neutre...
Quant à la princesse Anastasia, elle aurait elle aussi miraculeusement survécu à l’exécution de la famille royale. L’histoire de son sauvetage et son sort ultérieur sont encore plus étonnants (et plus tragiques). Et elle doit la vie... à ses bourreaux.
Tout d'abord, au prisonnier de guerre autrichien Franz Svoboda (un proche parent du futur président de la Tchécoslovaquie communiste Ludwig Svoboda) et au camarade du président de la commission d'enquête extraordinaire d'Ekaterinbourg Valentin Sakharov (neveu du général Koltchak), qui a emmené la jeune fille à l'appartement du gardien de la maison Ipatiev Ivan Kleshcheev, amoureux sans contrepartie de la princesse de dix-sept ans.
Ayant repris ses esprits, Anastasia s'est cachée d'abord à Perm, puis dans un village près de la ville de Glazov. C'est dans ces lieux qu'elle a été aperçue et identifiée par certains résidents locaux, qui a ensuite témoigné devant la commission d'enquête. Quatre confirmèrent l’enquête : il s’agissait de la fille du Tsar. Un jour, non loin de Perm, une jeune fille a croisé une patrouille de l'Armée rouge, elle a été rouée de coups et emmenée dans les locaux de la Tchéka locale. Le médecin qui l'a soignée a reconnu la fille de l'empereur. C'est pourquoi, le deuxième jour, il fut informé que la patiente était décédée et on lui montra même sa tombe.
En fait, cette fois aussi, ils l’ont aidée à s’échapper. Mais en 1920, lorsque Koltchak perdit le pouvoir sur Irkoutsk, la jeune fille fut arrêtée dans cette ville et condamnée à la peine capitale. Certes, l’exécution a ensuite été remplacée par 20 ans d’isolement.
Les prisons, les camps et l’exil ont cédé la place à de rares aperçus de liberté de courte durée. En 1929, à Yalta, elle fut convoquée au GPU et accusée de se faire passer pour la fille du tsar. Anastasia - à ce moment-là Nadezhda Vladimirovna Ivanova-Vasilieva, utilisant un passeport acheté et rempli de sa propre main - n'a pas reconnu les accusations et, curieusement, a été libérée. Mais pas pour longtemps.
Profitant d'un autre répit, Anastasia a contacté l'ambassade de Suède pour tenter de retrouver sa demoiselle d'honneur Anna Vyrubova, partie pour la Scandinavie, et a reçu son adresse. Et elle a écrit. Et elle a même reçu une réponse de Vyrubova étonnée lui demandant d'envoyer une photo.
...Et ils ont pris une photo - de profil et de face. Et à l'Institut serbe de médecine légale, le prisonnier a reçu un diagnostic de schizophrénie.
Le lieu du dernier emprisonnement d'Anastasia Nikolaevna était la colonie psychiatrique de Sviyazhsk, non loin de Kazan. La tombe d'une vieille femme dont personne n'avait besoin a été irrémédiablement perdue - elle a donc également perdu son droit posthume d'établir la vérité.
Ivanova-Vasilieva était-elle Anastasia Romanova ? Il est peu probable qu’il soit possible de le prouver maintenant. Mais il restait encore deux preuves indirectes.
Après la mort de sa malheureuse compagne de cellule, ils se sont souvenus : elle a déclaré que lors de l'exécution, les femmes étaient assises et les hommes debout. Beaucoup plus tard, on a appris que dans le sous-sol malheureux, les traces de balles étaient situées ainsi : certaines en bas, d'autres au niveau de la poitrine des personnes debout. Il n'y avait aucune publication sur ce sujet à cette époque.
Elle a également déclaré que le cousin de Nicolas II, le roi britannique George V, avait reçu de Kolchak des planches de parquet de la cave d'exécution. « Nadezhda Vladimirovna » n'a pas pu lire ce détail. Elle ne pouvait que se souvenir d'elle.
Et encore une chose : les experts ont combiné les moitiés des visages de la princesse Anastasia et de Nadezhda Ivanova-Vasilieva. Il s’est avéré que c’était un seul visage.
Bien sûr, Ivanova-Vasilieva n'était que l'une de celles qui se faisaient appeler Anastasia miraculeusement sauvée. Les trois imposteurs les plus célèbres sont Anna Anderson, Evgenia Smith et Natalia Belikhodze.
Anna Anderson (Anastasia Tchaikovskaya), selon la version généralement acceptée, était en fait une Polonaise, ancienne ouvrière dans l'une des usines de Berlin. Néanmoins, son histoire fictive a constitué la base de longs métrages et même du dessin animé «Anastasia», et Anderson elle-même et les événements de sa vie ont toujours été un objet d'intérêt général. Elle est décédée le 4 février 1984 aux USA. L’analyse ADN post-mortem a donné une réponse négative : « Pas pareil ».
Eugenia Smith est une artiste américaine, auteur du livre « Anastasia. Autobiographie de la Grande-Duchesse de Russie." Elle y se faisait appeler la fille de Nicolas II. En réalité, Smith (Smetisko) est né en 1899 en Bucovine (Ukraine). Elle a catégoriquement refusé l’examen ADN qui lui avait été proposé en 1995. Elle décède deux ans plus tard à New York.
Une autre candidate, Anastasia, est devenue il n'y a pas si longtemps - en 1995 - la centenaire Natalia Petrovna Belikhodze. Elle a également écrit un livre intitulé «Je suis Anastasia Romanova» et a subi deux douzaines d'examens, notamment pour l'écriture manuscrite et la forme des oreilles. Mais les preuves d'identité dans cette affaire ont été encore moins nombreuses que dans les deux premières.
Il existe une autre version, à première vue, complètement incroyable : ni Nicolas II ni sa famille n'ont été abattus, et toute la moitié féminine de la famille royale a été emmenée en Allemagne.
Voici ce qu'en dit Vladimir Sychev, journaliste travaillant à Paris.
En novembre 1983, il est envoyé à Venise pour un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Là, un collègue italien lui montra le journal « La Repubblica » avec un message selon lequel une certaine religieuse, sœur Pascalina, qui occupa un poste important sous le pape Pie XII et qui fut sur le trône du Vatican de 1939 à 1958, était décédée à Rome à un moment donné. très vieillesse.
Cette sœur Pascalina, qui a gagné le surnom honorable de « Dame de fer » du Vatican, a appelé avant sa mort un notaire avec deux témoins et a dicté en leur présence des informations qu'elle ne voulait pas emporter avec elle dans la tombe : l'un des filles du dernier tsar russe Nicolas II - Olga - n'a pas été abattue par les bolcheviks dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, elle a vécu longtemps et a été enterrée dans un cimetière du village de Marcotte, dans le nord de l'Italie.
Après le sommet, Sychev et son ami italien, qui était à la fois son chauffeur et son traducteur, se sont rendus dans ce village. Ils ont trouvé un cimetière et cette tombe. Sur la dalle était écrit en allemand : « Olga Nikolaevna, fille aînée du tsar russe Nikolaï Romanov », et les dates de vie : « 1895-1976 ».
Le gardien du cimetière et son épouse ont confirmé que, comme tous les habitants du village, ils se souvenaient très bien d'Olga Nikolaevna, savaient qui elle était et étaient sûrs que la grande-duchesse de Russie était sous la protection du Vatican.
Cette étrange découverte a beaucoup intéressé le journaliste, qui a décidé d'enquêter lui-même sur toutes les circonstances de la fusillade. Et en général, y a-t-il eu une exécution ?
En conséquence, Sychev est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu d'exécution. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, tous les bolcheviks et leurs sympathisants partirent en train pour Perm. Le lendemain matin, des tracts ont été affichés autour d'Ekaterinbourg avec le message que la famille royale avait été emmenée de la ville - comme cela s'est effectivement produit. Bientôt, la ville fut occupée par les Blancs. Naturellement, une commission d'enquête a été constituée « dans le cas de la disparition de l'empereur Nicolas II, de l'impératrice, du tsarévitch et des grandes-duchesses », qui n'a trouvé aucune trace convaincante de l'exécution.
L'enquêteur Sergueïev a déclaré dans une interview accordée à un journal américain en 1919 : « Je ne pense pas que tout le monde ait été exécuté ici - ni le tsar ni sa famille. "À mon avis, l'impératrice, le prince et les grandes-duchesses n'ont pas été exécutés dans la maison d'Ipatiev." Cette conclusion ne convenait pas à l’amiral Koltchak, qui s’était déjà proclamé « souverain suprême de la Russie ». Et vraiment, pourquoi le « suprême » a-t-il besoin d’une sorte d’empereur ? Koltchak a ordonné la constitution d'une deuxième équipe d'enquêteurs, qui a fait la lumière sur le fait qu'en septembre 1918, l'impératrice et les grandes-duchesses étaient détenues à Perm.
Seul le troisième enquêteur, Nikolai Sokolov (il a dirigé l'affaire de février à mai 1919), s'est montré plus compréhensif et a tiré la conclusion bien connue selon laquelle toute la famille a été abattue, les cadavres ont été démembrés et brûlés vifs. "Les parties qui n'étaient pas susceptibles de prendre feu", écrit Sokolov, "ont été détruites à l'aide d'acide sulfurique".
Quels types de restes ont donc été enterrés dans la cathédrale Pierre et Paul ? Comme vous le savez, peu de temps après le début de la perestroïka, des squelettes ont été retrouvés à Porosenkovo Log, près d’Ekaterinbourg. En 1998, ils ont été solennellement inhumés dans la tombe de la famille Romanov, après avoir procédé à de nombreux examens génétiques. De plus, le garant de l'authenticité de la dépouille royale était le pouvoir laïc de la Russie, en la personne du président Boris Eltsine. Il n’y a toujours pas de consensus sur la question de savoir à qui appartiennent ces restes.
Mais revenons à la guerre civile. Selon Vladimir Sychev, la famille royale était divisée à Perm. Le chemin des femmes se trouvait en Allemagne, tandis que les hommes - Nikolaï Romanov lui-même et le tsarévitch Alexei - étaient laissés en Russie. Père et fils furent longtemps gardés près de Serpoukhov dans l'ancienne datcha du marchand Konshin. Plus tard, dans les rapports du NKVD, cet endroit était connu sous le nom d'« Objet n° 17 ». Très probablement, le prince est décédé en 1920 des suites de l'hémophilie. Il n'y a aucune information sur le sort du dernier empereur russe. Cependant, on sait que dans les années 30, « l'objet n° 17 » a été visité à deux reprises par Staline. Cela signifie-t-il que Nicolas II était encore en vie à cette époque-là ?
Pour comprendre pourquoi des événements aussi incroyables du point de vue d'une personne du 21e siècle sont devenus possibles, et pour savoir qui en avait besoin, il faudra remonter à 1918. Comme vous le savez, le 3 mars, à Brest-Litovsk, un traité de paix a été conclu entre la Russie soviétique, d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie, d'autre part. La Russie a perdu la Pologne, la Finlande, les États baltes et une partie de la Biélorussie. Mais ce n’est pas pour cela que Lénine a qualifié le traité de paix de Brest-Litovsk d’« humiliant » et d’« obscène ». À propos, le texte intégral de l’accord n’a encore été publié ni à l’Est ni à l’Ouest. Très probablement, précisément à cause des conditions secrètes qui y sont présentes. Il est probable que le Kaiser, parent de l'impératrice Alexandra Feodorovna, ait exigé que toutes les femmes de la famille royale soient transférées en Allemagne. Les bolcheviks étaient d'accord : les filles n'avaient aucun droit sur le trône russe et ne pouvaient donc en aucun cas les menacer. Les hommes ont été laissés en otages pour s'assurer que l'armée allemande n'avancerait pas plus à l'est que ce qui était prévu dans le traité de paix.
Que s'est-il passé ensuite ? Quel fut le sort des femmes amenées en Occident ? Leur silence était-il une condition de leur intégrité ? Malheureusement, il y a ici plus de questions que de réponses (1 ; 9, 2006, n° 24, p. 20, 2007, n° 36, p. 13 et n° 37, p. 13 ; 12, pp. 481-482, 674-675).
Ce texte est un fragment d'introduction.Une nouvelle famille et une famille militaire En 1943, lors de la libération de la région de Mirgorod, les deux sœurs de Vasily furent hébergées par la sœur cadette de leur mère, tandis que le petit Vassia et son frère furent accueillis par la plus jeune. Le mari de ma sœur était directeur adjoint de l'école de pilotage d'Armavir. En 1944, il
5. « La famille remplace tout. Par conséquent, avant d'en commencer un, vous devriez réfléchir à ce qui est le plus important pour vous : tout ou la famille." C'est ce qu'a dit un jour Faina Ranevskaya. Je suis sûr que le sujet de la vie personnelle de la grande actrice devrait être pris en compte par nous. avec une attention particulière, dans un chapitre séparé. Raisons à cela
Chapitre XI. Empereur Nicolas II 1Comme son père, l'empereur Alexandre III, l'empereur Nicolas II n'était pas destiné à régner. La succession ordonnée du père au fils aîné fut perturbée par la mort prématurée du fils aîné de l'empereur, Alexandre II,
Empereur Nicolas II Alexandrovitch (06/05/1868-17/07/1918) Années de règne - 1894-1917 L'empereur Nicolas II fut le dernier souverain de la dynastie des Romanov. Il a eu l’occasion de diriger le pays dans des moments difficiles. Après être monté sur le trône, il s'est retrouvé otage de traditions politiques et d'une structure dépassée.
Chapitre XI Empereur Nicolas II 1Comme son père, l'empereur Alexandre III, l'empereur Nicolas II n'était pas destiné à régner. La succession ordonnée du père au fils aîné a été perturbée par la mort prématurée du fils aîné de l'empereur Alexandre II,
Chapitre XII. L'empereur Nicolas II, commandant en chef suprême. Arrivée du tsarévitch au quartier général. Voyages au front (septembre-décembre 1915) Le Grand-Duc Nikolaï Nikolaïevitch quitte le Quartier Général le 7 septembre, soit deux jours après l'arrivée du Souverain. Il part pour le Caucase, emmenant avec lui le général
Chapitre XVI. L'empereur Nicolas II Nicolas II, voulant dire au revoir à ses troupes, quitta Pskov le 16 mars et retourna au quartier général. Il y resta jusqu'au 21, vivant toujours dans la maison du gouverneur et recevant des rapports quotidiens du général Alekseev. Impératrice douairière Maria
Empereur Nicolas Ier Pavlovitch 1796-1855 Troisième fils de l'empereur Paul Ier et de l'impératrice Maria Feodorovna. Né le 25 juin 1796 à Tsarskoïe Selo, la direction principale de son éducation fut confiée au général M.I. Lamsdorf. Homme sévère, cruel et extrêmement colérique, Lamsdorf n'a pas
Empereur Nicolas II Alexandrovitch 1868-1918 Fils de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna. Né le 6 mai 1868 à Tsarskoïe Selo. Les journaux du 21 octobre 1894 ont publié un manifeste sur l'accession au trône de l'empereur Nicolas II. Le jeune roi fut immédiatement encerclé
Chapitre neuf Empereur Nicolas II Je me suis abstenu d'inclure ce chapitre dans mes mémoires, car pour sa parution il fallait choisir le moment où achever la tâche difficile et délicate de décrire les traits caractéristiques de l'empereur Nicolas II. Je ne peux cependant pas refuser maintenant
Empereur Nicolas II (1868-1918) Mon amour, tu nous manques terriblement, tellement que c'est impossible à exprimer ! La première rencontre du futur empereur Nicolas Alexandrovitch Romanov avec la princesse Alice de Hesse eut lieu en 1884, et quelques années plus tard, il lui fit
L'empereur Nicolas II à son épouse Alexandra Feodorovna (18 novembre 1914) Mon soleil bien-aimé, petite épouse chérie. J'ai lu ta lettre et j'ai failli fondre en larmes... Cette fois, j'ai réussi à me ressaisir au moment de me séparer, mais la lutte a été dure... Mon amour, j'ai peur de toi
Agence fédérale pour l'éducation de la Fédération de Russie
Etat fédéral établissement d'enseignement formation professionnelle supérieure
« L'Université d'État de Tchouvache du nom d'I.N. Oulianov"
Faculté de génie électrique
Essai
sur l'histoire de la Russie :
Nicolas II et sa famille
Complété:
étudiant du groupe ET-51-09
Ouvarov Alexeï Valentinovitch
Vérifié:
Ph.D., professeur agrégé
Département d'histoire nationale
eux. UN V. Arsentieva
Komlev I.G.
Tcheboksary 2009
Début du règne
Après la mort d'Alexandre III, le 20 octobre 1894, les regards du public libéral se tournèrent avec espoir vers son fils et héritier. On s'attendait à ce que le nouvel empereur change l'orientation conservatrice de son père et revienne à la politique de réformes libérales de son grand-père, Alexandre II. La société a suivi de près les déclarations du jeune tsar, à la recherche du moindre signe de tournant politique. Et si des mots étaient connus qui pouvaient, au moins dans une certaine mesure, être interprétés dans un sens libéral, ils étaient immédiatement repris et chaleureusement accueillis. Ainsi, le journal libéral « Vedomosti russe » a vanté les notes du tsar, devenues publiques, en marge d’un rapport sur les problèmes de l’enseignement public. Les notes reconnaissaient les problèmes dans ce domaine. Cela a été perçu comme un signe de la profonde compréhension du tsar des problèmes du pays, un signe de son intention d’entamer des réformes.
Nicolas II, le fils aîné de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Feodorovna, monta sur le trône après la mort de son père. Nicolas II a reçu une bonne éducation, il parlait français, anglais et Langues allemandes. En octobre 1890, le grand-duc Nikolaï Alexandrovitch se rend en Extrême-Orient, passant par Vienne, la Grèce et l'Égypte, pour se rendre en Inde, en Chine et au Japon. La route de retour de Nikolaï Alexandrovitch traversait toute la Sibérie. L'Empereur était simple et facilement accessible. Les contemporains ont noté deux défauts dans son caractère : une faible volonté et une inconstance. Tout le règne de Nicolas II s'est déroulé dans une atmosphère de mouvement révolutionnaire croissant. Au début de 1905, une révolution éclate en Russie, marquant le début de certaines réformes. Le 17 avril 1905, un Manifeste sur la tolérance religieuse fut publié, qui permettait aux Russes de se convertir de l'orthodoxie à d'autres religions chrétiennes et reconnaissait les droits religieux des schismatiques. Le 17 octobre 1905, un Manifeste est publié qui reconnaît les fondements de la liberté civile : l'inviolabilité de la personne, la liberté d'expression, de réunion et d'union. On a tenté d'abolir la communauté rurale, ce qui était d'une grande importance pour le développement des relations capitalistes à la campagne. Dans le domaine de la politique étrangère, Nicolas II a pris certaines mesures pour stabiliser les relations internationales. En 1898, l'empereur russe s'est tourné vers les gouvernements européens avec des propositions visant à signer des accords sur le maintien de la paix mondiale et à fixer des limites à la croissance constante des armements. Les conférences de paix de La Haye ont eu lieu en 1899 et 1907, dont certaines décisions sont encore en vigueur aujourd'hui.
En 1904, le Japon déclare la guerre à la Russie, qui se termine en 1905 par la défaite de l’armée russe.
En 1914, la Russie entre dans la Première Guerre mondiale aux côtés des pays de l’Entente contre l’Allemagne. Échecs au front pendant la Première Guerre mondiale, propagande révolutionnaire à l'arrière et parmi les troupes, dévastation, saute-mouton ministériel, etc. a provoqué un vif mécontentement à l'égard de l'autocratie dans divers cercles de la société. Les réformes militaires de 1905-12 ont été menées après la défaite de la Russie dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui a révélé de graves lacunes dans l'administration centrale, l'organisation, le système de recrutement, l'entraînement au combat et l'équipement technique de l'armée.
Début mars 1917, le président de la Douma d'Etat M.V. Rodzianko a déclaré à Nicolas II que le maintien de l'autocratie n'était possible que si le trône était transféré au tsarévitch Alexei, sous la régence du frère de l'empereur, le grand-duc Mikhaïl. 2 mars 1917 Nicolas II. Compte tenu de la mauvaise santé de son fils Alexei, il renonça au trône en faveur de son frère Mikhaïl Alexandrovitch. Mikhaïl Alexandrovitch a également signé le Manifeste d'abdication.
Famille de Nicolas II
L'impératrice Alexandra Feodorovna
Né à Darmstadt, en Allemagne, en 1872. La quatrième fille du grand-duc de Hesse et du Rhin Louis IV et de la duchesse Alice, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre.
De caractère et d'apparence, Alexandra était grande, mince, avec une allure royale et de grands yeux tristes - elle ressemblait à une vraie reine, semblait être la personnification du pouvoir et de la majesté. Elle n'a jamais perdu conscience de sa position élevée, sauf à la crèche.
Alexandra Fedorovna jouait du piano, était le chef des régiments : les gardes du corps du nom d'Oulan de Sa Majesté, le 5e hussards d'Alexandrie, le 21e régiment de fusiliers de Sibérie orientale et de cavalerie de Crimée, et parmi les étrangers - le 2e régiment de dragons de la garde prussienne .
Elle était impliquée dans des activités caritatives. Au 1er janvier 1909, sous son patronage, il y avait 33 sociétés caritatives, communautés de sœurs de miséricorde, refuges, orphelinats et institutions similaires, parmi lesquelles : le Comité pour trouver des places pour les grades militaires qui ont souffert dans la guerre avec le Japon, la Maison des Charité pour les soldats infirmes, Société impériale patriotique des femmes, Tutelle de l'assistance au travail, École des nounous de Sa Majesté à Tsarskoïe Selo, Société de Peterhof pour le bien-être des pauvres, Société d'assistance vestimentaire aux pauvres de Saint-Pétersbourg, Fraternité au nom de la Reine du Ciel pour la charité des enfants idiots et épileptiques, Alexandria Shelter for Women et autres.
Grande-Duchesse Olga Nikolaïevna
La fille aînée de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna. Né le 3 novembre 1895.
Elle a hérité des yeux bienveillants de son père, de la silhouette élancée et des cheveux blonds de sa mère. En esprit, elle était plus proche de son père : elle aimait prendre sa retraite avec un bon livre, elle était peu pratique et loin de la vraie vie. Elle avait une excellente oreille musicale, jouait du piano et chantait. La jeune fille a hérité de sa mère sa force de caractère. Lorsqu'il a fallu trancher la question de son mariage avec le prince roumain, pour lequel la famille a même fait un voyage en Roumanie, Olga a réussi à défendre son droit de choisir librement son conjoint, ce qu'elle n'a jamais réussi à réaliser.
Grande-Duchesse Tatiana Nikolaïevna
Deuxième fille de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna. Né le 29 mai 1897 près de Saint-Pétersbourg.
Grande, élancée, blonde, elle était réservée et réservée, très amicale avec sa mère, qui devint sa conseillère en tout. Elle était exceptionnellement organisée, énergique et déterminée, et avait ses propres opinions. Elle aimait par-dessus tout l'ordre, aidait sa mère au ménage, brodait, repassait le linge ; son sens du devoir était très développé.
Sofya Yakovlevna Ofrosimova, demoiselle d'honneur de l'impératrice, a écrit ce qui suit à propos de Tatiana : « À ma droite se trouve la grande-duchesse Tatiana Nikolaevna. C'est une grande-duchesse de la tête aux pieds, si aristocratique et royale. Son visage est pâle et mat, seules ses joues sont légèrement roses, comme si du satin rose perçait sous sa peau fine. Son profil est d’une beauté impeccable, comme sculpté dans le marbre par le ciseau d’un grand artiste. Son visage donne de l'originalité et de l'originalité à ses yeux, éloignés les uns des autres. Plus que les sœurs, elle porte le foulard de sœur de miséricorde et une croix rouge sur la poitrine. Elle rit moins souvent que ses sœurs. Son visage a parfois une expression concentrée et sévère. Dans ces moments-là, elle ressemble à Mère. Sur les traits pâles de son visage se trouvent des traces de réflexion intense et parfois même de tristesse. Sans mots, je sens qu'elle est en quelque sorte spéciale, différente des sœurs, malgré la gentillesse et l'amitié qu'elles partagent. J’ai l’impression qu’il contient son propre monde fermé et unique.
Pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), elle fut active dans la vie publique et fut présidente d'honneur du Comité Tatiana, une organisation dédiée à l'assistance aux réfugiés et aux autres personnes touchées par les opérations militaires. Avec sa mère, l'Impératrice, et sa sœur aînée, Olga, elle travaillait régulièrement dans les hôpitaux et les infirmeries. Elle collectait des dons pour aider les blessés et les blessés.
Grande-Duchesse Maria Nikolaïevna
La troisième fille de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Feodorovna. Né le 14 juin 1899.
Maria est la véritable petite-fille d'Alexandre III, son grand-père. Elle avait une grande force physique, était très facile à utiliser, affectueuse et amicale. Maria adorait dessiner, mais elle était un peu trop paresseuse pour faire quoi que ce soit de sérieux. Elle établissait facilement des contacts avec les gens ordinaires, savait parler aux soldats, les interroger sur leur vie de famille et de famille et aimait les jeunes enfants. Elle avait de très beaux yeux gris-bleu, mais elle ne pouvait pas se vanter d'une silhouette élancée.
Sofya Yakovlevna Ofrosimova, la demoiselle d'honneur de l'impératrice, a écrit à son sujet avec ravissement : « On peut la qualifier en toute sécurité de beauté russe. Grande, dodue, avec des sourcils noirs, avec une rougeur éclatante sur son visage russe ouvert, elle est particulièrement chère au cœur russe. Vous la regardez et l'imaginez involontairement vêtue d'une robe d'été de boyard russe ; Il y a des manches en mousseline blanche comme neige autour de ses bras, des pierres semi-précieuses sur sa poitrine haute et haletante, et au-dessus de son haut front blanc se trouve un kokochnik avec des perles qui roulent. Ses yeux illuminent tout son visage d'un éclat particulier et radieux ; ils... semblent parfois noirs, de longs cils jettent une ombre sur le rougissement éclatant de ses joues tendres. Elle est joyeuse et vivante, mais n'a pas encore pris conscience de la vie ; "Elle contient probablement l'immense force d'une vraie femme russe."
Grande-Duchesse Anastasia Nikolaïevna
La quatrième fille de l'empereur Nicolas II et d'Alexandra Feodorovna.
Anastasia était petite et si ronde qu'elle avait honte de sa carrure. Pour sa vivacité et son esprit, la jeune fille était souvent qualifiée de vilaine fille. Son excellente audition et sa capacité pour les langues l'ont aidée à acquérir une excellente prononciation. Elle savait faire rire tout en restant elle-même sérieuse. Ce dernier était son cadeau. Parmi les sœurs, Anastasia se distinguait par son aristocratie particulière.
Grand-Duc Alexeï Nikolaïevitch
Le cinquième enfant et fils unique de Nicolas II et d'Alexandra Feodorovna. Né le 30 juillet 1904.
Alexei était le premier héritier mâle depuis la fin du XVIIe siècle, né d'un père régnant. Le tsarévitch fut baptisé en présence de nombreux membres de la grande famille Romanov. Même l'arrière-grand-père de l'enfant, le roi danois Christian IX, alors âgé de quatre-vingt-sept ans, est arrivé à Saint-Pétersbourg pour assister au baptême.
Pourtant, dix semaines plus tard, la joie a fait place au désespoir. Il s'est avéré que le bébé avait hérité d'une terrible maladie - l'hémophilie, dont souffraient de nombreux membres de la famille de la reine Alexandra. Les femmes ne sont généralement pas touchées par cette maladie, mais elles sont porteuses de la maladie – elle peut se transmettre de mère en fils. Le frère de l'impératrice, Frédéric, ainsi que son oncle, le duc Léopold, fils de la reine Victoria, sont morts d'hémophilie, c'est-à-dire d'hémorragies dues à une mauvaise coagulation du sang. Les neveux de la tsarine russe souffraient de la même maladie depuis leur enfance. On pense que la porteuse de la maladie était la « grand-mère » de la plupart des cours royales, la reine Victoria, qui a régné sur l’Angleterre pendant soixante-quatre ans. En Russie, cette maladie était encore inconnue.
Toute la vie du petit héritier, un enfant beau et affectueux aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleu clair, a été une souffrance continue. Mais les parents ont doublement souffert, et surtout la reine Alexandra, qui a réalisé qu’elle était la coupable involontaire de la maladie de son fils. Le garçon était très actif et joueur. Pourtant, la moindre contusion insignifiante, une blessure légère pourrait le tuer. La médecine était ici impuissante ; il n’existait aucun remède à cette terrible maladie.
Parmi ceux qui n'appartenaient pas à la famille royale, Pierre Gilliard, venu de Suisse en Russie alors qu'il avait vingt-cinq ans, a été témoin de la manifestation de la terrible maladie de l'héritier. Il a été invité à enseigner le français aux filles royales alors que le garçon n'avait que deux ans. Chaque jour, pendant six ans, il venait au palais pour donner des cours. Il ne voyait le petit Alexei que parfois dans les bras de sa mère ; il ne savait rien de sa maladie. Il a rencontré le frère de ses élèves alors qu'il avait déjà huit ans. À la demande de l'impératrice, il a commencé à étudier le français avec lui. Le garçon avait une excellente audition et comprenait facilement la langue. Contrairement à ses sœurs, qui jouaient du piano, Alexey a préféré la balalaïka et a bien appris à jouer de cet instrument véritablement russe. Le fils du roi était un enfant joyeux qui aimait observer la nature et prendre soin des animaux. Des animaux dressés l'ont remplacé par la compagnie de garçons de son âge – des camarades de jeu. En raison de l'hémophilie, l'impératrice ne permettait pas à son fils de jouer avec ses pairs, alors l'enfant communiquait davantage avec des adultes - Gilliard et le marin Derevenko, qui lui était chargé de surveiller chacun de ses pas, car un malheur pouvait survenir à cause de toute négligence. . Il a été demandé aux médecins et aux proches du garçon de ne pas révéler la terrible maladie. L'état de santé de l'héritier du trône était gardé dans la plus stricte confidentialité. Il était impossible de permettre au peuple russe de découvrir que son futur tsar était réellement handicapé.
300e anniversaire de la Maison Romanov
En 1913, la Russie a célébré le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov à une échelle extraordinaire. La famille impériale s'est rendue à Moscou, de là à Vladimir, Nijni Novgorod, puis le long de la Volga jusqu'à Kostroma, où le 14 mars 1613, au monastère d'Ipatiev, a eu lieu le rite solennel d'appel de Mikhaïl Romanov au royaume. L'anniversaire a été marqué par de magnifiques célébrations, de magnifiques défilés et des festivités publiques. De luxueuses publications consacrées à l'histoire de la maison régnante ont été publiées. Le pays était optimiste quant à l'avenir. Les prévisions étaient différentes, mais personne n'aurait pu imaginer que le puissant empire, qui semblait plein de force, vivait ses dernières années.
Révolution de février et abdication du trône par Nicolas
À la mi-février 1917, des interruptions dans l'approvisionnement en pain survinrent à Petrograd. Des « queues » alignées près des boulangeries. Des grèves éclatent dans la ville : le 18 février, l'usine de Putilov ferme ses portes.
Des milliers de travailleurs sont descendus dans les rues de la ville. Ils criaient : « Du pain ! et « A bas la faim ! » Ce jour-là, environ 90 000 travailleurs ont pris part à la grève et le mouvement de grève s'est développé comme une boule de neige. Le lendemain, plus de 200 000 personnes étaient en grève, et le lendemain, plus de 300 000 personnes (80 % de tous les travailleurs du capital). Des rassemblements ont commencé sur la perspective Nevski et dans d’autres rues principales de la ville. Leurs slogans devenaient de plus en plus décisifs. Des drapeaux rouges retentissaient déjà dans la foule et on pouvait entendre : « A bas la guerre ! et "A bas l'autocratie!" Les manifestants ont chanté des chants révolutionnaires.
Le 25 février 1917, Nicolas II du quartier général télégraphia au commandant du district militaire de la capitale, le général Sergueï Khabalov : « Je vous ordonne d'arrêter demain les émeutes dans la capitale, qui sont inacceptables en temps de guerre difficile.
Le général essaya d'exécuter l'ordre. Le 26 février, une centaine d’« initiateurs des émeutes » sont arrêtés. Les troupes et la police ont commencé à disperser les manifestants à coups de feu. Au total, 169 personnes sont mortes au cours de ces jours, environ un millier ont été blessées (plus tard, plusieurs dizaines de personnes supplémentaires sont mortes parmi les blessés).
Cependant, les tirs dans les rues n’ont fait que provoquer un nouvel accès d’indignation, mais cette fois parmi les militaires eux-mêmes. Les soldats des équipes de réserve des régiments Volyn, Preobrazhensky et lituanien ont refusé de « tirer sur le peuple ». Une émeute éclata parmi eux et ils se rallièrent aux manifestants. Le 27 février 1917, Nicolas II écrit dans son journal : « Les troubles ont commencé à Petrograd il y a quelques jours ; Malheureusement, des troupes ont également commencé à y participer. C’est un sentiment dégoûtant d’être si loin et de recevoir de mauvaises nouvelles fragmentaires ! L'empereur envoya le général Nikolaï Ivanov dans la capitale rebelle, lui ordonnant de « rétablir l'ordre dans les troupes ». Mais cette tentative n'aboutit finalement à rien : le 28 février, les derniers défenseurs du gouvernement, menés par le général Khabalov, se rendirent à Petrograd. "Les troupes se sont progressivement dispersées...", a expliqué le général. « Ils se sont dispersés progressivement, laissant les armes derrière eux. » Les ministres ont pris la fuite et ont ensuite été arrêtés un à un. Certains ont été eux-mêmes placés en garde à vue pour éviter les représailles.
Le dernier jour de février, le souverain quitta Moguilev pour Tsarskoïe Selo. Cependant, en cours de route, des informations ont été reçues selon lesquelles le chemin était occupé par les rebelles. Ensuite, le train royal s'est tourné vers Pskov, où se trouvait le quartier général du Front Nord. Nicolas II est arrivé ici le soir du 1er mars.
Dans la nuit du 2 mars, Nicolas II convoque le commandant en chef du front, le général Nikolaï Rouzski, et lui dit : « J'ai décidé de faire des concessions et de leur confier un ministère responsable ». Nikolaï Rouzski a immédiatement informé Mikhaïl Rodzianko de la décision du tsar par télégramme direct. Il répondit : « Il est évident que Sa Majesté et vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe ici ; l'une des révolutions les plus terribles est arrivée, qui ne sera pas si facile à surmonter... Le temps est perdu et il n'y a pas de retour.» M. Rodzianko a déclaré que Nicolas devait désormais abdiquer en faveur de l'héritier. Ayant appris cette réponse de M. Rodzianko, N. Ruzsky, par l'intermédiaire de l'État-major, demanda l'avis de tous les commandants en chef des fronts. Dans la matinée, leurs réponses commencèrent à arriver à Pskov. Ils ont tous supplié le souverain de signer une renonciation pour sauver la Russie et poursuivre avec succès la guerre. Le message le plus éloquent est peut-être venu du général Vladimir Sakharov, sur le front roumain. Le général a qualifié la proposition d’abdiquer de « dégoûtante ». Le 2 mars vers 14h30, ces télégrammes furent signalés au souverain. Nikolai Ruzsky s'est également prononcé en faveur du renoncement. "Maintenant, nous devons nous rendre à la merci du vainqueur" - c'est ainsi qu'il a exprimé son opinion aux proches du roi. Une telle unanimité parmi les chefs de l'armée et de la Douma a fait de l'empereur
Nicolas II a fait forte impression. Il a été particulièrement frappé par le télégramme envoyé par le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch...
Dans la soirée du même jour, les députés de la Douma A. Guchkov et V. Shulgin sont arrivés à Pskov. L'Empereur les reçut dans sa voiture. Dans le livre « Days », V. Shulgin a ainsi transmis les paroles de Nicolas II : « Sa voix était calme, simple et précise.
J'ai décidé d'abdiquer le trône... Jusqu'à trois heures aujourd'hui, je pensais que je pourrais abdiquer en faveur de mon fils Alexei... Mais à ce moment-là, j'ai changé d'avis en faveur de mon frère Mikhaïl... J'espère que tu Je comprends les sentiments de mon père… Il a dit la dernière phrase plus doucement… »
Nicolas a remis aux députés un manifeste de renonciation, tapé sur une machine à écrire. Le document portait la date et l’heure : « 2 mars, 15h55 ».
Tobolsk
DANS conditions révolutionnaires Le gouvernement provisoire a jugé préférable que la famille de l'ancien roi quitte le palais. Diverses options ont été discutées - en particulier, Evgeny Sergeevich Botkin, médecin personnel de la cour impériale, a insisté sur Livadia, arguant qu'Alexandra Fedorovna pourrait se sentir mieux dans un climat chaud.
Il y avait aussi la possibilité d'envoyer la famille royale en Angleterre, sous la garde de George V, mais celui-ci, se sentant très précaire sur le trône, craignant le mécontentement de ses sujets, choisit de refuser. Ce refus officiel fut présenté à Kerensky par l'ambassadeur britannique George Buchanan. En fin de compte, le choix s'est porté sur Tobolsk, une ville à la fois éloignée de Moscou et de Saint-Pétersbourg et assez riche. Selon le mentor du tsarévitch Pierre Gillard : Il est difficile de déterminer exactement sur quoi le Conseil des ministres s'est guidé lorsqu'il a décidé de transférer les Romanov à Tobolsk. Lorsque Kerensky rapporta cela à l'empereur, il expliqua la nécessité de cette décision en disant que le gouvernement provisoire avait décidé de prendre les mesures les plus énergiques contre les bolcheviks ; en conséquence, selon lui, des affrontements armés se produiraient inévitablement, dans lesquels la première victime serait la famille royale... D'autres pensaient que cette décision n'était qu'une lâche concession à l'extrême gauche, qui exigeait l'expulsion de l'Empereur. en Sibérie, étant donné que tout le monde imaginait constamment un mouvement dans l'armée en faveur du tsar.
Presque jusqu'au dernier jour, la date et le lieu où les Romanov étaient censés se rendre étaient tenus secrets. DANS derniers jours Les Romanov ont reçu la visite du général Kornilov et du grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch. Les prisonniers n'étaient pas autorisés à le voir seuls ; il y avait un gardien dans la pièce pendant les 10 minutes de la conversation.
Le 2 août 1917, un train battant pavillon de la mission de la Croix-Rouge japonaise quitte une voie d'évitement dans le plus strict secret. Toutes les demi-heures, un officier de service, accompagné d'une sentinelle, parcourait la voiture, « s'assurant que toutes les personnes qui y étaient placées étaient présentes... » Des télégrammes avec rapport étaient envoyés au Gouvernement provisoire.
Le premier d'entre eux disait : nous suivons en toute sécurité, mais sans aucun horaire, conformément à l'accord du personnel. Kobylinski, Makarov, Verchinine.
Le 5 août 1917, un train spécial arrive à Tioumen. La famille aurait dû être transférée ici sur le bateau à vapeur "Rus", qui était censé les emmener jusqu'au bord de la rivière Tobolu. Ce jour-là, un autre télégramme fut envoyé : L'embarquement sur le navire s'est effectué en toute sécurité... Le 6 au soir, nous arrivons à Tobolsk. Kobylinski Makarov, Verchinine. Après son arrivée, la famille royale a dû vivre sur le navire pendant encore sept jours, la maison de l'ancien gouverneur a été réparée à la hâte et préparée pour leur réception. Conclusion de Tobolsk dans ce qu'on appelle La « Maison de la Liberté » n’était pas un fardeau pour la famille royale. L'éducation des enfants s'est poursuivie - ils ont été instruits par leur père, leur mère, Pierre Gillard et la demoiselle d'honneur Anastasia Gendrikova. Nous nous sommes promenés dans le jardin, nous sommes balancés sur des balançoires, avons scié du bois et mis en scène des pièces de théâtre à la maison. Professeur des enfants impériaux M.K. Bitner se souvient : Elle aimait et savait parler avec tout le monde, en particulier avec les gens ordinaires, les soldats. Elle avait de nombreux thèmes communs avec eux : les enfants, la nature, l'attitude envers sa famille... Le commissaire V.S. Pankratov l'aimait beaucoup, l'adorait carrément. Yakovlev l'a probablement aussi bien traitée... Les filles ont alors ri lorsqu'elles ont reçu une lettre d'elle d'Ekaterinbourg, dans laquelle elle leur écrivait probablement quelque chose sur Yakovlev : "Masha a de la chance d'être commissaires." Elle était l'âme de la famille.
Il y avait tellement de neige la veille de Noël que Pierre Gillard a proposé de construire un toboggan pour les enfants. Pendant plusieurs jours, quatre sœurs ont transporté de la neige ensemble, puis Zhiyard et Prince V.A. Dolgorouki lui versa trente seaux d'eau.
Pour Noël, deux arbres ont été disposés - un pour la famille royale, le second - dans le poste de garde pour les serviteurs et les gardes. Les prisonniers étaient autorisés à fréquenter l’église de la maison du gouverneur, et à chaque fois un couloir de sympathisants était aligné.
Pendant le service de Noël, un incident désagréable s'est produit - l'un des prêtres a proclamé « De nombreuses années à venir » à la famille impériale, ce qui a dérouté toutes les personnes présentes. L'évêque Hermogène a immédiatement envoyé le prêtre au monastère d'Abalak, mais des rumeurs persistantes se sont répandues dans toute la ville sur l'évasion imminente de la famille royale et le régime de détention des prisonniers a été renforcé.
Départ pour Ekaterinbourg
Après l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement bolchevique, les passions autour de la famille royale emprisonnée à Tobolsk ont continué à s’intensifier. Fin janvier 1918, le Conseil des commissaires du peuple décida d'ouvrir le procès de l'ancien tsar et Léon Trotsky devait être le principal accusateur. Le procès devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, et afin d'y livrer l'ancien tsar. Le commissaire V.V. Yakovlev a été envoyé à Tobolsk. Dans le livre de l'enquêteur de l'Armée blanche N.A. Sokolov a conservé de vagues allusions à la mauvaise volonté des « gardiens de la révolution » et à l'incitation au lynchage, ainsi qu'à un complot aventureux visant à emmener la famille royale en Allemagne.
Le 22 avril 1918, le commissaire Yakovlev arrive à Tobolsk. Le projet initial de faire sortir toute la famille de Tobolsk a dû être abandonné, car le 12 avril, Alexeï a été grièvement blessé et incapable de se déplacer de manière autonome.
Le 25 avril, Yakovlev a rencontré l'ancien tsar et a officiellement annoncé qu'il allait l'emmener seul. Nikolaï a tenté d'argumenter, mais Yakovlev lui a rappelé sans équivoque son statut de prisonnier et l'a menacé de violence ou de refus d'accomplir la mission qui lui était assignée, auquel cas « ils pourraient envoyer une autre personne, moins humaine, à ma place ». Ni la destination ni le motif du départ, selon le témoignage du colonel Kobylinsky, n'ont été communiqués à l'ancien tsar. Nicolas lui-même était d'avis qu'ils allaient le forcer à apposer sa signature sur le traité de paix de Brest, et il a vivement protesté contre cela. La reine décide d'accompagner son mari. On ne sait pas comment Maria les a rejoints. Des opinions ont été exprimées selon lesquelles elle l'avait fait volontairement ou, au contraire, avait été choisie par sa mère comme la plus forte physiquement des sœurs.
Le 26 avril, à 3h30 du matin, des « koshevas » sibériens – des charrettes – sont amenés au porche, et une paillasse est placée dans le second, destiné à l'impératrice. Outre son épouse et sa fille, le tsar devait être accompagné lors de ce voyage du prince Dolgorukov, du docteur Botkin, du valet Chemodurov, de la demoiselle d'honneur Demidova et du valet du tsar Ivan Sednev. Devant et derrière les équipages se trouvaient les gardes du détachement de Yakovlev avec deux mitrailleuses et huit soldats de la garnison de Tobolsk. Tioumen, où il était prévu de monter à bord du train, se trouvait à 260 verstes de Tobolsk, la route passait par l'Irtych et Tobol, où la glace allait bientôt commencer, ce qui rendait la route difficile et dans une certaine mesure dangereuse.
Le 26 avril à 21 heures, le cortège est arrivé à Tioumen. Au cours des deux derniers jours, le colonel Kobylinsky a réussi à recevoir deux télégrammes de son peuple confirmant le succès de l'expédition. Le 27 avril, Yakovlev plaça la famille dans une voiture de première classe et sépara le tsar de sa femme et de sa fille. Le lendemain, un télégramme fut envoyé à Kobylinsky avec le contenu suivant : « Nous partons sains et saufs. Le Christ est avec nous. Comment va la santé du petit ? Yakovlev." En chemin, on apprit qu'Ekaterinbourg allait arrêter de force l'ancien tsar.
Il convient de noter qu'aucun préparatif n'a été fait pour l'accueil de la famille royale à Ekaterinbourg. L'ingénieur Ipatiev a reçu l'ordre de vider la maison le 29 avril à 15 heures. La sécurité était initialement assurée par des gardes dépêchés à la hâte depuis la prison locale. Le train du tsar, arrivé pour la première fois à la gare d'Ekaterinbourg I, a été immédiatement entouré de curieux qui, de nulle part, ont appris ce qui s'était passé et, par conséquent, afin d'éviter d'éventuels incidents, ont été transférés à la gare d'Ekaterinbourg II, où deux les voitures ont été livrées. La demoiselle d'honneur Schneider, le comte Tatishchev, le prince Dolgorukov (qui a été retrouvé avec 80 000 roubles et deux revolvers lors de la perquisition) et la comtesse Gendrikova, qui accompagnait le tsar, ont été immédiatement arrêtés et emmenés à la prison locale.
Les autres ont été emmenés dans la maison d'Ipatiev et pour les personnes arrêtées, quatre pièces d'angle au deuxième étage ont été initialement attribuées, où le tsar, la tsarine et la grande-duchesse vivaient dans une chambre commune.
Maison Ipatiev
À leur arrivée, les personnes arrêtées ont été soumises à une fouille approfondie et tout a été vérifié, y compris les sacs à main de la tsarine et de la grande-duchesse, et il leur a également été ordonné de déclarer les sommes d'argent dont chacune disposait. Le régime dans la Maison à usage spécial était assez monotone - le matin il y avait du thé avec des restes de pain de la veille, au déjeuner - des plats chauds (soupe de viande, côtelettes ou rôti), de plus, le cuisinier Sednev cuisinait des pâtes, pour lequel un poêle primus lui a été fourni. Le soir, nous devions réchauffer ce qui restait du dîner. Sur ordre de l'ancien roi, les serviteurs s'asseyaient à table ensemble, car il n'y avait pas assez de couverts et ils devaient manger à tour de rôle. Le soir, Maria jouait au bezique ou au backgammon avec son père, lisait à tour de rôle à haute voix « Guerre et Paix » avec lui et se relayait avec sa mère et ses sœurs pour veiller au chevet d'Alexei malade. Nous nous sommes couchés vers 22 heures. Le valet Chemodurov (qui a ensuite témoigné auprès de N.A. Sokolov, qui a dirigé l'enquête sur l'exécution de la famille royale) et le docteur Derevenko étaient parfois autorisés à entrer dans la maison. Les femmes qui apportaient de la nourriture aux prisonniers de la cantine locale n'étaient pas autorisées à entrer et étaient obligées de la transmettre par l'intermédiaire des gardiens ; les religieuses ont également essayé de livrer de la nourriture, mais ces livraisons n'ont pas atteint les prisonniers, de peur que les « transferts » contiennent des messages secrets. À Pâques 1918, le prêtre de l'église locale fut autorisé à entrer dans la maison et des gâteaux de Pâques et des œufs colorés furent également livrés. La marche était autorisée dans une petite cour, entourée de tous côtés par une double clôture, et pendant les promenades, tout le monde devait rester ensemble, et la sécurité dans le jardin était considérablement renforcée.
Selon les souvenirs des proches survivants, les soldats de l’Armée rouge qui gardaient la maison d’Ipatiev faisaient parfois preuve de manque de tact et d’impolitesse envers les prisonniers.
Le 23 mai, à 2 heures du matin, le reste des enfants fut amené chez Ipatiev, après quoi une chambre séparée fut réservée aux quatre grandes-duchesses, et l'héritier prit la place de Maria dans la chambre des parents.
Exécution
La décision d'abattre les Romanov sans procès préliminaire a été prise par le Conseil de l'Oural, contrairement à l'avis du gouvernement de Moscou, qui a continué d'insister sur le renvoi de l'ancien tsar au plus profond du pays. La décision a été prise début juillet, lorsque l'inévitabilité de la reddition d'Ekaterinbourg face à l'avancée des armées blanches est devenue tout à fait claire, ainsi que la crainte d'éventuelles tentatives des monarchistes locaux de libérer la famille royale par la force. La question de l’exécution a été fondamentalement résolue début juillet. Il n'y avait pas d'accord entre les exécuteurs testamentaires sur la méthode d'exécution de la peine. Il a été suggéré de les poignarder dans leur lit pendant leur sommeil ou de lancer des grenades dans leur chambre. Finalement, le point de vue de Yakov Yurovsky l'a emporté, qui proposait de les réveiller au milieu de la nuit et de leur ordonner de descendre au sous-sol sous prétexte que des tirs pourraient commencer dans la ville et qu'il deviendrait dangereux de rester sur place. deuxième étage.
De tous les habitants de la maison Ipatiev, il a été décidé de ne laisser en vie que le cuisinier Leonid Sednev, qui a été emmené le même jour sous prétexte de rencontrer son oncle.
Le 16 juillet 1918, Alexandra Fedorovna écrit dans son journal : Matin gris... L'enfant a attrapé un léger rhume. Tout le monde est sorti une demi-heure le matin... Chaque matin, le commissaire vient dans nos chambres. Finalement, une semaine plus tard, j'ai de nouveau apporté des œufs à l'enfant. Dîner à 8 heures. Soudain, Lika Sednev a été convoquée à une réunion avec son oncle et s'est envolée - j'en suis vraiment surpris, nous verrons s'il reviendra.
Les Romanov, alarmés par ce changement, ne se couchèrent qu'à minuit. A une heure et demie du matin, un camion est arrivé, préalablement désigné pour évacuer les cadavres. À peu près au même moment, Yurovsky réveilla le docteur Botkin et lui ordonna d'emmener la famille royale au sous-sol. Pendant encore 30 à 40 minutes, les Romanov et les domestiques, se levant de leur lit, s'habillèrent et se mirent en ordre, puis descendirent au sous-sol. Des chaises ont été apportées dans la salle d'exécution pour l'impératrice et Alexei, qui, après s'être blessé au genou, n'ont pas pu marcher pendant un certain temps. Son père l'a porté au sous-sol. Maria se tenait derrière sa mère. D'après les mémoires de Ya.M. Yurovsky Romanovs avant dernière minute n'avaient aucune idée de leur sort. Yurovsky s'est limité à déclarer que le Conseil des députés ouvriers avait adopté une résolution sur l'exécution, après quoi il avait été le premier à tirer sur l'ancien tsar. Il était environ 2h30 du matin le 17 juillet. Ensuite, des tirs généraux ont commencé et, au bout d'une demi-heure, tout était terminé.
Au dessus de la fosse de Ganina
Le territoire des «Quatre Frères» est situé à quelques kilomètres du village de Koptyaki, non loin d'Ekaterinbourg. L'une de ses fosses a été choisie par l'équipe de Yurovsky pour enterrer les restes de la famille royale et des serviteurs.
Il n'a pas été possible de garder l'endroit secret dès le début, car littéralement à côté du terrain se trouvait une route menant à Ekaterinbourg ; tôt le matin, le cortège a été vu par un paysan du village de Koptyaki, Natalya. Zykova, puis plusieurs autres personnes. Les soldats de l'Armée rouge, menaçant avec leurs armes, les ont chassés. Plus tard dans la journée, des explosions de grenades ont été entendues dans la zone. Intéressés par cet étrange incident, des riverains, quelques jours plus tard, alors que le cordon avait déjà été levé, se sont rendus sur le terrain et ont réussi à découvrir à la hâte plusieurs objets de valeur (appartenant apparemment à la famille royale), non remarqués par les bourreaux. Du 6 juin au 10 juillet, sur ordre de l'amiral Kolchak, commencèrent les fouilles de la fosse de Ganina, qui furent interrompues en raison du retrait des Blancs de la ville.
Le 11 juillet 1991, des restes identifiés comme étant les corps de la famille royale et de ses serviteurs ont été retrouvés dans la fosse Ganina, à un peu plus d'un mètre de profondeur. En 1998, lorsque les restes de la famille impériale furent définitivement inhumés. Les doutes ont finalement été levés en 2007, après la découverte des restes d'une jeune fille et d'un garçon dans ce qu'on appelle le pré Porosenkovsky, identifiés plus tard comme étant le tsarévitch Alexei et Maria. Les tests génétiques ont confirmé les premiers résultats. En juillet 2008, cette information a été officiellement confirmée par la commission d'enquête du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie, rapportant qu'un examen des restes découverts en 2007 sur l'ancienne route Koptyakovskaya a établi : les restes découverts appartenaient à Grande-Duchesse Marie et le tsarévitch Alexei, qui était l'héritier de l'empereur.
Canonisation
La canonisation de la famille du dernier tsar au rang de nouveaux martyrs a été entreprise pour la première fois par l'Église orthodoxe étrangère en 1981. Les préparatifs pour la canonisation en Russie ont commencé en 1991, lorsque les fouilles ont repris dans la fosse Ganina. Avec la bénédiction de Mgr Melchisédek, une croix de culte a été installée dans le terrain le 7 juillet. Le 17 juillet 1992 a eu lieu la première procession religieuse de l'évêque jusqu'au lieu de sépulture des restes de la famille royale.
Une nouvelle croix avec un écrin d'icônes a été installée ici par la Confrérie au nom des Saints Martyrs Royaux. Dans la nuit du 17 juillet 1995, la première Divine Liturgie, désormais célébrée chaque année, a été célébrée à la croix. En 2000, la décision de canonisation a été prise par l'Église orthodoxe russe. La même année, avec la bénédiction du Patriarche, a commencé la construction du monastère de Ganina Yama. Nous espérons que la construction d'un monastère sur le site de la destruction des corps des Porteurs de la Passion Royale à Ganina Yama, où se trouve l'église la prière sera également bientôt offerte, effacera les conséquences des terribles crimes commis sur la terre de l'Oural qui souffre depuis longtemps.
Le 1er octobre 2000, Son Éminence Vincent, archevêque d'Ekaterinbourg et Verkhoturye, a posé la première pierre des fondations de la future église en l'honneur des Saints Porteurs de la Passion Royale. Le monastère est construit principalement en bois, il contient sept églises principales, en particulier le temple principal en l'honneur des saints passionnés royaux.
Littérature et sources
1. Dictionnaire encyclopédique. Édition de Brockhaus et Efron. T. XVII B, S.-Pb, 1858.
2. Syrov S.N. "Pages d'histoire", M., Maison d'édition "Langue russe", 1983.
3. Soloviev S.M. « Lectures et récits sur l'histoire de la Russie », M., Maison d'édition Pravda, 1989.
4. Klyuchevsky V.O. «Portraits historiques», M., Maison d'édition Pravda, 1991.
5. Platonov S.F. "Manuel d'histoire russe pour lycée. Cours systématique », M., Maison d'édition « Zveno », 1994.
6. Grand dictionnaire encyclopédique. – 2e éd., révisée. et supplémentaire – M. : Grande Encyclopédie russe, 1998.
7. Grande encyclopédie Cyrille et Méthode, 9e éd. sur 2 CD, 2005.
8. http://www.km.ru/ Encyclopédie de Cyrille et Méthode.
9. http://www.hrono.ru/ Chronos - L'histoire du monde sur Internet.
10. http://www.leadersschool.ru/ École de leaders charismatiques.
11. http://www.ido.edu.ru/ Tableau chronologique.
12. http://www.Wikipedia.ru/Wikipedia.
Nicolas II Alexandrovitch. Né le 6 (18) mai 1868 à Tsarskoïe Selo - exécuté le 17 juillet 1918 à Ekaterinbourg. Empereur de toute la Russie, tsar de Pologne et grand-duc de Finlande. Régna du 20 octobre (1er novembre) 1894 au 2 (15) mars 1917. De la Maison Impériale des Romanov.
Titre complet de Nicolas II en tant qu'empereur: « Par la grâce avancée de Dieu, Nicolas II, empereur et autocrate de toute la Russie, Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod ; Tsar de Kazan, Tsar d'Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar de Sibérie, Tsar de Tauride Chersonèse, Tsar de Géorgie ; Souverain de Pskov et grand-duc de Smolensk, de Lituanie, de Volyn, de Podolsk et de Finlande ; Prince d'Estland, Livonie, Courlande et Semigal, Samogit, Bialystok, Korel, Tver, Ugra, Perm, Viatka, Bulgarie et autres ; Souverain et grand-duc de Novagorod des terres de Nizovsky, Tchernigov, Riazan, Polotsk, Rostov, Yaroslavl, Belozersky, Udorsky, Obdorsky, Kondiysky, Vitebsk, Mstislavsky et tout le pays du Nord ; et le souverain des terres d'Iversk, de Kartalinsky et de Kabarde et de la région arménienne ; Princes de Tcherkassy et des Montagnes et autres souverains et propriétaires héréditaires, souverain du Turkestan ; héritier de Norvège, duc de Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen et Oldenburg, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Nicolas II Alexandrovitch est né le 6 mai (style 18e ancien) 1868 à Tsarskoïe Selo.
Le fils aîné de l'empereur et de l'impératrice Maria Feodorovna.
Immédiatement après sa naissance, le 6 (18) mai 1868, il fut nommé Nikolaï. C'est un nom traditionnel des Romanov. Selon une version, il s'agirait d'un « nom d'oncle » - une coutume connue des Rurikovich : il aurait été nommé en mémoire du frère aîné de son père et fiancé de sa mère, le tsarévitch Nikolaï Alexandrovitch (1843-1865), décédé jeune.
Deux arrière-arrière-grands-pères de Nicolas II étaient frères : Friedrich de Hesse-Kassel et Karl de Hesse-Kassel, et deux arrière-arrière-grands-mères étaient cousines : Amalia de Hesse-Darmstadt et Louise de Hesse-Darmstadt.
Le baptême de Nicolas Alexandrovitch a été célébré par le confesseur de la famille impériale, le protopresbytre Vasily Bazhanov, dans l'église de la Résurrection du Grand Palais de Tsarskoïe Selo le 20 mai de la même année. Les successeurs étaient : la reine Louise de Danemark, le prince héritier Frédéric de Danemark et la grande-duchesse Elena Pavlovna.
Dès sa naissance, il portait le titre de Son Altesse Impériale (souveraine) Grand-Duc Nikolaï Alexandrovitch. Après la mort de son grand-père, l'empereur Alexandre II, à la suite d'un attentat terroriste commis par les populistes, le 1er mars 1881, il reçut le titre d'héritier du prince héritier.

DANS petite enfance Le professeur de Nicolas et de ses frères était l'Anglais Karl Osipovich Heath (1826-1900), qui vivait en Russie. Le général G. G. Danilovich fut nommé son tuteur officiel comme héritier en 1877.
Nikolai a fait ses études à la maison dans le cadre d'un grand cours de gymnase.
En 1885-1890 - selon un programme spécialement rédigé qui combinait le cours des départements d'État et économiques de la faculté de droit de l'université avec le cours de l'Académie de l'état-major.
Les sessions de formation ont duré 13 ans : les huit premières années ont été consacrées aux matières d'un cours prolongé de gymnase, où une attention particulière a été accordée à l'étude de l'histoire politique, de la littérature russe, de l'anglais, de l'allemand et Français(Nikolai Alexandrovich parlait anglais comme un natif). Les cinq années suivantes furent consacrées à l'étude des affaires militaires, des sciences juridiques et économiques nécessaires à un homme d'État. Les conférences ont été données par des scientifiques de renommée mondiale : N. N. Beketov, N. N. Obruchev, Ts. A. Cui, M. I. Dragomirov, N. H. Bunge et d'autres. Ils donnaient tous simplement des conférences. Ils n'avaient pas le droit de poser des questions pour vérifier comment ils maîtrisaient la matière. Le protopresbytre Jean Yanyshev a enseigné le droit canonique du tsarévitch en relation avec l'histoire de l'Église, les principaux départements théologie et histoire des religions.
Le 6 (18) mai 1884, devenu majeur (pour l'héritier), il prête serment dans la Grande Église du Palais d'Hiver, comme l'annonce le plus haut manifeste.
Le premier acte publié en son nom était un rescrit adressé au gouverneur général de Moscou, V.A. Dolgorukov : 15 000 roubles à distribuer, à la discrétion de cette personne, « aux habitants de Moscou qui ont le plus besoin d'aide ».
Pendant les deux premières années, Nikolai a servi comme officier subalterne dans les rangs du régiment Preobrazhensky. Pendant deux saisons d'été, il a servi dans les rangs du Life Guards Hussar Regiment en tant que commandant d'escadron, puis a suivi un camp d'entraînement dans les rangs de l'artillerie.
Le 6 (18) août 1892, il est promu colonel. Parallèlement, son père l'initie aux affaires de gouvernement du pays, l'invitant à participer aux réunions du Conseil d'État et du Cabinet des ministres. Sur proposition du ministre des Chemins de fer S. Yu. Witte, Nikolai, en 1892, afin d'acquérir de l'expérience dans les affaires gouvernementales, fut nommé président du comité pour la construction du chemin de fer transsibérien. À l’âge de 23 ans, l’héritier était un homme qui avait reçu de nombreuses informations dans divers domaines du savoir.

Le programme éducatif comprenait des voyages dans diverses provinces de Russie, qu'il effectuait avec son père. Pour compléter ses études, son père a mis à sa disposition le croiseur "Mémoire d'Azov" faisant partie de l'escadron pour un voyage en Extrême-Orient.
En neuf mois, avec sa suite, il visita l'Autriche-Hongrie, la Grèce, l'Egypte, l'Inde, la Chine, le Japon, et plus tard, par voie terrestre depuis Vladivostok à travers toute la Sibérie, il retourna dans la capitale de la Russie. Pendant le voyage, Nikolaï conduisait Journal personnel. Au Japon, une tentative d'assassinat a été commise contre Nicolas (le soi-disant incident d'Otsu) - une chemise tachée de sang est conservée à l'Ermitage.
Taille de Nicolas II : 170 centimètres.
Vie personnelle de Nicolas II :
La première femme de Nicolas II était une célèbre ballerine. Ils entretenaient une relation intime entre 1892 et 1894.
Leur première rencontre eut lieu le 23 mars 1890 lors de l'examen final. Leur romance s'est développée avec l'approbation des membres de la famille royale, à commencer par l'empereur Alexandre III, qui a organisé cette connaissance, et se terminant par l'impératrice Maria Feodorovna, qui voulait que son fils devienne un homme. Mathilde a appelé le jeune tsarévitch Niki.
Leur relation prit fin après les fiançailles de Nicolas II avec Alice de Hesse en avril 1894. De l’aveu même de Kshesinskaya, elle a eu du mal à survivre à cette rupture.
Mathilda Kshesinskaya

La première rencontre du tsarévitch Nicolas avec sa future épouse eut lieu en janvier 1889 lors de la deuxième visite de la princesse Alice en Russie. Dans le même temps, une attirance mutuelle est née. La même année, Nicolas demande à son père la permission de l'épouser, mais sa demande lui est refusée.
En août 1890, lors de la troisième visite d'Alice, les parents de Nikolaï ne lui permettent pas de la rencontrer. Une lettre de la même année adressée à la grande-duchesse Elizabeth Feodorovna de la reine anglaise Victoria, dans laquelle la grand-mère de la mariée potentielle enquêtait sur les perspectives d'une union matrimoniale, a également eu un résultat négatif.
Cependant, en raison de la détérioration de la santé d'Alexandre III et de la persévérance du tsarévitch, son père lui permit de faire une proposition officielle à la princesse Alice et le 2 (14) avril 1894, Nicolas, accompagné de ses oncles, se rendit à Cobourg, où il arrive le 4 avril. La reine Victoria et l'empereur allemand Guillaume II sont également venus ici.
Le 5 avril, le tsarévitch a proposé à la princesse Alice, mais elle a hésité en raison de la question du changement de religion. Cependant, trois jours après un conseil de famille avec des proches (reine Victoria, sœur Elizabeth Feodorovna), la princesse donna son consentement au mariage et le 8 (20) avril 1894 à Cobourg lors du mariage du duc de Hesse Ernst-Ludwig ( Alice (frère d'Alice) et la princesse Victoria-Melita d'Édimbourg (fille du duc Alfred et Maria Alexandrovna) leurs fiançailles ont eu lieu, annoncées en Russie par un simple avis de journal.
Dans son journal, Nikolai a nommé ce jour « Merveilleux et inoubliable dans ma vie ».
Le 14 (26) novembre 1894, dans l'église du palais d'Hiver, eut lieu le mariage de Nicolas II avec la princesse allemande Alice de Hesse, qui après confirmation (réalisée le 21 octobre (2 novembre 1894) à Livadia) a pris le nom. Les jeunes mariés se sont d'abord installés au palais Anichkov à côté de l'impératrice Maria Feodorovna, mais au printemps 1895, ils ont déménagé à Tsarskoïe Selo et à l'automne dans leurs appartements du Palais d'Hiver.
En juillet-septembre 1896, après le couronnement, Nicolas et Alexandra Feodorovna effectuèrent une grande tournée européenne en tant que couple royal et rendirent visite à l'empereur d'Autriche, Kaiser allemand, le roi danois et la reine britannique. Le voyage s’est terminé par une visite à Paris et des vacances dans la patrie de l’impératrice à Darmstadt.
Au cours des années suivantes, le couple royal a donné naissance à quatre filles:
Olga(3 (15) novembre 1895 ;
Tatiana(29 mai (10 juin) 1897) ;
Marie(14 (26) juin 1899) ;
Anastasie(5 (18) juin 1901).
Les grandes-duchesses utilisaient cette abréviation pour se désigner elles-mêmes dans leurs journaux et leur correspondance. "OTMA", compilés selon les premières lettres de leurs noms, par ordre de naissance : Olga - Tatiana - Maria - Anastasia.
Le 30 juillet (12 août 1904), un cinquième enfant naît à Peterhof et Le fils unique- Tsarévitch Alexeï Nikolaïevitch.
Toute la correspondance entre Alexandra Feodorovna et Nicolas II (en anglais) a été conservée, une seule lettre d'Alexandra Feodorovna a été perdue, toutes ses lettres sont numérotées par l'impératrice elle-même ; publié à Berlin en 1922.


À l'âge de 9 ans, il a commencé à tenir un journal. Les archives contiennent 50 volumineux cahiers - le journal original pour les années 1882-1918, dont certains ont été publiés.
Contrairement aux assurances de l'historiographie soviétique, le tsar ne faisait pas partie des les gens les plus riches Empire russe.
La plupart du temps, Nicolas II vivait avec sa famille au palais Alexandre (Tsarskoïe Selo) ou à Peterhof. L'été, j'ai passé mes vacances en Crimée au palais de Livadia. Pour ses loisirs, il effectuait également chaque année des voyages de deux semaines autour du golfe de Finlande et de la mer Baltique sur le yacht « Standart ».
Je lis à la fois de la littérature de divertissement légère et des ouvrages scientifiques sérieux, souvent sur des sujets historiques - des journaux et magazines russes et étrangers.
J'ai fumé des cigarettes.
Il s'intéressait à la photographie, aimait aussi regarder des films et tous ses enfants prenaient également des photos.
Dans les années 1900, il s’intéresse à un nouveau type de transport : la voiture. Il possède l'un des plus grands parkings d'Europe.
En 1913, l’organe de presse officiel du gouvernement écrivait dans un essai sur l’aspect quotidien et familial de la vie de l’empereur : « L’empereur n’aime pas les soi-disant plaisirs profanes. Son passe-temps favori est la passion héréditaire des tsars russes : la chasse. Elle est organisée à la fois dans les lieux permanents du séjour du tsar et dans des lieux spéciaux adaptés à cet effet - à Spala, près de Skierniewice, à Belovezhye.»
J'avais l'habitude de tirer sur des corbeaux, des chats et des chiens errants lors de promenades.
Nicolas II. Documentaire
Couronnement et accession au trône de Nicolas II
Quelques jours après la mort d'Alexandre III (20 octobre (1er novembre) 1894) et son accession au trône (le plus haut manifeste fut publié le 21 octobre), le 14 (26 novembre 1894), dans la Grande Église de au Palais d'Hiver, il épousa Alexandra Fedorovna. La lune de miel s'est déroulée dans une atmosphère de funérailles et de visites de deuil.
L'une des premières décisions personnelles de l'empereur Nicolas II fut le licenciement de I.V. Gurko, en proie au conflit, du poste de gouverneur général du Royaume de Pologne en décembre 1894 et la nomination d'A.B. Lobanov-Rostovsky au poste de ministre des Affaires étrangères. Affaires en février 1895 - après la mort de N. K. Girsa.
À la suite de l'échange de notes du 27 mars (8 avril 1895), « la délimitation des sphères d'influence de la Russie et de la Grande-Bretagne dans la région du Pamir, à l'est du lac Zor-Kul (Victoria) » le long de la rivière Pyanj a été établi. Le volost du Pamir est devenu une partie du district d'Osh de la région de Fergana, la crête de Wakhan sur les cartes russes a reçu la désignation de crête de l'empereur Nicolas II.
Le premier acte international majeur de l'empereur fut la triple intervention - une présentation simultanée (11 (23) avril 1895), à l'initiative du ministère russe des Affaires étrangères, (avec l'Allemagne et la France) d'exigences pour que le Japon reconsidère les termes de l'accord. le Traité de paix de Shimonoseki avec la Chine, renonçant à ses revendications sur la péninsule du Liaodong.
La première apparition publique de l'empereur à Saint-Pétersbourg fut son discours prononcé le 17 (29) janvier 1895 dans la salle Nicolas du Palais d'Hiver devant les députations de la noblesse, des zemstvos et des villes venues « pour exprimer leurs sentiments loyaux envers leur Majestés et présentez vos félicitations pour le mariage. Le texte prononcé du discours (le discours était écrit à l'avance, mais l'empereur ne le prononçait que de temps en temps en regardant le papier) disait : "Je sais que dans Dernièrement Les voix de personnes emportées par des rêves insensés sur la participation des représentants du zemstvo aux affaires de gouvernement interne se sont fait entendre dans certaines assemblées du zemstvo. Que tout le monde sache qu'en consacrant toutes mes forces au bien du peuple, je protégerai le début de l'autocratie avec autant de fermeté et d'inébranlabilité que mon inoubliable et regretté parent l'a gardé..
Le couronnement de l'empereur et de son épouse eut lieu le 14 (26) mai 1896. La célébration a fait de nombreuses victimes sur le terrain de Khodynskoye, l'incident est connu sous le nom de Khodynka.
La catastrophe de Khodynka, également connue sous le nom de bousculade massive, s'est produite tôt le matin du 18 (30) mai 1896 sur le champ de Khodynka (partie nord-ouest de Moscou, début de l'actuelle perspective Leningradsky) à la périphérie de Moscou, lors des célébrations du à l'occasion du couronnement de l'empereur Nicolas II le 14 mai (26). . 1 379 personnes y sont mortes et plus de 900 ont été mutilées. La plupart des cadavres (à l'exception de ceux identifiés immédiatement sur place et remis pour être enterrés dans leurs paroisses) ont été récupérés au cimetière de Vagankovskoye, où ont eu lieu leur identification et leur enterrement. En 1896 au cimetière Vagankovskoye à charnier Un monument aux victimes de la bousculade sur le champ de Khodynka a été érigé selon les plans de l'architecte I. A. Ivanov-Shits, sur lequel est gravée la date de la tragédie : « 18 mai 1896 ».
En avril 1896, le gouvernement russe reconnut officiellement le gouvernement bulgare du prince Ferdinand. En 1896, Nicolas II fit également un grand voyage en Europe, rencontrant François-Joseph, Guillaume II, la reine Victoria (la grand-mère d'Alexandra Feodorovna), la fin du voyage fut son arrivée dans la capitale de la France alliée, Paris.
Au moment de son arrivée en Grande-Bretagne en septembre 1896, les relations entre la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman se sont fortement détériorées, associées au massacre des Arméniens en 1896. Empire ottoman, et le rapprochement simultané de Saint-Pétersbourg avec Constantinople.
Lors d'une visite à la reine Victoria à Balmoral, Nicolas, ayant accepté de développer conjointement un projet de réformes dans l'Empire ottoman, rejeta les propositions qui lui étaient faites par le gouvernement anglais visant à destituer le sultan Abdul Hamid, à conserver l'Égypte pour l'Angleterre et à recevoir en retour des concessions. sur la question des détroits.
Arrivé à Paris début octobre de la même année, Nicolas approuva des instructions conjointes aux ambassadeurs de Russie et de France à Constantinople (que le gouvernement russe avait catégoriquement refusé jusque-là), approuva les propositions françaises sur la question égyptienne (qui comprenaient des « garanties de neutralisation du canal de Suez » - un objectif précédemment défini pour la diplomatie russe par le ministre des Affaires étrangères Lobanov-Rostovsky, décédé le 30 août (11 septembre 1896).
Les accords de Paris du tsar, accompagné lors du voyage par N.P. Shishkin, ont suscité de vives objections de la part de Sergei Witte, Lamzdorf, l'ambassadeur Nelidov et d'autres. Cependant, à la fin de la même année, la diplomatie russe revient à son cours antérieur : renforcement de l'alliance avec la France, coopération pragmatique avec l'Allemagne sur certaines questions, gel de la question orientale (c'est-à-dire soutien au sultan et opposition aux projets de l'Angleterre en Égypte). ).
Il fut finalement décidé d'abandonner le projet de débarquement des troupes russes sur le Bosphore (selon un certain scénario), approuvé lors d'une réunion des ministres du 5 (17) décembre 1896, présidée par le tsar. En mars 1897, les troupes russes participèrent à l’opération internationale de maintien de la paix en Crète après la guerre gréco-turque.
En 1897, trois chefs d'État arrivent à Saint-Pétersbourg pour rendre visite à l'empereur russe : François-Joseph, Guillaume II et le président français Félix Faure. Lors de la visite de François-Joseph, un accord de 10 ans a été conclu entre la Russie et l'Autriche.
Le Manifeste du 3 (15) février 1899 sur l'ordre législatif au Grand-Duché de Finlande fut perçu par la population du Grand-Duché comme une atteinte à ses droits à l'autonomie et provoqua un mécontentement et des protestations de masse.
Le manifeste du 28 juin (10 juillet) 1899 (publié le 30 juin) annonçait la mort du même 28 juin « héritier du tsarévitch et grand-duc Georges Alexandrovitch » (le serment à ce dernier, en tant qu'héritier du trône, a été précédemment prêté avec le serment à Nicolas) et lisez plus loin : « Désormais, jusqu'à ce que le Seigneur veuille nous bénir par la naissance d'un fils, le droit immédiat de succession au trône de toute la Russie, sur la base exacte de la principale loi de l'État sur la succession au trône appartient à notre cher frère, le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch.
L'absence dans le manifeste des mots « héritier du prince héritier » dans le titre de Mikhaïl Alexandrovitch a suscité la perplexité dans les milieux judiciaires, ce qui a incité l'empereur à publier le 7 juillet de la même année un décret impérial personnel, ordonnant à ce dernier de être appelé « héritier souverain et grand-duc ».
Selon les données du premier recensement général réalisé en janvier 1897, la population de l'Empire russe était de 125 millions d'habitants. Parmi eux, 84 millions avaient le russe comme langue maternelle, 21 % de la population russe était alphabétisée et 34 % parmi les personnes âgées de 10 à 19 ans.

En janvier de la même année, il a été réalisé réforme monétaire, qui a établi l'étalon-or du rouble. Transition vers le rouble-or, entre autres choses, il y a eu une dévaluation de la monnaie nationale : sur les impériaux du poids et du titre antérieurs, il était désormais écrit « 15 roubles » - au lieu de 10 ; Cependant, contrairement aux prévisions, la stabilisation du rouble au taux des « deux tiers » a été réussie et sans chocs.
Une grande attention a été accordée à la question du travail. Le 2 (14) juin 1897, une loi a été promulguée sur la limitation de la durée du travail, qui a fixé une limite maximale de journée de travail ne dépassant pas 11,5 heures les jours ordinaires et 10 heures le samedi et les jours fériés, ou si au moins une partie de la journée de travail tombait sur la nuit.
Dans les usines de plus de 100 travailleurs, des soins médicaux gratuits ont été introduits, couvrant 70 pour cent nombre total ouvriers d'usine (1898). En juin 1903, le Règlement sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail fut approuvé en dernier ressort, obligeant l'entrepreneur à verser des prestations et des pensions à la victime ou à sa famille à hauteur de 50 à 66 % de l'entretien de la victime.
En 1906, des syndicats ouvriers sont créés dans le pays. La loi du 23 juin (6 juillet) 1912 en Russie a introduit l'assurance obligatoire des travailleurs contre les maladies et les accidents.
Un impôt spécial sur les propriétaires fonciers d'origine polonaise de la région occidentale, introduit en guise de punition pour l'insurrection polonaise de 1863, a été aboli. Par décret du 12 (25) juin 1900, l'exil en Sibérie à titre punitif fut aboli.
Le règne de Nicolas II fut une période de croissance économique : en 1885-1913, le taux de croissance de la production agricole était en moyenne de 2 %, et le taux de croissance production industrielle 4,5 à 5 % par an. La production de charbon dans le Donbass est passée de 4,8 millions de tonnes en 1894 à 24 millions de tonnes en 1913. L'extraction du charbon a commencé dans le bassin houiller de Kuznetsk. La production pétrolière s'est développée à proximité de Bakou, Grozny et Emba.
La construction de chemins de fer s'est poursuivie, dont la longueur totale, qui s'élevait à 44 000 kilomètres en 1898, dépassait en 1913 70 000 kilomètres. En termes de longueur totale des chemins de fer, la Russie dépassait tous les autres pays européens et était juste derrière les États-Unis, mais en termes de fourniture de chemins de fer par habitant, elle était inférieure à la fois aux États-Unis et aux plus grands pays européens.
Guerre russo-japonaise 1904-1905
Dès 1895, l'empereur prévoyait la possibilité d'un affrontement avec le Japon pour la domination du pays. Extrême Orient, et donc préparé à ce combat – tant diplomatiquement que militairement. De la résolution du tsar du 2 (14) avril 1895 au rapport du ministre des Affaires étrangères, son désir d'une nouvelle expansion russe dans le Sud-Est (Corée) était clair.
Le 22 mai (3 juin 1896), un accord russo-chinois sur une alliance militaire contre le Japon fut conclu à Moscou ; La Chine a accepté la construction d'un chemin de fer traversant la Mandchourie du Nord jusqu'à Vladivostok, dont la construction et l'exploitation ont été confiées à la Banque russo-chinoise.
Le 8 (20) septembre 1896, un accord de concession pour la construction du chemin de fer chinois oriental (CER) a été signé entre le gouvernement chinois et la banque russo-chinoise.
Le 15 (27) mars 1898, la Russie et la Chine ont signé à Pékin la Convention russo-chinoise de 1898, selon laquelle la Russie a obtenu un bail d'utilisation pour 25 ans des ports de Port Arthur (Lushun) et de Dalniy (Dalian) avec les ports adjacents. territoires et eaux; En outre, le gouvernement chinois a accepté d'étendre la concession qu'il a accordée à la CER Society pour la construction d'une ligne de chemin de fer (South Mandchurian Railway) depuis l'un des points de la CER jusqu'à Dalniy et Port Arthur.
Le 12 (24) août 1898, sur ordre de Nicolas II, le ministre des Affaires étrangères, le comte M. N. Muravyov, remit un message gouvernemental (note circulaire) à tous les représentants des puissances étrangères séjournant à Saint-Pétersbourg, qui disait : entre autres: « Mettre une limite aux armements continus et trouver les moyens d'éviter des malheurs qui menacent le monde entier, tel est désormais le devoir le plus élevé de tous les États. Rempli de ce sentiment, l'Empereur a daigné m'ordonner de contacter les gouvernements des États dont les représentants sont accrédités à la Cour suprême, avec une proposition de convoquer une conférence pour discuter de cette tâche importante..
Les conférences de paix de La Haye ont eu lieu en 1899 et 1907, dont certaines décisions sont encore en vigueur aujourd'hui (notamment la Cour permanente d'arbitrage a été créée à La Haye). Pour l'initiative de convoquer la Conférence de paix de La Haye et leur contribution à sa tenue, Nicolas II et le célèbre diplomate russe Fiodor Fedorovich Martens ont été nominés en 1901 pour le prix Nobel de la paix. Le Secrétariat de l'ONU conserve encore aujourd'hui un buste de Nicolas II et son discours aux puissances mondiales à l'occasion de la convocation de la première Conférence de La Haye.
En 1900, Nicolas II envoya des troupes russes pour réprimer le soulèvement de Yihetuan avec les troupes d'autres puissances européennes, du Japon et des États-Unis.
La location par la Russie de la péninsule du Liaodong, la construction du chemin de fer chinois oriental et l'établissement d'une base navale à Port Arthur, ainsi que l'influence croissante de la Russie en Mandchourie se heurtèrent aux aspirations du Japon, qui revendiquait également la Mandchourie.
24 janvier (6 février) 1904 ambassadeur du Japon a remis une note au ministre russe des Affaires étrangères V.N. Lamzdorf, annonçant la fin des négociations, que le Japon considérait comme « inutiles », et la rupture des relations diplomatiques avec la Russie. Le Japon a rappelé sa mission diplomatique de Saint-Pétersbourg et s'est réservé le droit de recourir à des « actions indépendantes » s'il le jugeait nécessaire pour protéger ses intérêts. Dans la soirée du 26 janvier (8 février 1904), la flotte japonaise attaque l'escadre de Port Arthur sans déclarer la guerre. Le plus haut manifeste, donné par Nicolas II le 27 janvier (9 février 1904), déclarait la guerre au Japon.
La bataille frontalière sur la rivière Yalu a été suivie par des batailles à Liaoyang, sur la rivière Shahe et à Sandepu. Après une bataille majeure en février-mars 1905, l'armée russe abandonna Moukden.
Après la chute de la forteresse de Port Arthur, peu de gens croyaient à une issue favorable de la campagne militaire. L'enthousiasme patriotique a cédé la place à l'irritation et au découragement. Cette situation a contribué au renforcement de l’agitation antigouvernementale et du sentiment critique. L'empereur n'a pas accepté pendant longtemps d'admettre l'échec de la campagne, estimant qu'il ne s'agissait que de revers temporaires. Il voulait sans aucun doute la paix, seulement une paix honorable, qu’une position militaire forte pouvait assurer.
À la fin du printemps 1905, il devint évident que la possibilité d’un changement de la situation militaire n’existait que dans un avenir lointain.
L'issue de la guerre s'est décidée par la mer bataille de Tsushima 14-15 (28) mai 1905, qui se solda par la destruction presque complète de la flotte russe.
Le 23 mai (5 juin 1905), l'empereur reçut, par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain à Saint-Pétersbourg Meyer, une proposition du président T. Roosevelt concernant une médiation pour conclure la paix. La réponse ne tarda pas à arriver. Le 30 mai (12 juin 1905), le ministre des Affaires étrangères V.N. Lamzdorf informa Washington dans un télégramme officiel de l'acceptation de la médiation de T. Roosevelt.
La délégation russe était dirigée par le représentant autorisé du tsar, S. Yu. Witte, et aux États-Unis, il était rejoint par l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, le baron R. R. Rosen. La situation difficile du gouvernement russe après la guerre russo-japonaise poussa la diplomatie allemande à faire une nouvelle tentative en juillet 1905 pour arracher la Russie à la France et conclure une alliance russo-allemande : Guillaume II invita Nicolas II à se rencontrer en juillet 1905 en Finlande. skerries, près de l'île de Bjorke. Nikolai a accepté et lors de la réunion a signé l'accord, de retour à Saint-Pétersbourg, il l'a abandonné, puisque le 23 août (5 septembre 1905), un traité de paix a été signé à Portsmouth par les représentants russes S. Yu. Witte et R. R. Rosen. . Aux termes de ce dernier, la Russie a reconnu la Corée comme sphère d'influence du Japon, a cédé au Japon le sud de Sakhaline et les droits sur la péninsule de Liaodong avec les villes de Port Arthur et Dalniy.
Le chercheur américain de l'époque T. Dennett déclarait en 1925 : «Peu de gens croient désormais que le Japon a été privé des fruits de ses prochaines victoires. L’opinion contraire prévaut. Beaucoup pensent que le Japon était déjà épuisé à la fin du mois de mai et que seule la conclusion de la paix l’a sauvé de l’effondrement ou d’une défaite totale lors d’un affrontement avec la Russie. ». Le Japon a dépensé environ 2 milliards de yens pour la guerre et sa dette nationale est passée de 600 millions de yens à 2,4 milliards de yens. Le gouvernement japonais devait payer 110 millions de yens par an uniquement en intérêts. Les quatre prêts étrangers reçus pour la guerre faisaient peser une lourde charge sur le budget japonais. Au milieu de l’année, le Japon a été contraint de contracter un nouvel emprunt. Réalisant que la poursuite de la guerre en raison du manque de financement devenait impossible, le gouvernement japonais, sous couvert de « l'opinion personnelle » du ministre de la Guerre Terauchi, par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain, en mars 1905, porta à l'attention de T. Roosevelt le désir de mettre fin à la guerre. Le plan était de s’appuyer sur la médiation américaine, ce qui s’est finalement produit.
La défaite de la guerre russo-japonaise (la première depuis un demi-siècle) et la répression ultérieure des troubles de 1905-1907, aggravées par la suite par l'émergence de rumeurs d'influence, ont conduit à un déclin de l'autorité de l'empereur au pouvoir. et les milieux intellectuels.
Dimanche sanglant et première révolution russe de 1905-1907.
Avec le début de la guerre russo-japonaise, Nicolas II fait quelques concessions aux cercles libéraux : après l'assassinat du ministre de l'Intérieur V.K. Plehve par un militant socialiste-révolutionnaire, il nomme P.D. Sviatopolk-Mirsky, considéré comme libéral, au poste de son poste.
Le 12 (25) décembre 1904, le décret le plus élevé fut rendu au Sénat « Sur les plans visant à améliorer l'ordre de l'État », qui promettait l'expansion des droits des zemstvos, l'assurance des travailleurs, l'émancipation des étrangers et des personnes d'autres confessions, et l'élimination de la censure. En discutant du texte du décret du 12 (25) décembre 1904, il déclara cependant en privé au comte Witte (d'après les mémoires de ce dernier) : « Je n'accepterai jamais, en aucun cas, une forme de gouvernement représentatif, car Je considère que cela est nuisible à la personne qui m'est confiée. " Dieu du peuple. "
6 (19) janvier 1905 (fête de l'Epiphanie), lors de la bénédiction de l'eau sur le Jourdain (sur la glace de la Neva), devant le Palais d'Hiver, en présence de l'empereur et des membres de sa famille , au tout début du chant du tropaire, un coup de feu a été entendu d'un pistolet, qui accidentellement (selon la version officielle) il y avait une charge de chevrotine laissée après les exercices du 4 janvier. La plupart des balles ont touché la glace à côté du pavillon royal et de la façade du palais, dont les vitres ont été brisées à 4 fenêtres. A propos de l'incident, le rédacteur en chef de la publication synodale a écrit qu'« on ne peut s'empêcher de voir quelque chose de spécial » dans le fait qu'un seul policier nommé « Romanov » a été mortellement blessé et le mât de la bannière de « la crèche de nos malades » "Flotte destinée" - la bannière du corps naval - a été transpercée.
Le 9 (22) janvier 1905, à Saint-Pétersbourg, à l'initiative du prêtre Georgy Gapon, une procession d'ouvriers eut lieu jusqu'au Palais d'Hiver. Du 6 au 8 janvier, le curé Gapone et un groupe d'ouvriers rédigèrent une pétition sur les besoins des travailleurs adressée à l'empereur, qui, outre des revendications économiques, contenait un certain nombre de revendications politiques.
La principale revendication de la pétition était l'élimination du pouvoir des fonctionnaires et l'introduction d'une représentation populaire sous la forme d'une Assemblée constituante. Lorsque le gouvernement a pris conscience du contenu politique de la pétition, il a été décidé de ne pas permettre aux travailleurs de s'approcher du Palais d'Hiver et, si nécessaire, de les arrêter de force. Dans la soirée du 8 janvier, le ministre de l'Intérieur P. D. Svyatopolk-Mirsky a informé l'empereur des mesures prises. Contrairement à la croyance populaire, Nicolas II n'a pas donné l'ordre de tirer, mais a seulement approuvé les mesures proposées par le chef du gouvernement.
Le 9 (22) janvier 1905, des colonnes d'ouvriers dirigées par le curé Gapon se déplaçaient avec différentes fins ville au Palais d'Hiver. Électrifiés par une propagande fanatique, les ouvriers se sont obstinément dirigés vers le centre-ville, malgré les avertissements et même les attaques de cavalerie. Pour empêcher une foule de 150 000 personnes de se rassembler dans le centre-ville, les troupes ont été contraintes de tirer des salves de fusil sur les colonnes.
Selon les données officielles du gouvernement, le 9 (22) janvier 1905, 130 personnes ont été tuées et 299 blessées. Selon les calculs de l'historien soviétique V.I. Nevsky, il y a eu jusqu'à 200 morts et jusqu'à 800 blessés. Le soir du 9 (22) janvier 1905, Nicolas II écrit dans son journal : "Dure journée! De graves émeutes éclatèrent à Saint-Pétersbourg à la suite du désir des ouvriers d’atteindre le Palais d’Hiver. Les troupes ont dû tirer à différents endroits de la ville, il y a eu de nombreux morts et blessés. Seigneur, comme c'est douloureux et difficile !.
Les événements du 9 (22) janvier 1905 sont devenus un tournant dans l'histoire de la Russie et ont marqué le début de la première révolution russe. L'opposition libérale et révolutionnaire a imputé toute la responsabilité des événements à l'empereur Nicolas.
Le curé Gapon, qui fuyait les persécutions policières, rédigea dans la soirée du 9 (22) janvier 1905 un appel dans lequel il appelait les ouvriers au soulèvement armé et au renversement de la dynastie.
Le 4 (17) février 1905, au Kremlin de Moscou, le grand-duc Sergueï Alexandrovitch, qui professait des opinions politiques d'extrême droite et avait une certaine influence sur son neveu, fut tué par une bombe terroriste.
Le 17 (30) avril 1905, un décret « Sur le renforcement des principes de tolérance religieuse » est publié, qui abolit un certain nombre de restrictions religieuses, notamment à l'égard des « schismatiques » (vieux croyants).
Les grèves se sont poursuivies dans le pays, des troubles ont commencé à la périphérie de l'empire : en Courlande, les frères de la forêt ont commencé à massacrer les propriétaires fonciers allemands locaux et le massacre arméno-tatar a commencé dans le Caucase.
Les révolutionnaires et les séparatistes ont reçu un soutien en argent et en armes de l'Angleterre et du Japon. Ainsi, à l'été 1905, le paquebot anglais John Grafton, échoué, fut arrêté dans la mer Baltique, transportant plusieurs milliers de fusils destinés aux séparatistes et militants révolutionnaires finlandais. Il y a eu plusieurs soulèvements dans la marine et dans diverses villes. Le soulèvement le plus important a été celui de décembre à Moscou. Dans le même temps, la terreur individuelle socialiste-révolutionnaire et anarchiste a pris une grande ampleur. En seulement quelques années, les révolutionnaires ont tué des milliers de fonctionnaires, d'officiers et de policiers - rien qu'en 1906, 768 ont été tués et 820 représentants et agents du gouvernement ont été blessés.

La seconde moitié de 1905 est marquée par de nombreux troubles dans les universités et les séminaires théologiques : en raison des troubles, près de 50 séminaires théologiques secondaires sont fermés. les établissements d'enseignement. L'adoption d'une loi provisoire sur l'autonomie universitaire le 27 août (9 septembre 1905) provoque une grève générale des étudiants et soulève l'agitation des professeurs des universités et des académies de théologie. Les partis d’opposition ont profité de l’élargissement des libertés pour intensifier les attaques contre l’autocratie dans la presse.
Le 6 (19) août 1905, un manifeste a été signé sur la création de la Douma d'État (« en tant qu'institution consultative législative, chargée de l'élaboration préliminaire et de la discussion des propositions législatives et de l'examen de la liste des recettes et dépenses de l'État » - la Douma de Bulygin) et la loi sur la Douma d'État et le règlement sur les élections à la Douma.
Mais la révolution, qui gagnait en force, dépassa les actes du 6 août : en octobre, une grève politique panrusse commença, plus de 2 millions de personnes se mirent en grève. Le soir du 17 (30) octobre 1905, Nicolas, après des hésitations psychologiquement difficiles, décide de signer un manifeste qui ordonnait, entre autres : "1. Accorder à la population les fondements inébranlables de la liberté civile sur la base de l'inviolabilité réelle de la personne, de la liberté de conscience, d'expression, de réunion et de syndicats... 3. Établir comme règle inébranlable qu'aucune loi ne peut entrer en vigueur sans l'approbation de la Douma d'État et que les élus du peuple aient la possibilité de participer véritablement au contrôle de la régularité des actions des autorités qui nous sont assignées".
Le 23 avril (6 mai) 1906, les lois fondamentales de l'État de l'Empire russe furent approuvées, prévoyant un nouveau rôle pour la Douma dans le processus législatif. Du point de vue du public libéral, le manifeste marquait la fin de l’autocratie russe en tant que pouvoir illimité du monarque.
Trois semaines après le manifeste, les prisonniers politiques ont été amnistiés, à l'exception de ceux reconnus coupables de terrorisme ; Le décret du 24 novembre (7 décembre 1905) abolit la censure préliminaire générale et spirituelle des publications temporelles (périodiques) publiées dans les villes de l'empire (le 26 avril (9 mai 1906, toute censure fut abolie).
Après la publication des manifestes, les grèves se sont calmées. Forces armées(à l'exception de la flotte, où des troubles ont eu lieu) sont restés fidèles au serment. Une organisation publique monarchiste d'extrême droite, l'Union du peuple russe, est née et a été secrètement soutenue par Nicolas.
De la première révolution russe à la Première Guerre mondiale
Le 18 (31) août 1907, un accord est signé avec la Grande-Bretagne pour délimiter les sphères d'influence en Chine, en Afghanistan et en Perse, qui complète généralement le processus de formation d'une alliance de 3 puissances - la Triple Entente, connue sous le nom de Entente (Triple-Entente). Cependant, les obligations militaires mutuelles n'existaient à cette époque qu'entre la Russie et la France - conformément à l'accord de 1891 et à la convention militaire de 1892.
Les 27 et 28 mai (10 juin 1908), une rencontre entre le roi britannique Édouard VII et le tsar eut lieu - sur la rade du port de Revel, le tsar accepta du roi l'uniforme de l'amiral de la flotte britannique. . La réunion des monarques de Revel a été interprétée à Berlin comme une étape vers la formation d'une coalition anti-allemande - malgré le fait que Nicolas était un farouche opposant au rapprochement avec l'Angleterre contre l'Allemagne.
L'accord conclu entre la Russie et l'Allemagne le 6 (19) août 1911 (Accord de Potsdam) n'a pas modifié le vecteur général de l'implication de la Russie et de l'Allemagne dans des alliances militaro-politiques opposées.
Le 17 (30) juin 1910, la loi sur la procédure d'adoption des lois relatives à la Principauté de Finlande, dite loi sur la procédure de la législation impériale générale, fut approuvée par le Conseil d'État et la Douma d'État.
Le contingent russe, stationné en Perse depuis 1909 en raison de l'instabilité politique, fut renforcé en 1911.
En 1912, la Mongolie est devenue de facto un protectorat de la Russie, obtenant son indépendance de la Chine à la suite de la révolution qui s'y est déroulée. Après cette révolution de 1912-1913, les noyons Touvans (ambyn-noyon Kombu-Dorzhu, Chamzy Khamby Lama, noyon Daa-ho.shuna Buyan-Badyrgy et autres) ont fait appel à plusieurs reprises au gouvernement tsariste en lui demandant d'accepter Touva sous le protectorat. de l'Empire russe. Le 4 (17) avril 1914, une résolution sur le rapport du ministre des Affaires étrangères établit un protectorat russe sur la région d'Uriankhai : la région fut incluse dans la province d'Ienisseï avec le transfert des affaires politiques et diplomatiques de Touva à la région d'Irkoutsk. Gouverneur général.
Le début des opérations militaires de l'Union balkanique contre la Turquie à l'automne 1912 marqua l'effondrement des efforts diplomatiques entrepris après la crise bosniaque par le ministre des Affaires étrangères S. D. Sazonov en vue d'une alliance avec la Porte et en même temps du maintien de la frontière balkanique. États sous son contrôle : contrairement aux attentes du gouvernement russe, les troupes de ce dernier réussirent à repousser les Turcs et en novembre 1912 l'armée bulgare se trouvait à 45 km de la capitale ottomane de Constantinople.
Dans le cadre de la guerre des Balkans, le comportement de l'Autriche-Hongrie est devenu de plus en plus provocant envers la Russie et, à cet égard, en novembre 1912, lors d'une réunion avec l'empereur, la question de la mobilisation des troupes de trois districts militaires russes a été examinée. Le ministre de la Guerre V. Sukhomlinov a préconisé cette mesure, mais le Premier ministre V. Kokovtsov a réussi à convaincre l'empereur de ne pas prendre une telle décision, qui menaçait d'entraîner la Russie dans la guerre.
Après le passage effectif de l'armée turque sous commandement allemand (le général allemand Liman von Sanders prit fin 1913 le poste d'inspecteur en chef de l'armée turque), la question de l'inévitabilité d'une guerre avec l'Allemagne fut soulevée dans la note de Sazonov à l'empereur datée du 23 décembre 1913 (5 janvier 1914), la note de Sazonov fut également discutée lors de la réunion du Conseil des ministres.
En 1913, une grande célébration du 300e anniversaire de la dynastie des Romanov eut lieu : la famille impériale se rendit à Moscou, de là à Vladimir, Nijni Novgorod, puis le long de la Volga jusqu'à Kostroma, où le premier tsar fut appelé au trône en le monastère d'Ipatiev le 14 (24) mars 1613 des Romanov - Mikhaïl Fedorovitch. En janvier 1914, la consécration solennelle de la cathédrale Fedorov, érigée pour commémorer l'anniversaire de la dynastie, eut lieu à Saint-Pétersbourg.

Les deux premières Doumas d'État étaient incapables de mener un travail législatif régulier : les contradictions entre les députés, d'une part, et l'empereur, de l'autre, étaient insurmontables. Ainsi, immédiatement après l’ouverture, en réponse au discours du trône de Nicolas II, les membres de gauche de la Douma ont exigé la liquidation du Conseil d’État (la chambre haute du Parlement) et le transfert des terres monastiques et domaniales aux paysans. Le 19 mai (1er juin 1906), 104 députés du Groupe travailliste présentent un projet de réforme agraire (projet 104), dont le contenu est la confiscation des terres des propriétaires fonciers et la nationalisation de toutes les terres.
La Douma de la première convocation fut dissoute par l'empereur par un décret personnel au Sénat du 8 (21 juillet) 1906 (publié le dimanche 9 juillet), qui fixa l'heure de convocation de la Douma nouvellement élue au 20 février (mars 5), 1907. Le manifeste le plus élevé du 9 juillet en expliquait les raisons, parmi lesquelles : « Les élus de la population, au lieu de travailler à l'élaboration d'une législation, ont dévié vers un domaine qui ne leur appartenait pas et se sont tournés vers l'enquête sur les actions qui nous étaient assignées. autorités locales, à Nous signaler les imperfections des Lois fondamentales, dont les modifications ne peuvent être entreprises que par notre volonté royale, et à des actions manifestement illégales, comme un appel de la Douma à la population.» Par décret du 10 juillet de la même année, les séances du Conseil d'Etat sont suspendues.
Simultanément à la dissolution de la Douma, I. L. Goremykin a été nommé au poste de président du Conseil des ministres. La politique agricole de Stolypine, la répression réussie des troubles et les discours brillants à la Deuxième Douma ont fait de lui l'idole de certains hommes de droite.
La deuxième Douma s'est avérée encore plus à gauche que la première, puisque les sociaux-démocrates et les socialistes-révolutionnaires, qui ont boycotté la première Douma, ont participé aux élections. Le gouvernement mûrissait l'idée de dissoudre la Douma et de modifier la loi électorale.
Stolypine n'avait pas l'intention de détruire la Douma, mais de changer la composition de la Douma. La raison de la dissolution était l'action des sociaux-démocrates : le 5 mai, dans l'appartement d'un membre de la Douma du RSDLP Ozol, la police a découvert une réunion de 35 sociaux-démocrates et d'une trentaine de soldats de la garnison de Saint-Pétersbourg. En outre, la police a découvert divers documents de propagande appelant au renversement violent du système étatique, divers ordres émanant de soldats d'unités militaires et de faux passeports.
Le 1er juin, Stolypine et le président de la Chambre judiciaire de Saint-Pétersbourg ont exigé que la Douma exclue toute la faction social-démocrate des réunions de la Douma et lève l'immunité de 16 membres du RSDLP. La Douma a répondu aux demandes du gouvernement par un refus; le résultat de la confrontation fut le manifeste de Nicolas II sur la dissolution de la Deuxième Douma, publié le 3 (16) juin 1907, ainsi que le Règlement sur les élections à la Douma, c'est-à-dire une nouvelle loi électorale. Le manifeste indiquait également la date d'ouverture de la nouvelle Douma - le 1er (14) novembre 1907. L'acte du 3 juin 1907 dans l'historiographie soviétique a été appelé le « coup d'État du troisième juin », car il contredisait le manifeste du 17 octobre 1905, selon lequel aucune nouvelle loi ne pouvait être adoptée sans l'approbation de la Douma d'État.
Depuis 1907, ce qu'on appelle "Stolypine" réforme agraire . L'orientation principale de la réforme était d'attribuer les terres, auparavant propriété collective de la communauté rurale, aux propriétaires paysans. L'État a également fourni une aide importante aux paysans pour l'achat des terres des propriétaires fonciers (grâce à des prêts de la Banque foncière paysanne) et une aide agronomique subventionnée. Lors de la mise en œuvre de la réforme, une grande attention a été accordée à la lutte contre le striping (phénomène dans lequel un paysan cultivait de nombreuses petites bandes de terre dans différents champs) et à l'attribution de parcelles aux paysans « en un seul endroit » (coupes, fermes). a été encouragée, ce qui a conduit à une augmentation significative de l’efficacité de l’économie.
La réforme, qui a nécessité un énorme travail de gestion foncière, s'est déroulée assez lentement. Avant Révolution de février Pas plus de 20 % des terres communales étaient attribuées à la propriété paysanne. Les résultats de la réforme, visiblement perceptibles et positifs, n’ont pas eu le temps de se manifester pleinement.
En 1913, la Russie (à l'exclusion des provinces de Vistlensky) occupait la première place mondiale pour la production de seigle, d'orge et d'avoine, la troisième (après le Canada et les États-Unis) pour la production de blé, la quatrième (après la France, l'Allemagne et l'Autriche). Hongrie) dans la production de pommes de terre. La Russie est devenue le principal exportateur de produits agricoles, représentant les 2/5 de toutes les exportations agricoles mondiales. Le rendement en céréales était 3 fois inférieur à celui de l'Angleterre ou de l'Allemagne, celui des pommes de terre était 2 fois inférieur.
Les réformes militaires de 1905-1912 ont été menées après la défaite de la Russie lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui a révélé de graves lacunes dans l'administration centrale, l'organisation, le système de recrutement, l'entraînement au combat et l'équipement technique de l'armée.
Dans la première période des réformes militaires (1905-1908), la plus haute administration militaire est décentralisée (la direction principale de l'état-major général, indépendante du ministère de la Guerre, est créée, le Conseil de la défense de l'État est créé, les inspecteurs généraux sont directement subordonnés à l'empereur), les durées de service actif furent réduites (dans l'infanterie et l'artillerie de campagne de 5 à 3 ans, dans les autres branches de l'armée de 5 à 4 ans, dans la marine de 7 à 5 ans), le corps des officiers fut rajeunie, la vie des soldats et des marins s'améliore (indemnités alimentaires et vestimentaires) ainsi que la situation financière des officiers et des militaires de longue durée.
Dans la deuxième période (1909-1912), la centralisation de la haute direction s'effectue (la direction principale de l'état-major général est incluse dans le ministère de la Guerre, le Conseil de la Défense de l'État est supprimé, les inspecteurs généraux sont subordonnés au ministre de la Guerre). Guerre). En raison de la faiblesse militaire des troupes de réserve et de forteresse, les troupes de campagne ont été renforcées (le nombre de corps d'armée est passé de 31 à 37), une réserve a été créée dans les unités de campagne, qui, lors de la mobilisation, a été affectée au déploiement d'unités secondaires (y compris artillerie de campagne, troupes du génie et des chemins de fer, unités de communication), des équipes de mitrailleuses ont été créées dans les régiments et les détachements aériens du corps, les écoles de cadets ont été transformées en écoles militaires qui ont reçu de nouveaux programmes, de nouveaux règlements et instructions ont été introduits.
En 1910, l’Imperial Air Force est créée.
Nicolas II. Un triomphe contrarié
Première Guerre mondiale
Nicolas II s'est efforcé d'empêcher la guerre au cours de toutes les années précédant la guerre et dans les derniers jours avant son déclenchement, lorsque (15 (28 juillet 1914) l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie et a commencé à bombarder Belgrade. Le 16 (29) juillet 1914, Nicolas II envoya un télégramme à Guillaume II avec une proposition de « transférer la question austro-serbe à la Conférence de La Haye » (à la Cour internationale d'arbitrage de La Haye). Guillaume II ne répondit pas à ce télégramme.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, les partis d’opposition des pays de l’Entente et de Russie (y compris les sociaux-démocrates) considéraient l’Allemagne comme l’agresseur. à l'automne 1914, il écrivait que c'était l'Allemagne qui avait déclenché la guerre à un moment qui lui convenait.
Le 20 juillet (2 août 1914), l'empereur donna et publia le soir du même jour un manifeste sur la guerre, ainsi qu'un décret personnel le plus élevé, dans lequel il « ne reconnaissait pas cela possible, pour des raisons de nature nationale, pour devenir désormais le chef de nos forces terrestres et maritimes destinées aux opérations militaires », a ordonné au Grand-Duc Nikolaï Nikolaïevitch d'être commandant en chef suprême.
Par décrets du 24 juillet (6 août 1914), les sessions du Conseil d'État et de la Douma furent interrompues à partir du 26 juillet.
Le 26 juillet (8 août 1914), un manifeste sur la guerre avec l'Autriche fut publié. Le même jour, la plus haute réception des membres du Conseil d'État et de la Douma a eu lieu : l'empereur est arrivé au Palais d'Hiver sur un yacht avec Nikolaï Nikolaïevitch et, entrant dans la salle Nicolas, s'est adressé aux personnes rassemblées avec les mots suivants : « L’Allemagne puis l’Autriche ont déclaré la guerre à la Russie. Cette immense poussée de sentiments patriotiques d'amour pour la Patrie et de dévotion au trône, qui a balayé comme un ouragan tout notre pays, sert à mes yeux et, je pense, aux vôtres, de garantie que notre grande Mère Russie amènera le guerre envoyée par le Seigneur Dieu à la fin souhaitée. ...Je suis convaincu que chacun d'entre vous, à votre place, m'aidera à supporter l'épreuve qui m'a été envoyée et que chacun, à commencer par moi, remplira son devoir jusqu'au bout. Grand est le Dieu de la terre russe !. À la fin de son discours de réponse, le président de la Douma, le chambellan M.V. Rodzianko, a déclaré : « Sans divergences d'opinions, de points de vue et de convictions, la Douma d'État, au nom de la Terre russe, dit calmement et fermement à son tsar : « Soyez courageux, Souverain, le peuple russe est avec vous et, confiant fermement dans la miséricorde de Dieu , ne s'arrêtera à aucun sacrifice jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. " et la dignité de la Patrie ne sera pas protégée ".
Pendant la période du commandement de Nikolaï Nikolaïevitch, le tsar s'est rendu à plusieurs reprises au quartier général pour des réunions avec le commandement (21 au 23 septembre, 22 au 24 octobre, 18 au 20 novembre). En novembre 1914, il se rendit également dans le sud de la Russie et sur le front du Caucase.

Début juin 1915, la situation sur les fronts se détériore fortement : Przemysl, ville forteresse capturée avec d'énormes pertes en mars, est capitulée. Fin juin, Lvov est abandonnée. Toutes les acquisitions militaires furent perdues et l’Empire russe commença à perdre son propre territoire. En juillet, Varsovie, toute la Pologne et une partie de la Lituanie furent capitulées ; l'ennemi continue d'avancer. L'opinion publique a commencé à parler de l'incapacité du gouvernement à faire face à la situation.
Tant au sein des organisations publiques, de la Douma d'État, que d'autres groupes, et même de nombreux grands-ducs, ils ont commencé à parler de la création d'un « ministère de la Confiance publique ».
Au début de 1915, les troupes du front commençaient à éprouver un grand besoin d’armes et de munitions. La nécessité d’une restructuration complète de l’économie conformément aux exigences de la guerre est devenue évidente. Le 17 (30) août 1915, Nicolas II approuva les documents sur la formation de quatre réunions spéciales : sur la défense, le carburant, la nourriture et les transports. Ces réunions, composées de représentants du gouvernement, d'industriels privés, de membres de la Douma d'État et du Conseil d'État et dirigées par les ministres concernés, étaient censées unir les efforts du gouvernement, de l'industrie privée et du public pour mobiliser l'industrie pour les besoins militaires. La plus importante d’entre elles fut la Conférence spéciale sur la défense.
Le 9 (22) mai 1916, l'empereur de Russie Nicolas II, accompagné de sa famille, du général Brusilov et d'autres, a passé en revue les troupes dans la province de Bessarabie, dans la ville de Bendery, et a visité l'infirmerie située dans l'Auditorium de la ville.
Parallèlement à la création de réunions spéciales, des comités militaro-industriels ont commencé à apparaître en 1915 - organismes publics bourgeoisie, qui étaient de nature semi-oppositionnelle.
La surestimation de ses capacités par le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch a finalement conduit à un certain nombre d'erreurs militaires majeures, et les tentatives de détourner de lui-même les accusations correspondantes ont conduit à attiser la germanophobie et la folie des espions. L'un de ces épisodes les plus significatifs a été le cas du lieutenant-colonel Myasoedov, qui s'est terminé par l'exécution d'un homme innocent, où Nikolai Nikolaevich a joué du premier violon avec A.I. Guchkov. Le commandant du front, en raison du désaccord des juges, n'a pas approuvé la sentence, mais le sort de Myasoedov a été décidé par la résolution du commandant en chef suprême, le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch : « Pendez-le quand même ! Cette affaire, dans laquelle le Grand-Duc a joué le premier rôle, a conduit à une augmentation des soupçons clairement orientés à l'égard de la société et a joué, entre autres, un rôle dans le pogrom allemand de mai 1915 à Moscou.
Les échecs sur le front se poursuivent : le 22 juillet, Varsovie et Kovno sont capitulées, les fortifications de Brest explosent, les Allemands s'approchent de la Dvina occidentale et l'évacuation de Riga commence. Dans de telles conditions, Nicolas II a décidé de destituer le grand-duc, qui ne pouvait pas s'en sortir, et de se mettre lui-même à la tête de l'armée russe.
Le 23 août (5 septembre 1915), Nicolas II prend le titre de commandant en chef suprême., remplaçant à ce poste le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch, nommé commandant du Front du Caucase. M.V. Alekseev a été nommé chef d'état-major du commandant en chef suprême.
Les soldats de l'armée russe ont accueilli sans enthousiasme la décision de Nicolas d'accepter le poste de commandant en chef suprême. Dans le même temps, le commandement allemand était satisfait de la démission du prince Nikolai Nikolaevich du poste de commandant en chef suprême - il le considérait comme un adversaire coriace et habile. Un certain nombre de ses idées stratégiques ont été jugées extrêmement audacieuses et brillantes par Erich Ludendorff.
Lors de la percée de Sventsyansky du 9 (22 août 1915) au 19 septembre (2 octobre 1915), les troupes allemandes furent vaincues et leur offensive stoppée. Les parties passent à la guerre de position : les brillantes contre-attaques russes qui s'ensuivent dans la région de Vilno-Molodechno et les événements qui s'ensuivent permettent, après le succès de l'opération de septembre, de préparer une nouvelle étape de la guerre, sans craindre une offensive ennemie. . Les travaux ont commencé dans toute la Russie pour former et entraîner de nouvelles troupes. L'industrie produisait rapidement des munitions et équipement militaire. Cette rapidité de travail est devenue possible grâce à la confiance naissante que l’avancée de l’ennemi avait été stoppée. Au printemps 1917, de nouvelles armées furent créées, dotées d'équipements et de munitions meilleurs que jamais pendant toute la guerre.
La conscription de l'automne 1916 mit 13 millions de personnes sous les armes et les pertes de la guerre dépassèrent les 2 millions.
En 1916, Nicolas II a remplacé quatre présidents du Conseil des ministres (I. L. Goremykin, B. V. Sturmer, A. F. Trepov et le prince N. D. Golitsyn), quatre ministres de l'Intérieur (A. N. Khvostov, B. V. Sturmer, A. A. Khvostov et A. D. Protopopov), trois ministres des Affaires étrangères (S. D. Sazonov, B. V. Sturmer et N. N. Pokrovsky), deux ministres militaires (A. A. Polivanov, D. S. Shuvaev) et trois ministres de la justice (A. A. Khvostov, A. A. Makarov et N. A. Dobrovolsky).
Le 1er (14) janvier 1917, des changements s'étaient également produits au Conseil d'État. Nicolas a expulsé 17 membres et en a nommé de nouveaux.
Le 19 janvier (1er février 1917), une réunion de représentants de haut rang des puissances alliées s'est ouverte à Petrograd, qui est entrée dans l'histoire sous le nom de Conférence de Petrograd : des alliés de la Russie y ont participé des délégués de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie. , qui s'est également rendu à Moscou et sur le front, a eu des réunions avec des hommes politiques de différentes orientations politiques, avec les dirigeants des factions de la Douma. Ce dernier a informé à l'unanimité le chef de la délégation britannique d'une révolution imminente - soit d'en bas, soit d'en haut (sous la forme d'un coup d'État de palais).

Nicolas II, espérant une amélioration de la situation dans le pays si l'offensive du printemps 1917 réussissait, comme convenu lors de la Conférence de Petrograd, n'avait pas l'intention de conclure une paix séparée avec l'ennemi - il voyait la fin victorieuse de la guerre. comme le moyen le plus important de renforcer le trône. Les allusions selon lesquelles la Russie pourrait entamer des négociations pour une paix séparée étaient un jeu diplomatique qui a forcé l’Entente à accepter la nécessité d’établir le contrôle russe sur les détroits.
La guerre, au cours de laquelle il y a eu une large mobilisation de la population masculine en âge de travailler, des chevaux et une réquisition massive de bétail et de produits agricoles, a eu un effet néfaste sur l'économie, en particulier dans les campagnes. Au sein de la société politisée de Petrograd, les autorités ont été discréditées par des scandales (notamment liés à l'influence de G. E. Raspoutine et de ses acolytes - les « forces obscures ») et des soupçons de trahison. L’engagement déclaratif de Nicolas en faveur de l’idée d’un pouvoir « autocratique » est entré en conflit aigu avec les aspirations libérales et de gauche d’une partie importante des membres de la Douma et de la société.
Abdication de Nicolas II
Le général a témoigné de l'état d'esprit qui régnait dans l'armée après la révolution : « Quant à l'attitude envers le trône, en tant que phénomène général, dans le corps des officiers, il y avait une volonté de distinguer la personne du souverain de la saleté de cour qui l'entourait, des erreurs politiques et des crimes du gouvernement tsariste, qui clairement et a progressivement conduit à la destruction du pays et à la défaite de l'armée. Ils ont pardonné au souverain, ils ont essayé de le justifier. Comme nous le verrons plus loin, dès 1917, cette attitude d’une certaine partie des officiers fut ébranlée, provoquant le phénomène que le prince Volkonsky appelait une « révolution à droite », mais pour des raisons purement politiques..
Les forces opposées à Nicolas II préparaient un coup d'État à partir de 1915. Il s'agissait des dirigeants de divers partis politiques représentés à la Douma, des principaux officiers militaires, du sommet de la bourgeoisie et même de certains membres de la famille impériale. On supposait qu'après l'abdication de Nicolas II, son fils mineur Alexei monterait sur le trône et que le frère cadet du tsar, Mikhaïl, deviendrait régent. Pendant la Révolution de Février, ce plan commença à se réaliser.
Depuis décembre 1916, un « coup d'État » sous une forme ou une autre était attendu dans l'environnement judiciaire et politique, l'éventuelle abdication de l'empereur en faveur du tsarévitch Alexei sous la régence du grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch.
Le 23 février (8 mars) 1917, une grève éclate à Petrograd. Au bout de 3 jours, c'est devenu universel. Le matin du 27 février (12 mars 1917), les soldats de la garnison de Petrograd se révoltèrent et rejoignirent les grévistes ; seule la police résista à la rébellion et aux troubles. Un soulèvement similaire a eu lieu à Moscou.
Le 25 février (10 mars) 1917, par décret de Nicolas II, les réunions de la Douma d'État furent interrompues du 26 février (11 mars) jusqu'en avril de la même année, ce qui a encore envenimé la situation. Le président de la Douma d'État, M.V. Rodzianko, a envoyé une série de télégrammes à l'empereur au sujet des événements de Petrograd.
Le quartier général a appris le début de la révolution avec deux jours de retard, selon les rapports du général S.S. Khabalov, du ministre de la Guerre Belyaev et du ministre de l'Intérieur Protopopov. Le premier télégramme annonçant le début de la révolution n'a été reçu par le général Alekseev que le 25 février (10 mars 1917) à 18h08 : « Je rapporte que les 23 et 24 février, en raison du manque de pain, une grève a éclaté dans de nombreuses usines... 200 000 ouvriers... Vers trois heures de l'après-midi, sur la place Znamenskaya, le policier Krylov a été tué en dispersant la foule. La foule est dispersée. Outre la garnison de Petrograd, cinq escadrons du neuvième régiment de cavalerie de réserve de Krasnoe Selo, une centaine de gardes de Leningrad, participent à la répression des troubles. un régiment cosaque combiné de Pavlovsk et cinq escadrons du régiment de cavalerie de réserve des gardes furent appelés à Petrograd. N ° 486. Sec. Khabalov". Le général Alekseev rapporte à Nicolas II le contenu de ce télégramme.
Au même moment, le commandant du palais Voyekov rapporte à Nicolas II un télégramme du ministre de l'Intérieur Protopopov : "Offre. Au commandant du palais. ...Le 23 février, une grève éclate dans la capitale, accompagnée d'émeutes de rue. Le premier jour, environ 90 000 travailleurs se sont mis en grève, le deuxième - jusqu'à 160 000, aujourd'hui - environ 200 000. Les troubles de rue se traduisent par des cortèges de démonstration, certains avec des drapeaux rouges, la destruction de certains magasins, l'arrêt partiel de la circulation des tramways par les grévistes et des affrontements avec la police. ...la police a tiré plusieurs coups de feu en direction de la foule, d'où elle a riposté. ...l'huissier Krylov a été tué. Le mouvement est inorganisé et spontané. ...Moscou est calme. Ministère de l'Intérieur Protopopov. N° 179. 25 février 1917".
Après avoir lu les deux télégrammes, Nicolas II, dans la soirée du 25 février (10 mars 1917), ordonna au général S. S. Khabalov de mettre fin aux troubles. force militaire: «Je vous ordonne d'arrêter demain dans la capitale les émeutes qui sont inacceptables dans les moments difficiles de la guerre avec l'Allemagne et l'Autriche. NICOLAS".
Le 26 février (11 mars 1917), à 17 heures, arrive un télégramme de Rodzianko : « La situation est grave. C'est l'anarchie dans la capitale. …Il y a des tirs aveugles dans les rues. Les unités de troupes se tirent dessus. Il faut immédiatement confier à une personne la confiance nécessaire pour former un nouveau gouvernement.». Nicolas II refuse de répondre à ce télégramme, disant au ministre de la Maison impériale Fredericks que "Encore une fois, ce gros Rodzianko m'a écrit toutes sortes de bêtises auxquelles je ne lui répondrai même pas".
Le prochain télégramme de Rodzianko arrive à 22h22 et présente également un caractère de panique similaire.
Le 27 février (12 mars 1917) à 19h22, un télégramme du ministre de la Guerre Belyaev arrive au quartier général, déclarant le passage presque complet de la garnison de Petrograd au côté de la révolution et exigeant l'envoi de troupes fidèles au tsar. ; à 19h29, il rapporte que le Conseil des ministres a déclaré l'état de siège à Petrograd. Le général Alekseev rapporte le contenu des deux télégrammes à Nicolas II. Le tsar ordonne au général N.I. Ivanov de se rendre à la tête des unités de l'armée loyale à Tsarskoïe Selo pour assurer la sécurité de la famille impériale, puis, en tant que commandant du district militaire de Petrograd, de prendre le commandement des troupes qui devaient être transférées du devant.
De 23 heures à 1 heure du matin, l'Impératrice envoie deux télégrammes depuis Tsarskoïe Selo : « La révolution d'hier a pris des proportions terrifiantes... Des concessions sont nécessaires. ... De nombreuses troupes se sont ralliées au côté de la révolution. Alix".
A 0h55, un télégramme de Khabalov arrive : « Veuillez signaler à Sa Majesté Impériale que je n'ai pas pu exécuter l'ordre de rétablir l'ordre dans la capitale. La plupart des unités, les unes après les autres, ont trahi leur devoir en refusant de lutter contre les rebelles. D'autres unités fraternisent avec les rebelles et retournent leurs armes contre les troupes fidèles à Sa Majesté. Ceux qui sont restés fidèles à leur devoir ont combattu toute la journée contre les rebelles, subissant de lourdes pertes. Dans la soirée, les rebelles s'emparent de la majeure partie de la capitale. De petites unités de divers régiments rassemblées près du Palais d'Hiver sous le commandement du général Zankevich restent fidèles au serment, avec qui je continuerai à me battre. lieutenant général Khabalov".
Le 28 février (13 mars 1917), à 11 heures du matin, le général Ivanov alerta le bataillon des chevaliers de Saint-Georges de 800 personnes et l'envoya de Mogilev à Tsarskoïe Selo via Vitebsk et Dno, se laissant à 13 heures.
Le commandant du bataillon, le prince Pojarski, annonce à ses officiers qu'il ne « tirera pas sur la population de Petrograd, même si l'adjudant général Ivanov l'exige ».
Le maréchal Benkendorf télégraphie de Petrograd au quartier général que le régiment lituanien des sauveteurs a abattu son commandant et que le commandant du bataillon du régiment des sauveteurs Preobrazhensky a été abattu.
Le 28 février (13 mars 1917) à 21 heures, le général Alekseev ordonne au chef d'état-major du front nord, le général Yu. N. Danilov, d'envoyer deux régiments de cavalerie et deux régiments d'infanterie, renforcés par des équipes de mitrailleuses, pour aidez le général Ivanov. Il est prévu d'envoyer à peu près le même deuxième détachement du front sud-ouest du général Brusilov dans le cadre des régiments Preobrazhensky, Third Rifle et Fourth Rifle de la famille impériale. Alekseev propose également, de sa propre initiative, d'ajouter une division de cavalerie à « l'expédition punitive ».
Le 28 février (13 mars 1917), à 5 heures du matin, le tsar partit (à 4 h 28, le train Litera B, à 5 heures du matin, le train Litera A) pour Tsarskoïe Selo, mais ne put voyager.
28 février, 8h25 Le général Khabalov envoie un télégramme au général Alekseev au sujet de sa situation désespérée et, entre 9h00 et 10h00, il s'entretient avec le général Ivanov, déclarant que « À ma disposition, dans le bâtiment principal. Amirauté, quatre compagnies de gardes, cinq escadrons et centaines, deux batteries. D'autres troupes se sont ralliées aux révolutionnaires ou restent, en accord avec eux, neutres. Des soldats et des bandes parcourent la ville, tirant sur les passants, désarmant les officiers... Tous les postes sont au pouvoir des révolutionnaires, strictement gardés par eux... Tous les établissements d'artillerie sont au pouvoir des révolutionnaires..
A 13h30, le télégramme de Belyaev est reçu concernant la capitulation définitive des unités fidèles au tsar à Petrograd. Le roi le reçoit à 15h00.
Dans l'après-midi du 28 février, le général Alekseev tente de prendre le contrôle du ministère des Chemins de fer par l'intermédiaire d'un collègue (sous-ministre), le général Kislyakov, mais il convainc Alekseev de revenir sur sa décision. Le 28 février, le général Alekseev a arrêté toutes les unités prêtes au combat en route vers Petrograd avec un télégramme circulaire. Son télégramme circulaire indiquait faussement que les troubles à Petrograd s'étaient apaisés et qu'il n'était plus nécessaire de réprimer la rébellion. Certaines de ces unités se trouvaient déjà à une heure ou deux de la capitale. Ils ont tous été arrêtés.
L'adjudant général I. Ivanov a déjà reçu l'ordre d'Alekseev à Tsarskoïe Selo.
Le député de la Douma Bublikov occupe le ministère des Chemins de fer, arrête son ministre et interdit la circulation des trains militaires sur 250 milles autour de Petrograd. À 21h27, Likhoslavl a reçu un message concernant les ordres de Bublikov aux cheminots.
Le 28 février à 20 heures, le soulèvement de la garnison de Tsarskoïe Selo a commencé. Les unités qui restent fidèles continuent de garder le palais.
A 3h45, le train approche de Malaya Vishera. Là, ils ont rapporté que le chemin à parcourir avait été capturé par des soldats rebelles et qu'à la gare de Lyuban, il y avait deux compagnies révolutionnaires équipées de mitrailleuses. Par la suite, il s'avère qu'en fait, à la gare de Lyuban, les soldats rebelles ont pillé le buffet, mais n'avaient pas l'intention d'arrêter le tsar.
Le 1er (14) mars 1917, à 4 h 50, le tsar ordonne de retourner à Bologoïe (où ils sont arrivés à 9 heures le 1er mars), et de là à Pskov.
Selon certains témoignages, le 1er mars à 16 heures à Petrograd, le cousin de Nicolas II, le grand-duc Kirill Vladimirovitch, s'est rangé du côté de la révolution, conduisant l'équipage naval de la Garde au palais de Tauride. Par la suite, les monarchistes ont déclaré cette calomnie.
Le 1er (14) mars 1917, le général Ivanov arrive à Tsarskoïe Selo et reçoit des informations selon lesquelles la compagnie des gardes de Tsarskoïe Selo s'est rebellée et est partie pour Petrograd sans autorisation. De plus, des unités rebelles s'approchaient de Tsarskoïe Selo : une division lourde et un bataillon de gardes du régiment de réserve. Le général Ivanov quitte Tsarskoïe Selo pour Vyritsa et décide d'inspecter le régiment Tarutinsky qui lui est transféré. A la gare de Semrino, les cheminots bloquent ses déplacements ultérieurs.
Le 1 (14) mars 1917 à 15h00, le train royal arrive à la gare de Dno, à 19h05 à Pskov, où se trouvait le quartier général des armées du Front Nord du général N.V. Ruzsky. Le général Ruzsky, en raison de ses convictions politiques, considérait la monarchie autocratique du XXe siècle comme un anachronisme et n'aimait pas personnellement Nicolas II. Lorsque le train du tsar arriva, le général refusa d'organiser la cérémonie habituelle de bienvenue au tsar et apparut seul et seulement après quelques minutes.
Le général Alekseev, qui, en l'absence du tsar au quartier général, a assumé les fonctions de commandant en chef suprême, reçoit le 28 février un rapport du général Khabalov selon lequel il ne lui reste plus que 1 100 personnes dans les unités loyales. Ayant appris le début des troubles à Moscou, le 1er mars à 15h58, il télégraphia au tsar que « La révolution, et cette dernière est inévitable, dès que les troubles commencent à l'arrière, marque la fin honteuse de la guerre avec toutes les graves conséquences pour la Russie. L'armée est trop étroitement liée à la vie de l'arrière, et nous pouvons affirmer avec certitude que les troubles à l'arrière provoqueront la même chose dans l'armée. Il est impossible d’exiger de l’armée qu’elle combatte calmement lorsqu’il y a une révolution à l’arrière. La jeune composition actuelle de l'armée et du corps des officiers, parmi lesquels un pourcentage énorme est appelé depuis les réservistes et promus officiers des établissements d'enseignement supérieur, ne donne aucune raison de croire que l'armée ne réagira pas à ce qui se passera dans Russie.".
Après avoir reçu ce télégramme, Nicolas II reçut le général N.V. Ruzsky, qui se prononça en faveur de l'établissement en Russie d'un gouvernement responsable devant la Douma. A 22h20, le général Alekseev envoie à Nicolas II un projet de manifeste sur la création d'un gouvernement responsable. Entre 17h00 et 18h00, les télégrammes sur le soulèvement de Cronstadt arrivent au quartier général.
Le 2 (15) mars 1917, à une heure du matin, Nicolas II télégraphia au général Ivanov « Je vous demande de ne prendre aucune mesure jusqu'à mon arrivée et de me faire rapport », et charge Ruzsky d'informer Alekseev et Rodzianko qu'il accepte de la formation d'un gouvernement responsable. Puis Nicolas II monte dans la voiture-lits, mais ne s'endort qu'à 17h15, après avoir envoyé un télégramme au général Alekseev : « Vous pouvez annoncer le manifeste présenté en le marquant Pskov. NICOLAS."
Le 2 mars, à 3h30 du matin, Ruzsky a contacté M.V. Rodzianko et, au cours d'une conversation de quatre heures, il s'est familiarisé avec la situation tendue qui s'était alors développée à Petrograd.
Ayant reçu un enregistrement de la conversation de Ruzsky avec M.V. Rodzianko, Alekseev a ordonné le 2 mars à 9 heures au général Lukomsky de contacter Pskov et de réveiller immédiatement le tsar, ce à quoi il a reçu la réponse que le tsar ne s'était endormi que récemment et que Ruzsky le rapport était prévu pour 10h00.
A 10h45, Ruzsky commença son rapport en informant Nicolas II de sa conversation avec Rodzianko. A cette époque, Ruzsky reçut le texte d'un télégramme envoyé par Alekseev aux commandants du front sur la question de l'opportunité de l'abdication et le lut au tsar.
Le 2 mars, de 14h00 à 14h30, les réponses des commandants du front ont commencé à arriver. Le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch a déclaré : « en tant que sujet loyal, je considère qu'il est du devoir et de l'esprit du serment de s'agenouiller et de supplier le souverain de renoncer à la couronne afin de sauver la Russie et la dynastie ». Les généraux A. E. Evert se sont également prononcés en faveur de l'abdication ( front occidental), Brusilov A.A. (Front sud-ouest), Sakharov V.V. (Front roumain), commandant de la flotte baltique, l'amiral Nepenin A.I. et le général Sakharov ont qualifié le Comité provisoire de la Douma d'État de « groupe de bandits qui ont profité d'une minute opportune, " mais " en sanglotant, je dois dire que le renoncement est la solution la plus indolore ", et le général Evert a noté que " vous ne pouvez pas compter sur l'armée dans sa composition actuelle pour réprimer les troubles... Je prends toutes les mesures pour que des informations sur la situation actuelle Les affaires dans les capitales n'ont pas pénétré l'armée afin de la protéger de troubles incontestables. Il n’existe aucun moyen d’arrêter la révolution dans les capitales.» Le commandant de la flotte de la mer Noire, l'amiral A.V. Kolchak, n'a pas envoyé de réponse.
Entre 14h00 et 15h00, Ruzsky entra chez le tsar, accompagné des généraux Danilov Yu.N. et Savich, emportant avec lui les textes des télégrammes. Nicolas II a demandé aux généraux de s'exprimer. Ils se sont tous prononcés en faveur du renoncement.
Vers 15h00 le 2 mars le tsar a décidé d'abdiquer en faveur de son fils pendant la régence du grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch.
À cette époque, Ruzsky fut informé que des représentants de la Douma d'État A.I. Guchkov et V.V. Shulgin avaient déménagé à Pskov. À 15h10, Nicolas II en fut informé. Les représentants de la Douma arrivent dans le train royal à 21h45. Goutchkov a informé Nicolas II qu'il y avait un risque de troubles se propageant sur le front et que les troupes de la garnison de Petrograd se sont immédiatement ralliées aux rebelles et, selon Goutchkov, les restes des troupes loyales à Tsarskoïe Selo sont passés. du côté de la révolution. Après l'avoir écouté, le roi rapporte qu'il a déjà décidé de renoncer pour lui et son fils.
2 (15) mars 1917 à 23 heures 40 minutes (dans le document, l'heure de la signature était indiquée par le tsar comme 15 heures - l'heure de la prise de décision) Nikolaï a remis le relais à Goutchkov et Shulgin Manifeste de renonciation, qui disait, en partie : "Nous ordonnons à notre frère de gouverner les affaires de l'État en unité complète et inviolable avec les représentants du peuple dans les institutions législatives, selon les principes qui seront établis par eux, en prêtant un serment inviolable à cet effet.".

Goutchkov et Choulgine ont également exigé que Nicolas II signe deux décrets : sur la nomination du prince G. E. Lvov comme chef du gouvernement et du grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch comme commandant en chef suprême, l'ancien empereur a signé les décrets, y indiquant l'époque du 14. heures.
Après cela, Nikolai écrit dans son journal : « Le matin, Ruzsky est venu et a lu sa longue conversation téléphonique avec Rodzianko. Selon lui, la situation à Petrograd est telle que le ministère de la Douma semble désormais impuissant, puisque le parti social-démocrate, représenté par le comité de travail, la combat. Mon renoncement est nécessaire. Ruzsky a transmis cette conversation au quartier général et Alekseev à tous les commandants en chef. Vers 14 heures et demie, tout le monde répondait. Le fait est que, pour sauver la Russie et maintenir le calme de l’armée au front, vous devez décider de franchir cette étape. J'ai été d'accord. Le quartier général a envoyé un projet de manifeste. Dans la soirée, Goutchkov et Choulguine sont arrivés de Petrograd, avec lesquels j'ai parlé et leur ai remis le manifeste signé et révisé. A une heure du matin, je quittai Pskov avec un lourd sentiment de ce que j'avais vécu. Il y a de la trahison, de la lâcheté et de la tromperie partout. ».
Goutchkov et Choulguine partent pour Petrograd le 3 (16) mars 1917 à trois heures du matin, après avoir préalablement informé le gouvernement par télégraphe du texte des trois documents acceptés. A 6 heures du matin, la commission temporaire de la Douma d'Etat contacte le grand-duc Mikhaïl, l'informant de l'abdication de l'ancien empereur en sa faveur.
Lors d'une réunion dans la matinée du 3 (16) mars 1917 avec le grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch Rodzianko, il déclara que s'il acceptait le trône, un nouveau soulèvement éclaterait immédiatement et que l'examen de la question de la monarchie devrait être transféré à l'Assemblée constituante. Il est soutenu par Kerensky, opposé par Milioukov, qui a déclaré que « le gouvernement seul, sans monarque… est un bateau fragile qui peut couler dans l'océan des troubles populaires ; « Dans de telles conditions, le pays risque de perdre toute conscience de son statut d’État. » Après avoir entendu les représentants de la Douma, le Grand-Duc a exigé un entretien privé avec Rodzianko et a demandé si la Douma pouvait garantir sa sécurité personnelle. Ayant entendu dire qu'il ne le pouvait pas, Le grand-duc Mikhaïl a signé un manifeste de renonciation au trône.
Le 3 (16) mars 1917, Nicolas II, ayant appris le refus du grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch du trône, écrivit dans son journal : « Il s'avère que Misha a renoncé. Son manifeste se termine par quatre queues pour des élections dans 6 mois Assemblée constituante. Dieu sait qui l'a convaincu de signer des trucs aussi dégoûtants ! A Petrograd, les troubles ont cessé – si seulement ils continuaient ainsi. ». Il rédige une seconde version du manifeste de renonciation, toujours en faveur de son fils. Alekseev a pris le télégramme, mais ne l'a pas envoyé. Il était trop tard : deux manifestes avaient déjà été annoncés au pays et à l'armée. Alekseev, « pour ne pas confondre les esprits », n'a montré ce télégramme à personne, l'a gardé dans son portefeuille et me l'a remis fin mai, quittant le haut commandement.
4 (17) mars 1917, le commandant du corps de cavalerie de la garde envoie un télégramme au quartier général au chef d'état-major du commandant en chef suprême « Nous avons reçu des informations sur des événements majeurs. Je vous demande de ne pas refuser de mettre aux pieds de Sa Majesté le dévouement sans limites de la cavalerie de la Garde et la volonté de mourir pour votre monarque bien-aimé. Khan du Nakhitchevan". Dans un télégramme de réponse, Nikolaï a déclaré : «Je n'ai jamais douté des sentiments de la cavalerie de la Garde. Je vous demande de vous soumettre au gouvernement provisoire. Nikolaï". Selon d'autres sources, ce télégramme aurait été envoyé le 3 mars et le général Alekseev ne l'aurait jamais remis à Nikolaï. Il existe également une version selon laquelle ce télégramme aurait été envoyé à l'insu du Khan du Nakhitchevan par son chef d'état-major, le général baron Wieneken. Selon la version opposée, le télégramme aurait au contraire été envoyé par le Khan du Nakhitchevan après une réunion avec les commandants des unités du corps.
Un autre télégramme de soutien bien connu a été envoyé par le commandant du 3e corps de cavalerie du front roumain, le général F. A. Keller : « Le Troisième Corps de Cavalerie ne croit pas que Vous, Souverain, ayez volontairement abdiqué le trône. Commande, Roi, nous viendrons te protéger. ». On ne sait pas si ce télégramme est parvenu au tsar, mais il est parvenu au commandant du front roumain, qui a ordonné à Keller de renoncer au commandement du corps sous la menace d'être accusé de trahison.
Le 8 (21) mars 1917, le comité exécutif du soviet de Petrograd, ayant appris le projet du tsar de partir pour l'Angleterre, décida d'arrêter le tsar et sa famille, de confisquer leurs biens et de les priver de leurs droits civils. Le nouveau commandant du district de Petrograd, le général L. G. Kornilov, arrive à Tsarskoïe Selo, arrêtant l'impératrice et mettant en place des gardes, notamment pour protéger le tsar de la garnison rebelle de Tsarskoïe Selo.
Le 8 (21) mars 1917, le tsar de Moguilev a dit au revoir à l'armée et a émis un ordre d'adieu aux troupes, dans lequel il leur a légué de « combattre jusqu'à la victoire » et d'« obéir au gouvernement provisoire ». Le général Alekseev transmet cet ordre à Petrograd, mais le gouvernement provisoire, sous la pression du soviet de Petrograd, refuse de le publier :
« Pour la dernière fois, je fais appel à vous, mes troupes bien-aimées. Après mon abdication pour moi et pour mon fils du trône de Russie, le pouvoir a été transféré au gouvernement provisoire, né à l'initiative de la Douma d'État. Que Dieu l'aide à conduire la Russie sur le chemin de la gloire et de la prospérité. Que Dieu vous aide, vaillantes troupes, à défendre la Russie contre l'ennemi maléfique. Depuis deux ans et demi, vous avez effectué un lourd service de combat toutes les heures, beaucoup de sang a été versé, beaucoup d'efforts ont été déployés, et l'heure approche déjà où la Russie, liée à ses vaillants alliés par un commun le désir de victoire, brisera le dernier effort de l'ennemi. Cette guerre sans précédent doit être menée vers une victoire complète.
Celui qui pense à la paix, qui la désire, est un traître à la Patrie, son traître. Je sais que tout guerrier honnête pense ainsi. Remplissez votre devoir, défendez notre vaillante Grande Patrie, obéissez au Gouvernement Provisoire, écoutez vos supérieurs, rappelez-vous que tout affaiblissement de l'ordre de service ne fait que faire le jeu de l'ennemi.
Je crois fermement que l'amour sans limites pour notre Grande Patrie ne s'est pas estompé dans vos cœurs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que le Saint Grand Martyr et Georges Victorieux vous conduisent à la victoire.
Avant que Nicolas ne quitte Mogilev, le représentant de la Douma au siège lui dit qu'il « doit se considérer comme en état d'arrestation ».
Exécution de Nicolas II et de la famille royale
Du 9 (22) mars 1917 au 1er (14) août 1917, Nicolas II, sa femme et ses enfants vivaient en état d'arrestation au palais Alexandre de Tsarskoïe Selo.
Fin mars, le ministre du gouvernement provisoire P. N. Milyukov a tenté d'envoyer Nicolas et sa famille en Angleterre, sous la garde de George V, pour lesquels le consentement préalable de la partie britannique a été obtenu. Mais en avril, en raison de la situation politique interne instable en Angleterre même, le roi a choisi d'abandonner un tel plan - selon certaines preuves, contre l'avis du Premier ministre Lloyd George. Cependant, en 2006, certains documents ont été connus indiquant que jusqu'en mai 1918, l'unité MI 1 de l'agence de renseignement militaire britannique se préparait à une opération de sauvetage des Romanov, qui n'a jamais été portée au stade de la mise en œuvre pratique.
Face au renforcement du mouvement révolutionnaire et à l'anarchie à Petrograd, le gouvernement provisoire, craignant pour la vie des prisonniers, a décidé de les transférer profondément en Russie, à Tobolsk, où ils ont été autorisés à emporter les meubles et les effets personnels nécessaires. palais, et proposent également au personnel de service, s'il le souhaite, de les accompagner volontairement sur le lieu du nouveau placement et du service ultérieur. A la veille du départ, le chef du gouvernement provisoire, A.F. Kerensky, est arrivé et a amené avec lui le frère de l'ancien empereur Mikhaïl Alexandrovitch. Mikhaïl Alexandrovitch fut exilé à Perm, où, dans la nuit du 13 juin 1918, il fut tué par les autorités bolcheviques locales.
Le 1er (14) août 1917, à 6 h 10, un train avec des membres de la famille impériale et des serviteurs sous le signe « Mission de la Croix-Rouge japonaise » partit de Tsarskoïe Selo depuis la gare d'Alexandrovskaya.
Le 4 (17) août 1917, le train arriva à Tioumen, puis les personnes arrêtées sur les navires « Rus », « Kormilets » et « Tyumen » furent transportées le long du fleuve jusqu'à Tobolsk. La famille Romanov s'est installée dans la maison du gouverneur, spécialement rénovée pour leur arrivée.
La famille a été autorisée à traverser la rue et le boulevard pour se rendre aux services religieux à l'église de l'Annonciation. Le régime de sécurité ici était beaucoup plus léger qu'à Tsarskoïe Selo. La famille menait une vie calme et mesurée.

Début avril 1918, le Présidium du Comité exécutif central panrusse (VTsIK) autorisa le transfert des Romanov à Moscou en vue de leur procès. Fin avril 1918, les prisonniers furent transportés à Ekaterinbourg, où une maison privée fut réquisitionnée pour loger les Romanov. Cinq militaires vivaient ici avec eux : le docteur Botkin, le valet de pied Trupp, la fille de chambre Demidova, le cuisinier Kharitonov et le cuisinier Sednev.
Nicolas II, Alexandra Fedorovna, leurs enfants, le docteur Botkin et trois domestiques (à l'exception du cuisinier Sednev) ont été tués avec des armes blanches et des armes à feu dans la « Maison à usage spécial » - le manoir d'Ipatiev à Ekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet. 1918.
Depuis les années 1920, dans la diaspora russe, à l'initiative de l'Union des dévots de la mémoire de l'empereur Nicolas II, des commémorations funéraires régulières de l'empereur Nicolas II étaient organisées trois fois par an (le jour de son anniversaire, le jour du même nom et le jour de l'anniversaire de son assassinat), mais sa vénération en tant que saint commença à se répandre après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le 19 octobre (1er novembre 1981), l'empereur Nicolas et sa famille furent canonisés par l'Église russe à l'étranger (ROCOR), qui n'avait alors aucune communion ecclésiale avec le Patriarcat de Moscou en URSS.
Décision du Conseil des évêques de l'Église orthodoxe russe du 14 août 2000 : « Glorifier la famille royale en tant que passionnée parmi les nouveaux martyrs et confesseurs de Russie : l'empereur Nicolas II, l'impératrice Alexandra, le tsarévitch Alexis, les grandes-duchesses. Olga, Tatiana, Maria et Anastasia » (leur mémoire - 4 juillet selon le calendrier julien).
L'acte de canonisation a été accueilli de manière ambiguë par la société russe : les opposants à la canonisation affirment que la proclamation de Nicolas II comme saint était de nature politique. D’un autre côté, dans une partie de la communauté orthodoxe, des idées circulent selon lesquelles glorifier le roi en tant que porteur de passion ne suffit pas, mais qu’il est un « roi-rédempteur ». Ces idées ont été condamnées par Alexis II comme blasphématoires, car « il n'y a qu'un seul exploit rédempteur : celui de notre Seigneur Jésus-Christ ».
En 2003, à Ekaterinbourg, sur le site de la maison démolie de l'ingénieur N. N. Ipatiev, où Nicolas II et sa famille furent fusillés, l'Église sur le Sang fut construite au nom de Tous les Saints qui brillaient en terre russe, devant lequel un monument à la famille de Nicolas II a été érigé.
Dans de nombreuses villes, la construction d'églises a commencé en l'honneur des saints porteurs royaux de la Passion.
En décembre 2005, une représentante de la chef de la « Maison impériale russe », Maria Vladimirovna Romanova, a adressé au parquet russe une demande de réhabilitation de l'ancien empereur Nicolas II exécuté et des membres de sa famille en tant que victimes de la répression politique. Selon le communiqué, après un certain nombre de refus de satisfaire, le 1er octobre 2008, le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie a décidé de réhabiliter le dernier empereur russe Nicolas II et les membres de sa famille (malgré l'avis du procureur Bureau général de la Fédération de Russie, qui a déclaré devant le tribunal que les exigences de réhabilitation ne sont pas conformes aux dispositions de la loi car ces personnes n'ont pas été arrêtées pour des raisons politiques et aucune décision judiciaire n'a été prise pour les exécuter).
Le 30 octobre 2008, il a été rapporté que le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie avait décidé de réhabiliter 52 personnes de l'entourage de l'empereur Nicolas II et de sa famille.
En décembre 2008, lors d'une conférence scientifique et pratique organisée à l'initiative de la commission d'enquête du parquet de la Fédération de Russie, avec la participation de généticiens de Russie et des États-Unis, il a été déclaré que les restes découverts en 1991 près d'Ekaterinbourg et inhumé le 17 juin 1998 dans la chapelle Catherine de la cathédrale Pierre et Paul (Saint-Pétersbourg), appartiennent à Nicolas II. Chez Nicolas II, l'haplogroupe du chromosome Y R1b et l'haplogroupe mitochondrial T ont été identifiés.
En janvier 2009, la commission d'enquête a achevé une enquête pénale sur les circonstances du décès et de l'enterrement de la famille de Nicolas II. L’enquête a été close « en raison de l’expiration du délai de prescription des poursuites pénales et de la mort des auteurs de meurtres avec préméditation ». Un représentant de M.V. Romanova, qui se dit chef de la Maison impériale russe, a déclaré en 2009 que « Maria Vladimirovna partage pleinement la position de l'Église orthodoxe russe sur cette question, qui n'a pas trouvé de motifs suffisants pour être reconnue ». Ekaterinbourg reste"appartenant à des membres de la famille royale". D'autres représentants des Romanov, menés par N. R. Romanov, ont pris une position différente : ces derniers ont notamment participé à l'enterrement des dépouilles en juillet 1998, déclarant : "Nous sommes venus à clôturer l’époque.
Le 23 septembre 2015, les restes de Nicolas II et de son épouse ont été exhumés pour des actions d'enquête dans le cadre de l'établissement de l'identité des restes de leurs enfants, Alexei et Maria.
Nicolas II au cinéma
Plusieurs longs métrages ont été réalisés sur Nicolas II et sa famille, parmi lesquels « Agony » (1981), le film anglo-américain « Nicholas and Alexandra » (Nicholas and Alexandra, 1971) et deux films russes « The Regicide » (1991). ) et « Romanov. La Famille Couronnée" (2000).
Hollywood a réalisé plusieurs films sur la fille soi-disant sauvée du tsar Anastasia, « Anastasia » (Anastasia, 1956) et « Anastasia, ou le mystère d'Anna » (Anastasia : Le mystère d'Anna, États-Unis, 1986).




Acteurs qui ont joué le rôle de Nicolas II :
1917 - Alfred Hickman - La Chute des Romanov (USA)
1926 - Heinz Hanus - Die Brandstifter Europas (Allemagne)
1956 - Vladimir Kolchine - Prologue
1961 - Vladimir Kolchin - Deux vies
1971 - Michael Jayston - Nicolas et Alexandra
1972 - - Famille Kotsyubinsky
1974 - Charles Kay - La Chute des Aigles
1974-81 - - Agonie
1975 - Youri Demich - Confiance
1986 - - Anastasia, ou le mystère d'Anna (Anastasia : Le Mystère d'Anna)
1987 - Alexandre Galibin - La vie de Klim Samgin
1989 - - Oeil de Dieu
2014 - Valéry Degtyar - Grigori R.
2017 - - Mathilde.