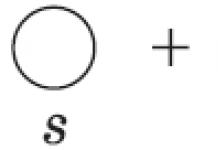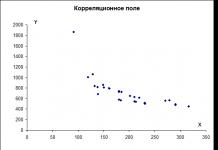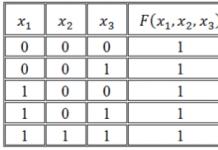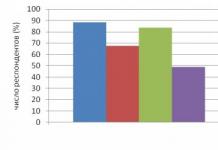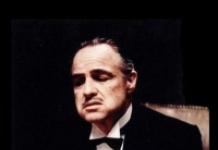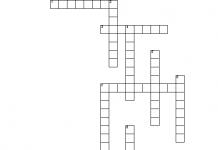INTRODUCTION
La vitesse de développement et de diffusion des innovations techniques à notre époque est enviable. Dans ce contexte, une question très importante et urgente se pose : « Le progrès technologique est-il incontestablement positif pour la société ? De nombreux penseurs reconnaissent l'impact négatif de la technologie sur une personne, ses émotions, ses sentiments et ses expériences. La technologie recèle non seulement des possibilités utiles infinies, mais aussi des dangers. Et plus le progrès technologique avance, plus les problèmes de gestion de ce progrès acquièrent un caractère éthique et spirituel. Récemment, des événements se sont produits dans le monde qui démontrent la diminution de l’importance non seulement des valeurs humaines universelles, mais aussi de la vie humaine. Ce que certaines personnes ou groupes sociaux considèrent comme un progrès et une bonne fortune pour l’humanité, d’autres l’évaluent souvent à partir de positions opposées.
Le but du travail est de trouver une solution logique au différend entre la société et la science et la technologie sur l'utilité incontestable ou le danger obligatoire des inventions scientifiques pour la société, ainsi que la preuve de la nécessité d'obligations techniques envers la société.
L'objectif de ce travail est d'utiliser la littérature pour trouver et analyser les caractéristiques positives et négatives du contrôle social sur le développement de la technologie.
1 SOCIÉTÉ ET PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
1.1 Dispositions générales
La société moderne se caractérise par l'inquiétude quant aux conséquences négatives du progrès scientifique et technologique, ainsi que de certains domaines de la recherche scientifique. Et la question de la légalité et de la possibilité d’un contrôle public sur le développement de la science et de la technologie est plus que jamais d’actualité. Toutes les réalisations utiles du progrès scientifique et technologique ne pourront pas forcer la société à accepter docilement tous les domaines de la recherche scientifique et à contribuer sans objections à l'avancement de tous les résultats scientifiques et pratiques.
Malheureusement, seuls les spécialistes travaillant dans cette direction et comprenant profondément ses problèmes peuvent juger avec compétence les problèmes de développement de l'une ou l'autre direction du progrès scientifique et technologique. Par conséquent, il existe une réponse négative à la question de la légalité et de la possibilité d’un contrôle public sur le développement de la science et de la technologie. Ce poste est généralement occupé par des spécialistes techniques, des scientifiques et la plupart des scientifiques. De leur point de vue, le désir des ignorants de juger les problèmes du développement de la science et de la technologie et de donner leur appréciation est totalement inacceptable. Cela revient à cautionner l’ignorance, ce qui peut avoir des conséquences négatives.
Il existe également une position opposée, selon laquelle la société a le droit de savoir dans quelle direction s'effectuent les derniers développements scientifiques et techniques et quelles sont leurs éventuelles conséquences socio-économiques, politiques, idéologiques et humanitaires, ce qui prévoit non seulement la sensibilisation du public, des structures gouvernementales et politiques aux innovations dans le domaine scientifique et technique, la légitimité de leurs jugements sur ces innovations, mais aussi le contrôle de leur mise en œuvre et de leur diffusion. Cette position est notamment soutenue par le fait que dans une société bâtie sur les principes de la démocratie, il ne devrait y avoir aucun problème fermé au débat public, à l'exception des secrets de nature militaire et étatique spécifiquement définis par la loi.
Ces points de vue existent depuis l’émergence de la science en tant qu’institution spécialisée dans la production de connaissances et sont depuis longtemps devenus traditionnels. Selon le premier d’entre eux, les professionnels sont l’autorité finale en matière d’utilisation et d’interprétation des connaissances. Selon la seconde, ces connaissances doivent être soumises à une juridiction supérieure : leur évaluation par la société. Ainsi, Platon pensait qu'il pourrait s'agir d'un tribunal de super-experts, composé de sages qui n'étaient pas directement impliqués dans les nouveaux développements. Protagoras croyait que cela pouvait être un jugement du peuple.
1.2 Point de vue de la société et des scientifiques
A titre d'exemple, une discussion qui a surgi au XVIe siècle. entre Galileo Galilei et le cardinal Roberto Bellarmino de l'Église catholique romaine. À l’époque de Galilée, l’Église, en tant qu’institution sociale de premier plan, était encore plus une organisation chargée de la mission de protéger les intérêts de la société tout entière. Pas un seul fait d'innovation significative dans le domaine scientifique ne pouvait échapper à l'attention de l'Église, responsable de la situation dans l'ensemble de la société. Par conséquent, la polémique avec Galilée a été confiée à l'un des représentants les plus instruits et les plus érudits de Rome, le cardinal Roberto Bellarmino.
Il oppose Galilée, qui défendait le point de vue de la compétence exclusive des scientifiques en matière scientifique, avec la position de l'intérêt public concernant les conséquences du développement de la science. L'un des principaux arguments de Bellarmino était que la révision de dispositions scientifiques établies de longue date et leur remplacement par des dispositions fondamentalement nouvelles du point de vue de la science elle-même nécessitent une justification scientifique très solide. Une révolution scientifique ne peut se réaliser uniquement grâce à une idée brillante qui a visité la tête d'un ou de plusieurs scientifiques, même les plus remarquables et les plus grands. La simplicité et « l’élégance » de la théorie jouent également un rôle dans la science moderne. Mais ces qualités ne dispensent pas toujours la théorie des difficultés à expliquer un certain nombre de phénomènes. P. Feyerabend écrit : « Un exemple est la mécanique ondulatoire de Schrödinger. Il est élégant, cohérent en interne, facile à utiliser et très réussi. Elle repose sur l’hypothèse que les particules élémentaires sont des ondes. Cependant, Bohr et les scientifiques de son école, après avoir analysé un large éventail de phénomènes, ont constaté que cette interprétation contredit un certain nombre de faits importants... »
Le deuxième argument de Bellarmino était que promouvoir à la hâte une nouvelle théorie comme seule véritable description de la réalité pourrait nuire aux gens. Il voulait avant tout nuire à la vie spirituelle. Ce préjudice est dû au fait que la diffusion généralisée de la nouvelle théorie en tant que description correcte de la réalité nécessitera des changements dans les idées des larges masses populaires. De tels changements ne peuvent se produire sans douleur et sans conflit. La découverte du caractère fallacieux d’une théorie largement appliquée entraînera une confusion encore plus grande dans l’esprit des gens : la croyance même dans la capacité de l’homme à comprendre le monde qui l’entoure pourrait être menacée.
Dans ce cas, nous ne parlons pas du droit du scientifique à la recherche libre. Ce droit est garanti dans les instituts et laboratoires spécialement créés aux fins de la recherche scientifique. Dans ces cas-là, le droit de rechercher librement et d’émettre des hypothèses très diverses est protégé par l’État. Mais l’État a le droit, et parfois l’obligation, de fixer des limites au-delà desquelles le chercheur ne doit pas dépasser. Si, par exemple, un « innovateur » souhaite tester l’efficacité d’une nouvelle méthode de traitement qu’il a inventée sur un groupe de volontaires sans autorisation spéciale, dans de nombreux États américains, cela sera suivi d’une visite immédiate de la police. Le contrôle de l'État et du public est d'autant plus justifié dans le cas de tentatives d'introduction et de diffusion universelles d'innovations scientifiques et techniques qui n'ont pas fait l'objet d'essais particuliers en laboratoire.
Ainsi, pour être largement reconnues, les innovations scientifiques et techniques passent par deux types de tamis. La première étape consiste à les tester du point de vue du développement interne de la science elle-même, ainsi que de la technologie. L'innovation est soumise à des tests minutieux en termes de critères acceptés dans l'environnement scientifique et technique. A ce stade, le rôle principal est joué par les spécialistes d'un domaine scientifique et technique donné, mais pas seulement. Un rôle important appartient aux scientifiques de domaines connexes, aux philosophes et historiens des sciences, aux méthodologistes scientifiques, etc. Lors de la deuxième étape, un large éventail d'organisations publiques et gouvernementales sont incluses dans la vérification. Eux seuls ont le droit d'autoriser l'introduction et la diffusion généralisées des innovations scientifiques et techniques.
Passer par un système d’inspection en plusieurs étapes peut prendre des années, voire des décennies. Il convient de noter que l'entrée dans la conscience publique et la vie publique d'une innovation scientifique et technique, sa perception adéquate par la conscience publique présuppose comme condition importante la tolérance mutuelle (tolérance) des découvreurs, d'une part, et du public et les organismes gouvernementaux, d’autre part. Sur la base de la tolérance, le public s'adapte progressivement aux nouvelles réalisations du progrès scientifique et technologique. Malheureusement, la condition de tolérance mutuelle n’est pas toujours respectée. Les représentants des milieux scientifiques et techniques et les représentants des organismes publics et gouvernementaux en sont également coupables.
De leur côté, les représentants des organismes publics et gouvernementaux, en particulier ceux chargés de la responsabilité de la science et de l’éducation, sont habitués à voir dans tout innovateur presque un ennemi. Souvent, tant d’obstacles insurmontables s’opposent à la réalisation d’une invention qu’elle meurt, sans pouvoir être revendiquée pour une application pratique. Les relations tolérantes entre l'auteur d'une innovation et l'État sont l'un des signes les plus importants d'une société démocratique. Seules de telles relations peuvent donner à la société un dynamisme répondant aux exigences de l’ère scientifique et technologique, tout en la protégeant des dangers.
2 UTILITÉ INCONDITIONNELLE OU CONSÉQUENCES NÉGATES DES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES POUR LA SOCIÉTÉ
Le débat sur la responsabilité sociale des scientifiques s’apparente à des tentatives de relier deux traditions autrement disparates concernant la relation entre science et société. Présenté dans les collections "Bulletin of Atomic Scientists", "International Pugwash Conference", "Azilomar Conference", etc. La tradition primaire considère la science empirique comme une forme de connaissance limitée en interne, basée sur un niveau inférieur de réalité, comme une menace potentielle. à l'ordre social au niveau de la pensée et de la pratique, ce qui implique la responsabilité des scientifiques (et du régime politique) par rapport à ces disciplines. La deuxième approche, plus récente, suppose que la science est plus profondément liée à la vérité et que, par conséquent, dans toutes les conditions, elle est essentiellement utile à la société, les scientifiques étant responsables du développement et de la diffusion de leurs disciplines (une activité que l'État devrait également soutenir). .
La tradition prémoderne de limitation de la science a été étayée, par exemple, dans la République de Platon et a été classiquement illustrée dans le récit bien connu de Plutarque sur Archimède, qui a refusé de publier certaines de ses découvertes mathématiques en raison du danger de leurs applications techniques et les a appliquées. lui-même uniquement lorsqu'il est menacé par un danger militaire.
Et déjà à l’aube des temps modernes, l’idéologie du progrès scientifique, étayée par Francis Bacon dans sa « Nouvelle Atlantide », préserve en partie l’idée selon laquelle le pouvoir de la connaissance doit être protégé auprès de larges pans de la société. Le récit de Werner Heisenberg sur la façon dont il a proposé à Niels Bohr en 1941 que les scientifiques allemands et américains s'abstiennent de développer des armes atomiques, et la décision de Norbert Wiener en 1947 de "ne pas... publier à l'avenir aucun travail... qui pourrait causer des dommages" dans le mains de militaristes irresponsables" sont peut-être des exemples plus récents de cette position.
La deuxième tradition peut être illustrée par Galilée. Pour Galilée, la recherche scientifique ne peut être soumise à aucune restriction prudente dictée de l’extérieur. En marge d’un exemplaire de son « Dialogue sur les grands systèmes du monde ». Il écrit : « Les pires troubles (troubles) surviennent lorsque l'esprit, créé libre,... est contraint de se soumettre servilement à la volonté extérieure... Les nouvelles formes de cette subordination sont des innovations qui peuvent conduire à la destruction des systèmes étatiques et du renversement de l’État. » Les scientifiques ont donc le droit de produire de la vérité scientifique sans se soucier des éventuelles conséquences négatives pour la société. Comme en témoigne l’image de Galilée le martyr, cette seconde tradition domine clairement la science moderne.
Les racines du doute sur la véracité de cette seconde tradition se trouvent dans la critique romantique de l’épistémologie scientifique et de la pratique industrielle, mais ce doute n’a été pris au sérieux par les scientifiques eux-mêmes qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, deux étapes de mouvement peuvent être distinguées dans ce domaine. Pour simplifier quelque peu, nous pouvons dire que dans le premier d'entre eux (en gros - de 1945 à 1970), les scientifiques ont réalisé les applications potentiellement défavorables de certaines de LEURS réalisations et découvertes et ont cherché à aider la société à utiliser correctement leurs travaux. D’autre part, apparaît une volonté de transformer le caractère interne de la science elle-même.
Sur la première page du premier numéro du Bulletin of the Atomic Scientists, publié en décembre 1945, est formulé le double objectif de la nouvelle association de scientifiques dans ce domaine : « Il faut d’abord clarifier… .. la responsabilité des scientifiques face aux problèmes posés par la libération de l'énergie nucléaire. Et en même temps, il convient également de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes scientifiques, technologiques et sociaux que pose l'exploitation de l'énergie nucléaire. » La seconde, en fait, est due à la première : la compréhension des responsabilités des scientifiques conduit à la nécessité de nouvelles actions, et la principale de ces activités est la formation scientifique du grand public. Dans le passé, les scientifiques pouvaient affirmer que leur responsabilité se limitait à bien faire un travail scientifique, sans falsifier les expériences, etc. En raison des applications destructrices d'au moins une branche de la science (telles que celles découvertes dans ses applications dans le développement de nouveaux types d'armes), les scientifiques comprennent que leur responsabilité s'étend. Ils sont obligés de prendre en compte plus que de simples considérations scientifiques elles-mêmes, ils doivent répondre à la situation complexe qui se présente.
Au cours de la décennie suivante, la principale manière dont les scientifiques nucléaires ont réagi à la situation créée par la technologie des armes scientifiques a été de placer la recherche nucléaire sous contrôle civil aux États-Unis et de subordonner ensuite ce contrôle national au contrôle international. Parce que les scientifiques sont plus familiers que quiconque avec les nouvelles réalités posées par les armes nucléaires (et autres armes scientifiquement développées), on souligne sans cesse qu’ils doivent sortir du laboratoire et s’engager dans l’éducation scientifique du public.
Néanmoins, l'objectif du mouvement scientifique d'après-guerre était de soustraire la science au domaine militaire, pour la placer sous le contrôle démocratique de la société et, à terme, sous le contrôle d'un gouvernement mondial, dont la communauté internationale des scientifiques était censée être le précurseur ou le modèle. Ainsi, les scientifiques nucléaires soutiennent la législation établie par la Commission américaine de l’énergie atomique, proposent la création d’une National Science Foundation pour restreindre la recherche lourdement financée par l’armée et soutiennent le plan de Baruch pour un contrôle international de l’énergie atomique. Et la croyance typique des Lumières dans le caractère paradigmatiquement démocratique de la communauté scientifique est défendue avec encore plus de force par les plus réceptifs aux nouvelles fourches de la responsabilité sociale. Mais, écrivait Edward Teller en 1947, la responsabilité des scientifiques atomiques n'est pas seulement d'éduquer le public et de l'aider à établir des contrôles publics qui « n'imposent pas de restrictions inutiles aux activités du scientifique » ; leur responsabilité est également de progresser. "Notre responsabilité", déclare Teller, "est également de continuer à œuvrer en faveur d'une recherche fructueuse et vigoureuse sur l'énergie atomique". Les nouveaux types de valeurs de réponse n'annulent pas les anciens - ils ne font que les compléter.
Dans la première étape du débat sur la responsabilité scientifique, les scientifiques hésitent donc à abandonner l’impératif galiléen, même si, contrairement à Galilée, ils sont conscients que la science, si elle n’est pas correctement dirigée, peut avoir des conséquences négatives sur la société. Le scientifique néerlando-américain Andrew J. Van Melsen résume cette position : « L’homme a compris que sa responsabilité exige le développement de la science, qu’il ne peut pas négliger cette circonstance, mais il ne peut pas connaître à l’avance toutes les responsabilités nouvelles et inattendues que le nouveau le développement imposera sur ses épaules... La responsabilité ultérieure de la science découle... de la responsabilité que les gens expérimentent initialement.
Cependant, dans les années 70, une deuxième « étape » de doute sur l’impératif galiléen a commencé à prendre forme. Elle est née en réaction à la prise de conscience croissante des problèmes de pollution de l’environnement et à la prise de conscience qu’il était inconcevable que la gravité de ces problèmes puisse être atténuée simplement par la démilitarisation de la science ou par le renforcement du contrôle démocratique. Un certain nombre des problèmes environnementaux les plus urgents sont précisément dus à l'accessibilité démocratique de son utilisation - comme la pollution de l'air causée par les véhicules à moteur, les produits chimiques agricoles, les aérosols, sans parler de la charge croissante du traitement et du stockage des déchets de consommation. Sur la base des événements de cette deuxième étape du mouvement vers la limitation internationale de la science elle-même, il s'agit de la Conférence d'Asilomar de 1975, au cours de laquelle les dangers du développement de molécules d'ADN recombinant ont été annoncés.
Le danger potentiel des molécules d'ADN recombinant a été discuté pour la première fois en privé en 1970-1971, et en 1973 il a été annoncé publiquement lors d'une conférence scientifique et dans un discours à la Science. En conséquence, Paul Berg, un pionnier de la recherche sur l'ADN à l'Université de Stanford qui avait déjà limité ses propres recherches, a été invité à diriger un comité sur ce problème à l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Lorsque ce comité s'est réuni pour la première fois en avril 1974, il a décidé de convoquer une conférence internationale et, en réponse aux sérieuses inquiétudes d'un certain nombre de scientifiques selon lesquelles « les molécules d'ADN recombinant pourraient présenter un risque biologique », a recommandé que « même si le risque potentiel... de Les molécules d'ADN recombinant n'existent plus, soigneusement évaluées, ... des scientifiques du monde entier se sont joints aux membres de ce comité pour décider de reporter volontairement certains types d'expériences. Le résultat fut une conférence convoquée à Asilomar. (Californie) en février de l'année suivante, 1975, où se sont réunis 150 scientifiques de différents pays. Un rapport a été publié pour servir d'orientation aux organes administratifs et législatifs.
Il est ensuite devenu évident que le danger posé par les molécules d'ADN recombinant n'était peut-être pas aussi immédiat qu'on le craignait, et certains membres de la communauté scientifique se sont offusqués de l'agitation d'Asilomar pendant et après la conférence, tandis que d'autres ont activement fait campagne en faveur de lignes d'action encore plus strictes que celles d'Asilomar. celles proposées Quoi qu'il en soit, la signification d'Asilomar est que les scientifiques proposaient d'empêcher certains types de recherche et d'abandonner, au moins pour un temps, l'impératif galiléen. L’élargissement du champ des conséquences et l’utilisation de la technologie de cette manière ont conduit à nouveau à un élargissement du champ de ce qui peut être considéré comme la responsabilité nécessaire des scientifiques. En clôturant le Symposium Nobel sur l'éthique de la politique scientifique en 1978, Torgny Segerstedt a déclaré : « Le nouvel aspect... est que les scientifiques eux-mêmes commencent à critiquer et à remettre en question le rôle du chercheur et son droit à une recherche sans restriction de la vérité. » En présentant leurs arguments, les critiques de la science moderne ont relancé et élargi un aspect de la critique prémoderne de la science qui considérait la science comme une menace interne à l’ordre social. Par exemple, Robert Sinsheimer, biologiste respecté et président de l’Université de Californie à Santa Cruz, montre que la science moderne repose sur deux types de foi. L’une d’elles est « une croyance dans la flexibilité de nos institutions sociales… suffisante pour utiliser les connaissances acquises par la science… au profit de l’humanité plutôt que de lui nuire, une croyance qui est de plus en plus renforcée par l’accélération des avancées technologiques ». changement et l'augmentation de la taille des forces déployées. Mais plus encore, dit-il, il y a aussi « une croyance en la flexibilité, voire en la bienveillance, de la Nature après que nous l'avons prédite, anatomisée, déplacé ses composants dans de nouvelles configurations, perturbé ses formes et dirigé ses forces pour l'humanité ». La conviction que nos recherches scientifiques et nos projets technologiques ne déplaceront pas certains éléments clés de l'environnement qui nous protègent et détruiront ainsi notre colonne vertébrale écologique. La conviction que la nature ne tend aucun piège à ses espèces imprudentes.
La deuxième croyance, peut-être la plus fondamentale, est remise en question non seulement par l’énergie nucléaire et les armes, mais aussi aujourd’hui par la recherche biologique et ses apparemment bonnes intentions. La science moderne peut menacer l’ordre social, mais ce qui est ici plus décisif est le fait qu’un projet initialement conçu comme un moyen de « soulager la condition de l’homme » (Bacon) s’avère en soi nocif pour sa santé.
3 LA RESPONSABILITÉ COMME UN APPEL DE DIEU
Le terme « responsabilité » (traduction du latin responsere - « promettre en retour », « répondre ») s'applique à l'expérience (religieuse) originelle de la tradition judéo-chrétienne-islamique, désignant par ce mot l'appel de Dieu. , dont les gens peuvent tenir compte ou rejeter. Le mot "responsabilité" a été mentionné pour la première fois au milieu du XIXe siècle dans diverses discussions religieuses, pratiques ou pastorales. Il n'est pas difficile de trouver des livres de cette époque qui parlent de "responsabilité pastorale" ou, dans d'autres cas, il s'agit de "responsabilité chrétienne" d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs. Dans de tels cas, surtout lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs ou d'hommes d'affaires, il y a déjà une allusion claire à une activité industrielle, c'est-à-dire technique. Cependant, l'utilisation du terme "responsabilité" dans la théologie, bien que quelque peu tardive, est associée à l'émergence et à la complication croissante du problème de l'environnement naturel, de la portée et des méthodes d'application de la technologie, et en relation avec cela, le défi posé par la technologie aux philosophes religieux, aux moralistes théologiques et institutions ecclésiales.
L'idée principale du philosophe juif Martin Buber (1878 - 1965) est de distinguer deux types de réalité : la « réalité-elle » et la « réalité-tu ». Il n’est possible d’établir des relations avec la « réalité-it » (c’est-à-dire la réalité naturelle et objective) qu’à l’aide de moyens strictement techniques ; une personne ne doit pas d'une manière ou d'une autre « se rapporter » à « vous-réalité » (réalité humaine), mais doit « y répondre », entrer en dialogue avec elle. Les tentatives répétées de Martin Buber pour défendre et affirmer la suprématie de la relation non technique « je-vous » sur la relation « je-ce » (de l'homme à la nature morte, à l'environnement objectif), ses appels à la libération de l'idée de la « responsabilité » de la sphère de l'éthique spécialisée, « l'inclure dans la vie vivante », étaient clairement dictées par la prédominance déjà établie des relations « je-cela » dans le monde technique moderne.
« Une personne agit bien dans la mesure où elle est appelée par Dieu à être responsable (...) Notre action n'est libre que dans la mesure où elle est notre réponse à la parole que Dieu nous a communiquée (...) Ainsi, le bien "La responsabilité d'une personne relève de sa responsabilité. Dans son expression la plus simple et la plus élevée, la responsabilité (...) est l'essence et en même temps la substance de l'éthique théologique." Cette insistance dans la définition du concept de l'unité de la relation Dieu-homme et cet appel à ne pas s'impliquer dans des calculs utilitaires, qui sont censés être presque l'essentiel de l'éthique chrétienne, sont en partie une réaction à la présence étouffante de l'environnement technique dans notre monde et surtout une réaction contre l’affirmation de la technologie moderne selon laquelle elle aurait des « racines divines ». Les théologiens n’ont pas tardé à faire appel à l’idée de responsabilité et, à cet égard, ont commencé à reformuler et à clarifier les principes de la morale catholique.
L’utilisation du terme « responsabilité » était la plus populaire à Vatican II. En plus de parler des réalisations de la science et de la technologie, le « Gaudium et Spes » (joie et espérance - (lat.)) proclamé à l'occasion de cet événement dit également ce qui suit : « simultanément à la croissance de la puissance humaine, la le temps est venu d’accroître la responsabilité des individus et des communautés humaines ». On affirme en outre que « nous assistons à la naissance d’un nouvel humanisme, dans le cadre duquel l’homme se définit avant tout selon l’étendue de sa responsabilité à l’égard de ses semblables et de l’histoire ».
Dans cet aspect de la théologie morale et personnelle (sur lequel tous les théologiens s'accordent), la moralité sexuelle de notre époque en général et l'utilisation de contraceptifs artificiels en particulier confèrent au concept de responsabilité une signification particulière comme base d'une nouvelle formulation de la morale catholique. face aux complications et contradictions évidentes générées par la technologie moderne. Rejetant la « planification des naissances » récemment répandue, le pape Paul VI a proposé, pour sa part, l’idée d’une « natalité responsable ». Nous parlons ici de responsabilité dans laquelle, reconnaissant la nécessité de limiter la natalité, des restrictions équitables du point de vue du pape sont proposées dans le domaine de la technologie moderne. Le terme « responsabilité » apparaît également constamment dans l’éthique biomédicale catholique contemporaine.
Cependant, l’Église catholique ne s’est pas limitée à la lettre pastorale dans son interprétation du concept de responsabilité. La toute première réunion du Conseil œcuménique des Églises a proclamé : "L'homme est créé et destiné à être un être libre et responsable devant Dieu et devant ses semblables. Toute tendance, toute capacité à agir et à agir de manière responsable contredit également le plan de Dieu pour l'homme. comme les efforts de l'homme pour le salut. Une société responsable est une société dans laquelle la liberté est la liberté des individus qui sont responsables envers la justice et l'ordre public. Elle doit être une société dans laquelle ceux qui sont investis du pouvoir politique et du pouvoir économique sont responsables de l'accomplissement des devoirs envers Dieu, ainsi que pour leur bien-être.
Il convient de prêter attention à la façon dont, dans cet extrait du document, le commandement traditionnel de l’amour de Dieu et du prochain est remplacé par un appel à être responsable devant Dieu et devant le prochain. Et cela avec une référence tout à fait consciente aux exigences de la « société technique ». C'est ce que révèle l'article introductif de la Déclaration, qui explique que le document préfère le terme « société libre », désignant non seulement une société libérée du totalitarisme, mais aussi complètement libre pour l'homme à une époque de technologie hautement développée tendant à dépersonnaliser et à dépersonnaliser. supprimer l’individu. » Le terme même de « responsabilité » est compris comme la recherche du monde le plus neutre sur le plan idéologique.
Pourtant, l'éthique la plus profondément chrétienne de la responsabilité est développée par H. Richard Niebuhr dans The Responsible Self (1963). Cet ouvrage, publié après la mort de l'auteur, oppose clairement l'anthropologie de l'homme en tant qu'être responsable à l'anthropologie du créateur et de l'homme. ... en tant que citadin, remettant ainsi apparemment en question la thèse selon laquelle il est possible d'établir une relation symbiotique entre responsabilité et technologie dans le cadre de la doctrine chrétienne.
Du point de vue d'une personne en tant que citadin, un acte moral s'entend comme une mise en œuvre conformément à toutes les règles de communication existantes avec le monde extérieur. Dans sa structure, l’éthique d’un citadin est généralement déontologique.
Cependant, avec l'image de l'homme en tant que personne responsable, la tension entre téléologie et déontologie est résolue en se tournant vers une réalité concrète perçue sensoriellement, en analysant la nature de cette réalité avec l'intention d'apprendre à agir en harmonie avec ce qui est déjà devenue réalité et existe « devant nous ». Ce qui est implicite dans l’idée de responsabilité, c’est l’image de l’homme comme être naturel qui est entré en dialogue et agit (uniquement) en réponse à une action en rapport avec lui. »38 Une éthique de la responsabilité pourrait donc, en un sens, , être appelée une éthique écologique.
Dans le même temps, le concept de responsabilité de Niebuhr (comme celui de Max Weber avant lui) pourrait facilement devenir la proie de cultures technologiquement très développées avec une connotation utilitaire clairement exprimée. Max Weber oppose ce qu’il appelle l’éthique des fins ultimes à l’éthique de la responsabilité. Serait. Il serait peut-être plus correct d’appeler l’éthique des buts ultimes de Weber l’éthique des intentions, et le concept de responsabilité éthique (axée sur les conséquences des activités techniques de la société et de l’homme) comme une complexité d’un type différent. Et lorsque cette complexité prend un caractère techniquement défini (même si ni Weber ni Niebuhr n'ont envisagé cet aspect de l'éthique de la responsabilité), il faut prendre en compte la complexité naissante de la situation technique et coordonner objectivement, sans parti pris, les actions techniques avec motifs raisonnables. Il est impossible de ne pas remarquer ce qui est devenu réalité. Par ailleurs, il est bien connu qu’en politique sociale, il est assez facile de défendre le principe de responsabilité, en faisant référence au maintien du statu quo comme garantie de stabilité. Cette approche est possible même dans les cas où certains chiffres procèdent de tout à fait de bonnes intentions. C’est ce qui s’est produit, par exemple, avec les auteurs de la collection « Technologie responsable : une perspective chrétienne » (Technologie responsable : une perspective chrétienne, 1986), publiée par le Calvinist Center for Christian Scholars.
Toute action radicale peut se révéler « non responsable » car liée à un seul aspect de la problématique étudiée. La responsabilité peut facilement acquérir les caractéristiques du conservatisme en raison de son caractère unidimensionnel, et le conservatisme n'est pas dans le sens d'un mode de vie qui rejette uniquement la technique et la technologie, mais dans le sens de la défense de tout statu quo existant.
4 OBLIGATIONS TECHNIQUES – UN ASPECT ESSENTIEL DE LA VIE HUMAINE
L’introduction de la technologie moderne a conduit à l’expansion et à la transformation de l’ensemble du domaine de la responsabilité. Cela se manifestait par une attitude à la fois négative, réactive et positive (créative) à l'égard de la technologie, dans laquelle la responsabilité avait déjà été établie et l'attention était concentrée sur les problèmes liés à des types particuliers de responsabilité. Divers aspects des changements survenus se reflètent dans des domaines tels que la responsabilité juridique, la conscience sociale des scientifiques, l'éthique professionnelle des ingénieurs, ainsi que dans les discussions théologiques et les études philosophiques.
Deux considérations supplémentaires suggèrent que le développement du concept de responsabilité peut avoir été, dans une certaine mesure, un stimulateur du développement technologique. Prenons comme exemple le droit de la responsabilité délictuelle, en vertu duquel les dommages et préjudices corporels résultant d'une interaction humaine cessent d'être de la responsabilité de la partie lésée et sont soumis à une indemnisation de la part de ceux qui en sont responsables. Il est à noter qu'avant l'adoption de la loi, l'ordre social était maintenu par la foi en une réalité spirituelle, la souffrance personnelle était justifiée par un objectif plus élevé ou le châtiment de la souffrance était effectué à un niveau transcendantal. Cette loi marque un déplacement du centre de gravité vers ce monde (et ce n’est pas si loin de ce qui détermine l’essence intérieure de la technologie).
De même, lorsqu'Emmanuel Kant, après avoir démontré la limitation de la raison théorique aux formes de l'expérience et proclamé la primauté de la raison pratique, caractérise l'homme comme « un sujet qui peut être tenu responsable (Zurcscliming) de ses actes », il reconnaît en réalité la nécessité de pour des obligations techniques en tant qu'aspect de la vie morale d'une personne. Cependant, quelles que soient les réflexions auxquelles nous amènent ces exemples, l’opinion générale semble être que les changements survenus ne sont en aucun cas catastrophiques et peut-être même très favorables. La plupart des gens sont convaincus que la responsabilité est une bonne chose. Concluons donc en examinant une objection possible à notre thèse – une objection qui, à son tour, nous incitera à formuler deux affirmations un peu plus provocatrices. 120 L’une des raisons de l’inquiétude et des critiques générales à l’égard de certaines technologies est qu’elles peuvent priver les gens de leurs responsabilités, déformant ainsi le concept même de responsabilité. Henryk Skolimowski, par exemple, lance l'accusation suivante contre les ordinateurs : "Dans cette période historique, nous devons considérer le problème de la responsabilité en relation indissociable avec le problème de la technologie. La technologie, nous soustrayant constamment à la responsabilité, confiant tout à des experts, incarne le triomphe du mal. Car, si tout est fait pour nous, si nous ne sommes plus responsables de rien, alors nous ne pouvons plus être considérés comme des personnes.
Les conditions matérielles de l’activité technique s’écartent souvent grandement des constructions théoriques. Et pourtant, c’est précisément parce que, même au niveau idéal et théorique, la technologie implique un degré important de responsabilité que les Skolimowski peuvent ressentir si subtilement l’aspect pratique du problème. Par exemple, il n’est pas du tout évident que les ordinateurs privent les gens de la responsabilité qu’ils assumaient auparavant. Au contraire, ils ont rendu possible l’existence de certains types particuliers de responsabilité dans lesquels la destruction de la responsabilité peut effectivement se produire. Skolimowski milite précisément contre l’utilisation des ordinateurs lorsqu’elle pourrait menacer de mettre en péril de nouveaux types de responsabilité.
Nous ne devons pas oublier que le potentiel destructeur des temps modernes est si grand et que toute erreur de calcul menace de conséquences tellement inacceptables que des coûts bien plus élevés sont nécessaires pour développer et tester des systèmes de sécurité, pour étudier les conséquences à grande échelle de telles technologies, de ce que (contrairement à la production d’armes nucléaires) vous ne pouvez tout simplement pas refuser. Est-il possible de mettre en œuvre des mesures préventives dans la mesure requise ? Premièrement, les tests nécessaires peuvent nécessiter des dépenses si importantes qu’ils conduiront à l’abandon total de la production. Ainsi, certaines sociétés pharmaceutiques ont été contraintes d'arrêter de développer certains types de médicaments au seul motif que les coûts de réalisation des tests requis pour l'autorisation dépassaient le bénéfice escompté de la vente. Les travaux de Nicholas Rescher apportent de nombreuses preuves de l'existence de facteurs économiques limitant le rythme du progrès scientifique et technologique. Le coût des découvertes scientifiques réalisées à l’aide d’équipements techniques de plus en plus coûteux augmente régulièrement et, parallèlement, la part du revenu national brut utilisée pour couvrir ces coûts augmente également. Cela conduit inévitablement à un ralentissement du rythme des changements scientifiques.
Deuxièmement, le taux de déclin pourrait être encore plus élevé que ce que pense Rescher, étant donné la nécessité de prendre des précautions contre d’éventuels risques. Il est bien connu combien il est difficile de prévoir le risque afin de le minimiser lorsqu'il s'agit d'un impact potentiellement catastrophique, et cela est de plus en plus vrai pour presque toutes les nouvelles technologies, il peut être nécessaire de réaliser des études si complexes qu'elles peuvent il faudra alors étudier ces études.
La question de savoir si le développement technologique moderne n’exige pas trop de responsabilités de la part d’une personne devient inévitablement hypothétique si l’on considère la question d’un point de vue psychologique.
Wilfred Cantwell Smith, professeur de religion comparée à l'Université Harvard, dans un article sur la responsabilité, conclut qu'il existe un lien entre le concept de « responsabilité » et la théologie apocalyptique judéo-chrétienne-islamique. Reconnaissant le fait que le terme « responsabilité » a été introduit dans la circulation relativement récemment, Smith voit dans la promotion de ce terme dans la catégorie des catégories culturelles sociologiques et historiques un signe de correspondance avec le déclin de la métaphore du Jour du Jugement qui se produit en Occident. Il y a certaines raisons psychologiques et analytiques de voir dans le concept de responsabilité une forme sécularisée de croyance au jugement posthume de Dieu, ce qui est sans doute tout à fait cohérent avec le fait que, comme indiqué plus haut, le développement de la problématique de la responsabilité a commencé avec des théologiens sensibles à la sécularisation de la culture occidentale.
De plus, Smith n’est pas enclin à affirmer que le désir de trouver des expressions figuratives de la réalité morale derrière la métaphore du Jugement dernier est inhérent exclusivement à la tradition judéo-chrétienne-islamique. Il dit par exemple que la loi hindoue du karma représente un certain parallèle fonctionnel à cet égard, car elle met l'accent sur l'existence des conséquences de tout acte moral d'une personne. Certes, puisque de telles conséquences ne sont pas déterminées par la personne elle-même, qui est destinée à comparaître devant le tribunal de Dieu, il n'existait pas de doctrine de la responsabilité au sens strict et, par conséquent, de sa laïcisation, qui pourrait faire naître une idée de responsabilité similaire à celle occidentale. Et pourtant, la croyance au Jugement dernier et à la prédestination karmique témoigne, surtout si l'on considère sa domination séculaire sur de vastes territoires, de la dotation d'une personne avec un certain sentiment intérieur, qui a trouvé son expression dans des formes si différentes, incompatibles les unes avec les autres et en même temps, brillant et possédant une grande force conceptuelle, des enseignements. Toute tentative d’expliquer la nature humaine en ignorant ce sentiment moral qui nous habite, ajoute-t-il, pèche contre la vérité. Renforcer la responsabilité apparaît donc à l’auteur comme un bénéfice évident.
Dans le même temps, la position centrale de la doctrine du karma et de l'ensemble de la tradition judéo-chrétienne-islamique est la possibilité pour une personne de sortir du karma et d'éviter le jugement. La responsabilité est une indication ou un signe de vérité morale, seule la première approche est un concept étroit, et lorsqu'elle est absolutisée, elle met de côté et déforme la vérité. La justice de la responsabilité exige une miséricorde qui l'inspire et la dépasse.
CONCLUSIONS
Il est nécessaire d’explorer les conditions de solutions possibles aux problèmes liés à la technologie. Il existe une ferme conviction que plus le progrès technologique progresse, plus les problèmes liés à la gestion de ce progrès acquièrent un caractère éthique et spirituel.
La science est utilisée pour créer non seulement des forces productives plus avancées, mais aussi des forces destructrices de plus en plus puissantes. L'informatisation et l'utilisation généralisée des technologies de l'information dans divers types d'activités élargissent sans limite les capacités créatives d'une personne et lui présentent en même temps de nombreux dangers, à commencer par l'émergence de divers types de nouvelles maladies et se terminant par d'éventuelles situations de contrôle total. sur sa vie personnelle.
La responsabilité est une indication ou un signe de vérité morale. Et on peut retracer le lien de ce terme avec la théologie judéo-chrétienne-islamique du Jour du Jugement. La responsabilité est une question éthique centrale associée au développement de la technologie moderne.
Je crois que quiconque a choisi l'activité scientifique comme œuvre de sa vie doit développer un sens des responsabilités envers la société dans son ensemble. Mais la société ne doit pas considérer le processus scientifique comme l’œuvre d’autrui, et donc comme le seul responsable des conséquences de ce processus.
Si une personne deviendra un appendice de la technologie ou préservera son âme et ses sentiments, l'avenir nous le dira. Mais chacun de nous doit garder à l’esprit sa responsabilité personnelle envers lui-même et envers l’humanité. et alors, peut-être, il y aura une opportunité pour l’humanité de ne pas succomber à la « technisation » de l’âme.
LITTÉRATURE
1. V.F. Shapovalov Philosophie des sciences et des technologies : Sur le sens de la science et de la technologie et les menaces mondiales de l'ère scientifique et technologique : Manuel - M : FAIR PRESS, 2004 - 320 p.
2 Gorokhov V.G., Rozine V.M. Introduction à la philosophie de la technologie : Manuel. – M : INFRA – M., 1998. – 224p.
3. K. Mitcham Quelle est la philosophie de la technologie ? / Trans. de l'anglais édité par V.G. Gorokhova - M : Aspect Progrès, 1995. - 199 p.
4. Ortega y Gaset X. Déshumanisation de l'art et d'autres œuvres. – M., 1991. - 185 p.
RÉSUMÉ SUR LA DISCIPLINE
« CONCEPTS DES SCIENCES NATURELLES MODERNES »
SUR LE SUJET
« ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET RESPONSABILITÉ D’UN SCIENTIFIQUE »
Introduction
1 L'éthique des sciences comme problème mondial du 21e siècle
2 Le problème de la responsabilité du scientifique
3 Génie génétique : éthique et responsabilité des scientifiques
Conclusion
Liste de la littérature utilisée
Introduction
La situation de crises émergentes, typiques de l'ère moderne, dont les conséquences affectent le sort de larges masses de la population et représentent parfois des dangers de nature véritablement mondiale, imposent une responsabilité particulière à la science en tant que force impliquée dans l'émergence de telles crises. situations, et sur les créateurs de cette science, c'est-à-dire sur les scientifiques.
Nous entendons souvent des accusations contre la science et, par conséquent, contre les scientifiques, et c’est naturel. Après tout, une partie importante des crises résulte de l’utilisation de la technologie moderne dans l’économie qui en découle. Il est devenu un truisme que les progrès de la technologie, son développement et ses nouvelles formes reposent sur les réalisations des araignées. La science n’est pas seulement devenue l’une des forces productives des économies nationales et de l’économie mondiale dans son ensemble ; elle est, par essence, peut-être la plus puissante de ces forces, sinon directement, du moins indirectement, en tant qu’outil universel. source de nouvelles réalisations qui deviennent la base du développement et du progrès technique.
Les raisons des crises qui surviennent à notre époque, ainsi que l'imperfection de diverses structures économiques et sociales, résident dans un grand nombre de cas dans l'ambiguïté quantitative et qualitative des résultats du progrès technologique, qui ouvre la possibilité à la fois du utilisation raisonnable des acquis technologiques et leur utilisation au détriment de l'homme (industrie nucléaire et menace radiologique ; croissance incontrôlable de l'utilisation des ressources naturelles ; pouvoir croissant des médias ; flux de nouvelles substances médicinales, aux actions souvent loin d'être étudiées, etc. ).
Si l’on considère la cause profonde directe ou au moins indirecte de l’apparition de situations alarmantes dans les succès et les réalisations de la science, nous devons supposer que la science porte une certaine responsabilité dans l’évolution des conditions, même si elle n’en est évidemment pas la cause principale. Et de là, il s'ensuit évidemment qu'une responsabilité particulière incombe aux créateurs de la science, aux scientifiques qui, par leurs travaux, ouvrent la voie à l'émergence de conséquences négatives.
Il convient également de noter que « le dernier des espoirs de l'humanité, le plus haut et le plus grand idéal des Lumières - la Science, qui « peut tout faire » et « peut tout faire », qui « aidera » et « sauvera », ... on s'occupe aujourd'hui non seulement du développement de masse indirect et caché, mais aussi direct et immédiat des moyens les plus inhumains de violence scientifique, scientifiquement fondée, comme on dit maintenant, contre le corps et l'esprit de l'homme" 1 .
Les particularités de la révolution scientifique et technologique ne pouvaient qu'influencer la formulation des problèmes éthiques des sciences naturelles modernes, en particulier l'attitude des scientifiques face au problème de la responsabilité. Tant la formulation que la solution du problème de la responsabilité d'un naturaliste dépendent directement du problème plus général des relations entre science, moralité et éthique.
1 L’éthique des sciences comme enjeu mondialXXIsiècle
Bien que la science et la technologie soient aujourd'hui parmi les facteurs qui conduisent à la nécessité de créer une sorte d'éthique nouvelle ou universelle, cette tâche est peut-être impossible dans l'esprit positiviste, et il est d'autant plus alarmant d'entendre les avertissements des biologistes, des généticiens et des médecins que nous sommes confrontés au danger de destruction de l’humanité sous forme d’apparence, de déformation même de ses fondations corporelles.
L’assouplissement du pool génétique, les étapes frénétiques du génie génétique, qui ouvrent de nouveaux horizons, mais aussi des possibilités inquiétantes : la création du « Fantôme de Frankenstein », l’évasion de « gènes mutants » d’un contrôle susceptible de fausser l’évolution humaine. adaptations, la génération massive de mutants artificiels. La possibilité de briser le code génétique principal à la suite d’interventions mal conçues dans sa structure ne peut être exclue. Le fardeau génétique des populations humaines augmente. On enregistre partout un fort affaiblissement du système immunitaire humain sous l'influence des xénobiotiques et de nombreux stress sociaux et personnels.
Peut-être que l’éthique de la non-violence et du dialogue, issue d’une construction semi-exotique et naïve-utopique, deviendra l’un des points centraux de la pensée éthique et de la survie de l’humanité dans ce monde en évolution rapide. Par conséquent, les discussions qui ont lieu sur les aspects éthiques de la biologie, de la médecine et de la génétique n’ont pas seulement un intérêt purement théorique, mais aussi un intérêt pratique, qui nous concerne tous d’une manière ou d’une autre.
Dans la littérature scientifique, les concepts de « moralité » et d’« éthique » sont souvent utilisés de manière interchangeable (bien qu’ils ne soient pas identiques). Par exemple, nous disons : normes d'éthique professionnelle, éthique d'un scientifique, normes morales, morales, éthiques, etc. Cela se produit parce que la moralité elle-même, en tant que réalité, contient différents éléments étroitement liés les uns aux autres - conscience, relations, actions (activités), c'est-à-dire qu'elle contient également une certaine justification de ses normes et principes, tout comme la science de la moralité - l'éthique - ne se limite pas à une simple réflexion théorique passive du côté moral des mœurs, mais elle-même a un contenu normatif et développe des modèles de comportement spécifiques, justifiant ce qui devrait être fait.
Le terme « éthique » vient du grec ancien , , s(coutume, caractère, façon de penser) et a été reconnu dans les œuvres d'Aristote. L'équivalent latin de ce mot est mosmores(humeur, coutumes, caractère, comportement). Ainsi, avec le grec , (la doctrine des vertus), le latin apparaît moralité(degré de moralité d'une personne). Autrement dit, selon leur sens originel, le grec et le latin moralité Cependant, dans le processus de développement de la culture et de la philosophie, les termes « éthique » et « moralité » coïncident fondamentalement.
Les particularités de la révolution scientifique et technologique ne pouvaient qu'influencer la formulation des problèmes éthiques des sciences naturelles modernes, en particulier l'attitude des scientifiques face au problème de la responsabilité. Tant la formulation que la solution du problème de la responsabilité d'un naturaliste dépendent directement du problème plus général des relations entre science, moralité et éthique.
Pour désigner l’éventail le plus large possible de problèmes philosophiques, méthodologiques et sociologiques qui reflètent les divers aspects de cette interaction, le terme « éthique des sciences » est utilisé.
L'éthique d'un scientifique est un concept de portée plus étroite que l'éthique de la science, car elle couvre principalement les aspects régulateurs du fonctionnement de la moralité dans la science, justifie la moralité professionnelle des scientifiques et fait partie de l'un des aspects de l'éthique de science.
L'éthique des sciences est l'étude philosophique et sociologique de la relation entre science et morale :
a) en termes d'impact de la science sur la moralité, de la connaissance et du progrès scientifique sur la moralité, de la morale des personnes et du progrès moral de la société, de l'influence des valeurs de la science sur la moralité, de la relation entre la vérité et le bien, le vérité des phénomènes moraux ;
b) en termes d'impact de la moralité sur la science, des valeurs et des normes morales sur les attitudes à l'égard de la science et de ses résultats, la vision du monde d'un scientifique sur la connaissance de l'action de la moralité en tant que régulateur de l'activité scientifique et de la communication scientifique, divulgation du contenu de la responsabilité civile et morale des scientifiques.
Les normes de l'éthique scientifique s'incarnent dans des exigences et des interdits moraux universels, adaptés bien entendu aux particularités de l'activité scientifique.
Les normes éthiques servent à affirmer et à protéger des valeurs spécifiques caractéristiques de la science. Le premier d’entre eux est la recherche et la défense désintéressées de la vérité. Dans l’activité scientifique quotidienne, il n’est généralement pas facile d’évaluer immédiatement les connaissances acquises comme étant vraies ou erronées. Et cette circonstance se reflète dans les normes de l'éthique scientifique, qui n'exigent pas que les résultats soient de nouvelles connaissances, et d'une manière ou d'une autre justifiés logiquement, expérimentalement ou autrement. La responsabilité du respect de ces exigences incombe au scientifique lui-même 2 .
2 Le problème de la responsabilité du scientifique
Le problème de la responsabilité du scientifique envers la société suscite depuis longtemps une grande attention. Il est complexe et diversifié, comprend un nombre considérable de facteurs et est étroitement lié au problème plus large des aspects éthiques de la science, que nous n'aborderons pas ici.
Un scientifique, dans ses activités, porte naturellement, pour ainsi dire, une responsabilité de nature humaine universelle. Il est responsable de l'utilité du « produit » scientifique qu'il réalise : il est attendu de lui avec des exigences irréprochables quant à la fiabilité du matériel, à l'exactitude de l'utilisation des travaux de ses collègues, à la rigueur de l'analyse et à la solide validité des conclusions tirées. Ce sont des aspects élémentaires et évidents de la responsabilité d’un scientifique, pour ainsi dire, de son éthique personnelle.
La responsabilité d'un scientifique devient beaucoup plus large lorsque se pose la question des formes et des résultats de l'utilisation de ses travaux à travers la technologie et l'économie. Il est naïf de penser que les actions et le comportement d’un scientifique individuel affecteront l’émergence ou l’évolution d’une crise particulière. Nous parlons ici d'autre chose : de la voix de la communauté des scientifiques, de leur position professionnelle.
Les dernières décennies ont été marquées par le développement extraordinaire de la neurobiologie, au sein de laquelle de nouvelles orientations ont émergé et se développent avec succès, étudiant la structure et les fonctions du système nerveux central humain. Les résultats de ces études, à la fois d’une véritable signification scientifique et représentant des « sensations » hâtives, infondées ou clairement falsifiées, cachent le danger de leur utilisation inhumaine non pas dans le but de guérir des troubles mentaux, mais comme moyen de « modification du comportement ». Le développement rapide de la chimie et de la pharmacologie au cours des dernières décennies a enrichi la médecine d'un grand nombre de nouveaux médicaments actifs qui affectent le psychisme et le comportement humains. Les progrès de la neurochirurgie ont permis de réaliser des opérations délicates et complexes sur le cerveau. Toutes ces réalisations du progrès scientifique et technologique et le désir naturel des scientifiques de pénétrer les secrets du cerveau humain ont soulevé un certain nombre de problèmes moraux, éthiques et juridiques importants 3 .
L'une des caractéristiques de la science moderne est son rapprochement croissant avec la production ; la distance entre le moment de la découverte scientifique et sa mise en œuvre pratique diminue ; la responsabilité du scientifique augmente. Ce risque scientifique est nécessaire, sans lequel il est impossible de traduire les résultats de laboratoire et les conclusions scientifiques en production à grande échelle.
Ainsi, la question de l’application pratique des découvertes scientifiques pose le problème du risque, c’est-à-dire de la conscience du scientifique de la nécessité du courage, qui est l’une des formes spécifiques de manifestation de la responsabilité.
Les formes de manifestation du risque scientifique sont diverses, mais la question de celui-ci est toujours étroitement liée au problème de la responsabilité morale du scientifique. Lorsqu'un scientifique prend conscience de la possibilité ou de la nécessité d'un certain risque scientifique, la nature contradictoire de la liberté de créativité scientifique, d'une part, et de la responsabilité, d'autre part, se révèle.
La responsabilité d’un scientifique est l’envers de la liberté de sa créativité scientifique. D’un côté, la responsabilité est impensable sans liberté, de l’autre, la liberté sans responsabilité devient arbitraire.
Lorsqu'un scientifique moderne, armé de toute la puissance de la technologie moderne et soutenu par tous les « atouts » des États modernes, perd des critères moraux clairs, alors qu'il est « dans l'intérêt de la science », et non par moralité, et souvent par d'un intérêt purement « esthétique » pour le « cas », pour la découverte et la créativité, en tant que telle, invente des ensembles de poisons, d'armes atomiques, bactériennes, psychopathogènes et autres, c'est mortel pour l'humanité, sans parler du fait que c'est aussi mortel pour la science 4.
Parmi les domaines de la connaissance scientifique dans lesquels les questions de responsabilité sociale d'un scientifique et l'évaluation morale et éthique de ses activités sont particulièrement discutées avec acuité et intensité, une place particulière est occupée par le génie génétique, la biotechnologie, la recherche biomédicale et génétique humaine, toutes dont sont assez étroitement liés les uns aux autres.
C'est le développement du génie génétique qui a conduit à un événement unique dans l'histoire de la science : en 1975, les plus grands scientifiques du monde ont volontairement conclu un moratoire, suspendant temporairement un certain nombre d'études potentiellement dangereuses non seulement pour les humains, mais aussi pour d'autres formes de vie sur notre planète. Le moratoire a été précédé par une avancée majeure dans la recherche en génétique moléculaire. Cependant, l’autre aspect de cette percée dans le domaine de la génétique était les menaces potentielles qu’elle recèle pour l’homme et l’humanité. Ce genre de craintes a contraint les scientifiques à prendre une mesure sans précédent, comme l’instauration d’un moratoire volontaire. Cependant, les discussions autour des questions éthiques du génie génétique ne se sont pas apaisées5.
Le problème de la responsabilité d'un scientifique se pose avec beaucoup de clarté et de netteté lorsqu'il se trouve confronté à un dilemme « pour » ou « contre », comme ce fut le cas, par exemple, en médecine au début du XXe siècle, avec l'ouvrage historique d'Ehrlich. découverte de son premier remède radical contre la syphilis, le médicament « 606 ».
La science médicale et, avec elle, la pratique de l’époque étaient régies par le principe « avant tout de ne pas nuire », et cela apparaît encore aujourd’hui dans le « Serment d’Hippocrate ». Ehrlich a avancé et défendu courageusement un autre principe : « avant tout, soyez utile ». Ces principes s'adressent directement à la responsabilité, à la conscience du scientifique. Il est clair qu’ils dépassent largement le cadre de la seule science médicale et qu’ils revêtent la signification générale la plus large. De tels problèmes surviennent à maintes reprises et il n’existe pas de recette absolue. À chaque fois, les scientifiques doivent peser le pour et le contre et assumer la responsabilité de la manière de procéder.
Dans le cas d’Ehrlich, la responsabilité du scientifique était inhabituellement élevée, on pourrait dire gigantesque. D’un côté de l’échelle se trouvait une terrible maladie, qui se propageait partout de manière colossale. De l’autre côté se trouve un agent thérapeutique prometteur, mais totalement inconnu, avec le danger d’effets secondaires secondaires, peut-être graves. Mais la confiance en soi et dans la fiabilité des contrôles a contribué au triomphe du principe « avant tout, apporter des bénéfices ». Malgré le risque de dommages supposément possibles, une maladie grave et véritablement mondiale a été vaincue.
3 Génie génétique : éthique et responsabilité des scientifiques
Ces dernières années, les discussions sur le génie génétique ont pris un nouvel élan du fait que la possibilité d'une utilisation pratique des méthodes de génie génétique pour le traitement des maladies héréditaires est devenue réelle ; en même temps, la question du contrôle génétique entraîne déjà de nouveaux problèmes d'ordre socio-économique et moral-éthique.
Par thérapie génique, le chercheur allemand I. Reiter entend l'introduction de matériel génétique dans l'organisme afin de corriger des défauts. Certains scientifiques et chefs religieux s’opposent généralement à l’application de la technologie génétique aux humains, estimant qu’il existe une limite au-delà de laquelle nous ne pourrons plus contrôler le cours des événements. Dans le même temps, ceux qui souffrent de maladies héréditaires placent leurs espoirs dans la thérapie génique.
À cet égard, la question se pose à nouveau : la science peut-elle s'autoréguler au niveau éthique, dans quelle mesure est-elle capable de s'autocontrôler éthiquement ? En effet, même si les principes de l’éthique sont appliqués dans la science, qui sont en réalité conditionnés par une compréhension spécifique du bien de l’homme, on peut se demander comment s’opéreront le « retour d’information » et le contrôle sur la mise en œuvre de ces principes.
Les raisons de l’intérêt porté au génie génétique sont désormais claires. Le fait est qu'en plus de l'intérêt purement cognitif, le génie génétique a suscité un intérêt pratique - il est même désormais considéré comme un prototype des technologies futures (biotechnologie du futur). Le développement du génie génétique a contraint de nombreux scientifiques à réfléchir aux problèmes de responsabilité sociale de la science et aux possibilités de régulation sociale de la recherche scientifique.
Une personne acquiert un pouvoir qui doit être utilisé avec la plus grande prévoyance et prudence - c'est ce qui détermine en fin de compte le contenu socio-éthique de la recherche dans le domaine du génie génétique.
En général, le génie génétique est un système de méthodes expérimentales permettant de créer des structures génétiques artificielles, appelées molécules d'ADN recombinantes (hybrides). Les possibilités ouvertes par le génie génétique à l'humanité, notamment dans son sens appliqué, sont véritablement illimitées.
Il est cependant extrêmement important de prêter attention à l’autre aspect du génie génétique, à sa menace potentielle pour l’homme et l’humanité. En effet, puisque les manipulations qui sous-tendent ses méthodes affectent les mécanismes les plus intimes des processus d’autorégulation génétique et, in fine, la vie elle-même, il est clair que les biologistes moléculaires sont au bord d’un terrible abîme expérimental. Après tout, même la simple négligence de l’expérimentateur (n’est-ce pas ainsi que le sida est né ?) ou son incompétence en matière de mesures de sécurité peuvent entraîner des conséquences irréparables et constituer donc une menace sérieuse pour l’humanité toute entière. Ces méthodes peuvent causer des dommages encore plus graves entre les mains de divers types de maniaques malveillants et lorsqu'elles sont utilisées à des fins militaires.
Le débat sur le génie génétique a commencé avec des inquiétudes au début des années 1970. XXe siècle, un certain nombre de scientifiques ont participé à l'expérience prévue sur l'introduction du virus du cancer SV-40, qui provoque des tumeurs chez la souris et le hamster, dans une bactérie qui vit en permanence dans l'intestin humain. Sous leur forme naturelle, ce virus ainsi que la bactérie E. coli sont inoffensifs pour l'homme. Cependant, on craignait qu'avec le temps, ces bactéries puissent se retrouver en dehors du dispositif expérimental et introduire leur charge mortelle dans une cellule humaine vivante.
Les tentatives des chercheurs pour évaluer la probabilité d'une « épidémie de cancer » ont échoué en raison du manque d'informations nécessaires à cet effet. Dans cette situation, en juillet 1974. Un groupe de chercheurs pionniers dans le domaine du génie génétique, dirigé par Berg, a appelé les scientifiques du monde entier à imposer un moratoire sur la recherche scientifique dans deux des domaines les plus dangereux. Cela signifiait, d'une part, des expériences sur l'introduction de gènes de virus oncogènes, d'animaux et de toxines dans des bactéries, et d'autre part, des expériences de clonage ou de fusil de chasse ( fusil à pompe), gènes d'organismes supérieurs chez les bactéries. Il s'agissait d'un appel fort lancé à la communauté scientifique sur les questions d'autorégulation de l'activité scientifique. Il était soutenu en tout par de nombreux scientifiques.
Parallèlement à la croissance du mouvement visant à mettre fin aux expériences dangereuses dans le domaine du génie génétique, une recherche intensive est menée pour trouver des formes acceptables pour la poursuite des travaux de génie génétique.
Le génie génétique, peut-être plus fort et plus évident qu'à aucun moment dans le passé (y compris les discussions sur la menace de la recherche dans le domaine de la physique nucléaire), a attiré l'attention de l'humanité sur la nécessité d'un contrôle public (social et éthique) de tout. ce qui se passe en science et ce qui peut menacer directement les humains. Bien que certaines règles aient été adoptées pour les travaux de génie génétique, il n’est guère approprié d’en minimiser le danger potentiel.
Le développement du génie génétique et des domaines de connaissance connexes (et pas seulement) nous oblige à réfléchir de manière nouvelle et multiple à la relation dialectique entre liberté et responsabilité dans les activités des scientifiques.
Aujourd'hui, le principe de la liberté de la recherche scientifique doit être compris dans le contexte des conséquences loin d'être claires du développement de la science auxquelles les gens doivent faire face. Dans les discussions actuelles sur les problèmes sociaux et éthiques de la science, ainsi que sur la défense de la liberté illimitée de la recherche, un point de vue diamétralement opposé est également présenté, qui propose de réglementer la science. Tout cela montre à quel point le rôle des scientifiques est important dans le monde moderne. Ainsi, agissant avec conscience de sa responsabilité sociale, un scientifique doit s’efforcer d’anticiper les éventuels effets indésirables potentiellement inhérents aux résultats de ses recherches.
Conclusion
Il ne fait aucun doute qu'en cas de problèmes et de crises mondiales, les scientifiques devront à plusieurs reprises se tourner vers leur conscience et faire appel à leur sens des responsabilités afin de trouver la bonne voie pour surmonter les menaces émergentes. Et, bien sûr, c'est une question de conscience publique des scientifiques du monde entier, de responsabilité commune - combattre par tous les moyens possibles les causes qui entraînent des conséquences néfastes et désastreuses, orienter la recherche scientifique pour corriger les dommages causés par l'araignée elle-même, sans peser et sans prendre en compte les conséquences possibles, pourrait entraîner et se révéler ainsi impliqué dans l'émergence de certains problèmes mondiaux. Et la forme particulière de réaction qui a récemment été rencontrée face aux décisions difficiles qui se présentent à la conscience d'un scientifique ne doit être considérée que comme une capitulation, qui s'exprime dans la promotion des slogans de « contre-science » et de « contre-culture » avec un appel à suspendre l’avancée de la recherche scientifique.
Actuellement, des formes aussi larges de mouvements sociaux que la Fédération internationale des scientifiques, leurs associations professionnelles dans chaque pays, l'émergence d'organisations avec un objectif particulier clairement exprimé, comme la British Association for the Social Responsibility of Scientists (BSSRS), etc. , attirent de plus en plus l'attention. .d. Dans le développement de ce mouvement, nous voyons une forme importante de scientifiques démontrer leur responsabilité dans des périodes caractérisées par des problèmes particulièrement vastes à l’échelle mondiale affectant divers aspects de la société moderne.
Liste de la littérature utilisée
Baev A.A. Génome humain : quelques problèmes éthiques et juridiques du présent et du futur // Man, 1995. - N° 2. - pp.
Dawkins R. Le gène égoïste. - M. : Mir, 1993.
Karpenkov S.Kh. Le concept des sciences naturelles modernes : un manuel pour les universités. – M. : Culture et Sports, UNITÉ, 1997. – 520 p.
Koutyrev V.A. Savoir, ça ne se pardonne pas // Homme, n°1, 1993.
Lazar M.G. Ethique des sciences. - L. : Université d'État de Léningrad, 1985. - 125 p.
Medyantseva députée. La responsabilité d'un scientifique comme problème social et éthique. - Kazan : KSU, 1973. - 174 p.
Siluyanova I.V. Bioéthique et traditions idéologiques // Homme, n° 5, 1995.
Troubnikov N.K. Esprit trompé ? Diversité des connaissances extra-scientifiques. - M. : Politizdat, 1990. - 464 p.
Toulinov V.F. Concepts des sciences naturelles modernes : manuel pour les universités. – 2e éd., révisée. et supplémentaire - M. : UNITÉ-DANA, 2004. – 416 p.
Frolov I.T. Philosophie et histoire de la génétique : recherches et discussions. - M. : Nauka, 1985.
Frolov I.T., Yudin B.G. Aspects éthiques de la biologie. - M. -Connaissance, 1986.
Chavkin S. Mind Thieves : Psychochirurgie et contrôle de l'activité cérébrale. - M. : Progrès, 1982.
1 Troubnikov N.K. Esprit trompé ? Diversité des connaissances extra-scientifiques. - M. : Politizdat, 1990. - P.294.
"L'éthique" ne sont pas équivalentes. Éthique - la science sur la moralité, doctrine sur les normes de moralité et de moralité... honnêteté, rationalité, conscience, justice, humanisme, Responsabilité, le respect de l'honneur et de la dignité d'une personne, etc...
Moderne la science la philosophie, c'est enseignements et des notions
Aide-mémoire >> PhilosophieFondamental les sciences, comme ontologie - doctrine sur l'être en tant que tel, et la dialectique - doctrine oh... l'individualité a toujours attiré l'attention scientifiques. L'individualité est unique... acceptée par la société. Responsabilité- c'est une catégorie éthique et les droits, reflétant...
Performance
Responsabilité sociale et morale d'un scientifique.
Préparé
Sysuev Vadim Nikolaïevitch
Krivoï Rog
Les humanistes accordent de plus en plus d’attention à ce que les chercheurs occidentaux appellent parfois une « crise d’identité », c’est-à-dire la perte par une personne de l’idée de sa place dans une société moderne en constante évolution, de l’estime de soi de l’individu. Nous sommes confrontés à une menace incontestable, comme s'il s'agissait d'une réflexion générale sur les problèmes mondiaux qui touchent les larges masses de la population, jusqu'à l'humanité tout entière, mais en oubliant une chose, mais en fin de compte la plus importante. Quel est ce « un » ? C'est une personne, c'est une personnalité, un individu. Nous devons constamment nous souvenir de lui.
L’attention moderne est dirigée vers l’environnement extérieur et matériel. Ils veillent à sa préservation et s’efforcent d’éviter la pollution. Mais la vie requiert de toute urgence une attention particulière à « l’environnement interne » de la personnalité humaine, à ses aspects les plus profonds. Dans la recherche des formes d'activité les plus efficaces, il est naturel de concentrer l'attention sur les problèmes qui touchent les larges masses de la population, mais il faut aussi penser à l'individu, à la personnalité humaine, au monde spirituel de l'homme moderne.
La situation de crises émergentes, typiques de l'ère moderne, dont les conséquences affectent le sort de larges masses de la population et représentent parfois des dangers de nature véritablement mondiale, imposent une responsabilité particulière à la science en tant que force impliquée dans l'émergence de telles crises. situations, et sur les créateurs de cette science, c'est-à-dire sur les scientifiques.
On entend souvent des accusations contre la science, et donc contre les scientifiques, et c’est naturel. Après tout, une partie importante des crises résulte de l’utilisation de la technologie moderne dans l’économie qui en découle. Il est devenu un truisme que les progrès de la technologie, son développement et ses nouvelles formes reposent sur les réalisations des araignées. La science n’est pas seulement devenue l’une des forces productives des économies nationales et de l’économie mondiale dans son ensemble ; elle est, par essence, peut-être la plus puissante de ces forces, sinon directement, du moins indirectement, en tant qu’outil universel. source de nouvelles réalisations qui deviennent la base du développement et du progrès technique.
Les causes des crises qui surviennent à notre époque, ainsi que l'imperfection de diverses structures économiques et sociales, résident dans un grand nombre de cas dans l'ambiguïté quantitative et qualitative des résultats du progrès technologique, ce qui ouvre la possibilité à la fois utilisation raisonnable des acquis technologiques et leur utilisation au détriment de l'homme (industrie nucléaire et menace radiologique ; croissance incontrôlable de l'utilisation des ressources naturelles ; pouvoir croissant des médias ; flux de nouvelles substances médicinales, aux effets souvent loin d'être étudiés, etc. ). Si l’on considère la cause profonde directe ou au moins indirecte de l’apparition de situations alarmantes dans les succès et les réalisations de la science, nous devons supposer que la science porte une certaine responsabilité dans l’évolution des conditions, même si elle n’en est évidemment pas la cause principale. Et de là, il s'ensuit évidemment qu'une responsabilité particulière incombe aux créateurs de la science, aux scientifiques, qui, par leurs travaux, ouvrent la voie à l'émergence de conséquences négatives.
Le problème de la responsabilité du scientifique envers la société suscite depuis longtemps une grande attention. Il est complexe et diversifié, comprend un nombre considérable de facteurs et est étroitement lié au problème plus large des aspects éthiques de la science, que nous n'aborderons pas ici. Un scientifique, dans ses activités, porte naturellement, pour ainsi dire, une responsabilité de nature humaine universelle. Il est responsable de l'utilité du « produit » scientifique qu'il réalise : il est attendu de lui avec des exigences irréprochables quant à la fiabilité du matériel, à l'exactitude de l'utilisation des travaux de ses collègues, à la rigueur de l'analyse et à la solide validité des conclusions tirées. Ce sont des aspects élémentaires et évidents de la responsabilité d’un scientifique, pour ainsi dire, de son éthique personnelle. La responsabilité d'un scientifique devient beaucoup plus large lorsque se pose la question des formes et des résultats de l'utilisation de ses travaux à travers la technologie et l'économie. Il est naïf de penser que les actions et le comportement d’un scientifique individuel affecteront l’émergence ou l’évolution d’une crise particulière. Nous parlons ici d'autre chose : de la voix de la communauté des scientifiques, de leur position professionnelle.
Un exemple déjà largement connu et qui concerne l'action collective des scientifiques est la suspension volontaire convenue de la recherche dans un nouveau domaine scientifique: le génie génétique. Ici, une technique inconsidérée ou une négligence dans la « fuite » de matériel dangereux et potentiellement pathogène des laboratoires en raison d'une négligence accidentelle pourrait avoir des conséquences importantes, voire mondiales, jusqu'à l'émergence d'une nouvelle épidémie jusqu'alors inconnue, contre laquelle la médecine ne fait rien. pas encore les moyens de lutter. Cette question a été discutée lors d'une réunion spéciale convoquée à Azilomar (États-Unis). Au cours d'une discussion très animée, il a finalement été décidé de déclarer un moratoire, c'est-à-dire sur la suspension des recherches concernées en attendant l'élaboration de précautions soigneusement réfléchies pour garantir contre un danger éventuel.
Les opposants à cet événement étaient les partisans de la « liberté de la recherche scientifique », mais le bon sens a prévalu et, à l'heure actuelle, les règles de travail correspondantes ont été adoptées dans la plupart des pays, acquérant parfois même un caractère législatif. Ainsi, le « Moratoire Azilomar » sur l’Iran peut être considéré comme un prototype de scientifiques démontrant leur responsabilité face à un danger qui pourrait atteindre les proportions d’un désastre national généralisé, l’ampleur d’une crise.
Le problème de la responsabilité d'un scientifique se pose avec beaucoup de clarté et de netteté lorsqu'il est confronté à un dilemme « pour » ou « contre », comme ce fut le cas, par exemple, en médecine au début du siècle, avec la découverte historique par Ehrlich de son premier remède radical contre la syphilis - le médicament "606" " La science médicale et, avec elle, la pratique de l’époque étaient régies par un seul principe, qui apparaît encore aujourd’hui dans le « Serment d’Hippocrate ». C’est un principe devenu une loi incontestable : « avant tout, ne pas nuire ». Ehrlich a avancé et défendu courageusement un autre principe : « avant tout, soyez utile ». Ces principes s'adressent directement à la responsabilité, à la conscience du scientifique. Il est clair qu’ils dépassent largement le cadre de la seule science médicale et qu’ils revêtent la signification générale la plus large. De tels problèmes surviennent à maintes reprises et il n’existe pas de recette absolue. À chaque fois, les scientifiques doivent peser le pour et le contre et assumer la responsabilité de la manière de procéder.
Dans le cas d’Ehrlich, la responsabilité du scientifique était inhabituellement élevée, on pourrait dire gigantesque. D’un côté de l’échelle se trouvait une terrible maladie, qui se propageait partout de manière colossale. De l’autre côté se trouve un agent thérapeutique prometteur, mais totalement inconnu, avec le danger d’effets secondaires secondaires, peut-être graves. Mais la confiance en soi et dans la fiabilité des contrôles a contribué au triomphe du principe « avant tout, apporter des bénéfices ». Malgré le risque de dommages supposément possibles, une maladie grave et véritablement mondiale a été vaincue.
Il ne fait aucun doute qu'en cas de problèmes et de crises mondiales, les scientifiques devront à plusieurs reprises se tourner vers leur conscience et faire appel à leur sens des responsabilités afin de trouver la bonne voie pour surmonter les menaces émergentes. Et, bien sûr, c'est une question de conscience publique des scientifiques du monde entier, de responsabilité commune - combattre par tous les moyens possibles les causes qui entraînent des conséquences néfastes et désastreuses, orienter la recherche scientifique pour corriger les dommages causés par l'araignée elle-même, sans peser et sans prendre en compte les conséquences possibles, pourrait entraîner et se révéler ainsi impliqué dans l'émergence de certains problèmes mondiaux. Et la forme particulière de réaction qui a récemment été rencontrée face aux décisions difficiles qui se présentent à la conscience d'un scientifique ne doit être considérée que comme une capitulation, qui s'exprime dans la promotion des slogans de « contre-science » et de « contre-culture » avec un appel à suspendre l’avancée de la recherche scientifique.
On peut admettre que les scientifiques sont, dans une certaine mesure, responsables des ulcères qui ravagent et corrodent le corps de la société occidentale moderne, même si cela s'exprime dans leur non-participation, dans leur désir d'échapper, pour ainsi dire, à leurs responsabilités. une nouvelle forme de « non-ingérence » des autres membres de la communauté mondiale des scientifiques. Beaucoup d’entre nous, les couches les plus âgées, se souviennent des fruits désastreux qu’a apporté le principe malheureux de non-intervention dans le domaine de la politique internationale, qui a conduit à l’incendie de la Seconde Guerre mondiale à l’époque de Munich. Il porte en lui des graines maléfiques lorsqu’il devient la norme de comportement pour un scientifique.
Le mouvement en faveur d’une responsabilité collective parmi les scientifiques doit être salué. Actuellement, des formes aussi larges de mouvements sociaux que la Fédération internationale des scientifiques, leurs associations professionnelles dans chaque pays, l'émergence d'organisations avec un objectif particulier clairement exprimé, comme la British Association for the Social Responsibility of Scientists (BSSRS), etc. , attirent de plus en plus l'attention. .d. Dans le développement de ce mouvement, nous voyons une forme importante de scientifiques démontrer leur responsabilité dans des périodes caractérisées par des problèmes particulièrement vastes à l’échelle mondiale affectant divers aspects de la société moderne.
Le problème de la responsabilité d'un scientifique envers la société est complexe et diversifié, il comprend un nombre considérable de facteurs et est étroitement lié au problème plus large des aspects éthiques de la science.
Dans ses activités, un scientifique porte naturellement une responsabilité de nature humaine universelle. Il est responsable de l'utilité du « produit » scientifique qu'il réalise : il est attendu de lui avec des exigences irréprochables quant à la fiabilité du matériel, à l'exactitude de l'utilisation des travaux de ses collègues, à la rigueur de l'analyse et à la solide validité des conclusions tirées. Ce sont là des aspects élémentaires et évidents de la responsabilité du scientifique, de son éthique personnelle.
La responsabilité d'un scientifique devient beaucoup plus large lorsque se pose la question des formes et des résultats de l'utilisation de ses travaux à travers la technologie et l'économie. Il est naïf de penser que les actions et le comportement d’un scientifique individuel affecteront l’émergence ou l’évolution d’une crise particulière. Nous parlons ici de la voix de la communauté des scientifiques, de leur position professionnelle.
La responsabilité d’un scientifique est l’envers de la liberté de sa créativité scientifique. D’un côté, la responsabilité est impensable sans liberté, de l’autre, la liberté sans responsabilité devient arbitraire.
L’une des conditions et caractéristiques nécessaires au développement de la science est la liberté de créativité scientifique. Sous tous ses aspects - psychologique (libre arbitre), épistémologique (la liberté comme nécessité reconnue), socio-politique (liberté d'action), interconnecté, la liberté dans le domaine de la science se manifeste sous des formes spécifiques et constitue une base nécessaire pour responsabilité non seulement du scientifique, mais aussi de l’humanité dans son ensemble.
La liberté doit se manifester non seulement à l'extérieur et avec l'aide de la science, mais aussi à l'intérieur d'elle-même dans toutes les formes de liberté de pensée (pose de problèmes scientifiques, imagination scientifique, prospective, etc.), liberté de choix des objets de recherche et des méthodes de recherche scientifique. travail, liberté d'action, liberté sociale du scientifique en tant qu'individu.
L'une des manifestations de la liberté de créativité scientifique, et donc de responsabilité, est la capacité d'un scientifique à se libérer des opinions préconçues, la capacité d'analyser pratiquement son propre travail et de traiter favorablement le travail des autres, de voir les grains de vérité dans il. Le doute constant quant à l’exactitude et à la fiabilité des conclusions et des découvertes est l’un des fondements de l’intégrité scientifique, le sens des responsabilités du scientifique quant à la véracité de ses opinions scientifiques. La victoire du doute, précédée d'un travail intensif de réflexion pour vérifier les conclusions, exprime une véritable liberté de créativité.
Il convient de noter que l'activité scientifique requiert certaines qualités de la part d'une personne. Il ne s’agit pas seulement d’un travail acharné, d’une curiosité et d’une obsession sans limites, mais aussi d’un grand courage civique. Un vrai scientifique mène une lutte sans compromis contre l'ignorance, défend les germes du nouveau et du progressiste contre les tentatives de préservation de vues et d'idées dépassées. L’histoire des sciences conserve soigneusement les noms de scientifiques qui, sans épargner leur vie, ont lutté contre une vision du monde arriérée qui a entravé le progrès de la civilisation. Giordano Bruno, grand penseur et matérialiste qui a hardiment déclaré l'infinité de l'Univers, a été brûlé vif par l'Inquisition.
Dans une société d'exploitation, la science et les scientifiques avaient et ont encore un ennemi de plus : le désir de ceux qui sont au pouvoir d'utiliser le travail des scientifiques dans le but de leur enrichissement et à des fins de guerre. Lorsqu'un scientifique moderne, armé de toute la puissance de la technologie moderne et soutenu par tous les « atouts » des États modernes, perd des critères moraux clairs, alors qu'il est « dans l'intérêt de la science » et non par moralité, et souvent par un intérêt purement « esthétique » pour le « cas », pour la découverte et la créativité, en tant que telle, invente des ensembles de poisons, d'armes atomiques, bactériennes, psychopathogènes, c'est mortel pour l'humanité, sans compter que c'est aussi mortel pour la science. responsabilité scientifique armes scientifiques
Parmi les domaines de la connaissance scientifique dans lesquels les questions de responsabilité sociale d'un scientifique et l'évaluation morale et éthique de ses activités sont particulièrement discutées avec acuité et intensité, une place particulière est occupée par le génie génétique, la biotechnologie, la recherche biomédicale et génétique humaine, toutes dont sont assez étroitement liés les uns aux autres.
C'est le développement du génie génétique qui a conduit à un événement unique dans l'histoire de la science : en 1975, les plus grands scientifiques du monde ont volontairement conclu un moratoire, suspendant temporairement un certain nombre d'études potentiellement dangereuses non seulement pour les humains, mais aussi pour d'autres formes de vie sur notre planète. Le moratoire a été précédé par une avancée majeure dans la recherche en génétique moléculaire. Cependant, l’autre aspect de cette percée dans le domaine de la génétique était les menaces potentielles qu’elle recèle pour l’homme et l’humanité. Ce genre de craintes a contraint les scientifiques à prendre une mesure sans précédent, comme l’instauration d’un moratoire volontaire. Cependant, les discussions autour des questions éthiques du génie génétique ne se sont pas apaisées.
Responsabilité des scientifiques envers la société dans le développement d'armes de destruction massive
Les scientifiques se sont toujours prononcés en faveur de la prévention des guerres et des effusions de sang, ainsi que de l’arrêt de l’utilisation de la technologie nucléaire. Ainsi, en décembre 1930, Albert Einstein exprimait la pensée : « S'il était possible d'amener seulement deux pour cent de la population mondiale à déclarer en temps de paix qu'ils refuseraient de se battre, la question des conflits internationaux serait résolue, car ce serait impossible d’emprisonner deux pour cent de la population mondiale, il n’y aurait pas assez de place pour eux dans les prisons de la terre entière. » Néanmoins, l'appel d'Einstein a laissé une marque notable : il s'agissait d'une étape inévitable et nécessaire dans le processus difficile par lequel les scientifiques réalisent leur devoir civique envers l'humanité.
A. Einstein et un certain nombre d'autres scientifiques éminents, dont Paul Langevin et Bertrand Russell, faisaient partie du comité d'initiative pour la préparation du Congrès mondial contre la guerre, tenu à Amsterdam en août 1932. Un pas important vers l’union des scientifiques contre la guerre a été réalisé par le congrès anti-guerre de Bruxelles en 1936. Lors de ce congrès, des représentants de la communauté scientifique de treize pays ont débattu de la question de la responsabilité des scientifiques face au danger militaire.
Dans une résolution adoptée par le comité scientifique du congrès, ils ont condamné la guerre comme portant atteinte au caractère international de la science et se sont engagés à diriger leurs efforts pour prévenir la guerre. Les participants au congrès ont appelé les scientifiques à expliquer les conséquences néfastes de l'utilisation des acquis scientifiques à des fins de guerre, à mener une propagande anti-guerre et à dénoncer les théories pseudo-scientifiques à l'aide desquelles certaines forces tentent de justifier la guerre.
Cette décision, prise à la veille de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas eu de conséquences pratiques graves, mais elle a obligé de nombreux scientifiques occidentaux à réfléchir aux causes socio-économiques de la guerre, au rôle que les scientifiques peuvent jouer dans l'éducation du grand public. public sur les causes et les conséquences de la guerre, en facilitant l'organisation de la résistance aux forces intéressées à déclencher une guerre.
Ces réflexions ont poussé les scientifiques antifascistes à agir, ce qui, du point de vue actuel, peut être considéré comme une manifestation du désir d’empêcher que les armes atomiques ne tombent entre les mains d’Hitler et de ses alliés.
L'Allemagne hitlérienne pouvait créer des armes nucléaires et les utiliser pour asservir des peuples - de nombreux scientifiques le pensaient, en particulier ceux qui avaient appris par la pratique ce qu'était le fascisme. Ils ont tout fait pour empêcher Hitler d’utiliser cette force puissante. Le courageux fils du peuple français, Frédéric Joliot-Curie, dont les recherches sur la fission du noyau d'uranium en deux fragments sous l'influence d'un neutron ont révélé le dernier maillon de la réaction en chaîne, a pris toutes les mesures pour empêcher les nazis de s'emparer du réserves d'uranium et d'eau lourde dont la France a besoin, création d'un réacteur nucléaire.
L'inquiétude quant au sort des nations et à la possibilité que l'Allemagne acquière des armes nucléaires a incité des scientifiques progressistes aux États-Unis, dont beaucoup étaient des réfugiés d'Europe, à faire appel au gouvernement américain en lui proposant de créer immédiatement une bombe atomique.
Cette décision fut prise et une organisation spéciale appelée Manhattan Project fut créée pour développer et fabriquer la bombe atomique. La direction de cette organisation a été confiée au général L. Groves, représentant du Pentagone.
Le 23 avril 1957, le célèbre scientifique, lauréat du prix Nobel, médecin et philosophe A. Schweitzer a attiré l'attention du public dans un discours diffusé par la radio norvégienne sur les conséquences génétiques et autres des essais d'armes nucléaires en cours. Joliot-Curie a soutenu cet appel, soulignant la nécessité urgente d'arrêter les explosions expérimentales d'armes nucléaires. Cet appel a reçu une réponse positive de la part des scientifiques de nombreux pays. Les scientifiques soviétiques ont également déclaré catégoriquement qu'ils soutenaient l'interdiction des armes nucléaires et exigeaient la conclusion d'un accord entre les pays sur la cessation immédiate des essais de bombes atomiques et à hydrogène, estimant que toute guerre nucléaire, où qu'elle se produise, se transformerait nécessairement en une guerre générale. guerre aux conséquences désastreuses pour l’humanité.
Un scientifique moderne ne peut être imaginé sans un sens élevé de citoyenneté, sans une responsabilité accrue à l'égard des résultats de ses activités, sans une préoccupation sérieuse pour le sort du monde et de l'humanité. Un scientifique, quelle que soit sa spécialité, doit, en toutes circonstances, considérer le souci du bien-être de l’humanité comme son devoir moral le plus élevé.
Responsabilité des scientifiques pour les développements dans le domaine du génie génétique et du clonage.
Le génie génétique est apparu dans les années 1970. en tant que branche de la biologie moléculaire associée à la création ciblée de nouvelles combinaisons de matériel génétique capables de se multiplier dans une cellule et de synthétiser des produits finaux. Un rôle décisif dans la création de nouvelles combinaisons de matériel génétique est joué par des enzymes spéciales qui permettent de couper la molécule d'ADN en fragments à des endroits strictement définis, puis de « coudre » les fragments d'ADN en un seul tout.
Le génie génétique a ouvert des perspectives pour la construction de nouveaux organismes biologiques - des plantes et des animaux transgéniques aux propriétés prédéfinies. L'étude du génome humain revêt également une grande importance.
La responsabilité des scientifiques lors du développement du génie génétique peut être caractérisée par le fait qu'ils doivent maintenir la confidentialité des informations génétiques sur des personnes spécifiques. Par exemple, certains pays ont des lois restreignant la diffusion de ces informations.
Bien que des travaux importants aient été réalisés en laboratoire pour créer des microbes transgéniques dotés d'une grande variété de propriétés, les scientifiques ont la responsabilité publique de garantir que les microbes transgéniques ne sont pas utilisés à l'air libre. Cela est dû à l’incertitude quant aux conséquences que peut entraîner un processus aussi fondamentalement incontrôlable. De plus, le monde des micro-organismes lui-même a été extrêmement mal étudié : la science connaît, au mieux, environ 10 % des micro-organismes, et pratiquement rien du reste ; les modèles d'interaction entre les microbes, ainsi qu'entre les microbes et d'autres organismes biologiques , n’ont pas été suffisamment étudiés. Ces circonstances et d'autres déterminent le sentiment accru de responsabilité des microbiologistes, exprimé non seulement envers les micro-organismes transgéniques, mais aussi envers les organismes biologiques transgéniques en général.
Il ne faut pas non plus sous-estimer l’importance de la prise de conscience de la responsabilité des scientifiques impliqués dans le clonage. Récemment, de nombreuses prédictions, souhaits, suppositions et fantasmes sur le clonage d'organismes vivants se sont répandus dans les médias. Le débat sur la possibilité du clonage humain confère à ces discussions une urgence particulière. Les aspects technologiques, éthiques, philosophiques, juridiques, religieux et psychologiques de ce problème, ainsi que les conséquences qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre de cette méthode de reproduction humaine, sont intéressants.
Bien entendu, les scientifiques se défendent par le fait qu'au XXe siècle de nombreuses expériences réussies ont été menées sur le clonage d'animaux (amphibiens, certaines espèces de mammifères), mais toutes ont été réalisées grâce au transfert de noyaux d'embryons (indifférenciés ou partiellement). cellules différenciées). On croyait qu'il était impossible d'obtenir un clone en utilisant le noyau d'une cellule somatique (entièrement différenciée) d'un organisme adulte. Pourtant, en 1997, des scientifiques britanniques annoncent une expérience réussie et sensationnelle : la production d'une progéniture vivante (Dolly la brebis) après le transfert d'un noyau prélevé dans la cellule somatique d'un animal adulte.
Une attention particulière devrait être accordée à la responsabilité du clonage humain. Bien qu'il n'existe pas encore de capacités techniques permettant de cloner une personne, le clonage humain semble en principe être un projet tout à fait réalisable. Et ici se posent de nombreux problèmes non seulement scientifiques et technologiques, mais aussi éthiques, juridiques, philosophiques et religieux.
Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie
Agence fédérale pour l'éducation
Université économique d'État de Rostov"RINH"
Département financier
Essai
Par discipline "Concepts des sciences naturelles modernes"
Sur le thème de : "Le problème de la responsabilité sociale d'un scientifique"
Effectué :
Étudiant de 2ème année, groupe 526
Tchaïkovskaya Daria Dmitrievna
Vérifié:
maître assistant
Kirsanova Olga Timofeevna
Rostov-sur-le-Don, 2010
Contenu:
1)Introduction…………………………………………………………………….. 3
2)Responsabilité des scientifiques……………………………………………………………... 3
3) Responsabilité sociale des scientifiques……………………………………. 5
4) Conclusion…………………………………………… ………………….13
5) Liste de la littérature utilisée……………………………………14
Introduction
La situation de crises émergentes, typiques de l'ère moderne, dont les conséquences affectent le sort de larges masses de la population et représentent parfois des dangers de nature véritablement mondiale, imposent une responsabilité particulière à la science en tant que force impliquée dans l'émergence de telles crises. situations, et sur les créateurs de cette science, c'est-à-dire sur les scientifiques.
Nous entendons souvent des accusations contre la science et, par conséquent, contre les scientifiques, et c’est naturel. Après tout, une partie importante des crises résulte de l’utilisation de la technologie moderne dans l’économie qui en découle.
Les particularités de la révolution scientifique et technologique ne pouvaient qu'influencer la formulation des problèmes éthiques des sciences naturelles modernes, en particulier l'attitude des scientifiques face au problème de la responsabilité. Tant la formulation que la solution du problème de la responsabilité d'un naturaliste dépendent directement du problème plus général des relations entre science, moralité et éthique.
Le problème de la responsabilité du scientifique
Le problème de la responsabilité du scientifique envers la société suscite depuis longtemps une grande attention. Elle est complexe et diversifiée, elle comprend un nombre considérable de facteurs et est étroitement liée au problème plus large des aspects éthiques de la science, que nous n'aborderons pas ici.
Un scientifique, dans ses activités, porte naturellement, pour ainsi dire, une responsabilité de nature humaine universelle. Il est responsable de l'utilité du « produit » scientifique qu'il réalise : il est attendu de lui avec des exigences irréprochables quant à la fiabilité du matériel, à l'exactitude de l'utilisation des travaux de ses collègues, à la rigueur de l'analyse et à la solide validité des conclusions tirées. Ce sont des aspects élémentaires et évidents de la responsabilité d’un scientifique, pour ainsi dire, de son éthique personnelle.
La responsabilité d'un scientifique devient beaucoup plus large lorsque se pose la question des formes et des résultats de l'utilisation de ses travaux à travers la technologie et l'économie. Il est naïf de penser que les actions et le comportement d’un scientifique individuel affecteront l’émergence ou l’évolution d’une crise particulière. Nous parlons ici d'autre chose : de la voix de la communauté des scientifiques, de leur position professionnelle.
Les dernières décennies ont été marquées par le développement extraordinaire de la neurobiologie, au sein de laquelle de nouvelles orientations ont émergé et se développent avec succès, étudiant la structure et les fonctions du système nerveux central humain. Les résultats de ces études, à la fois d’une véritable signification scientifique et représentant des « sensations » hâtives, infondées ou clairement falsifiées, cachent le danger de leur utilisation inhumaine non pas dans le but de guérir des troubles mentaux, mais comme moyen de « modification du comportement ». Le développement rapide de la chimie et de la pharmacologie au cours des dernières décennies a enrichi la médecine d'un grand nombre de nouveaux médicaments actifs qui affectent le psychisme et le comportement humains. Les progrès de la neurochirurgie ont permis de réaliser des opérations délicates et complexes sur le cerveau. Toutes ces réalisations du progrès scientifique et technologique et le désir naturel des scientifiques de pénétrer les secrets du cerveau humain ont soulevé un certain nombre de problèmes moraux, éthiques et juridiques importants.
Le problème de la responsabilité d'un scientifique se pose avec beaucoup de clarté et de netteté lorsqu'il se trouve confronté à un dilemme « pour » ou « contre », comme ce fut le cas, par exemple, en médecine au début du XXe siècle, avec l'ouvrage historique d'Ehrlich. découverte de son premier remède radical contre la syphilis, le médicament « 606 ».
La science médicale et, avec elle, la pratique de l’époque étaient régies par le principe « avant tout de ne pas nuire », et cela apparaît encore aujourd’hui dans le « Serment d’Hippocrate ». Ehrlich a avancé et défendu courageusement un autre principe : « avant tout, soyez utile ». Ces principes s'adressent directement à la responsabilité, à la conscience du scientifique. Il est clair qu’ils dépassent largement le cadre de la seule science médicale et qu’ils revêtent la signification générale la plus large. De tels problèmes surviennent à maintes reprises et il n’existe pas de recette absolue. À chaque fois, les scientifiques doivent peser le pour et le contre et assumer la responsabilité de la manière de procéder.
Dans le cas d’Ehrlich, la responsabilité du scientifique était inhabituellement élevée, on pourrait dire gigantesque. D’un côté de l’échelle se trouvait une terrible maladie, qui se propageait partout de manière colossale. De l’autre côté se trouve un agent thérapeutique prometteur, mais totalement inconnu, avec le danger d’effets secondaires secondaires, peut-être graves. Mais la confiance en soi et dans la fiabilité des contrôles a contribué au triomphe du principe « avant tout, apporter des bénéfices ». Malgré le risque de dommages supposément possibles, une maladie grave et véritablement mondiale a été vaincue.
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES SCIENTIFIQUES
Quelle devrait être la responsabilité sociale des scientifiques ? Contrairement aux professionnels, la responsabilité sociale des scientifiques se concrétise dans la relation entre la science et la société. Par conséquent, elle peut être caractérisée comme une éthique externe (parfois appelée sociale) de la science. Il convient de garder à l'esprit que dans la vie réelle des scientifiques, les problèmes d'éthique interne et externe des sciences, de responsabilité professionnelle et sociale des scientifiques sont étroitement liés. Bien sûr, l'intérêt pour les problèmes de responsabilité sociale des scientifiques ne s'est pas posé aujourd'hui, mais au cours des 20 à 25 dernières années, ce domaine d'étude scientifique est apparu sous un tout nouveau jour. Et aujourd'hui, alors que les fonctions sociales de la science se multiplient et se diversifient rapidement, alors que le nombre de canaux reliant la science à la vie de la société ne cesse de croître, la discussion des problèmes éthiques de la science reste l'un des moyens importants d'identifier ses changements sociaux et sociaux. caractéristiques de valeur.
M. Born, en parlant dans ses mémoires, a noté que « des changements se sont produits dans la science réelle et son éthique qui rendent impossible la préservation du vieil idéal de servir la connaissance pour elle-même, l'idéal auquel croyait ma génération. Nous étions convaincus que cela ne pourrait jamais tourner au mal, puisque la recherche de la vérité est une bonne en soi. C’était un beau rêve dont les événements mondiaux nous ont réveillés. Cela fait principalement référence aux explosions nucléaires américaines sur les villes japonaises. Le mouvement écologiste, qui s'est manifesté avec acuité dès le début des années 60, a joué un rôle majeur en attirant l'attention du public sur les conséquences de l'utilisation des acquis scientifiques et technologiques. À l’heure actuelle, l’inquiétude s’éveille dans la conscience publique en raison de la pollution croissante de l’environnement et de l’épuisement des ressources naturelles de la planète, ainsi que de l’aggravation générale des problèmes mondiaux. C’est la responsabilité sociale des scientifiques qui a été l’impulsion initiale qui leur a fait prendre, puis à l’opinion publique, la gravité de la situation qui menace l’avenir de l’humanité. Contrairement à l’exemple précédent, dans ce cas, l’attitude responsable des scientifiques s’est manifestée avant même que la situation – prise dans son ensemble – ne devienne irréparable. De plus, si dans le premier cas les représentants de seulement certains domaines de la physique étaient directement impliqués dans le développement tragique des événements, alors le mouvement environnemental s'est avéré être essentiellement un mouvement scientifique général, affectant les représentants de divers domaines de la connaissance. Comme on le voit, la responsabilité sociale des scientifiques s'avère être l'un des facteurs déterminant les tendances du développement de la science, des disciplines individuelles et des domaines de recherche.
Encore un fait. Dans les années 70, les résultats et les perspectives de la recherche biomédicale et génétique ont suscité un large écho. Le moment culminant a été l'appel d'un groupe de biologistes moléculaires et de généticiens dirigé par P. Berg (États-Unis) pour déclarer un moratoire volontaire (interdiction) sur de telles expériences dans le domaine du génie génétique qui pourraient constituer un danger potentiel pour la constitution génétique de les organismes vivants. L'essence du problème est que les molécules d'ADN recombinantes (hybrides) créées en laboratoire, capables d'être intégrées dans les gènes de n'importe quel organisme et de commencer à agir, peuvent donner naissance à des formes de vie totalement sans précédent et, éventuellement, potentiellement dangereuses pour les personnes existantes. espèces. Dans les discussions qui ont suivi, les sujets abordés étaient les normes et réglementations éthiques susceptibles d'influencer à la fois l'orientation générale et le processus de recherche lui-même.
L'annonce du moratoire a été un événement sans précédent pour la science : pour la première fois, des scientifiques ont décidé, de leur propre initiative, de suspendre des recherches qui leur promettaient des succès colossaux. Depuis l'annonce du moratoire, d'éminents scientifiques dans le domaine ont élaboré un système de précautions pour garantir la conduite sécuritaire des recherches. Cet exemple est significatif dans le sens où les scientifiques, faisant appel à leurs collègues et à l'opinion publique, ont tenté pour la première fois d'attirer l'attention non pas en promettant les bénéfices que l'on peut attendre de ce domaine de recherche scientifique, mais en mettant en garde contre dangers possibles. Cela signifie que la manifestation d'un sentiment de responsabilité et d'intérêt social agit non seulement comme une forme de comportement socialement acceptable, mais aussi socialement reconnue et, de plus, socialement stimulée pour les scientifiques. Il est ensuite apparu clairement que les dangers potentiels des expériences en général avaient été exagérés. Toutefois, cela n’était pas du tout évident lorsque la proposition de moratoire a été présentée. Et la connaissance que la science possède aujourd'hui de la sécurité de certaines expériences et des dangers d'autres est elle-même le résultat de recherches scientifiques menées précisément à la suite du moratoire. Grâce au moratoire, de nouvelles données scientifiques, de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes expérimentales ont été obtenues, ce qui a permis de diviser les expériences en classes selon leur degré de dangerosité potentielle, ainsi que de développer des méthodes d'obtention de virus affaiblis qui ne peuvent que existent dans un environnement de laboratoire artificiel. Nous voyons ainsi que la responsabilité sociale des scientifiques n’est pas quelque chose d’extérieur, une sorte d’appendice anormalement associé à l’activité scientifique. Au contraire, il s'agit d'une composante organique de l'activité scientifique, qui influence de manière assez significative les problématiques et les orientations de la recherche.
Nous pouvons remarquer que les problèmes de responsabilité sociale des scientifiques sont non seulement précisés, mais aussi, dans un certain sens, universalisés : ils se posent dans diverses sphères de la connaissance scientifique. Ainsi, on peut difficilement considérer qu’un domaine scientifique quelconque soit en principe et à tout moment assuré de ne pas se heurter à ces problèmes loin d’être simples. D’une certaine manière, un scientifique ne peut être tenu responsable des conséquences de ses recherches puisque, dans la plupart des cas, il ne prend pas les mesures décisives.
etc.................