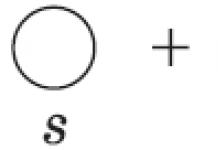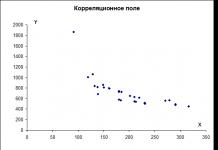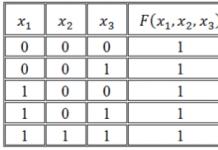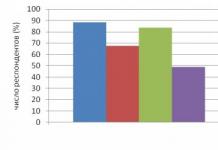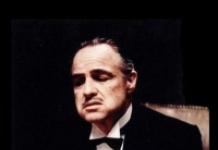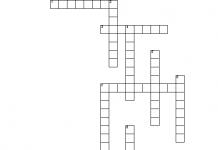Kojebash Elena Romanovna. (Transnistrie Université d'État. Département d'histoire. 5 cours)
Introduction
empire Byzantin, Byzance, Empire romain d'Orient (395 -1453) - un État qui a pris forme en 395. en raison de la division définitive de l'Empire romain après la mort de l'empereur Théodose Ier en parties occidentale et orientale. L'Empire romain d'Orient a reçu le nom de « Byzantin » dans les travaux des historiens d'Europe occidentale après sa chute ; il vient du nom original de Constantinople - Byzance, où l'empereur romain Constantin Ier a déplacé la capitale de l'empire en 330, renommant officiellement l'Empire romain d'Orient. ville Nouvelle Rome. Les Byzantins eux-mêmes s'appelaient Romains - en grec « Romains », et leur pouvoir - « l'Empire romain (« Romain ») » ou brièvement « Roumanie » (Ῥωμανία, Roumanie). Les sources occidentales l'ont appelé « l'Empire des Grecs » pendant la majeure partie de l'histoire byzantine en raison de sa prédominance de la langue grecque, de sa population et de sa culture hellénisées. DANS Rus antique Byzance était généralement appelée le « Royaume grec » et sa capitale était Constantinople.
La pertinence du thème choisi réside dans le fait que les relations entre Byzance et les Slaves étaient très étroites, très variées et très durables. Aucun autre État n’a probablement laissé une marque aussi profonde dans l’histoire et la culture russes. Les Slaves et Byzance sont exemple brillant comment une nation entière peut adopter traits de caractère Un pays.
Le but de cet ouvrage est de considérer les relations entre les Slaves et l'Empire byzantin aux VIe-VIIe siècles.
Sur la base de l'objectif fixé, les tâches suivantes ont été proposées :
- Caractériser l’État byzantin au cours de la période étudiée ;
- Déterminez les relations entre les Slaves et l’Empire byzantin dans la période VI – VII siècles.
- La formation de Byzance indépendante
La formation de Byzance en tant qu'État indépendant peut être attribuée à la période 330-518. Durant cette période, de nombreuses tribus barbares, principalement germaniques, pénétrèrent sur le territoire romain par-delà les frontières du Danube et du Rhin.
La situation à l'Est n'était pas moins difficile, et on pouvait s'attendre à une fin similaire, après qu'en 378 les Wisigoths eurent remporté la célèbre bataille d'Andrinople, que l'empereur Valens fut tué et que le roi Alaric dévasta toute la Grèce. Mais bientôt Alaric se dirigea vers l'ouest - vers l'Espagne et la Gaule, où les Goths fondèrent leur État, et le danger qu'ils représentaient pour Byzance était passé.
En 441, les Goths furent remplacés par les Huns. Leur chef Attila a déclenché une guerre à plusieurs reprises, et ce n'est qu'en payant un lourd tribut qu'il a été possible de l'acheter. Lors de la bataille des nations sur les champs catalauniens (451), Attila fut vaincu et son pouvoir se désintégra bientôt.
Dans la seconde moitié du Ve siècle, le danger vient des Ostrogoths : Théodoric le Grand ravage la Macédoine et menace Constantinople, mais il se dirige également vers l'ouest, conquiert l'Italie et fonde son État sur les ruines de Rome.
Dans le christianisme, divers courants se sont affrontés et se sont heurtés : l'arianisme, le nestorianisme, le monophysisme. Tandis qu'en Occident les papes, à commencer par Léon le Grand (440-461), instituèrent la monarchie papale, en Orient les patriarches d'Alexandrie, notamment Cyrille (422-444) et Dioscore (444-451), tentèrent d'établir la monarchie papale. trône papal à Alexandrie. En outre, ces troubles ont fait resurgir d’anciennes querelles nationales et des tendances séparatistes. Les intérêts et objectifs politiques étaient étroitement liés au conflit religieux.
A partir de 502, les Perses reprennent leurs assauts à l'est, les Slaves et les Bulgares lancent des raids au sud du Danube. Les troubles internes atteignirent leurs limites extrêmes et dans la capitale il y eut une lutte intense entre les partis « vert » et « bleu » (selon les couleurs des attelages de chars). Enfin, la forte mémoire de la tradition romaine, qui soutenait l’idée dela nécessité de l’unité du monde romain, tournait constamment les esprits vers l’Occident. Pour sortir de cet état d’instabilité, il fallait une main puissante, une politique claire avec des plans précis et définis. Contrairement aux pays d'Europe occidentale, Byzance a maintenu État unique avec un pouvoir impérial despotique. Tout le monde devait être impressionné par l'empereur, le glorifiant dans la poésie et les chansons. La sortie de l'empereur du palais, accompagné d'une brillante suite et de grands gardes, s'est transformée en une magnifique célébration. Il portait des robes de soie brodées d'or et de perles, une couronne sur la tête, une chaîne en or autour du cou et un sceptre à la main.
L'empereur avait un pouvoir énorme. Son pouvoir était hérité. Il était juge suprême, nommait les chefs militaires et les hauts fonctionnaires et recevait les ambassadeurs étrangers.
L’empereur dirigeait le pays avec l’aide de nombreux fonctionnaires. Ils ont essayé de toutes leurs forces d'acquérir de l'influence à la cour. Les cas des pétitionnaires ont été résolus grâce à des pots-de-vin ou à des relations personnelles.
Byzance pouvait défendre ses frontières contre les barbares et même mener des guerres de conquête. A la disposition d'un riche trésor, l'empereur entretenait une grande armée de mercenaires et une puissante marine. Mais il y a eu des périodes où un chef militaire majeur renversait lui-même l’empereur et devenait lui-même souverain.
- L'empereur Justinien et ses réformes. Empire byzantin sous Justinien
L'empire élargit surtout ses frontières sous le règne de Justinien (527-565). Intelligent, énergique, instruit, Justinien sélectionnait et dirigeait habilement ses assistants. Derrière son accessibilité extérieure et sa courtoisie se cachaient un tyran impitoyable et insidieux. Selon l'historien Procope, il pouvait, sans montrer de colère, « donner d'une voix douce et égale l'ordre de tuer des dizaines de milliers d'innocents ». Justinien avait peur des attentats contre sa vie, il croyait donc facilement aux dénonciations et n'hésitait pas à prendre des représailles.
La règle principale de Justinien était : « un État, une loi, une religion ». L'empereur accorda des terres et des cadeaux précieux à l'Église et construisit de nombreux temples et monastères. Son règne a commencé par une persécution sans précédent des païens, des juifs et des apostats des enseignements de l'Église. Leurs droits furent limités, ils furent démis de leurs fonctions et condamnés à mort.
La célèbre école d’Athènes, haut lieu de la culture païenne, a été fermée.
Pour introduire des lois uniformes pour tout l'empire, l'empereur créa une commission composée des meilleurs avocats. En peu de temps, elle a rassemblé les lois des empereurs romains, des extraits des œuvres d'éminents juristes romains avec une explication de ces lois, de nouvelles lois introduites par Justinien lui-même et a compilé un bref guide sur l'utilisation des lois.
Ces ouvrages ont été publiés sous le titre général « Code de droit civil ». Cet ensemble de lois préservait le droit romain pour les générations suivantes. Il a été étudié par les juristes du Moyen Âge et des Temps modernes, qui rédigeaient des lois pour leurs États.
Justinien a tenté de restaurer l'Empire romain dans ses anciennes frontières.
Profitant de la discorde dans le royaume vandale, l'empereur envoya une armée sur 500 navires pour conquérir l'Afrique du Nord. Les Byzantins vainquirent rapidement les Vandales et occupèrent la capitale du royaume, Carthage.
Justinien entreprit ensuite de conquérir le royaume Ostrogoth en Italie. Son armée occupa la Sicile, le sud de l'Italie et captura plus tard Rome. Une autre armée, venant de la péninsule balkanique, entra dans la capitale des Ostrogoths, Ravenne. Le royaume des Ostrogoths tomba.
Mais l'oppression des fonctionnaires et les vols de soldats ont provoqué des soulèvements. résidents locaux en Afrique du Nord et en Italie. Justinien fut contraint d'envoyer de nouvelles armées pour réprimer les soulèvements dans les pays conquis. Il a fallu 15 ans de lutte intense pour soumettre complètement l’Afrique du Nord, et en Italie, il a fallu environ 20 ans.
Profitant de la lutte intestine pour le trône dans le royaume wisigoth, l'armée de Justinien conquit la partie sud-ouest de l'Espagne.
Pour protéger les frontières de l'empire, Justinien construisit des forteresses à la périphérie, y plaça des garnisons et traça des routes menant aux frontières. Les villes détruites ont été restaurées partout, des conduites d'eau, des hippodromes et des théâtres ont été construits.
Après avoir envahi le royaume wisigoth en 554, Justinien conquit également la partie sud de l'Espagne. En conséquence, le territoire de l’empire a presque doublé. Mais ces succès nécessitèrent une trop grande dépense de forces, dont ne tardèrent pas à profiter les Perses, les Slaves, les Avars et les Huns qui, bien qu'ils ne conquièrent pas de territoires significatifs, dévastèrent de nombreuses terres à l'est de l'empire.
La diplomatie byzantine cherchait également à assurer le prestige et l'influence de l'empire dans le monde extérieur. Grâce à sa savante distribution de faveurs et d'argent et à son habile capacité à semer la discorde parmi les ennemis de l'empire, elle a mis sous domination byzantine les peuples barbares qui erraient aux frontières de la monarchie et les a mis en sécurité. Elle les a inclus dans la sphère d'influence de Byzance en prêchant le christianisme. Les activités des missionnaires qui répandirent le christianisme depuis les rives de la mer Noire jusqu'aux plateaux d'Abyssinie et aux oasis du Sahara furent l'un des traits les plus caractéristiques de la politique byzantine du Moyen Âge.
Outre l'expansion militaire, un autre la tâche la plus importante Justinien a mené des réformes administratives et financières. L’économie de l’empire était dans un état de crise grave et l’administration était en proie à la corruption. Afin de réorganiser l'administration de Justinien, une codification de la législation et un certain nombre de réformes furent réalisées qui, même si elles ne résolvèrent pas radicalement le problème, eurent sans aucun doute des conséquences positives. La construction a été lancée dans tout l'empire - la plus grande ampleur depuis « l'âge d'or » des Antonins. La culture connaît un nouvel épanouissement.
- Après Justinien. VI-VII siècles
Le territoire de Byzance vers 600. n. e. La carte montre les pertes territoriales de l'empire dans les péninsules ibérique et apennine.
Cependant, la grandeur a été achetée au prix fort : l'économie a été minée par les guerres, la population s'est appauvrie et les successeurs de Justinien (Justin II (565-578), Tibère II (578-582), Maurice (582-602)) ont été contraints de se concentrer sur la défense et de réorienter la politique vers l’Est. Les conquêtes de Justinien s'avèrent fragiles : à la fin des VIe-VIIe siècles, Byzance perd une partie importante des zones conquises à l'Ouest, conservant plusieurs territoires désunis en Italie, de grandes îles de la Méditerranée occidentale et l'Exarchat carthaginois.
Tandis que l'invasion des Lombards enleva à Byzance la moitié de l'Italie, l'Arménie fut conquise en 591 lors de la guerre avec la Perse, et au nord l'affrontement se poursuivit avec les Slaves et les Avars installés sur le Danube dans les années 560. Mais déjà au début du VIIe siècle suivant, les Perses reprirent lutte et a obtenu des succès significatifs à la suite de nombreux troubles dans l'empire.
En 610, le fils de l'exarque carthaginois Héraclius renverse l'empereur Phocas et fonde une nouvelle dynastie qui se montre capable de résister aux dangers qui menacent l'État. Ce fut l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de Byzance : les Perses conquirent l'Égypte, la Syrie et une partie de l'Asie Mineure et menacèrent Constantinople, les Avars, les Slaves et les Lombards attaquèrent les frontières de tous côtés. Héraclius a remporté une série de victoires sur les Perses, a transféré la guerre sur leur territoire, après quoi la mort de Shah Khosrow II et une série de soulèvements les ont forcés à abandonner toutes leurs conquêtes et à conclure la paix. Mais le grave épuisement des deux camps dans cette guerre prépara des conditions favorables aux conquêtes arabes.
- Invasion slave du territoire byzantin
La population de Byzance elle-même fut ruinée par des impôts insupportables. Selon l’historien, « les gens s’enfuirent en foule vers les barbares juste pour échapper à pays natal" Des soulèvements éclatèrent partout, que Justinien réprima brutalement.
À l’est, Byzance a dû mener de longues guerres avec l’Iran, voire céder une partie de son territoire à l’Iran et lui rendre hommage.
Byzance n'avait pas d'armée chevaleresque forte, comme dans Europe de l'Ouest, et a commencé à subir des défaites dans les guerres avec ses voisins. Peu après la mort de Justinien, Byzance perdit presque tous les territoires conquis en Occident. Les Lombards occupèrent la majeure partie de l'Italie et les Wisigoths reprirent leurs anciennes possessions en Espagne.
Les Slaves ont joué un rôle énorme dans le sort de l'empire.
Histoire slave aussi bien dans les premières étapes de son développement que jusqu'à sa formation Ancien État russeétait étroitement liée à Byzance. Influence culturelle ce dernier a laissé une marque puissante sur la vie des anciens Slaves. Mais il ne faut pas penser que les relations entre les Slaves et Byzance étaient unilatérales. Et Byzance a « reçu » le sien des Slaves, bien que pas toujours positif. Par exemple, elle a souffert de leurs attaques pendant plusieurs années. Et cela s'est reflété dans l'État et le système politique de Byzance. En conséquence, nous pouvons dire que les anciens Slaves et Byzance étaient en interaction constante.
Face à Byzance, les Slaves étudièrent la science militaire, alors que l'ennemi était à un stade digne de son développement. Il ne faut pas nier que les Slaves ont pillé sans pitié et beaucoup. La richesse des princes se reconstituait de plus en plus aux dépens de Byzance, mais des fonds considérables étaient également consacrés aux besoins militaires.
Les campagnes slaves contre Byzance ont eu lieu au début nouvelle ère. De plus, à cette époque, ils faisaient encore partie d’autres tribus. Ensemble, ils constituaient une force immense et destructrice.
Les Slaves attaquèrent pour la première fois l’Empire byzantin en 493. En passant par le Danube, ils pillèrent la Thrace. Quinze ans plus tard, ils étaient déjà partis vers les possessions du sud (l'invasion eut lieu en Macédoine, en Épire et en Thessalie). L’attaque suivante a eu lieu dix ans plus tard. Mais cela s'est avéré infructueux : les troupes de l'empire se sont révélées plus fortes. L'empereur Justinien ordonna la construction de huit fortifications. Pourtant, cet événement n’avait aucun sens : les campagnes se poursuivaient.
Vers 540, les Slaves s'intéressèrent à la capitale même de l'empire, la plus riche Constantinople (aujourd'hui Istanbul). Bien qu’ils n’aient pas réussi à prendre la ville, ils ont réussi à la piller et à la presque brûler.
Les chroniqueurs byzantins nous ont laissé des descriptions de guerriers slaves. Leurs armes étaient très primitives et maigres : une lance, un arc, des flèches et des boucliers. Ils ont habilement comblé cette lacune avec diverses astuces dans leur stratégie. Leurs embuscades étaient toujours inattendues. Eh bien, les Slaves auraient certainement pu surprendre l'ennemi.
L'une des campagnes majeures a eu lieu en 550. Puis les troupes slaves réussirent à prendre plusieurs villes de Macédoine, la ville fortifiée de Toper.
À la fin du VIe siècle, les Slaves commencèrent à s'intéresser aux friandises balkaniques de Byzance. Selon les contemporains, leur nombre était d'environ cent mille personnes.
La patience de l’empereur byzantin était loin d’être illimitée. Et ainsi, dans les années 590, les contre-attaques commencent. Les troupes byzantines traversent le Danube et envahissent les territoires slaves. Lors de leur première campagne, ils réussirent à dévaster les possessions des princes ennemis. La deuxième fois, les choses ne se sont pas très bien passées. Même si la victoire fut pour Byzance, elle fut très coûteuse.
Les plus vulnérables étaient le nord et le nord-ouest de l’Empire byzantin. À partir du VIe siècle, les Slaves firent de plus en plus souvent des campagnes, s'unissant aux Avars.
Comment Byzance s’est-elle comportée ? Premièrement, dans la capitale (Constantinople), les ambassadeurs Avar ont commencé à recevoir des cadeaux de valeur (or, argent, vêtements). Deuxièmement, l'empereur régnant Justinien à cette époque voulait simplement utiliser la force Avar pour vaincre les Slaves (ces derniers étaient considérés comme des barbares). Cependant, cette stratégie s’est avérée erronée. Par exemple, au milieu du VIe siècle, les Avars et les Slaves tentèrent de s'emparer d'une des villes de Byzance afin de renforcer leurs positions sur le Danube. En conséquence, tous deux pénétrèrent de plus en plus profondément dans les possessions de l'Empire byzantin.
Au fil du temps. Les Slaves de l'Est ont commencé à construire des navires. Et comme vous le savez, Byzance était située à proximité des mers. Et maintenant, les troupes slaves pillent les navires marchands ainsi que les villes côtières.
À la fin du IXe siècle, les Slaves orientaux se sont unis en un État (Kievan Rus). Lorsque le prince Oleg (le Prophète) est arrivé au pouvoir, la première campagne contre l'Empire byzantin a eu lieu en tant qu'entité politique fondamentalement nouvelle. De plus, la force des Slaves, leur organisation et leur discipline sont passées à une nouvelle étape. La campagne d'Oleg contre Constantinople s'est soldée par une défaite pour Byzance. Ces derniers ont dû signer un traité de paix défavorable afin de protéger d'une manière ou d'une autre la capitale.
Une autre campagne importante eut lieu au milieu du Xe siècle, lorsque le prince Igor était sur le trône. C'était vraie guerre, qui a duré des mois. Les combats étaient féroces, personne ne voulait céder. En conséquence, les troupes du prince furent vaincues. Mais Igor ne s'est pas calmé. Trois ans plus tard, une nouvelle campagne. Les Grecs décidèrent immédiatement de se rendre, offrant la paix. Certaines conditions de l’accord précédent ont été supprimées, mais de nouvelles sont également apparues.
Après Igor, Sviatoslav accéda au trône, poursuivant la politique de son père. Sous lui, la guerre avec Byzance dura longtemps, se terminant par des négociations de paix.
Après cela, d’autres campagnes, attaques et guerres eurent lieu. Mais ils étaient déjà de moindre importance tant pour Russie kiévienne, et pour l'Empire byzantin.
Il ne fait aucun doute que l'influence la plus importante de Byzance sur la culture des Slaves est le christianisme, qui a été adopté précisément par l'empire au Xe siècle. Et cela n’est pas surprenant, car les liens de la Russie kiévienne (à la fois économiques et étatiques) étaient beaucoup plus étroits avec Byzance qu’avec l’Occident.
Parallèlement à la religion, d'autres éléments de la culture arrivent sans problème aux Slaves. Le sort de ce dernier était prédéterminé par le prince Vladimir. Tout d’abord, les premiers temples apparaissent. Leur décoration intérieure, d'ailleurs, a également été empruntée à Byzance (mosaïques, fresques, icônes). Les services divins étaient également célébrés selon le modèle byzantin. Deuxièmement, la peinture connaît son apogée. Troisièmement, avec l’avènement du christianisme, la littérature s’est également développée. Jusqu’à cette époque, pourrait-on dire, cela n’existait pas. Quatrièmement, la musique. Et cela s'est présenté sous la forme de chants religieux qui, en entendant à Constantinople, les princes russes étaient tout simplement stupéfaits. C'est ce qui m'a attiré Slaves de l'Est Byzance.
De plus, pendant très longtemps, les Slaves ont mené un commerce actif avec les marchands byzantins. Cela a été possible grâce à chemin légendaire"des Varègues aux Grecs." Le miel, les fourrures, la cire et le poisson étaient importés dans l'empire. Et ils importaient des tissus, des produits de luxe, des livres (lorsque l'écriture apparut).
Conclusion
Byzance a créé une culture brillante, peut-être la plus brillante que le Moyen Âge ait connue, sans doute la seule avant le XIe siècle. existait dans l'Europe chrétienne. Constantinople est restée pendant de nombreux siècles la seule grande ville de l'Europe chrétienne, d'une splendeur inégalée. Avec sa littérature et son art, Byzance a fourni influence significative sur les peuples qui l'entourent. Les monuments et œuvres d'art majestueuses qui subsistent d'elle nous montrent toute la splendeur Culture byzantine. Byzance occupait donc une place importante et, il faut le dire, méritée dans l'histoire du Moyen Âge.
Ainsi, les relations entre Byzance et les Slaves furent très étroites, très diverses et très durables. Aucun autre État n’a probablement laissé une marque aussi profonde dans l’histoire et la culture russes. Les Slaves et Byzance sont un exemple frappant de la manière dont un peuple tout entier peut adopter les traits caractéristiques d’un seul pays.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans l'Empire russe sous Catherine II, il y avait un projet de renaissance de Byzance, appelé « Projet grec ». Empire russe puis fait la guerre à Empire ottoman, et le plan prévoyait, en cas de victoire inconditionnelle sur les Turcs et de prise de Constantinople, de créer un nouvel « Empire byzantin ». L'empereur de cette Byzance ressuscitée devait devenir Constantin Pavlovitch, grand Duc, fils de l'héritier Pavel Petrovich (futur Paul Ier) et petit-fils de Catherine. Voltaire a exhorté Catherine à atteindre Istanbul dans la guerre contre les Turcs, à en faire à nouveau Constantinople, à détruire la Turquie et à sauver les chrétiens des Balkans. Et il a même donné conseils pratiques: pour une plus grande ressemblance avec les exploits de l'Antiquité, utilisez des chars dans les batailles de steppe contre les Turcs. Cependant, la prise de Constantinople n’a pas eu lieu et le plan a ensuite été oublié.
Liste des sources et de la littérature
Sources
- Agibalova E.V., Donskoy G.M. Histoire du Moyen Âge. M., 2012.
- Budanova V.P. Histoire du Moyen Âge. M., 2013.
- Kalachnikov V. Mystères de l'histoire : Le Moyen Âge. M., 2012.
- Svanidze A. A. Histoires sur l'histoire du Moyen Âge. M., 2010.
Périodiques
- Atlas du Moyen Âge : Histoire. Traditions. M., 2010.
- Histoire du monde illustrée : de l'Antiquité au XVIIe siècle. M., 2013.
Svanidze A. A. Histoires sur l'histoire du Moyen Âge. M., 2010. P-124
Histoire du monde illustrée : de l'Antiquité au XVIIe siècle. M., 2013. P-226
Kalachnikov V. Mystères de l'histoire : Le Moyen Âge. M., 2012. P-198
Agibalova E.V., Donskoy G.M. Histoire du Moyen Âge. M., 2012. P-154
Budanova V.P. Histoire du Moyen Âge. M., 2013. P-227
Atlas du Moyen Âge : Histoire. Traditions. M., 2010. P-251
Byzance a eu la plus forte influence sur la culture du sud et de l'est Peuples slaves. Ils ont adopté le christianisme de Byzance et ont rejoint la culture gréco-romaine noble et raffinée. L'architecture, les beaux-arts, la littérature et de nombreuses coutumes sont venus de Byzance aux Slaves. Byzance, elle-même s'effaçant peu à peu, semblait redonner de la force aux peuples slaves. En ce sens, l'histoire de Byzance est étroitement liée à l'histoire de tous les Slaves du sud et de l'est, en particulier à l'histoire des peuples de Russie.
Des questions
1. Qu'est-ce qui a poussé le tsar bulgare Boris à se convertir au christianisme ?
2. Pourquoi les Byzantins ont-ils si volontiers répondu à l’appel de Rostislav d’envoyer des mentors dans la foi ?
3. Quels autres peuples, outre ceux répertoriés, utilisent l'alphabet cyrillique ?
4. Pourquoi la transition vers la nouvelle foi des dirigeants de Bulgarie et de Russie a-t-elle joué un rôle décisif dans la christianisation de ces pays ?
Extrait du « Strategikon » (« Strategikon » - un manuel sur les affaires militaires) d'un auteur inconnu (Pseudo-Maurice) sur les Slaves
Les tribus slaves se ressemblent dans leur mode de vie, dans leur morale, dans leur amour de la liberté ; ils ne peuvent en aucune manière être amenés à la servitude ou à la sujétion dans leur propre pays. Ils sont nombreux, rustiques et tolèrent facilement la chaleur et le froid, la pluie, la nudité et le manque de nourriture. Ils traitent avec bienveillance les étrangers qui viennent chez eux et, leur montrant des signes d'affection (lorsqu'ils se déplacent) d'un endroit à un autre, les protègent si nécessaire...
Ils possèdent un grand nombre de bétail différent et les fruits de la terre en tas, notamment le mil et le blé.
La modestie de leurs femmes dépasse toute la nature humaine, de sorte que la plupart d'entre elles considèrent la mort de leur mari comme leur mort et s'étranglent volontairement, sans compter le fait d'être veuve à vie.
Ils s'installent dans les forêts, à proximité de rivières infranchissables, de marécages et de lacs, et aménagent de nombreuses sorties dans leurs habitations en raison des dangers qu'ils rencontrent naturellement. Ils enterrent les choses dont ils ont besoin dans des endroits secrets, ne possèdent ouvertement rien d'inutile et mènent une vie errante...
Chacun est armé de deux petites lances, certains possèdent également des boucliers, solides mais difficiles à porter. Ils utilisent également des arcs en bois et de petites flèches imbibées d'un poison spécial pour flèches, qui est très efficace à moins que le blessé ne prenne d'abord l'antidote, ou (n'utilise pas) d'autres moyens auxiliaires connus des médecins expérimentés, ou ne coupe pas immédiatement le site de la plaie abruptement afin que le poison ne se propage pas dans tout le corps.
Chroniqueur byzantin sur la rencontre du basileus byzantin Romain Ier et du tsar bulgare Siméon
En septembre (924)... Siméon et son armée s'installèrent à Constantinople. Il dévasta la Thrace et la Macédoine, brûla tout, les détruisit, coupa des arbres et, s'approchant des Blachernes, il demanda de lui envoyer le patriarche Nicolas et quelques nobles pour négocier la paix. Les parties ont échangé des otages et le patriarche Nicolas a été le premier à se rendre à Siméon (suivi d'autres envoyés)... Ils ont commencé à parler de paix avec Siméon, mais il les a renvoyés et a demandé à rencontrer le tsar lui-même (Romain), puisque, comme il le prétendait, beaucoup ont entendu parler de son intelligence, de son courage et de son intelligence. Le roi en était très heureux, car il avait soif de paix et voulait mettre fin à cette effusion de sang quotidienne. Il a envoyé des gens à terre... pour construire une jetée fiable dans la mer, à laquelle la trirème royale pourrait s'approcher. Il ordonna que la jetée soit entourée de tous côtés de murs et qu'une cloison soit construite au milieu où ils pourraient communiquer entre eux. Siméon, quant à lui, envoya des soldats et incendia le temple de la Très Sainte Théotokos, montrant par là qu'il ne voulait pas la paix, mais qu'il trompait le roi avec des espoirs vides. Le tsar, arrivé aux Blachernes avec le patriarche Nicolas, entra dans le tombeau sacré, étendit les mains en prière... demanda à la Très Glorieuse et Immaculée Mère de Dieu d'adoucir le cœur inflexible et inexorable du fier Siméon et de le convaincre de accepter la paix. Et ainsi ils ouvrirent l'arche sainte,( Icône (kiot) - une armoire spéciale pour les icônes et les reliques) où était conservé le saint omophorion (c'est-à-dire la couverture) de la Sainte Mère de Dieu, et, l'ayant jeté, le roi semblait se couvrir d'un bouclier impénétrable, et au lieu d'un casque il plaça sa foi en l'Immaculée Mère de Dieu, elle quitta ainsi le temple, défendu par des armes fiables. Après avoir fourni à sa suite des armes et des boucliers, il se présenta au lieu désigné pour les négociations avec Siméon... Le roi fut le premier à se présenter à la jetée mentionnée et cessa d'attendre Siméon. Les parties ont échangé des otages et des Bulgares. Ils fouillèrent soigneusement la jetée pour voir s'il n'y avait pas là une ruse ou une embuscade, seulement après cela, Siméon sauta de son cheval et se dirigea vers le roi. Après s'être salués, ils ont entamé des négociations de paix. On raconte que le roi dit à Siméon : « J'ai entendu dire que tu es un homme pieux et un vrai chrétien, cependant, comme je le vois, les paroles ne correspondent pas aux actes. Après tout, une personne pieuse et un chrétien se réjouissent dans la paix et l'amour... et un méchant et un infidèle aime les meurtres et verse injustement le sang... Que rendrez-vous compte à Dieu, étant parti dans un autre monde, pour vos meurtres injustes ? Avec quel visage regarderez-vous le redoutable et juste Juge ? Si vous faites cela par amour de la richesse, je vous en nourrirai suffisamment, retenez simplement votre main droite. Réjouissez-vous dans la paix, aimez l'harmonie, afin que vous puissiez vous-même vivre une vie paisible, sans effusion de sang et calme, et que les chrétiens se débarrasseront des malheurs et cesseront de tuer les chrétiens, car il n'est pas juste qu'ils lèvent l'épée contre leurs frères croyants. Le roi dit cela et se tut. Siméon eut honte de son humilité et de ses discours et accepta de faire la paix. Après s'être salués, ils se séparèrent et le roi fit plaisir à Siméon avec des cadeaux luxueux.
Le grand mouvement allemand n'a touché que peu l'Empire romain d'Orient, mais il avait d'autres ennemis dangereux : en Europe, ils étaient Slaves, en Asie - Perses. Après l’entrée des peuples germaniques dans l’empire, les tribus slaves ont commencé à s’installer dans les endroits qu’elles avaient laissés derrière elles. La même frontière du Danube par laquelle les Wisigoths sont entrés dans l'empire a commencé à être menacée par les Slaves qui sont venus ici, qui ont été rejoints ici dès le début, en outre, les Bulgares, un peuple d'origine turque qui vivait auparavant sur le cours moyen de la Volga. (Au 7ème siècle, plus Avar origine touranienne). Byzance a eu beaucoup de problèmes avec ses nouveaux voisins du Danube. Des forteresses furent construites contre les Slaves ; tantôt les Slaves étaient vaincus et exterminés, tantôt ils étaient payés, tantôt ils étaient installés en masse Péninsule des Balkans et même en Asie Mineure. De nombreux Slaves se sont installés dans la péninsule balkanique au IXe siècle, lorsque, selon les mots de l'empereur Constantin Porphyrogénète, tout le pays jusqu'au sud de la Grèce était « asservi ». En général seulement plus tard, certaines tribus slaves réussirent à fonder comme les Allemands, leurs états, qui, cependant, étaient incapables de conquérir toutes les régions et empires européens.
La « reconquista » byzantine dans les Balkans
Les invasions slaves ont complètement modifié la carte ethnique des Balkans. Les Slaves devinrent partout la population prédominante. Les restes des peuples qui faisaient partie de l'Empire byzantin n'ont essentiellement survécu que dans des zones montagneuses inaccessibles (enDans les années 30 du XIXe siècle, le scientifique allemand Fallmerayer a remarqué que les Grecs modernes descendent essentiellement des Slaves. Cette déclaration a provoqué un débat houleux dans les cercles scientifiques).
Avec l'extermination de la population latinophone de l'Illyrie, le dernier élément de lien entre Rome et Constantinople disparut : l'invasion slave érige entre elles une barrière infranchissable de paganisme. Les voies de communication des Balkans se sont éteintes pendant des siècles ; Latin, qui existait avant le VIIIe siècle. langue officielle L’Empire byzantin fut désormais remplacé par l’Empire grec et fut heureusement oublié. L'empereur byzantin Michel III (842-867) écrivait déjà dans une lettre au pape que le latin est"Langue barbare et scythe". Et au 13ème siècle. Le métropolite d'Athènes Michael Choniates était absolument sûr que"Un âne ressentirait plutôt le son de la lyre et un bousier l'esprit, que les Latins ne comprendraient l'harmonie et le charme de la langue grecque."
Le « rempart païen » érigé par les Slaves dans les Balkans a aggravé le fossé entre l’Est et l’Ouest européens, et ce, précisément au moment où les facteurs politiques et religieux divisaient de plus en plus les Églises de Constantinople et de Rome.
Cet obstacle fut partiellement levé dans la seconde moitié du IXe siècle, lorsque les Slaves balkaniques et pannoniens adoptèrent le christianisme.
Au cours de ce siècle, Byzance connaît un renouveau politique et culturel. Il a été déterminé par plusieurs facteurs externes et vie intérieure empires. L'assaut arabe fut repoussé et un équilibre des pouvoirs s'établit à la frontière byzantine-arabe. Dans le même temps, la victoire encore plus importante sur l’iconoclasme impliquait la restauration de l’éducation laïque et la renaissance de la ferveur missionnaire. église orthodoxe. Les nouvelles générations de théologiens et de diplomates quittèrent l'Université de Constantinople avec un ardent désir de voir la politique byzantine - spirituelle et laïque - plus offensive ; ils étaient prêts à apporter aux « barbares » non seulement la lumière de la vraie foi, mais aussi celle de la magie. éclat attrayant de la brillante civilisation byzantine. Ce n'est pas un hasard si saint Constantin (Cyrille), dans des disputes scientifiques avec les Arabes et les Khazars, a soutenu la supériorité de l'orthodoxie grecque, d'une part, par le fait que tous les arts viennent de Byzance, et, d'autre part, par les paroles du prophète. Daniel :« …Le Dieu du ciel érigera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas transféré à un autre peuple ; il écrasera et détruira tous les royaumes, mais il subsistera pour toujours » (Daniel 2 : 44).
Le processus de christianisation de la population slave de Grèce s'est déroulé dans l'ordre suivant : pression militaire, diplomatique, culturelle ; Hellénisation; appel; subordination politique. Ces quatre étapes d’assimilation des Slaves « grecs » sont mentionnées par l’empereur Léon VI le Sage (881 – 911) en relation avec les activités de son prédécesseur l’empereur Basile Ier (867 – 886) :« Notre père Vasily, empereur des Romains, de mémoire bénie, a réussi à les convaincre(slave - S.Ts.)
abandonnant leurs anciennes coutumes, ils en firent des Grecs, les soumirent à des dirigeants selon le modèle romain, les honorèrent du baptême, les affranchirent du pouvoir de leurs dirigeants et leur enseignèrent à combattre avec des peuples hostiles aux Romains.
Mission de Cyrille et Méthode
La conversion des Bulgares et des Moraves, dont l'indépendance politique vis-à-vis de Byzance empêchait leur assimilation, s'est déroulée d'une manière quelque peu différente. À cet égard, la propagation de l'orthodoxie parmi eux s'est heurtée à une sérieuse difficulté : le langage de la prédication chrétienne est resté totalement incompréhensible pour la majorité des convertis. Le service religieux était dirigé par des prêtres grecs le grec, ce que les prêtres ordonnés des Slaves ne connaissaient pratiquement pas. À leur tour, seuls quelques missionnaires grecs maîtrisaient bien la langue slave. La Vie de saint Méthode rapporte que l'empereur, exhortant les frères de Thessalonique à se rendre en Moravie, avança l'argument suivant :« Vous êtes des Soluniens, et les Soluniens parlent tous du pur slave ».
La littérature médiévale « Cyrille et Méthode » décrit la création Alphabet slave comme une sorte d'acte ponctuel, une sorte de miracle. 
Cyrille et Méthode créent l'alphabet. Miniature de la Chronique de Radziwill
Mais les frères Solun ont certainement eu des prédécesseurs dans ce domaine. Envoyant Constantin (Cyrille) et Méthode en mission éducative auprès des Slaves du Danube en 862, l'empereur Michel III le nota dans son discours d'adieu déjà dans la première moitié du IXe siècle. Les philologues grecs ont tenté de créer un alphabet slave, mais en vain. Et les frères eux-mêmes apparaissent devant nous, entourés d'étudiants et d'assistants, dont la part, vraisemblablement, représentait une part considérable du travail éducatif. Il est fort probable que la création de l'alphabet slave ait été précédée d'un travail long et minutieux. travail scientifique Et alors écriture slave est née un peu plus tôt que la mission morave des frères Solunsky.
L'alphabet cyrillique était basé sur le dialecte slave de la Macédoine du Sud et des environs de Thessalonique, où les frères des Lumières ont passé leur enfance. Mais grâce à l'unité linguistique panslave encore préservée à cette époque, manifestée à la fois dans le vocabulaire et la syntaxe, l'alphabet cyrillique a acquis une signification universelle dans le monde slave. « Techniquement », il s’agissait d’une adaptation de l’écriture grecque aux caractéristiques phonétiques du discours slave. Mais, malgré son apparente simplicité, c’était la création d’un linguiste de premier ordre.«C'est la phase initiale du développement Langue slave de l'Église a eu le plus de succès en termes d'exactitude linguistique et de qualité littéraire, a noté D. Obolensky. -Tout d’abord, les traductions de Constantin se distinguent par leur pertinence scientifique et leur profondeur poétique. Il savait parfaitement utiliser toute la riche variété du vocabulaire et de la syntaxe grecque, sans la moindre violence contre l'esprit de la langue slave. Par conséquent, et également en raison du fait que différents peuples slaves parlaient alors plus ou moins un seul dialecte, le slave d'Église est devenu le troisième langue internationale L'Europe et le dialecte littéraire commun des peuples d'Europe de l'Est admis dans le Commonwealth byzantin : Bulgares, Russes, Serbes et Roumains" [Obolensky D. Commonwealth byzantin des nations. Six portraits byzantins. M., 1998. P. 153]. Les historiens sont unanimes pour dire que « Constantin peut à juste titre être classé parmi les plus grands philologues d’Europe » [ Juste là. P. 151].
Les missionnaires catholiques, à leur tour, tentèrent d'attirer la Principauté de Grande Moravie dans l'orbite d'influence de l'Église romaine. Au 9ème siècle. Elle a essayé de traduire plusieurs textes chrétiens (Notre Père, Credo, etc.) en dialecte morave en utilisant l'alphabet latin.
Au début, le trône romain était assez fidèle à l'idée du culte en langue slave. L'épiscopat franc oriental (allemand) considérait cette question différemment, exprimant sous une forme théologique le désir du roi Louis le Germanique d'étendre ses possessions aux dépens des terres moraves. Constantin dut donc se battre avec un groupe très uni de clercs latins extrêmement hostiles à la liturgie slave. Selon sa Vie, ils se sont jetés sur Constantin « comme des corbeaux sur un faucon », affirmant la théorie de trois langues « sacrées » - l'hébreu, le grec et le latin, dans lesquelles il est le seul « autorisé » à servir la liturgie. Konstantin était excellent dans ses objections. Il dénonce cet enseignement comme une « hérésie trilingue », contre laquelle il formule son credo : toutes les langues sont bonnes et acceptables aux yeux de Dieu. En même temps, il se référait aux paroles de l’apôtre Paul :« Maintenant, si je viens vers vous, frères, et que je commence à parler en langues inconnues, alors quel bénéfice vais-je vous apporter ?(1 Cor. 14:6) et sur le sermon de Jean Chrysostome :« Les enseignements des pêcheurs et des artisans brillent plus que le soleil dans la langue des barbares. ». À la suite de sa dispute avec les « trilingues », le pape Adrien II a pleinement approuvé et béni solennellement la liturgie slave dans un message spécial. 
Saints frères égaux aux apôtres Cyrille et Méthode. Fresque du monastère de Saint-Naum, Bulgarie.
En 869, Constantin mourut, après avoir prononcé ses vœux monastiques sous le nom de Cyrille avant sa mort. Méthode, nommé archevêque de Pannonie et légat papal des peuples slaves, tenta de poursuivre son œuvre. Mais hélas, la politique a fait obstacle à la culture. En 871, Sviatopolk, neveu du prince régnant de Grande Moravie, Rostislav, jeta son oncle en prison et prêta serment de vassal à Louis le Germanique. Le clergé franc oriental a réussi à arrêter Méthode, qui a passé deux ans dans une prison souabe et n'a été libéré qu'après de fortes pressions exercées sur les évêques allemands par le nouveau pape Jean VIII. Cependant, l'idée d'une liturgie slave trouva de moins en moins de soutien parmi puissant du monde ce. Sviatopolk, qui se disputa bientôt avec Louis et expulsa les Allemands du pays, ne voyait aucun avantage pour lui-même dans l'orientation byzantine ; Quant au trône romain, il révèle au fil des années de plus en plus clairement une volonté de ne pas aggraver les relations avec le clergé allemand insoumis. En 880, Jean VIII interdit le culte slave.
Les dernières années de la vie de Méthode furent empoisonnées par la persécution et les intrigues. Il a quand même réussi à traduire langue slave un certain nombre de textes juridiques byzantins concernant l'Église, mais après sa mort en 885, l'activité de traduction de son entourage s'éteignit. Quelque temps plus tard, l'ambassadeur de l'empereur Basile Ier à Venise, qui se promenait dans le marché aux esclaves à la recherche de ses compatriotes à racheter, attira l'attention sur un groupe d'esclaves mis en vente par des marchands juifs. Après s'être renseigné, il découvrit qu'il s'agissait de disciples de Constantin et de Méthode, vendus comme esclaves comme hérétiques. Les malheureux furent rachetés et envoyés à Constantinople.
Il semblait que la mission morave des frères Solun s'était soldée par un échec complet. Mais l’histoire n’aime pas tirer des conclusions hâtives. Au cours des vingt courtes années d'activité des éclaireurs slaves, les Slaves du Danube avaient leur propre clergé et, surtout, les bases de la littérature slave ont été posées. langue parlée. La nouvelle entreprise culturelle s'est avérée extrêmement viable. L’Église romaine a réussi à déraciner la liturgie slave en Europe centrale seulement deux siècles après la mort de Constantin et Méthode. Mais le germe de la spiritualité orthodoxe, greffé par eux sur l'arbre de la culture slave, ne s'est pas fané et a porté ses fruits ailleurs et à une autre époque : en 865, les disciples de Constantin et Méthode baptisèrent la Bulgarie, et en 988, la Russie terre a adopté le christianisme.