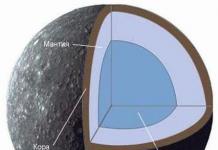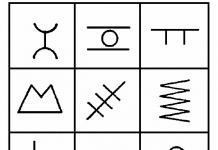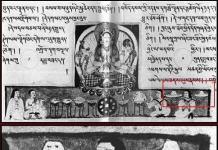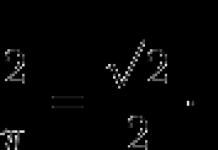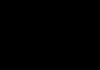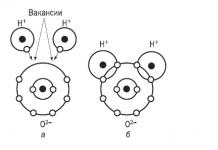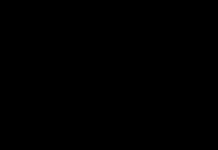À la mémoire d'Evgeny Borisovich Pasternak
Aimer les autres est une lourde croix,
Et tu es belle sans girations,
Et ta beauté est un secret
La réponse à la vie équivaut à .
Au printemps le bruissement des rêves se fait entendre
Et le bruissement des nouvelles et des vérités.
Vous venez d’une famille dotée de tels fondamentaux.
Votre sens, comme l'air, est altruiste.
Il est facile de se réveiller et de voir clairement,
Secouez les déchets verbaux du cœur
Et vivez sans vous encombrer à l'avenir.
Tout cela n’est pas un gros truc.
1931
Adressé à la nouvelle amante du poète et future seconde épouse, Zinaida Nikolaevna ( Eremeeva-Neuhaus-Pasternak), ce poème (ci-après dénommé LI) porte en grande partie l'empreinte de son image. Comme vous le savez, Zinaida Nikolaevna a immédiatement déclaré à Pasternak qu'elle ne comprenait pas vraiment ses premiers poèmes ; il a répondu qu'il était « prêt à écrire plus facilement pour [elle] ». 1
Pasternakovales paroles du début des années 1930 montraient réellement un nouveau style destiné à une simplicité inouïe, et LI, écrit d’une manière fondamentalement « simple », développe l’idée selon laquelle la vérité réside dans la libération naïve d’une complexité douloureuse et inutile. Mais, mettre à jour, exprimer bruissement de nouvelles, la manière reste reconnaissable Pasternak, initialement « complexe », et peut-être que le principal secret du LI est la combinaison de deux techniques opposées.
1. Vocabulaire et grammaire. La simplicité se réalise en LI principalement au niveau lexical. Il n'y a pas de mots étrangers ici (comme vin gai, vin triste, homo sapiens), ni les barbarismes à la nordiste (comme coiffeuse, cacao, stores; le seul emprunt secrète, - fait depuis longtemps partie du lexique quotidien), ni les raretés terminologiques recherchées, les archaïsmes et les dialectismes (comme finition, forte obscurité, Autoroute, omoplates [petits pois]), nécessitant les explications de l'auteur de la sous-page. Même les mots avec sublimement spirituel sémantique ( traverser, secret, solution, fondements, vérités, équivalent, voir la lumière) sont résolument élémentaires et le vocabulaire est volontairement simple ( secouer les détritus) ne dépasse pas la norme conversationnelle.
La syntaxe est également extrêmement simple, surtout par rapport aux premiers poèmes. Toutes les phrases sont simples ou complexes, mais pas complexes. Les sommets de « subordination » sont des chiffres d’affaires comparatifs comme l'air et phrase participative sans colmatage, relatif au répertoire d'une phrase simple et exprimant justement le rejet de tout ce qui est superflu. Une autre complication, mais encore une fois dans les limites d'une syntaxe simple, est l'utilisation d'infinitifs, une fois dans le 1er vers, puis quatre fois dans la 3ème strophe. C’est aussi un exemple de combinaison d’extrêmes, non seulement de simplicité et de complexité, mais aussi de statique et de dynamique. 2
Le fait est que le texte de LI est construit comme un système d’identités statiques. Tous les prédicats sont nominaux : chacun consiste en un connecteur omis [ Il y a], exprimant le fait de la prédication, et la partie nominale - un nom ou un adjectif ( traverser, beau, secret, équivalent, audible, facile, rusé), portant le prédicat sémantique lui-même. Construction infinitive L célébrer [Il y a]croixétablit immédiatement un compromis entre un début verbal dynamique et un début nominal statique. Le verbe lyrique principal du poème fait office de sujet, mais il apparaît également sous une forme imparfaite et sous la forme d'un mode indéfini, fonctionnellement proche du nom verbal et signifiant non pas une action ou un événement, mais l'état du sujet.
Dans les lignes suivantes de la strophe I, la staticité et la généralité sont consolidées, et dans la strophe II, un renouveau dynamique commence - le printemps arrive, tout bruisse, bruisse et se renouvelle. Cependant, cette mise en mouvement est présentée sous la forme d'un prédicat nominal avec une forme participative passive et imparfaite ( audible), et en noms fixes, bien qu'initialement prédicats, ( bruissement, bruissement, nouvelles). Dans la seconde moitié de la strophe le mouvement s'arrête et les mouvements panchrones reviennent vérité.
Dans la strophe III, le motif de l’éveil est repris. Le texte est saturé de verbes qui, tout en restant infinitifs et sujets, sont activés de manière décisive. Premièrement, ils apparaissent désormais principalement sous des formes perfectives, désignant des processus dirigés vers un but et même une action ( réveille-toi et vois la lumière;secouer). Deuxièmement, les infinitifs s'éloignent de la position initiale (qui être amoureux occupé en I) en finale - sous emphase logique et rime.
Mais après cet élan d'activité, que l'humeur indéfinie à la fois retient et hypostasie, proclamant un nouveau programme de vie 3, le calme revient. Il est introduit d'abord par deux formes non personnelles d'une forme imparfaite, projetant dans le futur nouvellement panchronique l'état véritable qui, une fois atteint ( en direct), ne nécessitera qu'un entretien ( sans colmatage). Le calme panchronique complet est marqué (dans le dernier vers du poème) par le retour d'une phrase simple élémentaire avec un connecteur abandonné.
L’imbrication de la simplicité et de la complexité se manifeste également dans la manière dont la prolifération syntaxique est gérée par des propositions indépendantes, sans recourir à l’hypotaxie – l’utilisation de propositions subordonnées. 4
La première strophe contient une conjonction en trois parties (avec des conjonctions UN Et ET), la troisième phrase étant de longueur égale à la somme de la première et de la deuxième, donnant la sommation classique (1+1+2).
La strophe II se compose à nouveau de trois phrases indépendantes, mais avec une inversion miroir de la longueur des parties (2+1+1), et la première est formée d'un prédicat ( audible) avec deux sujets homogènes.
Dans la strophe III, la première phrase couvre déjà trois vers : les quatre infinitifs y sont des sujets homogènes, et le prédicat nominal est facilement(contrairement à lourd de la ligne LI initiale). Vient ensuite une phrase récapitulative d'une ligne (schéma 3+1), qui dans sa brièveté fait écho à la simplification de la syntaxe - le rejet des constructions infinitives.
Toutes ces expansions et contractions s'effectuent strictement dans le cadre de strophes et de vers entiers - sans enjambements, qui sont en fait fréquents à Pasternak. Une « virtuosité modeste » particulière consiste précisément à saturer le texte d'une variété de mouvements rhétoriques, mais sans circonvolutions ni astuces rythmico-syntaxiques. Nous avons déjà envisagé certains de ses aspects : travailler avec des phrases simples et complexes de différentes longueurs, avec des sujets homogènes du même prédicat, avec des prédicats nominaux et des sujets infinitifs, avec des phrases comparatives et participatives. D'autres, en particulier la complexité/dynamisme caché d'un certain nombre de prédicats, nous n'en avons abordé que brièvement et nous y reviendrons maintenant plus en détail.
2. Logique, sémantique. Comme nous l'avons dit, la partie nominale du prédicat nominal est un prédicat, c'est-à-dire une certaine corrélation de concepts. Si le sujet est un verbe (par exemple, être amoureux), deux prédicats s’avèrent connectés.
Aimer les autres est une lourde croix Cela signifie, traduit dans le langage de la prose logique, quelque chose comme ceci :
Quand quelqu'un aime une personne (une femme) d'un certain type, cela équivaut au fait que l'amant s'engage à souffrir lourdement (de cette personne/de cet amour).
Le premier prédicat est exprimé assez directement - par un verbe, bien que sous une forme complexe et infinitive, le second - par la construction Adjectif + Nom, c'est-à-dire syntaxiquement simple, mais sémantiquement plus complexe - en raison de la complexité interne de la phrase Croix lourde, et plus compact - en raison de sa nature idiomatique.
Au 2ème vers, la situation semble simplifiée - le rôle du sujet est repris par le pronom personnel Toi. Mais en même temps cela devient plus compliqué, puisqu'à un simple prédicat nominal beau jointure de définition sans circonvolutions, de forme complexe (un nom avec une préposition) et de sens non standard. La formule « être belle sans circonvolutions » relie deux prédicats très différents entre eux et forme une phrase beaucoup plus complexe que l'habituelle. Croix lourde dès la 1ère ligne . Mais cette tournure audacieuse était en partie préparée : le prétexte sans explique la négation impliquée dans la sémantique du mot autre et annoncé par le syndicat adverse UN. 5
La phrase suivante est à la fois transparente dans sa structure et marque un nouveau niveau de complexité logique. La transparence est assurée par la synonymie lexicale ( secret-solution) et la symétrie syntaxique (qui n'est légèrement rompue que par le pronom « extra » le vôtre dans le groupe thématique) :
Sujet: charmes... secrets(nom + désaccord. définir. au gén. enfer.) - Prédicat Nominal : [ Il y a] équivalent(adj. court) - Ajout : la solution à la vie(nom + désaccord. définir. au gén. enfer.).
La transparence est également renforcée par le fait que le lien [ Il y a], encore omis, est ici prononcé à voix haute sous la forme d'un adjectif complet équivalent- un mot complexe se divisant en deux racines exactement au milieu.
Et grâce à sa forme interne, construite sur l'idée d'égalité, d'équivalence logique, ce mot non seulement verbalise le connecteur, mais le réifie aussi littéralement. Sans une telle verbalisation, l'équation paraîtrait plus courte, mais sonnerait plus lourde, plus muette, dans l'esprit des premiers Pasternak, quelque chose comme *ET
Le secret de vos charmes est la solution pour vivre sans effort.
Toute cette technique simplificatrice n'obscurcit pas le fait que nous parlons de hautes questions philosophiques, de l'essence de la beauté et du sens de la vie, qu'un prédicat du dictionnaire logico-mathématique est introduit dans le texte ( être équivalent) et qu'une équation à deux étages se construit, une sorte de syllogisme :
Si c'est un secret Ha (ta beauté) est égal à la réponse à Y ( vie), alors donc X ( ta beauté) = Y-y ( vie), c'est Toi = la vie, ce qui devait être prouvé (et est affirmé sous une forme ou une autre dans LI et d’autres versets de la « Seconde Naissance »).
La deuxième racine d’un mot composé est également importante pour la sémantique du poème. équivalent: indication de la force dégagée par l'héroïne et garantissant un passage salvateur de la lourdeur du début de la strophe I à la légèreté du début de la III. 6
La variation des identités simples se poursuit dans la seconde moitié de la strophe II en introduisant une phrase plus verbeuse : être issu d'une famille +être en désaccord déf. en genre enfer. PL. h. ( les bases). Philosophique les bases(et Pasternak a étudié la philosophie dans sa jeunesse) sont simplifiés en les transférant sur le plan domestique (les choses se dirigent vers le mariage et le poète a généralement un faible pour les noms de parenté), et au lieu de synonymes abstraits (comme nombre, classe, ensemble, catégorie, pas rare à Pasternak) apparaît famille de fondations, et exactement tel, comme il se doit, - contrairement à ceux autre qui ont été contestés.
Le dernier vers de la strophe II, comparant signification aimé des nécessités vitales, mais apparemment dépourvu de propriétés par avion, continue de développer le thème apophatique des vertus négatives sans circonvolutions et se termine par un adjectif désintéressé, incorporant la préposition sans sous forme de préfixe . 7 Structurellement, les deux derniers vers de la strophe II sont relativement simples : il y a une certaine accalmie syntaxique avant le décollage qui arrive dans la strophe III, qui sera suivie d'un calme final.La dernière ligne est complètement libérée des complexités des prédicats dans le sujet - elle devient un indéfini généralisé. DANS tout ça, résumant de manière pronominale une série d'infinitifs homogènes. Et le rôle du prédicat est à nouveau joué par la combinaison la plus simple Adjectif + Nom (comme l'initiale Croix lourde), sans prétention dans son sens et dans son style familier.
3. Connotations.Le thème leitmotiv de la simplicité apparaît dans la tournure caractéristique de « légèreté, non-lourdeur, non-difficulté », résonnant silencieusement dans une série de motifs « négatifs », cf. :
refus d'une lourde croix ;
redondance des circonvolutions ;
l'équation frivole du secret du charme féminin avec la réponse à la vie ;
l'éphémère des bruissements de rêves et autres bruissements printaniers ;
désincarnation/altruisme de l'air ;
réveil matinal involontaire;
implicitesans problème la transition de l'éveil physique à la compréhension existentielle ;
élimination purement mécanique des déchets et protection préventive ultérieure contre ceux-ci ;
échelle insignifiante d'une astuce déjà économique.
« Légèreté » respire à la fois par la simplicité volontaire du texte et par une partie de son ambiguïté. Un virage maladroit sans circonvolutionsécho:
carrefour ambigu facile de se réveiller, interprété par certains lecteurs comme Verbe + Adverbial (comme se réveiller tôt, instantanément, sans difficulté), et non comme Sujet + Prédicat (comme P. grandir à l'aube n'est pas difficile);
séquence ambiguë pas un gros truc, ce qui peut être interprété comme petite astuce, c'est-à-dire l'approbation de quelques petites astuces, alors qu'il s'agit de l'idée - et même de la formule linguistique elle-même Un peu de sagesse...;
contradiction entre le refus des circonvolutions et l'acceptation des trucs, du moins sur un plan purement verbal.
Cependant, toutes ces aspérités correspondent organiquement au style d'improvisation provocant que Pasternak a d'abord pratiqué dans compliqué formes linguistiques, et depuis les années 1930 - dans un esprit de liberté familière par rapport aux conventions du discours écrit. 8
4. Genre.Le poème commence par un rejet rhétorique de certains autre, ce qui contraste avec le destinataire traditionnel du poème à la 2e personne du singulier. h. Ceci Toi et ses formes possessives le vôtre, C'est le tien dominera les deux premières strophes, mais disparaîtra complètement dans la troisième généralisante.L'accent mis sur la généralisation et le dépassement des limites personnelles étroites se manifeste déjà dans la strophe II : dans sa première moitié Toi est absent, et seuls les changements printaniers typiques apparaissent, et dans le second, bien que Toi Et votre signification reviens, mais Toi se dissout dans une multitude de correct les bases Identité floue Toi Une manière fondamentalement négative de le caractériser contribue également à : sans, bes-, tu-, non, pas. 9 Et dans la strophe III, il n'y a pas Toi en général, il n'y en a plus, tout comme il n'y a aucune mention de l'amour, ce à quoi répond la prédominance du mode indéfini des verbes. Le poème, pour ainsi dire, entre dans l'étendue des vérités générales sur la vie, laissant derrière lui des déclarations d'amour pour une femme en particulier.
Dans cette optique, le sens du mot revêt un intérêt particulier. autre en 1ère ligne. Je n'y avais jamais pensé auparavant référentiel sens, mais en y réfléchissant maintenant, je l'attribuerais à la première épouse du poète, Evgenia Vladimirovna Lurie-Pasternak. 10 E si cela est vrai, alors l'expression autre sonne, d'une part, comme un euphémisme adoucissant la maladresse (on dit, il ne s'agit pas seulement d'elle), et d'autre part, comme un geste de dédain grossier de type soviétique ( D'autres ne le savent pas...). Mais à la lumière de la rhétorique généralisante de LI dans son ensemble, qui dans le final s'éloigne des mentions du destinataire du poème, ma première réaction semble plus adéquate : il ne s'agit pas seulement d'Evgenia Vladimirovna au début, pas seulement de Zinaida Nikolaevna dans le au milieu, et même pas du tout sur l'amour à la fin.
On peut dire que LI oscille entre les deux genres de discours lyrique préférés du poète : les poèmes sur « Vous » - des déclarations d'amour, que ce soit à une femme ou à un sapin de Noël, au format : * Tu es untel... 11, et des poèmes sur « Ceci » - définitions de quelques entités plus abstraites au format : *C'est [est] tel ou tel. 12 En comparaison avec les deux groupes de textes, LI est extrêmement équilibré, exempt d'exclamations, d'énumérations et d'enjambements fastidieux, très judicieux et axiomatique dans la présentation de son système d'équations. Et en reliant la série infinitive à cela dans la finale, elle gravite aussi généralement vers le troisième. Pasternak format : programme d’action à l’infinitif. 13
5. Phonétique.En développement Pasternak thèmes de l'unité de l'univers, variés par diverses manifestations de contact, la place la plus importante est occupée par l'allitération et la paronomasie, qui démontrent clairement la similitude phonétique, presque l'identité des différents mots, et donc des objets correspondants. Il est tout à fait naturel que dans un poème dont le leitmotiv est l'assimilation de différentes entités selon le principe « ceci est pareil que cela » 14, une telle technique trouverait de riches applications. En effet, le dictionnaire LI dans son ensemble, et souvent des lignes individuelles, forment une sorte de continuum sonore, où les mots individuels résonnent de diverses manières et semblent se fondre les uns dans les autres. Mais en même temps, le poème conserve une aura de clarté transparente, si différente du chaos improvisé des premiers poèmes du poète (cf. le vers caractéristique ET le chaos des fourrés éclabousse).
Esquissons, par exemple, un tableau des allitérations de la strophe I :
1ère ligne : trois T, deux tambours Et 15 ;
2ème : deux Et, deux R. , deux h ;
3ème : trois T, les trois tambours - e, dont deux après R. ;
4ème : deux ra au début des mots , deux h, trois Et, dont deux tambours, trois n.
A l'avenir, cette tendance se poursuit, seule l'orchestration se concentre sur d'autres sons phares : la consonne Avec et voyelle Ô dans la strophe II et sur les consonnes Avec, R. Et t et voyelle e en III.
Mais les répétitions évidentes de sons individuels ne donnent pas une idée du puissant système de connexions allitératives entre les mots qui en résulte dans tout l'espace du texte. Voici quelques chaînes impressionnantes :
ST: croix - charmes - bruissement - nouvelles - vérités - désintéressé - secouer - ruse;
SN : beau - printemps - rêves - actualités - bases - réveil - verbal;
CONCERNANT: croix - belle - charmes - secret - pour voir la lumière - désormais.
Les chaînes, comme il est facile de le constater, se croisent et même se chevauchent, formant parfois de puissants clusters, par exemple CRST : croix - secret - altruiste. Le réseau principal d'échos est constitué de superpositions plus clairsemées, avec un ou deux sons communs, parfois dans des ordres différents, et parfois avec des voix/étourdissements, de sorte que le sentiment n'est pas créé d'une équation accrocheuse, mais d'une sorte d'unité floue.
Un exemple serait une série de combinaisons h suivi d'une consonne variable ( c, d, n, d, r, s): Et son Ilin-ra zg adke - zhi zn et en bâtiment euh - à propos sp manger - et zs cœurs, après quoi pour la première et unique fois dans le poème h apparaît finalement séparément, sans consonne d'accompagnement : n e pour disputes.
Et la combinaison précédente h avec le son le plus proche Avec(V. du coeur) semble résumer le riche système de parallèles entre ces combinaisons h+ consonne et nombreuses combinaisons Avec+ consonne.
C'est le débordement h V Avec commence dans la rime de la strophe I, où Et h vilain rime avec équivaut à Avec Ilène, malgré les deux qui précèdent le mot qui rime h-mots : ra h enfoiré h ni l'un ni l'autre, mais basé sur beau Avec sur Et prél Avec toi Avec secret; il est aussi effectivement présenté au début de la strophe III : en paire réveille-toi - vois la lumière, où dans un contexte morphologique et phonétique similaire Avec(n ) semble entrer dans h (R. ).
Une couche spéciale de « tissage de mots » forme un son qui traverse tout le texte. n , intéressant en termes d'interprétation sémantique. Utilisation abondante de consonnes n en raison de plusieurs facteurs :
son rôle de suffixe des adjectifs ( beau, verbal, égal- 16 ) , ce qui, sous des formes courtes, le met à la suite du mot ( audible) et donc parfois de rimer ( équivalent, désintéressé);
son rôle de consonne principale d'une particule négative ( pas obstruant, pas gros) et le pronom adversatif ( autre);
à sa présence dans un nombre considérable de mots à pleine valeur ( circonvolutions, vie, printemps, actualités, vérités, rêves, fondations, réveille-toi).
Dans l'ensemble, cela favorise la cristallisation autour n halo sémantique, associant « assimiler adjectif" (= fonction des prédicats nominaux) avec négativité et avec cluster " sans circonvolutions - vie - printemps - actualités - rêves/éveil - bases - vérités - clarté».
Il convient de souligner que, dans le contexte des premiers poèmes de Pasternak, cette paronomastique semble plutôt modeste. Elle est réalisée avec beaucoup de soin et est largement compensée par la simplicité et la transparence des autres aspects de la structure.
6. Rimes.À première vue, la structure des rimes de LI est plus ou moins simple. Devant nous se trouvent trois quatrains de 4 st. iambique avec rime croisée MF. Les rimes sont parfois précises ( rêves/fondations;voir la lumière/désormais), parfois pas tout à fait ( croix/secret), souvent profond et riche ([ shoro ]X rêves/[après tout]X les bases; secouer /rusé).
Les écarts par rapport à cette simplicité sont également largement traditionnels pour Pasternak et consistent à donner des similitudes à différentes paires de rimes, ce qui augmente l'unité du répertoire de rimes.
Les rimes de la strophe I y sont faiblement soumises (sauf peut-être s/z présenté dans les quatre) : ils fixent une différence initiale presque complète entre les couples, mais seront impliqués rétroactivement dans le processus de fécondation mutuelle.
Les rimes de la strophe II sont unies par des sons communs Avec Et n, et Avec est hérité de la plupart des rimes de la strophe I, et n- d'elle même des rimes ; en plus, même les rimes ( vrai/altruiste) hériter T des rimes étranges de la strophe I ( croix/secret); sont hérités de la strophe I et des relations grammaticales au sein même des rimes convolutions/équivalent Et vrai/altruiste(nom féminin, genre, pluriel) / brièvement adj. mari. R. unités h. en eux. pad.), qui travaille pour la symétrie globale des structures et maintient la proportion le secret de la beauté = la réponse à la vie.
Dans la strophe III, la partie commune de tous les mots qui riment forme un groupe h /Avec, R., t, qui reprend le matériel rimant de certaines rimes des strophes précédentes (cf. voir la lumière/désormais Avec croix/secret, UN secouer /rusé Avec vrai/altruiste).
Le seul bloc sur lequel ces appels nominaux rimés sont placés est la rime sur Et dans les lignes paires - et donc finales - de toutes les strophes et sur e dans les vers impairs des strophes I et II. Rimes sur Ô dans les lignes impaires de la deuxième strophe, il y a ainsi un virage compositionnel sur le côté, avec un retour au schéma original à la fin e-e-e-e, selon le principe de thèse - antithèse - synthèse . La synthèse consiste en l'enrichissement des rimes finales, notamment celles décrites ci-dessus, avec le matériel sonore des strophes précédentes. Un autre détail qui attire l'attention dans les rimes de la dernière strophe est l'adoucissement constant T, hérité des strophes précédentes : le poème se termine par un accord de quatre rimes avec [- t ]. 17
Les longues chaînes instables de rimes imprécises sont un trait connu Pasternak versification. 18 Elles peuvent former des séquences continues ou alterner avec d’autres rimes. Il existe de nombreux cas où la même voyelle (ou consonne) est incluse dans plusieurs séries de rimes, formant une série de rimes différentes mais « consonnes », par exemple :
jouer - déchirer - épigraphe - amour ;
raisons - raison - pelouses - horizon ;
choral - molokan - ramassé - vers les nuages ;
sur le visage - rayures - vers la fin - baisers ;
paternel - protecteur - bouillant - (à) plus épais .
Dans LI, une telle impulsion libre, parfois jusqu'au désordre, est disciplinée dans le cadre d'une composition régulière de trois strophes, mais l'effet de flux libre augmente de strophe en strophe. Rimes sur Et former une seule chaîne imprécise : circonvolutions - équivalent - vérités - désintéressé - secouer - rusé; la première paire est connectée à la seconde Et Etn, et le deuxième et le troisième - et, avec, t. De plus, cette chaîne accumule également certains éléments des premières rimes du e et s'hybride ainsi en partie, au niveau des consonnes, avec une chaîne parallèle : croix - secret - voir la lumière - désormais.
1. Anagrammes ?Des interprétations anagrammatiques des poèmes de Pasternak ont été proposées à plusieurs reprises : dans certaines lignes, le nom de famille était lu Brioussov, chez les autres - Bach, Troisièmement - Scriabine, quatrièmement - le nom Hélène(Raisins), d'autant plus que Pasternak a aussi un poème acrostiche MARINE TSVETAEVA. J’en ai rendu hommage dans l’analyse de la « Ballade » de Neuhaus, en essayant de discerner les anagrammes du nom dans le texte. Harry. J'y ai rapidement signalé la possibilité d'un cryptage similaire dans la « Deuxième Ballade » (dédiée, en conjonction avec la première, à Z. N. Neuhaus) intitulée Zina- en lignes avec des rimes et des allitérations appropriées ( bouleau et tremble - dos - toile - deux fils - toute la nuit...). 19
"J'ai vraiment aimé les deux poèmes", a admis Zinaida Nikolaevna. 20 Il est possible que dans le LI un peu plus tardif qui lui est adressé, Pasternak ait utilisé en partie la même rime allusive (sur Et) et le placer dans la position structurelle la plus solide. Certains arguments en faveur de cela ont en fait déjà été exposés ci-dessus - lorsqu'on considère les jeux allitératifs avec h , Avec Et n et leurs combinaisons avec d'autres consonnes. Je vais ajouter ça dans la ligne ET vivre sans se salir à l'avenir, il y a un verbe à côté en direct(se référant à la solution à la vie) et séquence de syllabes PAS POUR, c'est-à-dire avec permutation, ZINA.
Malheureusement, ces suppositions fascinantes contredisent le déplacement évident de l’attention dans la dernière strophe de LI des individus vers les vérités générales, et sont généralement impossibles à prouver. Maintenant, si nous pouvions trouver des preuves réelles - disons que dans le cercle familial, le poème s'appelait rien de moins que "Zina" !... Ce serait la clé pour tout le monde.
LITTÉRATURE
Broitman S.N. 2007.Poétique du livre de Boris Pasternak « Ma sœur c'est la vie ». M. : Progrès-Tradition.
Gasparov M.L. 1997.Poème de B. Pasternak // Aka . Œuvres choisies. T. 3. À propos du vers. M. : Langues de la culture russe. pp. 502-523.
Jolkovsky AK 2011.Poétique de Pasternak. Invariants, structures, intertextes. M. : OVNI.
Pasternak B.L. 2004. Composition complète des écrits. En 11 volumes / Comp. Et
Composition
Boris Leonidovich Pasternak est un merveilleux poète et prosateur du XXe siècle. On peut pleinement le qualifier d’écrivain esthète, doté d’un sens subtil et profond de la beauté. Il a toujours été un connaisseur de la beauté naturelle et intacte, ce qui se reflète bien sûr dans son travail. Et comme exemple frappant de tout ce qui précède, je voudrais attirer une attention particulière sur un poème de Pasternak tel que « Aimer les autres est une lourde croix… ».
La première chose qui frappe dans cette œuvre est la simplicité et la légèreté du style. Il est très court, composé de seulement trois quatrains. Mais cette brièveté constitue l’une de ses plus grandes vertus. Ainsi, chaque mot semble avoir plus de valeur et avoir plus de poids et de sens. En analysant le discours de l’auteur, on ne peut s’empêcher de prêter attention à l’étonnant naturel du langage, à sa simplicité et même à un certain langage familier. La barre littéraire et linguistique a été abaissée jusqu'au langage presque quotidien, prenez par exemple une phrase telle que « Tout cela n'est pas un gros truc ». Bien qu'il existe également un style de livre, par exemple la phrase d'ouverture de l'ouvrage « Aimer les autres est une lourde croix ». Et ici, je voudrais noter que cette tournure phraséologique contient une allusion claire aux motifs bibliques si fréquents dans les œuvres de Boris Pasternak.
Comment déterminer le thème de ce poème ? Il semblerait que l'œuvre soit un appel du héros lyrique à sa femme bien-aimée, une admiration pour sa beauté :
Aimer les autres est une lourde croix,
Et tu es belle sans girations,
Et ta beauté est un secret
Cela équivaut à la solution à la vie.
La question se pose : quel est le secret du charme de sa bien-aimée ? Et puis l'écrivain nous donne la réponse : sa beauté réside dans son naturel, sa simplicité (« Et tu es belle sans circonvolutions »). Le quatrain suivant nous amène à un niveau sémantique plus profond de l'œuvre, à une réflexion sur l'essence, la nature de la beauté en général.
Qu'est-ce que la beauté selon Pasternak ? C'est une beauté naturelle, sans artificialité, sans faste ni fioritures. Dans ce poème, nous rencontrons à nouveau la soi-disant « théorie de la simplicité » du poète, la simplicité, qui est la base de la vie, de toutes choses. Et la beauté féminine ne doit pas contredire, mais s’intégrer organiquement dans l’image globale, vaste et globale, de la beauté universelle, que possèdent également toutes les créatures de Dieu. La beauté est la seule et principale vérité dans le monde du poète :
Au printemps le bruissement des rêves se fait entendre
Et le bruissement des nouvelles et des vérités.
Vous venez d’une famille dotée de tels fondamentaux.
Votre sens, comme l'air, est altruiste.
Le dernier vers de ce quatrain est particulièrement symbolique. Comme l’expression « air désintéressé » est profondément métaphorique ! En y réfléchissant, vous comprenez que la nature est en réalité altruiste, elle nous donne la possibilité de respirer et, par conséquent, de vivre, sans rien demander en retour. De même, la beauté, selon Pasternak, doit être altruiste, comme l'air, c'est quelque chose qui appartient également à chacun.
Dans ce poème, le poète distingue deux mondes : le monde de la beauté naturelle et le monde des gens, les querelles quotidiennes, les « déchets verbaux » et les petites pensées. L’image du printemps comme période de renaissance et de renaissance est symbolique : « Au printemps, on entend le bruissement des rêves et le bruissement des nouvelles et des vérités. » Et l'héroïne lyrique elle-même est comme le printemps, elle est « issue d'une famille aux fondations telles », elle est comme un souffle de vent frais, elle est un guide d'un monde à l'autre, le monde du beau et du naturel. Dans ce monde, il n’y a de place que pour les sentiments et les vérités. Il semblerait facile d'y entrer :
Il est facile de se réveiller et de voir clairement,
Secouez les déchets verbaux du cœur
Et vivre sans s'encombrer du futur,
Tout cela n’est pas un gros truc.
La clé de cette vie nouvelle et merveilleuse est la beauté, mais tout le monde est-il capable de voir la vraie beauté dans le simple et le naïf ? Chacun de nous est-il capable de « se réveiller et de voir la lumière »...
Il convient de noter les caractéristiques de la présentation par l'auteur du héros lyrique et de l'héroïne lyrique de ce poème. Ils semblent rester en coulisses, ils sont flous et vagues. Et chacun de nous peut involontairement s'imaginer, ainsi que ses proches, à la place des héros. Ainsi, le poème devient personnellement significatif.
En ce qui concerne la composition du poème, on peut noter que l'auteur a choisi une taille assez simple à comprendre (iamb tétramètre), ce qui confirme une fois de plus son intention de souligner la simplicité et la simplicité de la forme, qui recule devant le contenu. . Cela est également prouvé par le fait que l'œuvre n'est pas surchargée de tropes créés artificiellement. Sa beauté et son charme résident dans son naturel. Même si on ne peut s'empêcher de remarquer la présence d'allitération. "Le bruissement des rêves", "le bruissement des nouvelles et des vérités" - en ces termes, la répétition fréquente des sifflements et des sifflements crée une atmosphère de paix, de silence, de tranquillité et de mystère. Après tout, vous ne pouvez parler de l'essentiel que de la manière dont Pasternak le fait - doucement, à voix basse... Après tout, c'est un secret.
Pour terminer ma réflexion, j'ai involontairement envie de paraphraser l'auteur lui-même : lire d'autres poèmes est une lourde croix, mais celui-ci est vraiment « beau sans détours ».
Dans la vie de Pasternak, trois femmes ont réussi à conquérir son cœur. Un poème est dédié à deux des amants, dont l'analyse est présentée dans l'article. Il est étudié en 11e année. Nous vous invitons à vous familiariser avec une brève analyse de « Aimer les autres est une lourde croix » selon le plan.
Brève analyse
Histoire de la création- l'œuvre a été écrite à l'automne 1931, deux ans après sa rencontre avec Zinaida Neuhaus.
Thème du poème- Amour; qualités d'une femme qui méritent l'amour.
Composition– Le poème a été créé sous la forme d’un monologue-adresse à un être cher. Il est laconique, mais néanmoins divisé en parties sémantiques : la tentative du héros de percer le mystère de la beauté particulière de sa bien-aimée, de brèves réflexions sur la capacité de vivre sans « sale » dans le cœur.
Genre- élégie.
Taille poétique– écrit en tétramètre iambique, rime croisée ABAB.
Métaphores – « aimer les autres est une lourde croix », « votre charme équivaut au secret de la vie », « le bruissement des rêves », « le bruissement des nouvelles et des vérités », « secouer les ordures verbales du cœur ».
Épithètes – « tu es belle », « le sens... est altruiste », « ce n'est pas un gros truc ».
Comparaison – "Votre signification est comme l'air."
Histoire de la création
L'histoire de la création du poème doit être trouvée dans la biographie de Pasternak. La première épouse du poète était Evgenia Lurie. La femme était une artiste, donc elle n’aimait pas et ne voulait pas s’occuper de la vie quotidienne. Boris Leonidovich devait s'occuper lui-même des tâches ménagères. Pour le bien de sa femme bien-aimée, il a appris à cuisiner et à faire la lessive, mais cela n’a pas duré longtemps.
En 1929, le poète rencontre Zinaida Neuhaus, l'épouse de son ami pianiste Heinrich Neuhaus. Pasternak a immédiatement aimé cette jolie et modeste femme. Une fois qu'il lui a lu ses poèmes, au lieu de louanges ou de critiques, Zinaida a déclaré qu'elle ne comprenait rien à ce qu'elle lisait. L'auteur a aimé cette sincérité et cette simplicité. Il a promis d'écrire plus clairement. La relation amoureuse entre Pasternak et Neuhaus se développe, elle quitte son mari et devient la nouvelle muse du poète. En 1931, le poème analysé paraît.
Sujet
Le poème développe le thème de l’amour, populaire dans la littérature. Les circonstances de la vie du poète laissent une empreinte sur les lignes de l’œuvre, il faut donc lire les poèmes dans le contexte de la biographie de Pasternak. Le héros lyrique de l'œuvre se confond complètement avec l'auteur.
Dans la première ligne, Pasternak fait allusion à une relation avec Evgenia Lurie, qu'il n'était vraiment pas facile d'aimer, car la femme était colérique et capricieuse. Ensuite, le héros lyrique se tourne vers sa bien-aimée. Il considère que son avantage est « l’absence de circonvolutions », c’est-à-dire une intelligence pas trop élevée. Le poète pense que c’est ce qui donne son charme à une femme. Un tel représentant de la gent féminine est plus féminin et peut être une excellente femme au foyer.
L'auteur estime que la bien-aimée ne vit pas tant avec son esprit qu'avec ses sentiments, c'est pourquoi elle peut entendre des rêves, des nouvelles et des vérités. Elle est aussi naturelle que l'air. Dans la dernière strophe, le poète admet qu'à côté d'une telle femme, il lui est facile de changer. Il s’est rendu compte qu’il est très facile de « secouer les ordures verbales du cœur » et d’éviter de nouvelles contaminations.
Composition
Le poème est créé sous la forme d'un monologue-adresse à un être cher. Il peut être divisé en parties sémantiques : la tentative du héros de percer le mystère de la beauté particulière de sa bien-aimée, de brèves réflexions sur la capacité de vivre sans « sale » dans le cœur. Formellement, l'œuvre se compose de trois quatrains.
Genre
Le genre du poème est l'élégie, car l'auteur réfléchit sur un problème éternel ; dans le premier vers, on ressent de la tristesse, apparemment parce qu'il a ressenti cette « lourde croix » sur lui-même. Il y a aussi des signes d'un message dans l'œuvre. Le mètre poétique est le tétramètre iambique. L'auteur utilise la rime croisée ABAB.
Des moyens d'expression
Pour révéler le thème et créer l'image d'une femme idéale, Pasternak utilise des moyens artistiques. Joue le rôle principal métaphore: « aimer les autres est une lourde croix », « votre charme équivaut au secret de la vie », « le bruissement des rêves », « le bruissement des nouvelles et des vérités », « secouer les ordures verbales du cœur ».
Beaucoup moins dans le texte épithètes: « tu es belle », « le sens... est altruiste », « ce n'est pas un gros truc ». Comparaison juste une chose : « votre signification est comme l’air ».
Ce poème a été écrit en 1931. La période créatrice depuis 1930 peut être qualifiée de particulière : c'est alors que le poète a glorifié l'amour comme un état d'inspiration et de fuite, et est parvenu à une nouvelle compréhension de l'essence et du sens de la vie. Soudain, il commence à comprendre différemment le sentiment terrestre dans sa signification existentielle et philosophique. Une analyse du poème « Aimer les autres est une lourde croix » est présentée dans cet article.
Histoire de la création
L'œuvre lyrique peut être qualifiée de révélation, car Boris Pasternak y a capturé les relations difficiles avec deux femmes importantes de sa vie - Evgenia Lurie et Zinaida Neuhauz. La première dame était sa femme au tout début de sa carrière littéraire, et le poète rencontra la seconde bien plus tard. Evgenia faisait à peu près le même cercle que le poète, il savait comment elle vivait et respirait. Cette femme comprenait l’art, et la littérature en particulier.
Zinaida, quant à elle, était une personne loin de la vie de bohème, elle s'acquittait bien des tâches quotidiennes d'une femme au foyer. Mais pour une raison quelconque, à un moment donné, c’est la femme simple qui s’est révélée plus compréhensible et plus proche de l’âme raffinée du poète. Personne ne sait pourquoi cela s'est produit, mais peu de temps après, Zinaida est devenue l'épouse de Boris Pasternak. L'analyse poétique « Aimer les autres est une lourde croix » souligne la profondeur et la tension de ces relations difficiles avec deux femmes. Le poète les compare involontairement et analyse ses propres sentiments. Telles sont les conclusions individuelles auxquelles Pasternak arrive.
« Aimer les autres est une lourde croix » : analyse
Ce poème peut peut-être être considéré comme l’une des créations poétiques les plus mystérieuses. La charge sémantique de cette œuvre lyrique est très forte, elle coupe le souffle et excite l'âme des vrais esthètes. Boris Pasternak lui-même (« Aimer les autres est une lourde croix ») a qualifié l’analyse de ses propres sentiments de plus grand mystère insoluble. Et dans ce poème, il veut comprendre l'essence de la vie et sa composante intégrale - l'amour pour une femme. Le poète était convaincu que l'état de tomber amoureux change tout à l'intérieur d'une personne : des changements importants se produisent en elle, la capacité de penser, d'analyser et d'agir d'une certaine manière est révisée.

Le héros lyrique éprouve un sentiment de respect pour une femme, il est déterminé à agir pour le développement d'un sentiment grand et brillant. Tous les doutes s’éloignent et passent au second plan. Il est tellement émerveillé par la grandeur et la beauté de l'état d'intégrité qui s'est révélé à lui qu'il éprouve la joie et le ravissement, l'impossibilité de vivre plus loin sans ce sentiment. L’analyse de « Aimer les autres est une lourde croix » révèle la transformation des expériences du poète.
L'état du héros lyrique
Au centre se trouve celui qui vit le plus directement toutes les transformations. le héros lyrique change à chaque nouveau vers. Sa compréhension antérieure de l'essence de la vie est remplacée par une compréhension complètement nouvelle et acquiert une nuance de sens existentiel. Que ressent le héros lyrique ? Il a soudainement trouvé un refuge, une personne qui pouvait l'aimer de manière altruiste. Dans ce cas, le manque d'éducation et la capacité de pensées élevées sont perçus par lui comme un don et une grâce, comme en témoigne la phrase : « Et tu es belle sans circonvolutions ».

Le héros lyrique est prêt à se consacrer à percer le mystère de sa bien-aimée jusqu'à la fin de ses jours, c'est pourquoi il le compare au mystère de la vie. Un besoin urgent de changement s'éveille en lui, il a besoin de se libérer du fardeau des déceptions et des défaites antérieures. L'analyse de « Aimer les autres est une lourde croix » montre au lecteur à quel point des changements profonds et significatifs ont eu lieu chez le poète.
Symboles et significations
Ce poème utilise des métaphores qui sembleraient incompréhensibles au commun des mortels. Pour montrer toute la puissance de la renaissance en cours dans l’âme du héros, Pasternak met en mots certaines significations.
« Le bruissement des rêves » personnifie le mystère et l'incompréhensibilité de la vie. C’est quelque chose de véritablement insaisissable et perçant, qui ne peut être compris uniquement par la raison. Il faut aussi connecter l’énergie du cœur.

« Le bruissement des nouvelles et des vérités » désigne le mouvement de la vie, quels que soient les manifestations, chocs et événements extérieurs. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, la vie continue étonnamment son mouvement inexorable. Contre toute attente. Contrairement à cela.
Les « déchets verbaux » symbolisent les émotions négatives, les expériences du passé et les griefs accumulés. Le héros lyrique parle de la possibilité d'un renouveau, de la nécessité d'une telle transformation pour soi. L'analyse « Aimer les autres est une lourde croix » souligne l'importance et la nécessité du renouveau. L'amour devient ici un concept philosophique.
Au lieu d'une conclusion
Le poème laisse des sentiments agréables après la lecture. J'aimerais m'en souvenir longtemps et du sens qu'il contient. Pour Boris Leonidovich, ces lignes sont une révélation et un secret de polichinelle sur la transformation de l'âme, et pour les lecteurs, une autre raison de réfléchir à leur propre vie et à ses nouvelles possibilités. L’analyse du poème de Pasternak « Aimer les autres est une lourde croix » représente une révélation très profonde de l’essence et du sens de l’existence humaine dans le contexte d’une existence humaine unique.
Aimer les autres est une lourde croix,
Et tu es belle sans girations,
Et ta beauté est un secret
Cela équivaut à la solution à la vie.
Au printemps le bruissement des rêves se fait entendre
Et le bruissement des nouvelles et des vérités.
Vous venez d’une famille dotée de tels fondamentaux.
Votre sens, comme l'air, est altruiste.
Il est facile de se réveiller et de voir clairement,
Secouez les déchets verbaux du cœur
Et vivre sans s'encombrer du futur,
Tout cela n'est qu'un petit truc.
Analyse du poème « Aimer les autres est une lourde croix » de Pasternak
Le travail de B. Pasternak reflète toujours ses sentiments et expériences personnels. Il a consacré plusieurs de ses œuvres à ses relations amoureuses. L’un d’eux est le poème « Aimer les autres est une lourde croix ». Pasternak était marié à E. Lurie, mais son mariage ne pouvait pas être qualifié d'heureux. L'épouse du poète était artiste et souhaitait consacrer toute sa vie à l'art. Elle ne faisait pratiquement pas le ménage, le mettant sur les épaules de son mari. En 1929, Pasternak rencontre la femme de son ami, Z. Neuhaus. Il voyait en cette femme un exemple idéal de maîtresse de foyer familial. Littéralement immédiatement après sa rencontre, le poète lui a dédié un poème.
L’auteur compare son amour pour sa femme au fait de porter une « lourde croix ». Les activités créatives les rapprochaient autrefois, mais il s'est avéré que cela ne suffisait pas pour la vie de famille. E. Lurie a négligé ses responsabilités féminines directes pour peindre un nouveau tableau. Pasternak devait cuisiner et faire la lessive lui-même. Il s'est rendu compte qu'il était peu probable que deux personnes douées soient capables de créer une famille confortable et ordinaire.
L'auteur oppose sa nouvelle connaissance à sa femme et souligne immédiatement son principal avantage: "tu es belle sans girations". Il laisse entendre qu'E. Lurie est bien instruite et que vous pouvez parler avec elle sur un pied d'égalité sur les sujets philosophiques les plus complexes. Mais les conversations « savantes » n’apporteront pas le bonheur dans la vie de famille. Z. Neuhaus a presque immédiatement admis au poète qu'elle ne comprenait rien à ses poèmes. Pasternak a été touché par cette simplicité et cette crédulité. Il s’est rendu compte qu’une femme ne devait pas être valorisée pour sa grande intelligence et son éducation. L’amour est un grand mystère qui ne peut se fonder sur les lois de la raison.
Le poète voit le secret du charme de Z. Neuhaus dans la simplicité et l'altruisme de sa vie. Seule une telle femme est capable de créer une atmosphère familiale calme et d'apporter du bonheur à son mari. Pasternak est prêt à descendre des hauteurs créatives stratosphériques pour elle. Il a en fait promis à Z. Neuhaus qu'il se séparerait des symboles vagues et peu clairs et commencerait à écrire des poèmes dans un langage simple et accessible (« des détritus verbaux... secouez-vous »). Après tout, ce n’est « pas un gros truc », mais la récompense en sera le bonheur familial tant attendu.
Pasternak a pu emmener la femme de son ami. À l'avenir, le couple a encore connu des problèmes familiaux, mais Z. Neuhaus a grandement influencé le poète et son œuvre.