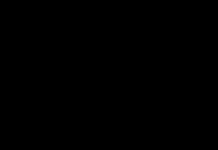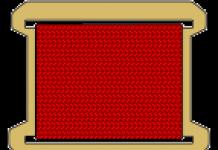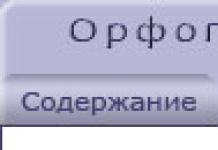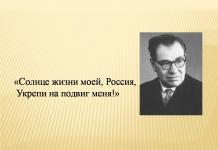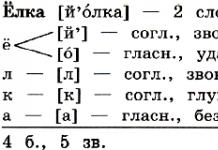100 roubles bonus pour la première commande
Sélectionnez le type de travail Travail d'études supérieures Travaux de cours Résumé Mémoire de maîtrise Rapport sur la pratique Article Rapport Revue Test Monographie Résolution de problèmes Plan d'affaires Réponses aux questions Travail créatif Essai Dessin Essais Traduction Présentations Dactylographie Autre Augmenter l'unicité du texte Mémoire de maîtrise Travaux de laboratoire Aide en ligne
Découvrez le prix
Les principales catégories de la sociologie du travail comprennent le comportement social et ses modifications - travail, économique, organisationnel, fonctionnel, de communication, de production, démographique, normatif et déviant. Ils reflètent les propriétés des principaux sujets de la vie sociale : individus, groupes et collectifs. Comportement social - une composante dérivée de l'environnement social, qui se réfracte en caractéristiques et actes subjectifs personnages, ainsi que le résultat de la détermination subjective de l'activité humaine.
Dans ce sens comportement social peut être compris comme un processus d'activité ciblée conformément aux intérêts et aux besoins importants d'une personne. D'une part, il s'agit d'un système complexe d'adaptation de l'individu à diverses conditions, un mode de fonctionnement dans le système d'une société particulière. Avec un autre - forme active transformations et changements de l'environnement social conformément aux possibilités objectives qu'une personne conçoit et découvre de manière indépendante par elle-même, conformément à ses propres idées, valeurs et idéaux. Variété comportement social est l'activité de travail et le comportement au travail.
Il est nécessaire de distinguer ces concepts. Activité de travail — Il s'agit d'une série d'opérations et de fonctions strictement fixées dans le temps et dans l'espace et exécutées par des personnes réunies dans une organisation de production. Comportement au travail — Ce sont des actions individuelles et collectives qui montrent le sens et l'intensité de la mise en œuvre du facteur humain dans une organisation de production. Ce un ensemble d'actions et de comportements consciemment réglementés d'un employé associé à la coïncidence des capacités et des intérêts professionnels avec les activités de l'organisation de production et du processus de production.
Structure du comportement au travail peut être représenté comme suit :
- des actions répétitives cycliquement, du même type en résultat, reproduisant des situations ou des états standard statut-rôle ;
— les actions et comportements marginaux qui se forment dans les phases de transition d'un statut à un autre ;
— les modèles de comportement et les stéréotypes, modèles de comportement fréquents ;
- des actions basées sur des schémas sémantiques rationalisés traduits en croyances stables ;
- les actions menées sous les exigences de certaines circonstances ;
- actions spontanées et actions provoquées état émotionnel;
— répétition consciente ou inconsciente de stéréotypes de comportement de masse et de groupe ;
— les actions et les actes comme transformation de l'influence d'autres sujets utilisant diverses formes de coercition et de persuasion.
Le comportement au travail peut être différencié selon les critères suivants :
1. selon l'orientation sujet-cible, c'est-à-dire selon ce à quoi elle vise ;
2. approfondir la perspective spatio-temporelle de la réalisation d'un certain objectif ;
3. selon le contexte du comportement de travail, c'est-à-dire selon un complexe de facteurs relativement stables de l'environnement de production, des sujets et des systèmes de communication, en interaction avec lesquels se déroule toute la variété des actions et des actions ;
4. sur les méthodes et moyens d'obtenir des résultats spécifiques, en fonction de l'orientation sujet-cible du comportement au travail et de ses modèles socioculturels ;
5. par profondeur et type de rationalisation, justification de tactiques et stratégies spécifiques de comportement au travail, etc.
Alors, le comportement au travail :
1) reflète l'algorithme fonctionnel du processus de production, est un analogue comportemental de l'activité de travail ;
2) est une forme d'adaptation de l'employé aux exigences et aux conditions du processus technologique et de l'environnement social ;
3) agit comme une manifestation dynamique des normes sociales, des stéréotypes et des attitudes professionnelles intériorisées par l'individu dans le processus de socialisation et d'expérience de vie spécifique ;
4) reflète les traits caractéristiques de la personnalité du salarié ;
5) il existe une certaine manière et certains moyens d'influence humaine sur l'environnement industriel et social environnant.
Types de comportement au travail, mécanisme de régulation
Dans la littérature spécialisée, on peut trouver diverses classifications des types de comportement au travail. Cela dépend de ce qui est pris comme base. En conséquence, nous pouvons proposer différentes sortes comportement au travail :
|
Base de classification |
Types de comportement au travail |
|
1. Sujets de comportement |
Individuel, collectif |
|
2. Présence (absence) d'interaction |
En supposant une interaction, sans impliquer une interaction |
|
3. Fonction de production |
Performance, gestion |
|
4. Degré de déterminisme |
Strictement déterminé, proactif |
|
5. Degré de conformité aux normes acceptées |
Normatif, s'écartant des normes |
|
6. Degré de formalisation |
Établi dans des documents officiels, non identifié |
|
7. Nature de la motivation |
Basé sur des valeurs, situationnel |
|
8. Résultats opérationnels et conséquences |
Positif négatif |
|
9. Portée du comportement |
Le processus de travail réel, l'établissement de relations dans la production, la création d'une atmosphère de travail |
|
10. Degré de comportement traditionnel |
Types de comportements établis, types émergents, y compris sous la forme d'une réaction à diverses actions socio-économiques |
|
11. Résultats et conséquences du point de vue des destinées humaines |
Correspondant aux schémas de vie professionnelle souhaités, non conforme |
|
12. Degré de réalisation du potentiel de travail |
Ne nécessitant pas de changement dans le degré atteint de réalisation du potentiel de travail, entraînant la nécessité d'une mobilisation significative de diverses composantes du potentiel de travail (en tant qu'ensemble de qualités des employés) |
|
13. La nature de la reproduction du potentiel de travail |
En supposant une reproduction simple du potentiel de travail, nécessitant une reproduction élargie du potentiel de travail |
Il est pratiquement difficile de limiter les types de comportement au travail à cette liste. Pour identifier le degré de mise en œuvre des types de comportement positifs traditionnels, les enquêtes sociologiques comprennent généralement un bloc de questions qui reflètent les exigences de production du salarié et correspondent à l'idée dominante d'un « bon » ou d'un « mauvais ». " employé. Ainsi, lors d'une enquête sociologique auprès des travailleurs, il s'agit généralement de détecter le désir et le fait même de manifestation d'un comportement socialement approuvé selon les caractéristiques suivantes :
— le respect et le dépassement des normes de production ;
— améliorer la qualité de notre travail et de nos produits ;
— rationalisation et activités inventives;
— le respect exact des exigences de la technologie de production ;
— économie de matières premières, de carburant, d'électricité ;
- prendre soin des machines et des mécanismes ;
— formation avancée et compétences commerciales, etc. Tous ces types de comportements peuvent être qualifiés de performants. Le comportement managérial inclut traditionnellement la participation des travailleurs à la gestion de la production, à l'échange d'expériences, etc. Bien entendu, lors de la caractérisation du comportement au travail, il est nécessaire de faire preuve de flexibilité.
Le comportement du travail se forme sous l'influence de divers facteurs : principalement les caractéristiques sociales et professionnelles des travailleurs, les conditions de travail au sens large du terme (y compris les conditions de travail et de vie dans la production, les salaires, etc.), un système de normes et de valeurs , et les motivations du travail. Elle est orientée par les intérêts personnels et collectifs des personnes et sert à satisfaire leurs besoins.
De nombreux facteurs influencent le comportement humain dans une organisation. Lorsqu'ils postulent à un emploi, le candidat à un certain poste dans l'organisation et l'employeur négocient une sorte de contrat concernant les attentes mutuelles. L'employeur attend de l'employé qu'il exécute des fonctions standard, résolve des problèmes standard et, par conséquent, se comporte d'une manière conforme à ces normes. À son tour, l'employé s'attend à recevoir une récompense bien méritée, à se voir confier des tâches réalisables et à disposer de toutes les ressources nécessaires, notamment de l'équipement, de la formation et d'un leadership efficace. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure de se conformer aux normes, et surtout tout le monde n'est pas en mesure de trouver une solution créative à un problème non standard dans des conditions d'incertitude. Afin de comprendre ce qui motive une personne lorsqu’elle prend une décision et entreprend une action, il est nécessaire de comprendre ce qui influence son comportement. Avant de commencer à comprendre la structure comportement individuel, nous devons déterminer concepts de base, qui sont utilisés pour décrire le comportement humain.
Individuel - personne spécifique avec tous ses caractéristiques individuelles
Personnalité- un ensemble de valeurs socialement significatives propriétés mentales, les relations et les actions d'une personne qui se sont développées au cours de son développement et déterminent son comportement.
Sujet- une source d'activité utile. A la capacité de fixer des objectifs, de déterminer les moyens pour atteindre les objectifs, de planifier et de mettre en œuvre des actions
Individualité- totalité traits caractéristiques et les propriétés qui distinguent un individu d'un autre, son originalité, son caractère unique
Le comportement humain est influencé par de nombreux facteurs. Parmi les principaux facteurs figurent les suivants :
Facteurs héréditaires.
Facteurs socioculturels. Ce sont des facteurs qui influencent une personne à partir de l'environnement. Ceux-ci incluent des facteurs externes, influencer le comportement humain, comme:
o origine sociale ;
o environnement culturel ;
o expérience professionnelle ;
o situation économique ;
o expérience en communication.
Facteurs moraux. Ce sont des valeurs et des normes de comportement partagées. Dans la structure de la personnalité, ils jouent un rôle fondamental et clé, puisqu'ils constituent une loi pour une personne, des facteurs objectifs de son comportement. Les normes et les valeurs apparaissent à travers la socialisation de l'individu, à travers l'assimilation de modèles et de lignes directrices culturelles.
Formation d'une structure de comportement. La structure de la personnalité d’une personne n’est pas une structure figée et complète. Il peut plutôt être décrit comme un système dynamique qui évolue constamment sous l’influence de facteurs internes et externes. Très souvent, les psychologues disent que la principale caractéristique d'une personnalité saine est comportement adaptatif, dans un comportement axé sur la satisfaction de ses besoins dans les conditions existantes. Outre le développement de caractéristiques physiologiques, chez l'homme âge mûr La capacité d'apprendre de nouvelles choses se développe. Ce processus est appelé apprentissage.
Théorie des traits explique le comportement humain en fonction d'eux : lent - agile, intelligent - stupide, etc. Très souvent, les raisons du comportement d'une personne sont déterminées par les facteurs qui ont provoqué ce comportement - internes (sous le contrôle personnel de la personne) ou externes (sous l'influence de circonstances extérieures, sont des éléments d'une situation objectivement existante).
Les régulateurs externes et internes déterminent les éléments suivants caractéristiques du comportement personne:
- Caractéristique- si le comportement se répète dans diverses circonstances extérieures, il s'agit alors d'un trait de personnalité d'une personne. Si le comportement change en fonction de la situation extérieure, cela est dû à des raisons externes
- Cohérence- si le comportement dans une certaine situation est une réaction standard universelle, alors nous devrions parler de cohérence du comportement
- Cohérence- la cohérence du comportement d'une personne, une attitude stable ou, au contraire, chaotique envers sa propre action indique la cohérence (ou l'incohérence) d'une personne
Le processus de formation des rôles dans une équipe.
Les relations au sein de l'équipe donnent lieu à l'émergence de certains rôles de production. Un rôle détermine comment on doit se comporter envers les autres et ce qu'on peut attendre d'eux. Certains droits, responsabilités et attentes sont toujours associés à un rôle, et celui qui ne les respecte pas est passible de sanctions, et celui qui les justifie est récompensé. Personnes différentes ont souvent des valeurs et des idées différentes sur le même rôle et s'y comportent différemment.
Les rôles dans l'équipe sont divisés en :
- production(fonctionnel et social)
- interpersonnel.
Les experts identifient huit rôles de production, qui ont reçu des noms uniques : passionné, chercheur de bénéfices, interprète et assistant.
"Coordinateur" possède les plus grandes capacités organisationnelles et devient généralement le leader d'une équipe, quelles que soient ses connaissances et son expérience. Sa principale responsabilité est de pouvoir travailler avec ceux qui possèdent de telles connaissances et expériences et d'orienter leurs activités pour atteindre leurs objectifs.
"Générateur d'idées", en règle générale, le membre le plus compétent et le plus talentueux de l'équipe. Il développe des options pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, mais en raison de sa passivité, de son manque de concentration, etc., il n'est pas en mesure de les mettre en pratique.
"Manette" Lui-même n'est pas capable de penser de manière créative, mais grâce à ses connaissances approfondies, son expérience et son érudition, il peut évaluer correctement n'importe quelle idée, identifier ses forces et ses faiblesses et encourager les autres à travailler à son amélioration ultérieure.
"Broyeur" a une vision large du problème et donc, si nécessaire, sait « lier » sa solution avec les autres tâches de l'équipe.
"Passionné"- le membre le plus actif de l'équipe ; Par son exemple, il inspire son entourage à passer à l’action pour atteindre son objectif.
"Chercheur d'avantages"- un médiateur dans les relations internes et externes, donnant une certaine unité aux actions des membres de l'équipe.
"Exécuteur" met consciencieusement en œuvre les idées des autres, mais a en même temps besoin de conseils et d'encouragements constants.
"Assistant"- une personne qui ne recherche personnellement rien, se contente de seconds rôles, mais est toujours prête à aider les autres dans le travail et dans la vie.
Il peut aussi y avoir auxiliaire rôles (par exemple, "bouffon").
On pense que l'équipe fonctionnera normalement si les rôles énumérés sont entièrement répartis et exécutés consciencieusement. S'il y a moins de huit membres, quelqu'un devra jouer simultanément deux rôles ou plus, ce qui entraînera inévitablement des conflits. Cette circonstance est l'une des raisons du manque de stabilité des petites équipes. Par conséquent, il est préférable aux équipes de 10 à 12 personnes dans leurs rangs, dans lesquelles l'équilibre interne est atteint beaucoup plus facilement, mais avec une nouvelle croissance du nombre de membres, elles deviennent moins gérables.
Par rôles liés à les relations interpersonnelles, les membres de l'équipe sont généralement divisés en
- menant - préféré (« stars », faisant autorité, ambitieux, autrement attrayant pour les autres) ;
- des esclaves- tous les autres, y compris ceux qui ne sont pas préférés, avec lesquels ils ne coopèrent que par la force et les rendent responsables de tout.
Du point de vue de l'attitude envers le groupe et ses normes, se distinguent :
- conformistes(conscient et inapproprié, c'est-à-dire accepter pour le bien de l'apparence) ;
- non-conformistes(d'accord avec la position du groupe, mais opposé à la raisons externes);
- négativistes(qui ne reconnaissent pas les opinions du groupe, y compris à leur propre détriment, souvent par esprit de contradiction).
Les membres de l'équipe peuvent être actif ou passif, inerte, avec des attitudes basses, en quête de soumission.
Le degré de reconnaissance qu'un groupe accorde à ses membres s'appelle le prestige. Conformément aux niveaux de cette échelle, les personnes sont divisées en un certain nombre positions sociales, dont chacun a ses propres normes de comportement et ses attentes. Un poste prestigieux est dynamique et n'est pas attribué de manière permanente à une personne, elle peut donc évoluer sur l'échelle de prestige. Le prestige peut être :
- personnel basé sur des traits individuels ;
- fonctionnel lié à l'autorité dans la hiérarchie organisationnelle ;
- positionnel- basé sur une évaluation synthétique.
Sociogramme de l'équipe.
Dans le schéma traditionnel de formation d'équipe, une structure organisationnelle est d'abord créée, puis elle est « remplie » de personnes dont les relations se développent spontanément, ce qui est loin d'être optimal. Les goûts et les aversions formés sont transformés en préférences, reflétant le désir et la réticence des autres à coopérer avec une personne donnée. L'identification des individus ou des groupes souhaitant coopérer se développe sur la base d'une des variantes de la méthode socio-graphique.
n1.docx
Isolement dans l'ontogenèseLes reins d'un nouveau-né présentent des signes d'immaturité morphologique et fonctionnelle. Le diamètre des glomérules est petit, les tubules contournés sont petits et les anses de Henle sont sous-développées. Le nombre de glomérules par unité de surface chez un nouveau-né est 5 à 7 fois plus élevé que chez un adulte. Cela permet aux reins de l’enfant de maintenir l’homéostasie eau-sel, mais uniquement dans des conditions de repos du corps et avec une alimentation et une consommation d’eau équilibrées. Dans des situations extrêmes, comme certaines maladies, les reins des enfants sont moins fiables que ceux des adultes, ce qui peut entraîner des modifications de l'homéostasie. Vers l'âge de 1 à 3 ans, la fonction excrétrice se développe proportionnellement à l'augmentation de la taille corporelle. Le travail des reins devient plus efficace, mais le système excréteur en termes de développement est encore en retard par rapport au système excréteur d'un adulte.
Comportement, ses composants, structure. Formes de comportement. Le rôle du génotype et de l'environnement dans l'organisation du comportement de l'enfant.
Théorie réflexe du comportement. Caractéristiques des réflexes inconditionnés et conditionnés. Inhibition des réflexes conditionnés, types, formation en cours d'ontogenèse.
Une activité nerveuse plus élevée se distingue parmi d'autres physiologiques
fonctions physiques en ce sens qu'elles sont associées à des phénomènes mentaux
vie humaine. Alors qu'une activité nerveuse inférieure est réalisée
établit une régulation réflexe état interne et fonctionnel
nivellement diverses pièces corps, activité nerveuse plus élevée
assure un comportement approprié dans des conditions changeantes
vie : apprentissage et formation de la conscience. Activité nerveuse plus élevée
croissance développée sur la base du mécanisme physiologique de
formation de connexions temporaires.
Réactions réflexes qui peuvent assurer l'existence
organisme uniquement lorsque l'environnement est relativement constant,
sont appelés réflexes inconditionnés. Et puisque les conditions existent
les fonctions du corps sont très complexes et changeantes, puis adaptation
son apport à l'environnement doit être apporté à l'aide d'un autre type de réaction
des solutions qui permettraient à l’organisme de répondre adéquatement à tous
changements environnementaux. De telles réactions sont conditionnelles
aucun réflexe. Le réflexe conditionné est individuellement
réactions humaines systémiques acquises survenant sur la base de
ve éducation dans le centre système nerveux connexion temporaire entre
J'attends comme un stimulus conditionné et un acte réflexe inconditionnel.
13.1. Types de réflexes conditionnés
Pour la formation de réflexes conditionnés, il faut que :
le développement du stimulus conditionné a coïncidé dans le temps avec l'action du stimulus
un teaser qui provoque un réflexe inconditionné ; stimulus conditionné
le corps était physiologiquement plus faible que le corps inconditionné ; action
le stimulus conditionné a précédé l’action de l’inconditionnel. Conditions
le réflexe ne peut être réalisé que dans un état normal
cortex cérébral et en l'absence de stimuli étrangers.
Le réflexe conditionné se caractérise par les caractéristiques suivantes : il
a un caractère adaptatif et rend le comportement particulièrement
en plastique, adapté à des conditions spécifiques ; formé avec la participation du cortex cérébral; est acquis
et est individuel ; a un caractère de signalisation, c'est-à-dire Toujours
précède l'émergence d'un réflexe inconditionné.
On distingue les groupes de réflexes conditionnés suivants :
Par renforcement : positif (renforcé) et négatif
nal (inhibiteur, non pris en charge, qui non seulement ne provoquent pas
réaction correspondante, mais aussi l'inhiber);
Selon l'importance biologique : vitale (nutritive, défensive
nal, régulation du sommeil), zoosocial (sexuel, parental, territorial
didacticiel), les réflexes de développement personnel (recherche, jeu,
imitation);
Selon les caractéristiques du renforcement : réflexe de premier ordre, réflexe
deuxième ordre, etc.;
Selon la qualité du signal conditionné : extéroceptif lointain (visuel)
corporel, auditif), contact extéroceptif (tactile, gustatif)
élevé), intéroceptif (mécanique, thermique, osmotique ;
se forment plus lentement que les extéroceptifs, et la réponse
plus diffus) ;
De par la nature de la stimulation conditionnée : naturelle (formée sur
signes naturels d'irritation inconditionnelle - l'odeur de la nourriture)
et artificiel (pour tout autre signal conditionné ; produire -
sont plus lents et se décomposent plus facilement que les naturels) ;
Selon la structure du signal conditionné : réflexe conditionné à un simple
teaser (cloche, lumière), réflexe conditionné aux successions
un complexe de stimuli, un réflexe conditionné à une chaîne de stimuli ;
Selon la relation dans le temps du stimulus conditionné et inconditionné.
coïncidant, retardé, retardé.
13.2. Le mécanisme de fermeture réflexe conditionnée
La structure d'un réflexe conditionné est une connexion temporaire,
fermeture dans le cortex entre le centre du stimulus conditionné-
corps et cellules de la représentation corticale du réflexe inconditionné.
On pense que la fermeture d'une connexion temporaire est effectuée par
neurones éternels du cortex, mais son mécanisme n'est pas bien compris.
L'explication morphologique suggère que lors de la formation
Lorsque le réflexe conditionné cesse, les processus des cellules nerveuses se développent,
établir de nouvelles connexions intercellulaires. Portée fonctionnelle
des éclaircissements suggèrent une conductivité accrue des
Synapses. Le facteur principal dans l'émergence d'une connexion temporaire d'un réflexe conditionné est considéré comme une modification de la synthèse protéique dans la cellule. Co-
l'excitation conjointe de nombreux neurones se reflète dans la structure de l'ARN,
dans lequel le signal de stimulation est codé. Ceci est confirmé par
C'est la présence d'une « mémoire chimique ». On suppose également que
la trace mnésique se fixe sur des molécules d'ADN, qui la préservent
plus long que l’ARN synthétisé rapidement.
13.3. Activité réflexe conditionnée
Dans l'ontogenèse
Il est impossible pour un fœtus de développer un réflexe conditionné. Même en pré-
Chez les enfants pauvres, le réflexe conditionné n'est noté qu'à l'âge de 1,5 à 2 mois.
Syatsev. À la fin de la première semaine de vie, un nouveau-né développe
a le premier réflexe conditionné pendant l'alimentation. 30 minutes avant de nourrir
une leucocytose et une augmentation des échanges gazeux sont détectées chez l'enfant,
puis l'enfant se réveille. D'ici la fin de la 2ème semaine, sous condition
réflexe de succion vers la « position d'alimentation ». Puis l'image
il existe des réflexes conditionnés aux stimuli olfactifs et gustatifs,
plus tard - aux stimuli cutanés et visuels. Conditions
les réflexes chez les nouveau-nés sont instables, importants
beaucoup plus difficile que pour les enfants plus âgés. Au premier semestre
vie, les réflexes conditionnés se développent plus rapidement que pendant la période
nouveau-né™ et devenez plus durable. Réflexe conditionné
l'activité active entre un et trois ans n'est pas caractérisée par
seulement par le développement de réflexes individuels conditionnés, mais aussi par la formation
niya stéréotypes dynamiques, et souvent plus un bref délais,
que chez les adultes. Un enfant de 2 ans produit grande quantité
réflexes conditionnés à la relation entre la taille, la gravité, la distance,
coloration des objets. Ce type de réflexes conditionnés est la base
concepts, - Systèmes les connexions conditionnées développées à cette époque sont différentes
sont particulièrement durables. La plupart d’entre eux conservent leur importance dans le présent
appréciation de la vie entière d'une personne. À l'âge de 3 à 5 ans, la condition s'améliore.
mais activité réflexe, le nombre d'activités dynamiques augmente
stéréotypes. La tranche d'âge de 7 à 11 ans se caractérise par une
renforcement des réflexes conditionnés, leur résistance aux influences extérieures
événements. A cette époque, lors de la formation de réflexes au complexe après-
stimuli agissant successivement, une réaction conditionnée est produite
s'applique à l'ensemble du complexe à la fois. Changements significatifs entre 12 et 18 ans
activité réflexe conditionnée des adolescents. À 13-15 ans, le taux de formation de réflexes conditionnés à immédiat (visuel)
physiques, auditifs et tactiles) augmentent, tandis que
comme processus de formation de réflexes conditionnés aux signaux verbaux
difficile. À 17-18 ans, une activité nerveuse plus élevée se normalise,
le corps est considéré comme mature.
Comportement communicatif. Comportement de communication non verbale et verbale. Bases neurophysiologiques de l'activité de la parole. Développement de la parole chez les enfants.
Sensation, perception : mécanismes neurophysiologiques, caractéristiques liées à l'âge.
Mécanismes neurophysiologiques de l'attention. Caractéristiques liées à l'âge de l'attention des enfants et des adolescents.
La motivation, les émotions, leur rôle dans le comportement de l’enfant. Manifestation externe d'émotions chez les enfants d'âges différents. Le rôle des émotions positives et négatives dans le processus d'éducation et d'éducation d'un enfant.
Mémoire, types, mécanismes neurophysiologiques. Caractéristiques liées à l'âge du développement de la mémoire chez les enfants.
Caractéristiques typologiques individuelles de l'enfant. Caractéristiques des principaux types d'enseignement supérieur activité nerveuse. Caractéristiques d'une activité nerveuse plus élevée chez les enfants et les adolescents.
Diagnostic complet du niveau de développement fonctionnel d'un enfant. La préparation de l'enfant à l'école.
Les reins d'un nouveau-né présentent des signes d'immaturité morphologique et fonctionnelle. Le diamètre des glomérules est petit, les tubules contournés sont petits et les anses de Henle sont sous-développées. Le nombre de glomérules par unité de surface chez un nouveau-né est 5 à 7 fois plus élevé que chez un adulte. Cela permet aux reins de l’enfant de maintenir l’homéostasie eau-sel, mais uniquement dans des conditions de repos du corps et avec une alimentation et une consommation d’eau équilibrées. Dans des situations extrêmes, comme certaines maladies, les reins des enfants sont moins fiables que ceux des adultes, ce qui peut entraîner des modifications de l'homéostasie. Vers l'âge de 1 à 3 ans, la fonction excrétrice se développe proportionnellement à l'augmentation de la taille corporelle. Le travail des reins devient plus efficace, mais le système excréteur en termes de développement est encore en retard par rapport au système excréteur d'un adulte.
33. Comportement, ses composants, structure. Formes de comportement. Le rôle du génotype et de l'environnement dans l'organisation du comportement de l'enfant.
34. Théorie réflexe du comportement. Caractéristiques des réflexes inconditionnés et conditionnés. Inhibition des réflexes conditionnés, types, formation en cours d'ontogenèse.
Une activité nerveuse plus élevée se distingue parmi d'autres physiologiques
fonctions physiques en ce sens qu'elles sont associées à des phénomènes mentaux
vie humaine. Alors qu'une activité nerveuse inférieure est réalisée
fournit une régulation réflexe de l'état interne et fonctionnel
ning de diverses parties du corps, activité nerveuse plus élevée
assure un comportement approprié dans des conditions changeantes
vie : apprentissage et formation de la conscience. Activité nerveuse plus élevée
croissance développée sur la base du mécanisme physiologique de
formation de connexions temporaires.
Réactions réflexes qui peuvent assurer l'existence
organisme uniquement lorsque l'environnement est relativement constant,
sont appelés réflexes inconditionnés. Et puisque les conditions existent
les fonctions du corps sont très complexes et changeantes, puis adaptation
son apport à l'environnement doit être apporté à l'aide d'un autre type de réaction
des solutions qui permettraient à l’organisme de répondre adéquatement à tous
changements environnementaux. De telles réactions sont conditionnelles
aucun réflexe. Le réflexe conditionné est individuellement
réactions humaines systémiques acquises survenant sur la base de
ve formations dans le système nerveux central de communication temporaire entre
J'attends comme un stimulus conditionné et un acte réflexe inconditionnel.
13.1. Types de réflexes conditionnés
Pour la formation de réflexes conditionnés, il faut que :
le développement du stimulus conditionné a coïncidé dans le temps avec l'action du stimulus
un teaser qui provoque un réflexe inconditionné ; stimulus conditionné
le corps était physiologiquement plus faible que le corps inconditionné ; action
le stimulus conditionné a précédé l’action de l’inconditionnel. Conditions
le réflexe ne peut être réalisé que dans un état normal
cortex cérébral et en l'absence de stimuli étrangers.
Le réflexe conditionné se caractérise par les caractéristiques suivantes : il
a un caractère adaptatif et rend le comportement particulièrement
en plastique, adapté à des conditions spécifiques ; formé avec la participation du cortex cérébral; est acquis
et est individuel ; a un caractère de signalisation, c'est-à-dire Toujours
précède l'émergence d'un réflexe inconditionné.
On distingue les groupes de réflexes conditionnés suivants :
par renfort : positif (renforcé) et négatif
nal (inhibiteur, non pris en charge, qui non seulement ne provoquent pas
réaction correspondante, mais aussi l'inhiber);
selon la signification biologique : vital (nourriture, défensive
nal, régulation du sommeil), zoosocial (sexuel, parental, territorial
didacticiel), les réflexes de développement personnel (recherche, jeu,
imitation);
selon les caractéristiques du renforcement : réflexe de premier ordre, réflexe
deuxième ordre, etc.;
selon la qualité du signal conditionné : extéroceptif lointain (visuel)
corporel, auditif), contact extéroceptif (tactile, gustatif)
élevé), intéroceptif (mécanique, thermique, osmotique ;
se forment plus lentement que les extéroceptifs, et la réponse
plus diffus) ;
par la nature de la stimulation conditionnée : naturelle (formée sur
signes naturels d'irritation inconditionnelle - l'odeur de la nourriture)
et artificiel (pour tout autre signal conditionné ; produire -
sont plus lents et se décomposent plus facilement que les naturels) ;
selon la structure du signal conditionné : réflexe conditionné à un simple
teaser (cloche, lumière), réflexe conditionné aux successions
un complexe de stimuli, un réflexe conditionné à une chaîne de stimuli ;
selon le rapport temporel du stimulus conditionné et inconditionné.
coïncidant, retardé, retardé.
13.2. Le mécanisme de fermeture réflexe conditionnée
La structure d'un réflexe conditionné est une connexion temporaire,
fermeture dans le cortex entre le centre du stimulus conditionné-
corps et cellules de la représentation corticale du réflexe inconditionné.
On pense que la fermeture d'une connexion temporaire est effectuée par
neurones éternels du cortex, mais son mécanisme n'est pas bien compris.
L'explication morphologique suggère que lors de la formation
Lorsque le réflexe conditionné cesse, les processus des cellules nerveuses se développent,
établir de nouvelles connexions intercellulaires. Portée fonctionnelle
des éclaircissements suggèrent une conductivité accrue des
synapses. Le facteur principal dans l'émergence d'une connexion temporaire d'un réflexe conditionné est considéré comme une modification de la synthèse protéique dans la cellule. Co-
l'excitation conjointe de nombreux neurones se reflète dans la structure de l'ARN,
dans lequel le signal de stimulation est codé. Ceci est confirmé par
C'est la présence d'une « mémoire chimique ». On suppose également que
la trace mnésique se fixe sur des molécules d'ADN, qui la préservent
plus long que l’ARN synthétisé rapidement.
13.3. Activité réflexe conditionnée
en ontogenèse
Il est impossible pour un fœtus de développer un réflexe conditionné. Même en pré-
Chez les enfants pauvres, le réflexe conditionné n'est noté qu'à l'âge de 1,5 à 2 mois.
Syatsev. À la fin de la première semaine de vie, un nouveau-né développe
a le premier réflexe conditionné pendant l'alimentation. 30 minutes avant de nourrir
une leucocytose et une augmentation des échanges gazeux sont détectées chez l'enfant,
puis l'enfant se réveille. D'ici la fin de la 2ème semaine, sous condition
réflexe de succion vers la « position d'alimentation ». Puis l'image
il existe des réflexes conditionnés aux stimuli olfactifs et gustatifs,
plus tard - aux stimuli cutanés et visuels. Conditions
les réflexes chez les nouveau-nés sont instables, importants
beaucoup plus difficile que pour les enfants plus âgés. Au premier semestre
vie, les réflexes conditionnés se développent plus rapidement que pendant la période
nouveau-né™ et devenez plus durable. Réflexe conditionné
l'activité active entre un et trois ans n'est pas caractérisée par
seulement par le développement de réflexes individuels conditionnés, mais aussi par la formation
l'élimination des stéréotypes dynamiques, et souvent dans un délai plus court,
que chez les adultes. Un enfant de 2 ans produit une quantité énorme
réflexes conditionnés à la relation entre la taille, la gravité, la distance,
coloration des objets. Ce type de réflexes conditionnés est la base
concepts, - Les systèmes de connexions conditionnelles développés à cette époque sont différents -
sont particulièrement durables. La plupart d’entre eux conservent leur importance dans le présent
appréciation de la vie entière d'une personne. À l'âge de 3 à 5 ans, la condition s'améliore.
mais activité réflexe, le nombre d'activités dynamiques augmente
stéréotypes. La tranche d'âge de 7 à 11 ans se caractérise par une
renforcement des réflexes conditionnés, leur résistance aux influences extérieures
événements. A cette époque, lors de la formation de réflexes au complexe après-
stimuli agissant successivement, une réaction conditionnée est produite
s'applique à l'ensemble du complexe à la fois. Changements significatifs entre 12 et 18 ans
activité réflexe conditionnée des adolescents. À 13-15 ans, le taux de formation de réflexes conditionnés à immédiat (visuel)
physiques, auditifs et tactiles) augmentent, tandis que
comme processus de formation de réflexes conditionnés aux signaux verbaux
difficile. À 17-18 ans, une activité nerveuse plus élevée se normalise,
le corps est considéré comme mature.
35. Comportement communicatif. Comportement de communication non verbale et verbale. Bases neurophysiologiques de l'activité de la parole. Développement de la parole chez les enfants.
36. Sensation, perception : mécanismes neurophysiologiques, caractéristiques liées à l'âge.
37. Mécanismes neurophysiologiques de l'attention. Caractéristiques liées à l'âge de l'attention des enfants et des adolescents.
38. La motivation, les émotions, leur rôle dans le comportement de l’enfant. Manifestation externe d'émotions chez les enfants d'âges différents. Le rôle des émotions positives et négatives dans le processus d'éducation et d'éducation d'un enfant.
39. Mémoire, types, mécanismes neurophysiologiques. Caractéristiques liées à l'âge du développement de la mémoire chez les enfants.
40. Caractéristiques typologiques individuelles de l'enfant. Caractéristiques des principaux types d'activité nerveuse supérieure. Caractéristiques d'une activité nerveuse plus élevée chez les enfants et les adolescents.
41. Diagnostic complet du niveau de développement fonctionnel d'un enfant. La préparation de l'enfant à l'école.
Nous vous rappelons que le comportement des vertébrés supérieurs, dont le chien, est constitué de trois composantes de genèse différente : le comportement inné, le comportement acquis et l'activité rationnelle élémentaire.
Le premier composant est comportement inné - caractéristique de l’espèce dans son ensemble. N'importe quel chien est normal ; d'une race et d'un sexe donnés ont le même ensemble de réactions innées. Cependant, il n’est pas toujours possible que toutes les réactions initialement inhérentes puissent se manifester pleinement. De plus, si l'on considère le comportement inné comme un certain programme d'action, il s'avère que bon nombre de ses parties ne sont pas activées simultanément, mais seulement avec l'arrivée d'un certain âge en présence de facteurs externes et internes. Un certain nombre de programmes comportementaux héréditaires complexes peuvent ne pas être activés ou ne pas se manifester dans leur intégralité en l'absence de certaines réactions acquises.
Deuxième composant - acquis lors du développement individuel comportement(éducation). Il est clair que dans ce domaine, les différences entre animaux, même de la même race, seront aussi grandes que possible. Le réflexe conditionné ne doit pas être perçu uniquement comme un réflexe classique ou pavlovien, qui se forme lorsque deux stimuli sont combinés dans le temps, généralement indifférents et inconditionnés.
Au cours de la vie, des chaînes réflexes complexes se forment plus souvent, activées non seulement par des stimuli inconditionnels, mais également par des stimuli conditionnés. Très grande importance a l'imitation, lorsqu'un animal apprend à reproduire le réflexe conditionné d'un autre. Ainsi, avec l'élevage traditionnel des chiens-loups bergers, ils apprennent les techniques de gestion simple du troupeau non pas tant auprès des bergers que auprès des autres chiens.
Il convient de noter que si le taux de développement des réflexes conditionnés est à peu près le même dans différentes races (à proprement parler, il est pratiquement constant pour différents types vertébrés), la vitesse de destruction de ces connexions temporaires est alors très variable. La formation est abordée plus en détail dans un chapitre séparé.
Activité rationnelle(RD), comme déjà mentionné, est une forme particulière de comportement, différente des deux autres.
Lorsque la situation se répète, l'activité rationnelle n'est plus utilisée, le problème est résolu au niveau réflexe conditionné. Comprendre cette différence de RD est fondamentalement important. Très souvent, les propriétaires disent que le chien a pensé et fait ceci ou cela. Dans l'écrasante majorité des cas, il n'est question d'aucune manifestation d'activité rationnelle. Le chien a simplement accompli un acte comportemental habituel. Lorsqu'un chien « réfléchit » en donnant un ordre familier, l'essentiel du problème n'est pas qu'il « réfléchisse » à la meilleure façon d'exécuter l'ordre, mais dans la distraction, la désobéissance, en n'amenant pas le réflexe conditionné développé à un automatisme complet (nous nous reviendrons sur cette question séparément, en parlant de la formation).
La composante innée, l'apprentissage et l'activité rationnelle ont des normes de réaction. Le concept de norme de réaction est la position principale de la génétique, du point de vue de laquelle est considérée la relation entre l'acquis individuellement et l'inné dans la formation du phénotype. Ce ne sont pas certaines caractéristiques quantitatives d'un organisme qui sont héritées, mais seulement certaines normes de ses réactions.
Le génotype ne change pas sous l'influence de l'environnement extérieur au cours de l'ontogenèse. Le phénotype est formé à la suite de l'interaction de normes de réaction déterminées génotypiquement et des conditions externes dans lesquelles l'animal se développe.