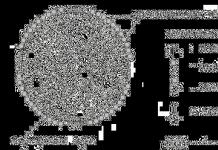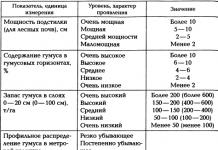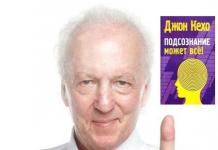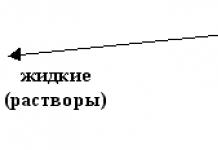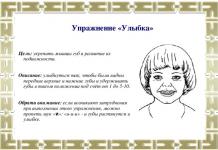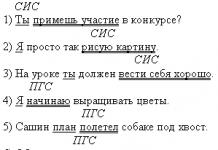Riz. 8.19 Moelle épinière au niveau mi-cervical. Principaux chemins indiqués matière blanche moelle épinière.
Moelle épinière fait partie du système nerveux central et se compose de voies ascendantes et descendantes qui transmettent des informations entre le cerveau et le SNP. Les voies sont reliées à différents niveaux par des interneurones courts, qui permettent une intégration et un contrôle accrus de la fonction motrice et de la sensibilité au niveau de la colonne vertébrale (Fig. 8.19).
Riz. 8.20 Médulla oblongata, pont et mésencéphale, (a) Le bulbe rachidien est la première partie du tronc cérébral dans laquelle se croisent les fibres motrices et certaines fibres sensorielles, (b) Le pont se situe entre moelle épinière et le mésencéphale. Il peut être considéré comme une station relais entre le cervelet, le cerveau et le système nerveux périphérique, (c) Le colliculus supérieur du mésencéphale permet la surveillance stimuli visuels. (d) Le colliculus inférieur du mésencéphale permet une perception sélective des stimuli auditifs.
Moelle directement relié à la moelle épinière et constitue sa continuation et la première partie du tronc cérébral (Fig. 8.20a). La moelle allongée contient les noyaux des nerfs crâniens V, IX, X, XI et XII, où se croisent les fibres motrices et certaines fibres sensorielles.
Entre la moelle oblongate et le mésencéphale se trouve pont. Il peut être considéré comme une station relais entre le cervelet, le cerveau et le SNP. Le pont contient des noyaux pour les nerfs crâniens V, VI, VII et VIII et des noyaux moteurs dans la formation réticulaire du pont, qui sont impliqués dans le contrôle postural, cardiovasculaire et respiratoire (voir Fig. 8.206).

Riz. 8.21 Vue latérale du cerveau.
Cervelet situé derrière le pont (Fig. 8.21) et a des connexions entrantes et sortantes avec les voies sensorielles et motrices montant et descendant de la moelle épinière. C'est la plus grande structure motrice du cerveau. Bien que la fonction du cervelet ne soit pas complètement comprise, sa diversité de connexions permet au cervelet de contrôler les mouvements et d'agir comme un centre d'intégration des informations sensorielles et motrices pour effectuer des tâches complexes.
Au-dessus du pont se trouve mésencéphale. C'est la partie la plus primitive du cerveau humain. Le mésencéphale se termine par deux énormes faisceaux de fibres qui forment les pédoncules cérébraux, transportant les fibres vers et depuis le thalamus et les hémisphères. Le mésencéphale contient également les colliculi supérieur (visuel) et inférieur (auditif) (voir Fig. 8.20c, 8.20d), les noyaux des paires de nerfs crâniens III et IV, deux noyaux moteurs, le noyau rouge et la substance noire, qui relie et agit comme un relais entre le ganglion principal et le système moteur (voir Fig. 8.20c).

Riz. 8.22 Diencéphale. Se compose de l'hypothalamus, du sous-thalamus, de l'épithalamus et du thalamus.
Diencéphale- noyau central du cerveau - comprend l'hypothalamus, le sous-thalamus, l'épithalamus et le thalamus (Fig. 8.22) :
- L'hypothalamus contribue à de nombreuses fonctions homéostatiques, telles que la régulation du SNA et du système endocrinien via l'hypophyse. Il joue également un rôle dans le contrôle des instincts de base : la faim, la soif, la fatigue, la conservation et le désir sexuel ;
- le sous-thalamus est impliqué dans la fonction motrice et est relié aux noyaux gris centraux, aux noyaux rouges et à la substance noire ;
- L'épithalamus est constitué de la laisse et de la glande pinéale (épiphyse). Le ganglion de laisse est le centre d'intégration des voies centripètes olfactives, viscérales et somatiques associées à la formation réticulaire. La fonction de la glande pinéale n'est pas claire, mais on sait qu'elle contient de fortes concentrations de mélatonine et de 5-hydroxytryptophane, qui peuvent jouer un rôle dans la régulation des rythmes circadiens ;
- Le thalamus est la plus grande partie du mésencéphale. Fonctionnellement et anatomiquement, le thalamus est étroitement lié au cortex cérébral. Presque toutes les fibres allant aux hémisphères cérébraux passent par une synapse située dans le thalamus. Il possède des connexions sortantes vers pratiquement toutes les parties du cerveau. La fonction du thalamus est probablement d'intégrer les informations sensorielles entrantes via les noyaux qui leur sont associés. L’information est ensuite envoyée au cortex cérébral pour interprétation.

Riz. 8.23 Ganglions de la base. Les masses bilatérales de matière grise forment des structures profondes. Le striatum est constitué du noyau caudé et du noyau lenticulaire, qui sont séparés par une capsule interne, à l'exception de la partie inférieure du noyau caudé dont la tête est reliée en permanence au putamen du noyau lenticulaire. Le noyau lentiforme est constitué du putamen et du globus pallidus.
Ganglions de la base- terme collectif donné aux masses bilatérales de matière grise profonde (Fig. 8.23). Les noyaux gris centraux ont des connexions centripètes et efférentes avec le cortex cérébral, le thalamus, le sous-thalamus et le tronc cérébral et contrôlent la fonction motrice à travers les hémisphères cérébraux.
Les hémisphères du cerveau se forment télencéphale. La conscience, la capacité de s’adapter et de réagir à des circonstances changeantes, de penser de manière abstraite, d’apprendre, de générer des hypothèses et de bénéficier non seulement de sa propre expérience, sont déterminées par la complexité et la taille des hémisphères. Ce fonctionnement supérieur conduit au développement d’une vie émotionnelle riche, de sorte que le risque de maladie mentale profonde est élevé.
Certaines fonctions sont davantage associées à certaines zones des hémisphères cérébraux
Hémisphères cérébraux divisé en lobes frontal, temporal, pariétal et occipital (voir Fig. 8.21).
La localisation exacte d'une fonction spécifique dans le cerveau est inconnue, peut-être parce qu'aucune fonction individuelle n'est localisée exclusivement dans une région spécifique. Cependant, comme pour les parties inférieures du système nerveux central, les fonctions individuelles sont davantage associées à certaines zones :
- gyrus précentral du lobe frontal - avec fonction motrice volontaire ;
- gyrus postcentral du lobe pariétal - avec fonction sensorielle ;
- On pense qu’une partie du lobe frontal dominant joue un rôle primordial dans le développement et l’utilisation du langage ;
- des parties des lobes frontaux des deux côtés sont probablement impliquées dans la formation de la personnalité, de la logique et de l'intelligence ;
- les lobes temporaux assurent une plus grande proportion des fonctions de mémoire, d'intégration et de centres auditifs ;
- Les lobes pariétaux assurent probablement une fonction intégrative complexe pour le fonctionnement sensoriel, moteur et, dans une moindre mesure, émotionnel. Ils vous permettent également de planifier et d'initier actions complexes et jouent un rôle crucial dans la reconnaissance topographique, objet et verbale et leur association avec l'émotion ;
- Le cortex occipital reçoit et traite les informations visuelles.
Le système limbique est essentiel à la formation de la mémoire et des émotions
Système limbique- un ensemble de structures connexes, comprenant une variété de structures profondes (par exemple, l'amygdale), des zones sélectionnées du cortex cérébral (par exemple, la zonule) et des segments d'autres structures (par exemple, l'hypothalamus) (Tableau 8.9 ; Fig.8.24). Le composant principal du système limbique est le circuit. Grâce à cette boucle, l'hippocampe transmet l'information via le fornix aux corps papillaires de l'hypothalamus, qui la transportent jusqu'au noyau antérieur du thalamus par les voies mamillothalamiques. Il est ensuite renvoyé à travers la capsule interne vers l’hippocampe. Les fonctions exactes du système limbique restent floues, mais des dommages à certaines parties de diverses boucles entraînent :
- Amygdale (complexe basolatéral, complexe centromédial, parties de la strie terminale et de l'hypothalamus)
- Noyaux caudés
- Corps mamillaires
- Noyaux antérieur et dorsomédial du thalamus (certains incluent d'autres aires corticales : aire orbitofrontale, champs temporaux et insula)
Les symptômes d'hallucinations et de délires chez les patients psychiatriques peuvent résulter d'un dysfonctionnement du système limbique.
La formation réticulaire a une fonction de signalisation d'alerte non spécifique et contribue aux fonctions motrices, sensorielles (douleur) et autonomes.
Formation réticulaire- un réseau de neurones avec des connexions dendritiques dispersées qui occupe le milieu du tronc cérébral et s'étend vers le haut depuis la substance intermédiaire jusqu'à la moelle épinière jusqu'aux noyaux intralaminaires du thalamus. Il est vaguement organisé en trois colonnes nucléaires longitudinales (médiale, moyenne et latérale), chacune étant subdivisée en trois colonnes ventrocaudales (mésencéphalique, varolienne et médullaire).
La formation réticulaire reçoit des entrées des neurones sensoriels ascendants, du cervelet, des noyaux gris centraux, de l'hypothalamus et du cortex et des sorties vers l'hypothalamus, le thalamus et la moelle épinière.
La fonction d'alerte non spécifique de la formation réticulaire peut être liée aux voies réticulothalamocorticales ascendantes (système d'activation réticulaire ascendant). La formation réticulaire contribue également aux fonctions motrices, sensorielles (douleur) et autonomes, affectant particulièrement la respiration et la fonction vasomotrice.
Il comprend le thalamus, l'épithalamus, le métathalamus et l'hypothalamus. fibres ascendantes de l'hypothalamus provenant des noyaux du raphé du locus coeruleus de la formation réticulaire du tronc cérébral et partiellement des voies spinothalamiques faisant partie du lemniscus médial. Hypothalamus Structure générale et localisation de l'hypothalamus.
Partagez votre travail sur les réseaux sociaux
Si cette œuvre ne vous convient pas, en bas de page se trouve une liste d'œuvres similaires. Vous pouvez également utiliser le bouton de recherche
Introduction
Thalamus (thalamus visuel)
Hypothalamus
Conclusion
Bibliographie
Introduction
Pour un psychologue moderne, l’anatomie du système nerveux central constitue la couche de base des connaissances psychologiques. Sans une compréhension du fonctionnement physiologique du cerveau, il est impossible d'étudier qualitativement les processus et phénomènes mentaux, ainsi que d'en comprendre l'essence.
En parlant du thalamus et de l'hypothalamus, il faut d'abord parler dediencéphale(diencéphale ). Le diencéphale est situé au-dessus du mésencéphale, sous le corps calleux. Il comprend le thalamus, l'épithalamus, le métathalamus et l'hypothalamus. À la base du cerveau, son bord antérieur longe la surface antérieure du chiasma optique, le bord antérieur de la substance perforée postérieure et des voies optiques, et en arrière le long du bord des pédoncules cérébraux. Sur la face dorsale, le bord antérieur est la bande terminale séparant diencéphale du télencéphale, et le bord postérieur est le sillon séparant le diencéphale du colliculus supérieur du mésencéphale. Dans une coupe sagittale, le diencéphale est visible sous le corps calleux et le fornix.
La cavité du diencéphale est III ventricule, qui communique par les foramens interventriculaires droit et gauche avec les ventricules latéraux situés à l'intérieur des hémisphères cérébraux et par l'aqueduc cérébral avec la cavité IV ventricule cérébral. Sur le mur du haut III Dans le ventricule se trouve un plexus choroïde qui, avec les plexus des autres ventricules du cerveau, participe à la formation du liquide céphalo-rachidien.
Le cerveau thalamique est divisé en formations appariées :
thalamus ( thalamus);
métathalamus (région zathalamique);
épithalamus (région suprathalamique);
sous-thalamus (région sous-thalamique).
Le métathalamus (région zathalamique) est formé par des pairescorps géniculés médial et latéralsitué derrière chaque thalamus. Les corps géniculés contiennent des noyaux dans lesquels sont commutées les impulsions allant aux sections corticales des analyseurs visuels et auditifs.
Le corps géniculé médial est situé derrière le coussin thalamique ; avec les colliculi inférieurs de la plaque du toit du mésencéphale, c'est le centre sous-cortical de l'analyseur auditif.
Le corps géniculé latéral est situé en dessous du coussin thalamique. Avec le colliculus supérieur, il forme le centre sous-cortical de l'analyseur visuel.
L'épithalamus (région suprathalamique) comprendcorps pinéal (épiphyse), laisses et triangles de laisses. Les triangles des laisses contiennent des noyaux liés à l'analyseur olfactif. Les laisses s'étendent à partir des triangles des laisses, vont caudalement, sont reliées par une commissure et passent dans la glande pinéale. Ce dernier est en quelque sorte suspendu à eux et se situe entre les tubercules supérieurs du quadrijumeau. La glande pinéale est une glande endocrine. Ses fonctions ne sont pas entièrement établies, on suppose qu'il régule le début de la puberté.
Thalamus (thalamus visuel)
Structure générale et localisation du thalamus.
Thalamus, ou thalamus, est une formation ovoïde appariée d'un volume d'environ 3,3 cm 3 , constitué principalement de matière grise (amas de nombreux noyaux). Les thalamis se forment en raison de l'épaississement des parois latérales du diencéphale. En face, la partie pointue du thalamus formetubercule antérieur,dans lequel se trouvent les centres intermédiaires des voies sensorielles (afférentes) allant du tronc cérébral au cortex cérébral. Partie postérieure, élargie et arrondie du thalamus - oreiller - contient le centre visuel sous-cortical.
Image 1 . Diencéphale en coupe sagittale.
L'épaisseur de la matière grise du thalamus est divisée verticalement Oui -couche (plaque) en forme de substance blanche en trois parties - antérieure, médiale et latérale.
Surface médiale du thalamusclairement visible sur le sagittal (sagittal - sagittal (lat. " sagitte" - flèche), se divisant en moitiés symétriques droite et gauche) dans une section du cerveau (Fig. 1). La surface médiale (c'est-à-dire située plus près du milieu) du thalamus droit et gauche, se faisant face, forme les parois latérales. III ventricule cérébral (cavité diencéphalique) au milieu, ils sont reliés les uns aux autresfusion interthalamique.
Surface antérieure (inférieure) du thalamusfusionné avec l'hypothalamus, à travers celui-ci, du côté caudal (c'est-à-dire situé plus près de la partie inférieure du corps), les voies des pédoncules cérébraux pénètrent dans le diencéphale.
Surface latérale (c'est-à-dire latérale) le thalamus bordecapsule interne -une couche de matière blanche des hémisphères cérébraux, constituée de fibres de projection reliant le cortex cérébral aux structures cérébrales sous-jacentes.
Chacune de ces parties du thalamus contient plusieurs groupesnoyaux thalamiques. Au total, le thalamus contient de 40 à 150 noyaux spécialisés.
Signification fonctionnelle des noyaux thalamiques.
Selon la topographie, les noyaux thalamiques sont divisés en 8 groupes principaux :
1. groupe antérieur ;
2. groupe médiodorsal ;
3. groupe de noyaux médians ;
4. groupe dorsolatéral ;
5. groupe ventrolatéral ;
6. groupe postéro-médial ventral ;
7. groupe postérieur (noyaux du coussin thalamique) ;
8. groupe intralaminaire.
Les noyaux du thalamus sont divisés en sensoriel ( spécifiques et non spécifiques),moteur et associatif. Considérons les principaux groupes de noyaux thalamiques nécessaires pour comprendre son rôle fonctionnel dans la transmission des informations sensorielles au cortex cérébral.
Situé dans la partie antérieure du thalamus groupe avant noyaux thalamiques (Fig.2). Les plus grands d'entre eux sontantéroventral noyau et antéromédialcœur. Ils reçoivent les fibres afférentes des corps mamillaires, centre olfactif du diencéphale. Les fibres efférentes (descendantes, c'est-à-dire transportant les impulsions du cerveau) des noyaux antérieurs sont dirigées vers le gyrus cingulaire du cortex cérébral.
Le groupe antérieur des noyaux thalamiques et les structures associées constituent un composant important du système limbique du cerveau, qui contrôle le comportement psycho-émotionnel.

Riz. 2 . Topographie des noyaux thalamiques
Dans la partie médiale du thalamus se trouventnoyau médiodorsal Et groupe de noyaux médians.
Noyau médiodorsala des connexions bilatérales avec le cortex olfactif du lobe frontal et le gyrus cingulaire des hémisphères cérébraux, l'amygdale et le noyau antéromédian du thalamus. Sur le plan fonctionnel, il est également étroitement lié au système limbique et entretient des connexions bilatérales avec le cortex pariétal, temporal et insulaire du cerveau.
Le noyau médiodorsal est impliqué dans la mise en œuvre de processus mentaux supérieurs. Sa destruction entraîne une diminution de l’anxiété, de l’anxiété, de la tension, de l’agressivité et l’élimination des pensées obsessionnelles.
Noyaux médianssont nombreuses et occupent la position la plus médiale du thalamus. Ils reçoivent des fibres afférentes (c'est-à-dire ascendantes) de l'hypothalamus, des noyaux du raphé, du locus coeruleus de la formation réticulaire du tronc cérébral et partiellement des voies spinothalamiques faisant partie du lemnisque médial. Les fibres efférentes des noyaux médians sont envoyées vers l'hippocampe, l'amygdale et le gyrus cingulaire des hémisphères cérébraux, qui font partie du système limbique. Les connexions avec le cortex cérébral sont bilatérales.
Les noyaux de la ligne médiane jouent un rôle important dans les processus d'éveil et d'activation du cortex cérébral, ainsi que dans le soutien des processus de mémoire.
Dans la partie latérale (c'est-à-dire latérale) du thalamus se trouventdorsolatéral, ventrolatéral, ventral postéro-médial Et groupe postérieur de noyaux.
Noyaux du groupe dorsolatéralrelativement peu étudié. Ils sont connus pour être impliqués dans le système de perception de la douleur.
Noyaux du groupe ventrolatéraldiffèrent anatomiquement et fonctionnellement les uns des autres.Noyaux postérieurs du groupe ventrolatéralsouvent considéré comme un noyau ventrolatéral du thalamus. Ce groupe reçoit des fibres du tractus ascendant de sensibilité générale dans le cadre du lemnisque médial. Les fibres de sensibilité gustative et les fibres des noyaux vestibulaires viennent également ici. Les fibres efférentes partant des noyaux du groupe ventrolatéral sont envoyées au cortex du lobe pariétal des hémisphères cérébraux, où elles transportent les informations somatosensorielles de tout le corps.
À noyaux du groupe postérieur(noyau du coussin thalamique) on trouve des fibres afférentes provenant des colliculi supérieurs et des fibres des voies optiques. Les fibres efférentes sont largement distribuées dans le cortex des lobes frontaux, pariétaux, occipitaux, temporaux et limbiques des hémisphères cérébraux.
Les centres nucléaires du coussin thalamique sont impliqués dans Analyse complète divers stimuli sensoriels. Ils jouent rôle important dans l'activité perceptuelle (liée à la perception) et cognitive (cognitive, mentale) du cerveau, ainsi que dans les processus de mémoire - stockage et reproduction d'informations.
Groupe intralaminaire de noyauxle thalamus se situe dans l'épaisseur de la verticale Oui -couche de matière blanche en forme. Les noyaux intralaminaires sont interconnectés avec les noyaux gris centraux, le noyau denté du cervelet et le cortex cérébral.
Ces noyaux jouent un rôle important dans le système d’activation du cerveau. Les dommages aux noyaux intralaminaires dans les deux thalamis entraînent une forte diminution de l'activité motrice, ainsi qu'une apathie et une destruction de la structure motivationnelle de la personnalité.
Le cortex cérébral, grâce aux connexions bilatérales avec les noyaux du thalamus, est capable d'exercer un effet régulateur sur leur activité fonctionnelle.
Ainsi, les principales fonctions du thalamus sont :
traitement des informations sensorielles provenant des récepteurs et des centres de commutation sous-corticaux avec leur transfert ultérieur vers le cortex ;
participation à la régulation des mouvements ;
assurer la communication et l’intégration des différentes parties du cerveau.
Hypothalamus
Structure générale et localisation de l'hypothalamus.
Hypothalamus ) représente la section ventrale (c'est-à-dire abdominale) du diencéphale. Il se compose d'un complexe de formations situées sous III ventricule L'hypothalamus est limité en avantcroix visuelle (chiasme), latéralement - la partie antérieure du sous-thalamus, la capsule interne et les voies optiques s'étendant à partir du chiasme. En arrière, l'hypothalamus continue dans le tegmentum du mésencéphale. L'hypothalamus comprendcorps mastoïdiens, tubercule gris et chiasma optique. Corps mastoïdienssitué sur les côtés de la ligne médiane en avant de la substance perforée postérieure. Ce sont des formations de forme sphérique irrégulière, blanches. En avant du tubercule gris se trouvechiasme optique. Dans celui-ci, une transition se produit vers le côté opposé d'une partie des fibres du nerf optique provenant de la moitié médiale de la rétine. Après la décussation, les voies optiques se forment.
Tubercule gris situé en avant des corps mastoïdiens, entre les voies optiques. Le tubercule gris est une saillie creuse de la paroi inférieure III ventricule, formé d’une fine plaque de matière grise. Le sommet du monticule gris est allongé en un creux étroit entonnoir , à la fin duquel se trouve glande pituitaire [ 4 ; 18].
Glande pituitaire : structure et fonctionnement
Pituitaire (hypophyse) - une glande endocrine, elle est située dans une dépression spéciale à la base du crâne, la « selle turcique » et est reliée à la base du cerveau à l'aide d'un pédicule. L'hypophyse contient le lobe antérieur (adénohypophyse - glande pituitaire glandulaire) et le lobe postérieur (neurohypophyse).
Lobe postérieur, ou neurohypophyse, se compose de cellules neurogliales et constitue une continuation de l'infundibulum hypothalamique. Part plus grande - adénohypophyse, constitué de cellules glandulaires. En raison de l'interaction étroite de l'hypothalamus avec l'hypophyse, un seul système fonctionne dans le diencéphale.système hypothalamo-hypophysaire,contrôler le travail de toutes les glandes endocrines et, avec leur aide, les fonctions végétatives du corps (Fig. 3).

Figure 3. L'hypophyse et son influence sur les autres glandes endocrines
Il existe 32 paires de noyaux dans la matière grise de l'hypothalamus. L'interaction avec l'hypophyse s'effectue grâce aux neurohormones sécrétées par les noyaux de l'hypothalamus -libérer des hormones. Par le système vasculaire, ils pénètrent dans le lobe antérieur de l'hypophyse (adénohypophyse), où ils contribuent à la libération d'hormones tropiques qui stimulent la synthèse d'hormones spécifiques dans d'autres glandes endocrines.
Dans le lobe antérieur de l'hypophyse les tropiques sont produits hormones (hormone stimulant la thyroïde - thyrotropine, hormone adrénocorticotrope - corticotropine et hormones gonadotropes - gonadotrophines) et effecteur hormones (hormones de croissance - somatotropine et prolactine).
Hormones de l'hypophyse antérieure
Tropique:
Hormone stimulant la thyroïde (thyrotropine)stimule la fonction thyroïdienne. Si l'hypophyse est enlevée ou détruite chez les animaux, une atrophie de la glande thyroïde se produit et l'administration de thyrotropine rétablit ses fonctions.
Hormone adrénocorticotrope (corticotropine)stimule la fonction de la zone fasciculée du cortex surrénalien, dans laquelle se forment les hormonesglucocorticoïdes.L'effet de l'hormone sur la zone glomérulée et réticulaire est moins prononcé. L'ablation de l'hypophyse chez les animaux entraîne une atrophie du cortex surrénalien. Les processus atrophiques affectent toutes les zones du cortex surrénalien, mais les changements les plus profonds se produisent dans les cellules des zones réticulaires et fasciculaires. L'effet extra-surrénalien de la corticotropine s'exprime par une stimulation des processus de lipolyse, une augmentation de la pigmentation et des effets anabolisants.
Hormones gonadotropes (gonadotrophines).Hormone de stimulation de follicule ( follitropine) stimule la croissance du follicule vésiculaire dans l'ovaire. L'effet de la follitropine sur la formation d'hormones sexuelles féminines (œstrogènes) est faible. Cette hormone est présente aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Chez l'homme, sous l'influence de la follitropine, se produit la formation de cellules germinales (spermatozoïdes). Hormone lutéinisante ( lutropine) nécessaire à la croissance du follicule vésiculaire de l'ovaire dans les stades précédant l'ovulation, et à l'ovulation elle-même (rupture de la membrane d'un follicule mature et libération d'un ovule), la formation du corps jaune au site de le follicule éclaté. Lutropin stimule la formation d'hormones sexuelles féminines - les œstrogènes. Cependant, pour que cette hormone exerce son effet sur l’ovaire, une action préalable à long terme de la follitropine est nécessaire. Lutropin stimule la production progestérone corps jaune. Lutropin est disponible chez les femmes et les hommes. Chez l'homme, il favorise la formation d'hormones sexuelles mâles - androgènes.
Effecteur :
Hormone de croissance (somatotropine)stimule la croissance corporelle en améliorant la formation de protéines. Sous l'influence de la croissance des cartilages épiphysaires dans les os longs des membres supérieurs et inférieurs, la croissance osseuse se produit en longueur. L'hormone de croissance augmente la sécrétion d'insuline les somatomédines, formé dans le foie.
Prolactine stimule la formation de lait dans les alvéoles des glandes mammaires. La prolactine exerce son effet sur les glandes mammaires après l'action préliminaire sur celles-ci des hormones sexuelles féminines, la progestérone et les œstrogènes. L'acte de sucer stimule la formation et la libération de prolactine. La prolactine a également un effet lutéotrope (favorise le fonctionnement à long terme du corps jaune et la formation de l'hormone progestérone).
Processus dans le lobe postérieur de l'hypophyse
Le lobe postérieur de l’hypophyse ne produit pas d’hormones. Les hormones inactives synthétisées dans les noyaux paraventriculaires et supraoptiques de l'hypothalamus entrent ici.
Les hormones sont principalement produites dans les neurones du noyau paraventriculaire. l'ocytocine, et dans les neurones du noyau supraoptique -vasopressine (hormone antidiurétique).Ces hormones s’accumulent dans les cellules de l’hypophyse postérieure, où elles sont transformées en hormones actives.
Vasopressine (hormone antidiurétique)joue un rôle important dans les processus de formation de l'urine et, dans une moindre mesure, dans la régulation du tonus des vaisseaux sanguins. La vasopressine, ou hormone antidiurétique - ADH (diurèse - débit urinaire) - stimule la réabsorption (résorption) de l'eau dans les tubules rénaux.
Ocytocine (ocytonine)augmente la contraction utérine. Sa contraction augmente fortement si elle était auparavant sous l'influence des hormones sexuelles féminines œstrogènes. Pendant la grossesse, l'ocytocine n'affecte pas l'utérus, car sous l'influence de la progestérone, l'hormone du corps jaune, elle devient insensible à l'ocytocine. L'irritation mécanique du col de l'utérus provoque la libération d'ocytocine par réflexe. L'ocytocine a également la capacité de stimuler la production de lait. L'acte de sucer favorise par réflexe la libération d'ocytocine par la neurohypophyse et la sécrétion de lait. En état de stress dans le corps, l'hypophyse libère des quantités supplémentaires d'ACTH, ce qui stimule la libération d'hormones adaptatives par le cortex surrénalien.
Signification fonctionnelle des noyaux hypothalamiques
DANS partie antérolatérale l'hypothalamus est distingué antérieur et moyengroupes de noyaux hypothalamiques (Fig. 4).

Figure 4. Topographie des noyaux hypothalamiques
Le groupe antérieur comprend noyaux suprachiasmatiques, noyau préoptique,et le plus grand -supraoptique Et paraventriculaire graines.
Dans les noyaux du groupe antérieur sont localisés :
centre de la division parasympathique (PSNS) du système nerveux autonome.
La stimulation de l'hypothalamus antérieur entraîne des réactions parasympathiques : constriction de la pupille, diminution de la fréquence cardiaque, dilatation de la lumière des vaisseaux sanguins, baisse de la tension artérielle, augmentation du péristaltisme (c'est-à-dire contraction ondulatoire des parois des tubes creux). organes, favorisant le mouvement de leur contenu vers les exutoires intestinaux) ;
centre de transfert de chaleur. La destruction de la section antérieure s'accompagne d'une augmentation irréversible de la température corporelle ;
centre de soif;
cellules neurosécrétoires qui produisent de la vasopressine (noyau supraoptique) et l'ocytocine ( noyau paraventriculaire). Dans les neurones paraventriculaire Et supraoptiquenoyaux, une neurosécrétion se forme, qui se déplace le long de leurs axones jusqu'à la partie postérieure de l'hypophyse (neurohypophyse), où elle est libérée sous forme de neurohormones -vasopressine et ocytocineentrant dans le sang.
Les dommages aux noyaux antérieurs de l'hypothalamus entraînent l'arrêt de la libération de vasopressine, entraînant le développement dediabète insipide. L'ocytocine a un effet stimulant sur les muscles lisses des organes internes, comme l'utérus. En général, l’équilibre eau-sel de l’organisme dépend de ces hormones.
Dans le préoptique Le noyau produit l'une des hormones de libération - la lulibérine, qui stimule la production d'hormone lutéinisante dans l'adénohypophyse, qui contrôle l'activité des gonades.
Suprachiasmatiqueles noyaux participent activement à la régulation des changements cycliques de l'activité du corps - biorythmes circadiens ou quotidiens (par exemple, dans l'alternance du sommeil et de l'éveil).
Au groupe intermédiaire les noyaux hypothalamiques comprennentdorsomédial Et noyau ventromédian, noyau de la tubérosité grise et le cœur de l'entonnoir.
Dans les noyaux du groupe intermédiaire sont localisés :
centre de la faim et de la satiété. DestructionventromédialLe noyau hypothalamique entraîne une consommation alimentaire excessive (hyperphagie) et l'obésité, ainsi que des dommagesgrains de monticule gris- perte d'appétit et amaigrissement brutal (cachexie) ;
centre de comportement sexuel;
centre d'agression;
le centre du plaisir, qui joue un rôle important dans les processus de formation des motivations et des comportements psycho-émotionnels ;
cellules neurosécrétrices qui produisent des hormones de libération (libérines et statines) qui régulent la production d'hormones hypophysaires : somatostatine, somatolibérine, lulibérine, follibérine, prolactolibérine, thyréolibérine, etc. À travers le système hypothalamo-hypophysaire, elles influencent les processus de croissance, le taux de développement physique et la puberté , la formation des caractères sexuels secondaires, les fonctions du système reproducteur ainsi que le métabolisme.
Le groupe intermédiaire de noyaux contrôle le métabolisme de l'eau, des graisses et des glucides, affecte la glycémie, l'équilibre ionique du corps, la perméabilité des vaisseaux sanguins et des membranes cellulaires.
Partie postérieure de l'hypothalamus situé entre le tubercule gris et la substance perforée postérieure et se compose des parties droite et gauchecorps mastoïdiens.
Dans la partie postérieure de l'hypothalamus, les plus gros noyaux sont : médial et noyau latéral, noyau hypothalamique postérieur.
Dans les noyaux du groupe postérieur sont localisés :
centre qui coordonne l'activité de la division sympathique (SNS) du système nerveux autonome (noyau hypothalamique postérieur). La stimulation de ce noyau entraîne des réactions sympathiques : dilatation des pupilles, augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, augmentation de la respiration et diminution des contractions toniques des intestins ;
centre de production de chaleur (noyau hypothalamique postérieur). La destruction de l'hypothalamus postérieur provoque une léthargie, une somnolence et une diminution de la température corporelle ;
centres sous-corticaux de l'analyseur olfactif. Médial et noyau latéraldans chaque corps mastoïde, ils constituent les centres sous-corticaux de l'analyseur olfactif et font également partie du système limbique ;
cellules neurosécrétoires qui produisent des hormones de libération qui régulent la production d'hormones hypophysaires.
Caractéristiques de l'apport sanguin à l'hypothalamus
Les noyaux de l’hypothalamus reçoivent un apport sanguin abondant. Le réseau capillaire de l'hypothalamus est plusieurs fois plus ramifié que dans d'autres parties du système nerveux central. L'une des caractéristiques des capillaires de l'hypothalamus est leur grande perméabilité, provoquée par l'amincissement des parois des capillaires et leur fenestration ("fenestration" - présence d'espaces - "fenêtres" - entre les cellules endothéliales adjacentes des capillaires ( du latin. » fenêtre " - fenêtre). En conséquence, la barrière hémato-encéphalique (BBB) est faiblement exprimée dans l'hypothalamus et les neurones hypothalamiques sont capables de percevoir les changements dans la composition du liquide céphalo-rachidien et du sang (température, teneur en ions, présence et quantité d'hormones, etc.).
Signification fonctionnelle de l'hypothalamus
L'hypothalamus est le lien central reliant les mécanismes nerveux et humoraux de régulation des fonctions autonomes de l'organisme. La fonction de contrôle de l'hypothalamus est déterminée par la capacité de ses cellules à sécréter et à transporter par axone des substances régulatrices, qui sont transférées vers d'autres structures du cerveau, du liquide céphalo-rachidien, du sang ou de l'hypophyse, modifiant ainsi l'activité fonctionnelle des organes cibles.
Il existe 4 systèmes neuroendocriniens dans l'hypothalamus :
Système hypothalamo-extrahypothalamiquereprésenté par les cellules neurosécrétoires de l'hypothalamus, dont les axones s'étendent dans le thalamus, les structures du système limbique et la moelle allongée. Ces cellules sécrètent des opioïdes endogènes, de la somatostatine, etc.
Système hypothalamo-adénopituitairerelie les noyaux de l'hypothalamus postérieur au lobe antérieur de l'hypophyse. Les hormones de libération (libérines et statines) sont transportées le long de cette voie. Grâce à eux, l'hypothalamus régule la sécrétion d'hormones tropiques de l'adénohypophyse, qui déterminent l'activité sécrétoire des glandes endocrines (thyroïde, reproductrice, etc.).
Système hypothalamo-métapituitairerelie les cellules neurosécrétoires de l'hypothalamus à l'hypophyse. Les axones de ces cellules transportent la mélanostatine et la mélanolibérine, qui régulent la synthèse de mélanine, le pigment qui détermine la couleur de la peau, des cheveux, de l'iris et d'autres tissus corporels.
Système hypothalamo-neurohypophysairerelie les noyaux de l'hypothalamus antérieur au lobe postérieur (glandulaire) de l'hypophyse. Ces axones transportent la vasopressine et l'ocytocine, qui s'accumulent dans le lobe postérieur de l'hypophyse et sont libérées dans la circulation sanguine selon les besoins.
Conclusion
Ainsi, la partie dorsale du diencéphale est phylogénétiquement plus jeunecerveau thalamique,étant le centre sensoriel sous-cortical le plus élevé dans lequel presque toutes les voies afférentes transportant les informations sensorielles des organes du corps et des organes sensoriels vers les hémisphères cérébraux sont commutées. Les tâches de l'hypothalamus incluent également la gestion du comportement psycho-émotionnel et la participation à la mise en œuvre de processus mentaux et psychologiques supérieurs, notamment la mémoire.
Section ventrale - l'hypothalamus est formation phylogénétiquement plus ancienne. Le système hypothalamo-hypophysaire contrôle la régulation humorale de l'équilibre eau-sel, du métabolisme et de l'énergie, le fonctionnement du système immunitaire, la thermorégulation, la fonction reproductive, etc. Jouant un rôle régulateur pour ce système, l'hypothalamus est le centre le plus élevé qui contrôle le système nerveux autonome (autonome).
Bibliographie
- Anatomie humaine / Éd. M. Sapine. - M. : Médecine, 1993.
- Bloom F., Leiserson A., Hofstadter L. Cerveau, esprit, comportement. - M. : Mir, 1988.
- Histologie / Éd. V.G. Eliseeva. - M. : Médecine, 1983.
- Prives M.G., Lysenkov N.K., Bushkovich V.I. Anatomie humaine. - M. : Médecine, 1985.
- Sinelnikov R.D., Sinelnikov Y.R. Atlas d'anatomie humaine. - M. : Médecine, 1994.
- Tishevskaya I.A. Anatomie du système nerveux central : Didacticiel. - Tcheliabinsk : Maison d'édition SUSU, 2000.
D'autres ouvrages similaires qui pourraient vous intéresser.vshm> |
|||
| 523. | Systèmes fonctionnels du corps. Fonction du système nerveux | 4,53 Ko | |
| Systèmes fonctionnels du corps. Travail du système nerveux En plus des analyseurs, c'est-à-dire des systèmes sensoriels, d'autres systèmes fonctionnent dans le corps. Ces systèmes peuvent avoir une forme morphologique claire, c'est-à-dire avoir une structure claire. De tels systèmes comprennent, par exemple, les systèmes circulatoire, respiratoire ou digestif. | |||
| 11302. | Caractéristiques du système nerveux d'un athlète écolier | 46,21 Ko | |
| Sur scène moderne développement du pays dans les conditions de transformation qualitative de tous les aspects de la vie sociale, les exigences en matière de condition physique nécessaires au succès de leur activité professionnelle augmentent... | |||
| 5880. | L'anatomie comme branche de la biologie│ Cours magistral d'anatomie | 670,47 Ko | |
| Le tissu nerveux conduit l'influx nerveux apparaissant sous l'influence d'un stimulus interne ou externe et se compose de : cellules neurones la névroglie remplit des fonctions trophiques et protectrices de soutien Organe orgnon instrument partie du corps qui occupe une certaine position dans le corps et est constituée d'un complexe de tissus uni fonction commune Chaque organe remplit une fonction unique, a une forme, une structure, un emplacement et des différences d'espèces individuelles. Le système organique est un groupe d'organes reliés les uns aux autres anatomiquement et ayant un point commun... | |||
| 15721. | L'influence de la Chine sur les pays d'Asie centrale et leur interaction | 195,28 Ko | |
| Les facteurs suivants tels que la proximité géographique frontières ouvertes et développé Système de transport permettons-nous de dire qu’il existe des conditions favorables à l’influence croissante de la Chine auprès des pays d’Asie centrale. L’étude de la politique de la Chine à l’égard des pays d’Asie centrale est donc pertinente à l’heure actuelle. | |||
| 13735. | Évaluation complète de la couverture du sol dans la zone centrale de la région d'Orel | 46,49 Ko | |
| Caractéristiques de la couverture du sol de la région d'Orel. Interaction des facteurs de formation des sols sur le territoire de la région d'Orel. Les principales combinaisons de sols de la couverture pédologique de la zone centrale de la région d'Orel. Caractéristiques globales des sols de la zone centrale de la région d'Orel... | |||
| 17360. | Le réflexe est la base de l'activité nerveuse. Réflexes inconditionnés et conditionnés et leur rôle dans la vie des humains et des animaux | 22,69 Ko | |
| Les mécanismes de l'activité nerveuse supérieure chez les animaux supérieurs et chez l'homme sont associés à l'activité d'un certain nombre de parties du cerveau. Le rôle principal dans ces mécanismes appartient au cortex cérébral. Il a été démontré expérimentalement que chez les représentants supérieurs du monde animal, après ablation chirurgicale complète du cortex, le plus haut activité nerveuse se détériore fortement. | |||
| 13711. | Anatomie et physiologie, aide-mémoire | 94,41 Ko | |
| Le développement et la formation d'idées sur l'anatomie et la physiologie commencent dans les temps anciens (Anatomie - vers 2550 avant JC, l'ancien papyrus égyptien Ebers "Le Livre secret du médecin" ; Physiologie - vers le 5ème siècle avant JC, Hippocrate, Aristote, Galien) Humain Anatomie – science de la forme, de la structure et du développement du corps humain en relation avec sa fonction et l'influence de l'environnement. | |||
| 11025. | ANATOMIE ET BIOMÉCANIQUE DES OS DU CRÂNE | 18,1 Mo | |
| Le crâne humain adulte est constitué de 28 os : 8 os crâniens (occipital, sphénoïde, frontal, ethmoïde, temporal, pariétal) ; 14 os du crâne facial (vomer, maxillaire, mandibulaire, palatin, zygomatique, lacrymal, nasal, cornets inférieurs) ; 6 os d'un groupe mixte (6 os de l'oreille interne. Dans certaines littératures, l'os hyoïde est également classé parmi les os du crâne. | |||
| 8275. | Anatomie des organes génitaux féminins | 18,98 Ko | |
| Les parois du vagin sont en contact les unes avec les autres et dans la partie supérieure autour de la partie vaginale du col elles forment des dépressions en forme de dôme, des voûtes latérales antérieure postérieure droite et gauche du vagin. La partie supérieure convexe du corps s’appelle le fond de l’utérus. La cavité utérine a la forme d'un triangle dans les coins supérieurs duquel s'ouvrent les ouvertures des trompes de Fallope. Au fond, la cavité utérine se rétrécit en isthme et se termine par l'orifice interne. | |||
| 13726. | Anatomie du système musculo-squelettique | 46,36 Ko | |
| Dans l'os, la place principale est occupée par : le tissu osseux lamellaire, qui forme une substance compacte et l'os spongieux. Composition chimique et propriétés physiques de l'os. La surface de l'os est recouverte de périoste. Le périoste est riche en nerfs et en vaisseaux sanguins, à travers lesquels s'effectuent la nutrition et l'innervation de l'os. | |||
INSTITUT SOCIAL-TECHNOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DES SERVICES D'ÉTAT DE MOSCOU
ANATOMIE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
(Didacticiel)
O.O. Iakimenko
Moscou - 2002
Un manuel sur l'anatomie du système nerveux est destiné aux étudiants de l'Institut socio-technologique de la Faculté de psychologie. Le contenu comprend des questions fondamentales liées à l'organisation morphologique du système nerveux. Outre les données anatomiques sur la structure du système nerveux, les travaux incluent les caractéristiques histologiques et cytologiques du tissu nerveux. Ainsi que des questions d'information sur la croissance et le développement du système nerveux depuis l'ontogenèse embryonnaire jusqu'à la fin de l'ontogenèse postnatale.
Pour plus de clarté du matériel présenté, des illustrations sont incluses dans le texte. Pour travail indépendant les étudiants reçoivent une liste de littérature pédagogique et scientifique, ainsi que des atlas anatomiques.
Les données scientifiques classiques sur l’anatomie du système nerveux constituent la base de l’étude de la neurophysiologie du cerveau. La connaissance des caractéristiques morphologiques du système nerveux à chaque étape de l’ontogenèse est nécessaire pour comprendre la dynamique du comportement et du psychisme humain liée à l’âge.
SECTION I. CARACTÉRISTIQUES CYTOLOGIQUES ET HISTOLOGIQUES DU SYSTÈME NERVEUX
Plan général de la structure du système nerveux
La fonction principale du système nerveux est de transmettre des informations rapidement et avec précision, assurant ainsi l'interaction du corps avec le monde extérieur. Les récepteurs répondent à tous les signaux provenant de l'environnement externe et interne, les convertissant en flux d'influx nerveux qui pénètrent dans le système nerveux central. Sur la base de l'analyse du flux de l'influx nerveux, le cerveau forme une réponse adéquate.
Avec les glandes endocrines, le système nerveux régule le fonctionnement de tous les organes. Cette régulation est réalisée du fait que la moelle épinière et le cerveau sont reliés par des nerfs à tous les organes, des connexions bilatérales. Les signaux sur leur état fonctionnel sont reçus des organes vers le système nerveux central, et le système nerveux, à son tour, envoie des signaux aux organes, corrigeant leurs fonctions et assurant tous les processus vitaux - mouvement, nutrition, excrétion et autres. De plus, le système nerveux assure la coordination des activités des cellules, des tissus, des organes et des systèmes organiques, tandis que le corps fonctionne comme un tout.
Le système nerveux est la base matérielle des processus mentaux : attention, mémoire, parole, pensée, etc., à l'aide desquels une personne non seulement connaît l'environnement, mais peut également le modifier activement.
Ainsi, le système nerveux est la partie d’un système vivant spécialisée dans la transmission d’informations et l’intégration de réactions en réponse aux influences environnementales.
Système nerveux central et périphérique
Le système nerveux est divisé topographiquement en système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière, et en système nerveux périphérique, constitué de nerfs et de ganglions.
Système nerveux
Selon la classification fonctionnelle, le système nerveux est divisé en somatique (divisions du système nerveux qui régulent le travail des muscles squelettiques) et autonome (végétatif), qui régule le travail des organes internes. Le système nerveux autonome comprend deux divisions : sympathique et parasympathique.
Système nerveux
![]() somatique autonome
somatique autonome
sympathique parasympathique
Les systèmes nerveux somatique et autonome comprennent des divisions centrales et périphériques.
Tissu nerveux
Le tissu principal à partir duquel est formé le système nerveux est Tissu nerveux. Il diffère des autres types de tissus en ce qu’il manque de substance intercellulaire.
Le tissu nerveux est constitué de deux types de cellules : les neurones et les cellules gliales. Les neurones jouent un rôle majeur en assurant toutes les fonctions du système nerveux central. Les cellules gliales ont un rôle auxiliaire, remplissant des fonctions de soutien, de protection, trophiques, etc. En moyenne, le nombre de cellules gliales dépasse le nombre de neurones dans un rapport de 10 : 1, respectivement.
Les méninges sont formées par du tissu conjonctif et les cavités cérébrales sont formées par un type spécial de tissu épithélial (revêtement épindymaire).
Le neurone est une unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux
Un neurone possède des caractéristiques communes à toutes les cellules : il possède une membrane plasmique, un noyau et un cytoplasme. La membrane est une structure à trois couches contenant des composants lipidiques et protéiques. De plus, à la surface de la cellule se trouve une fine couche appelée glycocalis. La membrane plasmique régule les échanges de substances entre la cellule et l'environnement. Pour une cellule nerveuse, cela est particulièrement important, puisque la membrane régule le mouvement des substances directement liées à la signalisation nerveuse. La membrane sert également de site d’activité électrique qui est à la base de la signalisation neuronale rapide et de site d’action des peptides et des hormones. Enfin, ses sections forment des synapses – lieu de contact entre les cellules.
Chaque cellule nerveuse possède un noyau qui contient matériel génétique sous forme de chromosomes. Le noyau remplit deux fonctions importantes : il contrôle la différenciation de la cellule jusqu'à sa forme finale, déterminant les types de connexions et régule la synthèse des protéines dans toute la cellule, contrôlant la croissance et le développement de la cellule.
Le cytoplasme d'un neurone contient des organites (réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, mitochondries, lysosomes, ribosomes, etc.).
Les ribosomes synthétisent des protéines, dont certaines restent dans la cellule, l'autre partie est destinée à être éliminée de la cellule. De plus, les ribosomes produisent des éléments de la machinerie moléculaire pour la plupart des fonctions cellulaires : enzymes, protéines porteuses, récepteurs, protéines membranaires, etc.
Le réticulum endoplasmique est un système de canaux et d'espaces entourés de membranes (grands, plats, appelés citernes, et petits, appelés vésicules ou vésicules). Il existe un réticulum endoplasmique lisse et rugueux. Ce dernier contient des ribosomes
La fonction de l'appareil de Golgi est de stocker, concentrer et conditionner les protéines sécrétoires.
En plus des systèmes qui produisent et transportent différentes substances, la cellule possède un système digestif interne constitué de lysosomes qui n'ont pas de forme spécifique. Ils contiennent une variété d’enzymes hydrolytiques qui décomposent et digèrent une variété de composés présents à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule.
Les mitochondries sont l'organe le plus complexe de la cellule après le noyau. Sa fonction est la production et la fourniture de l'énergie nécessaire à la vie des cellules.
La plupart des cellules du corps sont capables de métaboliser divers sucres, et l'énergie est soit libérée, soit stockée dans la cellule sous forme de glycogène. Cependant, les cellules nerveuses du cerveau utilisent exclusivement le glucose, puisque toutes les autres substances sont retenues par la barrière hémato-encéphalique. La plupart d’entre eux n’ont pas la capacité de stocker le glycogène, ce qui augmente leur dépendance à l’égard du glucose sanguin et de l’oxygène pour leur énergie. Par conséquent, les cellules nerveuses possèdent le plus grand nombre de mitochondries.
Le neuroplasme contient des organites à usage particulier : des microtubules et des neurofilaments, qui diffèrent par leur taille et leur structure. Les neurofilaments se trouvent uniquement dans les cellules nerveuses et représentent le squelette interne du neuroplasme. Les microtubules s'étendent le long de l'axone le long des cavités internes du soma jusqu'à l'extrémité de l'axone. Ces organites distribuent des substances biologiquement actives (Fig. 1 A et B). Le transport intracellulaire entre le corps cellulaire et les processus qui en découlent peut être rétrograde - des terminaisons nerveuses au corps cellulaire et orthograde - du corps cellulaire aux terminaisons.

Riz. 1 A. Structure interne d'un neurone
Une caractéristique distinctive des neurones est la présence de mitochondries dans l'axone comme source supplémentaire d'énergie et de neurofibrilles. Les neurones adultes ne sont pas capables de se diviser.
Chaque neurone possède un corps central étendu - le soma et des processus - dendrites et axone. Le corps cellulaire est enfermé dans une membrane cellulaire et contient un noyau et un nucléole, maintenant l'intégrité des membranes du corps cellulaire et de ses processus, assurant la conduction de l'influx nerveux. En relation avec les processus, le soma remplit une fonction trophique, régulant le métabolisme de la cellule. Les impulsions se déplacent le long des dendrites (processus afférents) jusqu'au corps de la cellule nerveuse et à travers les axones (processus efférents) du corps de la cellule nerveuse vers d'autres neurones ou organes.
La plupart des dendrites (dendron - arbre) sont des processus courts et très ramifiés. Leur surface augmente considérablement en raison de petites excroissances - les épines. Un axone (axe - processus) est souvent un processus long et légèrement ramifié.
Chaque neurone possède un seul axone dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Parfois, des processus latéraux - collatéraux - s'étendent à partir de l'axone. Les terminaisons de l’axone se ramifient généralement et sont appelées terminaisons. L'endroit où l'axone émerge du soma cellulaire est appelé la butte axonale.

Riz. 1 B. Structure externe d'un neurone
Il existe plusieurs classifications de neurones basées sur différentes caractéristiques : la forme du soma, le nombre de processus, les fonctions et les effets que le neurone a sur les autres cellules.
Selon la forme du soma, on distingue des neurones granulaires (ganglionnaires), dans lesquels le soma a une forme arrondie ; neurones pyramidaux de différentes tailles - grandes et petites pyramides ; neurones étoilés; neurones fusiformes (Fig. 2 A).
Sur la base du nombre de processus, on distingue les neurones unipolaires, ayant un processus s'étendant du soma cellulaire ; neurones pseudounipolaires (ces neurones ont un processus de ramification en forme de T); les neurones bipolaires, qui ont une dendrite et un axone, et les neurones multipolaires, qui ont plusieurs dendrites et un axone (Fig. 2 B).

Riz. 2. Classification des neurones selon la forme du soma et le nombre de processus
Les neurones unipolaires sont situés dans les ganglions sensoriels (par exemple, spinaux, trijumeaux) et sont associés à des types de sensibilité tels que la douleur, la température, le toucher, la sensation de pression, les vibrations, etc.
Ces cellules, bien qu’appelées unipolaires, possèdent en réalité deux processus qui fusionnent à proximité du corps cellulaire.
Les cellules bipolaires sont caractéristiques des systèmes visuel, auditif et olfactif
Les cellules multipolaires ont une forme corporelle variée - fusiforme, en forme de panier, étoilée, pyramidale - petite et grande.
Selon les fonctions qu'ils remplissent, les neurones sont divisés en : afférents, efférents et intercalaires (contact).
Les neurones afférents sont sensoriels (pseudo-unipolaires), leurs somas sont situés en dehors du système nerveux central dans les ganglions (spinaux ou crâniens). La forme du soma est granuleuse. Les neurones afférents ont une dendrite qui se connecte aux récepteurs (peau, muscle, tendon, etc.). Grâce aux dendrites, les informations sur les propriétés des stimuli sont transmises au soma du neurone et le long de l'axone jusqu'au système nerveux central.
Les neurones efférents (moteurs) régulent le fonctionnement des effecteurs (muscles, glandes, tissus, etc.). Ce sont des neurones multipolaires, leurs somas ont une forme étoilée ou pyramidale, se trouvant dans la moelle épinière ou le cerveau ou dans les ganglions du système nerveux autonome. Les dendrites courtes et abondamment ramifiées reçoivent des impulsions d'autres neurones, et les axones longs s'étendent au-delà du système nerveux central et, en tant que partie du nerf, se dirigent vers les effecteurs (organes de travail), par exemple vers le muscle squelettique.
Les interneurones (interneurones, neurones de contact) constituent la majeure partie du cerveau. Ils communiquent entre les neurones afférents et efférents et traitent les informations provenant des récepteurs vers le système nerveux central. Ce sont principalement des neurones multipolaires en forme d’étoile.
Parmi les interneurones, les neurones à axones longs et courts diffèrent (Fig. 3 A, B).

Sont représentés comme neurones sensoriels : un neurone dont le processus fait partie des fibres auditives du nerf vestibulocochléaire (paire VIII), un neurone qui répond à la stimulation cutanée (SC). Les interneurones sont représentés par les cellules amacrines (AmN) et bipolaires (BN) de la rétine, un neurone du bulbe olfactif (OLN), un neurone du locus coeruleus (LPN), une cellule pyramidale du cortex cérébral (PN) et un neurone étoilé (SN). ) du cervelet. Un motoneurone de la moelle épinière est représenté comme un motoneurone.
Riz. 3 A. Classification des neurones selon leurs fonctions
Neurone sensoriel:
1 - bipolaire, 2 - pseudobipolaire, 3 - pseudounipolaire, 4 - cellule pyramidale, 5 - neurone de la moelle épinière, 6 - neurone du p.ambigus, 7 - neurone du noyau du nerf hypoglosse. Neurones sympathiques : 8 - du ganglion stellaire, 9 - du ganglion cervical supérieur, 10 - de la colonne intermédiolatérale de la corne latérale de la moelle épinière. Neurones parasympathiques : 11 - du ganglion du plexus musculaire de la paroi intestinale, 12 - du noyau dorsal du nerf vague, 13 - du ganglion ciliaire.
En fonction de l'effet des neurones sur d'autres cellules, on distingue les neurones excitateurs et les neurones inhibiteurs. Les neurones excitateurs ont un effet activateur, augmentant l'excitabilité des cellules avec lesquelles ils sont connectés. Les neurones inhibiteurs, au contraire, réduisent l'excitabilité des cellules, provoquant un effet inhibiteur.
L'espace entre les neurones est rempli de cellules appelées névroglie (le terme gliale signifie colle, les cellules « collent » les composants du système nerveux central en un seul tout). Contrairement aux neurones, les cellules neurogliales se divisent tout au long de la vie d'une personne. Il existe de nombreuses cellules névrogliales ; dans certaines parties du système nerveux, il y en a 10 fois plus que les cellules nerveuses. On distingue les cellules macrogliales et les cellules microgliales (Fig. 4).

Quatre principaux types de cellules gliales.

Neurone entouré divers éléments gliale
1 - astrocytes macrogliaux
2 - macroglie oligodendrocytes
3 – microglie macroglie
Riz. 4. Cellules macrogliales et microgliales
Les macroglies comprennent les astrocytes et les oligodendrocytes. Les astrocytes possèdent de nombreux processus qui s'étendent à partir du corps cellulaire dans toutes les directions, donnant l'apparence d'une étoile. Dans le système nerveux central, certains processus se terminent par une tige terminale à la surface des vaisseaux sanguins. Les astrocytes situés dans la substance blanche du cerveau sont appelés astrocytes fibreux en raison de la présence de nombreuses fibrilles dans le cytoplasme de leur corps et de leurs branches. Dans la matière grise, les astrocytes contiennent moins de fibrilles et sont appelés astrocytes protoplasmiques. Ils servent de support aux cellules nerveuses, assurent la réparation des nerfs après des dommages, isolent et unissent les fibres et terminaisons nerveuses et participent aux processus métaboliques qui modélisent la composition ionique et les médiateurs. Les hypothèses selon lesquelles ils seraient impliqués dans le transport de substances des vaisseaux sanguins vers les cellules nerveuses et feraient partie de la barrière hémato-encéphalique ont désormais été rejetées.
1. Les oligodendrocytes sont plus petits que les astrocytes, contiennent de petits noyaux, sont plus courants dans la substance blanche et sont responsables de la formation de gaines de myéline autour des longs axones. Ils agissent comme un isolant et augmentent la vitesse de l'influx nerveux tout au long des processus. La gaine de myéline est segmentaire, l'espace entre les segments est appelé nœud de Ranvier (Fig. 5). En règle générale, chacun de ses segments est formé d'un oligodendrocytes (cellule de Schwann) qui, à mesure qu'il s'amincit, s'enroule autour de l'axone. La gaine de myéline est blanche (substance blanche) car les membranes des oligodendrocytes contiennent une substance grasse : la myéline. Parfois, une cellule gliale, formant des processus, participe à la formation de segments de plusieurs processus. On suppose que les oligodendrocytes effectuent des échanges métaboliques complexes avec les cellules nerveuses.

1 - oligodendrocytes, 2 - connexion entre le corps des cellules gliales et la gaine de myéline, 4 - cytoplasme, 5 - membrane plasmique, 6 - nœud de Ranvier, 7 - boucle de la membrane plasmique, 8 - mésaxone, 9 - pétoncle
Riz. 5A. Participation des oligodendrocytes à la formation de la gaine de myéline

Quatre étapes « d'enveloppement » de l'axone (2) par une cellule de Schwann (1) et son enveloppement avec plusieurs doubles couches de membrane, qui après compression forment une gaine de myéline dense, sont présentées.
Riz. 5 B. Schéma de formation de la gaine de myéline.
Le soma et les dendrites des neurones sont recouverts de fines membranes qui ne forment pas de myéline et constituent la matière grise.
2. Les microglies sont représentées par de petites cellules capables de mouvement amiboïde. La fonction des microglies est de protéger les neurones contre l’inflammation et les infections (via le mécanisme de phagocytose – la capture et la digestion de substances génétiquement étrangères). Les cellules microgliales fournissent de l'oxygène et du glucose aux neurones. De plus, ils font partie de la barrière hémato-encéphalique, qui est formée par eux et les cellules endothéliales qui forment les parois des capillaires sanguins. La barrière hémato-encéphalique piège les macromolécules, limitant leur accès aux neurones.
Fibres nerveuses et nerfs
Les longs processus des cellules nerveuses sont appelés fibres nerveuses. Grâce à eux, les influx nerveux peuvent être transmis sur de longues distances allant jusqu'à 1 mètre.
La classification des fibres nerveuses repose sur des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles.
Les fibres nerveuses qui ont une gaine de myéline sont appelées myélinisées (myélinisées) et les fibres qui n'ont pas de gaine de myéline sont appelées non myélinisées (non myélinisées).
Sur la base des caractéristiques fonctionnelles, on distingue les fibres nerveuses afférentes (sensorielles) et efférentes (motrices).
Les fibres nerveuses s'étendant au-delà du système nerveux forment des nerfs. Un nerf est un ensemble de fibres nerveuses. Chaque nerf possède une gaine et un apport sanguin (Fig. 6).

1 - tronc nerveux commun, 2 - branches de fibres nerveuses, 3 - gaine nerveuse, 4 - faisceaux de fibres nerveuses, 5 - gaine de myéline, 6 - membrane cellulaire de Schwann, 7 - nœud de Ranvier, 8 - noyau de cellule de Schwann, 9 - axolemme .
Riz. 6 Structure d'un nerf (A) et d'une fibre nerveuse (B).
Il existe des nerfs spinaux connectés à la moelle épinière (31 paires) et des nerfs crâniens (12 paires) connectés au cerveau. En fonction du rapport quantitatif des fibres afférentes et efférentes au sein d'un nerf, on distingue les nerfs sensoriels, moteurs et mixtes. Dans les nerfs sensoriels, les fibres afférentes prédominent, dans les nerfs moteurs, les fibres efférentes prédominent, dans les nerfs mixtes, le rapport quantitatif des fibres afférentes et efférentes est à peu près égal. Tous les nerfs spinaux sont des nerfs mixtes. Parmi les nerfs crâniens, il existe trois types de nerfs répertoriés ci-dessus. I paire - nerfs olfactifs (sensibles), II paire - nerfs optiques (sensibles), III paire - oculomoteur (moteur), IV paire - nerfs trochléaires (moteurs), V paire - nerfs trijumeaux (mixtes), VI paire - nerfs abducens ( moteur), VII paire - nerfs faciaux (mixtes), VIII paire - nerfs vestibulo-cochléaires (mixtes), IX paire - nerfs glossopharyngés (mixtes), X paire - nerfs vagues (mixtes), XI paire - nerfs accessoires (moteurs), Paire XII - nerfs hypoglosses (moteurs) (Fig. 7).

I - nerfs para-olfactifs,
II - nerfs para-optiques,
III - nerfs para-oculomoteurs,
IV - nerfs paratrochléaires,
V - paire - nerfs trijumeaux,
VI - nerfs para-abducens,
VII - nerfs parafaciaux,
VIII - nerfs para-cochléaires,
IX - nerfs paraglossopharyngés,
X - paire - nerfs vagues,
XI - nerfs para-accessoires,
XII - para-1,2,3,4 - racines des nerfs spinaux supérieurs.
Riz. 7, Schéma de l'emplacement des nerfs crâniens et spinaux
Matière grise et blanche du système nerveux
De nouvelles coupes du cerveau montrent que certaines structures sont plus sombres - c'est la matière grise du système nerveux, et d'autres structures sont plus claires - la matière blanche du système nerveux. La substance blanche du système nerveux est formée de fibres nerveuses myélinisées, la matière grise de parties non myélinisées des neurones - somas et dendrites.
La substance blanche du système nerveux est représentée par les voies centrales et les nerfs périphériques. La fonction de la substance blanche est la transmission d’informations des récepteurs au système nerveux central et d’une partie du système nerveux à une autre.
La matière grise du système nerveux central est formée du cortex cérébelleux et du cortex cérébral, des noyaux, des ganglions et de certains nerfs.
Les noyaux sont des accumulations de matière grise dans l’épaisseur de la matière blanche. Ils sont situés dans différentes parties du système nerveux central : dans la substance blanche des hémisphères cérébraux - noyaux sous-corticaux, dans la substance blanche du cervelet - noyaux cérébelleux, certains noyaux sont situés dans le diencéphale, le mésencéphale et la moelle allongée. La plupart des noyaux sont des centres nerveux qui régulent l'une ou l'autre fonction du corps.
Les ganglions sont un ensemble de neurones situés en dehors du système nerveux central. Il existe des ganglions rachidiens, crâniens et des ganglions du système nerveux autonome. Les ganglions sont formés principalement de neurones afférents, mais ils peuvent inclure des neurones intercalaires et efférents.
Interaction des neurones
Le lieu d'interaction fonctionnelle ou de contact de deux cellules (le lieu où une cellule influence une autre cellule) a été appelé synapse par le physiologiste anglais C. Sherrington.
Les synapses sont périphériques et centrales. Un exemple de synapse périphérique est la synapse neuromusculaire, où un neurone entre en contact avec une fibre musculaire. Les synapses du système nerveux sont appelées synapses centrales lorsque deux neurones entrent en contact. Il existe cinq types de synapses, selon les parties avec lesquelles les neurones sont en contact : 1) axo-dendritiques (l'axone d'une cellule entre en contact avec la dendrite d'une autre) ; 2) axo-somatique (l'axone d'une cellule entre en contact avec le soma d'une autre cellule) ; 3) axo-axonal (l'axone d'une cellule entre en contact avec l'axone d'une autre cellule) ; 4) dendro-dendritique (la dendrite d'une cellule est en contact avec la dendrite d'une autre cellule) ; 5) somo-somatique (les somas de deux cellules sont en contact). La majeure partie des contacts sont axo-dendritiques et axo-somatiques.
Les contacts synaptiques peuvent avoir lieu entre deux neurones excitateurs, deux neurones inhibiteurs ou entre un neurone excitateur et un neurone inhibiteur. Dans ce cas, les neurones qui ont un effet sont appelés présynaptiques et les neurones affectés sont appelés postsynaptiques. Le neurone excitateur présynaptique augmente l'excitabilité du neurone postsynaptique. Dans ce cas, la synapse est dite excitatrice. Le neurone inhibiteur présynaptique a l'effet inverse : il réduit l'excitabilité du neurone postsynaptique. Une telle synapse est dite inhibitrice. Chacun des cinq types de synapses centrales possède ses propres caractéristiques morphologiques, bien que le schéma général de leur structure soit le même.
Structure synaptique
Considérons la structure d'une synapse en prenant l'exemple d'une synapse axo-somatique. La synapse se compose de trois parties : la terminaison présynaptique, la fente synaptique et la membrane postsynaptique (Fig. 8 A, B).

Entrées A-synaptiques d'un neurone. Les plaques synaptiques aux extrémités des axones présynaptiques forment des connexions sur les dendrites et le corps (soma) du neurone postsynaptique.
Riz. 8 A. Structure des synapses
Le terminal présynaptique est la partie étendue du terminal axonal. La fente synaptique est l'espace entre deux neurones en contact. Le diamètre de la fente synaptique est de 10 à 20 nm. La membrane de la terminaison présynaptique faisant face à la fente synaptique est appelée membrane présynaptique. La troisième partie de la synapse est la membrane postsynaptique, située en face de la membrane présynaptique.
Le terminal présynaptique est rempli de vésicules et de mitochondries. Les vésicules contiennent des substances biologiquement actives - des médiateurs. Les médiateurs sont synthétisés dans le soma et transportés via des microtubules jusqu'au terminal présynaptique. Les médiateurs les plus courants sont l'adrénaline, la noradrénaline, l'acétylcholine, la sérotonine, l'acide gamma-aminobutyrique (GABA), la glycine et autres. Généralement, une synapse contient l'un des émetteurs de plus par rapport aux autres médiateurs. Les synapses sont généralement désignées par le type de médiateur : adrénergique, cholinergique, sérotoninergique, etc.
La membrane postsynaptique contient des molécules de protéines- des récepteurs capables d'attacher des molécules médiatrices.
La fente synaptique est remplie de liquide intercellulaire contenant des enzymes favorisant la destruction des neurotransmetteurs.
Un neurone postsynaptique peut avoir jusqu'à 20 000 synapses, dont certaines sont excitatrices et d'autres inhibitrices (Fig. 8 B).

B. Schéma de libération du transmetteur et processus se produisant dans une synapse centrale hypothétique.
Riz. 8 B. Structure des synapses
En plus des synapses chimiques, dans lesquelles les neurotransmetteurs sont impliqués dans l'interaction des neurones, on trouve des synapses électriques dans le système nerveux. Dans les synapses électriques, l'interaction de deux neurones s'effectue grâce à des biocourants. Le système nerveux central est dominé par des stimuli chimiques.
Dans certaines synapses interneurones, la transmission électrique et chimique se produit simultanément - il s'agit d'un type mixte de synapse.
L'influence des synapses excitatrices et inhibitrices sur l'excitabilité du neurone postsynaptique est résumée et l'effet dépend de la localisation de la synapse. Plus les synapses sont proches de la butte axonale, plus elles sont efficaces. Au contraire, plus les synapses sont situées loin de la butte axonale (par exemple, à l'extrémité des dendrites), moins elles sont efficaces. Ainsi, les synapses situées sur le soma et la butte axonale influencent l'excitabilité du neurone de manière rapide et efficace, tandis que l'influence des synapses distantes est lente et douce.
Les réseaux de neurones
Grâce aux connexions synaptiques, les neurones sont unis en unités fonctionnelles : les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones peuvent être constitués de neurones situés à courte distance. comme ça réseau neuronal appelé local. De plus, des neurones éloignés les uns des autres et provenant de différentes zones du cerveau peuvent être combinés en un réseau. La plupart haut niveau l'organisation des connexions neuronales reflète la connexion de plusieurs zones du système nerveux central. Ce réseau de neurones s'appelle par ou système. Il existe des chemins descendants et ascendants. Le long des voies ascendantes, les informations sont transmises des zones sous-jacentes du cerveau aux zones supérieures (par exemple, de la moelle épinière au cortex cérébral). Les voies descendantes relient le cortex cérébral à la moelle épinière.
Les réseaux les plus complexes sont appelés systèmes de distribution. Ils sont formés par des neurones situés dans différentes parties du cerveau qui contrôlent le comportement, auquel le corps participe dans son ensemble.
Certains réseaux nerveux assurent la convergence (convergence) des impulsions sur un nombre limité de neurones. Des réseaux nerveux peuvent également se construire selon le type de divergence (divergence). De tels réseaux permettent la transmission d'informations sur des distances considérables. De plus, les réseaux de neurones permettent l'intégration (résumation ou généralisation) de divers types d'informations (Fig. 9).
|
Riz. 9. Tissu nerveux.
Un gros neurone doté de nombreuses dendrites reçoit des informations via un contact synaptique avec un autre neurone (en haut à gauche). L'axone myélinisé forme un contact synaptique avec le troisième neurone (en bas). Les surfaces des neurones sont représentées sans les cellules gliales qui entourent le processus vers le capillaire (en haut à droite).
Le réflexe comme principe de base du système nerveux
Un exemple de réseau nerveux serait un arc réflexe, nécessaire à l’apparition d’un réflexe. EUX. En 1863, Setchenov, dans son ouvrage « Réflexes du cerveau », développa l'idée que le réflexe est le principe de base du fonctionnement non seulement de la moelle épinière, mais aussi du cerveau.
Un réflexe est la réponse du corps à une irritation avec la participation du système nerveux central. Chaque réflexe a son propre arc réflexe - le chemin le long duquel l'excitation passe du récepteur à l'effecteur (organe exécutif). Tout arc réflexe comprend cinq composants : 1) un récepteur - une cellule spécialisée conçue pour percevoir un stimulus (son, lumière, produit chimique, etc.), 2) une voie afférente, représentée par des neurones afférents, 3) une section du système nerveux central, représenté par la moelle épinière ou le cerveau ; 4) la voie efférente est constituée d'axones de neurones efférents s'étendant au-delà du système nerveux central ; 5) effecteur - organe de travail (muscle ou glande, etc.).
L'arc réflexe le plus simple comprend deux neurones et est appelé monosynaptique (en fonction du nombre de synapses). Un arc réflexe plus complexe est représenté par trois neurones (afférents, intercalaires et efférents) et est appelé trineurone ou disynaptique. Cependant, la plupart des arcs réflexes comprennent un grand nombre d'interneurones et sont appelés polysynaptiques (Fig. 10 A, B).
Les arcs réflexes peuvent traverser uniquement la moelle épinière (retirer la main en touchant un objet chaud) ou uniquement le cerveau (fermer les paupières lorsqu'un courant d'air est dirigé vers le visage), ou encore traverser à la fois la moelle épinière et le cerveau.

Riz. 10A. 1 - neurone intercalaire ; 2 - dendrites ; 3 - corps neuronal ; 4 - axones ; 5 - synapse entre les neurones sensoriels et les interneurones ; 6 - axone d'un neurone sensible ; 7 - corps d'un neurone sensible ; 8 - axone d'un neurone sensible ; 9 - axone d'un motoneurone; 10 - corps du motoneurone ; 11 - synapse entre les motoneurones intercalaires et moteurs ; 12 - récepteur dans la peau ; 13 - muscles; 14 - gaglia sympathique; 15 - intestin.

Riz. 10B. 1 - arc réflexe monosynaptique, 2 - arc réflexe polysynaptique, 3K - racine postérieure de la moelle épinière, PC - racine antérieure de la moelle épinière.
Riz. 10. Schéma de la structure de l'arc réflexe
Les arcs réflexes sont fermés en anneaux réflexes à l'aide de connexions de rétroaction. Le concept de feedback et son rôle fonctionnel ont été indiqués par Bell en 1826. Bell a écrit que des connexions bidirectionnelles s'établissent entre le muscle et le système nerveux central. À l'aide du feedback, des signaux sur l'état fonctionnel de l'effecteur sont envoyés au système nerveux central.
La base morphologique du feedback réside dans les récepteurs situés dans l'effecteur et les neurones afférents qui leur sont associés. Grâce aux connexions afférentes de rétroaction, une régulation fine du travail de l’effecteur et une réponse adéquate du corps aux changements environnementaux sont réalisées.
Méninges
Le système nerveux central (moelle épinière et cerveau) possède trois membranes de tissu conjonctif : dure, arachnoïdienne et molle. La plus externe d’entre elles est la dure-mère (elle fusionne avec le périoste tapissant la surface du crâne). La membrane arachnoïdienne se trouve sous la dure-mère. Il est fermement pressé contre la surface dure et il n'y a aucun espace libre entre eux.
Directement adjacente à la surface du cerveau se trouve la pie-mère, qui contient de nombreux vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Entre l'arachnoïde et les membranes molles se trouve un espace rempli de liquide - liquide céphalo-rachidien. La composition du liquide céphalo-rachidien est proche du plasma sanguin et du liquide intercellulaire et joue un rôle anti-choc. De plus, le liquide céphalo-rachidien contient des lymphocytes qui assurent une protection contre les substances étrangères. Il est également impliqué dans le métabolisme entre les cellules de la moelle épinière, du cerveau et du sang (Fig. 11 A).

1 - ligament denté dont le processus traverse la membrane arachnoïdienne située sur le côté, 1a - ligament denté attaché à la dure-mère de la moelle épinière, 2 - membrane arachnoïdienne, 3 - racine postérieure passant dans le canal formé par le mou et membranes arachnoïdiennes, Pour - racine postérieure passant par le trou de la dure-mère de la moelle épinière, 36 - branches dorsales du nerf spinal passant à travers la membrane arachnoïdienne, 4 - nerf spinal, 5 - ganglion spinal, 6 - dure-mère de la moelle épinière, 6a - dure-mère tournée sur le côté , 7 - pie-mère de la moelle épinière avec l'artère spinale postérieure.
Riz. 11A. Membranes de la moelle épinière
Cavités cérébrales
À l’intérieur de la moelle épinière se trouve le canal rachidien qui, passant dans le cerveau, se dilate dans la moelle oblongate et forme le quatrième ventricule. Au niveau du mésencéphale, le ventricule passe dans un canal étroit - l'aqueduc de Sylvius. Dans le diencéphale, l'aqueduc sylvien se dilate, formant la cavité du troisième ventricule, qui passe en douceur au niveau des hémisphères cérébraux dans les ventricules latéraux (I et II). Toutes les cavités répertoriées sont également remplies de liquide céphalo-rachidien (Fig. 11 B).

Figure 11B. Schéma des ventricules du cerveau et de leur relation avec les structures de surface des hémisphères cérébraux.
a - cervelet, b - pôle occipital, c - pôle pariétal, d - pôle frontal, e - pôle temporal, f - moelle allongée.
1 - ouverture latérale du quatrième ventricule (foramen de Lushka), 2 - corne inférieure du ventricule latéral, 3 - aqueduc, 4 - récessusinfundibularis, 5 - recrssusopticus, 6 - foramen interventriculaire, 7 - corne antérieure du ventricule latéral, 8 - partie centrale du ventricule latéral, 9 - fusion des tubérosités visuelles (massainter-melia), 10 - troisième ventricule, 11 - récessus pinéal, 12 - entrée du ventricule latéral, 13 - pro postérieur du ventricule latéral, 14 - quatrième ventricule.
Riz. 11. Méninges (A) et cavités cérébrales (B)
SECTION II. STRUCTURE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Moelle épinière
Structure externe de la moelle épinière
La moelle épinière est une moelle aplatie située dans le canal rachidien. Selon les paramètres du corps humain, sa longueur est de 41 à 45 cm, son diamètre moyen est de 0,48 à 0,84 cm, son poids est d'environ 28 à 32 g. Au centre de la moelle épinière se trouve un canal rachidien rempli de liquide céphalo-rachidien, et par les rainures longitudinales antérieure et postérieure, il est divisé en moitiés droite et gauche.
À l'avant, la moelle épinière passe dans le cerveau, et à l'arrière elle se termine par le cône médullaire au niveau de la 2ème vertèbre du rachis lombaire. Un filum terminale de tissu conjonctif (une continuation des membranes terminales) part du cône médullaire, qui attache la moelle épinière au coccyx. Le filum terminale est entouré de fibres nerveuses (cauda equina) (Fig. 12).
Il existe deux épaississements sur la moelle épinière - cervicale et lombaire, d'où proviennent les nerfs qui innervent respectivement les muscles squelettiques des bras et des jambes.
La moelle épinière est divisée en sections cervicales, thoraciques, lombaires et sacrées, chacune étant divisée en segments : cervical - 8 segments, thoracique - 12, lombaire - 5, sacré 5-6 et 1 - coccygien. Ainsi, le nombre total de segments est de 31 (Fig. 13). Chaque segment de la moelle épinière possède des racines spinales appariées - antérieures et postérieures. Grâce aux racines dorsales, les informations provenant des récepteurs de la peau, des muscles, des tendons, des ligaments et des articulations pénètrent dans la moelle épinière, c'est pourquoi les racines dorsales sont appelées sensorielles (sensibles). La section des racines dorsales désactive la sensibilité tactile, mais n'entraîne pas de perte de mouvement.
a - vue de face (sa face ventrale) ;
b - vue arrière (sa face dorsale).
La dure-mère et les membranes arachnoïdiennes sont coupées. La choroïde est retirée. Les chiffres romains indiquent l'ordre cervical (c), thoracique (th), lombaire (t)
et les nerfs spinaux sacrés.
1 - épaississement cervical
2 - ganglion spinal
3 - coque dure
4 - épaississement lombaire
5 - cône médullaire
6 - filetage terminal

Riz. 13. Moelle épinière et nerfs spinaux (31 paires).
Le long des racines antérieures de la moelle épinière, l'influx nerveux se déplace vers les muscles squelettiques du corps (à l'exception des muscles de la tête), provoquant leur contraction, c'est pourquoi les racines antérieures sont appelées motrices ou motrices. Après avoir coupé les racines antérieures d'un côté, il y a un arrêt complet des réactions motrices, tandis que la sensibilité au toucher ou à la pression persiste.
Les racines antérieures et postérieures de chaque côté de la moelle épinière s'unissent pour former les nerfs spinaux. Les nerfs spinaux sont appelés segmentaires, leur nombre correspond au nombre de segments et est de 31 paires (Fig. 14)

La répartition des zones nerveuses spinales par segment a été établie en déterminant la taille et les limites des zones cutanées (dermatomes) innervées par chaque nerf. Les dermatomes sont localisés à la surface du corps selon un principe segmentaire. Les dermatomes cervicaux comprennent la surface arrière de la tête, le cou, les épaules et la surface antérieure des avant-bras. Les neurones sensoriels thoraciques innervent la surface restante de l'avant-bras, de la poitrine et la majeure partie de l'abdomen. Les fibres sensorielles des segments lombaire, sacré et coccygien s'étendent au reste de l'abdomen et des jambes.
Riz. 14. Schéma des dermatomes. Innervation de la surface du corps par 31 paires de nerfs spinaux (C - cervical, T - thoracique, L - lombaire, S - sacré).
Structure interne de la moelle épinière
La moelle épinière est construite selon le type nucléaire. Il y a de la matière grise autour du canal rachidien et de la substance blanche en périphérie. La matière grise est formée de somas de neurones et de dendrites ramifiées qui n'ont pas de gaine de myéline. La substance blanche est un ensemble de fibres nerveuses recouvertes de gaines de myéline.
Dans la matière grise, on distingue les cornes antérieures et postérieures, entre lesquelles se trouve la zone interstitielle. Il existe des cornes latérales dans les régions thoracique et lombaire de la moelle épinière.
La matière grise de la moelle épinière est formée de deux groupes de neurones : efférents et intercalaires. La majeure partie de la matière grise est constituée d'interneurones (jusqu'à 97 %) et seulement 3 % sont des neurones efférents ou motoneurones. Les motoneurones sont situés dans les cornes antérieures de la moelle épinière. Parmi eux, on distingue les motoneurones a et g : les motoneurones a innervent les fibres musculaires squelettiques et sont de grandes cellules avec des dendrites relativement longues ; Les motoneurones g sont de petites cellules qui innervent les récepteurs musculaires, augmentant ainsi leur excitabilité.
Les interneurones sont impliqués dans le traitement de l'information, assurant le fonctionnement coordonné des neurones sensoriels et moteurs, et relient également les moitiés droite et gauche de la moelle épinière et ses différents segments (Fig. 15 A, B, C)
|
Riz. 15A. 1 - matière blanche du cerveau ; 2 - canal rachidien ; 3 - rainure longitudinale postérieure ; 4 - racine postérieure du nerf spinal ; 5 – nœud rachidien ; 6 - nerf spinal ; 7 - matière grise du cerveau ; 8 - racine antérieure du nerf spinal ; 9 - rainure longitudinale antérieure

Riz. 15B. Noyaux de matière grise dans la région thoracique
1,2,3 - noyaux sensibles de la corne postérieure ; 4, 5 - noyaux intercalaires de la corne latérale ; 6,7, 8,9,10 - noyaux moteurs de la corne antérieure ; I, II, III - cordons antérieurs, latéraux et postérieurs de substance blanche.

Les contacts entre les neurones sensoriels, intercalaires et moteurs dans la matière grise de la moelle épinière sont représentés.
Riz. 15. Coupe transversale de la moelle épinière
Voies médullaires
La matière blanche de la moelle épinière entoure la matière grise et forme les colonnes de la moelle épinière. Il y a des montants avant, arrière et latéraux. Les colonnes sont des étendues de la moelle épinière formées par de longs axones de neurones remontant vers le cerveau (voies ascendantes) ou descendant du cerveau vers les segments inférieurs de la moelle épinière (voies descendantes).
Les voies ascendantes de la moelle épinière transmettent au cerveau les informations provenant des récepteurs situés dans les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations et la peau. Les voies ascendantes sont également conductrices de sensibilité à la température et à la douleur. Toutes les voies ascendantes se croisent au niveau de la moelle épinière (ou du cerveau). Ainsi, la moitié gauche du cerveau (le cortex cérébral et le cervelet) reçoit les informations des récepteurs de la moitié droite du corps et vice versa.
Principaux chemins ascendants : des mécanorécepteurs de la peau et des récepteurs du système musculo-squelettique - ce sont les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations - les faisceaux de Gaulle et de Burdach ou, respectivement, les faisceaux tendres et en forme de coin sont représentés par les colonnes postérieures de la moelle épinière .
À partir de ces mêmes récepteurs, l’information pénètre dans le cervelet par deux voies représentées par des colonnes latérales, appelées voies spinocérébelleuses antérieure et postérieure. De plus, deux autres voies traversent les colonnes latérales - ce sont les voies spinothalamiques latérales et antérieures, qui transmettent les informations provenant des récepteurs de température et de sensibilité à la douleur.
Les colonnes postérieures assurent une transmission plus rapide des informations sur la localisation des stimuli que les voies spinothalamiques latérales et antérieures (Fig. 16 A).

1 - faisceau de Gaulle, 2 - faisceau de Burdach, 3 - faisceau spinocérébelleux dorsal, 4 - faisceau spinocérébelleux ventral. Neurones des groupes I-IV.
Riz. 16A. Voies ascendantes de la moelle épinière
Chemins descendants, passant par les colonnes antérieure et latérale de la moelle épinière, sont moteurs, car ils affectent l'état fonctionnel des muscles squelettiques du corps. Le tractus pyramidal commence principalement dans le cortex moteur des hémisphères et passe jusqu'à la moelle oblongate, où la plupart des fibres se croisent et passent du côté opposé. Après cela, le tractus pyramidal est divisé en faisceaux latéraux et antérieurs : respectivement les faisceaux pyramidaux antérieur et latéral. La plupart des fibres du tractus pyramidal se terminent sur les interneurones et environ 20 % forment des synapses sur les motoneurones. L’influence pyramidale est passionnante. Réticulospinal chemin, rubrospinal manière et vestibulospinal la voie (système extrapyramidal) part respectivement des noyaux de la formation réticulaire, du tronc cérébral, des noyaux rouges du mésencéphale et des noyaux vestibulaires de la moelle allongée. Ces voies parcourent les colonnes latérales de la moelle épinière et participent à la coordination des mouvements et au tonus musculaire. Les voies extrapyramidales, comme les voies pyramidales, sont croisées (Fig. 16 B).

Les principales voies rachidiennes descendantes des systèmes pyramidal (voies corticospinales latérales et antérieures) et extra pyramidale (voies rubrospinales, réticulospinales et vestibulospinales).
Riz. 16 B. Schéma des parcours
Ainsi, la moelle épinière remplit deux fonctions importantes : le réflexe et la conduction. La fonction réflexe est réalisée grâce aux centres moteurs de la moelle épinière : les motoneurones des cornes antérieures assurent le fonctionnement des muscles squelettiques du corps. Parallèlement, la préservation du tonus musculaire, la coordination du travail des muscles fléchisseurs-extenseurs sous-jacents aux mouvements et la préservation de la constance de la posture du corps et de ses parties sont maintenues (Fig. 17 A, B, C ). Les motoneurones situés dans les cornes latérales des segments thoraciques de la moelle épinière assurent les mouvements respiratoires (inspiration-expiration, régulant le travail des muscles intercostaux). Les motoneurones des cornes latérales des segments lombaire et sacré représentent les centres moteurs des muscles lisses qui font partie des organes internes. Ce sont les centres de miction, de défécation et du fonctionnement des organes génitaux.

Riz. 17A. L'arc du réflexe tendineux.

Riz. 17B. Arcs de flexion et réflexe transextenseur.

Riz. 17V. Schéma élémentaire d'un réflexe inconditionné.
Les influx nerveux résultant de l'irritation du récepteur (p) le long des fibres afférentes (nerf afférent, une seule de ces fibres est représentée) vont à la moelle épinière (1), où, à travers le neurone intercalaire, ils sont transmis aux fibres efférentes (nerf efférent), le long duquel ils atteignent l'effecteur. Les lignes pointillées représentent la propagation de l'excitation depuis les parties inférieures du système nerveux central vers ses parties supérieures (2, 3,4) jusqu'au cortex cérébral (5) inclus. Le changement qui en résulte dans l’état des parties supérieures du cerveau affecte à son tour (voir flèches) le neurone efférent, influençant le résultat final de la réponse réflexe.
Riz. 17. Fonction réflexe de la moelle épinière
La fonction de conduction est assurée par les voies vertébrales (Fig. 18 A, B, C, D, E).

Riz. 18A. Piliers arrière. Ce circuit, formé de trois neurones, transmet les informations des récepteurs de pression et de toucher au cortex somatosensoriel.

Riz. 18B. Tract spinothalamique latéral. Tout au long de ce chemin, les informations provenant des récepteurs de température et de douleur atteignent de vastes zones du cerveau coronaire.

Riz. 18V. Tract spinothalamique antérieur. Le long de cette voie, les informations provenant des récepteurs de pression et du toucher, ainsi que des récepteurs de douleur et de température, pénètrent dans le cortex somatosensoriel.

Riz. 18G. Système extrapyramidal. Les voies rubrospinales et réticulospinales, qui font partie du tractus extrapyramidal multineural allant du cortex cérébral à la moelle épinière.

Riz. 18D. Voie pyramidale ou corticospinale
Riz. 18. Fonction conductrice de la moelle épinière
SECTION III. CERVEAU.
Schéma général de la structure du cerveau (Fig. 19)
Cerveau

Figure 19A. Cerveau
1. Cortex frontal (zone cognitive)
2. Cortex moteur
3. Cortex visuel
4. Cervelet 5. Cortex auditif

Figure 19B. Vue de côté

Figure 19B. Les principales formations de la surface médaillée du cerveau dans la section médio-sagittale.

Figure 19G. Surface inférieure du cerveau
Riz. 19. Structure du cerveau
cerveau postérieur
Le cerveau postérieur, comprenant le bulbe rachidien et le pont, est une région phylogénétiquement ancienne du système nerveux central, conservant les caractéristiques d'une structure segmentaire. Le cerveau postérieur contient des noyaux et des voies ascendantes et descendantes. Les fibres afférentes des récepteurs vestibulaires et auditifs, des récepteurs de la peau et des muscles de la tête, des récepteurs des organes internes, ainsi que des structures supérieures du cerveau pénètrent dans le cerveau postérieur par les voies. Le cerveau postérieur contient les noyaux des paires V-XII de nerfs crâniens, dont certains innervent les muscles faciaux et oculomoteurs.
Moelle
La moelle allongée est située entre la moelle épinière, le pont et le cervelet (Fig. 20). Sur la surface ventrale du bulbe rachidien, le sillon médian antérieur s'étend le long de la ligne médiane ; sur ses côtés se trouvent deux cordons - pyramides ; les olives se trouvent du côté des pyramides (Fig. 20 A-B).

Riz. 20A. 1 - cervelet 2 - pédoncules cérébelleux 3 - pont 4 - moelle allongée
Riz. 20 V. 1 - pont 2 - pyramide 3 - olive 4 - fissure médiale antérieure 5 - rainure latérale antérieure 6 - croix de la moelle antérieure 7 - moelle antérieure 8 - moelle latérale
Riz. 20. Médulla oblongate
Sur la face postérieure de la moelle allongée se trouve un sillon médial postérieur. Sur ses côtés se trouvent les cordons postérieurs, qui vont au cervelet et font partie des pattes postérieures.
Matière grise de la moelle allongée
La moelle allongée contient les noyaux de quatre paires de nerfs crâniens. Ceux-ci comprennent les noyaux des nerfs glossopharyngé, vague, accessoire et hypoglosse. De plus, on distingue les noyaux tendres en forme de coin et les noyaux cochléaires du système auditif, les noyaux des olives inférieures et les noyaux de la formation réticulaire (cellule géante, parvocellulaire et latérale), ainsi que les noyaux respiratoires.
Les noyaux des nerfs hypoglosse (paire XII) et accessoire (paire XI) sont moteurs, innervant les muscles de la langue et les muscles qui font bouger la tête. Les noyaux des nerfs vague (paire X) et glossopharyngé (paire IX) sont mixtes ; ils innervent les muscles du pharynx, du larynx et de la glande thyroïde et régulent la déglutition et la mastication. Ces nerfs sont constitués de fibres afférentes provenant des récepteurs de la langue, du larynx, de la trachée et des récepteurs des organes internes de la poitrine et de la cavité abdominale. Les fibres nerveuses efférentes innervent les intestins, le cœur et les vaisseaux sanguins.
Les noyaux de la formation réticulaire activent non seulement le cortex cérébral, maintenant la conscience, mais forment également le centre respiratoire, qui assure les mouvements respiratoires.
Ainsi, certains noyaux de la moelle allongée régulent les fonctions vitales (ce sont les noyaux de la formation réticulaire et les noyaux des nerfs crâniens). L'autre partie des noyaux fait partie des voies ascendantes et descendantes (noyaux herbacés et cunéiformes, noyaux cochléaires du système auditif) (Fig. 21).
|
2 - noyau en forme de coin ;
3 - l'extrémité des fibres des moelles postérieures de la moelle épinière ;
4 - fibres arquées internes - le deuxième neurone de la voie propria de la direction corticale ;
5 - l'intersection des boucles est située dans la couche de boucles inter-olives ;
6 - boucle médiale - continuation des campagnols arqués internes
7 - couture formée par l'intersection de boucles;
8 - noyau d'olive - noyau intermédiaire d'équilibre ;
9 - chemins pyramidaux ;
10 - canal central.
Riz. 21. Structure interne de la moelle allongée
Matière blanche de la moelle allongée
La substance blanche de la moelle allongée est formée de fibres nerveuses longues et courtes.
Les longues fibres nerveuses font partie des voies descendantes et ascendantes. Les fibres nerveuses courtes assurent le fonctionnement coordonné des moitiés droite et gauche de la moelle allongée.
Pyramides moelle oblongate - partie tractus pyramidal descendant, allant à la moelle épinière et se terminant aux interneurones et aux motoneurones. De plus, le tractus rubrospinal traverse la moelle oblongate. Les voies vestibulospinales et réticulospinales descendantes proviennent respectivement de la moelle oblongue et des noyaux vestibulaire et réticulaire.
Les voies spinocérébelleuses ascendantes traversent Olives moelle oblongate et à travers les pédoncules cérébraux et transmettent les informations des récepteurs du système musculo-squelettique au cervelet.
Tendre Et noyaux en forme de coin La moelle allongée fait partie des voies médullaires du même nom, qui traversent le thalamus visuel du diencéphale jusqu'au cortex somatosensoriel.
À travers noyaux auditifs cochléaires et à travers noyaux vestibulaires voies sensorielles ascendantes à partir des récepteurs auditifs et vestibulaires. Dans la zone de projection du cortex temporal.
Ainsi, la moelle allongée régule l'activité de nombreuses fonctions vitales du corps. Par conséquent, le moindre dommage au bulbe rachidien (traumatisme, gonflement, hémorragie, tumeurs) entraîne généralement la mort.
Pons
Le pont est une crête épaisse qui borde la moelle allongée et les pédoncules cérébelleux. Les voies ascendantes et descendantes de la moelle allongée traversent le pont sans interruption. A la jonction du pont et de la moelle allongée, émerge le nerf vestibulocochléaire (VIII paire). Le nerf vestibulocochléaire est sensible et transmet les informations provenant des récepteurs auditifs et vestibulaires de l'oreille interne. De plus, le pont contient des nerfs mixtes, les noyaux du nerf trijumeau (paire V), du nerf abducens (paire VI) et du nerf facial (paire VII). Ces nerfs innervent les muscles du visage, le cuir chevelu, la langue et les muscles droits latéraux de l'œil.
En coupe transversale, le pont se compose d'une partie ventrale et dorsale - entre elles se trouve le corps trapézoïdal dont les fibres sont attribuées au tractus auditif. Dans la région du corps trapèze se trouve un noyau parabranchial médial, qui est relié au noyau denté du cervelet. Le noyau pontique proprement dit fait communiquer le cervelet avec le cortex cérébral. Dans la partie dorsale du pont se trouvent les noyaux de la formation réticulaire et les voies ascendantes et descendantes de la moelle allongée se poursuivent.
Le pont remplit des fonctions complexes et variées visant à maintenir la posture et à maintenir l'équilibre du corps dans l'espace lors des changements de vitesse.
Les réflexes vestibulaires sont très importants dont les arcs réflexes traversent le pont. Ils tonifient les muscles du cou, stimulent les centres autonomes, la respiration, la fréquence cardiaque et l'activité du tractus gastro-vasculaire.
Les noyaux des nerfs trijumeau, glossopharyngé, vague et pontique sont associés à la préhension, à la mastication et à la déglutition des aliments.
Les neurones de la formation réticulaire du pont jouent un rôle particulier dans l'activation du cortex cérébral et la limitation de l'afflux sensoriel de l'influx nerveux pendant le sommeil (Fig. 22, 23)
Riz. 22. Médulla oblongate et pont.
A. Vue de dessus (côté dorsal).
B. Vue latérale.
B. Vue du dessous (du côté ventral).
1 - luette, 2 - velum médullaire antérieur, 3 - éminence médiane, 4 - fosse supérieure, 5 - pédoncule cérébelleux supérieur, 6 - pédoncule cérébelleux moyen, 7 - tubercule facial, 8 - pédoncule cérébelleux inférieur, 9 - tubercule auditif, 10 - rayures cérébrales, 11 - bande du quatrième ventricule, 12 - triangle du nerf hypoglosse, 13 - triangle du nerf vague, 14 - areapos-terma, 15 - obex, 16 - tubercule du noyau sphénoïde, 17 - tubercule du noyau tendre, 18 - cordon latéral, 19 - sillon latéral postérieur, 19 a - sillon latéral antérieur, 20 - cordon sphénoïde, 21 - sillon intermédiaire postérieur, 22 - cordon tendre, 23 - sillon médian postérieur, 23 a - pont - base) , 23 b - pyramide de la moelle allongée, 23 c -olive, 23 g - décusation des pyramides, 24 - pédoncule cérébral, 25 - tubercule inférieur, 25 a - anse du tubercule inférieur, 256 - tubercule supérieur

1 - corps trapézoïdal 2 - noyau de l'olive supérieure 3 - dorsal contient les noyaux des paires VIII, VII, VI, V de nerfs crâniens 4 - partie médaille du pont 5 - partie ventrale du pont contient ses propres noyaux et pont 7 - noyaux transversaux du pont 8 - faisceaux pyramidaux 9 - pédoncule cérébelleux moyen.
Riz. 23. Schéma de la structure interne du pont en coupe frontale
Cervelet
Le cervelet est une partie du cerveau située derrière les hémisphères cérébraux, au-dessus de la moelle allongée et du pont.
Anatomiquement, le cervelet est divisé en une partie médiane - le vermis et deux hémisphères. À l’aide de trois paires de pattes (inférieure, moyenne et supérieure), le cervelet est relié au tronc cérébral. Les jambes inférieures relient le cervelet au bulbe rachidien et à la moelle épinière, celles du milieu au pont et celles du haut au mésencéphale et au diencéphale (Fig. 24).

1 - vermis 2 - lobule central 3 - luette du vermis 4 - cervelet veslus antérieur 5 - hémisphère supérieur 6 - pédoncule cérébelleux antérieur 8 - flocculus pédoncule 9 – flocculus 10 - lobule semi-lunaire supérieur 11 - lobule semi-lunaire inférieur 12 - hémisphère inférieur 13 - lobule digastrique 14 - lobule cérébelleux 15 - amygdale cérébelleuse 16 - pyramide du vermis 17 - aile du lobule central 18 - nœud 19 - sommet 20 - rainure 21 - moyeu du vermis 22 - tubercule du vermis 23 - lobule quadrangulaire.
Riz. 24. Structure interne du cervelet
Le cervelet est construit selon le type nucléaire - la surface des hémisphères est représentée par la matière grise, qui constitue le nouveau cortex. Le cortex forme des circonvolutions séparées les unes des autres par des sillons. Sous le cortex cérébelleux se trouve la substance blanche, dans l'épaisseur de laquelle se distinguent les noyaux cérébelleux appariés (Fig. 25). Il s'agit notamment des noyaux de tente, des noyaux sphériques, des noyaux en liège et des noyaux dentelés. Les noyaux de tente sont associés à l'appareil vestibulaire, les noyaux sphériques et corticaux sont associés au mouvement du torse et le noyau denté est associé au mouvement des membres.

1- pédoncules cérébelleux antérieurs ; 2 - noyaux de tente ; 3 - noyau denté ; 4 - noyau liégeux ; 5 - substance blanche ; 6 - hémisphères cérébelleux ; 7 – ver; 8 noyaux globulaires
Riz. 25. Noyaux cérébelleux
Le cortex cérébelleux est du même type et se compose de trois couches : moléculaire, ganglionnaire et granulaire, dans lesquelles se trouvent 5 types de cellules : cellules de Purkinje, cellules en panier, étoilées, granulaires et de Golgi (Fig. 26). Dans la couche moléculaire superficielle se trouvent des branches dendritiques de cellules de Purkinje, qui sont l’un des neurones les plus complexes du cerveau. Les processus dendritiques sont abondamment recouverts d'épines, indiquant un grand nombre de synapses. En plus des cellules de Purkinje, cette couche contient de nombreux axones de fibres nerveuses parallèles (axones ramifiés en forme de T de cellules granulaires). Dans la partie inférieure de la couche moléculaire se trouvent des corps de cellules en panier dont les axones forment des contacts synaptiques dans la région des buttes axonales des cellules de Purkinje. La couche moléculaire contient également des cellules étoilées.


15 Réponse: Cellule Purkinje. B. Cellules granulaires.
B. Cellule de Golgi.
Riz. 26. Types de neurones cérébelleux.
Sous la couche moléculaire se trouve la couche ganglionnaire, qui contient les corps des cellules de Purkinje.
La troisième couche - granulaire - est représentée par les corps des interneurones (cellules granulaires ou cellules granulaires). Dans la couche granulaire se trouvent également des cellules de Golgi dont les axones s'élèvent dans la couche moléculaire.
Seuls deux types de fibres afférentes pénètrent dans le cortex cérébelleux : grimpantes et moussues, qui transportent l'influx nerveux jusqu'au cervelet. Chaque fibre grimpante est en contact avec une cellule de Purkinje. Les branches de la fibre moussue forment des contacts principalement avec les neurones granulaires, mais n'entrent pas en contact avec les cellules de Purkinje. Les synapses des fibres moussues sont excitatrices (Fig. 27).

Les impulsions excitatrices arrivent au cortex et aux noyaux du cervelet via les fibres grimpantes et moussues. Depuis le cervelet, les signaux proviennent uniquement des cellules de Purkinje (P), qui inhibent l'activité des neurones des noyaux 1 du cervelet (P). Les neurones intrinsèques du cortex cérébelleux comprennent les cellules granulaires excitatrices (3) et les neurones inhibiteurs du panier (K), les neurones de Golgi (G) et les neurones étoilés (Sv). Les flèches indiquent la direction du mouvement de l'influx nerveux. Il y a à la fois passionnant (+) et ; synapses inhibitrices (-).
Riz. 27. Circuit neuronal du cervelet.
Ainsi, le cortex cérébelleux comprend deux types de fibres afférentes : grimpantes et moussues. Ces fibres transmettent les informations des récepteurs tactiles et des récepteurs du système musculo-squelettique, ainsi que de toutes les structures cérébrales qui régulent la fonction motrice du corps.
L'influence efférente du cervelet s'effectue à travers les axones des cellules de Purkinje, qui sont inhibiteurs. Les axones des cellules de Purkinje exercent leur influence soit directement sur les motoneurones de la moelle épinière, soit indirectement par l'intermédiaire des neurones des noyaux cérébelleux ou d'autres centres moteurs.
Chez l'homme, en raison de la posture verticale et de l'activité professionnelle, le cervelet et ses hémisphères atteignent leur plus grand développement et leur plus grande taille.
Lorsque le cervelet est endommagé, des déséquilibres et du tonus musculaire sont observés. La nature des violations dépend de la localisation du dommage. Ainsi, lorsque les âmes de la tente sont endommagées, l’équilibre du corps est perturbé. Cela se manifeste par une démarche chancelante. Si le ver, le liège et les noyaux sphériques sont endommagés, le travail des muscles du cou et du torse est perturbé. Le patient a des difficultés à manger. Si les hémisphères et le noyau denté sont endommagés, le travail des muscles des membres (tremblements) devient difficile et ses activités professionnelles deviennent difficiles.
De plus, chez tous les patients présentant des lésions cérébelleuses dues à une coordination altérée des mouvements et à des tremblements (tremblements), la fatigue survient rapidement.
Mésencéphale
Le mésencéphale, comme le bulbe rachidien et le pont, appartient aux structures de la tige (Fig. 28).

1 - commissure des laisses
2 - laisse
3 - glande pinéale
4 - colliculus supérieur du mésencéphale
5 - corps géniculé médial
6 - corps géniculé latéral
7 - colliculus inférieur du mésencéphale
8 - pédoncules cérébelleux supérieurs
9 - pédoncules cérébelleux moyens
10 - pédoncules cérébelleux inférieurs
11- moelle oblongue
Riz. 28. Cerveau postérieur
Le mésencéphale est constitué de deux parties : le toit du cerveau et les pédoncules cérébraux. Le toit du mésencéphale est représenté par le quadrijumeau, dans lequel se distinguent les colliculi supérieur et inférieur. Dans l'épaisseur des pédoncules cérébraux, on distingue des amas appariés de noyaux, appelés substance noire et noyau rouge. À travers le mésencéphale, il existe des voies ascendantes vers le diencéphale et le cervelet et des voies descendantes depuis le cortex cérébral, les noyaux sous-corticaux et le diencéphale jusqu'aux noyaux de la moelle allongée et de la moelle épinière.
Dans le colliculus inférieur du quadrijumeau se trouvent des neurones qui reçoivent des signaux afférents des récepteurs auditifs. Par conséquent, les tubercules inférieurs du quadrijumeau sont appelés centre auditif primaire. L'arc réflexe du réflexe auditif indicatif passe par le centre auditif primaire, qui se manifeste en tournant la tête vers le signal acoustique.
Le colliculus supérieur est le principal centre visuel. Les neurones du centre visuel primaire reçoivent des impulsions afférentes des photorécepteurs. Le colliculus supérieur fournit un réflexe visuel indicatif : tourner la tête vers le stimulus visuel.
Les noyaux des nerfs latéraux et oculomoteurs participent à la mise en œuvre des réflexes d'orientation, qui innervent les muscles du globe oculaire, assurant son mouvement.
Le noyau rouge contient des neurones de différentes tailles. Le tractus rubrospinal descendant commence à partir des gros neurones du noyau rouge, qui affecte les motoneurones et régule finement le tonus musculaire.
Les neurones de la substance noire contiennent le pigment mélanine et donnent à ce noyau sa couleur sombre. La substance noire, à son tour, envoie des signaux aux neurones des noyaux réticulaires du tronc cérébral et des noyaux sous-corticaux.
La substance noire est impliquée dans la coordination complexe des mouvements. Il contient des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire libérant de la dopamine comme médiateur. Une partie de ces neurones régule le comportement émotionnel, l’autre joue un rôle important dans le contrôle d’actes moteurs complexes. Les dommages à la substance noire, conduisant à la dégénérescence des fibres dopaminergiques, entraînent l'incapacité de commencer à performer. mouvements volontaires la tête et les bras lorsque le patient est assis tranquillement (maladie de Parkinson) (Fig. 29 A, B).

Riz. 29A. 1 - colliculus 2 - aqueduc du cervelet 3 - matière grise centrale 4 - substance noire 5 - sulcus médial du pédoncule cérébral

Riz. 29B. Schéma de la structure interne du mésencéphale au niveau des colliculi inférieurs (coupe frontale)
1 - noyau du colliculus inférieur, 2 - tractus moteur du système extrapyramidal, 3 - décussation dorsale du tegmentum, 4 - noyau rouge, 5 - noyau rouge - tractus rachidien, 6 - décussation ventrale du tegmentum, 7 - lemnisque médial , 8 - lemniscus latéral, 9 - formation réticulaire, 10 - fascicule longitudinal médial, 11 - noyau du tractus mésencéphale du nerf trijumeau, 12 - noyau du nerf latéral, I-V - voies motrices descendantes du pédoncule cérébral
Riz. 29. Schéma de la structure interne du mésencéphale
Diencéphale
Le diencéphale forme les parois du troisième ventricule. Ses principales structures sont les tubérosités visuelles (thalamus) et la région sous-tuberculeuse (hypothalamus), ainsi que la région supratuberculaire (épithalamus) (Fig. 30 A, B).

Riz. 30 R. 1 - thalamus (thalamus visuel) - le centre sous-cortical de tous les types de sensibilité, le « sensoriel » du cerveau ; 2 - épithalamus (région supratuberculaire); 3 - métathalamus (région étrangère).

Riz. 30 B. Circuits du cerveau visuel ( thalamencéphale ) : a - vue de dessus b - vue arrière et vue de dessous.
Thalamus (thalamus visuel) 1 - burf antérieur du thalamus visuel, 2 - coussin 3 - fusion intertuberculaire 4 - bande médullaire du thalamus visuel
Épithalamus (région supratuberculaire) 5 - triangle de la laisse, 6 - laisse, 7 - commissure de la laisse, 8 - corps pinéal (épiphyse)
Métathalamus (région externe) 9 - corps genouillé latéral, 10 - corps genouillé médial, 11 - ventricule III, 12 - toit du mésencéphale
Riz. 30. Cerveau visuel
Au plus profond du tissu cérébral du diencéphale se trouvent les noyaux des corps géniculés externe et interne. La bordure extérieure est formée par la substance blanche qui sépare le diencéphale du télencéphale.
Thalamus (thalamus visuel)
Les neurones du thalamus forment 40 noyaux. Topographiquement, les noyaux du thalamus sont divisés en antérieur, médian et postérieur. Fonctionnellement, ces noyaux peuvent être divisés en deux groupes : spécifiques et non spécifiques.
Les noyaux spécifiques font partie de voies spécifiques. Ce sont des voies ascendantes qui transmettent les informations des récepteurs des organes sensoriels aux zones de projection du cortex cérébral.
Les noyaux spécifiques les plus importants sont le corps géniculé latéral, qui est impliqué dans la transmission des signaux des photorécepteurs, et le corps géniculé médial, qui transmet les signaux des récepteurs auditifs.
Les côtes non spécifiques du thalamus sont classées dans la formation réticulaire. Ils agissent comme des centres d'intégration et ont un effet ascendant activant principalement sur le cortex cérébral (Fig. 31 A, B)

1 - groupe antérieur (olfactif) ; 2 - groupe postérieur (visuel) ; 3 - groupe latéral (sensibilité générale) ; 4 - groupe médial (système extrapyramidal ; 5 - groupe central (formation réticulaire).

Riz. 31B. Coupe frontale du cerveau au niveau du milieu du thalamus. 1a - noyau antérieur du thalamus visuel. 16 - noyau médial du thalamus visuel, 1c - noyau latéral du thalamus visuel, 2 - ventricule latéral, 3 - fornix, 4 - noyau caudé, 5 - capsule interne, 6 - capsule externe, 7 - capsule externe (capsula extrema) , 8 - noyau ventral thalamus optica, 9 - noyau sous-thalamique, 10 - troisième ventricule, 11 - pédoncule cérébral. 12 - pont, 13 - fosse interpédonculaire, 14 - pédoncule hippocampique, 15 - corne inférieure du ventricule latéral. 16 - substance noire, 17 - insula. 18 - boule pâle, 19 - coquille, 20 - champs de truite N ; et B. 21 - fusion interthalamique, 22 - corps calleux, 23 - queue du noyau caudé.
Figure 31. Schéma des groupes de noyaux du thalamus
L'activation des neurones dans les noyaux non spécifiques du thalamus est particulièrement efficace pour provoquer des signaux de douleur (le thalamus est le centre de sensibilité à la douleur le plus élevé).
Les dommages aux noyaux non spécifiques du thalamus entraînent également une altération de la conscience : perte de communication active entre le corps et l'environnement.
Sous-thalamus (hypothalamus)
L'hypothalamus est formé d'un groupe de noyaux situés à la base du cerveau. Les noyaux de l'hypothalamus sont les centres sous-corticaux du système nerveux autonome de toutes les fonctions vitales du corps.
Topographiquement, l'hypothalamus est divisé en zone préoptique, zones de l'hypothalamus antérieur, moyen et postérieur. Tous les noyaux de l'hypothalamus sont appariés (Fig. 32 A-D).

1 - aqueduc 2 - noyau rouge 3 - tegmentum 4 - substance noire 5 - pédoncule cérébral 6 - corps mastoïdes 7 - substance perforée antérieure 8 - triangle oblique 9 - infundibulum 10 - chiasme optique 11. nerf optique 12 - tubercule gris 13 - perforé postérieur substance 14 - corps géniculé externe 15 - corps géniculé médial 16 - coussinet 17 - tractus optique
Riz. 32A. Métathalamus et hypothalamus

a - vue de dessous ; b - coupe sagittale médiane.
Partie visuelle (parsoptique) : 1 - plaque à bornes ; 2 - chiasme visuel ; 3 - tube visuel ; 4 - tubercule gris; 5 - entonnoir ; 6 - glande pituitaire ;
Partie olfactive : 7 - corps mamillaires - centres olfactifs sous-corticaux ; 8 - la région sous-cutanée au sens étroit du terme est une continuation des pédoncules cérébraux, contient la substance noire, le noyau rouge et le corps de Lewis, qui est un maillon du système extrapyramidal et du centre végétatif ; 9 - sillon subtuberculeux de Monroe ; 10 - selle turcique, dans la fosse de laquelle se trouve l'hypophyse.
Riz. 32B. Région sous-cutanée (hypothalamus)

Riz. 32V. Principaux noyaux de l'hypothalamus

1 - noyau supraoptique; 2 - noyau préoptique ; 3 - noyau paraventriculaire ; 4 - noyau du fond d'œil ; 5 - noyaucorporisamillaris; 6 - chiasme visuel ; 7 - glande pituitaire ; 8 - tubercule gris; 9 - corps mastoïde ; 10 pont.
Riz. 32G. Schéma des noyaux neurosécréteurs de la région sous-thalamique (Hypothalamus)
La zone préoptique comprend les noyaux préoptiques périventriculaires, médial et latéral.
Le groupe de l'hypothalamus antérieur comprend les noyaux supraoptique, suprachiasmatique et paraventriculaire.
L'hypothalamus moyen constitue les noyaux ventromédian et dorsomédial.
Dans l'hypothalamus postérieur, on distingue les noyaux hypothalamiques postérieurs, périforniques et mamillaires.
Les connexions de l'hypothalamus sont étendues et complexes. Les signaux afférents à l'hypothalamus proviennent du cortex cérébral, des noyaux sous-corticaux et du thalamus. Les principales voies efférentes atteignent le mésencéphale, le thalamus et les noyaux sous-corticaux.
L'hypothalamus est le centre le plus élevé de régulation du système cardiovasculaire, du métabolisme eau-sel, protéines, graisses et glucides. Cette zone du cerveau contient des centres associés à la régulation du comportement alimentaire. Un rôle important de l'hypothalamus est la régulation. La stimulation électrique des noyaux postérieurs de l’hypothalamus entraîne une hyperthermie, conséquence d’une augmentation du métabolisme.
L'hypothalamus participe également au maintien du biorythme veille-sommeil.
Les noyaux de l'hypothalamus antérieur sont reliés à l'hypophyse et effectuent le transport biologiquement substances actives, qui sont produits par les neurones de ces noyaux. Les neurones du noyau préoptique produisent des facteurs de libération (statines et libérines) qui contrôlent la synthèse et la libération des hormones hypophysaires.
Les neurones des noyaux préoptique, supraoptique et paraventriculaire produisent de véritables hormones - la vasopressine et l'ocytocine, qui descendent le long des axones des neurones jusqu'à la neurohypophyse, où elles sont stockées jusqu'à leur libération dans le sang.
Les neurones de l'hypophyse antérieure produisent 4 types d'hormones : 1) l'hormone somatotrope, qui régule la croissance ; 2) l'hormone gonadotrope, qui favorise la croissance des cellules germinales, le corps jaune, et améliore la production de lait ; 3) hormone stimulant la thyroïde – stimule la fonction de la glande thyroïde ; 4) hormone adrénocorticotrope - améliore la synthèse des hormones du cortex surrénalien.
Le lobe intermédiaire de l'hypophyse sécrète l'hormone intermédine, qui affecte la pigmentation de la peau.
Le lobe postérieur de l'hypophyse sécrète deux hormones : la vasopressine, qui affecte les muscles lisses des artérioles, et l'ocytocine, qui agit sur les muscles lisses de l'utérus et stimule la sécrétion de lait.
L'hypothalamus joue également un rôle important dans le comportement émotionnel et sexuel.
L'épithalamus (glande pinéale) comprend la glande pinéale. L'hormone de la glande pinéale, la mélatonine, inhibe la formation d'hormones gonadotropes dans l'hypophyse, ce qui retarde le développement sexuel.
Cerveau antérieur
Le cerveau antérieur se compose de trois parties anatomiquement distinctes : le cortex cérébral, la substance blanche et les noyaux sous-corticaux.
Conformément à la phylogénie du cortex cérébral, on distingue l'ancien cortex (archicortex), l'ancien cortex (paléocortex) et le nouveau cortex (néocortex). L'ancien cortex comprend les bulbes olfactifs, qui reçoivent les fibres afférentes de l'épithélium olfactif, les voies olfactives - situées sur la surface inférieure du lobe frontal, et les tubercules olfactifs - les centres olfactifs secondaires.
L'ancien cortex comprend le cortex cingulaire, le cortex hippocampique et l'amygdale.
Toutes les autres zones du cortex sont du néocortex. Le cortex ancien et ancien est appelé cerveau olfactif (Fig. 33).
Le cerveau olfactif, en plus des fonctions liées à l'odorat, assure des réactions de vigilance et d'attention, et participe à la régulation des fonctions autonomes de l'organisme. Ce système joue également un rôle important dans la mise en œuvre de comportements instinctifs (alimentaires, sexuels, défensifs) et la formation des émotions.


a - vue de dessous ; b - sur une coupe sagittale du cerveau
Département périphérique : 1 - bulbusolfactorius (bulbe olfactif ; 2 - tractusolfactories (voie olfactive) ; 3 - trigonumolfactorium (triangle olfactif) ; 4 - substantiaperforateantérieur (substance perforée antérieure).
Section centrale - circonvolutions du cerveau : 5 - gyrus voûté ; 6 - l'hippocampe est situé dans la cavité de la corne inférieure du ventricule latéral ; 7 - continuation du vêtement gris du corps calleux ; 8 - coffre-fort ; 9 - septum transparent - voies conductrices du cerveau olfactif.
Figure 33. Cerveau olfactif
L'irritation des structures de l'ancien cortex affecte le système cardiovasculaire et la respiration, provoque une hypersexualité et modifie le comportement émotionnel.
Avec la stimulation électrique de l'amygdale, on observe des effets liés à l'activité du tube digestif : léchage, mastication, déglutition, modifications de la motilité intestinale. L'irritation des amygdales affecte également l'activité des organes internes - reins, vessie, utérus.
Ainsi, il existe un lien entre les structures de l'ancien cortex et le système nerveux autonome, avec des processus visant à maintenir l'homéostasie des environnements internes du corps.
Cerveau fini
Le télencéphale comprend : le cortex cérébral, la substance blanche et les noyaux sous-corticaux situés dans son épaisseur.
La surface des hémisphères cérébraux est pliée. Sillons - les dépressions le divisent en lobes.
Le sillon central (rolandien) sépare le lobe frontal du lobe pariétal. La fissure latérale (sylvienne) sépare le lobe temporal des lobes pariétal et frontal. Le sillon occipito-pariétal forme la limite entre les lobes pariétal, occipital et temporal (Fig. 34 A, B, Fig. 35).


1 - gyrus frontal supérieur ; 2 - gyrus frontal moyen ; 3 - gyrus précentral ; 4 - gyrus postcentral ; 5 - gyrus pariétal inférieur ; 6 - gyrus pariétal supérieur ; 7 - gyrus occipital ; 8 - sillon occipital ; 9 - sulcus intrapariétal ; 10 - rainure centrale ; 11 - gyrus précentral ; 12 - sillon frontal inférieur ; 13 - sulcus frontal supérieur ; 14 - fente verticale.
Riz. 34A. Cerveau de la surface dorsale


1 - sillon olfactif ; 2 - substance perforée antérieure ; 3 - crochet; 4 - sillon temporal moyen ; 5 - sillon temporal inférieur ; 6 - rainure hippocampe; 7 - rainure du rond-point ; 8 - sillon calcarin; 9 - coin; 10 - gyrus parahippocampique ; 11 - sillon occipitotemporal ; 12 - gyrus pariétal inférieur ; 13 - triangle olfactif ; 14 - gyrus droit ; 15 - tractus olfactif ; 16 - bulbe olfactif ; 17 - fente verticale.
Riz. 34B. Cerveau de la surface ventrale

1 - rainure centrale (Rolanda) ; 2 - rainure latérale (fissure sylvienne) ; 3 - sulcus précentral ; 4 - sulcus frontal supérieur ; 5 - sillon frontal inférieur ; 6 - branche ascendante ; 7 - branche antérieure ; 8 - rainure postcentrale ; 9 - sulcus intrapariétal ; 10 - sillon temporal supérieur ; 11 - sillon temporal inférieur ; 12 - sillon occipital transversal ; 13 - sillon occipital.
Riz. 35. Rainures sur la surface supérolatérale de l'hémisphère (côté gauche)
Ainsi, les sillons divisent les hémisphères du télencéphale en cinq lobes : le lobe frontal, pariétal, temporal, occipital et insulaire, situé sous le lobe temporal (Fig. 36).

Riz. 36. Zones de projection (marquées de points) et associatives (lumières) du cortex cérébral. Les zones de projection comprennent la zone motrice (lobe frontal), la zone somatosensorielle (lobe pariétal), la zone visuelle (lobe occipital) et la zone auditive (lobe temporal).
Il y a également des rainures à la surface de chaque lobe.
Il existe trois ordres de sillons : primaire, secondaire et tertiaire. Les rainures primaires sont relativement stables et les plus profondes. Ce sont les limites de grandes parties morphologiques du cerveau. Les rainures secondaires s'étendent à partir des rainures primaires et les rainures tertiaires à partir des rainures secondaires.
Entre les rainures se trouvent des plis - des circonvolutions dont la forme est déterminée par la configuration des rainures.
Le lobe frontal est divisé en gyri frontaux supérieur, moyen et inférieur. Le lobe temporal contient les gyri temporaux supérieur, moyen et inférieur. Le gyrus central antérieur (précentral) est situé devant le sillon central. Le gyrus central postérieur (postcentral) est situé derrière le sillon central.
Chez l'homme, il existe une grande variabilité dans les sillons et les circonvolutions du télencéphale. Malgré cette variabilité individuelle structure externe hémisphères, cela n’affecte pas la structure de la personnalité et de la conscience.
Cytoarchitecture et myéloarchitecture du néocortex
Conformément à la division des hémisphères en cinq lobes, on distingue cinq zones principales - frontale, pariétale, temporale, occipitale et insulaire, qui présentent des différences de structure et remplissent des fonctions différentes. Cependant, le plan général de la structure du nouveau cortex est le même. La nouvelle croûte est une structure en couches (Fig. 37). I - couche moléculaire, formée principalement de fibres nerveuses parallèles à la surface. Parmi les fibres parallèles, il existe un petit nombre de cellules granulaires. Sous la couche moléculaire se trouve une deuxième couche - la couche granulaire externe. La couche III est la couche pyramidale externe, la couche IV est la couche granulaire interne, la couche V est la couche pyramidale interne et la couche VI est multiforme. Les couches portent le nom des neurones. En conséquence, dans les couches II et IV, les somas des neurones ont une forme arrondie (cellules granulaires) (couches granulaires externe et interne), et dans les couches III et IV, les somas ont une forme pyramidale (dans la pyramidale externe il y a de petites pyramides, et dans les couches pyramidales internes, il y en a de grandes (pyramides ou cellules de Betz). La couche VI est caractérisée par la présence de neurones de formes diverses (fusiformes, triangulaires, etc.).
Les principales entrées afférentes du cortex cérébral sont les fibres nerveuses provenant du thalamus. Les neurones corticaux qui perçoivent les impulsions afférentes voyageant le long de ces fibres sont appelés sensoriels, et la zone où se trouvent les neurones sensoriels est appelée zones de projection du cortex.
Les principales sorties efférentes du cortex sont les axones des pyramides de la couche V. Ce sont des motoneurones efférents impliqués dans la régulation des fonctions motrices. La plupart des neurones corticaux sont intercorticaux, impliqués dans le traitement de l'information et fournissant des connexions intercorticales.

Neurones corticaux typiques

Les chiffres romains indiquent les couches cellulaires I - couche moléculaire ; II - couche granulaire externe ; III - couche pyramidale externe ; IV - couche granulaire interne ; V - couche interne de primamide ; Couche VI-multiforme.
a - fibres afférentes ; b - types de cellules détectées sur les préparations imprégnées selon la méthode Goldbrzy ; c - cytoarchitecture révélée par coloration Nissl. 1 - cellules horizontales, 2 - bande de Kees, 3 - cellules pyramidales, 4 - cellules étoilées, 5 - bande de Bellarger externe, 6 - bande de Bellarger interne, 7 - cellule pyramidale modifiée.
Riz. 37. Cytoarchitecture (A) et myéloarchitecture (B) du cortex cérébral.
Tout en conservant le plan structurel général, il a été constaté que différentes sections du cortex (au sein d'une même zone) diffèrent par l'épaisseur des couches. Dans certaines couches, plusieurs sous-couches peuvent être distinguées. De plus, il existe des différences dans la composition cellulaire (diversité des neurones, densité et localisation). Compte tenu de toutes ces différences, Brodman a identifié 52 zones, qu'il a appelées champs cytoarchitectoniques et désignées par des chiffres arabes de 1 à 52 (Fig. 38 A, B).


Et la vue de côté. B médio-sagittal ; tranche
Riz. 38. Disposition du terrain selon Boardman
Chaque champ cytoarchitectonique diffère non seulement par sa structure cellulaire, mais également par l'emplacement des fibres nerveuses, qui peuvent s'étendre dans les directions verticale et horizontale. L’accumulation de fibres nerveuses dans le champ cytoarchitectonique est appelée myéloarchitectonique.
Actuellement, le « principe colonnaire » d’organisation des zones de projection du cortex est de plus en plus reconnu.
Selon ce principe, chaque zone de projection est constituée d'un grand nombre de colonnes orientées verticalement, d'environ 1 mm de diamètre. Chaque colonne regroupe environ 100 neurones, parmi lesquels se trouvent des neurones sensoriels, intercalaires et efférents, reliés entre eux par des connexions synaptiques. Une seule « colonne corticale » est impliquée dans le traitement des informations provenant d'un nombre limité de récepteurs, c'est-à-dire : remplit une fonction spécifique.
Système de fibres hémisphériques
Les deux hémisphères contiennent trois types de fibres. Grâce aux fibres de projection, l'excitation pénètre dans le cortex à partir des récepteurs par des voies spécifiques. Les fibres d'association se connectent entre elles divers domaines le même hémisphère. Par exemple, la région occipitale avec la région temporale, la région occipitale avec la région frontale, la région frontale avec la région pariétale. Les fibres commissurales relient les zones symétriques des deux hémisphères. Parmi les fibres commissurales, on trouve : les commissures cérébrales antérieures et postérieures et le corps calleux (Fig. 39 A.B).
|
Riz. 39A. a - surface médiale de l'hémisphère ;
b - surface altérée supérieure de l'hémisphère ;
A - pôle frontal ;
B - pôle occipital ;
C - corps calleux ;
1 - les fibres arquées du cerveau relient les gyri voisins ;
2 - ceinture - un faisceau du cerveau olfactif se trouve sous le gyrus voûté, s'étend de la région du triangle olfactif jusqu'au crochet ;
3 - le fascicule longitudinal inférieur relie les régions occipitales et temporales ;
4 - le fascicule longitudinal supérieur relie les lobes frontal, occipital, temporal et le lobe pariétal inférieur ;
5 - le fascicule unciné est situé au bord antérieur de l'insula et relie le pôle frontal au pôle temporal.

Riz. 39B. Cortex cérébral en coupe transversale. Les deux hémisphères sont reliés par des faisceaux de substance blanche qui forment les corps calleux (fibres commissurales).
Riz. 39. Schéma des fibres associatives
Formation réticulaire
La formation réticulaire (substance réticulaire du cerveau) a été décrite par les anatomistes à la fin du siècle dernier.
La formation réticulaire commence dans la moelle épinière, où elle est représentée par la substance gélatineuse de la base du cerveau postérieur. Sa partie principale est située dans le tronc cérébral central et le diencéphale. Il se compose de neurones de formes et de tailles variées, dotés de processus de ramification étendus allant dans des directions différentes. Parmi les processus, on distingue les fibres nerveuses courtes et longues. Les processus courts fournissent des connexions locales, les longs forment les chemins ascendants et descendants de la formation réticulaire.
Des amas de neurones forment des noyaux situés sur différents niveaux cerveau (dorsal, bulbe rachidien, moyen, intermédiaire). La plupart des noyaux de la formation réticulaire n'ont pas de limites morphologiques claires et les neurones de ces noyaux ne sont unis que par des caractéristiques fonctionnelles (centre respiratoire, cardiovasculaire, etc.). Cependant, au niveau de la moelle allongée, on distingue des noyaux aux limites clairement définies - la cellule géante réticulaire, les noyaux parvocellulaires réticulaires et latéraux. Les noyaux de la formation réticulaire du pont sont essentiellement une continuation des noyaux de la formation réticulaire de la moelle allongée. Les plus gros d'entre eux sont les noyaux caudal, médial et oral. Ce dernier passe dans le groupe cellulaire des noyaux de la formation réticulaire du mésencéphale et du noyau réticulaire du tegmentum du cerveau. Les cellules de la formation réticulaire sont le début des voies ascendantes et descendantes, donnant de nombreuses collatérales (terminaisons) qui forment des synapses sur les neurones de différents noyaux du système nerveux central.
Les fibres de cellules réticulaires se dirigeant vers la moelle épinière forment le tractus réticulospinal. Les fibres des voies ascendantes, commençant dans la moelle épinière, relient la formation réticulaire au cervelet, au mésencéphale, au diencéphale et au cortex cérébral.
Il existe des formations réticulaires spécifiques et non spécifiques. Par exemple, certaines des voies ascendantes de la formation réticulaire reçoivent des garanties de voies spécifiques (visuelles, auditives, etc.), le long desquelles les impulsions afférentes sont transmises aux zones de projection du cortex.
Les voies ascendantes et descendantes non spécifiques de la formation réticulaire affectent l'excitabilité de diverses parties du cerveau, principalement le cortex cérébral et la moelle épinière. Ces influences, selon leur signification fonctionnelle, peuvent être à la fois activatrices et inhibitrices, c'est pourquoi on les distingue : 1) influence activatrice ascendante, 2) influence inhibitrice ascendante, 3) influence activatrice descendante, 4) influence inhibiteur descendante. Sur la base de ces facteurs, la formation réticulaire est considérée comme un système cérébral régulateur non spécifique.
La plus étudiée est l'influence activatrice de la formation réticulaire sur le cortex cérébral. La plupart des fibres ascendantes de la formation réticulaire se terminent de manière diffuse dans le cortex cérébral et maintiennent son tonus et assurent l'attention. Un exemple d'effets inhibiteurs descendants de la formation réticulaire est une diminution du tonus des muscles squelettiques humains au cours de certaines étapes du sommeil.
Les neurones de la formation réticulaire sont extrêmement sensibles aux substances humorales. Il s'agit d'un mécanisme indirect d'influence de divers facteurs humoraux et du système endocrinien sur les parties supérieures du cerveau. Par conséquent, les effets toniques de la formation réticulaire dépendent de l'état de l'organisme tout entier (Fig. 40).

Riz. 40. Le système réticulaire activateur (SRA) est un réseau nerveux à travers lequel l'excitation sensorielle est transmise de la formation réticulaire du tronc cérébral aux noyaux non spécifiques du thalamus. Les fibres de ces noyaux régulent le niveau d'activité du cortex.
Noyaux sous-corticaux
Les noyaux sous-corticaux font partie du télencéphale et sont situés à l'intérieur de la substance blanche des hémisphères cérébraux. Ceux-ci incluent le corps caudé et le putamen, collectivement appelés « striatum » (striatum) et le globus pallidus, constitué du corps lentiforme, de l’enveloppe et de l’amygdale. Les noyaux sous-corticaux et les noyaux du mésencéphale (noyau rouge et substance noire) constituent le système des noyaux gris centraux (noyaux) (Fig. 41). Les noyaux gris centraux reçoivent les impulsions du cortex moteur et du cervelet. À leur tour, les signaux des noyaux gris centraux sont envoyés au cortex moteur, au cervelet et à la formation réticulaire, c'est-à-dire Il existe deux boucles neuronales : l’une relie les noyaux gris centraux au cortex moteur, l’autre au cervelet.


Riz. 41. Système des noyaux gris centraux
Les noyaux sous-corticaux participent à la régulation de l'activité motrice, régulant des mouvements complexes lors de la marche, du maintien d'une posture et de l'alimentation. Ils organisent des mouvements lents (enjamber des obstacles, enfiler une aiguille, etc.).
Il existe des preuves que le striatum est impliqué dans les processus de mémorisation des programmes moteurs, car l'irritation de cette structure entraîne des troubles de l'apprentissage et de la mémoire. Le striatum a un effet inhibiteur sur diverses manifestations de l'activité motrice et sur les composantes émotionnelles du comportement moteur, notamment sur les réactions agressives.
Les principaux transmetteurs des noyaux gris centraux sont : la dopamine (notamment dans la substance noire) et l'acétylcholine. Les dommages aux noyaux gris centraux provoquent des mouvements lents, tordus et involontaires accompagnés de contractions musculaires brusques. Mouvements saccadés involontaires de la tête et des membres. Maladie de Parkinson dont les principaux symptômes sont des tremblements (tremblements) et une rigidité musculaire (forte augmentation du tonus des muscles extenseurs). En raison de la rigidité, le patient peut à peine commencer à bouger. Un tremblement constant empêche les petits mouvements. La maladie de Parkinson survient lorsque la substance noire est endommagée. Normalement, la substance noire a un effet inhibiteur sur le noyau caudé, le putamen et le globus pallidus. Lorsqu'il est détruit, les influences inhibitrices sont éliminées, ce qui augmente l'effet excitateur des noyaux gris centraux sur le cortex cérébral et la formation réticulaire, ce qui provoque les symptômes caractéristiques de la maladie.
Système limbique
Le système limbique est représenté par des sections du nouveau cortex (néocortex) et du diencéphale situées à la frontière. Il rassemble des complexes de structures d'âges phylogénétiques différents, dont certaines sont corticales et d'autres nucléaires.
Les structures corticales du système limbique comprennent le gyri hippocampique, parahippocampique et cingulaire (cortex sénile). L'ancien cortex est représenté par le bulbe olfactif et les tubercules olfactifs. Le néocortex fait partie des cortex frontal, insulaire et temporal.
Les structures nucléaires du système limbique combinent les noyaux amygdale et septal et les noyaux thalamiques antérieurs. De nombreux anatomistes considèrent la zone préoptique de l'hypothalamus et les corps mamillaires comme faisant partie du système limbique. Les structures du système limbique forment des connexions bidirectionnelles et sont reliées à d’autres parties du cerveau.
Le système limbique contrôle le comportement émotionnel et régule les facteurs endogènes qui fournissent la motivation. Les émotions positives sont principalement associées à l'excitation des neurones adrénergiques, et les émotions négatives, ainsi que la peur et l'anxiété, sont associées au manque d'excitation des neurones noradrénergiques.
Le système limbique est impliqué dans l’organisation des comportements d’orientation et d’exploration. Ainsi, des neurones « nouveautés » ont été découverts dans l’hippocampe, modifiant leur activité impulsionnelle lorsque de nouveaux stimuli apparaissent. L'hippocampe joue un rôle important dans le maintien de l'environnement interne du corps et est impliqué dans les processus d'apprentissage et de mémoire.
Par conséquent, le système limbique organise les processus d'autorégulation du comportement, des émotions, de la motivation et de la mémoire (Fig. 42).

Riz. 42. Système limbique
Système nerveux autonome
Le système nerveux autonome (végétatif) assure la régulation des organes internes, renforçant ou affaiblissant leur activité, remplit une fonction adaptative-trophique, régule le niveau de métabolisme (métabolisme) dans les organes et les tissus (Fig. 43, 44).

1 - tronc sympathique ; 2 - nœud cervicothoracique (stellaire); 3 – nœud cervical moyen ; 4 - nœud cervical supérieur ; 5 - artère carotide interne ; 6 - plexus coeliaque ; 7 - plexus mésentérique supérieur ; 8 - plexus mésentérique inférieur
Riz. 43. Partie sympathique du système nerveux autonome,
III - nerf oculomoteur ; YII - nerf facial ; IX - nerf glossopharyngé; X - nerf vague.
1 - nœud ciliaire ; 2 - nœud ptérygopalatin ; 3 - nœud d'oreille; 4 - nœud sous-maxillaire ; 5 - nœud sublingual ; 6 - noyau sacré parasympathique ; 7 - nœud pelvien extra-muros.
Riz. 44. Partie parasympathique du système nerveux autonome.
Le système nerveux autonome comprend des parties des systèmes nerveux central et périphérique. Contrairement au système nerveux somatique, dans le système nerveux autonome, la partie efférente est constituée de deux neurones : préganglionnaire et postganglionnaire. Les neurones préganglionnaires sont situés dans le système nerveux central. Les neurones postganglionnaires participent à la formation des ganglions autonomes.
Le système nerveux autonome est divisé en divisions sympathique et parasympathique.
Dans la division sympathique, les neurones préganglionnaires sont situés dans les cornes latérales de la moelle épinière. Les axones de ces cellules (fibres préganglionnaires) se rapprochent des ganglions sympathiques du système nerveux, situés de part et d'autre de la colonne vertébrale sous la forme d'une chaîne nerveuse sympathique.
Les neurones postganglionnaires sont situés dans les ganglions sympathiques. Leurs axones émergent dans le cadre des nerfs spinaux et forment des synapses sur les muscles lisses des organes internes, des glandes, des parois vasculaires, de la peau et d'autres organes.
Dans le système nerveux parasympathique, les neurones préganglionnaires sont situés dans les noyaux du tronc cérébral. Les axones des neurones préganglionnaires font partie des nerfs oculomoteurs, faciaux, glossopharyngés et vagues. De plus, des neurones préganglionnaires se trouvent également dans la moelle épinière sacrée. Leurs axones se dirigent vers le rectum, la vessie et les parois des vaisseaux qui irriguent les organes situés dans la région pelvienne. Les fibres préganglionnaires forment des synapses sur les neurones postganglionnaires des ganglions parasympathiques situés à proximité ou à l'intérieur de l'effecteur (dans ce dernier cas, le ganglion parasympathique est dit intra-muros).
Toutes les parties du système nerveux autonome sont subordonnées aux parties supérieures du système nerveux central.
Un antagonisme fonctionnel des systèmes nerveux sympathique et parasympathique a été noté, ce qui revêt une grande importance adaptative (voir tableau 1).
SECTION I V . DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME NERVEUX
Le système nerveux commence à se développer au cours de la 3ème semaine de développement intra-utérin à partir de l'ectoderme (couche germinale externe).
Sur la face dorsale (dorsale) de l'embryon, l'ectoderme s'épaissit. Cela forme la plaque neurale. La plaque neurale se plie ensuite plus profondément dans l’embryon et un sillon neural se forme. Les bords du sillon neural se rapprochent pour former le tube neural. Le tube neural long et creux, qui repose d'abord à la surface de l'ectoderme, s'en sépare et plonge vers l'intérieur, sous l'ectoderme. Le tube neural se dilate à l’extrémité antérieure, à partir de laquelle se forme ensuite le cerveau. Le reste du tube neural est transformé en cerveau (Fig. 45).

Riz. 45. Étapes de l'embryogenèse du système nerveux dans une coupe schématique transversale, a - plaque médullaire ; b et c - sillon médullaire ; d et e - tube cérébral. 1 - feuille cornée (épiderme); 2 - coussin ganglionnaire.
À partir des cellules migrant des parois latérales du tube neural, deux crêtes neurales se forment - les cordons nerveux. Par la suite, les ganglions spinaux et autonomes et les cellules de Schwann sont formés à partir des cordons nerveux, qui forment les gaines de myéline des fibres nerveuses. De plus, les cellules de la crête neurale participent à la formation de la pie-mère et de la membrane arachnoïdienne du cerveau. Dans la partie interne du tube neural, une division cellulaire accrue se produit. Ces cellules se différencient en 2 types : les neuroblastes (précurseurs des neurones) et les spongioblastes (précurseurs des cellules gliales). Simultanément à la division cellulaire, la tête du tube neural est divisée en trois sections : les vésicules cérébrales primaires. En conséquence, ils sont appelés cerveau antérieur (vésicule I), cerveau moyen (vésicule II) et cerveau postérieur (vésicule III). Lors du développement ultérieur, le cerveau est divisé en télencéphale (hémisphères cérébraux) et diencéphale. Le mésencéphale est préservé dans son ensemble et le cerveau postérieur est divisé en deux sections, y compris le cervelet avec le pont et la moelle allongée. Il s'agit du stade 5-vésical du développement cérébral (Fig. 46, 47).

a - cinq voies cérébrales : 1 - première vésicule (cerveau terminal) ; 2 - deuxième vessie (diencéphale); 3 - troisième vessie (mésencéphale) ; 4- quatrième vessie (médulla oblongata) ; entre la troisième et la quatrième vessie il y a un isthme ; b - développement du cerveau (d'après R. Sinelnikov).
Riz. 46. Développement cérébral (schéma)
A - formation de cloques primaires (jusqu'à la 4ème semaine de développement embryonnaire). B - E - formation de bulles secondaires. B, C - fin de la 4ème semaine ; G - sixième semaine ; D - 8-9 semaines, se terminant par la formation des principales parties du cerveau (E) - à 14 semaines.
3a - isthme du rhombencéphale ; 7 plaque d'extrémité.
Stade A : 1, 2, 3 - vésicules cérébrales primaires
1 - cerveau antérieur,
2 - mésencéphale,
3 - cerveau postérieur.
Stade B : le cerveau antérieur est divisé en hémisphères et noyaux gris centraux (5) et diencéphale (6)
Stade B : Le rhombencéphale (3a) est divisé en cerveau postérieur, qui comprend le cervelet (8), le pont (9) stade E et la moelle oblongue (10) stade E.
Stade E : formation de la moelle épinière (4)
Riz. 47. Le cerveau en développement.
La formation de vésicules nerveuses s'accompagne de l'apparition de courbures dues aux différents taux de maturation des parties du tube neural. À la 4ème semaine du développement intra-utérin, les courbes pariétales et occipitales se forment, et au cours de la 5ème semaine, la courbe pontine se forme. Au moment de la naissance, seule la courbure du tronc cérébral reste presque à angle droit au niveau de la jonction du mésencéphale et du diencéphale (Fig. 48).

Vue latérale illustrant les courbes du mésencéphale (A), du col utérin (B) et du pont (C).
1 - vésicule optique, 2 - cerveau antérieur, 3 - mésencéphale ; 4 - cerveau postérieur; 5 - vésicule auditive ; 6 - moelle épinière ; 7 - diencéphale; 8 - télencéphale; 9 - lèvre rhombique. Les chiffres romains indiquent l'origine des nerfs crâniens.
Riz. 48. Le cerveau en développement (de la 3ème à la 7ème semaine de développement).
Au début, la surface des hémisphères cérébraux est lisse. À 11-12 semaines de développement intra-utérin, le sillon latéral (Sylvius) se forme d'abord, puis le sillon central (rollandien). La pose de sillons dans les lobes des hémisphères se produit assez rapidement : en raison de la formation de sillons et de circonvolutions, la surface du cortex augmente (Fig. 49).
Riz. 49. Vue latérale des hémisphères cérébraux en développement.
A- 11ème semaine. B- 16_ 17 semaines. B- 24-26 semaines. G- 32-34 semaines. D - nouveau-né. La formation de la fissure latérale (5), du sillon central (7) et d'autres sillons et circonvolutions est illustrée.
I - télencéphale ; 2 - mésencéphale ; 3 - cervelet; 4 - moelle oblongue; 7 - rainure centrale ; 8 - pont; 9 - sillons de la région pariétale ; 10 - sillons de la région occipitale ;
II - sillons de la région frontale.
Par migration, les neuroblastes forment des amas - les noyaux qui forment la matière grise de la moelle épinière, et dans le tronc cérébral - certains noyaux des nerfs crâniens.
Les neuroblastes somatiques ont une forme ronde. Le développement d'un neurone se manifeste par l'apparition, la croissance et la ramification de processus (Fig. 50). Une petite saillie courte se forme sur la membrane neuronale à l'emplacement du futur axone - un cône de croissance. L'axone s'étend et fournit des nutriments au cône de croissance. Au début de son développement, un neurone développe un plus grand nombre de processus que le nombre final de processus d'un neurone mature. Certains processus sont rétractés dans le soma du neurone et les autres se développent vers d'autres neurones avec lesquels ils forment des synapses.

Riz. 50. Développement d'une cellule fusiforme dans l'ontogenèse humaine. Les deux derniers croquis montrent la différence de structure de ces cellules chez un enfant âgé de deux ans et chez un adulte.
Dans la moelle épinière, les axones sont courts et forment des connexions intersegmentaires. Des fibres de projection plus longues se forment plus tard. Un peu plus tard que l'axone, la croissance dendritique commence. Toutes les branches de chaque dendrite sont formées à partir d'un seul tronc. Le nombre de branches et la longueur des dendrites ne sont pas complétés pendant la période prénatale.
L’augmentation de la masse cérébrale pendant la période prénatale est principalement due à une augmentation du nombre de neurones et du nombre de cellules gliales.
Le développement du cortex est associé à la formation de couches cellulaires (dans le cortex cérébelleux il y a trois couches et dans le cortex cérébral il y en a six).
Les cellules dites gliales jouent un rôle important dans la formation des couches corticales. Ces cellules prennent une position radiale et forment deux longs processus orientés verticalement. La migration neuronale se produit le long des processus de ces cellules gliales radiales. Les couches les plus superficielles de l’écorce se forment en premier. Les cellules gliales participent également à la formation de la gaine de myéline. Parfois, une cellule gliale participe à la formation des gaines de myéline de plusieurs axones.
Le tableau 2 reflète les principales étapes de développement du système nerveux de l'embryon et du fœtus.
Tableau 2.
Les principales étapes du développement du système nerveux pendant la période prénatale.
| Âge fœtal (semaines) | Développement du système nerveux |
| 2,5 | Un sillon neural se dessine |
| 3.5 | Le tube neural et les cordons nerveux se forment |
| 4 | 3 bulles cérébrales se forment ; forme de nerfs et de ganglions |
| 5 | 5 bulles cérébrales se forment |
| 6 | Les méninges sont délimitées |
| 7 | Les hémisphères du cerveau atteignent une grande taille |
| 8 | Des neurones typiques apparaissent dans le cortex |
| 10 | Formé structure interne moelle épinière |
| 12 | Les caractéristiques structurelles générales du cerveau sont formées ; la différenciation des cellules neurogliales commence |
| 16 | Lobes distincts du cerveau |
| 20-40 | La myélinisation de la moelle épinière commence (semaine 20), des couches du cortex apparaissent (semaine 25), des sillons et des circonvolutions se forment (semaine 28-30), la myélinisation du cerveau commence (semaine 36-40) |
Ainsi, le développement du cerveau pendant la période prénatale se produit de manière continue et parallèle, mais se caractérise par une hétérochronie : le taux de croissance et de développement des formations phylogénétiquement plus anciennes est supérieur à celui des formations phylogénétiquement plus jeunes.
Les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans la croissance et le développement du système nerveux pendant la période prénatale. Le poids moyen du cerveau d'un nouveau-né est d'environ 350 g.
La maturation morpho-fonctionnelle du système nerveux se poursuit pendant la période postnatale. À la fin de la première année de vie, le poids du cerveau atteint 1 000 g, alors que chez un adulte, le poids du cerveau est en moyenne de 1 400 g. Par conséquent, la principale augmentation du poids du cerveau se produit au cours de la première année de la vie d’un enfant.
L’augmentation de la masse cérébrale au cours de la période postnatale est principalement due à une augmentation du nombre de cellules gliales. Le nombre de neurones n'augmente pas, car ils perdent la capacité de se diviser dès la période prénatale. La densité globale des neurones (le nombre de cellules par unité de volume) diminue en raison de la croissance du soma et des processus. Le nombre de branches de dendrites augmente.
Au cours de la période postnatale, la myélinisation des fibres nerveuses se poursuit également tant au niveau du système nerveux central que des fibres nerveuses qui composent les nerfs périphériques (crâniens et spinaux).
La croissance des nerfs spinaux est associée au développement du système musculo-squelettique et à la formation de synapses neuromusculaires, et la croissance des nerfs crâniens à la maturation des organes sensoriels.
Ainsi, si pendant la période prénatale le développement du système nerveux se produit sous le contrôle du génotype et est pratiquement indépendant de l'influence de l'environnement extérieur, alors pendant la période postnatale, les stimuli externes jouent un rôle de plus en plus important. L'irritation des récepteurs provoque des flux d'impulsions afférentes qui stimulent la maturation morpho-fonctionnelle du cerveau.
Sous l'influence d'impulsions afférentes, des épines se forment sur les dendrites des neurones corticaux - des excroissances qui sont des membranes postsynaptiques spéciales. Plus il y a d’épines, plus il y a de synapses et plus le neurone est impliqué dans le traitement de l’information.
Tout au long de l'ontogenèse postnatale jusqu'à la puberté, ainsi que pendant la période prénatale, le développement cérébral se produit de manière hétérochrone. Ainsi, la maturation finale de la moelle épinière se produit plus tôt que celle du cerveau. Le développement des structures souches et sous-corticales, plus tôt que les structures corticales, la croissance et le développement des neurones excitateurs dépassent la croissance et le développement des neurones inhibiteurs. Il s’agit de schémas biologiques généraux de croissance et de développement du système nerveux.
La maturation morphologique du système nerveux est en corrélation avec les caractéristiques de son fonctionnement à chaque étape de l'ontogenèse. Ainsi, une différenciation plus précoce des neurones excitateurs par rapport aux neurones inhibiteurs assure la prédominance du tonus des muscles fléchisseurs sur le tonus des extenseurs. Les bras et les jambes du fœtus sont dans une position pliée - cela détermine une position qui fournit un volume minimal, grâce à quoi le fœtus occupe moins de place dans l'utérus.
L'amélioration de la coordination des mouvements associés à la formation des fibres nerveuses se produit tout au long des périodes préscolaires et scolaires, ce qui se manifeste par le développement cohérent des postures assises, debout, de marche, d'écriture, etc.
L'augmentation de la vitesse des mouvements est principalement causée par les processus de myélinisation des fibres nerveuses périphériques et par une augmentation de la vitesse d'excitation de l'influx nerveux.
La maturation plus précoce des structures sous-corticales par rapport aux structures corticales, dont beaucoup font partie de la structure limbique, détermine les caractéristiques développement affectif les enfants (une grande intensité des émotions, l'incapacité à les retenir est associée à l'immaturité du cortex et à sa faible influence inhibitrice).
Lors de la vieillesse et de la sénilité, des changements anatomiques et histologiques se produisent dans le cerveau. Une atrophie du cortex des lobes frontaux et pariétaux supérieurs se produit souvent. Les fissures s'élargissent, les ventricules du cerveau s'agrandissent et le volume de substance blanche diminue. Un épaississement des méninges se produit.
Avec l’âge, la taille des neurones diminue, mais le nombre de noyaux dans les cellules peut augmenter. Dans les neurones, la teneur en ARN nécessaire à la synthèse des protéines et des enzymes diminue également. Cela altère les fonctions trophiques des neurones. Il a été suggéré que ces neurones se fatiguent plus rapidement.
Avec la vieillesse, l'apport sanguin au cerveau est également perturbé, les parois des vaisseaux sanguins s'épaississent et des plaques de cholestérol s'y déposent (athérosclérose). Cela altère également le fonctionnement du système nerveux.
LITTÉRATURE
Atlas « Système Nerveux Humain ». Comp. V. M. Astachev. M., 1997.
Blum F., Leiserson A., Hofstadter L. Cerveau, esprit et comportement. M. : Mir, 1988.
Borzyak E.I., Bocharov V.Ya., Sapina M.R. Anatomie humaine. - M. : Médecine, 1993. T.2. 2e éd., révisée. et supplémentaire
Zagorskaya V.N., Popova N.P. Anatomie du système nerveux. Programme de cours. MOSU, M., 1995.
Kishsh-Sentagotai. Atlas anatomique du corps humain. - Budapest, 1972. 45e édition. T.3.
Kurepina M.M., Vokken G.G. Anatomie humaine. - M. : Éducation, 1997. Atlas. 2e édition.
Krylova N.V., Iskrenko I.A. Cerveau et voies (Anatomie humaine en schémas et dessins). M. : Maison d'édition de l'Université russe de l'amitié des peuples, 1998.
Cerveau. Par. de l'anglais Éd. Simonova P.V. - M. : Mir, 1982.
Morphologie humaine. Éd. B.A. Nikityuk, vice-président. Chtetsova. - M. : Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1990. P. 252-290.
Prives M.G., Lysenkov N.K., Bushkovich V.I. Anatomie humaine. - L. : Médecine, 1968. P. 573-731.
Saveliev S.V. Atlas stéréoscopique du cerveau humain. M., 1996.
Sapin M.R., Bilich G.L. Anatomie humaine. - M. : Ecole Supérieure, 1989.
Sinelnikov R.D. Atlas d'anatomie humaine. - M. : Médecine, 1996. 6e éd. T.4.
Schade J., Ford D. Fondamentaux de la neurologie. - M. : Mir, 1982.
Le tissu est un ensemble de cellules et de substances intercellulaires dont la structure, l’origine et les fonctions sont similaires.
Certains anatomistes n'incluent pas la moelle allongée dans le cerveau postérieur, mais la distinguent comme une section indépendante.
Matière grise et blanche du cerveau. Matière blanche des hémisphères. Matière grise de l'hémisphère. Lobe frontal. Lobe pariétal. Lobe temporal. Lobe occipital. Île.
http://monax.ru/order/ - essais sur commande (plus de 2300 auteurs dans 450 villes de la CEI).
ANATOMIE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
ABSTRAIT
Sujet : "Matière grise et blanche du cerveau"
HÉMISPHÈRES DE MATIÈRE BLANCHE
Tout l'espace entre la matière grise du cortex cérébral et les noyaux gris centraux est occupé par la matière blanche. La substance blanche des hémisphères est formée de fibres nerveuses reliant le cortex d'un gyrus au cortex des autres gyrus de ses hémisphères opposés, ainsi qu'aux formations sous-jacentes. La topographie dans la substance blanche distingue quatre parties, vaguement délimitées les unes des autres :
substance blanche dans les gyri entre les sillons ;
zone de substance blanche dans les parties externes de l'hémisphère - centre semi-ovale ( centre semi-ovale);
couronne rayonnante ( Corona Radiata), formé de fibres rayonnantes entrant dans la capsule interne ( capsule interne) et ceux qui le quittent ;
substance centrale du corps calleux ( corps calleux), capsule interne et fibres associatives longues.
Les fibres nerveuses de la substance blanche sont divisées en associatives, commissurales et de projection.
Les fibres d'association relient différentes parties du cortex d'un même hémisphère. Ils sont divisés en courts et longs. Les fibres courtes relient les circonvolutions voisines sous la forme de faisceaux arqués. De longues fibres d'association relient les zones du cortex les plus éloignées les unes des autres.
Les fibres commissurales, qui font partie des commissures cérébrales, ou commissures, relient non seulement des points symétriques, mais aussi le cortex appartenant à différents lobes des hémisphères opposés.
La plupart des fibres commissurales font partie du corps calleux, qui relie les parties des deux hémisphères appartenant à neencéphale. Deux adhérences cérébrales Commission antérieure Et commissure fornicienne, de taille beaucoup plus petite, appartiennent au cerveau olfactif rhinencéphale et connectez-vous : Commission antérieure- les lobes olfactifs et les deux gyri parahippocampiques, commissure fornicienne- les hippocampes.
Les fibres de projection relient le cortex cérébral aux formations sous-jacentes et, à travers elles, à la périphérie. Ces fibres sont divisées en :
centripète - ascendant, corticopetal, afférent. Ils conduisent l'excitation vers le cortex ;
centrifuge (descendant, corticofuge, efférent).
Les fibres de projection dans la substance blanche de l'hémisphère plus proche du cortex forment la couronne radiée, puis la majeure partie d'entre elles converge vers la capsule interne, qui est une couche de substance blanche entre le noyau lenticulaire ( noyau lentiforme) d'un côté, et le noyau caudé ( noyau caudé) et le thalamus ( thalamus) - avec un autre. Sur une coupe frontale du cerveau, la capsule interne ressemble à une bande blanche oblique qui se prolonge dans le pédoncule cérébral. Dans la capsule interne, on distingue la patte antérieure ( crus antérieur), - entre le noyau caudé et la moitié antérieure de la face interne du noyau lentiforme, le pédoncule postérieur ( cru postère), - entre le thalamus et la moitié postérieure du noyau lentiforme et du genre ( genu), situé au point d'inflexion entre les deux parties de la capsule interne. Les fibres de projection peuvent être divisées selon leur longueur selon les trois systèmes suivants, en commençant par le plus long :
Tractus corticospinal (pyramidale) conduit les impulsions volontaires motrices vers les muscles du tronc et des membres.
Tractus corticonucléaire- les voies d'accès aux noyaux moteurs des nerfs crâniens. Toutes les fibres motrices sont rassemblées dans un petit espace de la capsule interne (le genou et les deux tiers antérieurs de sa jambe postérieure). Et s'ils sont endommagés à cet endroit, on observe une paralysie unilatérale du côté opposé du corps.
Tractus corticopontini- les chemins du cortex cérébral aux noyaux pontins. Grâce à ces voies, le cortex cérébral exerce un effet inhibiteur et régulateur sur l’activité du cervelet.
Fibrae thalamocorticalis et corticothalamici- les fibres du thalamus au cortex et retour du cortex au thalamus.
MATIÈRE GRISE DE L'HÉMISPHÈRE
Surface de l'hémisphère, manteau ( pallium), formé d'une couche uniforme de matière grise de 1,3 à 4,5 mm d'épaisseur, contenant des cellules nerveuses. La surface de la cape présente un motif très complexe, constitué de rainures alternant dans des directions différentes et de crêtes entre elles, appelées circonvolutions. gyri. La taille et la forme des sillons sont soumises à des fluctuations individuelles importantes, de sorte que non seulement les cerveaux de différentes personnes, mais même les hémisphères du même individu ne sont pas tout à fait similaires dans la configuration des sillons.
Des rainures profondes et permanentes sont utilisées pour diviser chaque hémisphère en grandes zones appelées lobes. lobi; ces derniers, à leur tour, sont divisés en lobules et circonvolutions. Il y a cinq lobes de l'hémisphère : frontal ( lobe frontal), pariétal ( lobe pariétal), temporel ( lobe temporal), occipital ( lobe occipital) et un lobule caché au fond du sillon latéral, appelé îlot ( île).
La surface supérolatérale de l'hémisphère est délimitée en lobes par trois sillons : l'extrémité latérale, centrale et supérieure du sillon pariéto-occipital. Sillon latéral ( sulcus cérébral latéral) commence sur la surface basale de l'hémisphère à partir de la fosse latérale puis passe à la surface supérolatérale. Sillon central ( sillon central) commence au bord supérieur de l’hémisphère et va de l’avant vers le bas. La partie de l'hémisphère située en avant du sillon central appartient au lobe frontal. La partie de la surface cérébrale située en arrière du sillon central constitue le lobe pariétal. Le bord postérieur du lobe pariétal correspond à l'extrémité du sillon pariéto-occipital ( sillon pariéto-occipital), situé sur la surface médiale de l’hémisphère.
Chaque lobe est constitué d'un certain nombre de circonvolutions, appelées à certains endroits lobules, qui sont limitées par des sillons à la surface du cerveau.
Lobe frontal
Dans la partie postérieure de la surface externe de ce lobe il y a sulcus précentralis presque parallèle à la direction sillon central. Deux sillons en partent dans le sens longitudinal : sulcus frontalis supérieur et sulcus frontalis inférieur. De ce fait, le lobe frontal est divisé en quatre circonvolutions. gyrus vertical, gyrus précentralis, situé entre les sillons central et précentral. Les gyri horizontaux du lobe frontal sont : frontal supérieur ( gyrus frontal supérieur), frontal moyen ( gyrus frontal moyen) et frontal inférieur ( gyrus frontal inférieur) actions.
Lobe pariétal
Sur celui-ci se trouve approximativement parallèle à la rainure centrale sulcus postcentralis, fusionnant généralement avec sulcus intrapariétal, qui va dans le sens horizontal. Selon l'emplacement de ces sillons, le lobe pariétal est divisé en trois gyri. gyrus vertical, gyrus postcentralis, passe derrière le sillon central dans la même direction que le gyrus précentral. Au-dessus du sillon interpariétal se trouve le gyrus pariétal supérieur, ou lobule ( lobule pariétal supérieur), ci-dessous - lobule pariétal inférieur.
Lobe temporal
La surface latérale de ce lobe présente trois gyrus longitudinaux, délimités les uns des autres sillon temporal supérieur r et sillon temporal inférieur. s'étend entre les sillons temporaux supérieur et inférieur gyrus temporal moyen. En dessous ça passe gyrus temporal inférieur.
Lobe occipital
Les rainures sur la surface latérale de ce lobe sont variables et incohérentes. Parmi ceux-ci, on distingue le transversal sillon occipital transversal, se connectant généralement à l'extrémité du sillon interpariétal.
Île
Ce lobe a la forme d'un triangle. La surface de l'insula est couverte de courtes circonvolutions.
La surface inférieure de l'hémisphère dans la partie antérieure à la fosse latérale appartient au lobe frontal.
Ici, parallèlement au bord médial de l'hémisphère, s'étend sillon olfactif. Sur la partie postérieure de la surface basale de l'hémisphère, deux sillons sont visibles : sillon occipitotemporal, passant dans le sens du pôle occipital vers le pôle temporel et limitant gyrus occipitotemporal latéral, et parallèle à lui sillon collatéral. Entre eux se trouve gyrus occipitotemporal médial. Il y a deux gyri situés médialement par rapport au sillon collatéral : entre la partie postérieure de ce sillon et sulcus calcarinus mensonges gyrus lingual; entre la partie antérieure de ce sillon et la profondeur sillon de l'hippocampe mensonges gyrus parahippocampalis. Ce gyrus, adjacent au tronc cérébral, est déjà situé sur la surface médiale de l'hémisphère.
Sur la surface médiale de l'hémisphère se trouve un sillon du corps calleux ( sillon des corps calleux), s'étendant directement au-dessus du corps calleux et continuant avec son extrémité postérieure dans les profondeurs sillon de l'hippocampe, qui est dirigé vers l’avant et vers le bas. Parallèlement et au-dessus de cette rainure, elle s'étend le long de la surface médiale de l'hémisphère. sulcus cinguli. Lobule paracentral ( lobule paracentralis) est appelée une petite zone au-dessus du sillon ligulaire. En arrière du lobule paracentral se trouve une surface quadrangulaire (appelée précuneus, précuneus). Il appartient au lobe pariétal. Derrière le précuneus se trouve une zone distincte du cortex appartenant au lobe occipital - le coin ( cuneus). Entre le sillon lingulaire et le sillon du corps calleux s'étend le gyrus cingulaire ( gyrus cinguli), qui, à travers l'isthme ( isthme) continue dans le gyrus parahippocampique, se terminant par l'uncus ( uncus). Gyrus cinguli, isthme Et gyrus parahippocampali s forment ensemble le gyrus voûté ( gyrus fornique), qui décrit un cercle presque complet, ouvert uniquement en bas et en avant. Le gyrus voûté n'est lié à aucun des lobes du manteau. Il appartient à la région limbique. La région limbique fait partie du néocortex des hémisphères cérébraux, occupant les gyri cingulaires et parahippocampiques ; partie du système limbique. Repousser les limites sillon de l'hippocampe, vous pouvez voir une étroite bande grise irrégulière, représentant un gyrus rudimentaire gyrus dentaire.
L I T E R A T U R A
Grande encyclopédie médicale. tome 6, M., 1977
2. Grande encyclopédie médicale. tome 11, M., 1979
3. M.G. Prives, N.K. Lysenkov, V.I. Bushkovitch. Anatomie humaine. M., 1985
|
À télécharger le travail vous devez rejoindre notre groupe gratuitement En contact avec. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous. À propos, dans notre groupe, nous aidons gratuitement à la rédaction d'articles pédagogiques. Quelques secondes après avoir vérifié votre abonnement, un lien pour continuer le téléchargement de votre œuvre apparaîtra. |
|
| Promouvoir originalité de ce travail. Contournez l’antiplagiat. | |
|
REF-Maître- un programme unique pour la rédaction indépendante d'essais, de cours, de tests et de mémoires. Avec l'aide de REF-Master, vous pouvez facilement et rapidement créer un essai, un test ou un cours original basé sur le travail fini - Anatomie du système nerveux central. |
|
| Comment écrire correctement introduction?
Les secrets d'une introduction idéale aux cours (ainsi qu'aux essais et diplômes) des auteurs professionnels des plus grandes agences de rédaction de Russie. Découvrez comment formuler correctement la pertinence du sujet de travail, définir les buts et objectifs, indiquer le sujet, l'objet et les méthodes de recherche, ainsi que la base théorique, juridique et pratique de votre travail. |
|
|
Les secrets de la conclusion idéale d'une thèse et d'une dissertation d'auteurs professionnels des plus grandes agences de rédaction de Russie. Découvrez comment formuler correctement des conclusions sur le travail effectué et faire des recommandations pour améliorer la problématique étudiée. |
|
| |
|
(cours, diplôme ou rapport) sans risques, directement auprès de l'auteur.
Ouvrages similaires :
18/03/2008/travail créatif
Anatomie humaine représentée dans des mots croisés. Pour accomplir cette tâche, non seulement les connaissances du cours de physiologie seront utiles, mais aussi les connaissances langue latine. Sous chaque mot donné en russe, écrivez sa traduction - vous obtenez un proverbe latin.
22/02/2007/résumé
Emplacement et forme des poumons. La structure des poumons. Ramification des bronches. Structure macro-microscopique du poumon. Tissu conjonctif interlobulaire. Conduits et sacs alvéolaires. Structure segmentaire des poumons. Segments broncho-pulmonaires.
23/01/2009/résumé
Base du cerveau. Hémisphères du cerveau. Système visuel. Moelle. Les principales zones de l'hémisphère droit du cerveau sont les lobes frontal, pariétal, occipital et temporal. Mésencéphale, diencéphale et télencéphale. Cortex cérébral.
20/05/2010/résumé
Structure anatomique du nez, caractéristiques structurelles de la membrane muqueuse. Anomalies congénitales du nez externe, causes de rhinite aiguë. Types d'écoulement nasal chronique, méthodes de traitement. Corps étrangers dans la cavité nasale Déformation de la cloison nasale, traumatisme.
05/10/2009/rapport
Difficultés diagnostiques des maladies de l'œsophage. Anatomie macroscopique et fonctionnelle, caractéristiques et types de troubles œsophagiens. Description et classification des saignements œsophagiens en fonction de la quantité de sang ou de liquide nécessaire pour reconstituer le volume.
15/03/2009/résumé
Maladies oblitérantes chroniques des artères des membres inférieurs sous forme de troubles congénitaux ou acquis de la perméabilité artérielle sous forme de sténose ou d'occlusion. Ischémie chronique des tissus des membres inférieurs de gravité variable et modifications des cellules.
La partie principale du système nerveux des vertébrés et des humains est le système nerveux central. Il est représenté par le cerveau et la moelle épinière et se compose de nombreux groupes de neurones et de leurs processus. Le système nerveux central remplit de nombreuses fonctions importantes, dont la principale est la mise en œuvre de divers réflexes.
Qu'est-ce que le SNC ?
Au fur et à mesure de notre évolution, la régulation et la coordination de tous les processus vitaux du corps ont commencé à se produire à un tout nouveau niveau. Des mécanismes améliorés ont commencé à fournir une réponse très rapide à tout changement dans l'environnement externe. De plus, ils ont commencé à se souvenir des effets sur le corps survenus dans le passé et, si nécessaire, à récupérer ces informations. Des mécanismes similaires ont formé le système nerveux apparu chez les humains et les vertébrés. Il est divisé en central et périphérique.
Alors, qu’est-ce que le SNC ? Il s'agit du département principal qui non seulement unit, mais coordonne également le travail de tous les organes et systèmes, assure également une interaction continue avec l'environnement extérieur et maintient une activité mentale normale.

Unité structurelle
Un chemin similaire comprend :
- Récepteur sensoriel;
- neurones afférents, associatifs et efférents;
- effecteur
Toutes les réactions sont divisées en 2 types :
- inconditionnel (inné);
- conditionnel (acquis).
Les centres nerveux d'un grand nombre de réflexes sont situés dans le système nerveux central, mais les réactions sont généralement fermées en dehors de ses limites.

Activités de coordination
Il s'agit de la fonction la plus importante du système nerveux central, impliquant la régulation des processus d'inhibition et d'excitation dans les structures des neurones, ainsi que la mise en œuvre de réponses.
La coordination est nécessaire pour que le corps puisse effectuer des mouvements complexes faisant appel à de nombreux muscles. Exemples : effectuer des exercices de gymnastique ; discours accompagné d'articulation; le processus d’ingestion de nourriture.
Pathologies
Il convient de noter que le système nerveux central est un système dont le dysfonctionnement affecte négativement le fonctionnement de tout l'organisme. Toute panne présente un risque pour la santé. Par conséquent, dès l’apparition des premiers symptômes alarmants, vous devriez consulter un médecin.
Les principaux types de maladies du système nerveux central sont :
- vasculaire;
- chronique;
- héréditaire;
- infectieux;
- reçu à la suite de blessures.
Actuellement, environ 30 pathologies de ce système sont connues. Les maladies du système nerveux central les plus courantes comprennent :
- insomnie;
- La maladie d'Alzheimer;
- paralysie cérébrale;
- La maladie de Parkinson;
- migraine;
- lumbago;
- méningite;
- myasthénie grave;
- AVC ischémique;
- névralgie;
- sclérose en plaques;
- encéphalite.
Les pathologies du système nerveux central résultent de lésions dans l'un de ses départements. Chacune des maladies présente des symptômes uniques et nécessite une approche individuelle pour choisir une méthode de traitement.

Enfin
La tâche du système nerveux central est d'assurer le fonctionnement coordonné de chaque cellule du corps, ainsi que son interaction avec le monde extérieur. une brève description de SNC : il est représenté par le cerveau et la moelle épinière, son unité structurelle est le neurone et le principe principal de son activité est le réflexe. Toute perturbation du fonctionnement du système nerveux central entraîne inévitablement des perturbations dans le fonctionnement de l'ensemble du corps.