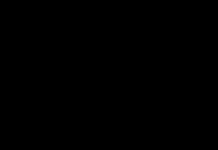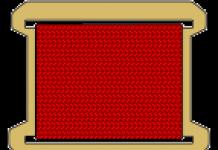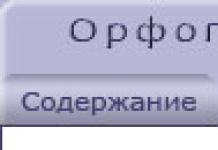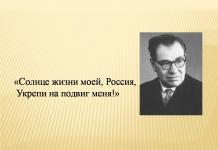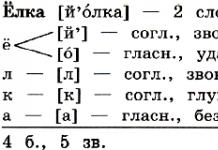Dans les moments difficiles auxquels notre patrie a été confrontée à plusieurs reprises, non seulement les troupes régulières, mais aussi les citoyens ordinaires sont venus à sa défense. Ils n'avaient rien à voir avec l'armée, mais ne pouvaient pas vivre en paix lorsque des troubles menaçaient leur foyer. Des détachements partisans ont été créés. Au début, ils sont apparus spontanément, mais après un certain temps, ils se sont unis et sont devenus de grandes formations nationales.
Léon Tolstoï a décrit dans son roman une telle guérilla pour défendre son pays natal contre les troupes françaises. Il a montré comment les Russes ordinaires, dès les premiers jours où les ennemis sont arrivés dans leur pays natal, se sont rebellés contre cela, ont d'abord créé de petits détachements de trois à dix personnes, puis se sont unis en Grands groupes, ce que l'empereur, le commandant Koutouzov et d'autres généraux furent contraints de reconnaître.
Sous la direction de Davydov et Dolokhov, il s'agissait d'unités mobiles qui, derrière les lignes ennemies, attaquaient des convois et de petits détachements militaires, obtenant souvent des informations importantes, c'est-à-dire qu'elles aidaient du mieux qu'elles pouvaient. armée régulière. Ils étaient absolument personnes différentes. DANS vie ordinaire beaucoup ne se seraient jamais rencontrés, mais dans temps difficiles ils sont tous devenus des héros qui n'ont pas épargné leur vie pour la victoire. Ainsi, par exemple, Tikhon Shcherbaty, un homme simple, rusé et inventif par nature, se fraye un chemin seul à l'arrière des Français pour obtenir une « langue ».
Il y avait des gens complètement différents dans les détachements partisans : riches, pauvres, célèbres et complètement inconnus. Par raisons diverses ils se sont unis - certains sont venus, comme Petya Rostov, pour une romance, mais la plupart ont simplement compris que s'ils ne défendaient pas leur maison, des problèmes viendraient certainement. Ils se sont battus, se sont défendus et sont morts pour une juste cause. Pour que leurs noms et prototypes restent dans notre mémoire et atteignent le futur, l'auteur a créé sa grande œuvre.
Option 2
L'ouvrage décrit des événements Guerre patriotique 1812, dans lequel l'écrivain analyse les causes et les facteurs de la victoire du peuple russe du point de vue non seulement des actions des forces armées, mais également de la participation des gens ordinaires à la guerre.
L'auteur illustre de manière frappante la cruauté et l'horreur de la guerre, mais affirme en même temps que le résultat des batailles militaires dépend toujours du facteur humain, et pas seulement de armée régulière, mais aussi d'une guerre menée par des peuples disparates réunis en petits détachements partisans.
Les actions des guérilleros contrastent fortement avec les tactiques militaires de l'armée, qui combat les envahisseurs derrière les lignes ennemies. Les méthodes de guérilla se caractérisent par la spontanéité et l’absence de règles uniformes et de lois militaires. Le seul motif qui unit à la fois les militaires et les partisans est le désir ardent de vaincre l'ennemi détesté, de libérer leur terre natale et de vivre en paix.
L'écrivain décrit les relations des personnes tombées dans le mouvement partisan en utilisant l'exemple des images de Davydov, Dolokhov, Denisov, Tikhon Shcherbaty, qui sont opposés tant par leur position que par leurs opinions, mais unis pour défendre la patrie, comprendre qu’ils se battent et meurent pour le rétablissement de la justice, pour le bien de votre famille et de vos amis.
Les personnages utilisent différentes techniques pour combattre les envahisseurs français, capturer des convois militaires, exterminer de petits détachements ennemis, capturer des officiers afin d'obtenir les informations nécessaires, mais dans la vie ce sont des personnes complètement différentes. Shcherbaty, parti en mission pour récupérer un Français capturé, ayant capturé un officier et se rendant compte qu'il ne dispose pas des informations nécessaires, le détruit facilement. Denisov, étant le chef de l'une des formations partisanes, interdit le meurtre sans pitié des envahisseurs capturés. De plus, les deux héros partisan Ils se rendent compte que dans un cas similaire, personne ne les épargnera ni ne les regrettera.
Les raisons pour lesquelles les personnages sont partisans sont variées ; il y a même des personnages romantiques (le personnage de Peter Rostov), qui présentent la guerre comme un terrain de jeu. Mais tous les participants au mouvement partisan décident de leur plein gré de défendre ainsi leurs proches et leur patrie, alors que chacun d'eux éprouve un sentiment naturel de peur et de douleur pour ses camarades, pour sa propre vie, pour le sort des pays.
Racontant non seulement les célèbres batailles de la guerre patriotique remportées par l'armée russe, l'écrivain se concentre sur le facteur clé de la victoire finale sur les Français. Selon l'auteur, le patriotisme des membres des détachements partisans est une aide inestimable pour les troupes actives, devient un moment décisif dans le tournant des événements militaires et contribue à l'expulsion des conquérants français du territoire de l'État russe.
Essai Guérilla dans le roman Guerre et Paix de Tolstoï
En quittant Moscou, les Français avancèrent plus loin sur la route de Smolensk, mais les échecs les suivirent partout. L'armée française disparut lentement, la faim n'épargna personne et des détachements de partisans commencèrent à attaquer, qui purent être vaincus par de petits détachements de l'armée.
Lev Nikolaevich Tolstoï décrit dans son roman les événements survenus en deux jours incomplets. Il s'agit d'une description de la mort de Peter Rostov, elle est décrite brièvement, mais elle contient tellement de choses incompréhensibles et de nombreuses questions se posent. Tolstoï se demande pourquoi les gens s'entretuent et pour quoi. La mort de Petka Rostov survient sous les yeux de Dolokhov et Denisov, une mort injuste et cruelle.
Tolstoï dit généralement que la guerre est quelque chose de dégoûtant et de terrible, qu'il y a de l'injustice et des meurtres partout. Lev Nikolaïevitch, décrivant la guerre partisane, a écrit qu'elle réunissait des gens qui aimaient beaucoup leur pays et ne voulaient pas être sous le joug d'étrangers. Diverses personnes étaient des partisans groupes sociaux et des couches de la population, mais ils avaient un objectif commun : ils voulaient chasser les ennemis de leur territoire.
Le peuple russe a immédiatement réagi à l’invasion de l’ennemi et a commencé à s’unir, organisant des détachements de partisans afin de vaincre ensemble l’ennemi. L'armée française n'avait aucune chance contre un peuple qui aimait son pays. Le peuple russe traite particulièrement sa terre comme s’il était sa propre mère qui la nourrissait. Peut-être, bien sûr, les Français auraient pu gagner, mais tout a joué contre eux : la maladie, la faim et le froid, puis les partisans ont commencé à attaquer.
Lev Nikolaïevitch Tolstoï voulait écrire que quoi que fasse le peuple, s'il a besoin de venir en aide à la patrie et de défendre ses droits, il est prêt à se tenir côte à côte et, quoi qu'il arrive, à se tenir debout jusqu'à la mort.
Tolstoï décrit l'image de la guerre de telle manière que l'escrime entre deux personnes a duré très longtemps. L’un d’eux comprend qu’il ne peut pas gagner et que cela pourrait se terminer par la mort pour lui. L'homme décide alors de jeter l'épée et de ramasser le gourdin, vainquant ainsi l'ennemi. C'est pourquoi les Français n'avaient aucune chance de gagner, car le tireur était français et le deuxième, qui prenait le relais, était un Russe avec une âme immense et ouverte.
Aucun des historiens n'a pu décrire la guerre sans ambiguïté, mais Lev Nikolaevich a décidé de le faire du point de vue personne ordinaire. Dans son roman, il montre que le peuple russe sera capable de se défendre et de défendre sa patrie.
Le ciel étoilé a toujours été rempli de nombreux mystères et phénomènes inexpliqués et a attiré le regard. Depuis l'Antiquité et même aujourd'hui ciel étoilé porte en lui quelque chose de mystérieux et d'inexplicable.
Un livre est un réservoir de toutes les connaissances collectées par l'humanité, ses expériences et ses émotions. De nos jours, il est très difficile de trouver le bon livre parmi l’abondance de la littérature moderne.
Guy Montag. Il travaille dans les pompiers, mec âge mûr. Sa réalité se limite au travail et aux loisirs, pas de projets ni de châteaux en l'air
Définition de la guérilla dans le roman "Guerre et Paix"
Selon la science militaire, pendant la guerre, « le droit est toujours du côté » grandes armées" Parlant de la guerre partisane dans le roman Guerre et Paix, Tolstoï réfute cette affirmation et écrit : « La guérilla (toujours réussie, comme le montre l'histoire) est exactement le contraire de cette règle. »
Les Français de 1812, croyant avoir conquis la Russie, se trompèrent lourdement. Ils ne s’attendaient pas à ce que la guerre soit non seulement le respect des règles de la science militaire, mais aussi cette force invisible qui se cache dans l’âme du peuple russe. C'est cette force qui dirigeait à la fois les paysans ordinaires et les militaires, les réunissant en petits détachements qui apportèrent une aide précieuse à l'armée russe dans la victoire sur les Français.
Napoléon, qui s'est comporté de manière si pathétique et pompeuse à Vilna, était convaincu que son armée conquérirait la Russie facilement et magnifiquement, et ne s'attendait pas à rencontrer la résistance non seulement de l'armée, mais aussi du peuple. Il croyait que sa grande armée traverserait victorieusement le territoire russe et ajouterait une nouvelle page au livre de sa gloire.
Mais Napoléon ne s'attendait pas à ce que cette guerre devienne une guerre populaire et que son armée soit pratiquement détruite par de petits détachements de personnes, parfois éloignées de la science militaire - des partisans.
Les partisans ont souvent agi contrairement à la logique de la guerre, sur un coup de tête, en observant leurs propres règles de guerre. « L’une des déviations les plus tangibles et les plus bénéfiques des soi-disant règles de la guerre est l’action de personnes dispersées contre des personnes regroupées. Ce genre d’action se manifeste toujours par une guerre qui revêt un caractère populaire. Ces actions consistent dans le fait qu'au lieu de devenir une foule contre une foule, les gens se dispersent séparément, attaquent un par un et s'enfuient immédiatement lorsqu'ils sont attaqués en grandes forces, puis attaquent à nouveau lorsque l'occasion se présente », écrit Tolstoï à propos de eux.
Car lorsqu’il s’agit de défendre sa Patrie, tous les moyens sont bons, et, comprenant cela, des personnes totalement inconnues sont unies dans un même élan par cet objectif.
Partisans, description et personnages
Dans le roman "Guerre et Paix" guérilla au début, elle est décrite comme des actions spontanées et inconscientes d’hommes et de paysans individuels. Tolstoï compare la destruction des Français à l'extermination des chiens enragés : « des milliers de personnes de l'armée ennemie - maraudeurs arriérés, butineurs - ont été exterminées par les cosaques et les paysans, qui ont battu ces gens aussi inconsciemment que les chiens tuent inconsciemment un chien enragé en fuite. .»
L’État ne pouvait manquer de reconnaître la force et l’efficacité des détachements individuels disparates de partisans qui « détruisirent Grande armée fragmentaire » et a donc reconnu de manière assez officielle le mouvement partisan. De nombreux « partis » sur toute la ligne de front l’ont déjà rejoint.
Les partisans sont des gens d'un caractère particulier, des aventuriers par nature, mais en même temps ce sont de vrais patriotes, sans discours pompeux ni beaux discours. Leur patriotisme est un mouvement naturel de l'âme, qui ne leur permet pas de rester à l'écart des événements qui se déroulent en Russie.
Les représentants éminents de l'armée dans le mouvement partisan du roman sont Denisov et Dolokhov. Avec leurs troupes, ils sont prêts à attaquer les transports français, ne voulant s'unir ni aux généraux allemands ni aux généraux polonais. Sans penser aux épreuves et aux difficultés de la vie dans le camp, comme par jeu, ils capturent les prisonniers français et libèrent les prisonniers russes.
Dans le roman Guerre et Paix, le mouvement partisan rassemble des gens qui, dans la vie ordinaire, ne se rencontreraient peut-être même pas. De toute façon, ils ne communiqueraient pas et ne deviendraient pas amis. Comme par exemple Denissov et Tikhon Shcherbaty, si gentiment décrits par Tolstoï. La guerre révèle le vrai visage de chacun et l’oblige à agir et à agir selon la signification de ce moment historique. Tikhon Shcherbaty, un homme adroit et rusé, se frayant un chemin à lui seul dans le camp ennemi afin de capturer la langue - l'incarnation des gens du peuple, prêt à servir pour détruire les ennemis par « loyauté envers le tsar et le Patrie et haine des Français, que les fils de la Patrie doivent garder », comme disait Denissov.
Les relations entre les gens pendant les hostilités sont intéressantes. D'une part, Tikhon, ayant pris le "plastun" et décidant qu'il ne convenait pas à Denisov, car il ne sait vraiment rien, le tue facilement. D'un autre côté, il dit aussi : « On ne fait rien de mal aux Français... On a juste fait comme ça, ce qui veut dire qu'on s'amuse avec les gars par plaisir. Nous avons définitivement battu environ deux douzaines de Miroders, sinon nous n’avons rien fait de mal… »
Denisov, faisant prisonniers des soldats français, les renvoie contre récépissé, regrettant de les avoir abattus sur place. Dolokhov se moque même de son scrupule. Dans le même temps, Denisov et Dolokhov comprennent parfaitement que s'ils sont capturés par les Français, il n'y aura aucune pitié pour aucun des deux. Et le fait que Denisov ait traité noblement les prisonniers n'aura aucune importance. "Mais ils nous attraperont, moi et toi, avec votre titre de chevalier, de toute façon", lui dit Dolokhov.
Certains viennent chez les partisans pour la romance, depuis que Petya Rostov est arrivé à la guerre, imaginant tout ce qui se passe sous la forme d'un jeu. Mais le plus souvent, les personnes participant au mouvement partisan font un choix conscient, comprenant que dans des périodes historiques aussi difficiles et dangereuses, chacun doit tout mettre en œuvre pour vaincre l'ennemi.
Le peuple russe, alliant chaleur spirituelle, humilité envers les proches, simplicité et modestie, est à la fois plein d'un esprit rebelle, audacieux, insoumis et spontané, qui ne permet pas d'observer sereinement comment pays natal Les conquérants marchent.
conclusions
Dans le roman « Guerre et Paix », Tolstoï, parlant des événements, les présente non pas comme un historien, mais comme un participant à ces événements, de l'intérieur. Montrant toute la banalité des phénomènes essentiellement héroïques, l'auteur nous parle non seulement de la guerre de 1812, mais aussi des personnes qui ont conduit la Russie à la victoire dans cette guerre. Il raconte au lecteur des gens ordinaires, avec leurs chagrins, leurs joies et leurs inquiétudes habituelles concernant leur apparence. Le fait que, malgré la guerre, les gens tombent amoureux et souffrent de trahisons, vivent et profitent de la vie.
Certaines personnes utilisent la guerre à leurs propres fins pour progresser dans leur carrière, comme Boris Drubetskoy, d'autres suivent simplement les ordres de leurs supérieurs, essayant de ne pas penser aux conséquences de l'exécution de ces ordres, comme Nikolaï Rostov commence à le faire au fil du temps.
Mais il y a des gens spéciaux, ceux qui partent en guerre au gré de leur âme, par patriotisme : ce sont des partisans, des héros de guerre presque invisibles, mais en même temps irremplaçables. Je veux terminer mon essai sur le thème « La guérilla dans le roman « Guerre et Paix » par une citation du roman : « Les Français, en retraite en 1812, alors qu'ils auraient dû se défendre séparément, selon la tactique, se sont regroupés parce que le moral de l’armée était tombé si bas que seule la masse maintient une armée unie. Les Russes, au contraire, selon la tactique, auraient dû attaquer en masse, mais en réalité ils sont fragmentés, car l'esprit est si élevé que les individus frappent sans les ordres des Français et n'ont pas besoin de coercition pour s'exposer à travail et danger.
Essai de travail
Après que les Français ont quitté Moscou et se sont déplacés vers l'ouest le long de la route de Smolensk, l'effondrement de l'armée française a commencé. L'armée fondait sous nos yeux : la faim et la maladie la poursuivaient. Mais pire que la faim et la maladie, les détachements de partisans ont réussi à attaquer des convois, voire des détachements entiers, détruisant ainsi l'armée française.
Dans le roman « Guerre et Paix », Tolstoï décrit les événements de deux jours incomplets, mais combien de réalisme et de tragédie il y a dans ce récit ! Il montre la mort, inattendue, stupide, accidentelle, cruelle et injuste : la mort de Petya Rostov, qui survient sous les yeux de Denisov et Dolokhov. Cette mort est décrite simplement et brièvement. Cela ajoute au réalisme dur de l’écriture. Voilà, la guerre. Ainsi, Tolstoï rappelle une fois de plus que la guerre est « un événement contraire à la raison humaine et à toute la nature humaine », la guerre est le moment où les gens tuent. C’est terrible, contre nature, inacceptable pour l’homme. Pour quoi? Pourquoi une personne ordinaire tuerait-elle un garçon, même issu d’un autre pays, qui s’est fait remarquer en raison de son inexpérience et de son courage ? Pourquoi une personne en tuerait-elle une autre ? Pourquoi Dolokhov prononce-t-il si calmement la sentence contre une douzaine de personnes capturées : « Nous ne les prendrons pas ! Tolstoï pose ces questions à ses lecteurs.
Le phénomène de la guérilla confirme pleinement notion historique Tolstoï. La guérilla est la guerre d’un peuple qui ne peut et ne veut pas vivre sous les envahisseurs. La guérilla est devenue possible grâce à l'éveil chez diverses personnes, quel que soit leur statut social, du principe de « l'essaim », dont Tolstoï était sûr de l'existence chez chaque personne, chez chaque représentant de la nation. Il y avait différents partisans : « il y avait des partis qui adoptaient toutes les techniques de l'armée, avec l'infanterie, l'artillerie, l'état-major, avec les commodités de la vie ; il n'y avait que des cosaques et de la cavalerie ; il y en avait des petits, des attelages, à pied et à cheval, il y avait des paysans et des propriétaires terriens... il y avait un sacristain... qui fit plusieurs centaines de prisonniers. Il y avait l'aînée Vasilisa, qui a tué des centaines de Français. Les partisans étaient différents, mais tous, animés par des objectifs et des intérêts différents, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour expulser l'ennemi de leur pays. Tolstoï croyait que leurs actions étaient causées par un patriotisme inné et instinctif. Les gens qui vaquaient calmement à leurs affaires quotidiennes en temps de paix s'arment, tuent et chassent leurs ennemis pendant la guerre. Ainsi, les abeilles, volant librement à travers un vaste territoire à la recherche de nectar, regagnent rapidement leur ruche natale lorsqu’elles apprennent l’invasion ennemie.
L'armée française était impuissante contre les détachements de partisans, tout comme un ours grimpé dans une ruche est impuissant contre les abeilles. Les Français pouvaient vaincre l’armée russe au combat, mais ils ne pouvaient rien faire contre la faim, le froid, la maladie et les partisans. "Les clôtures ont duré un certain temps. pendant longtemps; soudain un des adversaires, se rendant compte que ce n'était pas une plaisanterie, mais qu'il s'agissait de sa vie, jeta son épée, et, prenant... une massue, se mit à la faire bouger... L'escrimeur était français, son adversaire... étaient des Russes..."
L'armée de Napoléon a été détruite grâce à la guérilla - le "club guerre populaire" Et il est impossible de décrire cette guerre du point de vue des « règles de l'escrime » : toutes les tentatives des historiens qui ont écrit sur cet événement ont échoué. Tolstoï reconnaît la guérilla comme le moyen le plus naturel et le plus juste de lutter contre les envahisseurs.
Spécialité : « Economie, comptabilité, contrôle ».
Résumé de la littérature sur le sujet :
Mouvement de guérilla dans le travail
L. N. Tolstoï « Guerre et Paix »
Complété par l'élève du groupe 618
GOU Z.A.M.T.a
Alexandrovski Ivan
Le plan selon lequel le résumé a été rédigé :
1. Introduction : le mouvement partisan fait partie du mouvement populaire de libération dirigé contre les Français.
2. Événements historiques survenus en Russie en 1812.
3. Événements du roman épique « Guerre et Paix » (volume 4, partie 3)
4. Le rôle et l'importance du mouvement partisan dans la victoire sur les Français.
Introduction:
Le mouvement partisan dans la guerre patriotique de 1812 est l’une des principales expressions de la volonté et du désir de victoire du peuple russe contre les troupes françaises. Le mouvement partisan reflète le caractère populaire de la Guerre Patriotique.
Le début du mouvement partisan.
Le mouvement partisan débute après l'entrée des troupes napoléoniennes en
Smolensk Avant que la guérilla ne soit officiellement acceptée par notre gouvernement, des milliers de membres de l'armée ennemie - maraudeurs arriérés, butineurs - ont été exterminés par les cosaques et les « partisans ». Au début, le mouvement partisan était spontané, représentant l'action de petits détachements partisans dispersés, puis il s'emparait de zones entières. De grands détachements ont commencé à être créés, des milliers de héros nationaux sont apparus et de talentueux organisateurs de guérilla ont émergé. De nombreux participants aux événements témoignent du début du mouvement populaire : le décembriste I.D.
Yakushin, A. Chicherin et bien d'autres. Ils ont affirmé à plusieurs reprises que les habitants, non sur ordre de leurs supérieurs, à l'approche des Français, se sont retirés dans les forêts et les marécages, laissant leurs maisons incendiées, et de là, ils ont mené une guérilla contre les envahisseurs. La guerre a été menée non seulement par les paysans, mais par toutes les couches de la population. Mais une partie de la noblesse resta sur place afin de préserver ses domaines. Nettement inférieures en nombre aux Français, les troupes russes furent contraintes de battre en retraite, retenant l'ennemi par des combats d'arrière-garde. Après une résistance acharnée, la ville de Smolensk fut capitulée. La retraite provoqua le mécontentement dans le pays et dans l'armée. Suivant les conseils de son entourage, le tsar nomme M.I. Kutuzov commandant en chef de l'armée russe. Kutuzov a ordonné de poursuivre la retraite, en essayant d'éviter, dans des conditions défavorables, une bataille générale, que Napoléon Ier cherchait avec persistance. Aux abords de Moscou, près du village de Borodino, Kutuzov a livré aux Français une bataille générale, dans laquelle l'armée française, avoir souffert grosses pertes, n'a pas remporté la victoire. Dans le même temps, l’armée russe conserve sa capacité de combat, ce qui prépare les conditions d’un tournant dans la guerre et de la défaite définitive des armées françaises. Pour préserver et reconstituer l'armée russe, Koutouzov quitta Moscou, retira ses troupes par une habile marche de flanc et prit position à Taroutine, fermant ainsi la route de Napoléon vers les régions du sud de la Russie, riches en nourriture. Parallèlement, il organise les actions des détachements partisans de l'armée. Une guérilla populaire généralisée s’est également déroulée contre les troupes françaises. L'armée russe lance une contre-offensive.
Les Français, contraints de battre en retraite, subissent d'énormes pertes et subissent défaite après défaite. Plus les troupes napoléoniennes pénétraient profondément, plus la résistance partisane du peuple devenait évidente.
Événements dans le roman.
Le roman "Guerre et Paix" de L. N. Tolstoï décrit de manière complète et brève les actions des détachements partisans. « La période de la campagne de la 12e année, depuis la bataille de Borodino jusqu'à l'expulsion des Français, a prouvé qu'une bataille gagnée non seulement n'est pas une raison de conquête, mais n'est même pas un signe permanent de conquête ; a prouvé que le pouvoir qui décide du sort des peuples ne réside pas dans les conquérants, ni même dans les armées et les batailles, mais dans autre chose. Depuis l'abandon de Smolensk, la guerre des partisans commence ; tout le déroulement de la campagne ne correspond à aucun
"anciennes légendes de guerres". Napoléon le sentit, et « à partir du moment où il s'arrêta à Moscou dans la bonne position d'escrime et qu'au lieu de l'épée de l'ennemi il vit une massue levée au-dessus de lui, il ne cessa de se plaindre.
Kutuzov et l'empereur Alexandre, que la guerre a été menée contrairement à toutes les règles (comme s'il existait des règles pour tuer des gens).
Le 24 août, le premier détachement partisan de Davydov fut créé, et après son détachement, d'autres commencèrent à être constitués. Denisov dirige également l'un des détachements partisans. Dolokhov fait partie de son équipe. Partisans
Denisov traque un transport français avec un gros chargement d'équipement de cavalerie et des prisonniers russes et choisit le moment le plus opportun pour une attaque.
Pour mieux se préparer, Denisov envoie un de ses partisans,
Tikhon Shcherbaty, « derrière la langue ». Le temps est pluvieux, l'automne. Pendant que Denisov attend son retour, un nourrisseur arrive au détachement avec un colis du général. Denisov est surpris de reconnaître Petya Rostov parmi les officiers. Petya essaie de se comporter « comme un adulte », tout en se préparant à la façon dont il se comportera avec Denisov, sans faire allusion à une connaissance antérieure. Mais à la vue de la joie que manifeste Denisov, Petya oublie la formalité et demande à Denisov de le laisser dans le détachement pour la journée, bien qu'il rougit en même temps (la raison en était que le général, qui avait peur pour son vie, envoyant Petya avec un colis, lui ordonnant strictement de revenir immédiatement et de ne s'impliquer dans aucune « affaire »), reste Petya. A cette époque, Tikhon Shcherbaty revient
- les partisans envoyés en reconnaissance le voient fuir les Français qui lui tirent dessus de toutes leurs pièces. Il s'avère que Tikhon a capturé le prisonnier hier, mais Tikhon ne l'a pas amené vivant au camp. Tikhon essaie d'obtenir une autre « langue », mais il est découvert. Tikhon Shcherbaty était l'un des plus les bonnes personnes. Ils ont récupéré Shcherbaty dans un petit village. Le chef de ce village a rencontré Denisov de manière hostile au début, mais quand il dit que son objectif est de battre les Français et demande si les Français s'étaient promenés dans leur région, le chef répond qu'« il y avait des artisans de paix », mais que dans leur village seulement Tishka Shcherbaty s'occupait de ces choses-là. Par ordre de Denisov
Shcherbaty est amené, il explique qu'"on ne fait rien de mal aux Français... on a juste fait comme ça, ce qui veut dire qu'on s'est amusé avec les gars par plaisir." Nous avons définitivement battu une douzaine de Miroders, sinon nous n’avons rien fait de mal. Au début, Tikhon effectue tous les travaux subalternes du détachement : allumer du feu, livrer de l'eau, etc., mais il montre ensuite « un très grand désir et une très grande capacité pour la guérilla ». « Il sortait la nuit pour chasser des proies et à chaque fois il emmenait avec lui des vêtements et des armes françaises, et quand on lui en donnait l'ordre, il amenait aussi des prisonniers. » Denisov libère Tikhon du travail, commence à l'emmener avec lui en voyage, puis l'enrôle chez les Cosaques. Un jour, alors qu'il tentait de lui prendre la langue, Tikhon est blessé « dans la chair du dos », tuant un homme. Petya a réalisé un instant que Tikhon avait tué un homme, il s'est senti embarrassé. Dolokhov arrivera bientôt. Dolokhov invite les « messieurs officiers » à l'accompagner jusqu'au camp français. Il a avec lui deux uniformes français. Selon Dolokhov, il souhaite être mieux préparé à l’offensive, car « il aime faire les choses avec soin ».
Petya se porte immédiatement volontaire pour accompagner Dolokhov et, malgré toutes les persuasions,
Denisov et d’autres officiers tiennent bon. Dolokhov voit Vincent et exprime sa perplexité quant à la raison pour laquelle Denisov fait des prisonniers : après tout, ils ont besoin d'être nourris. Denisov répond qu'il envoie les prisonniers au quartier général de l'armée.
Dolokhov objecte raisonnablement : « Vous en envoyez une centaine, et trente viendront.
Ils mourront de faim ou seront battus. Alors, est-ce la même chose de ne pas les prendre ? Denissov est d'accord, mais ajoute : "Je ne veux pas m'en prendre à mon âme... Vous dites qu'ils vont mourir... Tant que cela ne vient pas de moi." Vêtus d'uniformes français,
Dolokhov et Petya se rendent au camp ennemi. Ils se dirigent vers l'un des feux et parlent aux soldats en français. Dolokhov se comporte avec audace et intrépidité, commence à interroger directement les soldats sur leur nombre, l'emplacement du fossé, etc. Petya attend avec horreur chaque minute une découverte, mais elle n'arrive jamais. Tous deux rentrent indemnes dans leur camp. Petya réagit avec enthousiasme à « l'exploit » de Dolokhov et l'embrasse même. Rostov se rend chez l'un des Cosaques et lui demande d'aiguiser son sabre, car il en aura besoin le lendemain en affaires. Le lendemain matin, il demande à Denisov de lui confier quelque chose. En réponse, il ordonne à Petya de lui obéir et de n'intervenir nulle part. Le signal d’attaque se fait entendre, et au même moment Petya, oubliant l’ordre de Denissov, fait démarrer son cheval à toute vitesse. Au grand galop, il s'envole vers le village où lui et Dolokhov s'étaient rendus la veille.
"la nuit. Petya veut vraiment se distinguer, mais il n'y parvient tout simplement pas. Derrière l'une des clôtures, les Français d'une embuscade tirent sur les Cosaques qui se pressent à la porte. Petya voit Dolokhov. Il lui crie qu'il doit attendre l'infanterie.
Au lieu de cela, Petya crie : « Hourra ! et se précipite en avant. Les Cosaques et Dolokhov courent après lui vers les portes de la maison. Les Français courent, mais le cheval de Petit ralentit et il tombe au sol. Une balle lui transperce la tête et, quelques instants plus tard, il meurt. Denisov est horrifié, il se souvient comment Petya a partagé les raisins secs envoyés de chez lui avec les hussards et pleure. Parmi les prisonniers libérés par le détachement de Denisov figure Pierre Bezukhov. Pierre a passé beaucoup de temps en captivité. Sur les 330 personnes qui ont quitté Moscou, moins de 100 sont restées en vie. Les jambes de Pierre étaient cassées et couvertes de plaies, et les blessés étaient de temps en temps abattus. Karataev tombe malade et s'affaiblit chaque jour. Mais sa situation devenait plus difficile, plus la nuit était terrible et plus, quelle que soit la position dans laquelle il se trouvait, des pensées, des souvenirs et des idées joyeux et apaisants lui venaient. À l'une des aires de repos
Karataev raconte l'histoire d'un commerçant emprisonné pour meurtre. Le commerçant n'a pas commis de meurtre, mais a souffert innocemment. Il a humblement enduré toutes les épreuves qui lui sont arrivées, et une fois il a rencontré un condamné et lui a raconté son sort. Le forçat, ayant entendu les détails de l'affaire par le vieillard, avoue que c'est lui qui a tué l'homme pour lequel le marchand a été envoyé en prison ; tombe à ses pieds et demande pardon.
Le vieil homme répond : « Nous sommes tous pécheurs pour Dieu, je souffre pour mes péchés ». Cependant, le criminel est annoncé à ses supérieurs et avoue avoir « ruiné six âmes ». Pendant que l'affaire est examinée, le temps passe et lorsque le roi publie un décret pour libérer le marchand et le récompenser, il s'avère qu'il est déjà mort - "Dieu lui a pardonné".
Karataev ne peut plus aller plus loin. Le lendemain matin, le détachement de Denisov bat les Français et libère les prisonniers. Les Cosaques « entourèrent les prisonniers et leur offrirent à la hâte des vêtements, des bottes, du pain ». « Pierre sanglotait, assis parmi eux et ne pouvait prononcer un mot ; il a serré dans ses bras le premier soldat qui s'est approché de lui et, en pleurant, il l'a embrassé. Dolokhov, quant à lui, compte les Français capturés, son regard "brille avec un éclat cruel". Une tombe est creusée dans le jardin pour Petya Rostov et il est enterré. Le 28 octobre, les gelées commencent et la fuite des Français de Russie prend un caractère encore plus tragique. Les commandants abandonnent leurs soldats et tentent de leur sauver la vie. Bien que les troupes russes aient encerclé l'armée française en fuite, elles ne l'ont pas détruite et n'ont pas capturé Napoléon, ses généraux et autres. Ce n’était pas le but de la guerre de 1812. L’objectif n’était pas de capturer les chefs militaires et de détruire l’armée, dont la plupart étaient déjà morts de froid et de faim, mais de chasser l’invasion du sol russe.
Le rôle et l'importance de la guérilla.
Ainsi, le mouvement partisan représenté par l'ensemble du peuple russe, ainsi que par les représentants de la noblesse, a influencé le cours de la guerre de 1812 et a joué un rôle important dans la défaite de l'armée française.
Bibliographie:
1. L'ouvrage de L. N. Tolstoï « Guerre et Paix » (Volume 4, partie
2. Ouvrage de L. G. Beskrovny « Partisans de la guerre patriotique de 1812 »
3. Depuis Internet : reportage sur le thème : « Guerre patriotique de 1812 »
4. Mémoires du décembriste I. D. Yakushin.
Après que les Français ont quitté Moscou et se sont déplacés vers l'ouest le long de la route de Smolensk, l'effondrement de l'armée française a commencé. L'armée fondait sous nos yeux : la faim et la maladie la poursuivaient. Mais pire que la faim et la maladie, les détachements de partisans ont réussi à attaquer des convois, voire des détachements entiers, détruisant ainsi l'armée française.
Dans le roman « Guerre et Paix », Tolstoï décrit les événements de deux jours incomplets, mais combien de réalisme et de tragédie il y a dans ce récit ! Il montre la mort, inattendue, stupide, accidentelle, cruelle et injuste : la mort de Petya Rostov, qui survient sous les yeux de Denisov et Dolokhov. Cette mort est décrite simplement et brièvement. Cela ajoute au réalisme dur de l’écriture. Voilà, la guerre. Ainsi, Tolstoï rappelle une fois de plus que la guerre est « un événement contraire à la raison humaine et à toute la nature humaine », la guerre est le moment où les gens tuent. C’est terrible, contre nature, inacceptable pour l’homme. Pour quoi? Pourquoi une personne ordinaire tuerait-elle un garçon, même issu d’un autre pays, qui s’est fait remarquer en raison de son inexpérience et de son courage ? Pourquoi une personne en tuerait-elle une autre ? Pourquoi Dolokhov prononce-t-il si calmement la sentence contre une douzaine de personnes capturées : « Nous ne les prendrons pas ! Tolstoï pose ces questions à ses lecteurs.
Le phénomène de la guérilla confirme pleinement la conception historique de Tolstoï. La guérilla est la guerre d’un peuple qui ne peut et ne veut pas vivre sous les envahisseurs. La guérilla est devenue possible grâce à l'éveil chez diverses personnes, quel que soit leur statut social, du principe de « l'essaim », dont Tolstoï était sûr de l'existence chez chaque personne, chez chaque représentant de la nation. Il y avait différents partisans : « il y avait des partis qui adoptaient toutes les techniques de l'armée, avec l'infanterie, l'artillerie, l'état-major, avec les commodités de la vie ; il n'y avait que des cosaques et de la cavalerie ; il y en avait des petits, des attelages, à pied et à cheval, il y avait des paysans et des propriétaires terriens... il y avait un sacristain... qui fit plusieurs centaines de prisonniers. Il y avait l'aînée Vasilisa, qui a tué des centaines de Français. Les partisans étaient différents, mais tous, animés par des objectifs et des intérêts différents, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour expulser l'ennemi de leur pays. Tolstoï croyait que leurs actions étaient causées par un patriotisme inné et instinctif. Les gens qui vaquaient calmement à leurs affaires quotidiennes en temps de paix s'arment, tuent et chassent leurs ennemis pendant la guerre. Ainsi, les abeilles, volant librement à travers un vaste territoire à la recherche de nectar, regagnent rapidement leur ruche natale lorsqu’elles apprennent l’invasion ennemie.
L'armée française était impuissante contre les détachements de partisans, tout comme un ours grimpé dans une ruche est impuissant contre les abeilles. Les Français pouvaient vaincre l’armée russe au combat, mais ils ne pouvaient rien faire contre la faim, le froid, la maladie et les partisans. « La clôture a duré assez longtemps ; soudain un des adversaires, se rendant compte que ce n'était pas une plaisanterie, mais qu'il s'agissait de sa vie, jeta son épée, et, prenant... une massue, se mit à la faire bouger... L'escrimeur était français, son adversaire... étaient des Russes..."
L'armée de Napoléon a été détruite grâce à la guérilla - le « club de la guerre populaire ». Et il est impossible de décrire cette guerre du point de vue des « règles de l'escrime » : toutes les tentatives des historiens qui ont écrit sur cet événement ont échoué. Tolstoï reconnaît la guérilla comme le moyen le plus naturel et le plus juste de lutter contre les envahisseurs.
- Ce n'est pas une question facile. Le chemin à parcourir pour trouver la réponse est long et douloureux. Et le trouverez-vous ? Parfois, il semble que cela soit impossible. La vérité n’est pas seulement une bonne chose, mais aussi une chose tenace. Plus vous avancez dans la recherche d’une réponse, plus vous êtes confronté à des questions. Et il n’est pas trop tard, mais qui reviendra à mi-chemin ? Et il est encore temps, mais qui sait, peut-être que la réponse est à deux pas de vous ? La vérité est tentante et présente de multiples facettes, mais son essence est toujours la même. Parfois, une personne pense qu'elle a déjà trouvé la réponse, mais il s'avère que c'est un mirage. […]
- Dans son roman Guerre et Paix, Tolstoï retrace la vie de trois générations de plusieurs familles russes. L'écrivain considérait à juste titre la famille comme la base de la société et y voyait l'amour, l'avenir, la paix et la bonté. De plus, Tolstoï croyait que les lois morales n'étaient établies et préservées que dans la famille. Pour un écrivain, une famille est une société en miniature. Presque tous les héros de L.N. Tolstoï sont des gens de famille, il est donc impossible de caractériser ces personnages sans analyser leurs relations au sein de la famille. Après tout, une bonne famille, croyait l’écrivain, c’est […]
- L. N. Tolstoï a travaillé sur le roman « Guerre et Paix » de 1863 à 1869. Créer une toile historique et artistique à grande échelle a nécessité d'énormes efforts de la part de l'écrivain. Ainsi, en 1869, dans les brouillons de « l'Épilogue », Lev Nikolaïevitch rappelait « la persévérance et l'excitation douloureuses et joyeuses » qu'il éprouvait au cours du travail. Les manuscrits de « Guerre et Paix » témoignent de la manière dont a été créée l’une des œuvres les plus grandes au monde : plus de 5 200 feuilles finement écrites ont été conservées dans les archives de l’écrivain. À partir d'eux, vous pouvez retracer toute l'histoire [...]
- Le titre même du roman de Tolstoï « Guerre et Paix » témoigne de l’ampleur du sujet étudié. L'écrivain a créé Roman historique, dans lequel sont compris les événements majeurs de l'histoire du monde, et leurs participants sont de véritables personnages historiques. Il s'agit de l'empereur russe Alexandre Ier, de Napoléon Bonaparte, du maréchal Koutouzov, des généraux Davout et Bagration, des ministres Arakcheev, Speransky et d'autres. Tolstoï avait sa propre vision du développement de l'histoire et du rôle de l'individu dans celle-ci. Il croyait que c'est seulement alors qu'une personne peut influencer [...]
- Tolstoï considérait la famille comme la base de tout. Il contient l’amour, l’avenir, la paix et la bonté. Les familles constituent la société dont les lois morales sont fixées et préservées au sein de la famille. La famille de l’écrivain est une société en miniature. Presque tous les héros de Tolstoï sont des gens de famille, et il les caractérise à travers leur famille. Dans le roman, la vie de trois familles se déroule devant nous : les Rostov, les Bolkonsky, les Kuragins. Dans l'épilogue du roman, l'auteur montre les heureuses « nouvelles » familles de Nikolai et Marya, Pierre et Natasha. Chaque famille est dotée de caractéristiques [...]
- "Guerre et Paix" est l'une des œuvres les plus brillantes de la littérature mondiale, révélant l'extraordinaire richesse des destins humains, des personnages, une étendue sans précédent de couverture des phénomènes de la vie, l'image la plus profonde événements majeurs dans l'histoire du peuple russe. La base du roman, comme l'a admis Léon Tolstoï, est la « pensée populaire ». « J'ai essayé d'écrire l'histoire du peuple », a déclaré Tolstoï. Les personnages du roman ne sont pas seulement des paysans et des soldats paysans déguisés, mais aussi les gens de la cour des Rostov, le marchand Ferapontov et des officiers de l'armée […]
- Léon Tolstoï, dans ses œuvres, a soutenu sans relâche que le rôle social des femmes est exceptionnellement grand et bénéfique. Son expression naturelle est la préservation de la famille, la maternité, le soin des enfants et les devoirs d'épouse. Dans le roman "Guerre et Paix", à l'image de Natasha Rostova et de la princesse Marya, l'écrivain a montré des femmes rares pour la société laïque de l'époque, les meilleures représentantes du milieu noble. début XIX siècle. Tous deux ont consacré leur vie à leur famille, ont ressenti un lien fort avec elle pendant la guerre de 1812, ont sacrifié […]
- Tolstoï utilise largement la technique de l'antithèse, ou de l'opposition, dans son roman. Les antithèses les plus évidentes : le bien et le mal, la guerre et la paix, qui organisent tout le roman. Autres antithèses : « bien - mal », « faux - vrai », etc. Basé sur le principe de l'antithèse, L.N. Tolstoï décrit les familles Bolkonsky et Kuragin. La principale caractéristique de la famille Bolkonsky peut être appelée le désir de suivre les lois de la raison. Aucun d'entre eux, à l'exception peut-être de la princesse Marya, ne se caractérise par une manifestation ouverte de ses sentiments. Sous la forme du chef de famille, vieux […]
- Léon Tolstoï est un maître reconnu de la création images psychologiques. Dans chaque cas, l'écrivain est guidé par le principe : « Qui plus de gens?", que son héros vive une vie réelle ou qu'il soit dépourvu de principe moral et soit spirituellement mort. Dans les œuvres de Tolstoï, tous les héros sont représentés dans l'évolution de leurs personnages. Les images féminines sont quelque peu schématiques, mais elles reflètent une attitude séculaire envers les femmes. Dans une société noble, une femme avait pour seule tâche de donner naissance à des enfants, de multiplier la classe des nobles. La fille était belle au début [...]
- L'événement central du roman "Guerre et Paix" est la guerre patriotique de 1812, qui a secoué tout le peuple russe, a montré au monde entier sa puissance et sa force, a mis en avant de simples héros russes et un brillant commandant, et en même temps a révélé la véritable essence de chaque personne spécifique. Tolstoï dans son œuvre dépeint la guerre comme un écrivain réaliste : dans un dur travail, le sang, la souffrance, la mort. Voici une photo de la campagne avant la bataille : « Le prince Andrei regardait avec mépris ces attelages interminables et interférents, ces charrettes, […]
- "Guerre et Paix" est une épopée nationale russe, qui reflète le caractère national du peuple russe au moment où se décide son destin historique. L.N. Tolstoï a travaillé sur le roman pendant près de six ans : de 1863 à 1869. Dès le début des travaux sur l’œuvre, l’attention de l’écrivain a été attirée non seulement par les événements historiques, mais également par la vie privée et familiale. Pour L.N. Tolstoï lui-même, l'une de ses principales valeurs était la famille. La famille dans laquelle il a grandi, sans laquelle nous n'aurions pas connu Tolstoï l'écrivain, la famille […]
- Le roman Guerre et Paix de L. N. Tolstoï est, selon nous, écrivains célèbres et les critiques, " le plus grand roman dans le monde". « Guerre et Paix » est un roman épique retraçant les événements de l'histoire du pays, à savoir la guerre de 1805-1807. et la guerre patriotique de 1812. Les héros centraux des guerres étaient les commandants - Koutouzov et Napoléon. Leurs images dans le roman « Guerre et Paix » sont construites sur le principe de l'antithèse. Tolstoï, glorifiant dans son roman le commandant en chef Koutouzov comme l'inspirateur et l'organisateur des victoires du peuple russe, souligne que Koutouzov est un véritable […]
- L.N. Tolstoï est un écrivain d'envergure mondiale, puisque le sujet de ses recherches était l'homme, son âme. Pour Tolstoï, l’homme fait partie de l’Univers. Il s’intéresse au chemin qu’emprunte l’âme d’une personne dans sa quête du haut, de l’idéal, dans sa quête de se connaître. Pierre Bezukhov est un noble honnête et très instruit. C'est une nature spontanée, capable de ressentir intensément et facilement excitée. Pierre se caractérise par des pensées et des doutes profonds, une recherche du sens de la vie. Le chemin de la vie c'est complexe et sinueux. […]
- Le sens de la vie... On réfléchit souvent à ce que pourrait être le sens de la vie. Le chemin de recherche pour chacun de nous n’est pas facile. Certaines personnes ne comprennent le sens de la vie, comment et avec quoi vivre, que sur leur lit de mort. La même chose s'est produite avec Andrei Bolkonsky, le plus, à mon avis, héros brillant Le roman "Guerre et Paix" de L. N. Tolstoï. Nous rencontrons pour la première fois le prince Andrei lors d'une soirée dans le salon d'Anna Pavlovna Scherer. Le prince Andrei était très différent de toutes les personnes présentes ici. Il n'y a chez lui ni manque de sincérité ni hypocrisie, si inhérentes au plus haut [...]
- Roman épique de L.N. "Guerre et Paix" de Tolstoï est une œuvre grandiose non seulement en raison de la monumentalité des choses qui y sont décrites événements historiques, profondément recherché par l'auteur et transformé artistiquement en un seul tout logique, mais aussi par la variété des images créées, à la fois historiques et fictives. En décrivant des personnages historiques, Tolstoï était plus un historien qu’un écrivain ; il disait : « Là où les personnages historiques parlent et agissent, il n’a pas inventé ni utilisé de matériaux. » Les personnages fictifs sont décrits […]
- Dans le roman épique Guerre et Paix, Lev Nikolaïevitch Tolstoï a interprété avec talent plusieurs personnages féminins. L'écrivain a essayé de comprendre monde mystérieux l'âme féminine, pour déterminer les lois morales de la vie d'une noble dans la société russe. L'une des images complexes était la sœur du prince Andrei Bolkonsky, la princesse Marya. Les prototypes des images du vieil homme Bolkonsky et de sa fille étaient Vrais gens. Il s’agit du grand-père de Tolstoï, N.S. Volkonsky, et de sa fille, Maria Nikolaevna Volkonskaya, qui n’était plus jeune et vivait à […]
- Dans le roman "Guerre et Paix", L. N. Tolstoï a montré société russe dans une période d'épreuves militaires, politiques et morales. On sait que le caractère du temps est déterminé par la façon de penser et le comportement non seulement des représentants du gouvernement, mais aussi des gens ordinaires ; parfois, la vie d'une personne ou d'une famille en contact avec d'autres peut être révélatrice de l'époque dans son ensemble. Les relations familiales, amicales et amoureuses lient les héros du roman. Souvent, ils sont séparés par une hostilité et une inimitié mutuelles. Pour Léon Tolstoï, la famille est l’environnement […]
- Personnage Ilya Rostov Nikolay Rostov Natalya Rostova Nikolay Bolkonsky Andrei Bolkonsky Marya Bolkonskaya Apparence Un jeune homme aux cheveux bouclés, de petite taille, au visage simple et ouvert, ne se distingue pas par sa beauté extérieure, a une grande bouche, mais a les yeux noirs. De petite taille avec un contour sec de la silhouette. Assez beau. Elle a un corps faible, qui ne se distingue pas par la beauté, a un visage mince et attire l'attention avec de grands yeux tristes et radieux. Caractère : De bonne humeur, aimant [...]
- Dans la vie de chaque personne, il y a des incidents qui ne sont jamais oubliés et qui déterminent son comportement pour longtemps. Dans la vie d’Andrei Bolkonsky, l’un des héros préférés de Tolstoï, un tel incident fut la bataille d’Austerlitz. Fatigué de la vanité, de la mesquinerie et de l'hypocrisie de la haute société, Andrei Bolkonsky part en guerre. Il attend beaucoup de la guerre : la gloire, l'amour universel. Dans ses rêves ambitieux, le prince Andrei se considère comme le sauveur de la terre russe. Il veut devenir aussi grand que Napoléon, et pour cela Andrei a besoin de son […]
- Le personnage principal du roman - l'épopée "Guerre et Paix" de Léon Tolstoï est le peuple. Tolstoï montre sa simplicité et sa gentillesse. Le peuple n'est pas seulement les hommes et les soldats qui jouent dans le roman, mais aussi les nobles qui ont une vision populaire du monde et des valeurs spirituelles. Ainsi, un peuple est un peuple uni par une histoire, une langue, une culture, vivant sur le même territoire. Mais il y a parmi eux des héros intéressants. L'un d'eux est le prince Bolkonsky. Au début du roman, il méprise les gens de la haute société, est malheureux dans son mariage […]