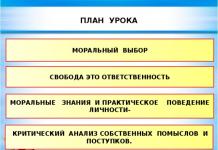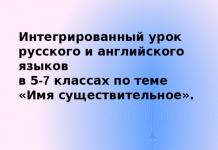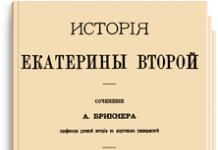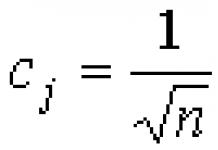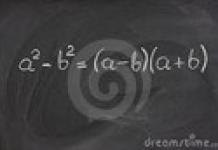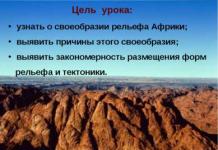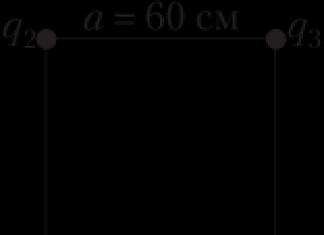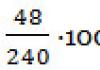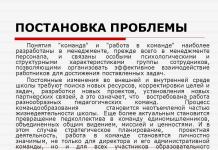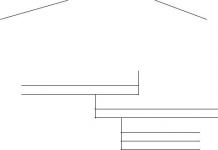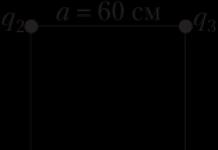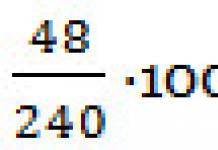Le discours oratoire est un discours influent et persuasif qui s'adresse à un large public, prononcé par un professionnel de la parole (orateur) et vise à changer le comportement du public, ses points de vue, ses croyances, ses humeurs, etc. Le désir de l'orateur de changer le comportement de l'auditeur peut concerner divers aspects de sa vie : le convaincre de voter pour le bon député, le persuader de prendre la bonne décision dans le domaine de l'activité commerciale, l'inciter à acheter certains biens, produits, etc. Il existe d'innombrables objectifs spécifiques de ce type, mais dans tous les cas, influencer la parole vise une réalité extra-linguistique, dans le domaine des intérêts vitaux et des besoins de l'auditeur. La capacité de convaincre a toujours été valorisée par la société. Le rôle d'un professionnel de la parole dans le domaine de la politique et des activités sociales est particulièrement important. Le rôle croissant de l'influence de la parole dans la vie de la société a conduit à l'émergence d'une doctrine qui a développé la théorie de ce type d'activité de parole. Cette doctrine s'appelle rhétorique. Dans la tradition russe, les mots sont également utilisés comme synonymes "oratorio" et « éloquence ».
L'enseignement rhétorique traditionnel comprenait cinq parties. L'enseignement sur la découverte parlait du développement significatif du texte. La doctrine de l'arrangement a développé des questions de composition du texte d'influence. La doctrine de l'expression est un élément central de la doctrine rhétorique, elle a donné une idée de qualités de discours telles que l'exactitude, la clarté, la précision, l'exactitude et la pertinence. Dans le même temps, les compétences de traitement artistique du matériel vocal ont été développées et une attention particulière a été accordée à la forme et aux méthodes de présentation du contenu. Cette partie de la rhétorique comprenait une section sur les tropes et les figures. L'enseignement de la mémorisation visait à développer des compétences d'orateur professionnel liées au travail de mémoire. La doctrine de la prononciation a développé la théorie de la parole. C'était l'acte même d'énonciation qui était perçu comme l'action du locuteur, exigeant un certain résultat.
Pour la société dans son ensemble, l’objectif principal de l’enseignement des langues est d’apprendre à chaque membre de la société à mettre toute information socialement significative sous la forme de discours appropriée. Dans ces conditions, il est naturel de s'intéresser de plus en plus aux problèmes de la science rhétorique ancienne, à la théorie du discours persuasif en général.
Le discours comme type de prose oratoire
Prendre la parole lors d'une réunion, d'une conférence, d'un rassemblement ou dans les médias est un type de prose oratoire. La tâche de l'orateur ne se limite jamais à présenter un certain nombre d'informations. L'orateur est obligé, en règle générale, de défendre son point de vue, de persuader les autres de l'accepter, de convaincre les autres qu'il a raison, etc. Les discours varient en sujet et en volume, les objectifs des orateurs sont différents et le public à dont ils parlent sont différents. Cependant, il existe des méthodes stables et standard pour développer le texte d'un discours. La combinaison de ces techniques peut être présentée sous la forme d’un ensemble de recommandations suivantes.
1. Vous devez absolument vous préparer pour le spectacle. Il ne faut pas compter sur une improvisation réussie s'il existe la moindre opportunité de préparation.
2. Tout d’abord, vous devez formuler clairement le sujet de votre discours en vous demandant : qu’est-ce que je veux dire ? Il ne faut pas présumer avec arrogance que cela est toujours clair pour celui qui parle. Cependant, de nombreux orateurs seulement après avoir commencé à parler se rendent compte qu'ils n'ont toujours pas une idée assez claire de l'idée qu'ils essaient de transmettre au public, qui, en règle générale, comprend le manque de préparation de l'orateur avant qu'il fait.
3. Déterminez le but du discours. Que souhaiteriez-vous réaliser ? Créer un nouveau problème ? Réfuter le point de vue de quelqu'un d'autre ? Convaincre. public? Changer le cours de la discussion ? Apporter des ajouts significatifs au problème en discussion ?
4. Au début du discours, formulez immédiatement l'idée principale du discours, la thèse principale. Il ne faut pas retarder l'introduction de la thèse. Jusqu’à ce que les auditeurs comprennent de quoi vous allez parler, leur attention sera dispersée et floue. N'oubliez pas que si vous retardez la présentation de l'essentiel du sujet, l'irritation du public augmente de façon exponentielle.
5. Déterminez l'idée principale, décomposez-la en composants distincts. Cette division doit être effectuée de manière cohérente sur la base d'un principe. Les éléments qui composent l'idée principale doivent être proportionnés en importance et interconnectés en un tout. Chaque élément de votre argument principal représentera une partie différente de votre discours, qui peut être nommée d'après le mot-clé de cette partie du discours.
6. Commencez à présenter le contenu avec les thèses fondamentales les plus importantes. Laissez les composants mineurs et supplémentaires pour la fin. Si l’attention du public diminue ou devient terne, cela se produira dans les parties les moins importantes de votre discours.
7. Si nécessaire, sélectionnez les informations appropriées pour chaque thèse : données statistiques, informations sur l'historique de la problématique, résultats d'enquêtes sociologiques, etc.
9. L'idée exprimée sera plus convaincante si vous l'étayez par des exemples.
10. Lorsque vous présentez des arguments pour étayer votre opinion, disposez-les de manière à ce que leur force probante augmente. Mettez vos arguments les plus forts à la fin. Le dernier argument est mieux enregistré en mémoire que le premier.
11. Évaluez la cohérence de l'ensemble du texte dans son ensemble. Vérifiez dans quelle mesure la séquence de présentation du matériel correspond à l'objectif fixé, à la nature du public et à la situation de discours spécifique qui s'est développée au moment du début de votre discours.
Les erreurs les plus typiques dans une présentation : écarts importants par rapport au contenu principal, incohérence, disproportion des parties individuelles, exemples peu convaincants, répétitions.
Chaque discours a sa préparation spécifique, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de principes généraux pour travailler sur le texte du discours.
Démontrons les principales caractéristiques de l'élaboration du contenu d'un discours oratoire à l'aide d'un exemple spécifique du discours d'A.I. Soljenitsyne, ce qu'il a dit en lui remettant le prix de la Freedom Foundation.
1. Chers messieurs, dirigeants et représentants de la Freedom Foundation !
2. Je suis profondément touché par votre décision de m'attribuer votre prix. Je l'accepte avec gratitude et avec un sens du devoir envers ce concept humain élevé qui sonne, est contenu, est contenu dans le nom de votre organisation, dans le symbole qui nous unit ici aujourd'hui. Il est naturel d’aborder ce symbole dans ma réponse.
3. Dans une situation comme celle d’aujourd’hui, il est plus facile de succomber à des chants sur les sombres abîmes du totalitarisme et à l’éloge des brillants bastions de la liberté occidentale. Il est beaucoup plus difficile, mais aussi plus fructueux, de se regarder soi-même d’un œil critique. Si l'espace des systèmes sociaux libres sur Terre se rétrécit de plus en plus et que d'immenses continents, qui semblent avoir récemment obtenu la liberté, sont entraînés dans l'espace de la tyrannie, cela n'est pas seulement à blâmer pour le totalitarisme, pour lequel la déglutition La liberté est une fonction de la croissance naturelle, mais, évidemment, pour les systèmes libres eux-mêmes, ayant perdu quelque chose dans leur force et leur stabilité intérieures.
4. Nos idées sur de nombreux événements et phénomènes sont basées sur des expériences de vie différentes, elles peuvent donc différer sensiblement, mais c'est précisément cet angle entre les rayons de vision qui peut nous aider à percevoir le sujet de manière plus globale. J’ose attirer votre attention sur certains aspects de la liberté dont il n’est pas de bon ton d’en parler, mais cela ne les fait pas cesser d’exister et donc d’influencer.
5 Le concept de liberté ne peut être véritablement compris sans évaluer les tâches vitales de notre existence terrestre. Je suis partisan de l'idée selon laquelle le but de la vie de chacun de nous n'est pas la jouissance sans fin de la richesse matérielle, mais : laisser la Terre meilleure que nous y sommes arrivés, qu'elle n'a été déterminée par nos inclinations héréditaires, c'est-à-dire passer par un certain chemin d’amélioration spirituelle au cours de notre vie. (La somme de ces processus ne peut être appelée que le progrès spirituel de l'humanité.) Si tel est le cas, alors la liberté extérieure s'avère n'être pas un objectif autosuffisant des personnes et des sociétés, mais seulement un moyen auxiliaire de notre développement non déformé ; seulement opportunité pour nous - vivre non pas comme un animal, mais comme un être humain ; seulement condition, afin qu'une personne puisse mieux remplir son objectif terrestre. Et la liberté n’est pas la seule condition. Certainement pas Pas Une personne a besoin de moins de liberté extérieure - d'espace non pollué pour l'âme, d'opportunités de concentration mentale.
6. Hélas, la liberté civilisée moderne ne veut pas nous laisser exactement cet espace. Hélas, c'est précisément au cours des dernières décennies que notre idée même de... la liberté a diminué et déchiqueté par rapport aux siècles précédents ; elle a été réduite presque exclusivement à l’absence de pression extérieure, à l’absence de violence d’État. À la liberté, entendue uniquement au niveau juridique – et pas plus haut.
7. Liberté ! - jeter de force les boîtes aux lettres, les yeux, les oreilles, le cerveau et les programmes télévisés des gens avec des déchets commerciaux, afin qu'aucun d'entre eux ne puisse être regardé avec une signification cohérente. Liberté! – d’imposer une information, indépendamment du droit de la personne de ne pas la recevoir, avec le droit de la personne à la tranquillité. Liberté! - cracher dans les yeux et dans l'âme des passants et des passants avec de la publicité. Liberté! – les éditeurs et les producteurs de films pour empoisonner la jeune génération avec l’abomination des plantes. Liberté! – aux adolescents de 14 à 18 ans de se délecter des loisirs et des plaisirs au lieu d'études intensives et de croissance spirituelle. Liberté! – des jeunes adultes à rechercher le farniente et à vivre aux dépens de la société. Liberté! – les grévistes, amenés à la liberté de priver tous les autres citoyens d'une vie normale, de travail, de mouvement, d'eau et de nourriture. Liberté! – les discours à décharge, lorsque l'avocat lui-même connaît la culpabilité de l'accusé. Liberté! - exaltent tellement le droit légal à l'assurance que même la miséricorde peut être réduite à l'extorsion. Liberté! – des plumes vulgaires et aléatoires effleurent de manière irresponsable la surface de n’importe quelle question, se précipitant pour façonner l’opinion publique. Liberté! - recueillir des potins, quand un journaliste, pour ses propres intérêts, n'épargnera ni son propre père ni sa patrie natale. Liberté! – divulguer les secrets de défense de votre pays à des fins politiques personnelles. Liberté! - un homme d'affaires pour toute transaction commerciale, peu importe le nombre de personnes qui tournent au malheur ou trahissent son propre pays. Liberté! – pour que les terroristes échappent à la punition, la pitié à leur égard équivaut à une condamnation à mort pour le reste de la société. Liberté! – des États entiers dépendent de l’aide extérieure, plutôt que de travailler à la construction de leur propre économie. Liberté! - comme une indifférence à l'égard de la liberté bafouée et lointaine des autres. Liberté! – ne défendez même pas votre propre liberté, laissez quelqu’un d’autre risquer sa vie.
8. Toutes ces libertés sont souvent juridiquement impeccables, mais moralement elles sont toutes imparfaites. En utilisant leur exemple, nous voyons que la totalité de tous les droits de liberté est loin d’être la Liberté de l’homme et de la société, c’est seulement une possibilité, elle peut être gérée de différentes manières. Tout cela est un faible type de liberté. Ce n’est pas le genre de liberté qui élève la race humaine. Mais - une liberté hystérique, qui peut certainement le détruire.
9. La liberté véritablement humaine est la liberté qui nous est donnée par Dieu interne, liberté de déterminer ses actions, mais aussi responsabilité spirituelle à leur égard. Et la liberté est véritablement comprise non pas par ceux qui se précipitent pour user égoïstement de leurs droits légaux, mais par ceux qui ont la conscience de se limiter même dans le cas de la légalité. Non pas celui qui est pressé de gagner un procès favorable, mais qui a la noblesse de le refuser – bien au contraire : de révéler publiquement ses erreurs ou ses méfaits. Ce qu'on appelait par un mot ancien et maintenant étrange - honneur.
10. Je pense qu’il ne serait pas excessivement modeste d’admettre cela dans certains pays glorieux du monde occidental au XXe siècle. la liberté, sous couvert de « développement », s’est dégradée par rapport à ses formes élevées originelles. Que dans aucun pays sur Terre il n'existe aujourd'hui cette forme la plus élevée de liberté pour les êtres humains spiritualisés, qui ne consiste pas à manœuvrer entre des articles de lois, mais dans une retenue volontaire et dans une pleine conscience de responsabilité - telles que ces libertés ont été conçues par nos ancêtres.
11. Cependant, je crois profondément aux racines intactes et saines de la nation américaine généreuse et puissante, avec l’honnêteté exigeante de sa jeunesse et un sens de la moralité toujours vigilant. J'ai vu la province américaine de mes propres yeux - et c'est pourquoi j'exprime tout cela ici aujourd'hui avec un ferme espoir.
Le but de ce discours est clair : fournir une analyse à la fois du concept même de « liberté » et de son rôle dans la vie de la communauté mondiale, afin que les gens puissent mieux comprendre le sens et le rôle de ce concept clé. Tout cela nous permet de qualifier le discours de Soljenitsyne de discours influent, c’est-à-dire de performance oratoire. Son contenu est développé comme suit. Le premier paragraphe est un appel. Dans le deuxième paragraphe, l'auteur exprime sa gratitude aux fondateurs du prix et définit le thème de son discours - « liberté » comme mot clé et symbolique. Le troisième paragraphe pose un problème qui est ensuite (paragraphes 4 à 6) divisé en aspects plus spécifiques : la liberté comme condition d'un développement spirituel non faussé et la liberté comme concept interprété au niveau juridique. Le septième paragraphe fournit des exemples confirmant l’incohérence de l’interprétation juridique étroite de la liberté, et le huitième paragraphe fournit un commentaire sur cette incohérence. Dans les neuvième et dixième paragraphes, une compréhension véritable et plus profonde de la liberté se dévoile. Le discours se termine par une conclusion-appel, dans laquelle l'auteur exprime sa confiance que ses auditeurs suivront cette seconde, vraie compréhension de la liberté.
Le discours oratoire est un discours influent et persuasif qui s'adresse à un large public, prononcé par un professionnel de la parole (orateur) et vise à changer le comportement du public, ses points de vue, ses croyances, ses humeurs, etc.
Prendre la parole lors d'une réunion, d'une réunion, d'un rassemblement ou dans les médias est un type de discours oratoire. La tâche de l’orateur est de présenter un certain nombre d’informations, de défendre son point de vue, de persuader les autres de l’accepter, de le convaincre qu’il a raison, etc. Les discours varient en termes de sujet, de volume, d'objectifs des orateurs et du public auquel ils s'adressent.
Il existe des méthodes stables et standard de développement du texte des discours. La combinaison de ces techniques peut être présentée sous la forme d’un ensemble de recommandations suivantes :
- - Vous devez absolument vous préparer pour le spectacle.
- - vous devez formuler clairement le sujet de votre discours en vous demandant : qu'est-ce que je veux dire ?
- - déterminer le but du discours. Que veux-tu accomplir? Définir une nouvelle tâche ? Réfuter le point de vue de quelqu'un d'autre ? Convaincre le public ? Changer le cours de la discussion ? Apporter des ajouts significatifs au problème en discussion ?
- - au début du discours, formuler immédiatement l'idée principale du discours, la thèse principale. Jusqu'à ce que les auditeurs comprennent de quoi vous allez parler, leur attention sera distraite ; flou. N'oubliez pas que si vous retardez la présentation de l'essentiel du sujet, l'irritation du public augmente de façon exponentielle.
- - Après avoir identifié l'idée principale, décomposez-la en éléments distincts. Cette division doit être effectuée sur la base d'un principe. Les composants qui composent l'idée principale doivent être d'importance égale et interconnectés en un tout. Chaque élément de l'idée principale représentera une partie différente de votre discours, qui peut être nommée d'après le mot-clé de cette partie du discours.
- - commencer à présenter le contenu des principales thèses fondamentales. Laissez les composants mineurs et supplémentaires pour la fin. Si l’attention de votre auditoire diminue, cela se produira pendant les parties les moins importantes de votre discours.
- - si nécessaire, sélectionner les informations adaptées à chaque thèse : données statistiques, informations sur l'historique de la problématique, résultats d'enquêtes sociologiques, etc.
- - votre opinion peut être étayée par une référence à une personne reconnue comme faisant autorité. A cet effet, il convient de citer, de raconter un autre texte, de reproduire des éléments d'une conversation personnelle, etc.
- - l'idée exprimée sera plus convaincante si vous l'étayez par des exemples.
- - lorsque vous avancez des arguments pour étayer votre opinion, disposez-les de manière à ce que leur force probante augmente. Mettez vos arguments les plus forts à la fin. Le dernier argument est mieux enregistré en mémoire que le premier.
- - évaluer la cohérence du texte dans son ensemble. Vérifiez dans quelle mesure la séquence de présentation du matériel correspond à l'objectif fixé, à la nature du public et à la situation de discours spécifique qui s'est développée au moment du début de votre discours.
Les erreurs les plus typiques dans une présentation : écarts importants par rapport au contenu principal, incohérence, disproportion des parties individuelles, exemples peu convaincants, répétitions. Chaque discours a sa préparation spécifique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de principes généraux pour travailler le texte du discours.
Cible cours pratiques - pour donner une idée holistique et détaillée d'un type d'activité de parole tel que l'oratoire ; apprendre à utiliser les moyens de base pour établir un contact ; développer des compétences dans la préparation de textes écrits pour une présentation orale.
Pour effectuer les tâches, vous devez connaître les termes suivants :
Discours d'impact - discours qui vise à changer le comportement de l’auditeur (lecteur).
Composition - organisation externe de l'œuvre, division en parties, leur disposition, interconnexion et corrélation.
Moyens d'établissement de contact - les moyens qu'un orateur utilise pour établir et maintenir le contact avec un public.
3tâches
8.1. Identifiez les moyens d'établissement de contact dans l'extrait donné du discours de D.S. Likhachev (constructions interrogatives, pronoms, particules, mots d'introduction, mots et constructions caractéristiques de la syntaxe conversationnelle).
Comme vous vous en souvenez tous bien, il détestait à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement les « faiseurs de problèmes ». Il se moquait de ceux qui résolvaient les problèmes et ne lisait pas leurs travaux.
Avait-il raison ?
Il n’avait pas raison, mais il y avait du vrai dans son attitude envers les créateurs de problèmes – sa propre vérité, celle de « Malyshev ». Peut-être que ceux qui traitent des « problèmes » sans s’occuper des manuscrits ont la même vérité ? Non, je ne veux pas dire que les deux ont également raison.
Laissez-moi vous donner une image. La science est un bâtiment à plusieurs étages. Comme tout bâtiment, il a une fondation - le matériau que la science étudie, puis il y a le premier étage - l'étude directe de ce matériau, et au-dessus s'élèvent les étages de « problèmes » et de « théories », de généralisations et d'hypothèses. Parfois, ces sols s'élèvent si haut que le sol et le sol sont presque invisibles et le matériau doit être examiné avec des jumelles ou un télescope. À l'ère de l'astronautique, nous
Le discours comme type de prose oratoire 3 3
Nous savons qu’une telle « vision télescopique » donne aussi les résultats les plus importants. Mais voici ce qui est important. Aucun bâtiment ne peut être construit sans premier étage. Le bâtiment peut avoir un seul étage, sans deuxième étage, mais le bâtiment ne peut pas commencer à partir du deuxième étage. Il devrait toujours y avoir un premier étage. Par conséquent, les gens des manuscrits et les gens des théories nues ne sont pas équivalents. (« Un peu sur Vladimir Ivanovitch Malyshev. » Discours introductif aux « Lectures à la mémoire de V.I. Malyshev »).
8.2. Corriger les erreurs de style(débarrassez-vous des inutiles
un grand nombre de noms verbaux, décomposez-le
des phrases longues en plusieurs phrases simples, etc.). Faire des changements
compréhension de l'aspect lexical et syntaxique du texte, en tenant compte de son
destiné à une présentation orale(entrez dans le texte un
phrases composées, incomplètes, adresses, question
toutes structures, etc.).
A. Une compréhension correcte des exigences en soi devrait échouer
les auditeurs de choisir la ligne de comportement la plus correcte, de provoquer davantage
attitude bien informée à l'égard de l'exercice de ses fonctions officielles.
B. De nombreuses personnes ont remarqué la fumée presque simultanément. Et les officiers, en attendant une réunion officielle, ont fait une pause cigarette près du quartier général.
B. La tâche responsable du maintien de l'ordre public dans la ville était
confié au personnel des unités militaires de subordination opérationnelle, spécial
toutes les unités militaires motorisées du district intérieur du Nord-Ouest
troupes du ministère de l'Intérieur de la Russie, cadets de l'École supérieure de commandement militaire de l'Intérieur
eux des troupes, ainsi que la police de Saint-Pétersbourg et régionale.
D. Après que les conscrits, vêtus de jeans et de cuir, ainsi que leurs proches et petites amies, aient été placés dans les tribunes du club de sport militaire sur le quai Petrovskaya, le présentateur a annoncé le début de l'action qui, selon les organisateurs, était censé être un spectacle brillant et mémorable.
D. Comment résoudre le problème du Caucase si nous ne pensons pas globalement, mais en termes généraux ?
E. Regardez, par exemple, l'avant-poste de N. Un avant-poste bien équipé qui vous permet de combattre et vous donne la possibilité de vous reposer et de vous préparer au service.
G. Et quand les soldats voient le général, vous le saluez et il vous tend également la main avec un sourire, n'est-ce pas l'humeur du peuple.
3. Ils ont tissé tout un enchevêtrement de bizutage, qui a donné lieu, comme des champignons après la pluie, à diverses sortes de « chepe » et d'infractions disciplinaires.
I. Notre tâche aujourd'hui, compte tenu de la situation clairement défavorable en matière de discipline parmi les soldats sous contrat, est un travail éducatif minutieux et persistant avec eux.
8.3. Préparez le texte ci-dessous pour votre présentation orale :
a) rendre le langage syntaxique plus accessible et plus facile à comprendre
et structure lexicale du texte ; b) entrez les contacts
des moyens, y compris des éléments de dialogisation ; c) identifier les éléments
contenu par structures métatextuelles ; d) corriger ceux existants
lacunes.
Envoyer votre bon travail dans la base de connaissances est simple. Utilisez le formulaire ci-dessous
Les étudiants, étudiants diplômés, jeunes scientifiques qui utilisent la base de connaissances dans leurs études et leur travail vous seront très reconnaissants.
Introduction
1.3 Contact avec le public
2.1 Discours d'information
2.2 Discours persuasif
Conclusion
Bibliographie
Introduction
La prise de parole en public est un processus de transmission d'informations dont le but principal est de convaincre les auditeurs de la justesse de certaines dispositions. Le mot orateur (du latin orare - « parler ») est utilisé dans deux sens :
1. une personne prononçant un discours, s'exprimant en public ;
2. une personne qui sait bien parler en public, qui a le don d'éloquence et qui maîtrise les mots.
L’orateur est un maître dans l’art oratoire et possède une brillante maîtrise de la langue. L'orateur influence les auditeurs avant tout par son éloquence, sa haute culture de la parole et ses compétences verbales. Un tel orateur sait comment mener une propagande de manière convaincante, intelligible et vivante. Il peut non seulement présenter de manière stricte et précise, mais aussi avec émotion toute question théorique complexe. Mais ces personnes sont très peu nombreuses.
Il existe de nombreuses classifications de prise de parole en public. Pour la formation pratique à l'art de parler en public, il est plus approprié de diviser la prise de parole en public en types selon leur fonction, c'est-à-dire selon l'objectif que l'orateur se fixe dans son discours.
Types de prise de parole en public par objectif :
1. Informations
2. Protocole et étiquette
3. Divertissant
4. Persuaseurs
Les objectifs que l'orateur se fixe peuvent être combinés, ce qui peut rendre les discours complexes. Nous pouvons, par exemple, parler d'étiquette informationnelle, de divertissement informationnel, de discours informationnels persuasifs et d'autres types mixtes sont également possibles.
1. Se préparer à une prise de parole en public
1.1 Comment surmonter votre peur de parler en public
Lorsqu’on parle devant un public, il ne faut « rien craindre mais se craindre soi-même ». La timidité est un phénomène assez courant chez les locuteurs débutants. Seuls quelques étudiants ont réellement peur de parler en public. En général, ils ont moins peur du public que les personnes plus âgées. Probablement, seul un étudiant sur mille est incapable de surmonter sa peur. La pratique continue de parler en public est le meilleur remède contre l’embarras et la peur. Mais les conseils suivants peuvent vous aider :
1. Soyez conscient de la cause de la peur. Personne ne vous fera de mal. Vos auditeurs sont sympathiques et ne vous souhaitent que du succès. Ils comprennent les défis auxquels vous êtes confrontés, en particulier lorsque vous parlez devant une classe où vous faites « partie de la même équipe ».
2. Effectuez-vous en pleine préparation. Vous aurez des raisons de vous sentir « anxieux » si vous vous précipitez dans vos notes juste avant une présentation, ou si vous avez soudainement « une idée » qui vous amène à griffonner quelques remarques aléatoires sur une feuille de papier.
3. Gardez une apparence confiante. Une apparence confiante a un effet sur l’auditeur. Si vous lui inculquez confiance en vos capacités, vous aurez vous-même un sentiment de confiance en vous. Si nécessaire, prenez quelques respirations relaxantes avant de parler. Il faut être particulièrement prudent dans les remarques liminaires. Si vous cédez à votre premier instinct : vous précipiter, votre nervosité ne fera qu'augmenter. Les pauses doivent être prises aussi souvent que vous le jugez opportun. Il n’est pas nécessaire d’être gêné lorsque vous vous trompez accidentellement. Les auditeurs n’y attacheront aucune importance s’ils ne sont pas eux-mêmes gênés.
4. Surmontez la peur par l’action. Un joueur de football combat l'excitation nerveuse avant le début d'un match avec un échauffement énergique. Nous devons agir de la même manière : n'ayez pas peur de nous mettre immédiatement au travail.
1.2 Déterminer le but du discours
Déterminez vos objectifs avant le discours, ils peuvent : informer les auditeurs sur quelque chose de nouveau ; convaincre les auditeurs de les préparer à reconnaître une manière de résoudre le problème ; un appel à l’action pour créer le désir de changer quelque chose. Souvent, une performance combine les trois objectifs, mais l’un d’eux est généralement le principal. Connaître le public est nécessaire pour atteindre les objectifs du discours.
Prendre la parole lors d'une réunion, d'une conférence, d'une réunion ou dans les médias est un type de prose oratoire. La présentation doit se distinguer par la clarté, la pertinence, la profondeur du contenu, l'efficacité, la richesse de l'information, la luminosité et l'accessibilité.
La tâche de l'orateur ne se résume parfois pas à présenter un certain nombre d'informations. En règle générale, l'orateur est obligé de défendre son point de vue, de persuader les autres de l'accepter et de convaincre les autres qu'il a raison. Les discours varient en sujet et en volume, les objectifs des orateurs sont différents et les publics auxquels ils s'adressent sont différents. Cependant, il existe des méthodes stables pour développer le texte d'un discours.
1. Vous devez absolument vous préparer pour le spectacle. Il ne faut pas compter sur une improvisation réussie s'il existe la moindre possibilité de préparation.
2. Commencez à présenter le contenu avec les thèses fondamentales les plus importantes. Laissez les composants mineurs pour la fin.
Si nécessaire, sélectionnez les informations appropriées pour chaque thèse : données statistiques, informations sur l'historique de la problématique, résultats d'enquêtes sociologiques.
3. L'idée exprimée sera plus convaincante si elle est étayée par des exemples.
Lorsque vous présentez des arguments pour étayer votre opinion, disposez-les de manière à ce que leur force probante augmente. Mettez les arguments les plus forts à la fin. Le dernier argument est mieux enregistré en mémoire que le premier.
4.Évaluer la cohérence de l'ensemble du texte. Vérifiez dans quelle mesure la séquence de présentation du matériel correspond à l'objectif fixé, à la nature du public et à la situation de discours spécifique qui s'était développée au moment du début du discours.
Il faut rappeler que les discours peuvent être : rédigés intégralement et mémorisés ; écrit en entier et lu à partir du manuscrit ; parlé de manière improvisée; parlé avec préparation préalable, mais sans écrit et sans mémorisation.
1.3 Contact avec le public
Le contact constant avec le public est le problème clé de la prise de parole en public. S'il n'y a pas de contact avec le public, soit le discours lui-même perd son sens dans son ensemble, soit son efficacité diminue fortement. Le travail de maintien du contact est multiforme et réalisé simultanément dans plusieurs directions. Pour une communication réussie avec le public et un contact constant, il est très important d'introduire des éléments de dialogue dans vos discours. Le dialogue est la principale forme de communication du discours. C'est le dialogue qui représente la forme originelle et primaire d'existence du langage, correspondant à la nature même de la pensée humaine, qui est de nature dialogique. Tout mot prononcé ou voulu représente une réaction à la parole de quelqu'un d'autre. Vous devez penser au contact avec le public lors de la préparation du texte de votre discours. Il existe des actions vocales spéciales dont le but est d'établir et de maintenir le contact.
Ceux-ci incluent : adresse, salutation, compliment, adieu. Des variantes de ces actions vocales sont bien développées et sont données dans des manuels sur l'étiquette de la parole. Vous devez choisir plusieurs options pour chacune de ces actions et bien les maîtriser en termes d'intonation et de style. Il est possible de commencer un discours sans salutation ni discours uniquement lors d'une réunion purement professionnelle dans un cercle restreint de spécialistes, avec lesquels les réunions sont assez fréquentes. Les appels peuvent et doivent être utilisés dans la partie centrale du discours ; ils activent l'attention des auditeurs. Les structures métatextuelles jouent un rôle très important dans le maintien du contact.
Le métatexte est constitué des mots et des phrases de votre discours dans lesquels vous parlez de la façon dont il est construit, de quoi et dans quel ordre vous allez parler ou écrire, c'est-à-dire le métatexte est un texte sur du texte. La conception métatextuelle d’un discours peut être assimilée au marquage de la chaussée et à la mise en place de panneaux le long de la route indiquant les virages, les pentes et les endroits difficiles. Un bon orateur désigne toujours des parties de son discours par des constructions métatextuelles : au début de mon discours, je voudrais attirer votre attention sur... ; Répétons-le, encore une fois... ; Passons maintenant à la question de... ; Premièrement...; Deuxièmement...; Troisièmement...; En conclusion, je voudrais dire que... etc.
2. Types de prise de parole en public
Prendre la parole en public peut être divertissant, informatif, inspirant, persuasif ou appeler à l’action.
Envisagez un discours informatif et persuasif :
2.1 Discours d'information
La tâche du discours informatif n'est pas seulement d'éveiller la curiosité, mais aussi de donner une nouvelle compréhension du sujet. Cela peut être un récit, une description, une explication. La narration est mouvement ; la description décompose l'objet, montre les détails et leur donne une apparence visuelle, comme dans une image ; l'explication montre à quoi ressemble l'objet en action ou quelle est sa structure. Dans tous les discours d’information, l’un de ces traits caractéristiques prédomine. Par exemple:
Narration : Expédition de l'amiral Byrd au pôle Sud. La vie d'une mouche domestique. Recherchez de l'uranium. La croissance et le déclin de l'entreprise.
Description : Composition intéressante de bon sol. Le jour J en Europe vu du ciel. La vie dans la stratosphère. Maison d'un citoyen romain.
Explication : Comment les abeilles essaiment. Jouer au hockey. Qu’est-ce qui inspire la politique ? Le sens du bouddhisme.
Le sens du mouvement évoqué par le récit, le côté concret caractéristique de la description et l’ordre naturel inhérent à l’explication sont les caractéristiques les plus importantes du discours qui ont une signification cognitive. La présentation des événements qui amènent le criminel à la merci de la justice acquerra un caractère vivant si elle prend la forme d'un récit intitulé « Les derniers jours du meurtrier ».
Le discours informatif doit répondre aux exigences suivantes.
a) Il ne devrait y avoir rien de controversé.
Dans le discours informatif, toute question trouve sa résolution si deux conditions sont remplies. La question doit être liée à quelque chose qui existe déjà ou qui représente la vérité réelle. Cela ne peut pas provoquer de dispute : croire ou ne pas croire et que faire.
b) Cela devrait évoquer la curiosité.
Le trait caractéristique du discours informationnel est qu’il éveille la curiosité de l’auditeur. Si des questions provoquées par la surprise, la perplexité ou le doute ne se sont pas posées à l'avance, il est de votre devoir de les poser.
c) Il doit satisfaire les besoins de l'auditeur.
Votre autre responsabilité est de répondre à toutes les questions soulevées à la satisfaction de l’auditeur. Vous ne pouvez pas entreprendre un rapport sur la structure de l’atome sans avoir résolu ce problème complexe avec la plus grande clarté.
d) Le message doit être pertinent.
Les intérêts de l'auditeur reposent sur les faits, leur signification, leurs processus, leurs principes et leurs événements en eux-mêmes. Mais les intérêts peuvent aussi surgir en relation avec des besoins pratiques, puisqu’ils sont directement liés aux activités de l’auditeur, à sa vie familiale, à sa religion, à ses loisirs, à ses opinions politiques ou à sa vie sociale. D'une part, le discours informatif se distingue difficilement du discours divertissant, car il contient un grand nombre d'éléments qui suscitent l'intérêt : spécificité, nouveauté, conflit, contraste et, éventuellement, humour. Exemple : une nouvelle histoire passionnante. D’un autre côté, le discours informatif se rapproche du discours de propagande. Par exemple, un reportage sur la hausse des prix attire en soi l'attention d'un public de femmes au foyer sur les problèmes économiques. Dans le même auditoire, une conversation sur la polio contient déjà un appel à résoudre un problème vital pour la famille. Dans toutes les conditions, un discours éducatif, par opposition à un discours divertissant, doit donner à l'auditeur l'impression que les connaissances qu'il emporte avec lui méritent son temps et son attention. Cependant, tout discours, quel qu’il soit, contient des éléments d’information et doit présenter un intérêt. Les conclusions pratiques, déterminées par la nature de l'information et l'intérêt qu'elle suscite chez un public donné, détermineront l'objectif principal de l'orateur. Parfois, une conversation, apparemment poursuivant des objectifs éducatifs, aura en réalité une valeur de propagande. Un reportage sur le fonctionnement des voleurs au XVIe siècle sera très amusant et c'est tout. Mais un discours destiné à familiariser l'auditeur avec les méthodes des gangsters modernes incitera le public à élever la voix avec plus de force en faveur de mesures décisives pour lutter contre le gangstérisme. Dans son sens, un tel discours relève déjà de la propagande. Dans un groupe d'étudiants, la présentation des modalités d'organisation des coopératives agricoles ne trouvera pas d'application pratique. Mais le même rapport destiné aux agriculteurs, même s'il est totalement objectif du point de vue du parti, sera accepté par eux comme argument dans les conflits sur la question de savoir s'il doit y avoir des coopératives ou telle ou telle forme de coopération coopérative.
2.2 Discours persuasif
Convaincre signifie prouver ou réfuter une position par des arguments logiques. Un tel discours cherche à définir une façon de penser et de se comporter, mais ne constitue pas un appel à l’action directe.
La capacité de convaincre a toujours été valorisée par la société. Le rôle d'un professionnel de la parole dans le domaine de la politique et des activités sociales est particulièrement important.
Lors d'un discours public, lors d'une présentation, lors d'une conversation, de négociations, vous devez constamment défendre votre point de vue, réfuter les avis de vos adversaires, convaincre, et souvent faire changer d'avis, les auditeurs.
Vous pouvez influencer les croyances des auditeurs non seulement par le discours et les arguments, mais également par les expressions faciales et les gestes. Même le silence, dans certains cas, constitue un argument convaincant.
L'étude des méthodes et techniques d'influence persuasive les plus efficaces dans le processus de communication est réalisée par une branche particulière de la connaissance - la théorie de l'argumentation ("nouvelle rhétorique").
L'argumentation est la présentation d'arguments pour changer la position ou les convictions de l'autre partie.
Un argument est destiné à soutenir la thèse d’un argument – une affirmation que la partie argumentante juge nécessaire de faire comprendre au public.
Les caractéristiques suivantes sont caractéristiques de l'argument :
1. L'argumentation s'exprime toujours dans le langage, sous forme d'énoncés oraux ou écrits.
2. L'argumentation est une activité utile.
3. l'argumentation est une activité sociale, car dirigé vers d’autres personnes.
L'Introduction à un discours persuasif permet de formuler sa thèse principale. D'une manière ou d'une autre, l'orateur doit dire quelle est en fait la question qu'il examinera et sur quels problèmes liés à cette question il s'attardera, c'est-à-dire Expliquez brièvement la structure du discours. Si le discours dure plus de 7 à 10 minutes, il est préférable de préparer l'introduction du discours après avoir compilé sa partie principale.
La partie principale du discours argumentatif contient la ou les thèses et les preuves nécessaires. Pour que les preuves acquièrent un pouvoir convaincant, l’orateur devra effectuer le travail approprié. Qu'est-ce que c'est?
1) La première étape consiste à dresser une liste des arguments disponibles et, si nécessaire, à « inventer » (sélectionner) des arguments supplémentaires.
2) La prochaine étape du travail consiste à amener cette pile chaotique d'arguments pour votre thèse dans un ordre plus ou moins ordonné, dans un système, afin que chaque argument y ait sa place et devienne par conséquent un argument - une preuve. Les arguments doivent être combinés en groupes sémantiques. Ayant un « sujet » commun pour les arguments de chaque groupe, il est facile d'en sélectionner d'autres qui manquent dans un tel groupe. Pour chaque groupe d'arguments, de plus en plus de nouveaux arguments peuvent être sélectionnés ; en fonction de la durée de votre discours (règlement) et des caractéristiques de l'auditoire, vous pouvez modifier l'ordre des groupes d'arguments, vous pouvez trouver les chiffres nécessaires, les données statistiques, ajouter des exemples et des faits issus de votre propre expérience, de la littérature . Le travail d'organisation des arguments dans un discours est également déterminé selon que votre discours est persuasif ou agitateur. Dans ce dernier cas, les arguments les plus précis et les plus pertinents doivent être placés séquentiellement vers la fin du discours (par ordre croissant de leur « pertinence », de leur « caractère frappant »).
Ainsi, les arguments sont disposés dans l’ordre qui convient à vos objectifs, c’est-à-dire qu’ils sont dotés d’un « pouvoir de frappe ».
3) La troisième étape du travail avec eux consiste à les vérifier.
a) l'exactitude des faits ; y a-t-il des erreurs dans les détails ?
b) le succès des exemples et comparaisons que vous avez sélectionnés ; ne susciteront-ils pas d'objections ?
c) la logique de la façon dont vous avez organisé (arrangé) les arguments et les groupes.
d) si vos arguments ou déclarations peuvent être retournés contre vous.
4) L'ordre des arguments selon leur « force » dépend en grande partie de l'humeur du public ; si le public est hostile, il est recommandé de ranger les arguments « par ordre croissant » et de terminer par le plus fort ; Si l'attitude du public est neutre ou favorable, les arguments principaux (ou l'argument global, si vous en avez un) peuvent être utilisés au début de l'argumentation ou à tout moment qui vous convient le mieux.
Dans tous les cas, il faut veiller à ce que les arguments soient présentés séquentiellement, c'est-à-dire que chaque ensemble d'arguments doit suivre « sa » thèse (ou la précéder si vous avez choisi la méthode d'argumentation inductive). Cela signifie que votre thèse générale doit être clairement divisée en positions distinctes, « sous-thèses », et chacune de ces positions doit recevoir sa propre confirmation - ses arguments.
La conclusion d’un discours persuasif en constitue une partie très importante. Vous devez le traiter avec le plus grand soin. Une bonne conclusion peut sauver la situation même s’il y a quelques défauts dans l’argumentation.
1) Pour la Conclusion, le plus important est : une conclusion claire et accrocheuse, et non une répétition des positions et des faits divulgués et présentés dans la partie principale. Vous pouvez utiliser, comme dans l'introduction, une citation, un aphorisme, une blague - selon la situation de discours
2) Les discours persuasifs se terminent généralement par un appel au public.
3) Et enfin, la conclusion doit être optimiste et doit être réalisée sur un « high », créant le même high parmi le public.
Conclusion
En conclusion, je voudrais souligner que la capacité de parler en public réside dans la capacité d'utiliser les deux formes de pensée humaine : logique et figurative. Ayant maîtrisé l'art de parler en public, les gens comprendront tout le charme et la beauté de notre langue. Ici, vous pouvez plaire à tout le monde avec un appel unique prononcé par A.P. Tchekhov : "Apprenez à maîtriser la langue, les locuteurs actuels et futurs ! La langue est votre base et votre arme professionnelle." Devenir un maître de l'art oratoire est une grande réussite pour quelqu'un qui le veut et qui ne recule devant rien, car ce qu'il a accompli lui ouvrira des portes dans tous les domaines de notre vie et contribuera peut-être à changer certains des aspects négatifs de cette situation. processus sans fin le plus difficile.
Bibliographie
1. L.A. Vvedenskaya., L.G. Pavlova. Culture et art de la parole. - Rostov-n/D, 1996
2. V.I. Maksimova. - M. : Gardariki. Langue russe et culture de la parole : , 2002
3. Soper P. Fondamentaux de l'art de la parole. - M., 1992
4. V.V. Sokolova Culture de la parole et culture de la communication. M., "Lumières" 1995
5. http://www.klikovo.ru
Documents similaires
Contact visuel et vocal entre l'orateur et le public. Secrets de prise de parole en public. Culture oratoire. Genres et types d'oratoire. Des orateurs politiques talentueux. Styles fonctionnels du langage littéraire en oratoire.
thèse, ajoutée le 24/10/2008
L’orateur est un maître dans l’art oratoire et possède une brillante maîtrise de la langue. La structure et les caractéristiques de l'oratoire, son intégrité et sa composition. Préparer un discours public et le répéter. Conception compositionnelle et stylistique du discours oratoire.
résumé, ajouté le 11/06/2012
Les principales composantes du discours. Préparer un discours : choix d'un sujet, but du discours. La structure du discours oratoire. Façons de préparer un discours public. Modèles de discours logiques et intonation-méthodologiques. Caractéristiques de l'étiquette de la parole, image de l'orateur.
résumé, ajouté le 12/02/2012
Arguments logiques et émotionnels utilisés pour influencer le public. Exigences de base pour l'art oratoire lors de la prise de parole en public. Caractéristiques de l'établissement du contact avec le public, le « facteur destinataire ». Le concept de « devoir moral de l'orateur ».
résumé, ajouté le 25/11/2014
Préparation à un discours précis, travail au stade pré-communicatif. Évaluation de la situation et de la composition du public. La structure du discours oratoire. Normes fondamentales de la parole publique. La signification des lois logiques pour le locuteur. Technique de prononciation et diction du locuteur.
résumé, ajouté le 15/02/2013
Le concept et l'essence de l'oratoire. Définition de l'oratoire, son histoire. "Secrets" de la prise de parole en public. Caractéristiques, types et types d'oratoire. Analyse des styles fonctionnels du langage littéraire dans le discours d’un locuteur.
résumé, ajouté le 20/12/2009
L'éloquence oratoire comme forme particulière d'art. Qualités qui distinguent l'oratoire des autres types de discours. Caractéristiques de la construction et propriétés du discours oratoire. Traditions de l'oratoire moderne. L'influence du psychisme sur la qualité du discours oratoire.
présentation, ajouté le 15/12/2010
La capacité de parler en public est la capacité d'utiliser les deux formes de pensée humaine : logique et figurative. Erreurs courantes commises par les orateurs. Règles pour réussir sa prise de parole en public : préparation du discours, lieu de discours, tenue vestimentaire, expressions faciales et gestes.
test, ajouté le 15/09/2009
Caractéristiques générales des formes de discours. L'essence de la preuve. Art oratoire. Rhétorique heuristique. Logique du discours. Techniques stylistiques de l'oratoire. Techniques lexicales du discours oratoire.
résumé, ajouté le 10/09/2007
Formation de l'art oratoire. Types d'éloquence : sociopolitique, académique, judiciaire, sociale et quotidienne, spirituelle. Qualités qui distinguent l'oratoire des autres types de discours. Caractéristiques de la construction et propriétés du discours oratoire.
Introduction 2
L'oratoire comme type de discours 3
Support informationnel pour la parole 5
Contact public 6
Caractéristiques syntaxiques 8
Caractéristiques lexicales 9
Logique, éthique, esthétique de la parole 9
Règles de construction du discours oratoire 9
Lois logiques 10
Éthique de la prise de parole en public 11
Conclusion 13
Bibliographie 14
Introduction
Le discours oratoire est un discours influent et persuasif qui s'adresse à un large public, prononcé par un professionnel de la parole (orateur) et vise à changer le comportement du public, ses points de vue, ses croyances, ses humeurs, etc. Le désir de l'orateur de changer le comportement de l'auditeur peut concerner divers aspects de sa vie : le convaincre de voter pour le bon député, le persuader de prendre la bonne décision dans le domaine de l'activité commerciale, l'inciter à acheter certains biens, produits , etc. Il existe d'innombrables objectifs spécifiques de ce type, mais dans tous les cas, le discours d'influence vise une réalité extra-linguistique, dans le domaine des intérêts vitaux et des besoins de l'auditeur. La capacité de convaincre a toujours été valorisée par la société. Le rôle d'un professionnel de la parole dans le domaine de la politique et des activités sociales est particulièrement important. Le rôle croissant de l'influence de la parole dans la vie de la société a conduit à l'émergence d'une doctrine qui a développé les racines de ce type d'activité de parole. Cet enseignement est appelé rhétorique (« Dans la tradition russe, les mots « oratorio » et « éloquence » sont également utilisés comme synonymes.)
Le but de ce travail est de considérer la structure du discours oratoire, et pour cela, vous devez vous familiariser avec les règles de base qui doivent être suivies lors de l'élaboration du contenu d'un discours, à quoi vous devez faire attention lors de l'élaboration du matériel, à quoi les moyens d'améliorer le discours oratoire et, bien sûr, avec les caractéristiques lexicales et syntaxiques de la structure du discours oratoire.
L'oratoire comme type de discours
Prendre la parole lors d'une réunion, d'une conférence, d'une réunion ou dans les médias est un type de prose oratoire. La tâche de l'orateur ne se limite jamais à présenter un certain nombre d'informations. L'orateur est obligé, en règle générale, de défendre son point de vue, de persuader les autres de l'accepter, de convaincre les autres qu'il a raison, etc. Les discours varient en sujet et en volume, les objectifs des orateurs sont différents et les publics auxquels ils s'adressent sont différents. Cependant, il existe des méthodes stables et standard pour développer le texte d'un discours. La combinaison de ces techniques peut être présentée sous la forme d’un ensemble de recommandations suivantes :
1. Vous devez absolument vous préparer pour le spectacle. Il ne faut pas compter sur une improvisation réussie s'il existe la moindre opportunité de préparation.
2. Tout d'abord, vous devez formuler clairement le sujet de votre discours en vous demandant : qu'est-ce que je veux dire ? Il ne faut pas présumer avec arrogance que cela est toujours clair pour celui qui parle.
3. Déterminez le but du discours. Que souhaiteriez-vous réaliser ? Créer un nouveau problème ? Réfuter le point de vue de quelqu'un d'autre ? Convaincre le public ? Changer le cours de la discussion ? Apporter des ajouts significatifs au problème en discussion ?
4. Au début du discours, formulez immédiatement l'idée principale du discours, la thèse principale. Il ne faut pas retarder l'introduction de la thèse. Jusqu’à ce que les auditeurs comprennent de quoi vous allez parler, leur attention sera dispersée et floue. N'oubliez pas que si vous retardez la présentation de l'essentiel du sujet, l'irritation du public augmente de façon exponentielle.
5. Déterminez l'idée principale, décomposez-la en composants distincts. Cette division doit être effectuée de manière cohérente sur la base d'un principe. Les éléments qui composent l'idée principale doivent être proportionnés en importance et interconnectés en un tout. Chaque élément de votre argument principal représentera une partie différente de votre discours, qui peut être nommée d'après le mot-clé de cette partie du discours.
6. Commencez à présenter le contenu avec les thèses fondamentales les plus importantes. Laissez les composants mineurs et supplémentaires pour la fin.
7. Si nécessaire, sélectionnez les informations appropriées pour chaque thèse : données statistiques, informations sur l'historique de la problématique, résultats d'enquêtes sociologiques, etc.
9. L’idée exprimée sera plus convaincante si vous l’étayez par des exemples.
10. Lorsque vous présentez des arguments pour étayer votre opinion, disposez-les de manière à ce que leur force probante augmente. Mettez vos arguments les plus forts à la fin. Le dernier argument est mieux enregistré en mémoire que le premier.
11.Évaluer la cohérence de l'ensemble du texte dans son ensemble. Vérifiez dans quelle mesure la séquence de présentation du matériel correspond à l'objectif fixé, à la nature du public et à la situation de discours spécifique qui s'est développée au moment du début de votre discours.
Les erreurs les plus typiques dans une présentation : écarts importants par rapport au contenu principal, incohérence, disproportion des parties individuelles, exemples peu convaincants, répétitions.
Chaque discours a sa préparation spécifique, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de principes généraux pour travailler sur le texte du discours.
Support informationnel pour le discours
Vous devez réfléchir à l'avance aux chiffres que vous donnerez. Le discours ne doit pas contenir beaucoup de matériel numérique, car un grand nombre de chiffres fatigue les auditeurs et obscurcit l'essentiel. Les chiffres doivent être compréhensibles et basés sur une connaissance réelle du public. Par exemple, les données numériques sur les rendements agricoles, les rendements laitiers, la quantité de ressources énergétiques produites ou consommées, les records sportifs, etc. sont difficiles à comprendre ou totalement incompréhensibles pour un large public. Comme il est rare que l'on puisse savoir quel est le rendement, par exemple, du seigle ou de l'orge en Russie centrale, etc., de tels indicateurs devraient être donnés en comparaison. Dans un public composé de spécialistes, il peut y avoir davantage de matériel numérique. Les connaissances de base d'un spécialiste lui permettent d'assimiler cette matière plus rapidement et plus facilement.
Dans certains cas, les chiffres doivent être arrondis ; de cette façon, ils sont mieux perçus et mémorisés (la population de Nijni Novgorod compte près de 500 000 personnes). Mais il n’est pas souhaitable d’arrondir le nombre de victimes et le montant des dommages causés ; Ici, les arrondis peuvent susciter un sentiment de méfiance chez les auditeurs.
Lors de la préparation du texte d'un discours, un domaine de travail distinct et indépendant consiste à travailler avec des citations. Le but du devis peut varier. Certaines citations sont conçues pour les émotions ; d'autres font appel à la conscience, convainquent avec les éléments factuels donnés, d'autres s'appuient sur l'autorité de la source.
Contact avec le public
Le contact constant avec le public est le problème clé de la prise de parole en public. S'il n'y a pas de contact avec le public, soit le discours lui-même perd son sens dans son ensemble, soit son efficacité diminue fortement. Le travail de maintien du contact est multiforme et réalisé simultanément dans plusieurs directions.
Pour une communication réussie avec le public et un contact constant, il est très important d'introduire des éléments de dialogue dans vos discours. Le dialogue est la principale forme de communication du discours. C'est le dialogue qui représente la forme originelle et primaire d'existence du langage, correspondant à la nature même de la pensée humaine, qui est de nature dialogique. Tout mot prononcé ou voulu représente une réaction à la parole de quelqu'un d'autre.
Vous devez penser au contact avec le public lors de la préparation du texte de votre discours. Il existe des actions vocales spéciales dont le but est d'établir et de maintenir le contact. Ceux-ci incluent : adresse, salutation, compliment, adieu. Des variantes de ces actions vocales sont bien développées et sont données dans des manuels sur l'étiquette de la parole. Vous devez choisir plusieurs options pour chacune de ces actions et bien les maîtriser en termes d'intonation et de style. Il est possible de commencer un discours sans salutation ni discours uniquement lors d'une réunion purement professionnelle dans un cercle restreint de spécialistes, avec lesquels les réunions sont assez fréquentes. Les appels peuvent et doivent être utilisés dans la partie centrale du discours ; ils activent l'attention des auditeurs.
Les structures métatextuelles jouent un rôle très important dans le maintien du contact. Le métatexte est constitué des mots et des phrases de votre discours dans lesquels vous parlez de la façon dont il est construit, de quoi et dans quel ordre vous allez parler ou écrire, c'est-à-dire le métatexte est un texte sur du texte. La conception métatextuelle d’un discours peut être assimilée au marquage de la chaussée et à la mise en place de panneaux le long de la route indiquant les virages, les pentes et les endroits difficiles. Un bon orateur désigne toujours des parties de son discours par des constructions métatextuelles : au début de mon discours, je voudrais attirer votre attention sur... ; Répétons-le, encore une fois... ; Passons maintenant à la question de... ; Premièrement...; Deuxièmement...; Troisièmement...; En conclusion, je voudrais dire que... etc.
Caractéristiques syntaxiques
Le discours oral étant irréversible, l’orateur doit constamment veiller à ce que son discours soit facilement compris par les auditeurs du premier coup. Il est de la responsabilité de l'orateur de minimiser les difficultés de compréhension de la parole. Dans ce cas, vous devez tout d’abord garder à l’esprit certains paramètres syntaxiques du texte.
Les phrases simples et les parties de phrases complexes ne doivent pas être excessivement longues. La limite de la RAM est limitée par la longueur d'une chaîne verbale composée de 5 à 7 mots.
Les types de constructions qui tendent vers la sphère du discours familier sont plus facilement perçus. En structure, ces constructions sont des phrases peu courantes et moins courantes, en une partie (définitivement personnelles, indéfiniment personnelles, personnelles généralisées, impersonnelles, dénominatives), incomplètes, simples. Ces constructions peuvent être soit des phrases indépendantes, soit des parties de phrases complexes.
Il n'est pas souhaitable d'utiliser des constructions vocales passives. Leur sphère naturelle de fonctionnement est le style commercial officiel, des textes conçus principalement pour la transmission et la préservation de l'information, et non pour avoir un impact.
Caractéristiques lexicales
La perception de la parole est considérablement compliquée par l'utilisation de noms verbaux se terminant par =nie, =tie, ainsi que d'autres noms similaires. Tout nom verbal est une phrase effondrée ; c'est, pour ainsi dire, un ensemble de sens qui nécessite un déploiement et une prise de conscience. Par conséquent, un texte contenant un grand nombre de noms verbaux est, en règle générale, impropre à la prise de parole en public.
Lors de la préparation d'un discours, il ne faut pas abuser de l'utilisation des termes : ne surchargez pas le texte de terminologie et n'utilisez pas de termes hautement spécialisés.
Logique, éthique, esthétique de la parole
Règles de construction du discours oratoire
Les aspects logiques de la parole ont été étudiés et développés de manière assez approfondie et peuvent être trouvés dans la littérature spécialisée. Voici quelques conseils pratiques à retenir et à suivre lorsque vous parlez :
Soyez cohérent dans votre discours. Ne passez pas au point suivant de votre discours tant que vous n’avez pas terminé le précédent. Le retour répété au non-dit produit une impression extrêmement défavorable.
Commencez votre discours par les dispositions les plus significatives, en laissant pour la fin les dispositions particulières et secondaires.
Ne perdez pas de temps sur des choses qui ne sont pas nécessaires et dont vous pouvez vous passer dans votre performance.
Ne vous répétez pas. Si vous estimez nécessaire de répéter ce qui a été dit, veuillez le préciser. Expliquez clairement qu'il s'agit d'une répétition intentionnelle.
Ne vous éloignez pas du sujet discuté ; ne vous laissez pas distraire par des problèmes, des faits, des informations, des exemples, etc. superflus qui ont peu d'importance pour l'essence du sujet.
A la fin du discours, résumez ce qui a été dit et tirez des conclusions.
Lois logiques
Lors de la préparation d'un discours, vous devez prendre en compte les lois fondamentales de la logique.
Loi de l'identité. Chaque pensée en cours de raisonnement doit être identique à elle-même. Cette loi exige que dans un discours, une pensée donnée sur un objet ou un événement ait un certain contenu stable, peu importe le nombre de fois et la forme sous laquelle elle est renvoyée.
Loi de non-contradiction. Deux propositions incompatibles ne peuvent pas être vraies en même temps : au moins l’une d’elles est nécessairement fausse.
Loi du tiers exclu. Une affirmation et sa négation ne peuvent pas être à la fois vraies et fausses : l’une est nécessairement vraie, l’autre est nécessairement fausse. Si dans un discours une position est formulée sous la forme d'un énoncé, puis sa négation, alors l'une de ces affirmations sera vraie et l'autre sera fausse.
Loi de la raison suffisante. Toute pensée est reconnue comme vraie si elle repose sur un fondement suffisant. Puisque nos jugements et nos déclarations peuvent être vrais ou faux, alors, lorsque nous affirmons la vérité d’une déclaration, nous devons fournir une justification à cette vérité.
Sur la base de lois logiques, de nature formelle, fixant l'exactitude formelle de diverses opérations intellectuelles dans leur forme pure, des règles, recommandations, instructions spécifiques sont formées qui prévoient l'obtention d'un résultat nécessaire très spécifique dans l'activité pratique.
Éthique de la prise de parole en public
L'attitude de l'orateur envers le public doit être absolument amicale et professionnelle.
La bonne volonté présuppose l'impossibilité de comportements verbaux tels que l'agressivité dans ses diverses manifestations (reproches, menaces, insultes) et la démagogie (mensonges).
Une attitude professionnelle envers le public présuppose la capacité de travailler avec n'importe quel public : un public amical, un public agressif et un public qui exprime son indifférence à l'égard de l'orateur.
Notons quelques erreurs typiques que commettent les locuteurs (même contre leur gré).
Vous ne devez pas dépeindre ou présenter comme stupides, malhonnêtes, incohérentes ou faibles les personnes dont vous contestez les opinions.
Faire appel aux sentiments du public ne doit pas se transformer en manipulation du public.
Il ne faut pas identifier les opinions d’une personne avec celles du groupe ou du parti auquel elle appartient.
Vous ne pouvez pas déformer les opinions des opposants avec lesquels vous polémiquez ou sur lesquels vous vous appuyez. Un soin particulier doit être apporté lors du traitement des devis.
N'affichez pas vos qualités personnelles, n'exagérez pas votre rôle dans des événements, des activités communes, etc.
Après avoir exprimé les points de départ de votre point de vue, de votre concept, défendez-les, justifiez-les, prouvez-les.
Pendant le discours, vous ne pouvez pas abandonner les thèses originales (exprimées ou tacites), en prétendant que vous « n'avez jamais pensé de cette façon ». Vous perdrez confiance.
N'exagérez pas au-delà du bon sens les résultats négatifs des actions réelles ou possibles de vos adversaires, des événements, etc. L'aggravation des conséquences indésirables doit être justifiée.
Vous ne devriez pas exiger que votre concept soit accepté comme correct simplement parce que vous pensez que votre argumentation est convaincante.
Conclusion
Après avoir analysé la structure du discours, nous pouvons conclure qu'un discours bon et efficace fait partie intégrante en termes d'intonation rythmique et en termes éthiques. Mais sans connaissance des règles de construction d'un discours public, l'efficacité pour influencer le public diminue rapidement. Nous ne devons pas non plus oublier les caractéristiques lexicales et syntaxiques, qui aident également à construire votre discours de manière compétente, correcte et professionnelle.
Ainsi, lors de la préparation d'un discours, nous devons veiller à un développement convaincant et significatif du sujet et à son bon support informationnel. Le format du discours doit assurer un contact constant avec le public et contribuer à l'assimilation rapide et fiable du contenu.
Ainsi, l'oratoire doit être structuré logiquement, l'auteur n'a pas le droit de violer les normes éthiques de comportement de parole acceptées dans ce groupe. L’utilisation de moyens expressifs embellit le discours, renforce son impact sur les auditeurs et aide à exprimer de manière plus précise et plus vivante l’attitude de l’auteur face au problème posé.
Bibliographie
Golovine B.N. Fondements de la culture de la parole. M., 1988
Nojine E.A. Compétences en présentation orale. M., 1989
Langue russe et culture de la parole. Éd. prof. V.I. Maksimova. M. : Gardariki, 2000.
Soper P. Fondamentaux de l'art de la parole. M., 1992
Frans H., Van Eemeren, Rob Groostendorst. Argumentation, communication et erreurs. Saint-Pétersbourg, 1992