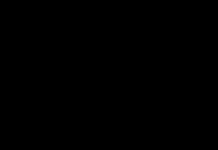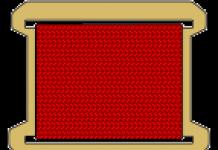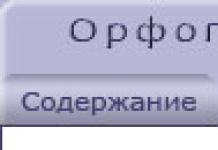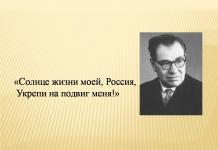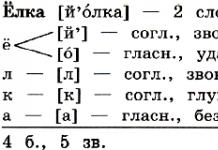Il existe un mythe sur le héros Jason, le chef des Argonautes. Il était le roi héréditaire de la ville d'Iolka dans le nord de la Grèce, mais le pouvoir dans la ville fut pris par son parent aîné, le puissant Pélias, et pour le restituer, Jason dut accomplir un exploit : avec ses amis guerriers sur le navire "Argo" pour naviguer jusqu'à l'extrémité orientale de la terre et là, dans le pays de Colchide, obtenir la toison d'or sacrée, gardée par un dragon. Apollonius de Rhodes écrivit plus tard le poème « Argonautica » sur ce voyage.
Un puissant roi, le fils du Soleil, régnait en Colchide ; Sa fille, la princesse sorcière Médée, est tombée amoureuse de Jason, ils se sont juré allégeance et elle l'a sauvé. Tout d'abord, elle lui a donné des médicaments de sorcellerie, qui l'ont d'abord aidé à résister à l'épreuve - labourer des terres arables sur des taureaux cracheurs de feu - puis à endormir le dragon gardien. Deuxièmement, lorsqu'ils quittèrent la Colchide, Médée, par amour pour son mari, tua son frère et dispersa des morceaux de son corps le long du rivage ; Les Colchidiens qui les poursuivaient tardèrent à l'enterrer et ne purent rattraper les fugitifs. Troisièmement, à leur retour à Iolcus, Médée, afin de sauver Jason de la trahison de Pélias, invita les filles de Pélias à massacrer leur vieux père, promettant de le ressusciter ensuite comme un jeune homme. Et ils tuèrent leur père, mais Médée refusa sa promesse, et les filles parricide s'enfuirent en exil. Cependant, Jason ne parvint pas à obtenir le royaume de Iolk : le peuple se rebella contre la sorcière étrangère et Jason, Médée et leurs deux jeunes fils s'enfuirent à Corinthe. Le vieux roi corinthien, après y avoir regardé de plus près, lui offrit sa fille comme épouse et le royaume avec elle, mais, bien sûr, pour qu'il divorce de la sorcière. Jason accepta l'offre : peut-être commençait-il lui-même déjà à avoir peur de Médée. Il célébra un nouveau mariage et le roi envoya à Médée l'ordre de quitter Corinthe. Sur un char solaire tiré par des dragons, elle s'enfuit à Athènes et dit à ses enfants : « Offrez à votre belle-mère mon cadeau de mariage : un manteau brodé et un bandeau tressé en or. » Le manteau et le bandage étaient saturés d'un poison ardent : les flammes engloutirent la jeune princesse, le vieux roi et le palais royal. Les enfants se précipitèrent pour chercher le salut dans le temple, mais les Corinthiens, furieux, les lapidèrent. Personne ne savait exactement ce qui était arrivé à Jason.
Il était difficile pour les Corinthiens de vivre avec la mauvaise réputation de meurtriers d’enfants et de méchants. C’est pourquoi, selon la légende, ils ont supplié le poète athénien Euripide de montrer dans la tragédie que ce ne sont pas eux qui ont tué les enfants de Jason, mais Médée elle-même, leur propre mère. Il était difficile de croire à une telle horreur, mais Euripide nous le faisait croire.
"Oh, si seulement ces pins d'où le navire sur lequel Jason naviguait ne s'étaient jamais effondrés..." - la tragédie commence. C'est ce que dit la vieille nourrice de Médée. Sa maîtresse vient d'apprendre que Jason épouse la princesse, mais ne sait pas encore que le roi lui ordonne de quitter Corinthe. Les gémissements de Médée se font entendre derrière la scène : elle maudit Jason, elle-même et les enfants. « Prenez soin des enfants », dit l'infirmière au vieux professeur. Le chœur des femmes corinthiennes est alarmé : Médée n'aurait-elle pas provoqué de pires ennuis ! « La fierté et la passion royales sont terribles ! monde meilleur et mesurer."
Les gémissements ont cessé, Médée sort au chœur, elle parle avec fermeté et courage. « Mon mari était tout pour moi, je n'ai plus rien. Ô misérable femme ! Ils la confient à quelqu'un d'autre, lui versent une dot, lui achètent un maître ; Cela lui fait mal d'accoucher, comme dans une bataille, et partir est une honte. Vous êtes ici, vous n’êtes pas seul, mais je suis seul. Le vieux roi corinthien sort à sa rencontre : aussitôt, devant tout le monde, que la sorcière s'exile ! "Toi! Difficile d'en savoir plus que les autres :
C’est pour cela qu’il y a la peur, c’est pour ça qu’il y a la haine.
XII. EURIPIDE
1. Biographie.
Euripide (vers 480-406 avant JC), l'un des plus grands dramaturges, était un jeune contemporain d'Eschyle et de Sophocle. Il est né sur l'île de Salamine. Les informations biographiques sur Euripide sont rares et contradictoires. Aristophane, dans sa comédie « Les femmes à la fête des Thesmosphories », dit que la mère d'Euripide était marchande de légumes, mais le biographe ultérieur Philochore le nie. Il ne fait aucun doute que la famille d’Euripide en avait les moyens et que le grand tragédien a donc pu recevoir une bonne éducation : il a étudié avec le philosophe Anaxagoras et le sophiste Protagoras, l’écrivain romain Aulus Gellius en parle (« Nuits mansardées »). En 408, Euripide, à l'invitation du roi Archelaus, s'installe en Macédoine, où il meurt.
Euripide a commencé à l'apogée de la polis athénienne, mais la plupart de son activité a eu lieu déjà dans les années de déclin de cette république esclavagiste. Il a été témoin de la longue et épuisante guerre du Péloponnèse pour Athènes, qui a duré de 431 à 404 avant JC. Cette guerre fut également agressive tant de la part d'Athènes que de la part de Sparte, mais il faut quand même noter la différence dans les positions politiques de ces deux politiques : Athènes, en tant qu'État esclavagiste démocratique, a introduit les principes de la démocratie esclavagiste dans les régions conquises pendant la guerre, et Sparte imposa partout une oligarchie. Euripide, contrairement à Eschyle et Sophocle, n’occupait aucune fonction publique. Il a servi sa patrie avec sa créativité. Il a écrit plus de 90 tragédies, dont 17 nous sont parvenues (la 18e tragédie « Rhéa » est attribuée à Euripide). De plus, un drame satyrique d'Euripide, « Cyclope », nous est parvenu, et de nombreux fragments de ses tragédies ont survécu.
La plupart des tragédies d'Euripide ne doivent être datées qu'approximativement, car il n'existe pas de données exactes sur l'époque de leur production. La séquence chronologique de ses tragédies est la suivante : « Alcès-ta » - 438, « Médée » - 431, « Hippolyte » - 428, « Héraclide » - env. 427, "Hercule", "Hécube" et "Andromaque" - ca. 423-421, « Pétitionnaires » - probablement 416, « Ion », « Femmes troyennes » - 415, « Electre », « Iphigénie en Tauride » - ca. 413, "Hélène" - 412, "Femmes Phéniciennes" - 410 - 408, "Oreste" - 408, "Les Bacchantes" et "Iphigénie à Aulis" ont été mises en scène après la mort d'Euripide.
3. Critique de la mythologie.
Euripide est extrêmement radical dans ses vues, s'alignant sur les philosophes naturels et les sophistes grecs en ce qui concerne leur critique de la mythologie traditionnelle. Par exemple, il croit qu'au début il y avait une masse matérielle commune indivise, puis elle a été divisée en éther (ciel) et terre, puis sont apparues des plantes, des animaux et des personnes (fragment 484).
Son attitude critique envers la mythologie comme base de la religion populaire grecque est connue. Il reconnaît une sorte d'entité divine qui contrôle le monde. Ce n'est pas sans raison que le comédien Aristophane, contemporain d'Euripide, qui considère ce tragédien comme le destructeur de toutes les traditions populaires, se moque de lui avec colère et, dans la comédie « Grenouilles », dit par la bouche de Dionysos que ses dieux « ont leurs propres dieux ». monnaie spéciale » (885-894).
Euripide représente presque toujours les dieux dès le début. aspects négatifs, comme s'il voulait inculquer au public la méfiance à l'égard des croyances traditionnelles. Ainsi, dans la tragédie "Hercule", Zeus apparaît maléfique, capable de déshonorer la famille de quelqu'un d'autre, la déesse Héra, l'épouse de Zeus, est vengeresse, faisant souffrir le célèbre héros grec Hercule uniquement parce qu'il est le fils bâtard de Zeus. Le dieu Apollon se montre cruel et perfide dans la tragédie « Oreste ». C'est lui qui a forcé Oreste à tuer sa mère, puis n'a pas jugé nécessaire de le protéger de la vengeance des Érinyes (cette interprétation diffère fortement de l'interprétation d'Eschyle dans sa trilogie Oresteia). Aussi sans cœur et envieuse qu'Héra, la déesse Aphrodite dans la tragédie "Hippolyte". Elle envie Artémis, que le bel Hippolyte vénère. Par haine pour le jeune homme, Aphrodite allume dans le cœur de sa belle-mère, la reine Phèdre, une passion criminelle pour son beau-fils, grâce à laquelle périssent Phèdre et Hippolyte.
Représentant de manière critique les dieux de la religion populaire, Euripide exprime la question de savoir si de telles images ne sont pas le fruit de l'imagination des poètes. Ainsi, par la bouche d'Hercule, il dit :
De plus, je ne croyais pas et je ne crois pas que Dieu mangerait du fruit défendu, que Dieu aurait des liens dans ses bras, et que Dieu seul commanderait aux autres. Non, la divinité se suffit à elle-même : tout cela n'est qu'une absurdité de chanteurs audacieux 3 . ("Hercule", 1342-1346.)
4. Tendances anti-guerre et démocratie.
Euripide était un patriote de sa ville natale et soulignait inlassablement la supériorité de l'Athènes démocratique sur l'oligarchique Sparte. À plusieurs reprises, Euripide a présenté son peuple comme le défenseur des petits États faibles. Ainsi, utilisant le mythe, il poursuit cette idée dans la tragédie « Héraclide ». Pour les enfants d'Hercule - les Héraclides, qui ont été expulsés de leur ville natale par le roi mycénien Eurysthée, aucun des États, craignant la puissance militaire de Mycènes, ne leur a donné refuge ou ne les a défendus. Seule Athènes protège les offensés, et le souverain athénien Démophon, exprimant la volonté de son peuple, dit à l'envoyé du roi mycénien, qui essayait d'éloigner les enfants des autels athéniens :
Mais si quelque chose M’inquiète, alors c’est l’argument le plus élevé : l’honneur. Après tout, si je permets à un étranger d’arracher de force ceux qui prient de l’autel, alors adieu, liberté athénienne ! Tout le monde dira que par peur d'Argos, j'ai insulté la prière avec Trahison. La Conscience (242-250) est pire qu'un nœud coulant.
Les Athéniens ont vaincu les troupes d'Eurysthée et ont rendu leur ville natale aux Héraclides. A la fin de la tragédie, le chœur chante la gloire d'Athènes. L'idée principale de la tragédie est exprimée par la sommité du chœur, en disant : « Ce n'est pas la première fois que le pays d'Athènes défend la vérité et le malheureux » (330).
La tragédie d'Euripide « Le Pétitionnaire » est aussi patriotique. Il représente les proches des soldats tombés sous les murs de Thèbes lors de la guerre fratricide entre Étéocle et Polynice. Les Thébains ne permettent pas aux familles des assassinés d'emporter les cadavres pour les enterrer. Les proches des soldats morts se tournent alors vers Athènes pour obtenir de l'aide. La conversation entre le roi athénien Thésée et Adraste, messager des proches des soldats morts, est une glorification de l'Athènes démocratique, protectrice des faibles et des opprimés. Le chœur chante :
Aide les mères, aide, ô ville de Pallas, Qu'elles ne piétinent pas les lois communes, Tu observes la justice, étrangère à l'injustice, Tu es le patron de tous, peu importe qui est malhonnêtement offensé (378-381).
Dans le même dialogue, par la bouche de Thésée, sont condamnées les guerres de conquête lancées par les dirigeants en raison de leurs intérêts égoïstes. Thésée dit à Adraste :
Ceux-là aspirent à la gloire, ceux-là gonflent le jeu de la guerre et corrompent les citoyens, Ceux-là visent les commandants, ceux-là le leadership, Leur tempérament est de se faire valoir, et ceux-là sont attirés par le profit - Ils ne pensent pas aux désastres de le peuple (233-237).
Euripide a reflété la haine des Athéniens envers Sparte dans les tragédies « Andromaque » et « Oreste ». Dans la première de ces tragédies, il représente le cruel Ménélas et sa non moins cruelle épouse Hélène et sa fille Hermione, qui ont traîtreusement rompu leur parole et ne se sont pas arrêtés avant de tuer l'enfant Andromaque, né par elle du fils d'Achille Néoptolème, à qui elle fut donnée comme concubine après la chute de Troie. Andromaque envoie des malédictions sur la tête des Spartiates. Pélée, le père d'Achille, maudit également les Spartiates arrogants et cruels. Les tendances anti-spartiates de la tragédie d'Andromaque rencontrèrent une vive réponse dans l'âme des citoyens athéniens ; tout le monde connaissait la cruauté des Spartiates envers les prisonniers et les esclaves hilotes. Euripide met en œuvre les mêmes idées dans la tragédie « Oreste », décrivant les Spartiates comme un peuple cruel et perfide. Ainsi, Tyndar, le père de Clytemnestre, exige l'exécution d'Oreste pour avoir tué sa mère, bien qu'Oreste affirme qu'il a commis ce crime sur ordre du dieu Apollon. Ménélas est pathétique et lâche. Oreste lui rappelle son père Agamemnon, qui, en tant que frère, est venu en aide à Ménélas, est allé avec ses troupes à Troie pour sauver Hélène et, au prix de grands sacrifices, l'a sauvée et a rendu le bonheur perdu à Ménélas. Rappelant son père, Oreste demande maintenant de l'aider à Ménélas, le fils d'Agamemnon, mais Ménélas répond qu'il n'a pas la force de combattre les Argiens et ne peut agir que par ruse. Alors Oreste remarque amèrement :
Rien de tel qu'un roi, mais un lâche sans valeur dans l'âme. Après avoir laissé vos amis dans le pétrin, vous vous enfuyez ! (717-718)
Les tragédies d'Euripide à tendance anti-spartiate sont étroitement liées aux tragédies dans lesquelles l'auteur exprime ses opinions anti-guerre et condamne les guerres de conquête. Il s'agit de la tragédie « Hécube », mise en scène vers 423, et de la tragédie « La Troyenne », mise en scène en 415.
La tragédie "Hécuba" décrit les souffrances de la famille de Priam, qui, avec d'autres prisonniers, après la prise de Troie, les Achéens conduisent en Grèce. La fille d'Hécube, Polyxena, est sacrifiée en l'honneur d'Achille assassiné, et son seul fils survivant, Polydorus, est tué par le roi thrace Polymestor, à qui l'enfant a été envoyé pour le protéger des horreurs de la guerre. Hécube demande humblement à Ulysse de l'aider à sauver sa fille, mais il se montre implacable. Euripide dessinant Polyxène fille fière, qui ne veut pas s'humilier devant les Grecs victorieux et va à la mort :
Que me promet le Caractère de mes futurs maîtres ? Un sauvage, m'ayant acheté, me forcera à moudre du blé, une maison de vengeance... ...Et le jour de torture prendra fin, et l'esclave acheté profanera mon lit... (358-365). Je n'ai rien ni aucune raison de me battre (371). ...La vie deviendra un fardeau pour nous lorsqu'elle ne contient aucune beauté (378).
Comme un grand connaisseur l'âme humaine Euripide représente dernières minutes la vie de Polyxène, allant fièrement vers la mort ; mais il est difficile de mourir dans la fleur de l’âge, et elle, accrochée à sa mère, salue à la fois sa sœur Cassandra, devenue la concubine d’Agamemnon, et son petit frère Polydor. Polyxena meurt en héroïne. Ses derniers mots furent :
Vous, fils d'Argos, avez détruit ma ville ! Je meurs de ma propre volonté. Que personne ne me retienne... ...Mais laisse-moi mourir Libre, j'en conjure les dieux. Comme si j'étais libre. Il est honteux que la princesse descende comme esclave de l'ombre (545-552).
La tragédie "Hécuba" est d'humeur pessimiste, l'auteur semble vouloir dire que la vie humaine est dure, l'injustice, la violence, le pouvoir de l'or règnent partout - telle est la loi de la vie et telle derniers mots tragédie : « la nécessité est inexorable ».
La tragédie des « Troyennes » est proche de cette tragédie dans ses tendances anti-guerre et même dans son intrigue. Il décrit également les souffrances des femmes troyennes captives, parmi lesquelles se trouvent des femmes de la famille du roi Priam.
Cette tragédie, comme la tragédie « Hécube », dépeint la guerre des Grecs contre les Troyens, contrairement à l'interprétation mythologique habituelle, glorifiant les exploits des Achéens. "Les Troyennes" dépeint les souffrances insensées des femmes et des enfants après la chute de Troie.
Un messager des Grecs victorieux informe la famille de Priam que l'épouse du roi Hécube sera l'esclave d'Ulysse, que sa fille aînée Cassandra deviendra la concubine d'Agamemnon, que la jeune Polyxène sera sacrifiée sur la tombe d'Achille, que l'épouse d'Hector Andromaque sera donnée en guise de cadeau. concubine du fils d'Achille, Néoptolème.
Andromaque est enlevée à son bébé Hector, bien qu'elle supplie de le lui laisser, puisque l'enfant n'est coupable de rien devant les Grecs. Les vainqueurs tuent l'enfant en le jetant du mur, et le cadavre est amené à sa grand-mère, Hécube, affolée de souffrance.
Une malheureuse vieille femme, qui a perdu sa patrie et tous ses proches, crie sur le cadavre de son petit-fils :
Le sang coule d'un crâne écrasé... Je garderai le silence sur le pire... Ô mains, Exactement comme celles de mon père ! Les articulations sont toutes écrasées... Ô douce bouche... (1177-1180). ...Qu'écrira le poète sur votre pierre tombale ? « Ce garçon a été tué par les Argiens par peur » - un vers honteux pour la Hellas (1189-1191).
Dans de nombreuses tragédies où l'idée de patriotisme est mise en œuvre, Euripide représente des héros sacrifiant leur vie pour le bien de leur patrie. Ainsi, dans la tragédie « Héraclide », la fille d'Hercule, la jeune Macaria, se sacrifie, sauvant sa ville natale ainsi que ses frères et sœurs.
Dans la tragédie « Les Phéniciennes » (mise en scène entre 410 et 408), le fils de Créon, le jeune homme Ménécée, sacrifie sa vie pour la victoire de sa patrie sur ses ennemis. Le père persuade son fils de ne pas entreprendre un tel exploit, mais d'aller quelque part au loin, au-delà des frontières de son pays natal. Menekey fait semblant d'être d'accord avec la volonté de son père, mais dans son âme, il est déjà fermement décidé à donner sa vie pour sauver sa patrie.
Euripide a eu du mal à vivre tout le déroulement de la guerre du Péloponnèse, les privations et les défaites militaires de ses concitoyens. Il a vu que les principes du système de polis démocratique s'effondraient, que des privilégiés accédaient à la tête de l'État. groupes sociaux, les riches, les hommes d’argent, les propriétaires de terres et d’entreprises. C'est pourquoi le dramaturge, dans ses tragédies, défend avec tant de passion les principes de la démocratie athénienne et dénonce la tyrannie. Il considérait que la base de la démocratie athénienne était constituée de groupes sociaux moyens, c'est-à-dire de petits travailleurs libres, paysans et artisans. Dans la tragédie « Le Pétitionnaire », son personnage principal Thésée, un représentant des vues d'Euripide lui-même, dit :
Il existe trois sortes de citoyens : les uns sont riches et inutiles, tout ne leur suffit jamais, les autres sont pauvres, dans un besoin perpétuel. Ils sont redoutables, ils sont rongés par l'envie et, dans leur colère, ils piquent avec précision les riches. Ils sont désorientés par les mauvaises langues des fauteurs de troubles. Le troisième type est celui du milieu, le soutien de l'État et la protection de la Loi en son sein... (238-246).
Aristote partageait également les mêmes vues (Politique, VI, 9).
Euripide a représenté les petits travailleurs libres et profondément sympathiques, en particulier les travailleurs de la terre. Le vieux fermier honnête de la tragédie "Electre", à qui la reine Clytemnestre épouse sa fille afin de la retirer du palais, parce qu'elle a peur de la vengeance de sa fille pour son père assassiné, a compris le plan de l'insidieuse Clytemnestre, considère son mariage fictif, protège l'honneur d'Électre et la traite comme sa fille. Le paysan est gentil et travailleur, dit-il : « Oui, celui qui est paresseux, que les paroles de prière ne quittent jamais ses lèvres, mais qu'il ne ramasse pas de pain » (81).
La même image d'un agriculteur honnête, gardien des principes démocratiques d'Athènes, est donnée dans la tragédie « Oreste ». Lui seul prit la défense d'Oreste à assemblée populaire, exigeant la clémence envers ce jeune homme, puisque le meurtre de Clytemnestre a été commis par lui sur ordre du dieu Apollon. Voici comment Euripide caractérise ce citoyen cher à son cœur :
Voici l'orateur - non pas un bel homme, mais un homme fort ; Ce n'est pas souvent qu'il laisse une empreinte sur la place d'Argive, Il laboure sa terre - sur de telles personnes Maintenant le pays repose. Il n'est pas pauvre d'esprit, car il y a parfois une chance de se mesurer lors d'une compétition verbale. Et dans la vie, c'est un mari impeccable (917-924).
5. Drames sociaux et quotidiens.
Les tragédies d'Euripide doivent être divisées en deux groupes : d'une part, les tragédies au sens plein du terme, et de l'autre, les drames sociaux et quotidiens, qui représentent non pas des héros remarquables par leurs pensées et leurs actes, mais des gens ordinaires. . Ces drames introduiront un élément comique, que la tragédie antique classique ne permettait pas du tout, et une fin heureuse, qui contredit également le canon du genre tragique. Il s'agit par exemple de pièces de théâtre telles que « Alceste », « Elena », « Ion ».
a) "Alceste".
"Alceste" a été mis en scène en 438 ; des œuvres d'Euripide qui nous sont parvenues, celle-ci est la plus ancienne. Le héros du drame est le roi de Thessalie Admet, à qui les dieux ont promis que sa vie pourrait être prolongée si quelqu'un acceptait volontairement de mourir pour lui. Lorsqu'Admète tomba gravement malade et fut menacé de mort, aucun de ses proches, même ses parents âgés, ne voulut mourir à sa place, et seule sa jeune épouse, la belle Alceste, accepta un tel sacrifice.
Euripide dépeint avec une grande habileté les dernières minutes de la vie d'Alceste, ses adieux à son mari, ses enfants et ses esclaves. Alceste aime la vie et il lui est difficile de mourir, mais même dans son délire mourant, elle pense au sort de son mari et de ses enfants.
Le mari d'Alcesta, le roi Admète, est un homme ordinaire, pas un héros : un bon père de famille, aime sa femme et ses enfants, est hospitalier envers ses amis, un hôte hospitalier, mais il est égoïste et s'aime par-dessus tout. Admet se maudit d'avoir accepté le sacrifice de sa femme, mais n'est pas capable de se sacrifier, d'exploiter.
Il y a une scène dans la pièce qui convainc vraiment qu'il n'y a qu'un pas du tragique au comique - lorsque le père d'Admet, Feret, apporte une couverture et veut en recouvrir le cadavre du défunt. Admet est indigné par le comportement de son père, qui n'a pas sacrifié sa vie en déclin pour sauver son fils unique, mais reproche au père son égoïsme, et le père, à son tour, gronde son fils pour avoir espéré le sacrifice de soi de la part de ses parents. Le vieil homme accuse son fils de vivre essentiellement aux dépens de sa femme, qui a sacrifié sa jeune vie. Cette querelle entre deux égoïstes est à la fois comique et amère. Euripide l'exprime de manière très vivante à l'aide de phrases courtes, ordinaires et accrocheuses :
Admet (montrant le cadavre d'Alceste) Tu vois là ta culpabilité, mon vieux. Féret Ou est-ce qu'on l'enterre pour moi, dites-vous ? Admet Tu auras besoin de moi aussi, j'espère. Féret Changez plus souvent de femme, vous serez en meilleure santé. Admète Honte à toi. Pourquoi t'es-tu épargné ? Féret Oh, ce flambeau de Dieu est si beau. Admète Et voici le mari ? Une honte entre maris... Féret Je serais la risée de toi si je mourais. Admète Toi aussi tu mourras, mais tu mourras sans gloire. Féret L'infamie n'atteint pas les morts. Admète Un si vieil homme... Et même une ombre de honte... (717 - 727).
Admet et Feret sont des gens ordinaires. Ce n'est pas sans raison qu'Aristote a noté que Sophocle dépeint les gens tels qu'ils devraient être, et Euripide - tels qu'ils sont (Poétique, 25).
Le dramaturge dépeint Hercule non pas dans l'auréole des exploits, mais comme un personnage ordinaire un homme bon qui sait profiter de la vie, capable d'un profond sentiment d'amitié. Euripide raconte comment Hercule, en route vers la Thrace, rend visite à Admète et lui, ne voulant pas contrarier son ami, ne lui parle pas de la mort de sa femme, mais organise une friandise dans l'une des pièces isolées du palais. Hercule s'enivre, chante des chansons fort, et ce comportement scandalise l'esclave qui l'a servi, qui pleure Alceste. Hercule est perplexe et prononce tout un discours dans lequel il raconte sa vie quotidienne qu'il faut vivre, dit-on, pour le plaisir, pour l'amour, pour le plaisir. Mais quand Hercule apprend d'un esclave qu'Alceste est mort, alors pour le bien de son ami, il descend aux Enfers, reprend Alkeste au démon de la mort et la ramène à Admète, affolé de joie.
b) "Hélène".
La pièce « Hélène » d'Euripide, mise en scène en 412, devrait également être incluse dans ce genre de drames sociaux et quotidiens. Il utilise un mythe peu connu selon lequel Pâris n'a pas emmené Hélène avec lui à Troie, mais seulement son fantôme, et la vraie Hélène, par la volonté d'Héra, a été transférée en Égypte au roi Protée. Le fils de ce roi, Théoclymène, veut épouser Hélène, mais celle-ci persiste, voulant rester fidèle à son mari. Après la chute de Troie, Ménélas rentre chez lui en bateau ; une tempête fit naufrage son navire, mais Ménélas, avec plusieurs camarades et le fantôme d'Hélène, s'échappa et fut jeté sur les côtes égyptiennes. Ici, il rencontre accidentellement la vraie Elena à la porte, qui propose un plan d'évasion astucieux. Elle dit à Théoclymène qu'elle deviendra sa femme, mais ne demande qu'une seule faveur : lui permettre, selon la coutume grecque, d'accomplir un rite funéraire en mer en l'honneur du défunt Ménélas. Le roi lui donne un bateau et des rameurs, puis Elena en robe de deuil monte dans le bateau, et les rameurs entrent, dont Ménélas et ses camarades, tous vêtus de vêtements égyptiens. Alors que le bateau était déjà loin du rivage, Ménélas et ses amis tuèrent les rameurs égyptiens, jetèrent leurs cadavres par-dessus bord et, les voiles levées, se dirigèrent vers les côtes de la Hellas.
Encore une fois, nous n'avons pas devant nous une tragédie grecque classique, mais un drame quotidien avec une fin heureuse, avec des rebondissements de nature aventureuse, avec l'idée de glorifier l'amour conjugal fidèle. L'Hélène de ce drame n'est pas du tout celle représentée dans les tragédies "Andromaque", "La Troyenne" et "Oreste", où elle nous apparaît comme une beauté narcissique, trompant son mari et se jetant dans les bras. de Paris. Cette image est également loin de l'image homérique de la belle Hélène, emmenée de force par Paris à Troie, languissant loin de sa patrie, mais ne faisant aucune démarche pour retourner dans sa famille.
c) "Ions".
En termes de drame social et quotidien, Euripide a également créé la pièce « Ion ». Il représente le fils d'Apollon, Ion, né de Creusa, victime de ce dieu. Pour cacher sa honte, Creusa jette l'enfant dans le temple. Par la suite, elle épouse le roi athénien Xuthus et, par hasard, grâce aux couches conservées dans lesquelles l'enfant était autrefois jeté, retrouve son fils, déjà devenu un jeune homme. L'intrigue d'un enfant abandonné deviendra plus tard, à l'époque hellénistique, la plus populaire parmi les comédiens grecs, qui croyaient généralement qu'ils « sortaient des drames d'Euripide », car en termes de contenu idéologique, dans la représentation des personnages, dans leur composition, les comédies hellénistiques sont sans doute très proches des drames sociaux et quotidiens d'Euripide. Dans les drames d'Euripide, l'une des forces directrices les plus importantes n'est plus le destin, mais le hasard qui arrive à une personne. Comme on le sait, le rôle du hasard sera particulièrement important dans la littérature hellénistique.
6. Tragédie psychologique.
Parmi les œuvres d’Euripide, se distinguent les célèbres tragédies à orientation psychologique prononcée, en raison du grand intérêt du dramaturge pour la personnalité humaine avec toutes ses contradictions et ses passions.
a) "Médée"
L'une des tragédies les plus remarquables d'Euripide, Médée, a été mise en scène sur la scène athénienne en 431. La sorcière Médée est la fille du roi Colchide, la petite-fille du Soleil, tombée amoureuse de Jason, l'un des Argonautes venus en Colchide pour la Toison d'Or. Pour le bien de son bien-aimé, elle a quitté sa famille, sa patrie, l'a aidé à prendre possession de la Toison d'Or, a commis un crime et l'a accompagné en Grèce. À sa grande horreur, Médée apprend que Jason veut la quitter et épouser la princesse, héritière du trône corinthien. C'est particulièrement difficile pour elle car elle est une « barbare » et vit dans un pays étranger, où il n'y a ni parents ni amis. Médée est indignée par les astucieux arguments sophistiques de son mari, qui tente de la convaincre qu'il épouse la princesse pour le bien de leurs petits-fils, qui seront des princes, héritiers du royaume. Une femme offensée comprend que la force motrice derrière les actions de son mari est le désir de richesse et de pouvoir. Médée veut se venger de Jason, qui a impitoyablement gâché sa vie, et détruit sa rivale en lui envoyant une tenue empoisonnée avec ses enfants. Elle décide de tuer les enfants, pour le bonheur desquels, selon Jason, il contracte un nouveau mariage.
Médée, contrairement aux normes de l'éthique de la polis, commet un crime, croyant qu'une personne peut agir selon ses aspirations et ses passions personnelles. Il s’agit là d’une sorte de réfraction dans la pratique quotidienne de la théorie sophistique selon laquelle « l’homme est la mesure de toutes choses », théorie sans doute condamnée par Euripide. En tant que psychologue profond, Euripide ne pouvait s'empêcher de montrer la tempête de tourments dans l'âme de Médée, qui envisageait de tuer les enfants. Deux sentiments s'affrontent en elle : la jalousie et l'amour pour les enfants, la passion et le sens du devoir envers les enfants. La jalousie la pousse à décider : tuer les enfants et ainsi se venger de son mari ; l'amour pour les enfants l'oblige à abandonner la terrible décision et à élaborer un plan différent : fuir Corinthe avec les enfants. Cette lutte douloureuse entre le devoir et la passion, représentée avec beaucoup d'habileté par Euripide, est le point culminant de tout le chœur de la tragédie. Médée caresse les enfants. Elle décide de les laisser vivre et de s’exiler :
Étranger pour toi, je vais prolonger mes journées. Et plus jamais, ayant remplacé la vie par une autre, tu ne verras plus moi qui t'ai porté... Avec ces yeux. Hélas! Hélas! Pourquoi me regardes-tu et ris-tu de ton dernier rire ?.. (1036-1041).
Mais les mots involontairement échappés « avec le dernier rire » expriment une autre décision terrible, qui a déjà mûri dans les recoins de son âme : tuer les enfants. Cependant, Médée, touchée par leur apparence, tente de se convaincre d'abandonner l'intention terrible dictée par une jalousie insensée, mais la jalousie et l'orgueil offensé prennent le pas sur les sentiments maternels. Et une minute plus tard, nous revoyons la mère, se persuadant d'abandonner son projet. Et puis la pensée destructrice du besoin de se venger de son mari, encore une fois une tempête de jalousie et décision finale tuer des enfants...
Je jure donc par Hadès et toute la puissance d'en bas, Que les ennemis de mes enfants, abandonnés par Médée à la moquerie, ne seront pas vus... (1059-1963).
La malheureuse mère caresse ses enfants pour la dernière fois, mais comprend que le meurtre est inévitable :
Oh douce étreinte, Ta joue est si tendre, et ta bouche Un souffle joyeux... Va-t'en... Va-t'en vite... Il n'y a pas de force pour te regarder... Je suis écrasé par le tourment... Quoi J'ose le faire, je vois... Seulement la colère Plus forte que moi, et pour la race mortelle il n'y a pas de bourreau plus féroce et plus zélé (1074-1080).
Euripide révèle l'âme d'un homme tourmenté lutte interne entre devoir et passion. Montrant ce conflit tragique sans embellir la réalité, le dramaturge arrive à la conclusion que la passion prend souvent le pas sur le devoir, détruisant la personnalité humaine.
b) Par l'idée, la dynamique et le caractère du personnage principal, la tragédie « Hippolyte », mise en scène en 428, est proche de la tragédie « Médée ». La jeune reine athénienne, Phèdre, épouse de Thésée, tomba passionnément amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Elle comprend que son devoir est d'être une épouse fidèle et une mère honnête, mais elle ne peut pas arracher la passion criminelle de son cœur. L’infirmière demande à Phèdre son secret et raconte à Hippolyte l’amour de Phèdre pour lui. Le jeune homme, en colère, marque sa belle-mère et envoie des malédictions sur la tête de toutes les femmes, les considérant comme la cause du mal et de la dépravation dans le monde.
Offensée par les accusations imméritées d'Hippolyte, Phèdre se suicide, mais pour sauver son nom de la honte et en protéger également ses enfants, elle laisse à son mari une lettre dans laquelle elle accuse Hippolyte d'avoir violé son honneur. Thésée, après avoir lu la lettre, maudit son fils, et il meurt bientôt : le dieu Poséidon, accomplissant la volonté de Thésée, envoie un taureau monstrueux, d'où les chevaux du jeune homme se précipitèrent avec horreur, et il s'écrasa contre les rochers. La déesse Artémis révèle à Thésée le secret de son épouse. Dans cette tragédie, comme dans la tragédie "Médée", Euripide révèle magistralement la psychologie de l'âme tourmentée de Phèdre, qui se méprise pour sa passion criminelle pour son beau-fils, mais en même temps ne pense qu'à sa bien-aimée, rêve inlassablement de rencontrer et l'intimité avec lui.
Les deux tragédies sont de composition similaire : le prologue explique la raison de la situation actuelle, puis les héroïnes sont montrées en proie à un conflit douloureux entre devoir et passion ; toute la tragédie est construite sur cette haute tension, révélant avec réalisme les secrets de l'histoire. âmes des héroïnes. Mais l'issue des tragédies est mythologique : Médée sera sauvée par son grand-père, le dieu Hélios, et elle s'envole avec les cadavres des enfants assassinés dans son char. La déesse Artémis apparaît à Thésée et lui rapporte que son fils est innocent de tout, qu'il a été calomnié par Phèdre. De telles fins, où le nœud du conflit est résolu avec l'aide des dieux, contredisant parfois tout le déroulement logique des tragédies, sont généralement appelées dans la pratique du théâtre antique yeis ex tasin, caractéristique d'Euripide, maître du complexe et déroutant. situations.
7. Interprétation particulière du mythe.
Euripide dans ses tragédies modifie souvent les vieux mythes, n'en laissant essentiellement que les noms des héros. Le grand tragédien, utilisant des intrigues mythologiques, y exprime les pensées et les sentiments de ses contemporains et pose des questions urgentes de son temps. Il modernise, pour ainsi dire, le mythe. Et c’est là la grande différence entre Euripide, Eschyle et Sophocle. La différence dans le système artistique des dramaturges est particulièrement visible lorsqu'on compare la tragédie d'Euripide "Electre" avec la tragédie du même nom de Sophocle et avec la tragédie d'Eschyle "Choéphora", qui est la deuxième partie de sa trilogie "Orestie". ". L'intrigue y est la même : le meurtre de Clytemnestre par ses enfants Oreste et Electre pour se venger de leur père assassiné.
Chez Eschyle, les deux héros, Oreste et Electre, sont encore complètement à la merci des principes religieux ; ils exécutent l'ordre d'Apollon de tuer leur mère parce qu'elle a tué leur père, son mari, le chef de la famille et de l'État, violant ainsi la priorité du principe paternel.
Eschyle a toujours un grand respect pour le mythe : pour lui, les dieux décident en grande partie du sort des hommes. Chez Sophocle, Électre et Oreste sont aussi des champions des lois données par les dieux, tandis que chez Euripide, ils sont simplement des enfants malheureux abandonnés par leur mère pour le bien de son amant Égisthe. Voulant renforcer sa position, Clytemnestre épouse délibérément Electre avec un vieux et pauvre fermier, afin de ne pas avoir de prétendants au trône de la part de sa fille. Oreste et Electre tuent leur mère parce qu'elle les a privés de la joie de vivre et de leur père.
Toute l'interprétation du meurtre de leur mère par Oreste et Electre dans Euripide se révèle de manière plus vitale, psychologiquement plus profonde.
Dans la tragédie « Électre », Euripide condamne les méthodes par lesquelles Eschyle et Sophocle reconnaissent Electre comme son frère : par une mèche de cheveux d'Oreste, qu'il coupa et déposa sur la tombe de son père, par les empreintes de ses pieds près de cette tombe. . Dans Euripide, lorsque l’oncle Oreste invite Électre à associer à la sienne une mèche de cheveux trouvée sur une tombe, elle, exprimant les propres arguments de l’auteur, se moque de lui.
Et ce volet ? Mais la couleur des cheveux du tsarévitch, qui a grandi dans la palestre, et la couleur délicate des tresses de la jeune fille, chéries avec un peigne, pourraient-elles conserver la ressemblance ? (526-530)
Lorsque le vieil homme invite Electre à comparer l'empreinte sur le sol près de la tombe avec l'empreinte de son pied, la jeune fille dit encore avec moquerie :
Y a-t-il une marque sur la pierre ? Que dis-tu, vieil homme ? Oui, même si sa trace persistait, un frère et une sœur peuvent-ils vraiment avoir des jambes de taille similaire ? (534-537)
Le vieil homme demande à Electre si elle reconnaît peut-être son frère aux vêtements de son travail, dans lesquels Oreste fut autrefois envoyé dans un pays étranger. Euripide en rit aussi, mettant dans la bouche d'Électre les objections sarcastiques suivantes :
Vous délirez ? Mais alors, mon vieux, j'étais un enfant : mon frère va-t-il vraiment mettre cette chlamyde maintenant ? Ou peut-être que nos vêtements grandissent avec nous ? (541-544)
Tout à fait différemment d’Eschyle, Euripide dépeint la scène du meurtre de sa mère par Oreste. Sans hésitation, même avec jubilation, il tue son amant Égisthe, coupable de toutes les souffrances de sa famille, mais il est effrayant et douloureux pour lui de tuer sa mère. Eschyle ne montre que le moment d'hésitation d'Oreste avant de tuer sa mère. Euripide dépeint le terrible tourment d'un fils qui ne peut lever la main contre sa mère, et quand Electre lui reproche sa lâcheté, lui, se couvrant le visage d'un manteau pour ne pas voir sa mère, la frappe avec une épée...
Après le meurtre, Oreste est tourmenté par des remords. Dans la tragédie « Oreste », mise en scène en 408 et qui révèle la même intrigue que la tragédie « Electre », en l'élargissant seulement quelque peu, Oreste malade, à la question : « Quelle maladie tourmente ? - Il répond directement : "Son nom est et les méchants ont une conscience."
Dans la trilogie « Oreste » d'Eschyle, les Érinyes, déesses terribles, défenseures des droits maternels, poursuivent Oreste, tandis que chez Euripide, dans la tragédie « Oreste », c'est un jeune homme malade qui souffre de convulsions, et après le meurtre, pendant le délire, il lui semble seulement que les Erinyes sont partout et veulent sa mort. Et chez Médée, contrairement au mythe, Euripide oblige une mère à tuer ses enfants. Pour Euripide, ce qui est important ici n'est pas la mythologie de la tragédie, mais la proximité des personnages et des situations de vie.
8. « Iphigénie à Aulis » est un exemple de tragédie pathétique.
Les tragédies posthumes d'Euripide étaient les tragédies « Les Bacchantes » avec ses problèmes religieux et psychologiques complexes et « Iphigénie à Aulis ». Tous deux ont été mis en scène lors de la fête de la ville de Denys en 406. Pour la tragédie « Iphigénie à Aulis », l'auteur a reçu le premier prix. "Iphigénie en Aulide" est l'une des tragédies parfaites d'Euripide. Il représente l'armée achéenne prête à naviguer sur des navires d'Aulis à Troie. La déesse Artémis, insultée par Agamemnon, n'envoie pas bon vent. Pour que le vent souffle et que les Grecs atteignent Troie, et donc la conquérir, il faut sacrifier à Artémis la fille aînée d’Agamemnon, Iphigénie. Son père la convoque avec sa mère sous prétexte du mariage de la jeune fille avec Achille, mais la déesse Artémis elle-même sauve Iphigénie et, sans que tout le monde ne la voie, lors du sacrifice, elle l'emmène dans son temple, dans la lointaine Tauris.
Si dans les tragédies d'Euripide « Hécube », « Andromaque », « Femme de Troie », « Electre » et « Oreste », la campagne grecque à Troie est dépeinte comme une guerre de conquête dont le but est de vaincre Troie et de prendre Hélène , épouse de Ménélas, puis dans la tragédie « Iphigénie en Aulis », la guerre des Grecs contre les Troyens est couverte à partir de positions homériques, c'est-à-dire comme une guerre pour l'honneur de la Hellas. Cette interprétation, qui a élevé l'esprit patriotique des Grecs, était particulièrement pertinente dans dernières années Vème siècle AVANT JC. pour la Grèce et les politiques épuisées par la guerre du Péloponnèse. Des personnes se sacrifiant pour le bien de leur patrie ont été représentées plus d'une fois dans les tragédies d'Euripide : Macaire dans la tragédie « Héraclide », Ménécée dans la tragédie « Phéniciens », Praxitea dans la tragédie « Érechthée » (seul un fragment a survécu) - mais là ces images n'étaient pas les principales.
Iphigénie, personnage central de cette tragédie, sacrifie sa vie pour le bien de sa patrie. Elle est représentée entourée de personnes qui vivent un conflit douloureux entre le devoir et le bonheur personnel. Ainsi, Agamemnon doit sacrifier sa fille pour la victoire de la Grèce, mais il n'ose pas le faire. Puis, après de douloureux tourments, il envoie néanmoins une lettre à sa femme lui demandant d'amener Iphigénie à Aulis, puisqu'Achille aurait courtisé la jeune fille. Bientôt, Agamemnon arrive à la conclusion qu'il est impossible de sacrifier sa fille et écrit une deuxième lettre à sa femme selon laquelle il n'est pas nécessaire de venir avec Iphigénie, puisque le mariage est reporté. Cette lettre fut interceptée par Ménélas, il reproche à Agamemnon son égoïsme et son manque d'amour pour sa patrie. Pendant ce temps, Clytemnestre, ayant reçu la première lettre de son mari, vient avec Iphigénie à Aulis. Agamemnon souffre énormément lorsqu'il rencontre sa fille, mais le sens du devoir l'emporte. Il sait que l’armée entière comprend le caractère inévitable de ce sacrifice. Agamemnon convainc Iphigénie que sa patrie a besoin de sa vie, qu'elle doit mourir pour son honneur. Contrairement à Agamemnon, Clytemnestre ne se soucie que du bonheur de sa famille et ne veut pas sacrifier sa fille pour le bien commun.
Achille est indigné d'apprendre qu'Agamemnon a délibérément menti dans une lettre à sa femme au sujet de sa relation avec leur fille, mais il est touché par la beauté de la jeune fille, son impuissance et il lui propose son aide. Cependant, Iphigénie a déjà décidé du sacrifice et refuse son offre. Achille est émerveillé par la noblesse de l'âme de la jeune fille, son héroïsme et l'amour pour Iphigénie naît dans son cœur. Après un certain temps, il la persuade déjà d'abandonner le sacrifice de soi, car il place le bonheur personnel avant le devoir envers la patrie. Ainsi, les gens entourant Iphigénie sont dépeints par Euripide comme immergés dans l’expérience d’un conflit entre le devoir et le bonheur personnel. Iphigénie elle-même joue le rôle principal dans la résolution de ce conflit. Son image est révélée par l'auteur avec beaucoup de pathos et d'amour, et la réussite d'Euripide est qu'elle n'est pas statique, comme la plupart des images de tragédies anciennes, mais est donnée dans son développement interne. Au début de la tragédie, nous voyons juste une fille douce et gentille, heureuse de la conscience de sa jeunesse, pleine de joie de son prochain mariage avec le glorieux héros de la Hellas, Achille. Elle est heureuse de rencontrer son père bien-aimé, mais sent que son père s'inquiète de quelque chose. Elle apprendra bientôt qu'elle a été amenée à Aulis non pas pour se marier avec Achille, mais pour un sacrifice à la déesse Artémis et que sa patrie a besoin de ce sacrifice. Mais la jeune fille ne veut pas donner la vie à l'autel de sa patrie, elle veut vivre, juste vivre et supplie son père de ne pas la détruire : « Après tout, regarder la lumière est si doux, mais descendre aux enfers est si effrayant – ayez pitié » (1218 et suiv.). Iphigénie rappelle à son père les jours de son enfance, où, en la caressant, elle lui promettait de lui donner la paix dans sa vieillesse :
Je garde tout dans ma mémoire, tous les mots ; Et tu as oublié, tu es content de me tuer (1230 et suiv.).
Iphigénie force son petit frère Oreste à s'agenouiller et supplie son père de l'épargner, Iphigénie. Puis elle s'exclame désespérée :
Que puis-je penser d'autre à dire ? Pour un mortel c'est joyeux de voir le soleil, Mais sous terre c'est si terrible... Si quelqu'un ne veut pas vivre, il est malade : le fardeau de la vie, Tout tourment vaut mieux que la gloire d'un mort (1249 -1253).
De plus, Euripide montre l'indignation de l'armée, désireuse d'aller à Troie, et exige qu'Iphigénie soit sacrifiée, sinon il n'y aura pas de bon vent, sinon il ne sera pas possible d'atteindre l'ennemi et de le vaincre. Ainsi, voyant des guerriers désireux de défendre l'honneur de leur patrie, prêts à donner leur vie pour cela, Iphigénie se rend peu à peu compte qu'il est honteux pour elle de mettre son bonheur au-dessus du bien commun des guerriers, qu'elle doit donner sa vie pour vaincre l'ennemi. Même lorsqu'Achille lui fait part de son amour et l'invite à s'enfuir secrètement avec lui, elle se déclare fermement prête à mourir pour l'honneur de la patrie. Ainsi, Iphigénie passe d'une jeune fille naïve et effrayée à une héroïne qui réalise son sacrifice.
9. Conclusion générale.
Dans ses tragédies, Euripide a posé et résolu un certain nombre de problèmes urgents de son temps - la question du devoir et du bonheur personnel, le rôle de l'État et de ses lois. Il a protesté contre les guerres d’agression, critiqué les traditions religieuses et défendu l’idée d’un traitement humain des personnes. Ses tragédies mettent en scène des personnes pleines de sentiments, commettant parfois des crimes, et Euripide, en profond psychologue, révèle les fractures de l'âme de ces personnes, leurs souffrances douloureuses. Pas étonnant qu'Aristote le considérait comme le poète le plus tragique (Poétique, 13).
Euripide est un grand maître dans la construction des rebondissements des tragédies ; pour lui, elles sont toujours motivées par des causes causales et justifiées de manière vitale.
Le langage des tragédies est simple et expressif. La chorale ne joue plus un grand rôle dans ses tragédies, elle chante de belles chansons lyriques, mais ne participe pas à la résolution du conflit.
Euripide n'a pas été pleinement compris par ses contemporains, car ses vues plutôt audacieuses sur la nature, la société et la religion semblaient trop en dehors du cadre habituel de l'idéologie de la majorité.
Mais ce tragédien était très apprécié à l'époque hellénistique, lorsque ses drames sociaux et quotidiens commençaient à jouir d'une popularité particulière, ce qui eut sans aucun doute une grande influence sur la dramaturgie de Ménandre et d'autres écrivains hellénistiques.
Euripide (également Euripide, grec ancien ?????????, lat. Euripide, 480 - 406 av. J.-C.) - dramaturge grec ancien, représentant de la nouvelle tragédie attique, dans laquelle la psychologie prévaut sur l'idée de destin divin.
Euripide a été précédé par un dramaturge peu connu du même nom, comme le rapporte le dictionnaire byzantin Suda.
Le grand dramaturge est né à Salamine, le jour de la célèbre victoire des Grecs sur les Perses en bataille navale, 23 septembre 480 avant JC e., de Mnesarchus et Cleito. Les parents se sont retrouvés à Salamine parmi d'autres Athéniens qui ont fui l'armée perse
Le roi Xerxès. Le lien exact entre l'anniversaire d'Euripide et la victoire est un embellissement que l'on retrouve souvent dans les récits des grands auteurs anciens. Ainsi, la Cour rapporte que la mère d’Euripide l’a conçu au moment où Xerxès envahit l’Europe (mai 480 avant JC), d’où il résulte qu’il ne pouvait pas naître en septembre.
Une inscription sur le marbre de Paros identifie l'année de naissance du dramaturge comme étant 486 avant JC. e., et dans cette chronique de la vie grecque, le nom du dramaturge est mentionné 3 fois - plus souvent que le nom d'un roi. Selon d'autres preuves, la date de naissance peut être attribuée à 481 avant JC. e.
Le père d'Euripide était respecté et jugeait
Apparemment un homme riche, la mère de Cleito vendait des légumes. Enfant, Euripide s'est sérieusement impliqué dans la gymnastique, il a même remporté des compétitions entre garçons et voulait se lancer dans jeux olympiques, mais il fut rejeté en raison de sa jeunesse. Puis il se met au dessin, sans grand succès toutefois.
Puis il commença à prendre des cours d'oratoire et de littérature auprès de Prodicus et d'Anaxagoras et des cours de philosophie auprès de Socrate. Euripide rassembla des livres pour la bibliothèque et commença bientôt à écrire lui-même. La première pièce, Peliad, est apparue sur scène en 455 avant JC. e., mais ensuite l'auteur n'a pas gagné en raison d'une querelle avec les juges.
Euripide a remporté le premier prix d'habileté en 441 avant JC. e. et dès lors jusqu'à sa mort, il créa ses créations. L'activité sociale du dramaturge s'est manifestée par le fait qu'il a participé à l'ambassade de Syracuse en Sicile, soutenant apparemment les objectifs de l'ambassade avec l'autorité d'un écrivain reconnu dans toute la Grèce.
La vie de famille d'Euripide fut un échec. De sa première femme, Chloirina, il a eu 3 fils, mais a divorcé d'elle à cause de son adultère, écrivant la pièce « Hippolyte », dans laquelle il ridiculisait les relations sexuelles. La deuxième épouse, Melitta, ne valait pas mieux que la première. Euripide est devenu célèbre en tant que misogyne, ce qui a donné au maître de la comédie Aristophane une raison de plaisanter à son sujet.
En 408 avant JC e. le grand dramaturge décide de quitter Athènes, acceptant l'invitation du roi macédonien Archelaus. On ne sait pas exactement ce qui a influencé la décision d'Euripide. Les historiens ont tendance à penser que la raison principale était, sinon le harcèlement, du moins le ressentiment envers les personnes vulnérables. personnalité créative sur des concitoyens pour non-reconnaissance du mérite.
En effet, sur 92 pièces (75 selon une autre source), seules 4 ont été primées lors de concours de théâtre du vivant de l’auteur, et une pièce à titre posthume. La popularité du dramaturge parmi le peuple est attestée par l'histoire de Plutarque sur la terrible défaite des Athéniens en Sicile en 413 av. e.:
« Ils [les Athéniens] furent vendus comme esclaves et marqués d'un cheval sur le front. Oui, il y avait ceux qui, en plus de la captivité, ont dû endurer cela. Mais même dans de tels extrêmes, ils ont bénéficié de l’estime de soi et de la maîtrise de soi. Les propriétaires les libéraient ou les valorisaient grandement.
Et certains ont été sauvés par Euripide. Le fait est que les Siciliens, probablement plus que tous les Grecs vivant en dehors de l’Attique, vénéraient le talent d’Euripide. Lorsque les visiteurs leur apportaient de petits extraits de ses œuvres, les Siciliens prenaient plaisir à les mémoriser et à se les répéter. On dit qu'à cette époque, beaucoup de ceux qui rentraient chez eux saluèrent chaleureusement Euripide et lui racontèrent comment ils avaient obtenu la liberté en enseignant à leur maître ce qui leur restait en mémoire de ses poèmes, ou comment, errant après la bataille, ils gagnaient de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes. en chantant des chansons de ses tragédies.
Archélaüs montra honneur et respect démonstratif envers le célèbre invité, à tel point que les signes de faveur furent la cause de la mort du roi lui-même. Aristote, dans son ouvrage «Politique», rapporte l'histoire d'un certain Decamnichus, qui fut livré à Euripide pour flagellation pour une insulte qui lui avait été infligée, et ce Decamnichus, pour se venger, organisa une conspiration, à la suite de laquelle Archelaus mourut. Cela s'est produit après la mort d'Euripide lui-même en 406 avant JC. e. La mort d'une personnalité aussi remarquable a donné naissance à des légendes exposées à la Cour :
« Euripide a mis fin à ses jours à la suite de la conspiration d'Arrhidaeus de Macédoine et de Crateus de Thessalie, poètes jaloux de la gloire d'Euripide. Ils ont soudoyé un courtisan nommé Lysimaque en 10 minutes pour qu'il lâche les chiens royaux qu'il surveillait sur Euripide. D'autres disent qu'Euripide n'a pas été déchiré par des chiens, mais par des femmes, lorsqu'il s'est précipité la nuit pour un rendez-vous avec Craterus, le jeune amant d'Archélaos. D’autres encore prétendent qu’il allait rencontrer Nikodika, la femme d’Aref.
La version sur les femmes est une plaisanterie grossière avec une allusion à la pièce d’Euripide « Les Bacchantes », où des femmes affolées déchiraient le roi. Plutarque raconte l'amour d'un écrivain âgé pour les jeunes hommes dans « Citations ». Version moderne plus banal - le corps d'Euripide, 75 ans, n'a tout simplement pas pu résister au rude hiver de la Macédoine.
Les Athéniens demandèrent la permission d'enterrer le dramaturge dans leur ville natale, mais Archélaüs souhaita laisser la tombe d'Euripide dans leur capitale, Pella. Sophocle, ayant appris la mort du dramaturge, obligea les acteurs à jouer la pièce la tête découverte. Athènes a érigé une statue d'Euripide au théâtre pour lui rendre hommage après sa mort.
Plutarque a véhiculé une légende : la foudre a frappé le tombeau d'Euripide, grand signe qui lui a été décerné des personnes célèbres seulement Lycurgue.
(Aucune note pour l'instant)
Articles Similaires:
- Le grand dramaturge est né à Salamine, le jour de la célèbre victoire des Grecs sur les Perses lors d'une bataille navale, le 23 septembre 480 avant JC. e., de Mnesarchus et Cleito. Les parents se retrouvèrent à Salamine parmi d'autres Athéniens qui fuyaient l'armée du roi perse Xerxès. Le lien exact entre l'anniversaire d'Euripide et la victoire est un embellissement que l'on retrouve souvent dans les récits des auteurs anciens […]...
- Euripide Alceste C'est une tragédie avec une fin heureuse. Lors des concours dramatiques à Athènes, il y avait une coutume : chaque poète présentait une « trilogie », trois tragédies, parfois même se reprenant dans des thèmes (comme Eschyle), et après elles, pour soulager l'ambiance morose, un « drame satirique ». où les héros et l'action étaient également issus de mythes, mais le chœur était certainement composé de satyres joyeux, [...]
- Euripide Iphigénie en Tauris Les anciens Grecs appelaient la Crimée moderne Tauris. Là vivaient les Tauri, une tribu scythe qui honorait la jeune déesse et lui faisait des sacrifices humains, ce qui était depuis longtemps devenu une coutume en Grèce. Les Grecs croyaient que cette jeune déesse n’était autre que leur Artémis la chasseresse. Ils avaient un mythe, au début et à la fin duquel il y avait […]...
- La guerre de Troie commença. Le prince troyen Pâris séduit et kidnappe Hélène, l'épouse du roi spartiate Ménélas. Les Grecs rassemblèrent contre eux une immense armée, dirigée par le roi argien Agamemnon, frère de Ménélas et époux de Clytemnestre, la sœur d'Hélène. L'armée se tenait à Aulis, sur la côte grecque, face à Troie. Mais il ne pouvait pas naviguer - la déesse de ces lieux [...]
- Le dernier de la triade des grands tragédiens grecs est né seize ans plus tard que Sophocle et est mort la même année. Mais contrairement à son grand frère du métier, il fuyait les affaires publiques et aimait la solitude. Bien éduqué, il s'essaye à la peinture et à la musique, se distingue par une soif infatigable de connaissances, lit beaucoup et collectionne l'un des meilleurs pour son [...]
- Dans l’Athènes antique, le roi Thésée régnait. Comme Hercule, il avait deux pères : le terrestre, le roi Égée, et le céleste, le dieu Poséidon. Il accomplit son principal exploit sur l'île de Crète : il tua le monstrueux Minotaure dans le labyrinthe et libéra Athènes de l'hommage qui lui était rendu. Son assistante était la princesse crétoise Ariane : elle lui donna un fil, à la suite duquel il sortit […]...
- Oeuvre : Divers EURIPIDES – acteur les comédies d'Aristophane « Acharniens » (425 avant JC), « Femmes à un festival » (411) et « Grenouilles » (405) ; le grand dramaturge grec ancien est devenu un personnage. Dans « Les Acharniens », semblable à ses héros distraits, il est représenté comme un marchand de ferraille, ce qui laisse entrevoir ses héros plaintifs sans vergogne, souvent vêtus de haillons, éternelles victimes de toutes sortes de malheurs. Dans « Les femmes […]...
- Euripide Iphigénie à Aulis La guerre de Troie commença. Le prince troyen Pâris séduit et kidnappe Hélène, l'épouse du roi spartiate Ménélas. Les Grecs rassemblèrent contre eux une immense armée, dirigée par le roi argien Agamemnon, frère de Ménélas et époux de Clytemnestre, la sœur d'Hélène. L'armée se tenait à Aulis, sur la côte grecque, face à Troie. Mais il ne pouvait pas naviguer […]...
- Euripide Hippolyte, le roi Thésée, régnait dans l'Athènes antique. Comme Hercule, il avait deux pères : le terrestre, le roi Égée, et le céleste, le dieu Poséidon. Il accomplit son principal exploit sur l'île de Crète : il tua le monstrueux Minotaure dans le labyrinthe et libéra Athènes de l'hommage qui lui était rendu. La princesse crétoise Ariane était son assistante : elle lui donna un fil, à la suite duquel [...]
- « Euripide » Euripide, le troisième tragédien grec célèbre, ne participait apparemment pas aux activités publiques et n'était pas très apprécié de ses contemporains. Au cours de sa vie, il n'a reçu le premier prix que quatre fois dans des concours de tragédie (la cinquième fois, il a obtenu la première place immédiatement après sa mort), mais cent ans plus tard, il est devenu le poète grec le plus aimé et, comme Eschyle et […]. ..
- Le nom « Hercule » signifie « Gloire à la déesse Héra ». Ce nom semblait ironique. La déesse Héra était une reine céleste, l'épouse du suprême Zeus le Tonnerre. Et Hercule était le dernier des fils terrestres de Zeus : Zeus est descendu sur de nombreuses femmes mortelles, mais après Alcmène, la mère d'Hercule, il n'est allé vers personne. Hercule dut sauver les dieux de l’Olympe dans la guerre pour le pouvoir sur le monde contre […]...
- Il existe un mythe sur le héros Jason, le chef des Argonautes. Il était le roi héréditaire de la ville d'Iolka dans le nord de la Grèce, mais le pouvoir dans la ville fut pris par son parent aîné, le puissant Pélias, et pour le restituer, Jason dut accomplir un exploit : avec ses amis héros, sur le navire « Argo », navigue jusqu'à l'extrémité orientale de la terre et là, dans le pays de Colchide, pour obtenir la toison d'or sacrée, protégée [...]
- Euripide C'est une tragédie avec une fin heureuse. Lors des concours dramatiques à Athènes, il y avait une coutume : chaque poète présentait une « trilogie », trois tragédies, parfois même se reprenant dans des thèmes (comme Eschyle), et après elles, pour soulager l'ambiance morose, un « drame satirique ». où les héros et l'action étaient également issus de mythes, mais le chœur était certainement composé de satyres joyeux, aux pattes de chèvre […]...
- Euripide Les anciens Grecs appelaient la Crimée moderne Tauris. Là vivaient les Tauri, une tribu scythe qui honorait la jeune déesse et lui faisait des sacrifices humains, ce qui était depuis longtemps devenu une coutume en Grèce. Les Grecs croyaient que cette jeune déesse n’était autre que leur Artémis la chasseresse. Ils avaient un mythe, au début et à la fin duquel se tenait Artémis, et tous deux [...]
- Euripide Hercule Le nom « Hercule » signifie « Gloire à la déesse Héra ». Ce nom semblait ironique. La déesse Héra était une reine céleste, l'épouse du suprême Zeus le Tonnerre. Et Hercule était le dernier des fils terrestres de Zeus : Zeus est descendu sur de nombreuses femmes mortelles, mais après Alcmène, la mère d'Hercule, il n'est allé vers personne. Hercule dut sauver les dieux de l'Olympe dans la guerre pour le pouvoir sur […]...
- Euripide La guerre de Troie commença. Le prince troyen Pâris séduit et kidnappe Hélène, l'épouse du roi spartiate Ménélas. Les Grecs rassemblèrent contre eux une immense armée, dirigée par le roi argien Agamemnon, frère de Ménélas et époux de Clytemnestre, la sœur d'Hélène. L'armée se tenait à Aulis, sur la côte grecque, face à Troie. Mais il ne pouvait pas naviguer - la déesse de ces [...]
- Euripide Le nom « Hercule » signifie « Gloire de la déesse Héra ». Ce nom semblait ironique. La déesse Héra était une reine céleste, l'épouse du suprême Zeus le Tonnerre. Et Hercule était le dernier des fils terrestres de Zeus : Zeus est descendu sur de nombreuses femmes mortelles, mais après Alcmène, la mère d'Hercule, il n'est allé vers personne. Hercule dut sauver les dieux de l’Olympe dans la guerre pour le pouvoir sur le monde […]...
- C'est une tragédie avec une fin heureuse. Lors des concours dramatiques à Athènes, il y avait une coutume : chaque poète présentait une « trilogie », trois tragédies, parfois même se reprenant dans des thèmes (comme Eschyle), et après elles, pour soulager l'ambiance morose, un « drame satirique ». où les héros et l'action étaient également issus de mythes, mais le chœur était certainement composé de satyres joyeux, aux pattes de chèvre et [...]
- Les anciens Grecs appelaient la Crimée moderne Taurida. Là vivaient les Tauri, une tribu scythe qui honorait la jeune déesse et lui faisait des sacrifices humains, ce qui était depuis longtemps devenu une coutume en Grèce. Les Grecs croyaient que cette jeune déesse n’était autre que leur Artémis la chasseresse. Ils avaient un mythe, au début et à la fin duquel se tenait Artémis, et les deux fois [...]
- Junichiro Tanizaki (japonais ?? ??? Tanizaki Junichiro, 24 juillet 1886 - 30 juillet 1965) - écrivain, dramaturge japonais ; V premières années un ardent adversaire du naturalisme en littérature ; adepte du modernisme, de l'avant-garde, du romantisme et de la philosophie ; a tenté de combiner dans son œuvre les goûts littéraires japonais traditionnels avec les principes esthétiques de la littérature décadente d'Europe occidentale ; il a écrit avec une extrême audace, sans tenir compte des opinions généralement acceptées ; tôt […]...
- Alexey Nikolaevich Arbuzov (13 (26) mai 1908, Moscou - 20 avril 1986) - dramaturge russe. Arbuzov est né à Moscou dans une famille intelligente. En 1914, la famille déménage à Petrograd et, en 1916, il commence à étudier au gymnase, mais ne reçoit pas d'éducation systématique. La révolution de 1917, la faim et une grave maladie de sa mère font d'Alexeï Nikolaïevitch un orphelin à l'âge de 11 ans. […]...
- Dans son travail, Nikolai Semenovich Leskov a souvent évoqué le sujet de la vie difficile des travailleurs ordinaires de Russie. Beaucoup de personnages de ses œuvres sont des maîtres dans leur métier, des artisans difficiles à trouver ! Et, probablement, le personnage principal de l’œuvre de Leskov peut s’appeler en toute sécurité Lefty, un artisan de Toula qui a réussi à forger une puce en acier. Dans « Lefty », l'auteur raconte comment [...]
- La basse-cour du roi Augeas Après qu'Hercule ait attrapé le sanglier d'Erymanian, Eurysthée (le roi lâche et faible au service duquel Hercule était) lui confia une nouvelle mission : nettoyer toute la basse-cour du roi Augeas, qui vivait à Elis, du fumier. Augeas était le fils du dieu solaire Hélios, qui lui donna une grande richesse. Le roi d'Elis était particulièrement célèbre pour son [...]
- Aristophane Grenouilles Il y avait trois auteurs célèbres de tragédies à Athènes : l'aîné - Eschyle, le milieu - Sophocle et le plus jeune - Euripide. Eschyle était puissant et majestueux, Sophocle était clair et harmonieux, Euripide était tendu et paradoxal. Après l'avoir regardé une fois, le public athénien n'a pas pu oublier pendant longtemps à quel point sa Phèdre était tourmentée par la passion pour son beau-fils, et sa Médée et le chœur préconisaient […]...
- Euripide Il existe un mythe sur le héros Jason, le chef des Argonautes. Il était le roi héréditaire de la ville d'Iolka dans le nord de la Grèce, mais le pouvoir dans la ville fut pris par son parent aîné, le puissant Pélias, et pour le restituer, Jason dut accomplir un exploit : avec ses amis héros, sur le navire « Argo », navigue jusqu'à l'extrémité orientale de la terre et là, dans le pays de Colchide, pour obtenir la toison d'or sacrée, [...]
- Mikhail Petrovich Artsybashev (24 octobre (5 novembre) 1878, village de Dobroslavovka, district d'Akhtyrsky, province de Kharkov - 3 mars 1927, Varsovie) - écrivain, dramaturge, publiciste russe. Il est issu de la noblesse locale, son père était chef de la police du district. Il étudie au gymnase d'Akhtyrka, à l'école de dessin et de peinture de Kharkov (1897-1898). À partir de 1894, il collabore à des journaux provinciaux (le journal de Kharkov « Yuzhny Krai »), publiant […]...
- Yesenin S.A. Le paysan et guerrier Pougatchev, qui rêve de liberté, vient à Yaik après de longues errances et, lors d'une conversation avec un gardien cosaque, apprend que les paysans attendent un nouveau roi - un paysan. C'est ainsi qu'un homme assassiné apparaît comme un roi. Pierre III– il donnerait la liberté au peuple. Cette pensée captive Pougatchev. Il vient voir les Kalmouks et les appelle à partir […]...
- S. A. Yesenin Pougatchev Paysan et guerrier qui rêve de liberté, Pougatchev, après de longues errances, vient à Yaik et, lors d'une conversation avec un gardien cosaque, apprend que les paysans attendent un nouveau roi - un paysan. Pierre III assassiné semble être un tel roi - il aurait donné la liberté au peuple. Cette pensée captive Pougatchev. Il vient chez les Kalmouks et les interpelle […]...
- Le roi Wu consulte ses dignitaires Sun Wu, Wu Tzu-xu et Bo Xi sur la manière de restituer l'épée magique qui a volé vers le royaume de Chu. Les dignitaires recommandent de déclencher une guerre en comptant sur une victoire facile. Le roi Chu Zhao consulte également son frère Qian-xuan pour savoir s'il doit renoncer à l'épée. Et il décide de ne pas le donner, puisque ce trésor a été « envoyé du Ciel ». Un messager arrive de [...]
- Hermann Bahr (allemand : Hermann Bahr ; 19 juillet 1863 – 15 janvier 1934) était un écrivain, dramaturge, metteur en scène et critique autrichien. [modifier] Biographie Né et élevé à Linz, il a étudié la philosophie, le droit, l'économie et la philologie à Vienne, Tchernivtsi et Berlin. Lors d'un long séjour à Paris, il découvre son intérêt pour l'art et la littérature. Bar a d’abord travaillé comme critique […]...
- (1837) Moscou. L'action du poème commence dans le Kremlin, déjà en pierre blanche. Le repas royal est en cours. Ivan IV le Terrible est à table. Derrière le tsar se trouvent les gardes, au contraire les princes et les boyards, sur les côtés se trouvent les gardes et les gardes. Chez le roi bonne humeur et il décide d'offrir à tout le monde un vin doux et étranger. Tous ses combattants fidèles et audacieux boivent du vin et louent le roi. Tout à coup […]...
- Goethe I. Nous sommes tous des enfants de la nature. Des gens créatifs Ils ressentent et connaissent particulièrement bien la nature et sa vie secrète. Goethe fait partie des poètes qui savaient « voir », et pour « voir », il faut l'âme brillante et pure d'un enfant. Ce sont les enfants qui sont capables de percevoir le monde avec toutes ses peurs d'un autre monde, de voir ce qui est inaccessible à un adulte. « Le Roi de la Forêt » […]...
- S À propos des messagers envoyés par le roi Leukius, nommé Basile lors du baptême, qu'il envoya à Babylone pour prendre des objets de valeur célèbres auprès des trois saints jeunes - Ananias, Azariah et Misail. Le grec Gury, le géorgien Jacob, le russe Laurus sont les héros de l'histoire traduite, envoyés par le roi byzantin Vasily à Babylone pour les célèbres objets de valeur conservés par les trois saints jeunes (mentionnés dans la Bible) […].. .
- Les environs de Moscou sont décrits. Non loin du mur du monastère se trouve une cabane dans laquelle Lisa et sa mère vivaient il y a trente ans. Son père était « un villageois assez prospère, car il aimait le travail, labourait bien la terre et menait toujours une vie sobre ». Mais il est mort. Sa veuve et sa fille ne pouvaient pas cultiver elles-mêmes la terre et furent obligées de la céder […]...
- Parti à Moscou après un dîner avec des amis, le héros ne s'est réveillé qu'à la prochaine gare postale - Sofia. Ayant du mal à réveiller le gardien, il réclama des chevaux, mais fut refusé en raison de la nuit. J'ai dû donner de la vodka aux cochers, ils l'ont exploitée et le voyage a continué. A Tosna, le héros rencontre un avocat qui composait d'anciennes généalogies pour les jeunes nobles. Sur […]...
- La fin du XVIIe siècle, qui marque la mort du tsar Fiodor Alekseevich, est marquée par le début de la lutte pour le pouvoir. A cette époque, il y a une révolte des archers, incitée par la princesse Sophie et son amant le prince Vasily Golitsyn. Deux jeunes tsars sont apparus à Moscou, dont Ivan Alekseevich, le second Piotr Alekseevich, et Sophie elle-même les a dirigés. Rien n'a changé, rien […]...
- Trifonov Yu.V. Tout a commencé à Saratov, où la troupe est venue en tournée et où les acteurs ont été hébergés dans un mauvais hôtel. Il fait chaud, le réalisateur Sergueï Leonidovitch part pour Moscou, laissant à sa place son assistant Smurny. Ce Smurny a longtemps lorgné sur Lyalya (Lyudmila Petrovna Telepneva), une des actrices de théâtre, mais, se vengeant d'elle pour l'avoir rejeté, […]...
- Les campagnes victorieuses d'Alexandre le Grand conduisirent à la conquête de vastes terres à l'Est. Après la mort du commandant en 323 av. e. Une lutte acharnée pour le pouvoir s'ensuivit entre ses commandants et les dyades. L'empire se divisa en plusieurs grandes monarchies, parmi lesquelles se distinguaient les royaumes des Séleucides en Syrie et des Ptolémées en Égypte, États appelés hellénistiques. Villes fondées par Alexandre le Grand le […]...
- Comédie en cinq actes PERSONNAGES : Simpletons. MS. Prostakova, sa femme. Mitrofan, leur fils, est un sous-bois. Eremeevna, la mère de Mitrofan. Pravdine. Starodum. Sophia, la nièce de Starodum. Milo. M. Skotinin, frère de Mme. Prostakova. Kuteikin, séminariste. Tsyfirkin, sergent à la retraite. Vralman, professeur. Trishka, tailleur. Le serviteur de Prostakov. Le valet de Starodum. Action dans le village de Prostakovs. ACTE PREMIÈRE SCÈNE I Gzh. Prostakova, regardant un nouveau caftan [...]
- Bhurivasu, le ministre du roi de la ville de Padmavati, et Devarata, le ministre du pays de Vidarbha, dès que la fille de Bhurivasu, Malati, est née et que le fils de Devarata, Madhava, est né, ils ont conspiré pour les fiancer. Mais le roi Padmavati décida fermement de marier Malati à son favori, le courtisan Nandana. Une vieille amie de Bhurivasu et Devarata, la sage religieuse bouddhiste Kamandaki, s'engage à empêcher ce mariage. Elle […]...
Il existe un mythe sur le héros Jason, le chef des Argonautes. Il était le roi héréditaire de la ville d'Iolcus dans le nord de la Grèce, mais le pouvoir dans la ville fut pris par son parent aîné, le puissant Pélias, et pour le restituer, Jason dut accomplir un exploit : avec ses amis guerriers sur le navire "Argo" pour naviguer jusqu'à l'extrémité orientale de la terre et là, dans le pays de Colchide, obtenir la toison d'or sacrée, gardée par un dragon. Apollonius de Rhodes écrivit plus tard le poème « Argonautica » sur ce voyage.
Un puissant roi, le fils du Soleil, régnait en Colchide ; Sa fille, la princesse sorcière Médée, est tombée amoureuse de Jason, ils se sont juré allégeance et elle l'a sauvé. Tout d'abord, elle lui a donné des médicaments de sorcellerie, qui l'ont d'abord aidé à résister à l'épreuve - labourer des terres arables sur des taureaux cracheurs de feu - puis à endormir le dragon gardien. Deuxièmement, lorsqu'ils quittèrent la Colchide, Médée, par amour pour son mari, tua son frère et dispersa des morceaux de son corps le long du rivage ; Les Colchidiens qui les poursuivaient tardèrent à l'enterrer et ne purent rattraper les fugitifs. Troisièmement, à leur retour à Iolcus, Médée, afin de sauver Jason de la trahison de Pélias, invita les filles de Pélias à massacrer leur vieux père, promettant de le ressusciter ensuite comme un jeune homme. Et ils tuèrent leur père, mais Médée refusa sa promesse, et les filles parricide s'enfuirent en exil. Cependant, Jason ne parvint pas à obtenir le royaume de Iolk : le peuple se rebella contre la sorcière étrangère et Jason, Médée et leurs deux jeunes fils s'enfuirent à Corinthe. Le vieux roi corinthien, après y avoir regardé de plus près, lui offrit sa fille comme épouse et le royaume avec elle, mais, bien sûr, pour qu'il divorce de la sorcière. Jason accepta l'offre : peut-être commençait-il lui-même déjà à avoir peur de Médée. Il célébra un nouveau mariage et le roi envoya à Médée l'ordre de quitter Corinthe. Elle s'enfuit à Athènes sur un char solaire tiré par des dragons et dit à ses enfants : « Offrez à votre belle-mère mon cadeau de mariage : un manteau brodé et un bandeau tissé d'or. » Le manteau et le bandage étaient saturés d'un poison ardent : les flammes engloutirent la jeune princesse, le vieux roi et le palais royal. Les enfants se précipitèrent pour chercher le salut dans le temple, mais les Corinthiens, furieux, les lapidèrent. Personne ne savait exactement ce qui était arrivé à Jason.
Il était difficile pour les Corinthiens de vivre avec la mauvaise réputation de meurtriers d’enfants et de méchants. C’est pourquoi, selon la légende, ils ont supplié le poète athénien Euripide de montrer dans la tragédie que ce ne sont pas eux qui ont tué les enfants de Jason, mais Médée elle-même, leur propre mère. Il était difficile de croire à une telle horreur, mais Euripide nous le faisait croire.
"Oh, si seulement ces pins d'où le navire sur lequel Jason naviguait ne s'étaient jamais effondrés..." - la tragédie commence. C'est ce que dit la vieille nourrice de Médée. Sa maîtresse vient d'apprendre que Jason épouse la princesse, mais ne sait pas encore que le roi lui ordonne de quitter Corinthe. Les gémissements de Médée se font entendre derrière la scène : elle maudit Jason, elle-même et les enfants. « Prenez soin des enfants », dit l'infirmière au vieux professeur. Le chœur des femmes corinthiennes est alarmé : Médée n'aurait-elle pas provoqué de pires ennuis ! « La fierté et la passion royales sont terribles ! la paix et la modération valent mieux.
Les gémissements ont cessé, Médée sort au chœur, elle parle avec fermeté et courage. « Mon mari était tout pour moi, je n'ai plus rien. Ô misérable femme ! Ils la confient à quelqu'un d'autre, lui versent une dot, lui achètent un maître ; Cela lui fait mal d'accoucher, comme dans une bataille, et partir est une honte. Vous êtes ici, vous n’êtes pas seul, mais je suis seul. Le vieux roi corinthien sort à sa rencontre : aussitôt, devant tout le monde, que la sorcière s'exile ! "Hélas! Difficile d'en savoir plus que les autres :
C’est pour cela qu’il y a la peur, c’est pour ça qu’il y a la haine. Donnez-moi au moins une journée pour décider où aller. Le roi lui donne un jour à vivre. "Homme aveugle! - dit-elle après lui. "Je ne sais pas où j'irai, mais je sais que je vais te laisser mort." Qui tu? Le chœur chante une chanson sur le mensonge universel : les serments sont piétinés, les rivières coulent à rebours, les hommes sont plus traîtres que les femmes !
Jason entre ; une dispute commence. « Je t'ai sauvé des taureaux, du dragon, de Pélias - où sont tes vœux ? Où dois-je aller? En Colchide - les cendres d'un frère ; à Iolka - les cendres de Pélias ; vos amis sont mes ennemis. Ô Zeus, pourquoi pouvons-nous reconnaître le faux or, mais pas une fausse personne ! » Jason répond : « Ce n'est pas toi qui m'as sauvé, mais l'amour qui t'a ému. Pour cela, je compte sur le salut : vous n'êtes pas dans la Colchide sauvage, mais en Grèce, où l'on sait chanter ma gloire et celle de toi. Mon nouveau mariage est pour le bien des enfants : ceux qui sont nés de toi sont incomplets, mais dans ma nouvelle maison, ils seront heureux. - "On n'a pas besoin du bonheur au prix d'une telle insulte !" - « Oh, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas naître sans femmes ! il y aurait moins de mal dans le monde. La chorale chante une chanson sur l'amour maléfique.
Médée fera son travail, mais alors où aller ? C'est ici qu'apparaît le jeune roi athénien Égée : il se rendit chez l'oracle pour demander pourquoi il n'avait pas d'enfants, et l'oracle répondit de manière incompréhensible. « Vous aurez des enfants, dit Médée, si vous m'hébergez à Athènes. » Elle sait qu'Égée aura un fils du côté étranger - le héros Thésée ; sait que ce Thésée la chassera d'Athènes ; sait que plus tard Égée mourra de ce fils - il se jettera à la mer avec de fausses nouvelles de sa mort ; mais il est silencieux. "Laissez-moi périr si je permets que vous soyez chassés d'Athènes !" - dit Égée, "Médée n'a plus besoin de rien maintenant." Égée aura un fils, mais Jason n'aura pas d'enfants - ni de sa nouvelle épouse, ni d'elle, Médée. «Je vais déraciner la famille Jason!» - et que les descendants soient horrifiés. Le chœur chante une chanson à la gloire d’Athènes.
Médée a rappelé le passé, assuré l'avenir, et maintenant sa préoccupation se porte sur le présent. La première concerne mon mari. Elle appelle Jason et lui demande pardon : "C'est comme ça que nous sommes, les femmes !" - flatte, dit aux enfants d'embrasser leur père : « J'ai un manteau et un bandage, héritage du Soleil, mon ancêtre ; qu'ils les présentent à votre femme ! - "Bien sûr, et que Dieu leur accorde une longue vie !" Le cœur de Médée se serre, mais elle s'interdit la pitié. La chorale chante : « Quelque chose va arriver ! »
La deuxième préoccupation concerne les enfants. Ils prirent les cadeaux et revinrent ; Médée pleure pour la dernière fois. « Je t'ai donné naissance, je t'ai allaité, je vois ton sourire, est-ce vraiment la dernière fois ? Chères mains, lèvres douces, visages royaux - ne vous épargnerai-je vraiment pas ? Votre père vous a volé votre bonheur, votre père vous prive de votre mère ; Si j'ai pitié de toi, mes ennemis riront ; cela ne devrait pas arriver ! L'orgueil est fort en moi, et la colère est plus forte que moi ; c'est décidé!" La chorale chante : « Oh, il vaut mieux ne pas donner naissance à des enfants, ne pas diriger un foyer, vivre en pensée avec les Muses - les femmes sont-elles plus faibles d'esprit que les hommes ?
La troisième préoccupation concerne le briseur de maison. Un messager arrive : « Sauve-toi, Médée : la princesse et le roi ont péri à cause de ton empoisonnement ! » - "Dis-moi, dis-moi, plus c'est détaillé, plus c'est doux !" Les enfants entrent dans le palais, tout le monde les admire, la princesse se réjouit de sa tenue, Jason lui demande d'être une bonne marâtre pour les petits. Elle promet, elle enfile une tenue, elle s'exhibe devant le miroir ; tout à coup, la couleur disparaît de son visage, l'écume apparaît sur ses lèvres, les flammes engloutissent ses boucles, la viande brûlée rétrécit sur ses os, le sang empoisonné suinte comme le goudron de l'écorce. Le vieux père tombe en criant sur son corps, le cadavre s'enroule autour de lui comme du lierre ; il essaie de s'en débarrasser, mais il meurt lui-même, et tous deux gisent carbonisés, morts. "Oui, notre vie n'est qu'une ombre", conclut le messager, "et il n'y a pas de bonheur pour les gens, mais il y a des succès et des échecs".
Il n’y a plus de retour en arrière désormais ; Si Médée ne tue pas elle-même les enfants, d’autres les tueront. « N'hésite pas, cœur : seul un lâche hésite. Tais-toi, souvenirs : maintenant je ne suis plus leur mère, je pleurerai demain. Médée quitte la scène, le chœur chante avec horreur : « Le soleil ancêtre et le Zeus le plus haut ! retiens sa main, ne la laisse pas multiplier les meurtres par les meurtres ! Les gémissements de deux enfants se font entendre, et c'est fini.
Jason fait irruption : « Où est-elle ? sur terre, en enfer, au paradis ? Qu'ils la mettent en pièces, je veux juste sauver les enfants ! «C'est trop tard, Jason», lui dit la chorale. Le palais s'ouvre, au-dessus du palais se trouve Médée sur le Chariot du Soleil avec des enfants morts dans ses bras. « Tu es une lionne, pas une femme ! - Jason crie. "Tu es le démon avec lequel les dieux m'ont frappé !" - "Appelle-moi comme tu veux, mais je t'ai blessé le cœur." - "Et le mien!" - "Ma douleur est facile pour moi quand je vois la tienne." - "Ta main les a tués!" - "Et d'abord, votre péché." - "Alors laisse les dieux t'exécuter !" - "Les dieux n'entendent pas les transgresseurs de serment." Médée disparaît, Jason fait appel en vain à Zeus. Le chœur termine la tragédie par ces mots :
"Ce que vous pensiez être vrai ne se réalise pas, / Et les dieux trouvent des moyens pour l'inattendu - / C'est ce que nous avons vécu"...
Raconté
Dans l’Athènes antique, le roi Thésée régnait. Comme Hercule, il avait deux pères : le terrestre, le roi Égée, et le céleste, le dieu Poséidon. Il accomplit son principal exploit sur l'île de Crète : il tua le monstrueux Minotaure dans le labyrinthe et libéra Athènes de l'hommage qui lui était rendu. La princesse crétoise Ariane était son assistante : elle lui donna un fil, à la suite duquel il sortit du labyrinthe. Il a promis de prendre Ariane pour épouse, mais le dieu Dionysos l'a exigée pour lui-même, et pour cela Thésée était détesté par la déesse de l'amour Aphrodite.
La seconde épouse de Thésée était une guerrière amazonienne ; Elle mourut au combat et laissa Thésée avec son fils Hippolyte. Fils d'Amazone, il n'était pas considéré comme légitime et n'a pas été élevé à Athènes, mais dans la ville voisine de Trézène. Les Amazones ne voulaient pas connaître les hommes ; Hippolyte ne voulait pas connaître les femmes. Il se disait serviteur de la chasseuse de déesse vierge Artémis, initiée aux mystères souterrains, dont le chanteur Orphée parlait aux gens : une personne doit être pure, et alors elle trouvera le bonheur au-delà de la tombe. Et pour cela, la déesse de l'amour Aphrodite le détestait également.
La troisième épouse de Thésée était Phèdre, également originaire de Crète, la sœur cadette d'Ariane. Thésée la prit pour épouse afin d'avoir des enfants-héritiers légitimes. Et c'est ici que commence la vengeance d'Aphrodite. Phèdre a vu son beau-fils Hippolyte et est tombée amoureuse de lui. Au début, elle surmonta sa passion : Hippolyte n'était pas là, il était à Trézène. Mais il se trouve que Thésée tua ses proches qui se révoltèrent contre lui et dut s'exiler pendant un an ; avec Phèdre, il s'installa dans la même Trézène. Ici, l'amour de la belle-mère pour son beau-fils s'est à nouveau enflammé ; Phèdre était bouleversée à cause d'elle, tombait malade, tombait malade, et personne ne pouvait comprendre ce qui n'allait pas avec la reine. Thésée alla voir l'oracle ; C'est en son absence que le drame s'est produit.
En fait, Euripide a écrit deux tragédies à ce sujet. Le premier n'a pas survécu. Dans ce document, Phèdre elle-même révélait son amour à Hippolyte, Hippolyte la rejeta avec horreur, puis Phèdre calomnia Hippolyte auprès de Thésée de retour : comme si c'était son beau-fils qui tombait amoureux d'elle et voulait la déshonorer. Hippolyte est mort, mais la vérité a été révélée et ce n'est qu'à ce moment-là que Phèdre a décidé de se suicider. C’est de cette histoire que la postérité se souvient le mieux. Mais les Athéniens ne l'aimaient pas : Phèdre s'est avérée ici trop impudique et méchante. Puis Euripide composa une deuxième tragédie sur Hippolyte - et elle est devant nous.
La tragédie commence par un monologue d'Aphrodite : les dieux punissent les orgueilleux, et elle punira le fier Hippolyte, qui abhorre l'amour. Le voici, Hippolyte, avec sur les lèvres un chant en l'honneur de la vierge Artémis : il est joyeux et ne sait pas qu'aujourd'hui le châtiment va tomber sur lui. Aphrodite disparaît, Hippolyte sort avec une couronne à la main et la dédie à Artémis - « pure de pure ». "Pourquoi n'honores-tu pas aussi Aphrodite ?" - lui demande le vieil esclave. « Je l'ai lu, mais de loin : les dieux de la nuit ne sont pas dans mon cœur », répond Hippolyte. Il s'en va et l'esclave prie Aphrodite pour lui : « Pardonnez son arrogance de jeunesse : c'est pourquoi vous, dieux, êtes sages de pardonner. » Mais Aphrodite ne pardonnera pas.
Un chœur de femmes trézéniennes entre : elles ont entendu une rumeur selon laquelle la reine Phèdre est malade et délire. De quoi ? Colère des dieux, jalousie maléfique, mauvaise nouvelle ? Phèdre est amenée à leur rencontre, se retournant sur son lit, accompagnée de sa vieille nourrice. Phèdre s'extasie : « Allons chasser dans les montagnes ! » au pré fleuri d'Artemidin ! aux listes de chevaux côtiers » - ce sont tous les lieux d'Hippolyte. La nourrice persuade : « Réveillez-vous, ouvrez-vous, ayez pitié, sinon pour vous-même, du moins pour les enfants : si vous mourez, ce ne seront pas eux qui régneront, mais Hippolyte. Phèdre frémit : « Ne dis pas ce nom ! Mot à mot : « la cause de la maladie, c'est l'amour » ; « la raison de l'amour, c'est Hippolyte » ; « Il n’y a qu’un seul salut : la mort. » L'infirmière s'y oppose : « L'amour est la loi universelle ; résister à l’amour est un orgueil stérile ; et pour chaque maladie, il existe un remède. Phaedra prend ce mot au pied de la lettre : peut-être que l'infirmière connaît une potion de guérison ? L'infirmière s'en va ; la chorale chante : « Oh, laisse Eros me souffler ! »
Il y a du bruit derrière la scène : Phèdre entend les voix de la nourrice et d'Hippolyte. Non, il ne s’agissait pas de la potion, mais de l’amour d’Hippolyte : l’infirmière lui a tout révélé – et en vain. Alors ils montent sur scène, il s'indigne, elle ne demande qu'une chose : "Ne dis un mot à personne, tu as prêté serment !" «Ma langue jurait, mon âme n'y était pour rien», répond Hippolyte. Il prononce une cruelle dénonciation des femmes : « Oh, si seulement il était possible de continuer notre course sans femmes ! Un mari dépense de l'argent pour un mariage, un mari reçoit une belle-famille, une femme stupide est difficile, une femme intelligente est dangereuse - je tiendrai mon serment de silence, mais je te maudis ! Il s'en va; Phèdre, désespérée, lance à l'infirmière : « Malédiction ! Je voulais me sauver du déshonneur par la mort ; Maintenant, je vois que même la mort ne peut lui échapper. Il ne reste plus qu'une chose, le dernier recours », et elle part sans le nommer. Ce moyen est de blâmer Hippolyte devant son père. La chorale chante : « Ce monde est terrible ! Je devrais m'enfuir, je devrais m'enfuir !
De derrière la scène - cris : Phèdre est dans un nœud coulant, Phèdre est morte ! L'alarme règne sur scène : Thésée apparaît, il est horrifié par le désastre inattendu. Le palais s'ouvre, un cri général s'élève sur le corps de Phèdre, Mais pourquoi s'est-elle suicidée ? Dans sa main se trouvent des tablettes à écrire ; Thésée les lit, et son horreur est encore plus grande. Il s'avère que c'est Hippolyte, le beau-fils criminel, qui a empiété sur son lit et qu'elle, incapable de supporter le déshonneur, s'est suicidée. « Père Poséidon ! - S'exclame Thésée. "Vous m'avez promis un jour de réaliser trois de mes souhaits - voici le dernier d'entre eux : punir Hippolyte, qu'il ne survive pas à ce jour !"
Hippolyte apparaît ; il est aussi frappé par la vue de Phèdre morte, mais plus encore par les reproches que lui adresse son père. « Oh, pourquoi ne sommes-nous pas capables de reconnaître les mensonges au son ! - Thésée crie. - Les fils sont plus trompeurs que les pères, et les petits-enfants sont plus trompeurs que les fils ; Bientôt, il n’y aura plus assez de place sur terre pour les criminels.» Le mensonge est ta sainteté, le mensonge est ta pureté, et voici ton accusateur. Sortez de ma vue, partez en exil ! - « Les dieux et les hommes savent que j'ai toujours été pur ; "Voici mon serment, mais je me tais sur d'autres excuses", répond Hippolyte. « Ni la convoitise ne m'a poussé vers Phèdre la belle-mère, ni la vanité vers Phèdre la reine. Je vois : le mauvais est sorti propre du boîtier, mais la vérité n'a pas sauvé le propre. Exécutez-moi si vous voulez. - "Non, la mort serait une miséricorde pour toi - pars en exil !" - « Désolé, Artémis, désolé, Trézène, désolé, Athènes ! Tu n’avais pas de personne au cœur plus pur que moi. Feuilles d'Hippolyte ; le chœur chante : « Le destin est changeant, la vie est effrayante ; À Dieu ne plaise, je connais les lois cruelles du monde ! »
La malédiction se réalise : un messager arrive. Hippolyte sortit de Trézène sur un char le long d'un chemin entre les rochers et le bord de la mer. "Je ne veux pas vivre comme un criminel", cria-t-il aux dieux, "mais je veux seulement que mon père sache qu'il a tort, et j'ai raison, vivant ou mort." Alors la mer rugit, un puits s'élevait au-dessus de l'horizon, un monstre s'élevait du puits, comme un taureau marin ; les chevaux cédèrent et s'enfuirent, le char heurta les rochers et le jeune homme fut traîné le long des pierres. Le mourant est ramené au palais. "Je suis son père, et je suis déshonoré par lui", dit Thésée, "qu'il n'attende de moi ni sympathie ni joie."
Et puis Artémis, la déesse Hippolyte, apparaît au-dessus de la scène. « Il a raison, tu as tort », dit-elle. « Phèdre avait également tort, mais elle était motivée par la méchante Aphrodite. Pleure, roi ; Je partage votre chagrin avec vous. Hippolyte est transporté sur une civière, il gémit et demande qu'on l'achève ; pour qui paie-t-il les péchés ? Artémis se penche de haut sur lui : « C'est la colère d'Aphrodite, c'est elle qui a détruit Phèdre, et Phèdre Hippolyte, et Hippolyte laisse Thésée inconsolable : trois victimes, l'une plus malheureuse que l'autre. Oh, quel dommage que les dieux ne paient pas pour le sort des hommes ! Il y aura aussi du chagrin pour Aphrodite - elle a aussi un chasseur préféré, Adonis, et il tombera sous la flèche de ma flèche, Artemidina. Et toi, Hippolyte, tu auras un souvenir éternel à Trézène, et chaque fille avant le mariage te sacrifiera une mèche de cheveux. Hippolyte meurt après avoir pardonné à son père ; Le chœur termine la tragédie avec les mots : « Les larmes couleront à flots pour lui - Si le destin a renversé un grand mari - Sa mort est inoubliable pour toujours !
Option 2
À cette époque, Athènes était gouvernée par le sage roi Thésée, qui était un demi-dieu. Son père sur terre était le roi Égée et son père céleste était le dieu Poséidon. Thésée a vaincu le Minotaure dans le labyrinthe de l'île de Crète, libérant ainsi Athènes des sacrifices. Il a quitté le labyrinthe avec l'aide d'Ariane et de sa boule magique, promettant de la prendre pour épouse, mais a perdu la fille au profit du dieu Dionysos, pour lequel Aphrodite détestait Thésée. La seconde épouse du roi était une guerrière amazonienne décédée au combat, laissant son fils Hippolyte élevé par son mari. Pour la troisième fois, le roi prit pour épouse la sœur cadette d’Ariane, Phèdre. La belle-mère est tombée amoureuse de son beau-fils, mais grâce à la séparation, elle est restée sous contrôle. Mais lorsque Thésée tue ses proches qui se sont rebellés contre lui, il est envoyé en exil pour un an, et lui et sa femme se rendent chez Hippolyte à Trézène. Et puis Phèdre est devenue folle d'amour ravivé, est tombée malade et est tombée malade. Personne ne pouvait en comprendre la raison et le roi se tourna vers les oracles. Pendant l'absence de Thésée, une tragédie se produisit.
De la reine malade, l’infirmière apprend la vérité sur les causes de la maladie de Phèdre. L’infirmière a tout raconté à son beau-fils, qui se précipite immédiatement dans les appartements de sa belle-mère. Phèdre lui prête serment de garder le silence sur ce qu'il découvre. Après le départ d'Eppolit, la reine attaque l'infirmière en lui reprochant de ne pas avoir caché le secret, et incapable de supporter cela, Phèdre meurt par pendaison. Thésée revint des oracles et fut alarmé : il pleurait partout. Il est horrifié par ce malheur inattendu et ne comprend pas la raison de ce qu'il a fait. Mais il découvre des tablettes sur lesquelles la reine accuse son beau-fils d'être responsable de sa mort, affirmant qu'il a empiété sur son lit et, incapables de résister au déshonneur, ils se sont suicidés. Ici, Eppolit entre dans les chambres royales, abasourdi par ce qui s'est passé. Enivré de colère contre son fils, Thésée chasse son fils, et il répond en disant : « Les dieux et les hommes savent que j'ai toujours été pur ; Voici mon serment, mais je me tais sur les autres excuses », et il s’éloigne. Au matin, Eppolit quitta le château sur un char. Conduisant au bord de la mer, le jeune homme souhaitait que son père le croie. Soudain, un puits s'est élevé de la mer au-dessus de l'horizon, d'où s'est élevé un monstre ressemblant à un taureau marin. Par peur, les chevaux sont devenus incontrôlables, le char a heurté les rochers et Eppolit a roulé sur les rochers. Près de la mort, le gars a été emmené au palais chez son père, qui a abandonné son fils. Mais alors apparaît Artémis, qui a dit toute la vérité à Thésée. Et enfin elle dit : « C'est la colère d'Aphrodite, c'est elle qui a détruit Phèdre, et Phèdre Hippolyte, et Hippolyte laisse Thésée inconsolable : trois victimes, l'une plus malheureuse que l'autre.
Essai sur la littérature sur le thème : Résumé d'Hippolyte Euripide
Autres écrits :
- Euripide trouve un matériau précieux pour représenter les passions en utilisant le thème de l'amour, presque totalement intact dans la tragédie précédente. La tragédie « Hippolyte » est particulièrement intéressante à cet égard. Le mythe d'Hippolyte est l'une des variantes grecques de l'intrigue très répandue sur une épouse traîtresse qui calomnie Lire la suite ......
- HIPPOLYTE (le héros de la tragédie d'Euripide « Hippolyte » (428 avant JC). I. est le fils illégitime du roi athénien Thésée et de l'Amazonie, un beau jeune homme dont la seule passion dans la vie était la chasse. Il vénère la jeune chasseuse Artémis, mais rejette l'amour charnel. Aux reproches de ton serviteur Lire la suite......
- Médée Il existe un mythe sur le héros Jason, le chef des Argonautes. Il était le roi héréditaire de la ville d'Iolka dans le nord de la Grèce, mais le pouvoir dans la ville fut pris par son parent aîné, le puissant Pélias, et pour le restituer, Jason dut accomplir un exploit : avec ses amis guerriers sur le expédier Lire la suite ......
- Hercule Le nom « Hercule » signifie « Gloire à la déesse Héra ». Ce nom semblait ironique. La déesse Héra était une reine céleste, l'épouse du suprême Zeus le Tonnerre. Et Hercule était le dernier des fils terrestres de Zeus : Zeus descendit sur de nombreuses femmes mortelles, mais après Alcmène, la mère d'Hercule, Lire la suite ......
- Le dernier de la triade des grands tragédiens grecs est né seize ans plus tard que Sophocle et est mort la même année. Mais contrairement à son grand frère du métier, il fuyait les affaires publiques et aimait la solitude. Bien éduqué, il s'essaye à la peinture, Lire la suite......
- Lysistrata Basé sur la guerre entre Athènes et Sparte en 431-404. avant JC e. L'écrivain Aristophane écrit la comédie « Lysistrata » en 411 av. e.. Le personnage principal du tableau est Lilistrata, dont le nom se traduit littéralement par « arrêt des campagnes » ou « dissolution de l'armée ». Comédie Lire la suite ......
- Alceste C'est une tragédie qui finit bien. Lors des concours dramatiques à Athènes, il y avait une coutume : chaque poète présentait une « trilogie », trois tragédies, reprenant parfois même les thèmes les uns des autres (comme Eschyle), et après elles, pour soulager l'ambiance morose, un « drame satirique », où En savoir plus .. ....
- Iphigénie en Tauris Les anciens Grecs appelaient la Crimée moderne Tauris. Là vivaient les Tauri, une tribu scythe qui honorait la jeune déesse et lui faisait des sacrifices humains, ce qui était depuis longtemps devenu une coutume en Grèce. Les Grecs croyaient que cette jeune déesse n'était autre que Lire la suite ......