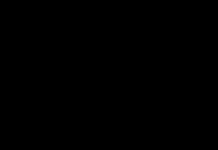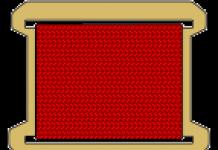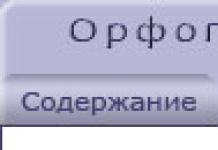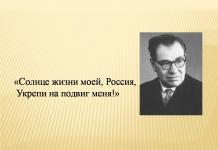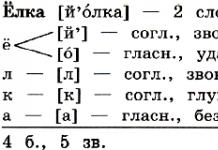Diverses formes de comportements déviants ont les propriétés générales, qui sont un critère d'appartenance à un groupe d'écarts. Un de ceux-là caractéristiques essentielles est destructivité - destructivité. La destructivité est étroitement liée à une caractéristique humaine fondamentale comme agression.
Agression- désigne toute forme de comportement visant à insulter ou à nuire à un autre être vivant qui ne souhaite pas être traité de cette manière.
Caractéristiques de l'agression:
1. se concentrer
Vers des objets externes (personnes ou objets)
Ou sur vous-même (corps ou personnalité) ;
2. formes de manifestation :
Explicite - conflit, calomnie, pression, coercition
Latent - évitement des contacts, inaction dans le but de nuire à quelqu'un) ;
3. intensité.
Les manifestations d'agressivité chez les personnes sont infinies et variées ; Bass a décrit des actions agressives.
Selon Bass, les actions agressives peuvent être décrites sur la base de trois échelles:
1. physique - verbal ;
2. actif - passif ;
3. direct Indirect.
Leur combinaison donne huit catégories possibles, dont relèvent les actions les plus agressives.
| Non. | Type d'agression | Exemples |
| 1. | Physique - actif - direct | Frapper une autre personne avec une arme blanche, battre ou blesser avec une arme à feu |
| 2. | Physique - actif - indirect | Poser des pièges, conspirer avec un assassin |
| 3. | Physique - passif - direct | Essayer d'empêcher physiquement une autre personne d'atteindre un objectif souhaité ou de s'engager dans une activité souhaitée (par exemple, démonstration assise) |
| 4. | Physique - passif - indirect | Refuser d'accomplir les tâches nécessaires (par exemple, refuser de quitter une zone lors d'un sit-in) |
| 5. | Verbal - actif - direct | Insulter ou humilier verbalement une autre personne |
| 6. | Répandre des calomnies ou des commérages malveillants sur une autre personne | |
| 7. | Verbal - passif - direct | Refus de parler à une autre personne, de répondre à ses questions, etc. |
| 8. | Verbal - actif - indirect | Refus de donner certaines explications ou explications verbales (par exemple, prendre la parole pour défendre une personne injustement critiquée) |
Théories de base de l'agression
Il ne fait aucun doute que les gens commettent souvent des actes agressifs et dangereux. Cependant, la question de savoir pourquoi ils font cela fait depuis longtemps l’objet d’un débat sérieux. Il existe de nombreuses directions théoriques qui examinent à leur manière l'essence et les causes de l'agression.
La plupart tombent dans l'une des quatre catégories:
JE. l'agressivité comme comportement instinctif (impulsions ou inclinations innées) ;
II. l'agression comme manifestation de motivation (besoin activé par des stimuli externes) ;
III. agression résultant d’une activité cognitive et émotionnelle (fait référence aux processus cognitifs et émotionnels) ;
IV. l'agressivité en tant que comportement social acquis (lié aux conditions sociales actuelles en combinaison avec les apprentissages antérieurs).
I. L'agressivité comme comportement instinctif(approche évolutive)
Approche psychanalytique.
Dans ses premiers travaux, S. Freud affirmait que tout comportement humain découle, directement ou indirectement, de eros (libido), instinct de vie . L'énergie de l'éros est dirigée vers renforcer, préserver et reproduire la vie. Dans ce contexte, l'agression était considérée comme réaction au blocage ou à la destruction des impulsions libidinales.
Freud a proposé plus tard l'existence d'un deuxième instinct fondamental , thanatos - pulsion de mort. L'énergie de Thanatos est dirigée vers destruction et cessation de la vie.
Il a soutenu que tout comportement humain est le résultat d’une interaction complexe entre ces deux instincts et qu’il existe une tension constante entre eux. En raison du fait qu'il existe un conflit aigu entre la préservation de la vie (eros) et sa destruction (thanatos), d'autres mécanismes (par exemple, le déplacement) servent à diriger l'énergie du thanatos vers l'extérieur, loin du « je ».
Ainsi, thanatos contribue indirectement au fait que l'agressivité soit manifestée et dirigée contre les autres.
Dans la théorie psychanalytique de Freud agression, dirigé vers les autres s'explique comme le résultat d’un conflit constant entre l’autodestruction et l’auto-préservation.
Approche éthologique
C'est similaire à la théorie de S. Freud. Selon l'auteur de cette approche, Lorenz, l'agressivité provient principalement de l'instinct inné de lutte pour la survie, également présent chez l'homme. Énergie agressive (ayant pour source l'instinct de combat), selon Lorenz, généré dans le corps spontanément, continuellement, à un rythme constant, s’accumule avec le temps. Comment grande quantité L'énergie agressive est disponible à ce moment-là, moins le stimulus est nécessaire pour que l'agression « éclabousse » vers l'extérieur.
Approche sociobiologique
Le principal argument des sociobiologistes est le suivant : l’influence des gènes est si durable parce qu’ils assurent un comportement adaptatif. Les gènes sont « adaptés » à tel point qu’ils contribuent à une reproduction réussie, assurant ainsi leur survie dans les générations futures.
Selon les sociobiologistes, les individus sont susceptibles de coopérer avec ceux qui partagent des gènes similaires, faisant preuve d'altruisme et d'abnégation, et seront agressifs envers ceux qui sont différents ou sans lien avec eux, c'est-à-dire que ceux qui ont des gènes similaires sont les moins susceptibles.
Les sociobiologistes nous convainquent que agression – c'est le moyen par lequel les individus tentent d'obtenir leur part des ressources, ce qui garantit le succès (principalement au niveau génétique) de la sélection naturelle.
Page 1
Dans ses premiers écrits, Freud soutenait que tout comportement humain découlait, directement ou indirectement, de l’éros, l’instinct de vie, dont l’énergie (connue sous le nom de libido) est dirigée vers l’amélioration, la préservation et la reproduction de la vie. Il a également proposé l'existence d'un deuxième instinct fondamental, le thanatos, une attirance pour la mort, dont l'énergie vise la destruction et la cessation de la vie. Parce qu'il existe un conflit aigu entre la préservation de la vie (eros) et sa destruction (thanatos), d'autres mécanismes (par exemple, le déplacement) servent à diriger l'énergie du thanatos vers l'extérieur, loin du Soi.
Ainsi, le thanatos contribue indirectement au fait que l'agressivité soit manifestée et dirigée vers autrui.
Le concept de pulsion de mort a en fait été rejeté par de nombreux étudiants de Freud. La seule lueur d’espoir réside dans le fait que l’expression extérieure des émotions qui accompagnent l’agression peut libérer une énergie destructrice et ainsi réduire la probabilité que des actions plus dangereuses se produisent.
Les approches qui seront discutées convergent vers la reconnaissance que la prédisposition d’une personne à l’agressivité est une conséquence de l’influence sélection naturelle.
Approche éthologique. Selon Lorenz, l'agressivité provient principalement de l'instinct inné de lutte pour la survie, présent chez l'homme comme chez les autres êtres vivants. Cet instinct s'est développé au cours d'une longue période d'évolution.
Il croyait que l'énergie agressive (ayant sa source dans l'instinct de combat) est générée dans le corps de manière spontanée, continue, à un rythme constant, s'accumulant régulièrement au fil du temps. Plus la quantité d’énergie agressive disponible à ce moment est grande, moins il faut de force pour que l’agression « éclabousse » vers l’extérieur.
Selon Lorenz, en plus de l'instinct inné de lutte, tous les êtres vivants sont dotés de la capacité de réprimer leurs aspirations ; ces dernières varient en fonction de leur capacité à infliger de graves dégâts à leurs victimes. Ainsi, prédateurs dangereux, par exemple, les lions, que la nature a généreusement dotés de tout le nécessaire pour réussir à tuer d'autres êtres vivants (avec d'énormes griffes, dents), ont un pouvoir dissuasif très puissant qui les empêche d'attaquer les représentants de leur espèce, tandis que des créatures moins dangereuses - les gens - ont une dissuasion beaucoup plus faible.
Lorenz pensait que s'engager dans une variété d'activités non nocives pourrait empêcher l'énergie agressive d'atteindre des niveaux dangereux et ainsi réduire le risque d'explosions de violence.
Hypothèse de chasse. Andri prétend qu'en raison de la sélection naturelle, le nouveau genre- des chasseurs qui attaquaient pour ne pas mourir de faim. Cette « nature de chasseur » est à la base de l’agressivité humaine.
Andri assure que c'est l'instinct de chasse, résultat de la sélection naturelle, combiné au développement du cerveau et à l'apparition d'armes frappant à distance, qui a formé l'homme comme une créature qui attaque activement les représentants de sa propre espèce.
Approche sociobiologique.
Les sociobiologistes le prouvent. Les individus sont susceptibles de promouvoir la survie de ceux qui partagent des gènes similaires (c'est-à-dire leurs proches) par altruisme et abnégation, et se comporteront de manière agressive envers ceux qui sont différents ou sans lien avec eux, c'est-à-dire ceux qui en ont le moins sont susceptibles être des gènes communs.
Au cours de près de 80 ans d'études socio-psychologiques sur l'agressivité, diverses théories, expliquant raisons de son apparition. Pouvez-vous souligner trois principaux points de vue influents:
selon l'un d'eux - l'agressivité est une forme de comportement déterminé par des instincts et des impulsions innés ;
selon l'autre est l'agression, comme d'autres formes de comportement , acquis à la suite d'une expérience individuelle ;
troisième, intermédiaire point de vue, relie motivation et acquisition, hypothèse frustration-agression.
Tous refléter les points de vue et l’expérience empirique spécifique des chercheurs Et écoles psychologiques de différentes époques.
*Considérons l'épisode suivant, qui se déroule dans un bar d'une ville ordinaire et, malheureusement, est courant ces derniers temps. Autour du bar se pressent des jeunes, parmi lesquels se trouve un groupe de personnes originaires du Caucase (Chine, Afrique), vivant et travaillant dans la même ville. Deux jeunes hommes (russes) commencèrent à se disputer, de plus en plus passionnés. Soudain, l'un d'eux se lève d'un bond, crie après l'Azerbaïdjanais et le frappe au menton.
Essayons d'analyser cet épisode à partir de diverses constructions théoriques.
L'agressivité comme instinct
considéré par deux approches théoriques influentes – psychanalytique et éthologique.
Approche psychanalytique
L’un des fondateurs de cette théorie est sans aucun doute le 3. Freud. Il croyait qu'il existe deux instincts innés les plus puissants chez l'homme : instinct de vie, Éros, Et instinct de mort - Thanatos. Le premier était considéré comme les aspirations associées aux tendances créatives du comportement humain : amour, soins, intimité . Le second porte l'énergie de destruction, sa tâche est « d'amener tout ce qui vit organiquement à un état sans vie » - c'est de la colère, de la haine, de la destructivité .
Quand l'instinct de mort orienté vers l'intérieur, s'exprime alors dans auto-punition, dont la forme extrême est le suicide une fois converti vers l'extérieur, puis s'exprime dans l'hostilité, le désir de destruction, de meurtre.
Freud était convaincu que, tout comme la tension sexuelle est réduite par l'activité sexuelle, énergie agressive doit aussi d'une manière ou d'une autre sors. Si les gens ne laisse pas ton agressivité s'exprimer, son énergie grandira, et avec elle la tension grandira ; l'énergie cherchera un exutoire, soit en explosant en actes d'une violence extrême, soit en s'exprimant par des symptômes de maladie mentale. Cela a conduit à l'idée " catharsis».
Catharsis(littéralement « purification des émotions ») est le processus de libération de l'excitation ou de l'énergie stockée, entraînant une diminution des niveaux de tension.
Hostile et tendances agressives peut être exprimé Pas de manière destructrice, Par exemple, par sarcasme ou fantaisie, ils peuvent être sublimer, c'est-à-dire envoyerénergie destructrice conforme à un comportement acceptable ou socialement utile.
1.1.2 Approche éthologique.
Le thème du conditionnement de l'agression humaine, principalement par des facteurs biologiques, a reçu un nouveau son dans les temps modernes grâce aux travaux de l'un des fondateurs de l'éthologie - K. Lorenza. Il a affirmé que l'instinct agressif signifiait beaucoup dans le processus d'évolution, de survie et d'adaptation humaine. Le développement rapide de la pensée et du progrès scientifiques et techniques a dépassé la maturation biologique et psychologique naturelle de l'homme et a conduit à ralentir le développement des mécanismes inhibiteurs de l’agressivité ce qui est inévitable implique une expression extérieure périodique d’agressivité. Dans le cas contraire, les tensions internes vont s’accumuler et créer une « pression » à l’intérieur du corps jusqu’à provoquer l’apparition d’un comportement incontrôlable (principe du défoulement d’une chaudière de locomotive).
Il convient cependant de noter que le « modèle psychohydraulique » de K. Lorenz reposait principalement sur le transfert souvent injustifié des résultats de recherche obtenus sur les animaux vers le comportement humain. Aux autres point faible de la théorie de l'instinctétait façons prédéterminées de gérer l’agressivité. On croyait qu'une personnene pourra jamais faire face à son agressivité . Et comme l'accumulation d'agressivité va certainement doit être répondu, alors le seul espoir reste de l'orienter dans la bonne direction. Les partisans de la théorie de l'instinct croient que le plus une forme civilisée de désamorçage de l'agression pour une personne sont compétition, divers types de compétitions, exercice physique et participation à des compétitions sportives.
Dans cette section, nous examinerons trois perspectives évolutives sur le comportement agressif humain. Les preuves à l'appui de ces théories provenaient principalement d'observations du comportement animal. Les trois approches qui seront discutées convergent vers la reconnaissance que la prédisposition d’une personne à l’agressivité est une conséquence de l’influence de la sélection naturelle. On prétend que l’agression a procuré des avantages biologiques à nos ancêtres préhistoriques.
1) Approche éthologique.
Lorenz (1966, 1964), lauréat prix Nobel, un éminent éthologue, a adopté une approche évolutionniste de l'agression, montrant des similitudes surprenantes avec la position de Freud.
Selon Lorenz, l'agressivité provient principalement de l'instinct inné de lutte pour la survie, présent chez l'homme ainsi que chez les autres êtres vivants. Il supposait que cet instinct s’était développé au cours d’une longue période d’évolution, comme en témoignent ses trois fonctions importantes.
Premièrement, les combats dispersent les espèces sur une vaste zone géographique, garantissant ainsi une utilisation maximale des ressources alimentaires disponibles.
Deuxièmement, l'agressivité contribue à améliorer le fonds génétique de l'espèce du fait que seuls les individus les plus forts et les plus énergiques pourront laisser une progéniture.
Enfin, les animaux forts sont mieux à même de se défendre et d’assurer la survie de leur progéniture.
Alors que Freud n'avait pas d'opinion claire concernant l'accumulation et la décharge de l'énergie pulsionnelle agressive, Lorenz avait une vision très précise sur ce problème. Il croyait que l'énergie agressive (qui prend sa source dans l'instinct de combat) est générée dans le corps de manière spontanée, continue, à un rythme constant, s'accumulant régulièrement dans le temps.
Ainsi, le déploiement d’actions ouvertement agressives est une fonction conjointe
1) la quantité d'énergie agressive accumulée et
2) la présence et la force de stimuli spéciaux facilitant la décharge d'agressivité dans l'environnement immédiat.
Autrement dit, Plus la quantité d’énergie agressive disponible à un moment donné est grande, moins il faut de force pour que l’agression « éclabousse » vers l’extérieur. En fait, si depuis le dernier manifestation agressive suffisamment de temps s'est écoulé, un tel comportement peut se développer spontanément, en l'absence absolue de stimulus déclencheur. Comme le note Lorenz (Evans, 1974), « chez certains animaux, l'agressivité correspond à toutes les règles d'abaissement de seuil et de comportement instinctif. Vous pouvez observer l'animal en prévision du danger ; une personne peut aussi se comporter de la même manière.
L’une des implications les plus intéressantes de la théorie de Lorenz est qu’elle peut expliquer le fait que les humains, contrairement à la plupart des autres êtres vivants, exercent une violence généralisée contre les membres de leur propre espèce. Selon Lorenz, en plus de l'instinct inné de lutte, tous les êtres vivants sont dotés de la capacité de réprimer leurs aspirations ; ces dernières varient en fonction de leur capacité à infliger de graves dommages à leurs victimes. Ainsi, les prédateurs dangereux, par exemple les lions et les tigres, que la nature a généreusement dotés de tout le nécessaire pour réussir à tuer d'autres êtres vivants (agilité, griffes et dents énormes), disposent d'un pouvoir dissuasif très puissant qui les empêche d'attaquer les représentants de leur propre espèce, tandis que les créatures moins dangereuses - les humains - ont un principe de retenue beaucoup plus faible. Lorsqu’à l’aube de l’histoire de l’humanité, les hommes et les femmes utilisaient leurs dents et leurs poings pour agir de manière agressive contre leurs compatriotes, l’absence des restrictions mentionnées ci-dessus n’était pas si terrible. Après tout, la probabilité qu’ils puissent se blesser gravement était relativement faible. Cependant, les progrès technologiques ont rendu possible l'émergence d'armes de destruction massive et, à cet égard, l'auto-indulgence présente un danger croissant : la survie de l'homme en tant qu'espèce est en danger. En bref, Lorenz a interprété le désir des dirigeants du monde d’exposer des nations entières au risque d’autodestruction à la lumière du fait que la capacité humaine de violence prévaut sur les moyens de dissuasion innés qui répriment les actions agressives.
Bien que Lorenz, comme Freud, croyait que l'agressivité était inévitable, en grande partie une conséquence de forces innées, il était plus optimiste quant à la possibilité de réduire l'agressivité et de contrôler ce comportement. Il pensait que s'engager dans une variété d'activités non nocives pourrait empêcher l'énergie agressive d'atteindre des niveaux dangereux et ainsi réduire la probabilité d'explosions de violence. Il est peut-être un peu exagéré de dire que la menace de violence d'une personne peut être évitée grâce à mille autres actions (Zillmann, 1979). Lorenz a également soutenu que l'amour et l'amitié peuvent être incompatibles avec l'expression d'une agression ouverte et bloquer sa manifestation.
2) Hypothèse de chasse
Ardrey, scénariste hollywoodien et « archéologue amateur » (Munger, 1971), a écrit plusieurs livres qui ont fait découvrir à de nombreuses personnes la version populaire de la théorie évolutionniste. Ardrey affirme qu'à la suite de la sélection naturelle, une nouvelle espèce est apparue : les chasseurs : « Nous avons attaqué pour ne pas mourir de faim. Nous avons ignoré les dangers, sinon nous aurions cessé d'exister. Nous nous sommes adaptés à la chasse anatomiquement et physiologiquement » (Ardrey, 1970). Cette « nature » de chasse est à la base de l’agressivité humaine.
Deux autres inventions, ancrées dans le besoin humain de « tuer pour vivre » (Ardrey, 1976), rendent possible la participation à la violence sociale et à la guerre.
Premièrement, afin de réussir à chasser en groupe, les humains ont développé un langage pour communiquer qui contenait des concepts tels que « ami » et « ennemi », « nous » et « eux », qui servaient à justifier des actions agressives contre les autres.
Deuxièmement, l’avènement des armes à longue portée telles que les arcs et les flèches (au lieu des massues et des pierres) a permis aux humains de devenir des « prédateurs armés » plus efficaces.
Dans une conversation avec Richard Leakey, un anthropologue renommé, Ardrey a expliqué l’importance de l’invention de telles armes : « Une fois que nous avons eu cette chose offensive, tuer est devenu tellement plus facile que, grâce à la violence, nous sommes devenus des créatures différentes » (Munger, 1971). Donc, Ardrey assure que c'est l'instinct de chasse, résultat de la sélection naturelle, combiné au développement du cerveau et à l'apparition d'armes frappant à distance, qui a formé l'homme comme une créature qui attaque activement les représentants de sa propre espèce..
3) Approche sociobiologique.
Contrairement aux partisans de la théorie évolutionniste, les sociobiologistes proposent une base plus spécifique pour expliquer le processus de sélection naturelle. Leur principal argument se résume au suivant. L’influence des gènes est si durable parce qu’ils assurent un comportement adaptatif, c’est-à-dire que les gènes sont « adaptés » à tel point qu’ils contribuent au succès de la reproduction, assurant ainsi leur persistance dans les générations futures (Barach, 1977). Ainsi, les sociobiologistes affirment que les individus sont plus susceptibles de promouvoir la survie de ceux qui partagent des gènes similaires (c'est-à-dire les membres de leur famille) par l'altruisme et le sacrifice de soi, et qu'ils se comporteront de manière agressive envers ceux qui sont différents ou sans lien avec eux. est le moins susceptible d’avoir des gènes communs. Ils saisiront toutes les occasions pour leur nuire et éventuellement limiter la capacité de ces derniers à avoir une progéniture avec des membres de leur propre clan.
Selon l'approche sociobiologique, les interactions agressives avec les concurrents sont l'un des moyens d'augmenter le succès de la reproduction dans un environnement aux ressources limitées - manque de nourriture ou de partenaires de mariage. Apparemment, une reproduction réussie est plus probable si l’individu dispose de suffisamment de nourriture et de partenaires avec lesquels se reproduire. Cependant, l’agressivité n’augmentera la valeur génétique d’un individu donné que si les bénéfices qui en découlent dépassent l’effort déployé. Le coût potentiel de l'agression dépend du risque de mort ou de préjudice grave pour les individus qui doivent survivre pour assurer la survie de leur progéniture. La condition génétique d’une personne ne s’améliorera pas si une concurrence agressive conduit à la disparition de sa lignée. Ainsi, les sociobiologistes nous convainquent de ce qui suit : L'agression est un moyen par lequel les individus tentent d'obtenir leur part des ressources, ce qui garantit le succès (principalement au niveau génétique) de la sélection naturelle..
4) Critique des approches évolutionnistes.
Bien que les différentes théories évolutionnistes diffèrent les unes des autres à bien des égards, leurs critiques reposent sur des arguments similaires. Les critiques soulèvent des questions de preuves, exigeant la nécessité de prendre en compte d'autres facteurs susceptibles de contribuer à l'agression ou au calme ; Par ailleurs, se pose le problème de la définition de la notion d’« adaptabilité ». Premièrement, les partisans de l’approche évolutionniste ne fournissent pas de preuves directes en faveur des concepts sur lesquels reposent leurs arguments. Par exemple, aucun gène directement associé au comportement agressif n’a été trouvé. De même, la notion d'énergie agressive de Lorenz n'a pas été soutenue (Zillmann, 1979). Un autre aspect du problème des preuves est que les arguments sont basés sur des observations du comportement animal (Johnson, 1972 ; Tinbergen, 1978). L'expérience consistant à généraliser les observations d'êtres vivants dont le cerveau est plus primitif et moins influencés par le contrôle social et culturel que les humains est également critiquée.
Certains critiques ont accusé les éthologues et les sociobiologistes d’avoir tendance à oublier la variabilité du comportement humain dans leurs théories (Baldwin & Baldwin, 1981 ; Gold, 1978). Gould (1978) soutient que notre hérédité biologique fournit la base potentielle d'un très large éventail de comportements qui incluent, sans toutefois s'y limiter, l'agression et la violence.
Pourquoi sommes-nous censés avoir des gènes d'agressivité, de domination ou de colère quand nous savons que l'extraordinaire flexibilité du cerveau nous permet d'être agressifs ou pacifiques, dominants ou soumis, colériques ou généreux ? La violence, le sexisme et la promiscuité généralisée sont de nature biologique car ils représentent un sous-système d'un large éventail de modèles de comportement. Mais la paix, l’égalité et la gentillesse sont définitivement d’origine biologique. Ainsi, ma critique met en avant le concept de potentialité biologique par opposition au concept de déterminisme biologique : le cerveau régule un large éventail de comportements humains, et il n'a pas de prédisposition exclusive à une quelconque forme de comportement...
Enfin, la logique même du raisonnement sur les manifestations d’adaptabilité de tout comportement est discutable. Par exemple, les sociobiologistes admettent : si le comportement existe, alors il doit être adaptatif. Baldwin & Baldwin (1981) donnent l'exemple de la fonction adaptative de l'acné pour démontrer l'absurdité de cette pensée paradoxale : « L'acné est nécessaire pour qu'une personne prenne soin de son apparence, ce qui, à son tour, augmente la probabilité d'avoir des rapports sexuels - d’où l’héritage des gènes responsables de l’acné.
La position théorique la plus ancienne et peut-être la plus connue concernant l’agression est que le comportement est principalement de nature instinctive. Selon cette approche assez courante, l’agression se produit parce que les êtres humains sont génétiquement ou constitutionnellement « programmés » pour agir de telle manière.
L'agressivité comme comportement instinctif : une approche psychanalytique
Dans ses premiers écrits, Freud soutenait que tout comportement humain découlait, directement ou indirectement, de l’éros, l’instinct de vie, dont l’énergie (connue sous le nom de libido) est dirigée vers la promotion, la préservation et la reproduction de la vie. Dans ce contexte général, l’agressivité était considérée simplement comme une réaction au blocage ou à la destruction des pulsions libidinales. L'agression en tant que telle n'était interprétée ni comme faisant partie intégrante, ni comme une partie constante et inévitable de la vie.
Ayant vécu la violence de la Première Guerre mondiale, Freud (1920) en est progressivement arrivé à une conception plus sombre quant à la nature et à la source de l’agression. Il a suggéré l'existence d'un deuxième instinct fondamental, le thanatos, la pulsion de mort, dont l'énergie vise la destruction et la cessation de la vie. Il a soutenu que tout comportement humain est le résultat d’une interaction complexe entre cet instinct et l’éros et qu’il existe une tension constante entre eux. Parce qu'il existe un conflit aigu entre la préservation de la vie (c'est-à-dire l'eros) et sa destruction (thanatos), d'autres mécanismes (tels que le déplacement) servent à diriger l'énergie du thanatos vers l'extérieur, loin du Soi.
Ainsi, le thanatos contribue indirectement au fait que l'agressivité soit manifestée et dirigée vers autrui. La théorie de Freud sur l'interaction de l'éros et du thanatos est présentée dans la Fig. 1.2.
La position sur l’instinct de lutte vers la mort est l’une des plus controversées de la théorie de la psychanalyse. Cette idée a en fait été rejetée par de nombreux étudiants de Freud qui partageaient ses vues sur d'autres questions (Fenichel, 1945 ; Fine, 1978 ; Hartmann, Kris et Lowenstein, 1949). Néanmoins, l’affirmation selon laquelle l’agressivité provient de forces innées et instinctives a généralement trouvé du soutien, même parmi ces critiques.
Les opinions de Freud sur les origines et la nature de l'agression sont extrêmement pessimistes. Ce comportement est non seulement inné, provenant de l'instinct de mort « intégré » chez une personne, mais aussi inévitable, car si l'énergie du thanatos n'est pas tournée vers l'extérieur, elle conduira bientôt à la destruction de l'individu lui-même. La seule lueur d’espoir réside dans le fait que l’expression extérieure des émotions qui accompagnent l’agression peut libérer une énergie destructrice et ainsi réduire la probabilité que des actions plus dangereuses se produisent. Cet aspect de la théorie de Freud (catharsis) a souvent été interprété comme suit : l'exécution d'actions expressives qui ne sont pas accompagnées de
Le désordre peut être un moyen efficace de prévenir des comportements plus dangereux. Cependant, une connaissance plus approfondie des œuvres de Freud révèle des arguments contre de telles affirmations. Bien que Freud n’ait pas de position claire sur la force et la durée de la catharsis, il avait tendance à croire que cet effet était minime et de courte durée. Ainsi, Freud était moins optimiste sur ce point que ne le croyaient les théoriciens ultérieurs.
L'agression comme comportement instinctif : un regard sur le problème sous l'angle d'une approche évolutive
Dans cette section, nous examinerons trois perspectives évolutives sur le comportement agressif humain. Les preuves à l'appui de ces théories provenaient principalement d'observations du comportement animal. Les trois approches qui seront discutées convergent vers la reconnaissance que la prédisposition d’une personne à l’agressivité est une conséquence de l’influence de la sélection naturelle. On prétend que l’agression a procuré des avantages biologiques à nos ancêtres préhistoriques.
Approche éthologique. Lorenz (1966, 1964), lauréat du prix Nobel et éminent éthologue, a adopté une approche évolutionniste de l'agression, montrant des similitudes surprenantes avec la position de Freud.
Selon Lorenz, l'agressivité provient principalement de l'instinct inné de lutte pour la survie, présent chez l'homme ainsi que chez les autres êtres vivants. Il supposait que cet instinct s’était développé au cours d’une longue période d’évolution, comme en témoignent ses trois fonctions importantes. Premièrement, les combats dispersent les espèces sur une vaste zone géographique, garantissant ainsi une utilisation maximale des ressources alimentaires disponibles. Deuxièmement, l'agressivité contribue à améliorer le fonds génétique de l'espèce du fait que seuls les individus les plus forts et les plus énergiques pourront laisser une progéniture. Enfin, les animaux forts sont mieux à même de se défendre et d’assurer la survie de leur progéniture.
Alors que Freud n'avait pas d'opinion claire concernant l'accumulation et la décharge de l'énergie pulsionnelle agressive, Lorenz avait une vision très précise sur ce problème. Il croyait que l'énergie agressive (ayant sa source dans l'instinct de combat) est générée dans le corps de manière spontanée, continue, à un rythme constant, s'accumulant régulièrement au fil du temps. Ainsi, le déploiement d’actions ouvertement agressives est une fonction conjointe de 1) la quantité d’énergie agressive accumulée et 2) de la présence et de la force de stimuli spéciaux facilitant la décharge d’agressivité dans l’environnement immédiat. En d’autres termes, plus la quantité d’énergie agressive disponible à un moment donné est grande, moins il faut de force avec le stimulus pour que l’agression « éclabousse » vers l’extérieur. En fait, si suffisamment de temps s'est écoulé depuis la dernière manifestation agressive, un tel comportement peut se développer spontanément, en l'absence absolue de stimulus déclencheur. Comme le note Lorenz (Evans, 1974), « chez certains animaux, l'agressivité correspond à toutes les règles d'abaissement de seuil et de comportement instinctif. Vous pouvez observer l'animal en prévision du danger ; une personne peut aussi se comporter de la même manière. Les hypothèses sur la relation entre les stimuli libérant l'agressivité et la quantité d'énergie agressive accumulée sont présentées sous la forme d'un graphique sur la figure. 13.
L’une des implications les plus intéressantes de la théorie de Lorenz est qu’elle peut expliquer le fait que les humains, contrairement à la plupart des autres êtres vivants, exercent une violence généralisée contre les membres de leur propre espèce. Selon Lorenz, en plus de l'instinct inné de lutte, tous les êtres vivants sont dotés de la capacité de réprimer leurs aspirations ; ces dernières varient en fonction de leur capacité à infliger de graves dommages à leurs victimes. Ainsi, les prédateurs dangereux, par exemple les lions et les tigres, que la nature a généreusement dotés de tout le nécessaire pour réussir à tuer d'autres êtres vivants (agilité, énormes griffes et dents), disposent d'un pouvoir dissuasif très puissant qui les empêche d'attaquer leurs proies.
agents de leur propre espèce, tandis que les créatures moins dangereuses - les humains - ont un principe de retenue beaucoup plus faible. Lorsqu’à l’aube de l’histoire de l’humanité, les hommes et les femmes utilisaient leurs dents et leurs poings pour agir de manière agressive contre leurs compatriotes, l’absence des restrictions mentionnées ci-dessus n’était pas si terrible. Après tout, la probabilité qu’ils puissent se blesser gravement était relativement faible. Cependant, les progrès technologiques ont rendu possible l'émergence d'armes de destruction massive et, à cet égard, l'auto-indulgence présente un danger croissant : la survie de l'homme en tant qu'espèce est en danger.
En bref, Lorenz a interprété le désir des dirigeants du monde d’exposer des nations entières au risque d’autodestruction à la lumière du fait que la capacité humaine de violence prévaut sur les moyens de dissuasion innés qui répriment les actions agressives.
Bien que Lorenz, comme Freud, croyait que l'agressivité était inévitable, en grande partie une conséquence de forces innées, il était plus optimiste quant à la possibilité de réduire l'agressivité et de contrôler ce comportement. Il pensait que s'engager dans une variété d'activités non nocives pourrait empêcher l'énergie agressive d'atteindre des niveaux dangereux et ainsi réduire la probabilité d'explosions de violence. Il est peut-être un peu exagéré de dire que la menace de violence d'une personne peut être évitée grâce à mille autres actions (Zillmann, 1979). Lorenz a également soutenu que l'amour et l'amitié peuvent être incompatibles avec l'expression d'une agression ouverte et bloquer sa manifestation.
Hypothèse de chasse. Ardrey, scénariste hollywoodien et « archéologue amateur » (Munger, 1971), a écrit plusieurs livres qui ont fait découvrir à de nombreuses personnes la version populaire de la théorie évolutionniste. Ardrey affirme qu'à la suite de la sélection naturelle, une nouvelle espèce est apparue : les chasseurs : « Nous avons attaqué pour ne pas mourir de faim. Nous avons ignoré les dangers, sinon nous aurions cessé d'exister. Nous nous sommes adaptés à la chasse anatomiquement et physiologiquement » (Ardrey, 1970). Cette « nature » de chasse est à la base de l’agressivité humaine.
Deux autres inventions, ancrées dans le besoin humain de « tuer pour vivre » (Ardrey, 1976), rendent possible la participation à la violence sociale et à la guerre. Premièrement, afin de réussir à chasser en groupe, les humains ont développé un langage pour communiquer qui contenait des concepts tels que « ami » et « ennemi », « nous » et « eux », qui servaient à justifier des actions agressives contre les autres. Deuxièmement, l’avènement des armes à longue portée telles que les arcs et les flèches (au lieu des massues et des pierres) a permis aux humains de devenir des « prédateurs armés » plus efficaces. Dans une conversation avec Richard Leakey, un anthropologue renommé, Ardrey a expliqué l’importance de l’invention de telles armes : « Une fois que nous avons eu cette chose offensive, tuer est devenu tellement plus facile que, grâce à la violence, nous sommes devenus des créatures différentes » (Munger, 1971). Ainsi, Ardrey assure que c'est l'instinct de chasse, résultat de la sélection naturelle, combiné au développement du cerveau et à l'apparition d'armes frappant à distance, qui a formé l'homme comme une créature qui attaque activement les représentants de sa propre espèce. .
Approche sociobiologique. Contrairement aux partisans de la théorie évolutionniste, les sociobiologistes proposent une base plus spécifique pour expliquer le processus de sélection naturelle. Leur principal argument se résume au suivant. L’influence des gènes est si durable parce qu’ils assurent un comportement adaptatif, c’est-à-dire que les gènes sont « adaptés » à tel point qu’ils contribuent au succès de la reproduction, assurant ainsi leur persistance dans les générations futures (Barach, 1977). Ainsi, les sociobiologistes affirment que les individus sont plus susceptibles de promouvoir la survie de ceux qui partagent des gènes similaires (c'est-à-dire les membres de leur famille) par l'altruisme et le sacrifice de soi, et qu'ils se comporteront de manière agressive envers ceux qui sont différents ou sans lien avec eux. est le moins susceptible d’avoir des gènes communs. Ils saisiront toutes les occasions pour leur nuire et éventuellement limiter la capacité de ces derniers à avoir une progéniture avec des membres de leur propre clan.
Selon l'approche sociobiologique, les interactions agressives avec les concurrents sont l'un des moyens d'augmenter le succès de la reproduction dans un environnement aux ressources limitées - manque de nourriture ou de partenaires de mariage. Apparemment, une reproduction réussie est plus probable si l’individu dispose de suffisamment de nourriture et de partenaires avec lesquels se reproduire. Cependant, l’agressivité n’augmentera la valeur génétique d’un individu donné que si les bénéfices qui en découlent dépassent l’effort déployé. Le coût potentiel de l'agression dépend du risque de mort ou de préjudice grave pour les individus qui doivent survivre pour assurer la survie de leur progéniture. La condition génétique d’une personne ne s’améliorera pas si une concurrence agressive conduit à la disparition de sa lignée. Ainsi, les sociobiologistes nous convainquent de ce qui suit : l'agressivité est un moyen par lequel les individus tentent d'obtenir leur part de ressources, ce qui, à son tour, garantit le succès (principalement au niveau génétique) de la sélection naturelle.
Critique des approches évolutionnistes. Bien que les différentes théories évolutionnistes diffèrent les unes des autres à bien des égards, leurs critiques reposent sur des arguments similaires. Les critiques soulèvent des questions de preuves, exigeant la nécessité de prendre en compte d'autres facteurs susceptibles de contribuer à l'agression ou au calme ; Par ailleurs, se pose le problème de la définition de la notion d’« adaptabilité ». Premièrement, les partisans de l’approche évolutionniste ne fournissent pas de preuves directes en faveur des concepts sur lesquels reposent leurs arguments. Par exemple, aucun gène directement associé au comportement agressif n’a été trouvé. De même, la notion d'énergie agressive de Lorenz n'a pas été soutenue (Zillmann, 1979). Un autre aspect du problème des preuves est que les arguments sont basés sur des observations du comportement animal (Johnson, 1972 ; Tinbergen, 1978). L'expérience consistant à généraliser les observations d'êtres vivants dont le cerveau est plus primitif et moins influencés par le contrôle social et culturel que les humains est également critiquée.
Certains critiques ont accusé les éthologues et les sociobiologistes d’avoir tendance à oublier la variabilité du comportement humain dans leurs théories (Baldwin & Baldwin, 1981 ; Gold, 1978). Gould (1978) soutient que notre hérédité biologique fournit la base potentielle d'un très large éventail de comportements qui incluent, sans toutefois s'y limiter, l'agression et la violence.
Pourquoi sommes-nous censés avoir des gènes d'agressivité, de domination ou de colère quand nous savons que l'extraordinaire flexibilité du cerveau nous permet d'être agressifs ou pacifiques, dominants ou soumis, colériques ou généreux ? La violence, le sexisme et la promiscuité généralisée sont de nature biologique car ils représentent un sous-système d'un large éventail de modèles de comportement. Mais la paix, l’égalité et la gentillesse sont définitivement d’origine biologique. Ainsi, ma critique met en avant le concept de potentialité biologique par opposition au concept de déterminisme biologique : le cerveau régule un large éventail de comportements humains, et il n'a pas de prédisposition exclusive à une quelconque forme de comportement...
Enfin, la logique même du raisonnement sur les manifestations d’adaptabilité de tout comportement est discutable. Par exemple, les sociobiologistes admettent : si le comportement existe, alors il doit être adaptatif. Baldwin & Baldwin (1981) donnent l'exemple de la fonction adaptative de l'acné pour démontrer l'absurdité de cette pensée paradoxale : « L'acné est nécessaire pour qu'une personne prenne soin de son apparence, ce qui, à son tour, augmente la probabilité d'avoir des rapports sexuels - d’où l’héritage des gènes responsables de l’acné.