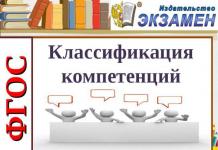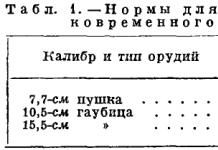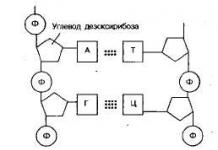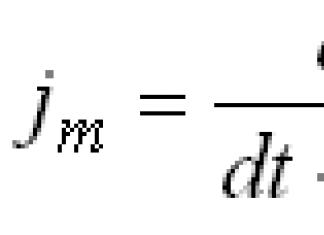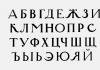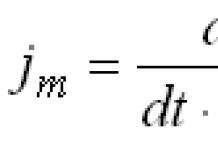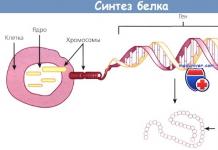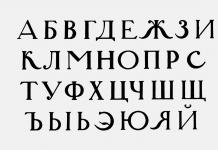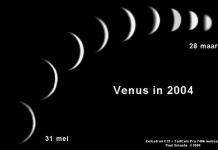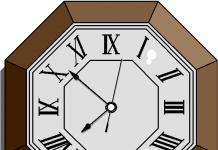Les événements révolutionnaires de 1917 et la guerre civile qui a suivi ont été un désastre pour une grande partie des citoyens russes, qui ont été contraints de quitter leur patrie et de se retrouver hors de ses frontières. Le mode de vie séculaire a été bouleversé, les liens familiaux ont été rompus. L’émigration des Blancs est une tragédie, mais le pire, c’est que beaucoup n’ont pas réalisé comment cela pouvait se produire. Seul l’espoir de retourner dans mon pays natal m’a donné la force de vivre.
Étapes de l'émigration
Les premiers émigrés, plus clairvoyants et plus riches, commencèrent à quitter la Russie au début de 1917. Ils ont pu obtenir un bon travail, disposer des fonds nécessaires pour obtenir divers documents, permis et choisir un lieu de résidence pratique. Dès 1919, l’émigration des Blancs était massive et ressemblait de plus en plus à une fuite.
Les historiens le divisent généralement en plusieurs étapes. Le début du premier est associé à l'évacuation en 1920 de Novorossiysk des forces armées du sud de la Russie ainsi que de leur état-major sous le commandement d'A.I. Denikine. La deuxième étape est l'évacuation de l'armée sous le commandement du baron P. N. Wrangel, qui quittait la Crimée. La troisième étape finale - défaite face aux bolcheviks et fuite honteuse des troupes de l'amiral V.V. Kolchak en 1921 du territoire Extrême Orient. Le nombre total d'émigrants russes varie de 1,4 à 2 millions de personnes.

Composition de l'émigration
La majorité du nombre total de citoyens qui ont quitté leur pays d’origine était une émigration militaire. C'étaient pour la plupart des officiers, des cosaques. Rien qu’au cours de la première vague, environ 250 000 personnes ont quitté la Russie. Ils espéraient revenir bientôt, ils sont partis pour une courte période, mais il s'est avéré qu'ils sont partis pour toujours. La deuxième vague comprenait des officiers fuyant les persécutions bolcheviques, qui espéraient également un retour rapide. C’est l’armée qui constituait l’épine dorsale de l’émigration blanche en Europe.
Les personnes suivantes sont également devenues des émigrants :
- les prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale qui se trouvaient en Europe ;
- employés des ambassades et divers bureaux de représentation Empire russe qui ne voulait pas entrer au service du gouvernement bolchevique ;
- nobles;
- les fonctionnaires ;
- des représentants du monde des affaires, du clergé, de l'intelligentsia et d'autres résidents de Russie qui ne reconnaissaient pas le pouvoir des Soviétiques.
La plupart d’entre eux ont quitté le pays avec toute leur famille.
Initialement, les États voisins qui recevaient le principal flux d'émigration russe étaient la Turquie, la Chine, la Roumanie, la Finlande, la Pologne et les pays baltes. Ils n’étaient pas prêts à recevoir une telle masse de personnes, pour la plupart armées. Pour la première fois dans l'histoire du monde, un événement sans précédent a été observé : l'émigration d'un pays.
La plupart des émigrés n'ont pas combattu, c'étaient des gens effrayés par la révolution. Conscient de cela, le 3 novembre 1921, le gouvernement soviétique déclara une amnistie pour la base des Gardes blancs. Les Soviétiques n’avaient aucune plainte contre ceux qui ne combattaient pas. Plus de 800 000 personnes sont rentrées dans leur pays.

Émigration militaire russe
L'armée de Wrangel a été évacuée sur 130 navires de différents types, militaires et civils. Au total, 150 000 personnes ont été emmenées à Constantinople. Les navires transportant des passagers sont restés en rade pendant deux semaines. Ce n'est qu'après de longues négociations avec le commandement d'occupation français qu'il fut décidé de placer les personnes dans trois camps militaires. Ainsi se termina l’évacuation de l’armée russe de la partie européenne de la Russie.
Il a été déterminé que le lieu principal du personnel militaire évacué était un camp près de Gallipoli, situé sur la rive nord du détroit des Dardanelles. Le 1er corps d'armée était stationné ici sous le commandement du général A. Kutepov.
Les soldats du Don et du Kouban ont été placés dans deux autres camps, situés à Chalataj, près de Constantinople et sur l'île de Lemnos. À la fin de 1920, 190 000 personnes figuraient sur les listes du Bureau d'enregistrement, dont 60 000 militaires et 130 000 civils.

Siège de Gallipoli
Le camp le plus célèbre du 1er corps d’armée d’A. Kutepov évacué de Crimée se trouvait à Gallipoli. Au total, plus de 25 000 militaires, 362 fonctionnaires et 142 médecins et aides-soignants étaient stationnés ici. En plus d'eux, le camp comptait 1 444 femmes, 244 enfants et 90 élèves - des garçons de 10 à 12 ans.
La séance de Gallipoli est entrée dans l’histoire de la Russie au début du XXe siècle. Les conditions de vie étaient terribles. Les officiers et soldats de l'armée, ainsi que les femmes et les enfants, étaient hébergés dans l'ancienne caserne. Ces bâtiments étaient totalement impropres à la vie hivernale. Les maladies ont commencé, que les gens affaiblis et à moitié nus ont endurés avec difficulté. Au cours des premiers mois de résidence, 250 personnes sont mortes.
En plus de la souffrance physique, les gens ont vécu une angoisse mentale. Les officiers qui menaient les régiments au combat, commandaient les batteries et les soldats qui combattaient pendant la Première Guerre mondiale se trouvaient dans la position humiliante de réfugiés sur des côtes étrangères et désertes. N'ayant pas de vêtements normaux, se retrouvant sans moyens de subsistance, ne connaissant pas la langue et n'ayant d'autre profession que militaire, ils se sentaient comme des enfants sans abri.
Grâce au général de l'Armée blanche A. Kutepov, aucune démoralisation supplémentaire des personnes qui se trouvaient dans des conditions insupportables ne s'est produite. Il comprit que seules la discipline et le travail quotidien de ses subordonnés pouvaient les protéger de la décadence morale. L'entraînement militaire a commencé et des défilés ont eu lieu. L'allure et l'apparence des militaires russes surprenaient de plus en plus les délégations françaises visitant le camp.
Des concerts, des concours ont eu lieu, des journaux ont été publiés. Des écoles militaires ont été organisées, dans lesquelles 1 400 cadets ont été formés, il y avait une école d'escrime, un studio de théâtre, deux théâtres, des clubs chorégraphiques, un gymnase, Jardin d'enfants et beaucoup plus. 8 églises ont tenu des services. Il y avait 3 postes de garde pour les contrevenants à la discipline. La population locale traitait les Russes avec sympathie.
En août 1921, commença l'exportation d'émigrants vers la Serbie et la Bulgarie. Cela s'est poursuivi jusqu'en décembre. Le reste du personnel militaire était stationné dans la ville. Les derniers « prisonniers de Gallipoli » furent déportés en 1923. La population locale garde les souvenirs les plus chaleureux de l’armée russe.

Création de « l'Union panmilitaire russe »
La position humiliante dans laquelle se trouvait l'émigration blanche, en particulier l'armée prête au combat, composée pratiquement d'officiers, ne pouvait laisser le commandement indifférent. Tous les efforts du baron Wrangel et de son état-major visaient à préserver l'armée en tant qu'unité de combat. Ils étaient confrontés à trois tâches principales :
- Obtenez une aide matérielle de l’Entente alliée.
- Empêcher le désarmement de l'armée.
- Dans les plus brefs délais, réorganisez-le, renforcez la discipline et renforcez le moral.
Au printemps 1921, il lance un appel aux gouvernements États slaves- La Yougoslavie et la Bulgarie avec une demande d'autorisation du déploiement d'une armée sur leur territoire. A quoi une réponse positive a été reçue avec une promesse d'entretien aux frais du trésor, avec le paiement de petits salaires et rations aux officiers, avec la fourniture de contrats de travail. En août, le retrait du personnel militaire de Turquie a commencé.
Le 1er septembre 1924 s'est produit un événement important dans l'histoire de l'émigration blanche - Wrangel a signé un ordre pour créer un « Russe union pan-militaire"(ROVS). Son objectif était d'unir et d'unir toutes les unités, sociétés militaires et alliances. Ce qui fut fait.
En tant que président du syndicat, il est devenu commandant en chef et son quartier général a pris la direction de l'EMRO. C’était une organisation d’émigrants qui est devenue le successeur de l’organisation russe. La tâche principale de Wrangel était de préserver les anciens militaires et d’en former de nouveaux. Mais malheureusement, c’est à partir de ce personnel que fut formé le Corps russe pendant la Seconde Guerre mondiale, luttant contre les partisans de Tito et l’armée soviétique.
Cosaques russes en exil
Des cosaques ont également été emmenés de Turquie vers les Balkans. Ils se sont installés, comme en Russie, dans des villages dirigés par des conseils villageois avec des atamans. Le « Conseil unifié du Don, du Kouban et du Terek » fut créé, ainsi que « l'Union cosaque », à laquelle tous les villages étaient subordonnés. Les Cosaques menaient un mode de vie familier, travaillaient la terre, mais ne se sentaient pas comme de vrais Cosaques - le soutien du tsar et de la patrie.
La nostalgie de la terre natale - les riches terres noires du Kouban et du Don, des familles restées au pays, du mode de vie habituel - ne laissaient pas de repos. Par conséquent, beaucoup ont commencé à partir à la recherche d’une vie meilleure ou à retourner dans leur pays d’origine. Restaient ceux à qui on n'avait pas pardonné dans leur pays les massacres brutaux commis et leur résistance acharnée aux bolcheviks.
La plupart des villages étaient situés en Yougoslavie. Le village de Belgrade était célèbre et initialement nombreux. Divers Cosaques y vivaient et il portait le nom d'Ataman P. Krasnov. Elle a été fondée après son retour de Turquie et plus de 200 personnes y vivaient. Au début des années 30, seules 80 personnes y vivaient. Peu à peu, les villages de Yougoslavie et de Bulgarie sont devenus partie intégrante de l'EMRO, sous le commandement d'Ataman Markov.

L'Europe et l'émigration blanche
La majeure partie des émigrés russes ont fui vers l'Europe. Comme mentionné ci-dessus, les pays qui ont accueilli le principal flux de réfugiés étaient : la France, la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Lettonie et la Grèce. Après la fermeture des camps en Turquie, la majeure partie des émigrés s'est concentrée en France, en Allemagne, en Bulgarie et en Yougoslavie, centre d'émigration de la Garde blanche. Ces pays sont traditionnellement associés à la Russie.
Les centres d'émigration étaient Paris, Berlin, Belgrade et Sofia. Cela s’est produit en partie parce qu’il fallait du travail pour reconstruire les pays qui avaient pris part à la Première Guerre mondiale. Il y avait plus de 200 000 Russes à Paris. Berlin occupe la deuxième place. Mais la vie a fait ses propres ajustements. De nombreux émigrants ont quitté l'Allemagne pour d'autres pays, notamment la Tchécoslovaquie voisine, en raison des événements qui se déroulaient dans ce pays. Après la crise économique de 1925, sur 200 000 Russes, seuls 30 000 sont restés à Berlin ; ce nombre a été considérablement réduit en raison de l'arrivée au pouvoir des nazis.
Au lieu de Berlin, c'est Prague qui est devenue le centre de l'émigration russe. Paris jouait une place importante dans la vie des communautés russes à l’étranger, où affluaient l’intelligentsia, la soi-disant élite et les hommes politiques de divers bords. Il s'agissait principalement d'émigrants de la première vague, ainsi que de cosaques de l'armée du Don. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie de l’émigration européenne s’est déplacée vers le Nouveau Monde – les États-Unis et les pays d’Amérique latine.

Russes en Chine
Avant la Grande Révolution socialiste d'Octobre en Russie, la Mandchourie était considérée comme sa colonie et les citoyens russes y vivaient. Leur nombre était de 220 000 personnes. Ils avaient le statut d’extraterritorialité, c’est-à-dire qu’ils restaient citoyens de la Russie et étaient soumis à ses lois. À mesure que l’Armée rouge avançait vers l’Est, le flux de réfugiés vers la Chine augmentait et ils se précipitèrent tous vers la Mandchourie, où les Russes constituaient la majorité de la population.
Si la vie en Europe était proche et compréhensible pour les Russes, alors la vie en Chine, avec son mode de vie caractéristique et ses traditions spécifiques, était loin d'être comprise et perçue par les Européens. Par conséquent, le chemin d’un Russe qui s’est retrouvé en Chine se trouvait à Harbin. En 1920, le nombre de citoyens ayant quitté la Russie s'élevait à plus de 288 000. L'émigration vers la Chine, la Corée et le chemin de fer chinois oriental (CER) est également généralement divisée en trois flux :
- Premièrement, la chute du Directoire d’Omsk au début des années 1920.
- La seconde, la défaite de l’armée d’Ataman Semenov en novembre 1920.
- Troisièmement, l’établissement du pouvoir soviétique à Primorye à la fin de 1922.
La Chine, contrairement aux pays de l'Entente, n'était liée à la Russie tsariste par aucun traité militaire. Par conséquent, par exemple, les restes de l'armée d'Ataman Semenov qui ont traversé la frontière ont d'abord été désarmés et privés de la liberté de mouvement et de sortie hors du pays, c'est-à-dire , ils furent internés dans les camps de Tsitskar. Après cela, ils ont été transférés à Primorye, dans la région de Grodekovo. Dans certains cas, les contrevenants aux frontières ont été expulsés vers la Russie.
Le nombre total de réfugiés russes en Chine s'élevait à 400 000 personnes. L’abolition du statut d’extraterritorialité en Mandchourie a transformé du jour au lendemain des milliers de Russes en simples migrants. Néanmoins, les gens ont continué à vivre. Une université, un séminaire et 6 instituts ont été ouverts à Harbin, qui fonctionnent encore aujourd'hui. Mais la population russe a tenté de toutes ses forces de quitter la Chine. Plus de 100 000 personnes sont retournées en Russie et d'importants flux de réfugiés ont afflué vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord.

Intrigue politique
L’histoire de la Russie au début du XXe siècle est pleine de tragédies et de bouleversements incroyables. Plus de deux millions de personnes se sont retrouvées hors de leur pays. Pour l’essentiel, c’était la fleur de la nation, qui ne pouvait pas comprendre son propre peuple. Le général Wrangel a fait beaucoup pour ses subordonnés en dehors de son pays. Il a réussi à maintenir une armée prête au combat et à organiser des écoles militaires. Mais il n’a pas compris qu’une armée sans peuple, sans soldat, n’est pas une armée. Vous ne pouvez pas combattre votre propre pays.
Entre-temps, une campagne sérieuse éclata autour de l’armée de Wrangel, dans le but de l’impliquer dans la lutte politique. D'une part, la direction du mouvement blanc a été mise sous pression par les libéraux de gauche dirigés par P. Milyukov et A. Kerensky. De l’autre côté se trouvent les monarchistes de droite dirigés par N. Markov.
La gauche fut complètement défaite en attirant le général à ses côtés et se vengea de lui en commençant à diviser le mouvement blanc, coupant les Cosaques de l'armée. Ayant suffisamment d'expérience dans les « jeux d'infiltration », ils ont réussi, à l'aide des médias, à convaincre les gouvernements des pays où se trouvaient les émigrés de cesser de financer l'Armée blanche. Ils obtinrent également le transfert du droit de disposer des biens de l'Empire russe à l'étranger.
Cela a eu un triste effet sur l'Armée blanche. Les gouvernements de Bulgarie et de Yougoslavie, pour des raisons économiques, ont retardé le paiement des contrats pour le travail effectué par les officiers, ce qui les a laissés sans moyens de subsistance. Le général publie un arrêté dans lequel il transfère l'armée vers l'autosuffisance et permet aux syndicats et aux grands groupes de militaires de conclure des contrats de manière indépendante, une partie de leurs revenus étant transférée à l'EMRO.
Mouvement blanc et monarchisme
Réalisant que la plupart des officiers étaient déçus par la monarchie à la suite de la défaite sur les fronts de la guerre civile, le général Wrangel décida d'enrôler du côté de l'armée le petit-fils de Nicolas Ier. Le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch jouissait d'un grand respect et d'une grande influence. parmi les émigrés. Il partageait profondément les vues du général sur le mouvement blanc et sur le fait de ne pas impliquer l’armée dans des jeux politiques et a accepté sa proposition. Le 14 novembre 1924, le Grand-Duc, dans sa lettre, accepte de diriger l'Armée blanche.
La situation des émigrés
Le 15 décembre 1921, la Russie soviétique a adopté un décret par lequel la plupart des émigrants ont perdu leur citoyenneté russe. Restés à l'étranger, ils se sont retrouvés apatrides, apatrides privés de certains droits civils et politiques. Leurs droits étaient protégés par les consulats et les ambassades de la Russie tsariste, qui ont continué à opérer sur le territoire d'autres États jusqu'à ce que la Russie soviétique soit reconnue sur la scène internationale. A partir de ce moment, il n’y avait plus personne pour les protéger.
La Société des Nations est venue à la rescousse. Le Conseil de la Ligue a créé le poste de Haut-Commissaire pour les réfugiés russes. Il était occupé par F. Nansen, sous lequel, en 1922, des passeports ont commencé à être délivrés aux émigrants de Russie, connus sous le nom de passeports Nansen. Grâce à ces documents, les enfants de certains émigrés ont vécu jusqu'au XXIe siècle et ont pu obtenir la nationalité russe.
La vie des émigrés n'était pas facile. Beaucoup ont coulé, incapables de résister à des épreuves difficiles. Mais la majorité, préservant la mémoire de la Russie, a construit une nouvelle vie. Les gens ont appris à vivre d'une manière nouvelle, ont travaillé, ont élevé des enfants, ont cru en Dieu et espéraient qu'un jour ils retourneraient dans leur pays d'origine.
Rien qu'en 1933, 12 pays ont signé la Convention relative aux droits juridiques des réfugiés russes et arméniens. Ils étaient égaux en droits fondamentaux résidents locauxÉtats qui ont signé la Convention. Ils pouvaient entrer et sortir librement du pays, recevoir Assistance sociale, du travail et bien plus encore. Cela a permis à de nombreux émigrants russes de s'installer en Amérique.

L'émigration russe et la Seconde Guerre mondiale
La défaite dans la guerre civile, les difficultés et les difficultés de l'émigration ont laissé leur marque dans les esprits. Il est clair qu’ils n’avaient aucun sentiment de tendresse à l’égard de la Russie soviétique et qu’ils la considéraient comme un ennemi implacable. Par conséquent, beaucoup ont placé leurs espoirs dans l’Allemagne hitlérienne, qui leur ouvrirait la voie du retour. Mais il y avait aussi ceux qui considéraient l’Allemagne comme un ennemi ardent. Ils vivaient avec amour et sympathie pour leur lointaine Russie.
Le début de la guerre et l'invasion ultérieure des troupes hitlériennes sur le territoire de l'URSS ont divisé le monde des émigrants en deux parties. De plus, comme le pensent de nombreux chercheurs, ils sont inégaux. La majorité a accueilli avec enthousiasme l’agression de l’Allemagne contre la Russie. Les officiers de la Garde blanche ont servi dans le Corps russe, la ROA et la division Russland, tournant leurs armes contre leur peuple pour la deuxième fois.
De nombreux émigrés russes ont rejoint le mouvement de Résistance et ont combattu désespérément les nazis dans les territoires occupés d'Europe, croyant qu'en agissant ainsi, ils aidaient leur lointaine patrie. Ils sont morts, sont morts dans des camps de concentration, mais n'ont pas abandonné, ils croyaient en la Russie. Pour nous, ils resteront à jamais des héros.
La première vague d'émigrants russes qui ont quitté la Russie après Révolution d'Octobre, a le sort le plus tragique. Aujourd'hui vit la quatrième génération de leurs descendants, qui ont largement perdu tout lien avec leur patrie historique.
Continent inconnu
L’émigration russe de la première guerre post-révolutionnaire, également appelée la guerre blanche, est un phénomène historique, sans précédent dans l’histoire, non seulement par son ampleur, mais aussi par sa contribution à la culture mondiale. La littérature, la musique, le ballet, la peinture, comme de nombreuses réalisations scientifiques du XXe siècle, sont impensables sans les émigrés russes de la première vague.
Ce fut le dernier exode d’émigration, où non seulement les sujets de l’Empire russe se retrouvèrent à l’étranger, mais aussi les porteurs de l’identité russe sans les impuretés « soviétiques » ultérieures. Par la suite, ils ont créé et habité un continent qui ne figure sur aucune carte du monde - son nom est « Les Russes à l'étranger ».
La principale direction de l'émigration blanche est celle des pays d'Europe occidentale avec des centres à Prague, Berlin, Paris, Sofia et Belgrade. Une partie importante s'est installée à Harbin chinois - en 1924, il y avait ici jusqu'à 100 000 émigrants russes. Comme l'a écrit l'archevêque Nathanaël (Lvov), « Harbin était un phénomène exceptionnel à cette époque. Construite par les Russes sur le territoire chinois, elle est restée une ville de province russe typique pendant encore 25 ans après la révolution.
Selon les estimations de la Croix-Rouge américaine, au 1er novembre 1920, le nombre total d'émigrants de Russie était de 1 million 194 000 personnes. La Société des Nations fournit des données en août 1921 : 1,4 million de réfugiés. L'historien Vladimir Kabuzan estime à au moins 5 millions le nombre de personnes ayant émigré de Russie entre 1918 et 1924.
Séparation à court terme
La première vague d’émigrants ne s’attendait pas à passer toute sa vie en exil. Ils s’attendaient à ce que le régime soviétique s’effondre et qu’ils puissent revoir leur patrie. De tels sentiments expliquent leur opposition à l'assimilation et leur intention de limiter leur vie aux limites d'une colonie d'émigrants.
Le publiciste et émigré du premier vainqueur Sergueï Rafalsky a écrit à ce sujet : « D'une manière ou d'une autre, cette époque brillante où l'émigration sentait encore la poussière, la poudre et le sang des steppes du Don, et son élite pouvait imaginer la remplacer à tout appel à minuit, a été en quelque sorte effacée dans mémoire étrangère." usurpateurs" et l'effectif complet du Conseil des Ministres, et le quorum nécessaire des Chambres Législatives, et de l'État-Major, et du Corps de Gendarmes, et du Département de Détective, et de la Chambre de Commerce, et Saint-Synode, et le Sénat directeur, sans oublier les professeurs et les représentants des arts, notamment de la littérature.
Lors de la première vague d’émigration, outre un grand nombre d’élites culturelles de la société pré-révolutionnaire russe, il y avait une proportion importante de militaires. Selon la Société des Nations, environ un quart de tous les émigrés post-révolutionnaires appartenaient aux armées blanches qui ont quitté la Russie à différents moments et sur différents fronts.
L'Europe
En 1926, selon le Service des Réfugiés de la Société des Nations, 958 500 réfugiés russes étaient officiellement enregistrés en Europe. Parmi eux, environ 200 000 ont été reçus par la France et environ 300 000 par la République de Turquie. La Yougoslavie, la Lettonie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Grèce comptaient chacune environ 30 à 40 000 émigrants.
Au cours des premières années, Constantinople a joué le rôle de base de transbordement pour l'émigration russe, mais au fil du temps, ses fonctions ont été transférées à d'autres centres - Paris, Berlin, Belgrade et Sofia. Ainsi, selon certaines données, en 1921, la population russe de Berlin atteignait 200 000 personnes - ce sont elles qui étaient les plus touchées par la crise économique et, en 1925, il n'y restait plus que 30 000 personnes.
Prague et Paris s'imposent progressivement comme les principaux centres de l'émigration russe, cette dernière étant notamment considérée à juste titre comme la capitale culturelle de la première vague d'émigration. L'Association militaire du Don, présidée par l'un des dirigeants du mouvement blanc, Venedikt Romanov, jouait une place particulière parmi les émigrés parisiens. Après l’arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en Allemagne en 1933, et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, l’afflux d’émigrants russes d’Europe vers les États-Unis s’est fortement accru.
Chine
À la veille de la révolution, le nombre de la diaspora russe en Mandchourie atteignait 200 000 personnes, après le début de l'émigration, il a augmenté de 80 000 supplémentaires. Pendant toute la période de la guerre civile en Extrême-Orient (1918-1922), en lien avec la mobilisation, commença un mouvement actif de la population russe de Mandchourie.
Après la défaite du mouvement blanc, l’émigration vers le nord de la Chine a fortement augmenté. En 1923, le nombre de Russes ici était estimé à environ 400 000 personnes. Sur ce nombre, environ 100 000 ont reçu des passeports soviétiques, dont beaucoup ont décidé de rentrer en RSFSR. L'amnistie annoncée aux membres ordinaires des formations de la Garde blanche a joué ici un rôle.
La période des années 1920 a été marquée par une réémigration active des Russes de Chine vers d’autres pays. Cela a particulièrement touché les jeunes qui partaient étudier dans les universités américaines. Amérique du Sud, Europe et Australie.
Apatrides
Le 15 décembre 1921, la RSFSR a adopté un décret selon lequel de nombreuses catégories d'anciens sujets de l'Empire russe étaient privées du droit à la citoyenneté russe, y compris ceux qui étaient restés à l'étranger de manière continue pendant plus de 5 ans et n'avaient pas reçu de passeport étranger. ou des certificats pertinents en temps opportun des missions soviétiques.
Ainsi, de nombreux émigrés russes se sont retrouvés apatrides. Mais leurs droits ont continué à être protégés par les anciennes ambassades et consulats russes, les États correspondants ayant reconnu la RSFSR puis l'URSS.
Un certain nombre de problèmes concernant les émigrés russes ne peuvent être résolus qu'au niveau international. À cette fin, la Société des Nations a décidé de créer le poste de Haut-Commissaire pour les réfugiés russes. Il s'agissait du célèbre explorateur polaire norvégien Fridtjof Nansen. En 1922, des passeports spéciaux « Nansen » sont apparus, délivrés aux émigrants russes.
Jusqu'à la fin du 20e siècle différents pays il y avait des émigrants et leurs enfants vivant avec des passeports « Nansen ». Ainsi, l'aînée de la communauté russe de Tunisie, Anastasia Alexandrovna Shirinskaya-Manstein, n'a reçu un nouveau passeport russe qu'en 1997.
« J'attendais la citoyenneté russe. Je ne voulais rien de soviétique. Ensuite, j'ai attendu que le passeport ait un aigle à deux têtes - l'ambassade l'a offert avec les armoiries de l'international, j'ai attendu avec l'aigle. Je suis une vieille femme tellement têtue», a admis Anastasia Alexandrovna.
Le sort de l'émigration
De nombreuses personnalités de la culture et de la science russes ont rencontré la révolution prolétarienne dans la fleur de l’âge. Des centaines de scientifiques, d'écrivains, de philosophes, de musiciens et d'artistes se sont retrouvés à l'étranger, qui auraient pu être la fleur de la nation soviétique, mais qui, en raison des circonstances, n'ont révélé leur talent que dans l'émigration.
Mais l’écrasante majorité des émigrés ont été contraints de trouver du travail comme chauffeurs, serveurs, lave-vaisselle, employés auxiliaires et musiciens dans de petits restaurants, tout en continuant à se considérer comme porteurs de la grande culture russe.
Les voies de l'émigration russe étaient différentes. Certains n’ont d’abord pas accepté le pouvoir soviétique, d’autres ont été expulsés de force à l’étranger. Le conflit idéologique a essentiellement divisé l’émigration russe. Cette situation est devenue particulièrement aiguë pendant la Seconde Guerre mondiale. Une partie de la diaspora russe estimait que pour lutter contre le fascisme il valait la peine de conclure une alliance avec les communistes, tandis que d’autres refusaient de soutenir les deux régimes totalitaires. Mais il y avait aussi ceux qui étaient prêts à lutter contre les Soviétiques détestés aux côtés des fascistes.
Les émigrés blancs de Nice s'adressent aux représentants de l'URSS avec une pétition :
« Nous avons profondément pleuré qu’au moment de l’attaque perfide de l’Allemagne contre notre patrie, il y ait eu
physiquement privé de la possibilité de faire partie des rangs de la vaillante Armée rouge. Mais nous
a aidé notre patrie en travaillant sous terre. Et en France, selon les calculs des émigrés eux-mêmes, un représentant de la Résistance sur dix était russe.
Dissolution dans un environnement étranger
La première vague d’émigration russe, après avoir connu un pic dans les dix années qui ont suivi la révolution, a commencé à décliner dans les années 1930 et a complètement disparu dans les années 1940. De nombreux descendants de la première vague d'émigrants ont oublié depuis longtemps leur patrie ancestrale, mais les traditions de préservation de la culture russe autrefois établies sont en grande partie vivantes à ce jour.
Un descendant d'une famille noble, le comte Andrei Musin-Pouchkine, déclara tristement : « L'émigration était vouée à la disparition ou à l'assimilation. Les vieillards sont morts, les jeunes ont progressivement disparu dans l'environnement local, se transformant en Français, Américains, Allemands, Italiens... Parfois, il semble que du passé il ne reste que de beaux noms et titres sonores : comtes, princes, Narychkine, Cheremetiev, Romanov, Musins-Pouchkine. » .
Ainsi, aux points de transit de la première vague d’émigration russe, personne n’a survécu. La dernière en date était Anastasia Shirinskaya-Manstein, décédée à Bizerte, en Tunisie, en 2009.
La situation de la langue russe, qui au tournant des XXe et XXIe siècles se trouvait dans une position ambiguë dans la diaspora russe, était également difficile. Natalya Bashmakova, professeur de littérature russe vivant en Finlande, descendante d'émigrants qui ont fui Saint-Pétersbourg en 1918, note que dans certaines familles, la langue russe vit même à la quatrième génération, dans d'autres, elle est morte il y a plusieurs décennies.
"Le problème des langues est triste pour moi personnellement", dit le scientifique, "car je ressens émotionnellement mieux le russe, mais je ne suis pas toujours sûr d'utiliser certaines expressions ; le suédois est profondément ancré en moi, mais, bien sûr, je je l'ai oublié maintenant. Émotionnellement, c’est plus proche de moi que le finnois.
Aujourd’hui à Adélaïde, en Australie, vivent de nombreux descendants de la première vague d’émigrants qui ont quitté la Russie à cause des bolcheviks. Ils portent toujours des noms de famille russes et même des noms russes, mais leur langue maternelle est déjà l'anglais. Leur patrie est l'Australie, ils ne se considèrent pas comme des émigrés et s'intéressent peu à la Russie.
La plupart de ceux qui ont des racines russes vivent actuellement en Allemagne - environ 3,7 millions de personnes, aux États-Unis - 3 millions, en France - 500 000, en Argentine - 300 000, en Australie - 67 000. Plusieurs vagues d'émigration en provenance de Russie se sont mélangées ici. Mais, comme le montrent les enquêtes, ce sont les descendants de la première vague d’émigrants qui ressentent le moins de liens avec la patrie de leurs ancêtres.
Nous nous souvenons des terribles événements survenus il y a 95 ans. Les adultes ne sont pas les seuls à ressentir la tragédie qui s'est alors produite dans le pays. Les enfants l'ont compris à leur manière, en un sens plus pure et plus nette. Garçons et filles des années 1920. Les voix de ces enfants disent de plus en plus vrai, ils ne savent pas mentir.
je ne peux pas mentir
L’année 1917, en tant que tournant dans l’histoire de la Russie, et la guerre civile fratricide qui l’a suivi, ont fait l’objet d’une attention particulière depuis de nombreuses années non seulement de la part des historiens professionnels, mais aussi de la part de nombreux contemporains de ces événements. Essentiellement, ils ont commencé à « se souvenir » presque immédiatement, presque de manière synchrone avec ce qui se passait. Et cela ne pouvait pas s'expliquer uniquement par l'influence de la situation politique : ce qui s'est passé dans le pays a touché directement et directement chacun de ses citoyens, complètement bouleversé, et parfois simplement brisé leur vie, les obligeant à repenser à nouveau le passé récent et encore une fois, à la recherche d'une réponse à des questions insolubles ou posées qui ne peuvent pas du tout être résolues époque révolutionnaire si inattendu et poignant. Cela peut paraître surprenant, mais la polyphonie discordante de « souvenir » des premières années post-révolutionnaires entrelaçait constamment les voix de ceux qui, semble-t-il, y étaient difficiles à entendre - des enfants qui ont grandi dans cette période difficile.
En effet, les garçons et les filles des années 1920 ont laissé derrière eux de nombreux textes écrits qui traitaient de ce qui leur était arrivé, ainsi qu’à celui de leurs parents et d’autres personnes proches ou moins proches d’eux, après la révolution de 1917. Pour la plupart, ces souvenirs d'enfance sont conservés sous la forme dissertations scolaires. Sans nier le fait que l'influence des adultes sur cette forme de créativité des mémoires des enfants était assez importante - même leur apparition même a été initiée par des adultes - l'importance de ces souvenirs ne peut être surestimée. Non seulement les enfants observateurs remarquaient et enregistraient parfois ce qui restait invisible aux adultes, non seulement ils proposaient leurs propres interprétations « enfantines » de nombreux phénomènes, faits et événements, mais ils écrivaient si ouvertement, si sincèrement et ouvertement que ce qu'ils énonçaient en termes simples Les termes pages de cahier se sont immédiatement transformés en une sorte de confession. "Je ne sais pas mentir, mais j'écris ce qui est vrai", cette confession d'une jeune fille de 12 ans de la province de Yaroslavl pourrait être étendue à la grande majorité des mémoires d'enfance écrites peu après la fin de la guerre civile. Guerre en Russie.
Enfants de 1917
Les premiers souvenirs d’enfance de la révolution de 1917 remontent à la culture écrite des « premiers » et ont été créés par les enfants des « étrangers ». Ces textes étaient clairement politisés, ce qui est compréhensible : le passé s'est rapidement transformé en un « paradis perdu » pour ces enfants, souvent accompagné d'une patrie perdue et d'un nouvel épilogue d'émigrant – ce n'est pas pour rien qu'un des enseignants, écrivain et écrivain émigré russe le publiciste N.A. Tsurikov les a appelés « petits oiseaux migrateurs ». Selon les estimations du Bureau pédagogique pour les écoles secondaires et inférieures russes à l'étranger, créé en 1923 à Prague sous la présidence de l'éminent théologien, philosophe et enseignant V.V. Zenkovsky, au milieu des années 1920, il y avait environ 20 000 enfants russes à l'étranger. âge scolaire. Parmi eux, au moins 12 000 personnes ont étudié dans des écoles russes étrangères. Les enseignants émigrés pensaient, non sans raison, qu’étudier dans les écoles russes contribuerait à préserver l’identité nationale des enfants, notamment en préservant leur langue maternelle et leur religion orthodoxe. Notons que le clergé orthodoxe, tant personnellement qu’en tant que dirigeant d’organisations publiques, a joué un rôle majeur dans la création et le fonctionnement des écoles russes pour réfugiés. Le penseur religieux, théologien et philosophe G. V. Florovsky, fondateur et premier hiérarque de l'école russe d'émigration, a apporté une contribution significative au développement des fondements psychologiques et pédagogiques de l'éducation et de l'enseignement des enfants et des jeunes et directement à la vie de l'école russe en émigration. Église orthodoxe russe à l'étranger, le métropolite Antoine (Khrapovitsky) et son futur successeur, le métropolite Anastasy (Gribanovsky), évêque de Prague Sergius (Korolev), son plus proche compagnon d'armes, qui était principalement chargé d'enseigner la Loi de Dieu à l'émigrant russe écoles, l'archimandrite Isaac (Vinogradov), président honoraire de l'Administration diocésaine des Églises orthodoxes russes d'Europe occidentale, le métropolite Evlogy (Georgievsky), chef de la mission spirituelle russe en Chine, le métropolite Innokenty (Figurovsky) et bien d'autres. Sous les auspices de l'Église orthodoxe russe, diverses organisations d'enfants et de jeunes existaient et opéraient à l'étranger : scouts, faucons, chorales d'enfants, orchestres et troupes de théâtre ; les Journées de la culture russe et les Journées de l'enfant russe, célébrées à l'occasion de l'Annonciation, étaient régulièrement organisées, au cours de laquelle des fonds ont été collectés pour les besoins des enfants grâce à des collectes d'assiettes paroissiales et de feuilles d'abonnement.En décembre 1923, dans l'une des plus grandes écoles d'émigrants russes - le gymnase russe de Trzebov morave (Tchécoslovaquie) - à l'initiative de son directeur, deux cours furent annulés de manière inattendue et tous les élèves furent invités à rédiger un essai sur le thème « Mes souvenirs de 1917 jusqu'au jour de son entrée au gymnase »(parmi les autres participants à l'enquête se trouvait la fille de Marina Tsvetaeva, Ariadna Efron, dont elle a parlé dans ses mémoires plusieurs années plus tard). Plus tard, le Bureau pédagogique a étendu cette expérience à un certain nombre d'autres écoles d'émigrants russes en Bulgarie, en Turquie, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. En conséquence, au 1er mars 1925, le Bureau avait rassemblé 2 403 essais pour un volume total de 6,5 mille pages manuscrites. Les résultats de l'analyse des souvenirs ont été publiés dans plusieurs brochures, mais les souvenirs eux-mêmes pendant longtemps n'ont pas été publiés et ont été initialement conservés dans les Archives historiques étrangères russes à Prague, et après leur transfert en Russie à la fin de la Seconde Guerre mondiale - dans les Archives centrales d'État de l'URSS (aujourd'hui les Archives d'État Fédération Russe). Certains de ces documents (plus de 300) n'ont été publiés qu'en 1997 avec la bénédiction de l'archimandrite Kirill (Pavlov).
Les essais rassemblés étaient très différents, ce qui n'est pas un hasard : après tout, ils ont été rédigés par des étudiants d'âges différents, et la tranche d'âge variait de 8 (élèves de l'école préparatoire) à 24 ans (jeunes qui ont repris leurs études après une interruption forcée ). En conséquence, ces essais différaient considérablement par leur volume - de quelques lignes, écrites avec beaucoup de difficulté par les plus jeunes, à des essais de 20 pages rédigés par des lycéens, rédigés avec une petite écriture soignée. Au fur et à mesure que l'enfant grandissait et que son écriture s'améliorait, une complication naturelle des textes fut observée, lorsque la fixation de faits autobiographiques individuels, souvent dispersés, fut remplacée par des tentatives de compréhension du passé, des raisonnements sur le sort de la patrie abandonnée, et souvent des discours patriotiques. les humeurs et les sentiments étaient directement alimentés par les attitudes religieuses et la conscience religieuse des écrivains. La Russie et la foi orthodoxe étaient étroitement liées, et c'est dans la foi du Christ que ces enfants, rejetés par le nouveau gouvernement soviétique, voyaient l'espoir de la résurrection de leur patrie : « Demandons à Dieu de prendre sous sa protection les personnes maltraitées et humiliée, mais non oubliée, malgré toutes les persécutions, la foi chrétienne, notre chère Sainte Rus'" ; « Quelque part là-bas, au fond de la vaste Russie, apparaîtront des gens au mode de vie ancien qui, avec le nom de Dieu sur les lèvres, iront sauver la Russie » ; « Je crois que la vérité triomphera et que la Russie sera sauvée par la lumière de la foi chrétienne ! »
Dieu était avec les enfants
Dans toute leur diversité, la majeure partie des souvenirs d'enfance s'inscrit dans un schéma opposé assez stable : « c'était bien - c'est devenu mauvais ». Le passé pré-bolchevique est apparu dans les écrits des enfants de l’émigration comme un conte de fées beau et aimable, dans lequel il y avait toujours une place pour la religion et Dieu. Se souvenant de l'enfance « dorée », « calme » et « heureuse » en Russie, les garçons et les filles ont décrit en détail avec tant d'impatience les « fêtes lumineuses » attendues de Noël et de Pâques, où ils allaient toujours à l'église et recevaient des cadeaux, décoraient un Noël. arbre et des œufs de Pâques peints, alors qu'il y avait des parents et des amis à proximité, et aussi "Quelqu'un de Miséricordieux, qui pardonnera et ne condamnera pas". «... Noël», écrit Ivan Chumakov, élève de 6e année à l'école anglaise pour garçons russes d'Erinkey (Turquie). « Tu étudies le tropaire, tu le racontes à ton père, à ta mère, à tes sœurs et même à ton petit frère, qui ne comprend toujours rien. Et tu demanderas à ta mère de te réveiller pour matines trois jours à l’avance. À l'église, vous vous tenez calmement, vous signez à chaque minute et lisez le tropaire. Le service religieux s'est terminé. Sans rentrer chez vous, vous courez « glorifier le Christ ». Il y a des bonbons, des pains d'épices, des sous - pour toutes les poches. Rentrez ensuite chez vous pour rompre votre jeûne. Après cela, louez à nouveau, et ainsi de suite toute la journée... Et bientôt Pâques. C'est des vacances... indescriptibles. Toute la journée, les cloches sonnent, les œufs roulent, le « baptême », les félicitations, les cadeaux... »
Dieu était avec les enfants, et les enfants étaient avec Dieu, non seulement lors des fêtes religieuses, mais constamment, quotidiennement, toutes les heures. Certains d’entre eux ont directement reconnu la « profonde religiosité » héritée de leurs parents. La prière occupait invariablement une place particulière et stable dans les pratiques quotidiennes des enfants : « Le lendemain matin, je me réveillais toujours joyeux, je m'habillais, je me lavais, je priais Dieu et j'allais dans la salle à manger, où la table était déjà mise... Après le thé Je suis allé étudier, j’ai résolu plusieurs problèmes, j’ai écrit deux pages de calligraphie, etc. Dieu a préservé, Dieu a protégé, Dieu a apaisé, Dieu a insufflé l'espoir : « Voici quelques images d'une enfance lointaine. La nuit, devant l'image de la Mère de Dieu brûle une lampe, sa lumière tremblante et incertaine illumine le visage indulgent de la Belle Vierge, et il semble que les traits de son visage bougent, vivent et sa belle profondeur mes yeux me regardent avec affection et amour. Moi, une petite fille, je suis allongée dans mon lit dans une longue chemise de nuit, je ne veux pas dormir, j'entends les ronflements de ma vieille nounou, et dans le silence de la nuit il me semble que je suis seule dans un immense Dans un monde où il n'y a pas une seule âme humaine, j'ai peur, mais, en regardant les merveilleux traits de la Mère de Dieu, mes peurs s'en vont peu à peu et je m'endors imperceptiblement.
Et soudain, tout à coup, en un instant, tout cela - si « le nôtre », si familier, si établi - a été détruit, et l'impiété, aussi blasphématoire que cela puisse paraître, a été élevée au rang d'une nouvelle foi, où ils ont prié les nouveaux apôtres révolutionnaires et suivirent les nouvelles alliances révolutionnaires. « Les bolcheviks prêchaient qu'il n'y avait pas de Dieu, qu'il n'y avait pas de beauté dans la vie et que tout était permis », et ils ne se contentaient pas de prêcher, mais mettaient cette permissivité en pratique. L’interdiction d’enseigner la Loi de Dieu et le remplacement des icônes accrochées dans les salles de classe – « ces bibelots », comme les appelaient les commissaires rouges – par des portraits des dirigeants de la révolution étaient peut-être les mesures les plus inoffensives prises par les nouvelles autorités. La profanation des sanctuaires religieux s'est produite partout : même lors des perquisitions, auxquelles ont assisté des enfants (« Plusieurs marins ivres et débridés, pendus de la tête aux pieds avec des armes, des bombes et des ceintures de mitrailleuses entrelacées, ont fait irruption dans notre appartement avec de grands cris et des insultes : les recherches ont commencé... Tout a été détruit et vandalisé, même les icônes ont été arrachées par ces blasphémateurs, frappées à coups de crosse de fusil, piétinées"), et devant leur domicile. "Les bolcheviks ont envahi les temples de Dieu, tué les prêtres, sorti les reliques et les ont dispersés autour de l'église, ont maudit à la manière bolchevique, ont ri, mais Dieu a enduré et enduré", a déclaré un élève de 15 ans du gymnase russe de Shumen (Bulgarie) en témoigne avec amertume. « La lumière du feu illuminait l'église... les pendus se balançaient sur le clocher ; leurs silhouettes noires projetaient une ombre terrible sur les murs de l’église », se souvient un autre. « À Pâques, au lieu de sonner, on tire. J’ai peur de sortir », écrit un troisième. Et il y avait beaucoup de telles preuves.
C’est en Dieu que les enfants ont eu confiance dans les moments les plus difficiles, les plus terribles de leur vie, quand il n’y avait rien à espérer, et c’est Lui qu’ils ont loué alors que les épreuves étaient déjà derrière eux : « Nous avons été conduits dans un grand , pièce lumineuse (ChK. - COMME.)… Je me souviens qu'à ce moment-là, je priais simplement. Nous ne sommes pas restés assis longtemps, un soldat est venu et nous a emmenés quelque part ; lorsqu'on lui a demandé ce qu'ils allaient nous faire, il m'a tapoté la tête et a répondu : « Ils vont tirer »... Nous avons été amenés dans une cour où se tenaient plusieurs Chinois armés de fusils... C'était comme un cauchemar, et je j'attendais juste que ça se termine. J’ai entendu quelqu’un compter : « Un, deux »… J’ai vu ma mère murmurer : « Russie, Russie », et mon père serrer la main de ma mère. Nous nous attendions à la mort, mais... un marin est entré et a arrêté les soldats qui étaient prêts à tirer. «Cela nous sera utile», a-t-il dit en nous disant de rentrer chez nous. De retour à la maison, nous nous sommes tenus tous les trois devant les images et pour la première fois j'ai prié avec autant de ferveur et de sincérité. Pour beaucoup, la prière devient la seule source de vitalité : « La nuit de l'Annonciation, il y eut une terrible canonnade ; Je n’ai pas dormi et j’ai prié toute la nuit » ; « Je n'avais jamais prié auparavant, je ne me souvenais jamais de Dieu, mais quand je me suis retrouvé seul (après la mort de mon frère), j'ai commencé à prier ; J’ai prié tout le temps – partout où l’occasion se présentait, et surtout j’ai prié au cimetière, sur la tombe de mon frère.
Aie pitié de la Russie, aie pitié de moi !
Pendant ce temps, parmi les enfants, il y avait ceux qui étaient complètement désespérés, qui avaient perdu le noyau de la vie, et avec lui - comme il leur semblait - leur foi dans le Tout-Puissant : « Je suis pire qu'un loup, la foi s'est effondrée, la moralité est tombé"; « J’ai... remarqué avec horreur que je n’avais rien de ce sacré, de cette gentillesse que mon père et ma mère m’ont mis. Dieu a cessé d'exister pour moi comme quelque chose de lointain, prenant soin de moi : le Christ évangélique. Un nouveau dieu se tenait devant moi, le dieu de la vie... Je suis devenu... un égoïste complet prêt à sacrifier le bonheur des autres pour son propre bonheur, qui ne voit dans la vie que la lutte pour l'existence, qui croit que le Le plus grand bonheur sur terre, c'est l'argent. C'est précisément à ces enfants et adolescents que V.V. Zenkovsky pensait quand, analysant ses écrits, il affirmait que la « voie religieuse du dépassement » n'était pas encore ouverte à tout le monde et qu'un travail très minutieux était nécessaire pour aider les enfants « à se rapprocher de l'église."
Lors de l'émigration, les enfants étaient dans une certaine mesure protégés du révolutionnaire sanguinaire Moloch. Ils ont récupéré une grande partie de ce qu’ils aimeraient eux-mêmes récupérer du passé récent. Mais, selon leurs propres mots, même Noël est devenu en quelque sorte « triste », pas comme dans la Russie qu’ils ont laissée derrière eux, qu’ils ne pouvaient pas oublier et où ils aimeraient tant retourner. Non, ils n’avaient pas du tout besoin d’une nouvelle patrie soviétique, d’un « anti-monde » hostile et inhabituel du pouvoir soviétique et du bolchevisme. Ils s'efforçaient de revenir à l'ancienne Russie dont ils parlaient dans leurs écrits et qu'ils représentaient dans leurs dessins : des domaines nobles calmes et enneigés, des murs et des tours du Kremlin, de petites églises de village. Parmi les dessins survivants, l'un est particulièrement touchant : les dômes des églises orthodoxes avec des croix et l'inscription laconique « J'aime la Russie ». La plupart de ces enfants ne réalisent jamais leurs rêves. Mais ils ont continué à croire et à prier avec ferveur pour leur patrie - avec autant de ferveur que pour eux-mêmes : « Dieu, est-ce que tout va vraiment rester ainsi ? Aie pitié de la Russie, aie pitié de moi !
Lors de la préparation de l'article, des éléments des livres « Les enfants de l'émigration russe (le livre dont les exilés rêvaient et ne pouvaient pas être publiés) » (M. : TERRA, 1997) et « Les enfants de l'émigration : Mémoires » (M. : TERRA, 1997) et « Les enfants de l'émigration : Mémoires » (M. : Agraf, 2001), ainsi que les monographies de l'auteur de « L'enfance russe au XXe siècle : histoire, théorie et pratique de la recherche ». (Kazan : Université d'État de Kazan, 2007).
Formation d'éclaireurs russes. Marseille. 1930

Cours de musique avec enfants dans la commune russe de Montgeron. Paris. 1926

Enseignants et étudiants du pro-gymnase de l'Union panrusse des villes du camp de Selimiye. 1920

Enseignants et étudiants de l'Institut théologique Saint-Serge de Paris. 1945 Dans le centre- Schémamonk Savvaty. A sa droite— Vladimir Veidle. Alexander Shmeman, Konstantin Andronikov et Sergueï Verkhovsky. Extrème droite- Père Vasily Zenkovsky
Texte : Alla SALNIKOVA
Un quart d'entre vous mourra de famine, de peste et d'épée.
V. Brioussov. Le cheval est pâle (1903).
DISCOURS AUX LECTEURS.
Tout d’abord, il faut préciser que de la fin 1917 à l’automne 1922, le pays a été dirigé par deux dirigeants : Lénine, puis immédiatement Staline. Les récits écrits pendant les années Brejnev sur une certaine période de règne d'un Politburo amical ou peu amical, qui a duré presque jusqu'au congrès des vainqueurs, n'ont rien de commun avec l'histoire.
"Le camarade Staline, devenu secrétaire général, a concentré entre ses mains un immense pouvoir, et je ne suis pas sûr qu'il saura toujours utiliser ce pouvoir avec suffisamment de prudence", écrit Lénine avec horreur le 24 décembre 1922. PSS, tome 45 , p. 345. Staline n'a occupé ce poste que 8 mois, mais ce temps a suffi à Ilitch, politiquement expérimenté, pour comprendre ce qui s'était passé...
Dans la préface des Archives Trotsky (4 volumes), il y a une remarque significative : « En 1924-1925, Trotsky était en réalité complètement seul, se retrouvant sans personnes partageant les mêmes idées. »
Je remercie tous les lecteurs qui ont souhaité m'aider par des critiques ou des informations complétant les faits présentés. Veuillez indiquer les sources exactes à partir desquelles les données ont été obtenues, en indiquant l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'année et le lieu de publication, ainsi que les pages sur lesquelles se trouve la citation spécifique. Cordialement - l'auteur.
"La comptabilité et le contrôle sont les principales choses nécessaires au bon fonctionnement d'une société communiste." Lénine V.I. PSS, vol. 36, p. 266.
Les pertes de la Russie à la suite de 4 années de Première Guerre mondiale et de 3 années de guerre civile se sont élevées à plus de 40 milliards de roubles-or, ce qui dépassait 25 % de la richesse totale du pays d'avant-guerre. Plus de 20 millions de personnes sont mortes et sont devenues handicapées. Production industrielle en 1920, il a diminué de 7 fois par rapport à 1913. La production agricole ne représentait que les deux tiers de son niveau d'avant-guerre. Les mauvaises récoltes qui ont touché de nombreuses régions productrices de céréales au cours de l'été 1920 ont encore aggravé la crise alimentaire dans le pays. La situation difficile dans l'industrie et l'agriculture a été aggravée par l'effondrement des transports. Des milliers de kilomètres de voies ferrées ont été détruits. Plus de la moitié des locomotives et environ un quart des wagons étaient défectueux. Kovkel I.I., Yarmusik E.S. Histoire de la Biélorussie de l'Antiquité à nos jours. - Minsk, 2000, page 340.
Les chercheurs en histoire soviétique savent qu’il n’existe pas une seule statistique nationale au monde aussi fausse que les statistiques officielles de la population de l’URSS.
L’histoire enseigne qu’une guerre civile est plus destructrice et plus meurtrière qu’une guerre contre n’importe quel ennemi. Elle laisse derrière elle une pauvreté, une faim et une destruction généralisées.
Mais les derniers recensements et registres fiables de la population russe datent de 1913-1917.
Après ces années, la falsification complète commence. Ni le recensement de la population de 1920, ni celui de 1926, encore moins le recensement « rejeté » de 1937 puis le recensement « accepté » de 1939 ne sont fiables.
Nous savons qu'au 1er janvier 1911, la population de la Russie était de 163,9 millions d'âmes (avec celle de la Finlande, 167 millions).
Comme le estime l'historienne L. Semennikova, "selon les données statistiques, en 1913, la population du pays était d'environ 174 100 000 personnes (165 personnes en faisaient partie)". Science et Vie, 1996, n° 12, p. 8.
TSB (3e éd.) La population totale de l'Empire russe avant la Première Guerre mondiale était de 180,6 millions de personnes.
En 1914, elle s'élevait à 182 millions d'âmes. Selon les statistiques de la fin de 1916, 186 millions de personnes vivaient en Russie, soit une augmentation de 60 millions sur les 16 années du XXe siècle. Kovalevsky P. La Russie au début du 20e siècle. - Moscou, 1990, n° 11, page 164.
Au début de 1917, plusieurs chercheurs évaluaient le chiffre définitif de la population du pays à 190 millions d'habitants. Mais après 1917 et jusqu'au recensement de 1959, personne ne savait avec certitude, à l'exception des « dirigeants » élus, combien d'habitants il y avait sur le territoire de l'État.
L'ampleur de la violence, des mutilations et des meurtres, ainsi que les pertes de ses habitants, sont également cachées. Les démographes ne font que les deviner et les estimer approximativement. Et les Russes se taisent ! Comment pourrait-il en être autrement : les ouvrages imprimés et les témoignages révélant ce massacre leur sont inconnus. Ce que l’on sait des manuels scolaires, pour l’essentiel, ne sont pas des faits, mais des fictions de propagande.
L’une des questions les plus confuses est celle du nombre de personnes qui ont quitté le pays pendant les années de révolution et de guerre civile. Le nombre exact de fugitifs est inconnu.
Ivan Bounine : « Je n'étais pas de ceux qui en ont été surpris, pour qui sa taille et ses atrocités étaient une surprise, mais la réalité a quand même dépassé toutes mes attentes : personne qui ne l'a pas vu ne comprendra ce que la révolution russe bientôt transformé en. Ce spectacle était une pure horreur pour quiconque n'avait pas perdu l'image et la ressemblance de Dieu, et de Russie, après la prise du pouvoir par Lénine, des centaines de milliers de personnes qui avaient la moindre occasion de s'échapper ont fui" (I. Bounine. "Jours maudits" ).
Le journal des socialistes-révolutionnaires de droite Volya Rossii, qui disposait d'un bon réseau d'information, a cité de telles données. Au 1er novembre 1920, il y avait environ 2 millions d'émigrants du territoire de l'ancien Empire russe en Europe. En Pologne - un million, en Allemagne - 560 000, en France - 175 000, en Autriche et à Constantinople - 50 000 chacun, en Italie et en Serbie - 20 000 chacun. En novembre, 150 000 personnes supplémentaires sont arrivées de Crimée. Par la suite, les émigrants de Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est affluèrent vers la France, et beaucoup vers les deux Amériques.
La question du nombre d’émigrants russes ne peut être résolue sur la base de sources situées uniquement en URSS. Parallèlement, dans les années 20 et 30, la question a été abordée dans un certain nombre d'ouvrages étrangers basés sur des données étrangères.
Parallèlement, on constate que dans les années 1920, des données extrêmement contradictoires sur le nombre d'émigrants compilées par des organisations et institutions caritatives apparaissent dans les publications d'émigrants étrangers. Cette information est parfois mentionnée dans la littérature moderne.
Dans le livre de Hans von Rimschi, le nombre d'émigrants est déterminé (sur la base des données de la Croix-Rouge américaine) à 2 935 000 personnes. Ce chiffre comprenait plusieurs centaines de milliers de Polonais rapatriés en Pologne et enregistrés comme réfugiés auprès de la Croix-Rouge américaine, un nombre important de prisonniers de guerre russes encore en 1920-1921. en Allemagne (Rimscha Hans Von. Der russische Biirgerkrieg und die russische Emigration 1917-1921. Jena, Fromann, 1924, s.50-51).
Les données de la Société des Nations pour août 1921 fixent le nombre d'émigrants à 1 444 mille (dont 650 mille en Pologne, 300 mille en Allemagne, 250 mille en France, 50 mille en Yougoslavie, 31 mille en Grèce, 30 mille en Bulgarie). On pense que le nombre de Russes en Allemagne a atteint son point culminant en 1922-1923 - 600 000 dans l'ensemble du pays, dont 360 000 à Berlin.
F. Lorimer, compte tenu des données sur les émigrants, rejoint les calculs écrits de E. Kulischer, qui ont déterminé le nombre d'émigrants de Russie à environ 1,5 million, et avec les rapatriés et autres migrants - à environ 2 millions (Kulischer E. Europe on the Move : Guerre et changements populaires. 1917-1947. N. Y., 1948, p. 54).
En décembre 1924, il y avait environ 600 000 émigrés russes rien qu’en Allemagne, jusqu’à 40 000 en Bulgarie, environ 400 000 en France et plus de 100 000 en Mandchourie. Certes, tous n’étaient pas des émigrés au sens strict du terme : beaucoup servaient sur le chemin de fer chinois de l’Est avant même la révolution.
Les émigrants russes se sont également installés en Grande-Bretagne, en Turquie, en Grèce, en Suède, en Finlande, en Espagne, en Égypte, au Kenya, en Afghanistan, en Australie et au total dans 25 pays, sans compter les pays d'Amérique, principalement les États-Unis, l'Argentine et le Canada.
Mais si nous nous tournons vers la littérature nationale, nous constaterons que les estimations du nombre total d'émigrants diffèrent parfois de deux à trois fois.
DANS ET. Lénine écrivait en 1921 qu'il y avait à cette époque entre 1,5 et 2 millions d'émigrants russes à l'étranger (Lénine V.I. PSS, vol. 43, p. 49, 126 ; vol. 44, p. 5, 39, bien que dans un cas il ait nommé le chiffre 700 mille personnes - vol. 43, p. 138).
V.V. Comin, affirmant qu'il y avait entre 1,5 et 2 millions de personnes dans l'émigration blanche, s'est appuyé sur les informations de la mission genevoise de la Croix-Rouge russe et de la Société littéraire russe à Damas. Komin V.V. L’effondrement politique et idéologique de la contre-révolution petite-bourgeoise russe à l’étranger. Kalinin, 1977, partie 1, pp. 30, 32.
L.M. Spirin, affirmant que le nombre d'émigrants russes était de 1,5 million, a utilisé les données de la section des réfugiés du Bureau international du Travail (fin des années 20). Selon ces données, le nombre d'émigrants enregistrés était de 919 000. Spirin L.M. Classes et partis pendant la guerre civile russe 1917-1920. - M., 1968, p. 382-383.
S.N. Semanov donne le chiffre de 1 million 875 mille émigrants rien qu'en Europe au 1er novembre 1920 - Semanov S.N. Liquidation de la rébellion antisoviétique de Cronstadt en 1921. M., 1973, p. 123.
Les données sur l'émigration vers l'Est - vers Harbin, Shanghai - ne sont pas prises en compte par ces historiens. L'émigration du sud n'est pas non plus prise en compte - vers la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, bien qu'il y ait eu de nombreuses colonies russes dans ces pays.
D'autre part, des informations clairement sous-estimées ont été données par J. Simpson (Simpson Sir John Hope. The Refugee Problem: Report of a Survey. L., Oxford University Press, 1939), déterminant le nombre d'émigrants de Russie au 1er janvier 2008. 1922, 718 mille en Europe et au Moyen-Orient et 145 mille en Extrême-Orient. Ces données incluent uniquement les émigrants officiellement enregistrés (reçus ce qu'on appelle les passeports Nansen).
G. Barikhnovsky pensait qu'il y avait moins d'un million d'émigrants. L’effondrement idéologique et politique de l’émigration blanche et la défaite de la contre-révolution interne. L., 1978, p. 15-16.
Selon I. Trifonov, le nombre de rapatriés en 1921-1931. dépassé 180 000. Trifonov I.Ya. Élimination des classes exploiteuses en URSS. M., 1975, page 178. De plus, l’auteur, citant les données de Lénine sur 1,5 à 2 millions d’émigrants, par rapport aux années 20 et 30, appelle ce chiffre à 860 000. Ibid., pp. 168-169.
Au total, environ 2,5 % de la population, soit environ 3,5 millions de personnes, ont probablement quitté le pays.
Le 6 janvier 1922, le journal Vossische Zeitung, respecté parmi l'intelligentsia, publié à Berlin, a soumis le problème des réfugiés à l'opinion publique allemande pour discussion.
L'article « La nouvelle grande migration des peuples » disait : « La Grande Guerre a provoqué un mouvement parmi les peuples d'Europe et d'Asie, qui pourrait être le début d'un vaste processus historique sous la forme d'une grande migration de peuples. L'émigration russe joue un rôle particulier, exemples similaires ce qui n'est pas dans histoire moderne. De plus, dans cette émigration, nous parlons de tout un ensemble de problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et ils ne peuvent être résolus ni par des phrases générales ni par des mesures immédiates... Pour l'Europe, il est nécessaire de considérer l'émigration russe non pas comme un incident passager... Mais c'est précisément la communauté de destins qu'elle a créée. Cette guerre est pour les vaincus, les incitant à réfléchir au-delà des difficultés immédiates aux futures opportunités de coopération.
En regardant ce qui se passait en Russie, l'émigration a vu : toute opposition dans le pays était détruite. Immédiatement (en 1918), les bolcheviks fermèrent tous les journaux d'opposition (y compris socialistes). La censure est introduite.
En avril 1918, le parti anarchiste fut vaincu et en juillet 1918, les bolcheviks rompirent leurs relations avec leurs seuls alliés dans la révolution - les socialistes-révolutionnaires de gauche, le parti de la paysannerie. En février 1921, les arrestations de mencheviks commencèrent et en 1922, un procès contre les dirigeants du Parti socialiste révolutionnaire de gauche eut lieu.
C'est ainsi qu'est apparu un régime de dictature militaire à parti unique, dirigé contre 90 % de la population du pays. La dictature était bien entendu comprise comme « une violence non limitée par la loi ». Staline I.V. Discours à l'Université de Sverdlovsk le 9 juin 1925
L'émigration était abasourdie et tirait des conclusions qui, hier encore, leur semblaient impossibles.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le bolchevisme est le troisième phénomène de la grande puissance russe, l’impérialisme russe – le premier était le royaume moscovite, le deuxième était l’empire de Pierre le Grand. Le bolchevisme est favorable à un État centralisé fort. La volonté de vérité sociale s’est combinée à la volonté de pouvoir d’État, et la seconde volonté s’est avérée plus forte. Le bolchevisme est entré dans la vie russe comme une force hautement militarisée. Mais le vieil État russe a toujours été militarisé. Le problème du pouvoir était le problème principal pour Lénine et les bolcheviks. Et ils ont créé un État policier, très similaire dans ses méthodes d'administration à l'ancien État russe... L'État soviétique est devenu le même que n'importe quel État despotique, il agit par les mêmes moyens, la même violence et le même mensonge. Berdiaev N. A. Origines et signification du communisme russe.
Même le vieux rêve slavophile de déplacer la capitale de Saint-Pétersbourg à Moscou, au Kremlin, a été réalisé par le communisme rouge. Une révolution communiste dans un pays conduit inévitablement au nationalisme et à une politique nationaliste. Berdiaev N.A.
Par conséquent, lors de l'évaluation de l'ampleur de l'émigration, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu'une partie considérable des gardes blancs qui ont quitté leur patrie sont ensuite retournés en Russie soviétique.
Dans État et révolution, Ilitch promettait : « … la répression de la minorité des exploiteurs par la majorité des esclaves salariés d'hier est si facile, simple et naturelle que la répression des soulèvements d'esclaves, de serfs et de salariés, qu'elle coûtera beaucoup moins cher à l’humanité » (Lénine V.I. PSS, vol. 33, p. 90).
Le dirigeant s'est même aventuré à estimer le « coût » total de la révolution mondiale : un demi-million, un million de personnes (PSS, vol. 37, p. 60).
Des informations fragmentaires sur les pertes de population dans certaines régions spécifiques peuvent être trouvées ici et là. On sait, par exemple, que Moscou, dans laquelle vivaient 1 580 000 personnes au début de 1917, en 1917-1920. a perdu près de la moitié des habitants (49,1%) - c'est ce que dit l'article sur la capitale en 5 volumes. UIT, 1ère éd. (M., 1927, colonne 389).
En raison de l'afflux de travailleurs vers le front et vers les campagnes, avec l'épidémie de typhus et la dévastation économique générale, Moscou en 1918-1921. a perdu près de la moitié de sa population : en février 1917, il y avait 2 044 000 personnes à Moscou et en 1920, 1 028 000 personnes. En 1919, le taux de mortalité a particulièrement augmenté, mais à partir de 1922, le déclin de la population de la capitale a commencé à diminuer et sa population a augmenté rapidement. BST, 1re éd. t.40, M., 1938, p.355.
Ce sont ces données sur la dynamique de la population de la ville citées par l’auteur de l’article de la revue sur la Moscou soviétique, publiée en 1920.
« Au 20 novembre 1915, Moscou comptait déjà 1 983 716 habitants, et l'année suivante la capitale franchit le deuxième million. Le 1er février 1917, juste à la veille de la révolution, 2 017 173 personnes vivaient à Moscou, et sur le territoire moderne de la capitale (y compris certaines zones suburbaines annexées en mai et juin 1917), le nombre d'habitants de Moscou atteignait 2 043 594.
Selon le recensement d'août 1920, Moscou comptait 1 028 218 habitants. Autrement dit, depuis le recensement du 21 avril 1918, la diminution de la population de Moscou s'élève à 687 804 personnes, soit 40,1 %. Ce déclin démographique est sans précédent dans Histoire européenne. Seul Saint-Pétersbourg a dépassé Moscou en termes de degré de dépopulation. Depuis le 1er février 1917, lorsque la population de Moscou a atteint son maximum, le nombre d'habitants de la capitale a diminué de 1 015 000 personnes, soit près de la moitié (plus précisément de 49,6 %).
Pendant ce temps, la population de Saint-Pétersbourg (au sein de la municipalité) atteignait en 1917, selon les calculs du bureau municipal des statistiques, 2 440 000 personnes. Selon le recensement du 28 août 1920, il n'y avait que 706 800 personnes à Saint-Pétersbourg, donc depuis la révolution, le nombre d'habitants de Saint-Pétersbourg a diminué de 1 733 200 personnes, soit de 71 %. En d’autres termes, la population de Saint-Pétersbourg diminuait presque deux fois plus vite que celle de Moscou.» Moscou rouge, M., 1920.
Mais les chiffres définitifs n’apportent pas de réponse exacte à la question : de combien la population du pays a-t-elle diminué entre 1914 et 1922 ?
Oui et pourquoi - aussi.
Le pays a écouté en silence Alexandre Vertinsky le maudire :
- Je ne sais pas pourquoi et qui a besoin de ça,
Qui les a envoyés à la mort d'une main inébranlable,
Seulement si impitoyable, si méchant et inutile
Ils furent descendus dans le repos éternel...
Immédiatement après la guerre, le sociologue Pitirim Sorokin réfléchissait aux tristes statistiques de Prague :
- L'État russe est entré en guerre avec une population de 176 millions de sujets.
En 1920, la RSFSR, avec toutes les républiques soviétiques, dont l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, etc., ne comptait que 129 millions d'habitants.
En six ans, l’État russe a perdu 47 millions de citoyens. C’est le premier paiement pour les péchés de la guerre et de la révolution.
Quiconque comprend l’importance de la taille de la population pour le sort de l’État et de la société, ce chiffre en dit long…
Cette diminution de 47 millions s'explique par la séparation de la Russie d'un certain nombre de régions devenues des États indépendants.
Maintenant, la question est : quelle est la situation de la population du territoire qui compose la RSFSR moderne et des républiques qui lui sont alliées ?
A-t-il diminué ou augmenté ?
Les chiffres suivants donnent la réponse.
Selon le recensement de 1920, la population des 47 provinces de la Russie européenne et de l'Ukraine a diminué depuis 1914 de 11 504 473 personnes, soit 13 % (de 85 000 370 à 73 495 897).
Population de tous républiques soviétiques perte de 21 millions, soit 154 millions, soit une perte de 13,6 %.
La guerre et la révolution n'ont pas seulement dévoré tous ceux qui sont nés, mais néanmoins un certain nombre ont continué à naître. On ne peut pas dire que l’appétit de ces personnes fût modéré et que leur estomac fût modeste.
Même si elles fournissaient un certain nombre de valeurs réelles, il serait difficile de reconnaître que le prix de ces « conquêtes » est bon marché.
Mais en plus de cela, ils ont absorbé 21 millions de victimes.
Sur ces 21 millions, les victimes directes de la guerre mondiale sont les suivantes :
tués et morts de blessures et de maladies - 1 000 000 de personnes,
disparus et capturés (dont la plupart sont revenus) 3 911 000 personnes. (dans les données officielles, les disparus et les capturés ne sont pas séparés les uns des autres, je cite donc chiffre total), plus 3 748 000 blessés, pour un total de victimes directes de la guerre - pas plus de 2 à 2,5 millions. Le nombre de victimes directes de la guerre civile n'était guère inférieur.
En conséquence, nous pouvons admettre que le nombre de victimes directes de la guerre et de la révolution approche les 5 millions. Les 16 millions restants sont dus à leurs victimes indirectes : une mortalité accrue et une baisse du taux de natalité. Sorokin P.A. État actuel Russie. (Prague, 1922).
« Temps cruel ! Comme le témoignent aujourd'hui les historiens, 14 à 18 millions de personnes sont mortes pendant la guerre civile, dont seulement 900 000 ont été tuées sur les fronts. Les autres furent victimes de la typhoïde, de la grippe espagnole, d'autres maladies, puis de la Terreur blanche et rouge. Le « communisme de guerre » a été causé en partie par les horreurs de la guerre civile, en partie par les illusions de toute une génération de révolutionnaires. Confiscation directe de la nourriture des paysans sans aucune compensation, rations pour les travailleurs - de 250 grammes à un demi-kilo de pain noir, travaux forcés, exécutions et prison pour transactions marchandes, une immense armée d'enfants sans abri qui ont perdu leurs parents, la faim, la sauvagerie dans dans de nombreuses régions du pays - tel était le prix dur à payer pour la plus radicale de toutes les révolutions qui aient jamais ébranlé les peuples de la terre ! Burlatsky F. Dirigeants et conseillers. M., 1990, page 70.
En 1929, ancien général de division et ministre de la Guerre du gouvernement provisoire, et alors professeur à l'Académie militaire du quartier général de l'Armée rouge, A.I. Verkhovsky a publié dans Ogonyok un article détaillé sur la menace d'intervention.
Ses calculs démographiques méritent une attention particulière.
« Les colonnes sèches de chiffres données dans les tableaux statistiques passent généralement inaperçues », écrit-il. - Mais si on les regarde bien, quels chiffres terribles il y a parfois !
La maison d'édition de l'Académie communiste a publié un recueil rédigé par B.A. Gukhman "Questions fondamentales de l'économie de l'URSS dans des tableaux et des diagrammes."
Le tableau 1 montre la dynamique de la population de l'URSS. Il montre qu'au 1er janvier 1914, 139 millions de personnes vivaient sur le territoire aujourd'hui occupé par notre Union. Au 1er janvier 1917, le tableau estime que la population était de 141 millions d'habitants, alors qu'avant la guerre, la croissance démographique était d'environ 1,5 % par an, ce qui donne une augmentation de 2 millions de personnes par an. Par conséquent, de 1914 à 1917, la population aurait dû augmenter de 6 millions et atteindre non pas 141, mais 145 millions.
On voit que 4 millions, ce n'est pas suffisant. Ce sont des victimes de la guerre mondiale. Parmi eux, nous estimons que 1,5 millions sont morts ou portés disparus, et 2,5 millions sont imputables à la baisse du taux de natalité.
Le chiffre suivant du tableau se réfère au 1er août 1922, c'est-à-dire couvre 5 ans de guerre civile et ses conséquences immédiates. Si le développement démographique s'était déroulé normalement, sa croissance aurait été d'environ 10 millions en 5 ans et, par conséquent, l'URSS en 1922 aurait dû en compter 151 millions.
En 1922, la population s'élevait à 131 millions d'habitants, soit 10 millions de moins qu'en 1917. La guerre civile nous a coûté encore 20 millions d'habitants, soit 5 fois plus qu'en 1917. Guerre mondiale" Verkhovsky A. L’intervention n’est pas acceptable. Ogonyok, 1929, n° 29, page 11.
Les pertes humaines totales subies par le pays pendant la guerre mondiale, la guerre civile et l'intervention (1914-1920) ont dépassé les 20 millions de personnes. - Histoire de l'URSS. L'ère du socialisme. M., 1974, page 71.
Les pertes totales de population dues à la guerre civile sur les fronts et à l'arrière à cause de la faim, de la maladie et de la terreur des gardes blancs se sont élevées à 8 millions de personnes. BST, 3e éd. Les pertes du Parti communiste sur les fronts se sont élevées à plus de 50 000 personnes. BST, 3e éd.
Il y avait aussi des maladies.
Fin 1918 - début 1919. La pandémie mondiale de grippe (appelée « grippe espagnole ») a touché environ 300 millions de personnes et a coûté la vie à 40 millions de personnes en 10 mois. Puis une deuxième vague, quoique moins forte, surgit. La malignité de cette pandémie peut être jugée par le nombre de décès. En Inde, environ 5 millions de personnes en sont mortes, aux États-Unis en 2 mois - environ 450 000 personnes, en Italie - environ 270 000 personnes ; Au total, cette épidémie a fait environ 20 millions de victimes et le nombre de maladies s'élève également à des centaines de millions.
Puis est arrivée la troisième vague. Probablement 0,75 milliard de personnes ont contracté la grippe espagnole en 3 ans. La population de la Terre à cette époque était de 1,9 milliard. Les pertes dues à la grippe espagnole ont dépassé le taux de mortalité de la Première Guerre mondiale sur tous les fronts réunis. À cette époque, jusqu’à 100 millions de personnes sont mortes dans le monde. La « grippe espagnole » aurait existé sous deux formes : chez les patients âgés, elle s'exprimait généralement par une pneumonie sévère, le décès survenait après 1,5 à 2 semaines. Mais ces patients étaient peu nombreux. Le plus souvent, pour une raison inconnue, des jeunes de 20 à 40 ans mouraient de la grippe espagnole... La plupart des personnes de moins de 40 ans sont mortes d'un arrêt cardiaque, cela s'est produit deux à trois jours après le début de la maladie.
Au début, la jeune Russie soviétique a eu de la chance : la première vague du « mal espagnol » ne l’a pas touchée. Mais à la fin de l’été 1918, une épidémie de grippe arriva de Galice en Ukraine. Rien qu'à Kiev, 700 000 cas ont été enregistrés. Ensuite, l'épidémie a commencé à se propager dans les provinces d'Orel et de Voronej à l'est, dans la région de la Volga, et au nord-ouest, dans les deux capitales.
Le docteur V. Glinchikov, qui travaillait à l'époque à l'hôpital Petropavlovsk de Petrograd, a noté que dans les premiers jours de l'épidémie, sur les 149 personnes amenées chez eux avec la « grippe espagnole », 119 personnes sont décédées. Dans l'ensemble de la ville, le taux de mortalité dû aux complications de la grippe atteint 54 %.
Pendant l'épidémie, plus de 2,5 millions de cas de grippe espagnole ont été enregistrés en Russie. Les manifestations cliniques de la grippe espagnole ont été bien décrites et étudiées. Il y avait des manifestations cliniques complètement atypiques pour la grippe, caractéristiques des lésions cérébrales. En particulier, les encéphalites à « hoquet » ou à « éternuements », survenant parfois même sans fièvre grippale typique. Ces maladies douloureuses sont des lésions de certaines zones du cerveau lorsqu'une personne a le hoquet ou éternue continuellement pendant une période assez longue, de jour comme de nuit. Certains en sont morts. Il existe d’autres formes monosymptomatiques de la maladie. Leur nature n'a pas encore été déterminée.
En 1918, des épidémies simultanées de peste et de choléra éclatèrent soudainement dans le pays.
De plus, en 1918-1922. En Russie, il y a également plusieurs épidémies de formes de typhus sans précédent. Au cours de ces années, plus de 7,5 millions de cas de typhus ont été enregistrés. Probablement, plus de 700 000 personnes en sont mortes. Mais il était impossible de compter tous les malades.
1919. « En raison de l’extrême surpopulation des prisons et des hôpitaux pénitentiaires de Moscou, le typhus y a pris un caractère épidémique. » Anatoly Mariengof. Mon âge.
Un contemporain a écrit : « Des voitures entières meurent du typhus. Pas un seul médecin. Aucun médicament. Des familles entières délirent. Il y a des cadavres le long de la route. Il y a des tas de cadavres dans les gares.
C’est le typhus, et non l’Armée rouge, qui a détruit les troupes de Koltchak. "Quand nos troupes", a écrit le commissaire du peuple à la santé N.A. Semashko, - est entré dans l'Oural et le Turkestan, une énorme avalanche de maladies épidémiques (typhoïde des trois types) s'est dirigée vers notre armée depuis les troupes de Koltchak et Dutov. Qu'il suffise de mentionner que parmi les 60 000 hommes de l'armée ennemie qui sont venus à nos côtés dès les premiers jours après la défaite de Koltchak et de Dutov, 80 % étaient infectés par le typhus. Le typhus sur le front de l'Est, fièvre récurrente, principalement sur le front du Sud-Est, s'est précipité vers nous en un torrent orageux. Et même la fièvre typhoïde, ce signe certain du manque de mesures sanitaires de base - du moins de vaccination, s'est répandue en grande vague dans toute l'armée Dutov et s'est propagée jusqu'à nous "...
Dans Omsk capturée, la capitale de Koltchak, l'Armée rouge a trouvé 15 000 ennemis malades abandonnés. Qualifiant l’épidémie d’« héritage des Blancs », les vainqueurs mènent une lutte sur deux fronts, le principal étant celui du typhus.
La situation était catastrophique. À Omsk, 500 personnes tombaient malades chaque jour et 150 en mouraient. L'épidémie a balayé le refuge pour réfugiés, la poste, l'orphelinat et les dortoirs des travailleurs ; les malades s'entassent sur des couchettes et sur des matelas pourris à même le sol.
Les armées de Koltchak, se retirant vers l'est sous l'assaut des troupes de Toukhatchevski, emportèrent tout avec elles, y compris les prisonniers, et parmi elles se trouvaient de nombreux malades du typhus. Au début, ils ont été conduits par étapes le long de la voie ferrée, puis montés dans des trains et emmenés en Transbaïkalie. Des gens sont morts dans les trains. Les cadavres ont été jetés hors des wagons, dessinant une ligne pointillée de corps en décomposition le long des rails.
Ainsi, en 1919, toute la Sibérie était infectée. Toukhatchevski a rappelé que la route d'Omsk à Krasnoïarsk était le royaume du typhus.
Hiver 1919-1920 L'épidémie à Novonikolaevsk, la capitale du typhus, a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes (le décompte exact des victimes n'a pas été tenu). La population de la ville a été réduite de moitié. À la gare de Krivoshchekovo, il y avait 3 piles de 500 cadavres chacune. Vingt autres wagons contenant les morts se trouvaient à proximité.
"Toutes les maisons étaient occupées par Chekatif, et la ville était dictatoriale par Chekatrup, qui a construit deux crématoires et creusé des kilomètres de tranchées profondes pour enterrer les cadavres", selon le rapport du CCT, voir : GANO. F.R-1133. Op. 1. D. 431v. L. 150.).
Au total, pendant les jours de l'épidémie, 28 institutions médicales militaires et 15 institutions médicales civiles fonctionnaient dans la ville. Le chaos régnait. L'historienne E. Kosyakova écrit : « Au début de janvier 1920, dans le huitième hôpital surpeuplé de Novonikolaevsk, les patients gisaient sur les lits, dans les allées et sous les lits. Dans les infirmeries, contrairement aux exigences sanitaires, des couchettes doubles ont été installées. Les malades de la typhoïde, les patients thérapeutiques et les blessés étaient hébergés dans une seule pièce, qui n'était en fait pas un lieu de traitement, mais une source d'infection typhoïde.
Ce qui est étrange, c'est que cette maladie n'affectait pas seulement la Sibérie, mais aussi le Nord. En 1921-1922 Sur les 3 000 habitants de Mourmansk, 1 560 personnes souffraient du typhus. Des cas de variole, de grippe espagnole et de scorbut ont été enregistrés.
En 1921-1922 et en Crimée, il y a eu des épidémies de typhoïde et - dans des proportions notables - de choléra, des épidémies de peste, de variole, de scarlatine et de dysenterie. Selon le Commissariat du Peuple à la Santé, dans la province d'Ekaterinbourg, début janvier 1922, 2 000 patients atteints du typhus ont été enregistrés, principalement dans les gares. Une épidémie de typhus a également été observée à Moscou. Là, au 12 janvier 1922, il y avait 1 500 patients atteints de fièvre récurrente et 600 patients atteints de typhus. Pravda, n° 8, 12 janvier 1922, p.2.
La même année 1921, éclate une épidémie de paludisme tropical qui touche également les régions du nord. Le taux de mortalité atteint 80% !
Les causes de ces épidémies soudaines et graves sont encore inconnues. Au début, ils pensaient que le paludisme et le typhus arrivaient en Russie depuis le front turc. Mais l'épidémie de paludisme sous sa forme habituelle ne peut pas persister dans les régions où il fait plus froid que +16 degrés Celsius ; La manière dont il a pénétré dans la province d’Arkhangelsk, dans le Caucase et en Sibérie n’est pas claire. À ce jour, on ne sait pas exactement d'où provenaient les bacilles du choléra dans les rivières sibériennes - dans ces régions presque non peuplées. Cependant, des hypothèses ont été émises selon lesquelles des armes bactériologiques auraient été utilisées pour la première fois contre la Russie au cours de ces années.
En effet, après le débarquement des troupes britanniques et américaines à Mourmansk et Arkhangelsk, en Crimée et Novorossiysk, à Primorye et dans le Caucase, ces épidémies inconnues ont immédiatement éclaté.
Il s'avère que pendant la Première Guerre mondiale, un centre top secret, la Royal Engineers Experimental Station, a été créé dans la ville de Porton Down près de Salisbury (Wiltshire), où physiologistes, pathologistes et météorologues des meilleures universités britanniques ont effectué expériences sur des personnes.
Au cours de l'existence de ce complexe secret, plus de 20 000 personnes ont participé à des milliers de tests sur les agents pathogènes de la peste et du charbon, d'autres maladies mortelles, ainsi que sur les gaz toxiques.
Au début, des expériences ont été menées sur des animaux. Mais comme dans les expériences sur les animaux, il est difficile de savoir exactement comment se produisent les effets des produits chimiques sur les organes et les tissus humains, en 1917, un laboratoire spécial est apparu à Porton Down, destiné aux expériences sur les humains.
Plus tard, il a été réorganisé en Centre de Recherche Microbiologique. Le CCU était situé à l’hôpital Harvard à l’ouest de Salisbury. Les sujets (pour la plupart des soldats) ont volontairement accepté les expériences, mais presque personne ne savait quels risques ils prenaient. L'histoire tragique des « vétérans de Porton » a été racontée par l'historien britannique Ulf Schmidt dans le livre Secret Science : A Century of Poison Warfare and Human Experiments.
Outre Porton Down, l'auteur rend également compte des activités de l'Edgewood Arsenal, une unité spéciale des forces chimiques des forces armées américaines, organisée en 1916.
La peste noire, comme si elle revenait du Moyen Âge, suscitait une peur particulière parmi les médecins. Mikhel D.V. Combattre la peste dans le sud-est de la Russie (1917-1925). - Sur SAT. Histoire des sciences et des techniques. 2006, n° 5, p. 58-67.
En 1921, Novonikolaevsk a connu une vague d'épidémie de choléra, accompagnée d'un afflux de réfugiés provenant des régions affamées.
En 1922, malgré les conséquences de la famine, les épidémies infectieuses endémiques dans le pays diminuent. Ainsi, à la fin de 1921, plus de 5,5 millions de personnes en Russie soviétique souffraient du typhus, de la typhoïde et de la fièvre récurrente.
Les principaux foyers du typhus étaient la région de la Volga, l'Ukraine, la province de Tambov et l'Oural, où l'épidémie destructrice a frappé en premier lieu les provinces d'Oufa et d'Ekaterinbourg.
Mais déjà au printemps 1922, le nombre de patients tomba à 100 000 personnes, même si le tournant dans la lutte contre le typhus ne survint qu'un an plus tard. Ainsi, en Ukraine, le nombre de typhus et de décès dus à celui-ci en 1923 a diminué de 7 fois. Au total, en URSS, le nombre de maladies par an a été divisé par 30. Région de la Volga.
La lutte contre le typhus, le choléra et le paludisme s'est poursuivie jusqu'au milieu des années 1920. Le soviétologue américain Robert Gates estime que la Russie, sous le règne de Lénine, a perdu 10 millions de personnes à cause de la terreur et de la guerre civile. (Washington Post, 30/04/1989).
Les défenseurs de Staline contestent avec zèle ces données, inventant de fausses statistiques. Voici, par exemple, ce qu'écrit le président du CIPF Gennady Zyuganov : « En 1917, la population de la Russie à l'intérieur de ses frontières actuelles était de 91 millions de personnes. En 1926, lorsque fut effectué le premier recensement de la population soviétique, la population de la RSFSR (c'est-à-dire toujours sur le territoire de la Russie actuelle) atteignait 92,7 millions de personnes. Et ce, même si la guerre civile, destructrice et sanglante, avait pris fin cinq ans plus tôt.» Ziouganov G.A. Staline et la modernité. http://www.politpros.com/library/9/223.
D'où proviennent ces chiffres, de quelles collections statistiques exactement, le principal communiste de Russie ne bégaie pas, espérant qu'ils le croiront sans preuves.
Les communistes ont toujours exploité la naïveté des autres.
Que s'est-il vraiment passé?
L'article de Vladimir Chubkine « Les adieux difficiles » est consacré à la perte de population à l'époque de Lénine et de Staline ( Nouveau monde, n° 4, 1989). Selon Choubkine, pendant le règne de Lénine, de l’automne 1917 à 1922, les pertes démographiques de la Russie se sont élevées à près de 13 millions de personnes, auxquelles il faut soustraire les émigrés (1,5 à 2 millions de personnes).
L'auteur, se référant à l'étude de Yu.A. Polyakova, indique que les pertes humaines totales de 1917 à 1922, en tenant compte des naissances ratées et de l'émigration, s'élèvent à environ 25 millions de personnes (l'académicien S. Strumilin a estimé les pertes de 1917 à 1920 à 21 millions).
Au cours des années de collectivisation et de famine (1932-1933), les pertes humaines de l'URSS, selon les calculs de V. Shubkin, s'élevaient à 10 à 13 millions de personnes.
Si nous continuons avec l'arithmétique, alors pendant la Première Guerre mondiale, en plus de quatre ans, l'Empire russe a perdu 20 - 8 = 12 millions de personnes.
Il s’avère que les pertes annuelles moyennes de la Russie pendant la Première Guerre mondiale se sont élevées à 2,7 millions de personnes.
Apparemment, cela inclut les victimes civiles.
Mais ces chiffres sont également contestés.
En 1919-1920, la publication d'une liste de 65 volumes des grades inférieurs tués, blessés et disparus de l'armée russe en 1914-1918 a été achevée. Sa préparation a commencé en 1916 par des employés de l'état-major de l'Empire russe. Sur la base de ces travaux, l'historien soviétique rapporte : « Pendant 3,5 ans de guerre, les pertes armée russe s'élevait à 68.994 généraux et officiers, 5.243.799 soldats. Cela inclut les tués, les blessés et les disparus." Beskrovny L.G. L'armée et la marine de Russie au début du 20e siècle. Essais sur le potentiel militaro-économique. M., 1986. P.17.
De plus, il faut tenir compte de ceux qui ont été capturés. A la fin de la guerre, 2 385 441 prisonniers russes étaient enregistrés en Allemagne, 1 503 412 en Autriche-Hongrie, 19 795 en Turquie et 2 452 en Bulgarie, pour un total de 3 911 100. Actes de la Commission chargée d'étudier les conséquences sanitaires de la guerre de 1914-1920. Vol. 1. P. 169.
Ainsi, les pertes humaines totales de la Russie devraient s'élever à 9 223 893 soldats et officiers.
Mais il faut soustraire de là 1.709.938 blessés revenus des hôpitaux de campagne. En conséquence, sans ce contingent, le nombre de tués, de morts des suites de blessures, de blessés graves et de prisonniers s'élèvera à 7 513 955 personnes.
Tous les chiffres sont donnés d'après des informations de 1919. En 1920, des travaux sur les listes de pertes, notamment la clarification du nombre de prisonniers de guerre et de disparus au combat, permettent de réviser les pertes militaires totales et de les déterminer à 7 326 515 personnes. Actes de la Commission d'enquête... P. 170.
L’ampleur sans précédent de la Première Guerre mondiale a en effet conduit à un nombre considérable de prisonniers de guerre. Mais la question du nombre de militaires de l’armée russe qui se trouvaient en captivité ennemie reste controversée.
Ainsi, l’encyclopédie « La Grande Révolution socialiste d’Octobre » nomme plus de 3,4 millions de prisonniers de guerre russes. (M., 1987. P. 445).
D'après E.Yu. Sergeev, au total, environ 1,4 million de soldats et officiers de l'armée russe ont été capturés. Sergueïev E.Yu. Prisonniers de guerre russes en Allemagne et en Autriche-Hongrie // Histoire nouvelle et récente. 1996. N 4. P. 66.
L'historien O.S. Nagornaya appelle chiffre similaire- 1,5 million de personnes (Nagornaya O.S. Une autre expérience militaire : prisonniers de guerre russes de la Première Guerre mondiale en Allemagne (1914-1922). M., 2010. P. 9).
Autres données de S.N. Vasilyeva : « Au 1er janvier 1918, l'armée russe avait perdu des prisonniers : soldats - 3 395 105 personnes, et officiers et fonctionnaires de classe - 14 323 personnes, ce qui représentait 74,9 % de toutes les pertes au combat, soit 21,2 % du nombre total des mobilisés" . (Vasilieva S.N. Prisonniers de guerre d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de Russie pendant la Première Guerre mondiale : Manuel pour un cours spécial. M., 1999. P. 14-15).
Cet écart de chiffres (plus de 2 fois) est apparemment la conséquence d'une comptabilité et d'un enregistrement mal organisés des prisonniers de guerre.
Mais si l’on approfondit les statistiques, tous ces chiffres ne semblent pas très convaincants.
"En parlant de pertes Population russeÀ la suite de deux guerres et d'une révolution, écrit l'historien Yu. Polyakov, un étrange écart est frappant dans la population de la Russie d'avant-guerre, qui, selon divers auteurs, atteint 30 millions de personnes. Cet écart dans la littérature démographique s'explique principalement par des écarts territoriaux. Certains collectent des données sur le territoire de l'État russe dans les frontières d'avant-guerre (1914), d'autres sur le territoire à l'intérieur des frontières établies en 1920-1921. et ceux qui existaient avant 1939, le troisième - par territoire à l'intérieur des frontières modernes avec une rétrospective pour 1917 et 1914. Les calculs sont parfois effectués en incluant la Finlande, l'émirat de Boukhara et le khanat de Khiva, parfois sans les exclure. Nous n'avons pas recours aux données démographiques de 1913 à 1920, calculées pour le territoire situé à l'intérieur des frontières modernes. Ces données, importantes pour montrer la dynamique de croissance de la population actuelle, ne sont pas très utiles dans les études historiques consacrées à la Première Guerre mondiale, à la Révolution d'Octobre et à la guerre civile.
Ces chiffres indiquent la population du territoire qui existe actuellement, mais en 1913-1920. elle ne correspondait ni aux frontières légales ni réelles de la Russie. Rappelons que selon ces données, la population du pays à la veille de la Première Guerre mondiale était de 159,2 millions de personnes, et au début de 1917 - 163 millions (URSS en chiffres en 1977 - M., 1978, p. 7). La différence dans la détermination de la taille de la population d'avant-guerre (fin 1913 ou début 1914) de la Russie (à l'intérieur des frontières établies en 1920-1921 et existant avant le 17 septembre 1939) atteint 13 millions de personnes (de 132,8 millions à 145,7 millions).
Les collections statistiques des années 60 déterminent la population à cette époque à 139,3 millions de personnes. Des données confuses sont fournies (pour le territoire à l'intérieur des frontières avant 1939) pour 1917, 1919, 1920, 1921, etc.
Une source importante est le recensement de 1917. Une partie importante de ses documents a été publiée. Les étudier (y compris les tableaux inédits stockés dans les archives) est très utile. Mais les documents de recensement ne couvrent pas le pays dans son ensemble, les conditions de guerre ont affecté l'exactitude des données et, lors de la détermination de la composition nationale, ses informations présentent les mêmes défauts que toutes les statistiques pré-révolutionnaires, qui ont commis de graves erreurs dans la détermination de la nationalité. fondée uniquement sur l'appartenance linguistique.
Entre-temps, la différence dans la détermination de la taille de la population, selon les propres déclarations des citoyens (ce principe est accepté par les statistiques modernes), est très grande. Un certain nombre de nationalités n'étaient pas du tout prises en compte avant la révolution.
Le recensement de 1920 ne peut malheureusement pas non plus être cité parmi les sources de base, même si ses matériaux doivent sans aucun doute être pris en compte.
Le recensement a été effectué à l'époque (août 1920) où il y avait une guerre avec la Pologne bourgeoise et les zones de première ligne étaient inaccessibles aux recenseurs, lorsque Wrangel occupait encore la Crimée et le nord de la Taurida, lorsque le contre-attaque -des gouvernements révolutionnaires existaient en Géorgie et en Arménie, et des territoires importants en Sibérie et en Extrême-Orient étaient sous le règne des interventionnistes et des gardes blancs, lorsque différentes fins Des gangs nationalistes et koulaks opéraient dans le pays (de nombreux recenseurs ont été tués). C’est pourquoi la population de nombreux territoires périphériques a été calculée sur la base d’informations pré-révolutionnaires.
Le recensement présentait également des lacunes dans la détermination de la composition nationale de la population (par exemple, les petits peuples du Nord étaient réunis en un groupe sous le nom douteux d'« Hyperboréens »). Il existe de nombreuses contradictions dans les données sur les pertes de population pendant la Première Guerre mondiale et la guerre civile (le nombre de tués, de morts d'épidémies, etc.), sur les réfugiés des territoires de première ligne occupés par les troupes austro-allemandes en 1917, sur les conséquences démographiques des mauvaises récoltes et de la famine.
Les recueils statistiques des années 60 donnent les chiffres de 143,5 millions de personnes au 1er janvier 1917, 138 millions au 1er janvier 1919, 136,8 millions au 1er août 1920.
En 1973-1979 à l'Institut d'histoire de l'URSS, sous la direction de l'auteur de ces lignes (Polyakov), une méthode a été développée et mise en œuvre pour utiliser (à l'aide d'un ordinateur) les données du recensement de 1926 pour déterminer la population du pays des années précédentes . Ce recensement a enregistré la composition de la population du pays avec une précision et un niveau scientifique sans précédent en Russie. Les documents du recensement de 1926 ont été publiés largement et intégralement - en 56 volumes. L'essence de la méthodologie sous sa forme générale est la suivante : sur la base des données du recensement de 1926, principalement basées sur la structure par âge de la population, la série dynamique de la population du pays pour 1917-1926 est restaurée. Parallèlement, les données sur les ressources naturelles et mouvement mécanique population pour les années indiquées. Par conséquent, cette technique peut être qualifiée de technique d'utilisation rétrospective des matériaux du recensement de la population, en tenant compte de l'ensemble des données supplémentaires dont dispose l'historien.
À la suite des calculs, plusieurs centaines de tableaux ont été obtenus caractérisant le mouvement de population en 1917-1926. pour différentes régions et pour le pays dans son ensemble, déterminant le nombre et la proportion des peuples du pays. En particulier, le nombre et Composition nationale population de la Russie à l'automne 1917 sur le territoire à l'intérieur des frontières de 1926 (147 644,3 mille). Il nous a semblé extrêmement important d'effectuer des calculs sur la base du territoire réel de la Russie à l'automne 1917 (c'est-à-dire sans les zones occupées par les troupes austro-allemandes), car la population située derrière la ligne de front était alors exclue du champ d'action. vie économique et politique de la Russie. Nous avons déterminé le territoire réel sur la base de cartes militaires retraçant la ligne de front à l’automne 1917.
La taille de la population du territoire actuel de la Russie à l'automne 1917, à l'exclusion de la Finlande, de l'émirat de Boukhara et du khanat de Khiva, était de 153 617 000 personnes ; sans la Finlande, y compris Khiva et Boukhara - 156 617 000 personnes ; avec la Finlande (avec le volost de Pechenga), Khiva et Boukhara - 159 965 mille personnes. Polyakov Yu.A. Population de la Russie soviétique en 1917-1920. (Historiographie et sources). - Sur SAT. Problèmes russes mouvement social Et science historique. M., Nauka, 1981. pp. 170-176.
Si l'on se souvient du chiffre de 180,6 millions de personnes citées dans la Grande Encyclopédie soviétique, alors laquelle de celles mentionnées par Yu.A. Polyakov ne donne aucun chiffre, mais à l'automne 1917, le déficit démographique de la Russie ne sera pas de 12 millions, mais oscillera entre 27 et 37,5 millions de personnes.
Comment comparer ces chiffres ? En 1917, la population de la Suède, par exemple, était estimée à 5,5 millions d'habitants. En d’autres termes, cette erreur statistique est égale à 5-7 en Suède.
La situation est similaire avec les pertes de population du pays causées par la guerre civile.
"Les innombrables victimes de la guerre contre les gardes blancs et les interventionnistes (la population du pays a diminué de 13 millions de personnes entre 1917 et 1923) ont été à juste titre attribuées à l'ennemi de classe - le coupable, l'instigateur de la guerre." Polyakov Yu.A. Années 20 : l’ambiance de l’avant-garde du parti. Questions de l'histoire du PCUS, 1989, n° 10, page 30.
Dans l'ouvrage de référence V.V. Erlichman « Pertes de population au 20e siècle ». (M. : Russian Panorama, 2004) on dit que pendant la guerre civile de 1918-1920. environ 10,5 millions de personnes sont mortes.
Selon l'historien A. Kilichenkov, « en trois ans de massacres civils fratricides, le pays a perdu 13 millions de personnes et n'a conservé que 9,5 % du produit national brut précédent (avant 1913). » Science et Vie, 1995, n° 8, p. 80.
L. Semyannikova, professeur à l'Université d'État de Moscou, objecte : « la guerre civile, extrêmement sanglante et destructrice, a coûté la vie, selon les historiens russes, à 15 à 16 millions de personnes ». Science et Vie, 1995, n° 9, p. 46.
L'historien M. Bernshtam, dans son ouvrage « Les partis dans la guerre civile », a tenté de dresser un bilan général des pertes de population russe au cours des années de guerre 1917-1920 : « D'après l'ouvrage de référence spécial de l'Office central de statistique, le nombre La population sur le territoire de l'URSS après 1917 ne prend pas en compte la population des territoires éloignés de la Russie et ceux qui ne faisaient pas partie de l'URSS s'élevaient à 146 755 520 personnes. - Composition administrative-territoriale de l'URSS aux 1er juillet 1925 et 1er juillet 1926, par rapport à la division de la Russie d'avant-guerre. Expérience dans l'établissement de liens entre la composition administrative-territoriale de la Russie d'avant-guerre et composition moderne L'URSS. Office central de statistique de l'URSS. - M., 1926, p.49-58.
C'est le chiffre initial de la population qui, depuis octobre 1917, se trouve dans la zone de la révolution socialiste. Sur le même territoire, le recensement du 28 août 1920, incluant ceux de l'armée, ne retrouva que 134 569 206 personnes. - Annuaire statistique 1921. Vol. 1. Actes de l'Office central de statistique, tome VIII, no. 3, M., 1922, p.8. Le déficit démographique total est de 12 186 314 personnes.
Ainsi, résume l’historien, en moins des trois premières années de la révolution socialiste sur le territoire de l’ancien Empire russe (de l’automne 1917 au 28 août 1920), la population a perdu 8,3 pour cent de sa composition originale.
Au cours de ces années, l'émigration se serait élevée à 86 000 personnes (Alekhin M. White Emigration. TSB, 1ère éd., vol. 64. M., 1934, colonne 163), et le déclin naturel - l'excédent de mortalité sur le taux de natalité - 873 623 personnes (Actes de l'Office central de statistique, vol. XVIII, M., 1924, p. 42).
Ainsi, les pertes dues à la révolution et à la guerre civile au cours des trois premières années du pouvoir soviétique, sans émigration ni déclin naturel, se sont élevées à plus de 11,2 millions de personnes. Il faut ici noter, commente l’auteur, que le « déclin naturel » nécessite une interprétation raisonnable : pourquoi ce déclin ? Le terme scientifique « naturel » est-il approprié ici ? Il est clair que l’excès de mortalité par rapport au taux de natalité est un phénomène contre nature et est lié aux résultats démographiques de la révolution et de l’expérience socialiste.»
Cependant, si l'on suppose que cette guerre a duré 4 ans (1918-1922) et que les pertes totales sont de 15 millions de personnes, alors les pertes annuelles moyennes de la population du pays au cours de cette période s'élèvent à 3,7 millions de personnes.
Il s’avère que la guerre civile a été plus sanglante que la guerre contre les Allemands.
Dans le même temps, la taille de l’Armée rouge atteignait 3 millions de personnes à la fin de 1919 et 5,5 millions de personnes à l’automne 1920.
Le célèbre démographe B.Ts. Urlanis, dans son livre « Guerres et population de l'Europe », parlant des pertes parmi les soldats et les commandants de l'Armée rouge pendant la guerre civile, donne les chiffres suivants. Le nombre total de morts et de morts, selon lui, est de 425 000 personnes. Environ 125 000 personnes ont été tuées au front, environ 300 000 personnes sont mortes dans l'armée d'active et dans les districts militaires. Urlanis B. Ts. Guerres et population de l'Europe. - M., 1960. pp. 183, 305. De plus, l'auteur écrit que "la comparaison et la valeur absolue des chiffres donnent des raisons de supposer que les tués et les blessés sont inclus dans les pertes au combat". Urlanis B.Ts. Là, p. 181.
L'ouvrage de référence « L'économie nationale de l'URSS en chiffres » (M., 1925) contient des informations complètement différentes sur les pertes de l'Armée rouge en 1918-1922. Dans ce livre, selon les données officielles du département des statistiques de la Direction principale de l'Armée rouge, les pertes au combat de l'Armée rouge pendant la guerre civile sont citées - 631 758 soldats de l'Armée rouge, et sanitaires (avec évacuation) - 581 066, et au total - 1 212 824 personnes (p. 110).
Le mouvement blanc était assez restreint. À la fin de l'hiver 1919, c'est-à-dire au moment de son développement maximum, selon les rapports militaires soviétiques, il ne dépassait pas 537 000 personnes. Parmi eux, pas plus de 175 000 personnes sont mortes. - Kakaurin N.E. Comment la révolution s'est battue, tome 2, M.-L., 1926, p. 137.
Ainsi, il y avait 10 fois plus de rouges que de blancs. Mais il y a eu beaucoup plus de victimes dans les rangs de l'Armée rouge - soit 3 ou 8 fois.
Mais si l’on compare les pertes des deux armées adverses sur trois ans avec les pertes de la population russe, on ne peut échapper à la question : qui a combattu avec qui ?
Blanc et rouge ?
Ou les deux avec le peuple ?
« La cruauté est inhérente à toute guerre, mais dans la guerre civile russe, il y avait une cruauté incroyable. Les officiers blancs et les volontaires savaient ce qui leur arriverait s'ils étaient capturés par les Rouges : j'ai vu plus d'une fois des corps terriblement défigurés avec des bretelles découpées sur les épaules. Orlov, G. Journal d'un Drozdovite. // Étoile. - 2012. - N° 11.
Les Rouges ne furent pas moins brutalement détruits. "Dès que l'appartenance partisane des communistes fut établie, ils furent pendus à la première branche." Reden, N. À travers l'enfer de la révolution russe. Mémoires d'un aspirant 1914-1919. -M., 2006.
Les atrocités commises par Dénikine, Annenkov, Kalmokov et Koltchak sont bien connues.
Au début de la Campagne de Glace, Kornilov a déclaré : "Je vous donne un ordre très cruel : ne faites pas de prisonniers ! J'assume la responsabilité de cet ordre devant Dieu et le peuple russe !" L'un des participants à la campagne a rappelé la cruauté des volontaires ordinaires lors de la « Marche de glace » lorsqu'il a écrit à propos des représailles contre les capturés : « Tous les bolcheviks capturés par nous, les armes à la main, ont été abattus sur place : seuls, en des dizaines, des centaines : c'était une guerre « d'extermination ». Fedyuk V.P. White. Mouvement antibolchevique dans le sud de la Russie 1917-1918.
Un témoin, l'écrivain William, a parlé des Dénikinites dans ses mémoires. Certes, il hésite à parler de ses propres exploits, mais il raconte en détail les histoires de ses complices dans la lutte pour l'un et l'indivisible.
« Ils ont chassé les Rouges - et combien d'entre eux ont été abattus, la passion du Seigneur ! Et ils ont commencé à établir leur propre ordre. La libération a commencé. Au début, les marins ont été blessés. Ces imbéciles sont restés, « notre affaire, disent-ils, est sur l'eau, nous vivrons avec les cadets »... Eh bien, tout est comme il se doit, à l'amiable : ils les ont expulsés de la jetée, forcés qu'ils creusent un fossé pour eux-mêmes, puis ils les mèneront un à un au bord et hors des revolvers. Alors, pouvez-vous le croire, ils se sont déplacés comme des écrevisses dans ce fossé jusqu'à s'endormir. Et puis, à cet endroit, la terre entière a bougé : c’est pour ça qu’ils n’ont pas fini, pour que d’autres soient embarrassés.
Le commandant du corps d'occupation américain en Sibérie, le général Greves, témoigne à son tour : « Des meurtres terribles ont été commis en Sibérie orientale, mais ils n'ont pas été commis par les bolcheviks, comme on le pensait habituellement. Je ne me tromperai pas si je dis qu’en Sibérie orientale, pour chaque personne tuée par les bolcheviks, 100 personnes ont été tuées par des éléments antibolcheviks.»
« Il est possible de mettre un terme au soulèvement le plus rapidement possible, sans recourir aux mesures les plus sévères, voire les plus cruelles, non seulement contre les rebelles, mais aussi contre la population qui les soutient... Pour la dissimulation... là doit être une punition impitoyable... Pour la reconnaissance et les communications, utiliser les résidents locaux, prendre des otages . En cas d’informations erronées et intempestives ou de trahison, les otages seront exécutés et les maisons leur appartenant seront incendiées. Ce sont des citations de l'ordre du souverain suprême de la Russie, l'amiral A.V. Koltchak du 23 mars 1919
Et voici des extraits de l'ordre du 27 mars 1919 de Kolchak S. Rozanov, gouverneur de l'Ienisseï et d'une partie de la province d'Irkoutsk spécialement autorisé : dans les villages qui n'extradent pas les Rouges, « tirez sur le dixième » ; les villages qui résistent doivent être incendiés, et « la population masculine adulte doit être fusillée sans exception », les biens et le pain sont entièrement confisqués au profit du trésor ; En cas de résistance des villageois, les otages seront « fusillés sans pitié ».
Les chefs politiques du corps tchécoslovaque B. Pavlu et V. Girsa déclaraient dans leur mémorandum officiel aux alliés en novembre 1919 : « L'amiral Kolchak s'entoura d'anciens fonctionnaires tsaristes, et comme les paysans ne voulaient pas prendre les armes et sacrifier leurs vies pour le retour de ces gens au pouvoir, ils ont été battus, fouettés et tués de sang-froid par milliers, après quoi le monde les a appelés « bolcheviks ».
«La faiblesse la plus importante du gouvernement d'Omsk est qu'une écrasante majorité s'y oppose. En gros, environ 97 % de la population sibérienne est aujourd’hui hostile à Koltchak.» Témoignage du lieutenant-colonel Eichelberg. Nouvelle heure, 1988. N° 34. pp. 35-37.
Mais il est également vrai que les Rouges ont traité avec brutalité les ouvriers et les paysans rebelles.
Il est intéressant de noter que pendant la guerre civile, il n'y avait presque pas de Russes dans l'Armée rouge, même si peu de gens le savent...
« Tu ne devrais pas devenir soldat, Vanek.
Dans l'Armée rouge, il y aura des baïonnettes et du thé,
Les bolcheviks se débrouilleront sans vous. »
Outre les tirailleurs lettons, plus de 25 000 Chinois ont participé à la défense de Petrograd depuis Yudenich, et au total il y avait au moins 200 000 internationalistes chinois dans les unités de l'Armée rouge. En 1919, plus de 20 unités chinoises opéraient dans l'Armée rouge - près d'Arkhangelsk et de Vladikavkaz, à Perm et près de Voronej, dans l'Oural et au-delà de l'Oural...
Il n'y a probablement personne qui n'a pas vu le film "The Elusive Avengers", mais peu de gens savent que le film est basé sur le livre de P. Blyakhin "Little Red Devils", et très peu de gens s'en souviennent dans dans le livre, il n'y a pas de gitan Yashka, il y a un Yu-yu chinois, et dans le film réalisé dans les années 30, à la place de Yu il y avait un Johnson noir.
Le premier organisateur des unités chinoises de l'Armée rouge, Yakir, a rappelé que les Chinois se distinguaient par une haute discipline, une obéissance inconditionnelle aux ordres, un fatalisme et un sacrifice de soi. Dans son livre « Mémoires de la guerre civile », il écrit : « Les Chinois considéraient les salaires très au sérieux. Vous avez donné votre vie facilement, mais payez à temps et nourrissez-vous bien. Oui c'est ça. Leurs représentants viennent me voir et me disent qu'ils ont embauché 530 personnes et que je dois donc les payer toutes. Et autant qu'il n'y en a pas, alors rien - le reste de l'argent qui leur est dû, ils le partageront entre tous. Je leur ai parlé pendant longtemps, les convainquant que ce n'était pas bien et que ce n'était pas notre façon de faire. Pourtant, ils ont eu le leur. Un autre argument a été avancé : ils disent que nous devrions envoyer les familles des personnes tuées en Chine. Nous avons eu beaucoup de bonnes choses avec eux au cours de ce long et pénible voyage à travers toute l'Ukraine, tout le Don, jusqu'à la province de Voronej.»
Quoi d'autre?
Il y avait environ 90 000 Lettons, plus 600 000 Polonais, 250 Hongrois, 150 Allemands, 30 000 Tchèques et Slovaques, 50 000 Yougoslaves, il y avait une division finlandaise et des régiments persans. Dans l'Armée rouge coréenne - 80 000, et dans Différents composants environ 100 autres, il y avait des unités ouïghoures, estoniennes, tatares, de montagne...
Le personnel de l'état-major est également curieux.
« Beaucoup des ennemis les plus féroces de Lénine ont accepté de se battre aux côtés des bolcheviks détestés lorsqu’il s’agissait de défendre la patrie. » Kerensky A.F. Ma vie est souterraine. Sména, 1990, n° 11, p. 264.
Le livre de S. Kavtaradze « Les spécialistes militaires au service du pouvoir soviétique » est bien connu. Selon ses calculs, 70 % des généraux tsaristes servaient dans l'Armée rouge et 18 % dans toutes les armées blanches. Il existe même une liste de noms - du général au capitaine - d'officiers d'état-major qui ont volontairement rejoint l'Armée rouge. Leurs motivations étaient un mystère pour moi jusqu'à ce que je lise les mémoires de N.M. Potapov, quartier-maître général de l'infanterie, qui dirigea le contre-espionnage de l'état-major en 1917. C'était une personne difficile.
Je vais brièvement raconter ce dont je me souviens. Je vais d'abord faire une réservation - une partie de ses mémoires a été publiée dans les années 60 dans le Journal historique militaire, et j'ai lu l'autre dans le département des manuscrits de Leninka.
Alors, qu'y a-t-il dans le magazine ?
En juillet 1917, Potapov rencontra M. Kedrov (ils étaient amis depuis l'enfance), N. Podvoisky et V. Bonch-Bruevich (le chef des renseignements du parti, et son frère Mikhaïl dirigea quelque temps plus tard le quartier général opérationnel sur le terrain du Armée rouge). C'étaient les dirigeants de l'armée bolchevique, les futurs organisateurs du coup d'État bolchevique. Après de longues négociations, ils parvinrent à un accord : 1. L'état-major aidera activement les bolcheviks à renverser le gouvernement provisoire. 2. Les gens de l'état-major s'installeront dans les structures pour créer une nouvelle armée pour remplacer celle désintégrée.
Les deux parties ont rempli leurs obligations. Après octobre, Potapov lui-même fut nommé directeur des affaires du ministère de la Guerre, car les commissaires du peuple étaient constamment en mouvement. En fait, il fut chef du commissariat du peuple et, à partir de juin 1918, il travailla comme expert. D'ailleurs, il a joué un rôle important dans les opérations Trest et Syndicate-2. Il fut enterré avec les honneurs en 1946.
Parlons maintenant du manuscrit. Selon Potapov, l'armée, grâce aux efforts de Kerensky et d'autres démocrates, a été complètement désintégrée. La Russie était en train de perdre la guerre. L'influence des banques européennes et américaines sur le gouvernement était trop visible.
Les bolcheviks pragmatiques, à leur tour, devaient détruire la fausse démocratie dans l’armée, établir une discipline de fer et, en outre, défendre l’unité de la Russie. Les officiers patriotes de carrière comprirent parfaitement que Koltchak avait promis de céder la Sibérie aux Américains, et les Britanniques et les Français obtinrent des promesses similaires de la part de Dénikine et de Wrangel. En réalité, les livraisons d’armes en provenance de l’Occident se sont déroulées dans ces conditions. La commande n°1 a été annulée.
Trotsky a rétabli une discipline de fer et une subordination complète de la base aux commandants dans un délai de six mois, en recourant aux mesures les plus sévères, y compris les exécutions. Après la révolte de Staline et de Vorochilov, connus sous le nom d'opposition militaire, le VIIIe Congrès a introduit l'unité de commandement dans l'armée, interdisant les tentatives d'ingérence des commissaires. Les histoires d'otages étaient des mythes. Les officiers étaient bien pourvus, ils étaient honorés, récompensés, leurs ordres étaient exécutés sans condition, l'une après l'autre les armées de leurs ennemis étaient chassées de Russie. Ce poste leur convenait très bien en tant que professionnels. Donc, en tout cas, a écrit Potapov.
Pitirim Sorokin, contemporain des événements, témoigne : « Depuis 1919, le gouvernement a en réalité cessé d'être le pouvoir des masses laborieuses et est devenu simplement une tyrannie, composée d'intellectuels sans principes, d'ouvriers déclassés, de criminels et d'aventuriers de tout genre. » La terreur, a-t-il noté, « a commencé à être menée dans une plus grande mesure contre les ouvriers et les paysans ». Sorokin P.A. L'état actuel de la Russie. Nouveau monde. 1992. N° 4. P.198.
C'est vrai, contre les ouvriers et les paysans. Il suffit de rappeler les exécutions de Toula et d'Astrakhan, de Cronstadt et de l'Antonovisme, la répression de centaines de révoltes paysannes...
Comment ne pas vous rebeller quand on vous vole ?
"Si nous, dans les villes, pouvons dire que le gouvernement soviétique révolutionnaire est assez fort pour résister à toute attaque de la bourgeoisie, alors on ne peut en aucun cas dire cela dans les campagnes. Nous devons sérieusement poser la question de la stratification dans les campagnes, de la création de deux forces hostiles opposées dans le village... Seulement si nous pouvons diviser le village en deux camps hostiles irréconciliables, si nous pouvons y attiser la même guerre civile qui se déroulait il n'y a pas si longtemps dans les villes, si nous parvenons à restaurer le village, les pauvres contre la bourgeoisie rurale, - alors seulement nous pourrons dire que nous ferons à l'égard des campagnes ce que nous avons pu faire pour les villes." Yakov Sverdlov. Discours lors d'une réunion de l'Exécutif central panrusse Comité de la IVe convocation du 20 mai 1918.
Le 29 juin 1918, s'exprimant au 3e Congrès panrusse du Parti socialiste révolutionnaire de gauche, le délégué de la région de l'Oural N.I. Melkov a dénoncé les exploits des détachements alimentaires dans la province d'Oufa, où « la question alimentaire était « bien organisée » par le président de l'administration alimentaire Tsyurupa, nommé commissaire à l'alimentation pour toute la Russie, mais l'autre côté de la question C'est plus clair pour nous, socialistes-révolutionnaires de gauche, que pour n'importe qui d'autre. Nous savons comment ce pain a été arraché des villages, quelles atrocités cette Armée rouge a commises dans les villages : des bandes purement bandits sont apparues qui ont commencé à voler, cela a atteint la débauche, etc. Parti des socialistes révolutionnaires de gauche. Documents et matériels. 1917-1925 En 3 volumes T. 2. Partie 1. M., 2010. P. 246-247.
Pour les bolcheviks, réprimer la résistance de leurs opposants était le seul moyen de maintenir le pouvoir dans un pays paysan dans le but d’en faire la base de la révolution socialiste internationale. Les bolcheviks étaient convaincus de la justification historique et de la justice du recours à la violence impitoyable contre leurs ennemis et les « exploiteurs » en général, ainsi qu'à la coercition à l'égard des couches moyennes hésitantes de la ville et de la campagne, en premier lieu la paysannerie. S'appuyant sur l'expérience de la Commune de Paris, V.I. Lénine croyait raison principale sa mort fut l'incapacité de réprimer la résistance des exploiteurs renversés. Il convient de réfléchir à son aveu, répété à plusieurs reprises au Xe Congrès du RCP (b) en 1921, que « la contre-révolution petite-bourgeoise est sans aucun doute plus dangereuse que Dénikine, Ioudenitch et Koltchak réunis » et… "représente un danger, à bien des égards, plusieurs fois plus grand que tous les Dénikines, Kolchaks et Yudenich réunis."
Il a écrit : « ... La dernière et la plus nombreuse des classes exploiteuses s’est soulevée contre nous dans notre pays. » PSS, 5e éd., vol. 37, p. 40.
«Partout, le koulak avare, gorgé et brutal s'est uni aux propriétaires fonciers et aux capitalistes contre les travailleurs et contre les pauvres en général... Partout il a conclu une alliance avec les capitalistes étrangers contre les travailleurs de leur pays... Il n'y aura pas de paix. : le koulak peut et peut facilement se réconcilier avec le propriétaire foncier, le tsar et le prêtre, même s'ils se querellent, mais jamais avec la classe ouvrière. Et c’est pourquoi nous appelons la bataille contre les poings la bataille finale et décisive. » Lénine V.I. PSS, tome 37, p. 39-40.
En juillet 1918 déjà, il y eut 96 soulèvements armés de paysans contre le pouvoir soviétique et sa politique alimentaire.
Le 5 août 1918, un soulèvement des paysans de la province de Penza éclate, mécontents des réquisitions alimentaires du gouvernement soviétique. Il couvrait les volosts de Penza et les districts voisins de Morshansky (8 volosts au total). Voir : Chronique de l'organisation régionale de Penza du PCUS. 1884-1937 Saratov, 1988, p. 58.
Les 9 et 10 août, V.I. Lénine a reçu des télégrammes du président du Comité provincial de Penza du RCP (b) E.B. Bosch et du président du Conseil des commissaires provinciaux V.V. Kuraev avec un message sur le soulèvement et, en réponse, des télégrammes ont donné des instructions sur organiser sa suppression (voir. : Lénine V.I. Biographical Chronicle, T. 6. M., 1975, pp. 41, 46, 51 et 55 ; Lénine V.I. Œuvres complètes de collection, vol. 50, pp. 143-144, 148, 149 et 156).
Lénine envoie une lettre à Penza adressée à V.V. Kuraev, E.B. Bosch, A.E. Minkin.
11 août 1918
T-scham Kuraev, Bosch, Minkin et autres communistes de Penza
T-shchi ! Le soulèvement des cinq volosts koulaks doit conduire à une répression impitoyable.
Cela est requis par les intérêts de la révolution tout entière, car il y a désormais partout une « dernière bataille décisive » avec les koulaks. Vous devez donner un échantillon.
1) Suspendre (assurez-vous de suspendre pour que les gens puissent voir) au moins 100 koulaks notoires, riches, sangsues.
2) Publiez leurs noms.
3) Enlevez tout leur pain.
4) Attribuez des otages.
Faites en sorte qu'à des centaines de kilomètres à la ronde les gens voient, tremblent, sachent, crient : ils étranglent et étrangleront les koulaks suceurs de sang.
Réception et exécution du virement.
Votre Lénine.
P.S. Trouvez des personnes plus coriaces. Fonds 2, sur. 1, n° 6898 - autographe. Lénine V.I. Documents inconnus. 1891-1922 - M. : ROSSPEN, 1999. Doc. 137.
L'émeute de Penza fut réprimée le 12 août 1918. Autorités locales y sont parvenus grâce à l’agitation, avec un recours limité à la force militaire. Participants au meurtre de cinq membres pro-armée et de trois membres du conseil du village. Kuchki du district de Penza et les organisateurs de la rébellion (13 personnes) ont été arrêtés et fusillés.
Les bolcheviks ont infligé toutes les punitions aux agriculteurs qui ne remettaient pas de céréales et de nourriture : les paysans ont été arrêtés, battus et fusillés. Naturellement, les villages et les volosts se sont rebellés, les hommes ont pris des fourches et des haches, ont déterré des armes cachées et ont brutalement traité les « commissaires ».
Déjà en 1918, plus de 250 soulèvements majeurs ont eu lieu à Smolensk, Yaroslavl, Orel, Moscou et dans d'autres provinces ; Plus de 100 000 paysans des provinces de Simbirsk et Samara se sont rebellés.
Pendant la guerre civile, les cosaques du Don et du Kouban, les paysans de la région de la Volga, de l'Ukraine, de la Biélorussie et de l'Asie centrale se sont battus contre les bolcheviks.
Au cours de l'été 1918, à Yaroslavl et dans la province de Yaroslavl, des milliers d'ouvriers urbains et de paysans des environs se sont rebellés contre les bolcheviks ; dans de nombreux volosts et villages, toute la population, y compris les femmes, les vieillards et les enfants, a pris les armes.
Le rapport du quartier général du Front rouge de l'Est contient une description du soulèvement dans les districts de Sengileevsky et Belebeevsky de la région de la Volga en mars 1919 : « Les paysans se sont déchaînés, avec des fourches, des pieux et des fusils seuls et en foule grimpant avec des mitrailleuses. , malgré les tas de cadavres, leur rage défie toute description. Koubanine M.I. Mouvement paysan antisoviétique pendant la guerre civile (communisme de guerre). - Sur le front agraire, 1926, n° 2, p. 41.
De tous les soulèvements antisoviétiques dans la région de Nijni Novgorod, le plus organisé et le plus important fut celui des districts de Vetluzhsky et Varnavinsky en août 1918. La cause du soulèvement était le mécontentement à l'égard de la dictature alimentaire des bolcheviks et des actions prédatrices. de détachements de nourriture. Les rebelles comptaient jusqu'à 10 000 personnes. L'affrontement ouvert dans la région d'Urensky a duré environ un mois, mais des gangs individuels ont continué à opérer jusqu'en 1924.
Un témoin de la révolte paysanne dans le district de Shatsky de la province de Tambov à l'automne 1918 a rappelé : « Je suis un soldat, j'ai participé à de nombreuses batailles avec les Allemands, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Une mitrailleuse fauche les rangs, et ils marchent, ils ne voient rien, ils rampent droit sur les cadavres, sur les blessés, leurs yeux sont terribles, les mères des enfants s'avancent en criant : Mère, Intercesseur, sauve, aie pitié , nous nous coucherons tous pour Toi. Il n’y avait plus aucune peur en eux. Steinberg I.Z. Le visage moral de la révolution. Berlin, 1923, p.62.
Depuis mars 1918, Zlatooust et ses environs sont en guerre. Dans le même temps, environ les deux tiers de la région de Koungour étaient engloutis par le feu du soulèvement.
À l’été 1918, les régions « paysannes » de l’Oural éclatèrent également dans les flammes de la résistance.
Dans toute la région de l'Oural - de Verkhoturye et Novaya Lyalya à Verkhneuralsk et Zlatooust et de la Bachkirie et la région de Kama jusqu'à Tioumen et Kurgan - des détachements de paysans ont écrasé les bolcheviks. Le nombre de rebelles ne pouvait être compté. Il y en avait plus de 40 000 rien que dans la région d'Okhanska-Osa. 50 000 rebelles ont mis les Rouges en fuite dans la région de Bakal - Satka - Mesyagutovskaya volost. Le 20 juillet, les paysans prirent Kuzino et coupèrent Chemin de fer transsibérien, bloquant Ekaterinbourg par l'ouest.
En général, à la fin de l'été, de vastes territoires étaient libérés des rebelles rouges. Il s'agit de presque tout le sud et le milieu, ainsi qu'une partie de l'Oural occidental et nord (où il n'y avait pas encore de Blancs).
La région de l'Oural brûlait également : les paysans des districts de Glazov et Nolinsky de la province de Viatka prirent les armes. Au printemps 1918, les flammes du soulèvement antisoviétique ont englouti les volosts Lauzinskaya, Duvinskaya, Tastubinskaya, Dyurtyulinskaya et Kizilbashskaya de la province d'Oufa. Dans la région de Krasnoufimsk, une bataille a eu lieu entre les ouvriers d'Ekaterinbourg venus réquisitionner les céréales et les paysans locaux qui ne voulaient pas abandonner les céréales. Ouvriers contre paysans ! Ni l'un ni l'autre n'ont soutenu les blancs, mais cela ne les a pas empêchés de s'exterminer les uns les autres... Du 13 au 15 juillet près de Nyazepetrovsk et le 16 juillet près du Haut Oufaley, les rebelles de Krasnoufima ont vaincu des unités de la 3e Armée rouge. Souvorov Dm. Guerre civile inconnue, M., 2008.
N. Poletika, historien : « Le village ukrainien a mené une lutte brutale contre l'appropriation et les réquisitions des excédents, éventrant les ventres des autorités rurales et des agents de Zagotzern et Zagotskot, remplissant ces ventres de céréales, gravant des étoiles de l'Armée rouge sur le front et la poitrine, enfoncer des clous dans les yeux, crucifier sur des croix. »
Les soulèvements ont été réprimés de la manière la plus brutale et la plus habituelle. En six mois, 50 millions d'hectares de terres furent confisqués aux koulaks et répartis entre paysans pauvres et moyens.
En conséquence, à la fin de 1918, la superficie des terres utilisées par les koulaks est passée de 80 millions d’hectares à 30 millions d’hectares.
Ainsi, les positions économiques et politiques des koulaks ont été considérablement affaiblies.
Le visage socio-économique du village a changé : la part des paysans pauvres, qui était de 65 % en 1917, est tombée à 35 % fin 1918 ; les paysans moyens, au lieu de 20 %, sont devenus 60 %, et les koulaks, au lieu de 15 %, sont devenus 5 %.
Mais même un an plus tard, la situation n’a pas changé.
Les délégués de Tioumen ont déclaré à Lénine au congrès du parti : « Pour procéder à l'appropriation des excédents, ils ont organisé les choses suivantes : les paysans qui ne voulaient pas donner d'appropriation, ils ont été mis dans des fosses, remplis d'eau et congelés... »
F. Mironov, commandant de la Deuxième armée de cavalerie (1919, dans un discours à Lénine et Trotsky) : « Le peuple gémit... Je le répète, le peuple est prêt à se jeter dans les bras de l'esclavage des propriétaires terriens, ne serait-ce que le tourment ne serait pas aussi douloureux, aussi évident qu'il l'est maintenant..."
En mars 1919, lors du VIIIe Congrès du RCP (b) G.E. Zinoviev a brièvement décrit la situation dans les campagnes et l'humeur des paysans : « Si vous allez au village maintenant, vous verrez qu'ils nous haïssent de toutes leurs forces. »
UN V. Lounatcharski a informé en mai 1919 V.I. Lénine à propos de la situation dans la province de Kostroma : « Dans la plupart des régions, il n'y a pas eu de troubles graves. Il n'y avait que des revendications purement alimentaires, pas même des émeutes, mais simplement des demandes de pain, qui n'est pas disponible... Mais à l'est de la province de Kostroma, il y a des districts de koulaks forestiers et céréaliers - Vetluzhsky et Varnavinsky, dans ce dernier il y a un toute la région riche et prospère des Vieux-croyants, la soi-disant Ourenski... Une guerre formelle est menée avec cette région. Nous voulons à tout prix pomper ces 200 ou 300 000 pouds de là... Les paysans résistent et sont devenus extrêmement aigris. J’ai vu de terribles photographies de nos camarades, à qui les poings de Varnavin ont arraché la peau, qu’ils ont gelés dans la forêt ou brûlés vifs… »
Comme indiqué dans le même 1919 dans un rapport au Comité exécutif central panrusse, au Conseil des commissaires du peuple et au Comité central du RCP (b), le président de l'Inspection militaire supérieure N.I. Podvoïsky :
« Les ouvriers et les paysans qui ont pris la part la plus directe à la Révolution d'Octobre, sans en comprendre les conséquences. importance historique, pensèrent l'utiliser pour satisfaire leurs besoins immédiats. Esprit maximaliste avec un penchant anarcho-syndicaliste, les paysans nous ont suivis pendant la période destructrice de la Révolution d'Octobre, ne montrant aucune différence avec ses dirigeants. Durant la période de création, ils ont naturellement dû s'écarter de notre théorie et de notre pratique. »
En effet, les paysans se sont séparés des bolcheviks : au lieu de leur donner respectueusement tout le pain disponible, cultivé grâce au travail, ils ont arraché des mitrailleuses et des fusils à canon tronqué pris pendant la guerre dans des endroits isolés.
Extrait des procès-verbaux des réunions de la Commission spéciale pour l'approvisionnement de l'armée et de la population de la province d'Orenbourg et du territoire kirghize sur l'assistance au centre prolétarien du 12 septembre 1919.
Nous écoutions. Rapport du camarade Martynov sur la situation alimentaire catastrophique au Centre.
Il a été décidé. Après avoir entendu le rapport du camarade Martynov et le contenu de la conversation par fil direct avec le représentant autorisé du Conseil des commissaires du peuple, le camarade Blumberg, la Commission spéciale décide :
1. Mobiliser les membres du conseil d'administration, les travailleurs du parti et des non-partis du comité provincial de l'alimentation pour les envoyer dans les districts afin de renforcer le déversement des céréales et leur livraison aux stations.
2. Mener une mobilisation similaire parmi les travailleurs de la Commission spéciale, du département alimentaire du Comité révolutionnaire kirghize et utiliser les travailleurs du département politique de la 1ère Armée pour les envoyer dans les régions.
3. Ordonner d'urgence aux présidents des comités alimentaires de district de prendre les mesures les plus exceptionnelles pour renforcer le dumping des céréales, la responsabilité des présidents et des membres des conseils d'administration des comités alimentaires de district.
4. Le chef du département des transports du comité provincial de l'alimentation, le camarade Gorelkin, reçoit l'ordre de faire preuve d'un maximum d'énergie pour organiser les transports.
5. Envoyez les personnes suivantes dans les zones : Camarade Shchipkova - dans la zone ferroviaire d'Orskaya. (Saraktash, Orsk), T. Styvrina - aux comités alimentaires de district d'Isaevo-Dedovsky, Mikhailovsky et Pokrovsky, T. Andreeva - à Iletsky et Ak-Bulaksky, T. Golynicheva - au comité de production du district de Krasnokholmsky, T. Chukhrita - à Aktyubinsk, lui donnant les pouvoirs les plus étendus.
6.Envoyez immédiatement tout le pain disponible aux centres.
7. Prendre toutes les mesures pour retirer d'Iletsk tous les stocks de pain et de mil qui y sont disponibles, et envoyer à cet effet le nombre de wagons requis à Iletsk.
8. S'adresser au Conseil militaire révolutionnaire en lui demandant de prendre d'éventuelles mesures pour fournir au comité provincial de l'alimentation un moyen de transport pour ces travaux urgents, pour lesquels, si nécessaire, annuler la patrouille sous-marine du Conseil militaire révolutionnaire pour certaines zones et délivrer un mandat d'arrêt. décret selon lequel le Conseil militaire révolutionnaire garantit le paiement dans les délais aux chauffeurs qui ont apporté du grain.
9. Proposer aux osprodivs 8 et 49 de répondre temporairement aux besoins de l'armée avec l'aide de leurs zones afin que les zones restantes puissent être utilisées pour approvisionner les centres...
Authentique avec les signatures appropriées
Archives de la KazSSR, f. 14. op. 2, d.1.14. Copie certifiée conforme.
Insurrection de la Trinité-Pechora, rébellion anti-bolchevique dans la haute Pechora pendant la guerre civile. La raison en était l'exportation de réserves de céréales par les Rouges de Troitsko-Pechorsk vers Vychegda. L'initiateur du soulèvement était le président de la cellule volost du RCP (b), commandant de Troitsko-Pechorsk I.F. Melnikov. Parmi les conspirateurs figuraient le commandant de la compagnie de l'Armée rouge, M.K. Pystin, prêtre V. Popov, député. Président du comité exécutif de Volost, député. Pystin, forestier N.S. Skorokhodov et autres.
Le soulèvement commença le 4 février 1919. Les rebelles tuèrent une partie des soldats de l'Armée rouge, les autres passèrent à leurs côtés. Au cours du soulèvement, le chef de la garnison soviétique de Troitsko-Pechorsk, N.N., a été tué. Suvorov, commandant rouge A.M. Cheremnykh. Commissaire militaire de district M.M. Frolov s'est suicidé. Le comité judiciaire des rebelles (présidé par P.A. Yudin) a exécuté environ 150 communistes et militants du régime soviétique - réfugiés de la région de Tcherdyn.
Ensuite, des émeutes antibolcheviques ont éclaté dans les villages volosts de Pokcha, Savinobor et Podcherye. Après que l'armée de Koltchak soit entrée dans les hauteurs de Pechora, ces volosts tombèrent sous la juridiction du gouvernement provisoire sibérien et les participants au soulèvement contre le pouvoir soviétique à Troitsko-Pechora rejoignirent le régiment séparé de Pechora sibérien, qui s'avéra être l'un des plus importants. unités prêtes au combat de l'armée russe dans le cadre d'opérations offensives dans l'Oural.
L'historien soviétique M.I. Koubanine, rapportant que 25 à 30 % de la population totale a participé au soulèvement contre les bolcheviks dans la province de Tambov, a résumé : « Il ne fait aucun doute que 25 à 30 % de la population du village signifie que la totalité de la population masculine adulte est allée à L'armée d'Antonov. Koubanine M.I. Mouvement paysan antisoviétique pendant la guerre civile (communisme de guerre). - Sur le front agraire, 1926, n° 2, p. 42.
MI. Koubanine écrit également sur un certain nombre d'autres soulèvements majeurs au cours des années du communisme de guerre : à propos de l'Ijevsk armée populaire, qui comptait 70 000 personnes, qui a réussi à tenir pendant plus de trois mois, à propos du soulèvement du Don, auquel ont participé 30 000 cosaques et paysans armés, et avec une force arrière de cent mille personnes et a percé le Front rouge.
À l'été-automne 1919, lors du soulèvement paysan contre les bolcheviks dans la province de Yaroslavl, selon M.I. Lebedev, président de la Tchéka provinciale de Iaroslavl, 25 à 30 000 personnes y ont participé. Des unités régulières de la 6e armée du front nord et des détachements de la Tchéka, ainsi que des détachements d'ouvriers de Yaroslavl (8 500 personnes), qui ont traité sans pitié les rebelles, ont été lancés contre les « blancs-verts ». Rien qu'en août 1919, ils tuèrent 1 845 rebelles et en blessèrent 832, fusillèrent 485 rebelles sur la base des verdicts des tribunaux militaires révolutionnaires et envoyèrent plus de 400 personnes en prison. Centre de documentation sur l'histoire contemporaine de la région de Yaroslavl (CDNI YaO). F. 4773. Op. 6. D. 44. L. 62-63.
L'ampleur du mouvement insurrectionnel dans le Don et le Kouban atteint une ampleur particulière à l'automne 1921, lorsque l'armée insurrectionnelle du Kouban, sous la direction d'A.M. Prjevalsky fit une tentative désespérée pour capturer Krasnodar.
En 1920-1921 Sur le territoire de la Sibérie occidentale, libéré des troupes de Koltchak, éclatait une révolte sanglante de 100 000 paysans contre les bolcheviks.
« Dans chaque village, dans chaque hameau, écrit P. Turkhansky, les paysans ont commencé à battre les communistes : ils ont tué leurs femmes, leurs enfants, leurs proches ; Ils coupaient à la hache, coupaient les bras et les jambes et leur ouvraient le ventre. Ils ont traité particulièrement durement les travailleurs du secteur alimentaire. Turkhansky P. Soulèvement paysan en Sibérie occidentale en 1921. Souvenirs. - Archives sibériennes, Prague, 1929, n° 2.
La guerre pour le pain a été menée à mort.
Voici un extrait du rapport du département de gestion du comité exécutif du district de Novonikolayevsky des Soviétiques sur le soulèvement de Kolyvan au département de gestion du Sibrevkom :
« Dans les zones rebelles, les komjacheki ont été presque entièrement exterminés. Les seuls survivants étaient des individus aléatoires qui ont réussi à s'échapper. Même ceux qui étaient expulsés de la cellule furent exterminés. Après la répression du soulèvement, les cellules vaincues ont été restaurées d'elles-mêmes, ont augmenté leur activité et un afflux important de pauvres dans les cellules a été perceptible dans les villages après la répression du soulèvement. Les cellules insistent pour les armer ou créer des escouades but spécial d'entre eux dans les comités de district du parti. Il n’y a eu aucun cas de lâcheté ou de trahison des membres de la cellule par des membres individuels de la cellule.
La police de Kolyvan a été prise par surprise, 4 policiers et un assistant du chef de la police du district ont été tués. Les policiers restants (un petit pourcentage ont fui) ont rendu leurs armes une à une aux rebelles. Une dizaine de policiers de la police de Kolyvan ont pris part (passivement) au soulèvement. Parmi eux, après notre occupation de Kolyvan, trois ont été abattus sur ordre du service spécial du contrôle départemental.
La raison du manque de satisfaction de la police s'explique par sa composition composée de petits-bourgeois locaux de Kolyvan (il y a environ 80 à 100 ouvriers dans la ville).
Les comités exécutifs communistes ont été tués, les koulaks ont pris une part active au soulèvement et sont souvent devenus les chefs des départements rebelles.»
http://basiliobasilid.livejournal.com/17945.html
La révolte sibérienne fut réprimée aussi impitoyablement que toutes les autres.
« L'expérience de la guerre civile et de la construction pacifique du socialisme a prouvé de manière convaincante que les koulaks sont les ennemis du pouvoir soviétique. La collectivisation complète de l’agriculture était une méthode pour éliminer les koulaks en tant que classe. (Essais sur l'organisation de Voronej du PCUS. M., 1979, p. 276).
La Direction statistique de l'Armée rouge estime les pertes au combat de l'Armée rouge pour 1919 à 131 396 personnes. En 1919, il y eut une guerre sur 4 fronts intérieurs contre les armées blanches et sur front occidental contre la Pologne et les pays baltes.
En 1921, aucun front n’existait plus, et le même département estime les pertes de l’Armée rouge « ouvrière et paysanne » pour cette année à 171 185 personnes. Les unités de la Tchéka de l'Armée rouge n'ont pas été incluses et leurs pertes ne sont pas incluses ici. Les pertes du ChON, du VOKhR et d'autres détachements communistes, ainsi que de la police, ne peuvent pas être incluses.
La même année, des soulèvements paysans contre les bolcheviks éclatèrent dans le Don et en Ukraine, en Tchouvachie et dans la région de Stavropol.
L'historien soviétique L.M. Spirin généralise: "Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il n'y a pas eu non seulement une seule province, mais aussi pas une seule région où il n'y a eu aucune protestation ni aucun soulèvement de la population contre le régime communiste."
Alors que la guerre civile battait encore son plein, à l'initiative de F.E. Dzerjinski en Russie soviétique, des unités et des troupes à des fins spéciales et spéciales sont créées partout (sur la base de la résolution du Comité central du RCP (b) du 17 avril 1919). Il s'agit de détachements militaires du parti dans les cellules du parti d'usine, des comités de district, des comités municipaux, des comités régionaux du parti et des comités provinciaux du parti, organisés pour assister les organes du pouvoir soviétique dans la lutte contre la contre-révolution, pour assurer la garde dans des installations particulièrement importantes, etc. . Ils étaient formés de communistes et de membres du Komsomol.
Les premiers CHON surgirent à Petrograd et à Moscou, puis dans les provinces centrales de la RSFSR (en septembre 1919, ils étaient créés dans 33 provinces). Le CHON, de la ligne de front des fronts sud, ouest et sud-ouest, a participé aux opérations de première ligne, même si sa tâche principale était la lutte contre la contre-révolution interne. Le personnel du CHON était divisé en personnel et police (variable).
Le 24 mars 1921, le Comité central du Parti, sur la base de la décision du Xe Congrès du RCP (b), adopta une résolution sur l'inclusion du ChON dans les unités de milice de l'Armée rouge. En septembre 1921, le commandement et le quartier général du ChON du pays ont été créés (commandant A.K. Alexandrov, chef d'état-major V.A. Kangelari), pour la direction politique - le Conseil du ChON sous le Comité central du RCP (b) (Secrétaire du Central Comité V.V. Kuibyshev, vice-président de la Tchéka I.S. Unshlikht, commissaire du quartier général de l'Armée rouge et commandant du ChON), dans les provinces et les districts - le commandement et le quartier général du ChON, les conseils du ChON sous les comités provinciaux et le parti comités.
C'était une force de police assez sérieuse. En décembre 1921, le CHON comptait 39 673 hommes. et variable - 323 372 personnes. Le CHON comprenait des unités d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et blindées. Plus de 360 000 combattants armés !
Avec qui se sont-ils battus si la guerre civile prenait officiellement fin en 1920 ? Après tout, les unités spéciales n'ont été dissoutes par décision du Comité central du RCP (b) qu'en 1924-1925.
Jusqu'à la toute fin de 1922, la loi martiale était en vigueur dans 36 provinces, régions et républiques autonomes du pays, c'est-à-dire que presque tout le pays était sous la loi martiale.
CHON. Règlements, directives et circulaires.- M. : ShtaCHONresp., 1921 ; Naida S.F. Unités à usage spécial (1917-1925). Leadership du Parti dans la création et les activités du ChON // Revue historique militaire, 1969. N° 4. P.106-112 ; Telnov N.S. De l'histoire de la création et des activités de combat des unités communistes spéciales pendant la guerre civile. // Notes scientifiques de l'Institut pédagogique de Kolomna. - Kolomna, 1961. Tome 6. P.73-99 ; Gavrilova N.G. Activités du Parti communiste dans la direction d'unités spéciales pendant la guerre civile et la restauration de l'économie nationale (sur la base de matériaux provenant des provinces de Toula, Riazan et Ivanovo-Voznessensk). Insulter. doctorat est. Sci. - Riazan, 1983 ; Krotov V.L. Activités du Parti communiste d'Ukraine dans la création et l'utilisation au combat d'unités spéciales (CHON) dans la lutte contre la contre-révolution (1919-1924). dis. doctorat est. Sci. - Kharkov, 1969 ; Murashko P.E. Parti communiste de Biélorussie - organisateur et chef de formations communistes à des fins spéciales (1918-1924) Diss. doctorat est. Sciences - Minsk, 1973 ; Démentiev I.B. CHON de la province de Perm dans la lutte contre les ennemis du pouvoir soviétique. Insulter. doctorat est. Sci. - Perm, 1972 ; Abramenko I.A. Création de forces spéciales communistes en Sibérie occidentale (1920). // Notes scientifiques de l'Université de Tomsk, 1962. N° 43. P.83-97 ; Vdovenko G.D. Détachements communistes - Unités spéciales de Sibérie orientale (1920-1921) - Mémoire. doctorat est. nauk.-Tomsk, 1970; Fomine V.N. Unités spéciales en Extrême-Orient en 1918-1925. - Briansk, 1994 ; Dmitriev P. Unités spéciales - Revue soviétique. N° 2.1980. P.44-45. Krotov V.L. Chonovtsy - M. : Politizdat, 1974.
Le moment est venu d’examiner enfin les résultats de la guerre civile pour s’en rendre compte : sur plus de 11 millions de morts, plus de 10 millions étaient des civils.
Nous devons l’admettre : il ne s’agissait pas seulement d’une guerre civile, mais d’une guerre contre le peuple, en premier lieu contre la paysannerie de Russie, qui était la force principale et la plus dangereuse dans la résistance à la dictature du pouvoir exterminateur.
Comme toute guerre, elle était menée dans l’intérêt du profit et du vol.
D. Mendeleïev, créateur du tableau périodique des éléments, le plus célèbre scientifique russe, a étudié non seulement la chimie, mais aussi la démographie.
Presque personne ne lui refuserait une approche approfondie de la science. Dans son ouvrage « Vers une connaissance de la Russie », Mendeleïev prédisait en 1905 (sur la base des données du recensement de la population panrusse) que d’ici l’an 2000, la population de la Russie atteindrait 594 millions d’habitants.
C’est en 1905 que le Parti bolchevique commença réellement la lutte pour le pouvoir. Le châtiment pour leur soi-disant socialisme s’est avéré amer.
Sur la terre qui pendant des siècles a été appelée Russie, à la fin du XXe siècle, à en juger par les calculs de Mendeleev, il manquait près de 300 millions de personnes (avant l'effondrement de l'URSS, environ 270 millions y vivaient, et non environ 600 millions). , comme le scientifique l'avait prédit).
B. Isakov, chef du département des statistiques de l'Institut Plekhanov d'économie nationale de Moscou, déclare : « En gros, nous sommes « divisés par deux ». À cause des « expériences » du XXe siècle, le pays a perdu un habitant sur deux... Les formes directes de génocide ont coûté la vie à 80 à 100 millions de personnes.»
Novossibirsk septembre 2013
Critiques de « La Russie en 1917-1925. Arithmétique des pertes" (Sergey Shramko)
Un article très intéressant et riche en matériel numérique. Merci, Sergey!
Vladimir Eisner 02.10.2013 14:33.
Je suis entièrement d'accord avec l'article, du moins sur la base de l'exemple de mes proches.
Mon arrière-grand-mère est décédée jeune en 1918, lorsque les détachements de nourriture ont ratissé tout son grain, et elle est morte de faim quelque part dans un champ de seigle. En conséquence, elle a souffert d’un « volvulus » et est morte dans de terribles souffrances.
De plus, le mari de la sœur de ma grand-mère est mort des suites de la persécution dès 1920, alors que ses deux filles étaient bébés.
Le mari de la sœur d’une autre grand-mère est mort du typhus en 1921 et ses deux filles étaient également des bébés.
Dans la famille de mon père, de 1918 à 1925, trois frères sont morts de faim très jeunes.
Les deux frères de ma mère sont morts de faim et elle-même, née en 1918, a survécu de justesse.
Le détachement alimentaire a voulu tirer sur ma grand-mère alors qu'elle était enceinte de ma mère et leur a crié : « Oh, vous les voleurs !
Mais grand-père s'est levé et il a été arrêté, battu et relâché pieds nus à 20 kilomètres de là.
Les parents de ma mère et de mon père ont dû quitter avec leurs familles des maisons chaleureuses de la ville pour des villages reculés, dans des maisons inadaptées. En raison du désespoir, le contact avec d'autres proches a été perdu et nous ne connaissons pas toute la terrible situation de 1917 à 1925. Sincèrement. Valentina Gazova 19/09/2013 09:06.
Commentaires
Merci Sergey pour votre travail énorme et clair. Maintenant, alors que les Khmers rouges recommencent à agiter des drapeaux, à ériger ici et là de terribles obstacles au tyran, à marmonner leurs prières utopiques, à poudrer le cerveau de la jeunesse, à polluer les âmes fragiles par l'hérésie, NOUS devons nous lever avec le monde entier pour défendre notre État afin d'éviter le Moyen Âge! Ignorance! - C'est une force terrible, surtout à la campagne, à la campagne. Je vois cela dans mes régions sibériennes natales. Ceux qui ont connu la véritable horreur et l'ont vécue ne sont plus en vie. Seuls les enfants de la guerre sont restés. Dans mon village, où il reste 30 foyers, ma tante est la seule qui reste – une enfant de la guerre. Il s'avère qu'elle connaît l'horreur de la ruine complète, de la destruction du capital humain de haute qualité et de toutes les perspectives. Et les jeunes restants sont complètement ignorants ! Elle se soucie de cette HISTOIRE ! Elle a besoin de survivre, elle survivra ! Elle se boit à mort, prête à rejoindre dès demain la bannière du prochain prolétaire ; diviser, déchiqueter, exiler et mettre contre le mur ! J'ai vécu en Sibérie, grâce aux histoires de personnes âgées, je sais comment une tornade rouge et sanglante a balayé une terre qui ne connaissait pas le servage. Grand-mère, se souvenant de l'époque de la collectivisation de la dé-paysannerie (dékoulakisation), se mettait toujours à pleurer, à prier et à murmurer : « Oh, pauvre Seigneur, et si tu étais une petite-fille, tu souffrais une telle chose, tu le voyais de tes yeux, tu vivais avec ça dans les tripes. » Aujourd'hui, les champs sont tous abandonnés, les fermes sont détruites, et tout cela est une conséquence de ces temps terribles où les staliniens et les léninistes ont forgé un homme nouveau, brûlant en lui les sentiments du propriétaire, le maître! Le résultat final fut des villages complètement morts. "Prends la terre, Vaska ! Après tout, ton grand-père a pris les devants !" - Je dis à mon compatriote, qui a récemment eu cinquante ans. Et il est assis sur un banc, déjà édenté, fumant une cigarette, crachant dans l'herbe, portant des galoches aux pieds nus et marmonnant un sourire enfumé" - "Et putain... Moi Nikolaïch, c'est la terre pour moi, qu'est-ce que je suis " La graine a été jetée sur ce fruit terrible en l'an 17. Cet arbre puissant appelé SAINTE RUSSIE s'est effondré, arrachant des racines, des racines, chacune d'elles du sol fertile. Merci beaucoup pour votre travail. ! Patience à VOUS et idées créatives. Dieu nous garde, Dieu nous préserve d'une nouvelle panne, d'une bacchanale révolutionnaire... Comme on dit, ne réveillez pas l'imbécile !
Pendant leur exil, de nombreux représentants de l'intelligentsia russe ont continué à travailler : ils ont fait des découvertes scientifiques, promu la culture russe, créé des systèmes de soins médicaux, développé des facultés, dirigé des départements d'universités de premier plan dans des pays étrangers et créé de nouvelles universités et gymnases.
À Moscou, dans le cadre de la Conférence théologique internationale annuelle de l'Université orthodoxe humanitaire Saint-Tikhon, s'est tenue la IXe Conférence scientifique et éducative internationale « Le peuple et les destinées des Russes à l'étranger ».
La conférence était consacrée à l'émigration de l'élite scientifique russe à l'étranger au début du XXe siècle. Les experts dans leurs rapports ont parlé de l'histoire Le chemin de la vie personnalités scientifiques qui ont voyagé à l'étranger et ont apporté une contribution significative au développement de la science mondiale.
L'événement a réuni : Mgr Michel de Genève, des chercheurs indépendants, des experts de l'Institut histoire générale RAS, Institut d'études slaves RAS, INION RAS, École supérieure d'économie de l'Université nationale de recherche, Université d'État de Moscou, Institut du patrimoine culturel russe de Lettonie, Institut d'histoire de l'Académie des sciences de Moldavie, etc.
Comme l'a noté le professeur de l'Université nationale de médecine d'Odessa, K.K. Vasiliev, le sort du professeur Russie impériale naturellement, elle se divisait en deux parties : la vie à la maison et la vie en exil. Qu'est-ce qui a poussé certains scientifiques, dont beaucoup avaient déjà fait carrière et s'étaient fait un nom dans la science russe, à émigrer de Russie après 1917 et à se disperser à travers le monde avec d'autres intellectuels ? Chacun avait ses propres raisons privées : persécutions, arrestations, circonstances familiales, licenciements, fermeture de départements, incapacité de continuer à travailler sur le sujet choisi, etc. Cependant, la pression idéologique peut être citée comme la raison principale. « Les gens étaient placés dans certains cadres. Une personne qui a grandi libre ne pouvait pas accepter de telles conditions et, naturellement, les gens, non pas avec joie, mais avec une grande amertume, ont quitté la Russie dans l'espoir de retourner bientôt dans leur pays d'origine", a-t-elle déclaré au magazine. La vie internationale» Docteur en histoire et représentante de l'Institut du patrimoine culturel russe de Lettonie Tatyana Feigmane.
Le destin d'un professeur dans la Russie impériale se divisait naturellement en deux parties : sa vie au pays et sa vie en exil. Les données sur le nombre de scientifiques russes ayant émigré dans les années 1920 vont de 500 à plus de 1 000 personnes. Cependant, comme l'a souligné le professeur agrégé lycée(Faculté) d'audit d'État de l'Université d'État de Moscou du nom de M.V. Lomonosova Olga Barkova, de nombreux chercheurs modernes estiment que l'émigration scientifique russe représentait environ un quart de la communauté scientifique pré-révolutionnaire, c'est-à-dire environ 1 100 personnes. Certains scientifiques qui se sont retrouvés à l'étranger ont réussi non seulement à se réaliser dans les conditions difficiles de l'émigration, mais également à promouvoir la pensée scientifique russe à l'étranger. À titre d'exemple, il s'agit des personnalités suivantes, dont la vie et les activités ont été décrites en détail par les participants à la conférence :
- Alexander Vasilyevich Boldur, professeur associé privé à l'Université de Petrograd, ayant émigré en Roumanie, a dirigé pendant de nombreuses années les départements d'histoire des principales universités du pays.
- Le professeur N.K. Kulchitsky, qui a fait une carrière vertigineuse d'étudiant en médecine à ministre de l'Éducation de la Russie impériale, a acquis une renommée mondiale dans le domaine de l'histologie et de l'embryologie. En 1921, il s'installe en Grande-Bretagne et, travaillant à l'Université de Londres, apporte une contribution significative au développement de l'histologie et de la biologie nationales et britanniques.
- Historien de la philosophie et de la jurisprudence P.I. Novgorodtsev est devenu l'un des organisateurs de la Faculté russe de droit de Prague, ouverte à l'Université Charles en 1922.
- Scientifique clinicien A.I. Après 1917, Ignatovsky fut évacué vers le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, où il reçut une chaire à l'Université de Belgrade. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Université de Skopje a ouvert ses portes en Macédoine, où il a également dirigé le département clinique. Entre autres choses, A.I. Ignatovsky a fondé sa propre école scientifique.
- Professeur agrégé privé de l'Université de Saint-Pétersbourg A.N. Kruglevsky à propos de la fermeture des départements juridiques des facultés Sciences sociales en 1924, il part pour la Lettonie, où il a déjà acquis une autorité à l'Université de Lettonie et est devenu l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques sur le droit pénal, publiés en letton, russe et Langues allemandes. Participation à la création d'articles sur des questions de droit pénal pour le dictionnaire encyclopédique letton.
- Professeur F.V. Taranovsky (un célèbre avocat, docteur en droit d'État, auteur du manuel « Encyclopédie du droit », toujours publié et utilisé dans les facultés de droit) a émigré en 1920 au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, où il a été immédiatement élu professeur. de droit slave à l'Université de Belgrade et, en 1930, il dirigea l'Institut scientifique russe de Belgrade.
Une contribution importante à la formation et au développement de la communauté scientifique russe en exil, ainsi qu'à la science mondiale, a été apportée non seulement par les hommes, mais aussi par les femmes qui, selon Olga Barkova, sont allées à l'étranger principalement en tant que membres de leur famille - soit avec leurs parents, soit avec leur mari. L’expert a cité plusieurs femmes en exemple :
- Docteur en médecine Nadezhda Dobrovolskaya-Zavadskaya, première femme russe à diriger le département de chirurgie, dont les recherches dans le domaine de l'oncologie dans les années 1930. ont été associés à l'étude des effets des rayons X sur la nature de divers cancers.
- Immunologue, diplômée de l'Université de Moscou, chef de laboratoire de l'Institut Pasteur et lauréate de l'Académie française de médecine (1945) Antonina Gelen (née Shchedrina), qui a proposé une méthode d'utilisation des virus bactériophages à des fins médicales, qui a jeté les bases de une des méthodes de chimiothérapie moderne.
- Philosophe et théologienne Nadezhda Gorodetskaya, première femme professeur à travailler dans un département universitaire de Liverpool.
- L'historienne Anna Burgina, spécialiste de l'histoire du mouvement menchevik, grâce aux efforts de laquelle une direction scientifique dans l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier a été formée aux États-Unis et toute une génération de spécialistes américains de l'histoire de la Russie a été formée. .
Dans le même temps, l'ensemble de l'intelligentsia russe émigrée n'a pas réussi à s'implanter dans un pays étranger, car ils étaient affectés par des processus complexes d'adaptation et d'intégration dans la nouvelle société, des difficultés linguistiques et d'autres problèmes. Selon les bureaux parisiens et marseillais de Zemgor pour 1923, sur 7 050 personnes, 51,3 % étaient des personnes exerçant des professions intelligentes qui percevaient des revenus dans le domaine du travail physique, et seulement 0,1 % - dans le domaine du travail mental.
La vague d'émigration russe après 1917 s'est déplacée non seulement vers l'Europe, mais aussi vers l'Asie, vers la Chine, qui avait ses propres conditions spécifiques - non seulement le climat, mais aussi une civilisation, une langue, des coutumes, un manque d'assainissement et bien plus encore. Senior Chercheur INION RAS Victoria Sharonova, qui a consacré son rapport aux professeurs russes de Shanghai, a noté que le personnel enseignant russe dans ce pays peut être divisé en deux catégories : 1 – ceux qui sont venus en Chine lors de la construction du chemin de fer chinois oriental, 2 – les réfugiés qui venaient principalement de Saint-Pétersbourg (ils étaient la fleur de la chaire), ainsi que les restes de l'armée de Koltchak, des réfugiés de Sibérie occidentale et orientale, d'Extrême-Orient et des cosaques du Transbaïkal. « En Chine, les professeurs menaient avant tout des activités éducatives non seulement auprès des Russes, mais aussi auprès de la jeunesse chinoise. Grâce à notre intelligentsia, une nouvelle génération de Chinois a émergé. Les directions étaient très différentes. Pour les Russes, le plus important était l'éducation militaire (puisqu'ils ont été évacués vers la Chine). corps de cadets et un grand nombre de militaires russes vivaient ici), mais la médecine européenne était importante pour les Chinois, tout comme la culture », a déclaré l'expert.
Dans son discours, Victoria Sharonova a mentionné le professeur Bari Adolf Eduardovich, originaire de Saint-Pétersbourg, psychiatre de formation. Il est arrivé à Shanghai, une ville avec l'un des taux de suicide les plus élevés, où les gens devenaient fous du mal du pays. Adolf Eduardovich était actif dans les activités éducatives et sociales : il enseignait à l'Université de Shanghai, organisait des consultations gratuites pour les émigrés russes, était médecin du détachement du régiment russe du Corps des volontaires de Shanghai, président de la Société caritative russe et professeur à l'Université chinoise de Pékin. Victoria Sharonova a souligné le rôle important de Bari dans la préservation de la vie des émigrés russes à Shanghai.
A l'issue de la conférence, les participants ont convenu qu'en plus de tous réalisations scientifiques, des scientifiques émigrés russes ont présenté des exemples étonnants de moralité, de courage et de volonté d'abnégation, qui peuvent servir d'exemple à la jeunesse moderne.
Barkova O. N. « Ils ne pouvaient pas se consacrer à une seule science... » : femmes scientifiques de la diaspora russe 1917 - 1939 // Clio. - 2016. - N° 12. - P. 153-162.