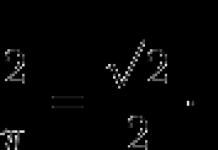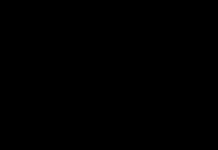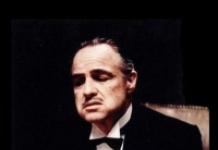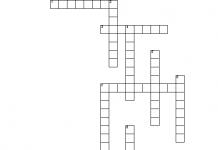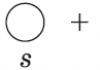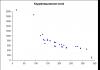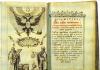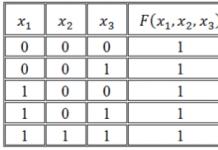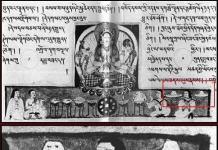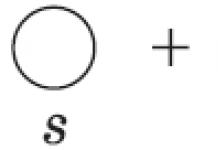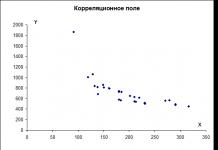un type de foi dans laquelle le surnaturel est accepté sans preuve ni vérification individuelle de la réalité...
un type de foi dans lequel, sans preuve et vérification individuelle de la réalité, le surnaturel est reconnu dans l'une ou l'autre de ses manifestations (Dieu, dieux, esprits, anges, etc.). La foi chrétienne, la foi islamique, etc. sont synonymes de religion. La foi religieuse est un état spécifique d'une personne religieuse, qui se dit donc croyant.
Foi Religieux
Croyance en l'existence d'un principe d'être personnel supérieur, dont la connexion est fondamentalement importante pour la vie humaine lorsque...
Croyance en l'existence d'un principe d'être personnel supérieur, dont la connexion est fondamentalement importante pour la vie d'une personne, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est appelée à coordonner ses actions et ses actes avec l'ordre invisible d'être créé par son Créateur. Cette foi n'est pas seulement la conviction de l'esprit, mais aussi l'ouverture du cœur à Dieu, elle est l'expression de la soif spirituelle de l'homme et de son amour pour Dieu, l'ouverture du cœur humain à Dieu, une attention sensible à Son Parole, réponse à son appel. Dans le christianisme – abandon de soi à Dieu révélé dans le Christ, Dieu qui a appelé à accepter comme frères tous ceux qui aimaient le Christ et sa voie. La foi est la réponse d’une personne à la Parole de Dieu qui lui est adressée. La foi est aussi un lien avec le Christ. La foi est secondaire par rapport à l'expérience spirituelle de la rencontre avec Dieu et, dans les formes de foi matures, à la vie avec Dieu et en Dieu. La plénitude de la foi s'obtient dans la révélation des puissances de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant.
Foi Religieux
Confiance dans l'existence réelle d'êtres surnaturels qui ne repose pas sur des conclusions logiques et des données scientifiques. créatures...
Confiance dans l'existence réelle d'êtres surnaturels qui ne repose pas sur des conclusions logiques et des données scientifiques. êtres, propriétés, relations. V.r. représente l'essentiel signe de religion. conscience, détermine le culte des religions, les expériences et le comportement des croyants. Dans la théologie de V. r. est considéré soit comme une propriété intégrante de l’être humain. âmes, ou comme grâce donnée par Dieu, c'est-à-dire comme phénomène de nature transcendantale. En fait, la capacité de croire est conditionnée par les conditions sociales. nature humaine, et la transformation de cette capacité en V. r. causée par la société conditions qui font naître le besoin de religion des masses. V. r., en tant qu'élément de la psyché des croyants, est une formation complexe, comprenant l'intellect et les émotions. et des moments volontaires. L'intelligence, élément de V. r. est un ensemble de religions. idées et images dans l’esprit des croyants. Étant donné que ces idées ne peuvent pas être scientifiquement prouvées et justifiées et sont en même temps considérées par les croyants comme d'une importance vitale, alors un rôle important dans V. r. acquiert de l'émotion. élément. Les théologiens, essayant d'élever le V. r., le déclarent le plus élevé. manifestation de l'humanité conscience : la plus élevée morale une forme de connaissance supérieure à la raison, qui contredit les données de la science et de la pratique. Élimination des droits sociaux facteurs de religiosité, assimilation des connaissances scientifiques la connaissance conduit à vaincre V. r.
discipline : Culture spirituelle
sur le thème : Religion et foi religieuse
Est réalisé par un étudiant
Vérifié:
Introduction................................................. ....................................................... ............ ................3
1. Religion................................................................ ..................................................... .......... ................4
2. Caractéristiques de la foi religieuse........................................................ ........................................5
3. Diversité des religions.................................................. ....... ........................................7
4. Le rôle de la religion dans le monde moderne.................................................. ............ .......................dix
Conclusion................................................. .................................................................. ...... ..........14
Bibliographie................................................................ .. ......................16
Introduction
L'une des formes les plus anciennes de culture spirituelle est la religion. Les idées religieuses des gens sont nées dans les temps anciens. Tout comme les rituels et cultes religieux, ils étaient très divers. Une étape importante dans l'histoire de l'humanité a été l'émergence des religions du monde : le bouddhisme, le christianisme, l'islam. A un certain stade du développement de la religion, une église surgit, au sein de laquelle se forme une hiérarchie spirituelle et des prêtres apparaissent.
Depuis l'Antiquité, la religion est porteuse de valeurs culturelles ; elle est elle-même l'une des formes de la culture. Des temples majestueux, des fresques et des icônes magistralement exécutées, de merveilleuses œuvres littéraires et religieuses et philosophiques, des rituels religieux et des préceptes moraux ont extrêmement enrichi le fonds culturel de l'humanité. Le niveau de développement de la culture spirituelle se mesure par le volume des valeurs spirituelles créées dans la société, l'ampleur de leur diffusion et la profondeur de l'assimilation par les gens, par chaque personne.
Aujourd'hui, l'activité religieuse a acquis une nouvelle ampleur et de nouvelles formes. La prédication de valeurs morales absolues (éternelles et immuables) était caractéristique de toutes les religions du monde et reste d'actualité à notre époque pleine de mal, car l'amertume, le déclin de la moralité, la croissance du crime et de la violence sont autant de conséquences du manque de spiritualité. . Les règles morales non seulement n'ont pas perdu leur sens, mais ont également acquis un sens nouveau et profond, puisqu'elles s'adressent au monde intérieur et spirituel de l'homme.
1. Religions
L'origine du mot « religion » est associée au verbe latin relegere - « traiter avec respect » ; selon une autre version, il doit son origine au verbe religare - « lier » (le ciel et la terre, la divinité et l'homme). Il est beaucoup plus difficile de définir la notion de « religion ». Il existe un grand nombre de définitions de ce type, elles dépendent de l’affiliation des auteurs à une école ou une tradition philosophique particulière. Ainsi, la méthodologie marxiste définissait la religion comme une forme spécifique de conscience sociale, un reflet pervers et fantastique dans l’esprit des gens des forces extérieures qui les dominent. Un croyant définira très probablement la religion comme la relation entre Dieu et l’homme. Il existe également des définitions plus neutres : la religion est un ensemble de points de vue et d'idées, un système de croyances et de rituels qui unit les personnes qui les reconnaissent en une seule communauté. La religion est constituée de certains points de vue et idées des gens, des rituels et des cultes correspondants.
Toute religion comprend plusieurs éléments essentiels. Parmi eux : la foi (sentiments, humeurs, émotions religieuses), la doctrine (un ensemble systématisé de principes, d'idées, de concepts spécialement développés pour une religion donnée), le culte religieux (un ensemble d'actions que les croyants accomplissent dans le but d'adorer les dieux, c'est-à-dire rituels, prières, sermons, etc.). Les religions suffisamment développées ont également leur propre organisation : l'Église, qui organise la vie de la communauté religieuse.
L'origine de la religion est controversée. L'Église enseigne que la religion apparaît avec l'homme et existe dès le début. Les enseignements matérialistes considèrent la religion comme un produit du développement de la conscience humaine. Convaincu de sa propre impuissance, de son incapacité à vaincre le pouvoir d'une nécessité aveugle dans certains domaines de la vie, l'homme primitif attribuait aux forces naturelles des propriétés surnaturelles. Les fouilles de sites antiques indiquent la présence de croyances religieuses primitives chez les Néandertaliens. De plus, l'homme primitif se sentait partie intégrante de la nature, ne s'y opposait pas, bien qu'il essayait de déterminer sa place dans le monde qui l'entourait et de s'y adapter.
L’une des premières formes de religion fut le totémisme – le culte d’une sorte, d’une tribu, d’un animal ou d’une plante comme son ancêtre mythique et son protecteur. Le totémisme a cédé la place à l'animisme, c'est-à-dire croyance aux esprits et à l'âme ou à la spiritualité universelle de la nature. Dans l'animisme, de nombreux scientifiques voient non seulement une forme indépendante d'idées religieuses, mais aussi la base de l'émergence des religions modernes. Parmi les êtres surnaturels, plusieurs sont particulièrement puissants : les dieux. Peu à peu, elles acquièrent un caractère anthropomorphique (les qualités inhérentes à l'homme et même son apparence sont transférées aux dieux, même si l'on prétend que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance), les premières religions polythéistes (des mots poly - beaucoup, theos - dieu) prennent forme . Plus tard, à un stade supérieur, apparaissent également des religions monothéistes (du grec monos - un, uni, theos - dieu). Un exemple classique de polythéisme est celui des anciennes religions grecque et romaine, le paganisme slave. Le monothéisme comprend le christianisme, l'islam et d'autres, bien que chacun d'eux conserve des traces de polythéisme.
2. Caractéristiques de la foi religieuse
La base de toute religion est la croyance au surnaturel, c'est-à-dire dans l'inexplicable à l'aide de lois connues de la science, les contredisant. La foi, selon l'Évangile, est la réalisation de ce qu'on espère et l'assurance de ce qu'on ne voit pas. Il est étranger à toute logique et n’a donc pas peur des justifications des athées selon lesquelles Dieu n’existe pas, et n’a pas besoin d’une confirmation logique de son existence. L’apôtre Paul a dit : « Que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
Quelles sont les caractéristiques de la foi religieuse ? Son premier élément est la foi en l’existence même de Dieu en tant que créateur de tout ce qui existe, gestionnaire de toutes les affaires, actions et pensées des hommes. Cela signifie que les puissances supérieures qui le contrôlent sont responsables de toutes les actions d’une personne ? Selon les enseignements religieux modernes, l’homme est doté par Dieu du libre arbitre, a la liberté de choix et, de ce fait, est responsable de ses actes et de l’avenir de son âme.
Mais sur quelle base cette foi est-elle possible ? Basé sur la connaissance du contenu des mythes religieux et des livres saints (la Bible, le Coran, etc.) et la confiance dans les témoignages qu'ils contiennent de ceux qui se sont avérés convaincus des faits de l'existence de Dieu (apparition au peuple, révélations, etc.) ; basé sur des preuves directes de l’existence de Dieu (miracles, apparitions et révélations directes, etc.)
L'histoire montre qu'il n'y a pratiquement aucun cas de manifestations directes de puissances supérieures non décrites auparavant dans les mythes et les livres saints : les églises sont extrêmement prudentes à l'égard de toute manifestation d'un miracle, croyant à juste titre que l'erreur ou, pire, la malhonnêteté dans sa description provoquera l'incrédulité parmi personnes et peuvent saper l’autorité des églises et des croyances. Enfin, la foi en Dieu repose sur des arguments logiques et théoriques. Depuis des siècles, les théologiens de toutes les religions cherchent à prouver l’existence de Dieu. Cependant, le philosophe allemand I. Kant a montré de manière convaincante dans son raisonnement qu'il est impossible de prouver logiquement ni l'existence de Dieu ni son absence, il ne reste plus qu'à croire.
L’idée de l’existence de Dieu est le point central de la foi religieuse, mais ne l’épuise pas. Ainsi, la foi religieuse comprend :
Normes de moralité, normes de moralité déclarées provenir de la révélation divine ; la violation de ces normes est un péché et, par conséquent, est condamnée et punie ;
Certaines lois et réglementations juridiques qui sont également déclarées comme étant le résultat direct d'une révélation divine ou du résultat de l'activité divinement inspirée de législateurs, généralement des rois et d'autres dirigeants ;
Je crois à l'inspiration divine des activités de certains clergés, personnes déclarées saintes, saintes, bienheureuses, etc. ; Ainsi, dans le catholicisme, il est généralement admis que le chef de l'Église catholique - le Pape - est le vicaire (représentant) de Dieu sur terre ;
Croyance au pouvoir salvateur pour l'âme humaine de ces actions rituelles que les croyants accomplissent conformément aux instructions des Livres Saints, du clergé et des chefs d'église (baptême, circoncision de la chair, prière, jeûne, culte, etc.) ;
Je crois à la direction divine des activités des églises en tant qu'associations de personnes se considérant comme adeptes d'une foi particulière.
3. Diversité des religions
Il existe une variété de croyances, de sectes et d’organisations ecclésiales dans le monde.
Toutes les religions actuellement existantes peuvent être divisées en trois grands groupes :
1) les croyances tribales primitives qui ont survécu jusqu'à ce jour ;
2) les religions d'État qui constituent la base de la vie religieuse des nations individuelles, par exemple le confucianisme (Chine), le judaïsme (Israël) ;
3) les religions du monde. Il n'y en a que trois : le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Ce sont les religions du monde qui ont la plus grande influence sur le développement des civilisations modernes.
Les caractéristiques des religions du monde comprennent :
A) un grand nombre de followers partout dans le monde ;
B) ils sont de nature cosmopolite, inter- et supra-ethnique, dépassant les frontières des nations et des États ;
C) ils sont égalitaires (ils prêchent l'égalité de tous et s'adressent aux représentants de tous les groupes sociaux) ;
D) ils se distinguent par une activité de propagande et un prosélytisme extraordinaires (le désir de convertir les personnes d'une autre religion).
Le bouddhisme est la première religion du monde en termes d’apparition. C'est en Asie qu'elle est la plus répandue. Le domaine central de l'enseignement bouddhiste est la moralité, les normes du comportement humain. Par la réflexion et la contemplation, une personne peut atteindre la vérité, trouver le bon chemin vers le salut et, en observant les commandements du saint enseignement, parvenir à la perfection. Les commandements élémentaires, obligatoires pour chacun, se résument à cinq : ne tuez pas un seul être vivant, ne prenez pas les biens d'autrui, ne touchez pas la femme d'autrui, ne mentez pas, ne buvez pas de vin. Mais pour ceux qui s'efforcent d'atteindre la perfection, ces cinq commandements-interdictions se transforment en tout un système de réglementations beaucoup plus strictes. L’interdiction de tuer va jusqu’à interdire de tuer même des insectes à peine visibles à l’œil nu. L'interdiction de prendre le bien d'autrui est remplacée par l'obligation de renoncer à toute propriété en général, etc. L’un des préceptes les plus importants du bouddhisme est l’amour et la miséricorde envers tous les êtres vivants. De plus, le bouddhisme prescrit de ne faire aucune distinction entre eux et de traiter le bien et le mal, les personnes et les animaux de manière égale et compatissante. Un disciple du Bouddha ne devrait pas payer le mal pour le mal, car sinon non seulement il ne serait pas détruit, mais au contraire, l'inimitié et la souffrance augmenteraient. Vous ne pouvez même pas protéger les autres de la violence et punir le meurtre. Un disciple du Bouddha doit avoir une attitude calme et patiente envers le mal, en évitant seulement d'y participer.
Réflexions sur la religion Balachov Lev Evdokimovich
Substitution de concepts (foi en général et foi religieuse en particulier)
Dans la série télévisée américaine « Cool Walker », un bandit repenti, père de famille qui croyait en Jésus-Christ, déclare : « Je ne parle pas de religion. Je parle de foi. Si on ne croit en rien, la vie devient vide. »
Ou : « Nous étions tous en quelque sorte athées. Et les gens ont cru. Après tout, on ne peut pas du tout vivre sans foi » (paroles d’un journaliste entendues sur NTV le 11 février 1996)
Un commentaire . Dans les deux cas, il y a une nette substitution de concepts : la foi religieuse est remplacée par la foi en général - puisque la vie est vide sans foi ou qu'on ne peut pas vivre, alors la foi en Dieu est nécessaire. Le besoin de foi religieuse se justifie par référence au besoin de foi en général.
Les croyants ne se rendent probablement pas compte de cette substitution de concepts. Ils essaient simplement de monopoliser à la fois la foi et leur compréhension de la foi.
Si une personne se dit croyant, cela ne signifie pas du tout qu'elle est le seul gardien de la foi. Il n’y a personne qui ne croit en rien. Quiconque a perdu confiance en absolument tout se suicide en règle générale. Un croyant est une personne qui absolutise la foi, qui la place au-dessus de la connaissance, de la raison, de la moralité, etc.
La foi en général- c'est une confiance basée sur l'expérience de vie et le désir de réaliser ou d'avoir quelque chose. La foi est généralement opposée à la connaissance. En fait, la foi « agit » précisément là où la connaissance est absente ou manquante, mais le désir de réaliser et d’avoir est fort. La foi, comme la volonté, émeut une personne. Par exemple, une personne croit en sa « star » et essaie de tout faire pour que sa « star » devienne réalité. La foi est aussi comme un rêve. Comme un rêve, il « réchauffe » ou « réchauffe » psychologiquement une personne. «Bienheureux celui qui croit, il est chaleureux dans le monde», disait le poète.
Le plus souvent, la foi concerne l’avenir. Le futur n’a pas la même certitude que le présent (sans parler du passé). La possibilité de différentes options futures et la nécessité de préférer le meilleur du bien au pire du mauvais obligent une personne à se brancher sur la vague de la foi.
La foi est active dans son essence. Cela est nécessaire dans les grandes affaires, lorsque la réalisation d'un objectif nécessite des efforts, des sacrifices ou de la patience importants. La foi est nécessaire dans la communication, dans les relations entre les personnes ou entre les personnes et les animaux supérieurs. Une personne croit ou fait confiance à une autre. Sans cette foi et cette confiance, une communication constructive et fructueuse est impossible, et une activité commune est généralement impossible. Voir aussi « Foi et conviction » ci-dessous.
Extrait du livre Problèmes de la vie auteur Jiddu KrishnamurtiFOI Nous avons grimpé haut dans les montagnes. Il y avait une sécheresse. Il n’y a pas eu de pluie pendant plusieurs mois et les ruisseaux sont devenus silencieux. Les pins brunissaient ; certains étaient déjà secs et le vent soufflait parmi eux. Les montagnes, pli après pli, s'étendaient jusqu'à l'horizon. Presque tous les êtres vivants se sont déplacés vers
Extrait du livre Avoir ou être auteur De Erich SeligmannFOI Au sens religieux, politique ou personnel, le concept de foi peut avoir deux significations complètement différentes, selon qu'il est utilisé sur le principe de l'avoir ou de l'être. Dans le premier cas, la foi est la possession d'une certaine réponse qui n'a besoin d'aucune
Extrait du livre Pensées sur la religion auteur Balachov Lev EvdokimovitchFoi religieuse et raison La religion place la foi au-dessus de la raison. Ce n’est pas naturel, cela revient à dire que ce n’est pas le cerveau qui contrôle le corps, mais le cœur ou une autre partie de celui-ci. Le mot « tête » est l’incarnation matérielle de l’esprit, probablement dans toutes les langues.
Extrait du livre Philosophie : un manuel pour les universités auteur Mironov Vladimir Vassilievitch3. Foi religieuse et rationalité Le deuxième problème central qui se pose lors de la clarification du contenu et du sens du problème de la relation entre philosophie et religion est le problème du statut cognitif de la foi religieuse et de l'expérience religieuse, la relation entre la religion et la religion.
Extrait du livre "Pyramides" entre les lignes ou un peu sur l'éternel auteur Kuvshinov Viktor Yurievitch Extrait du livre Dieu est avec nous par Frank Semyon1. FOI-CONFIANCE ET FOI-CRÉDIBILITÉ Que faut-il entendre par « foi » ? Quelle est la différence entre « foi » et « incrédulité » ou entre « croyant » et « non-croyant » ? Il semble que la grande majorité des gens, suivant la compréhension dominante de longue date de la « foi », entendent par là une sorte de particulier
Extrait du livre Avoir ou être ? auteur De Erich SeligmannFOI Dans un sens religieux, politique ou personnel, le concept de foi peut avoir deux significations complètement différentes, selon qu'il est utilisé selon le principe de l'avoir ou de l'être. Dans le premier cas, la foi est la possession d'une réponse qui ne besoin d'aucune
Extrait du livre Introduction à la philosophie de la religion par Murray Michael7.4.2. Psychologie évolutionniste et foi religieuse Au cours de la dernière décennie, la foi religieuse a été confrontée à un nouveau défi dans le domaine de la psychologie évolutionniste. La psychologie évolutionniste est un domaine de recherche spécifique dont le but est de comprendre comment la pression
Extrait du livre Travaux en deux volumes. Volume 1 de Descartes René8.6.2. La foi religieuse dans les démocraties libérales Bien que les adeptes des démocraties libérales préconisent une politique de tolérance à l'égard de la religion et des différences religieuses entre les citoyens, un certain nombre de théoriciens libéraux contemporains soutiennent que le rôle de la religion dans les affaires civiles
Extrait du livre Ouvert à la source par Harding DouglasChapitre IX De l'origine et du cheminement des planètes et des comètes en général et des comètes en particulier Pour passer à la question des planètes et des comètes, je vous demande de prêter attention à la variété de particules de matière que j'ai suggérée. Malgré le fait que la plupart de ces particules, se désagrégeant et
Extrait du livre Philosophie : notes de cours auteur Chevtchouk Denis AlexandrovitchChapitre X Des planètes en général et de la terre et de la lune en particulier Il convient tout d'abord de faire quelques remarques sur les planètes. Premièrement, bien que toutes les planètes tendent vers les centres du ciel qui les contiennent, cela ne signifie pas qu'elles atteindront jamais ces centres, car, comme je l'ai dit,
Extrait du livre Théologie comparée. Livre 3 auteur Équipe d'auteurs15 FOI La ferme conviction de chaque adulte, la base de sa vie en tant que personne parmi les gens (acquérant un poids particulier en raison de son manque de recherche) est qu'au centre de son univers il y a quelque chose de dense, d'opaque, de coloré, de complexe et d'actif. , selon
Extrait du livre L'Évangile d'un athée auteur Boghossian Peter53 FOI La solution à tout problème, quel qu'il soit, est de voir à qui il appartient, non pas de comprendre, de sentir ou de penser qui a le problème, mais de voir réellement QUI et d'attendre ce qui sortira de cette vision. Cette vision et cette attente sont toujours disponibles, peu importe dans quoi vous vous trouvez.
Extrait du livre de l'auteur3. Connaissance scientifique et foi religieuse Pour certains, le titre de ce paragraphe, et surtout son inclusion dans le chapitre sur la science, semblera étrange, pour ne pas dire plus. C'est faux. Si nous parlons purement formellement, alors la science et la religion, étant des formes de conscience sociale, mises comme objet
Extrait du livre de l'auteur Extrait du livre de l'auteurSéparation des concepts : « foi » n'est pas « espoir » « Foi » et « espoir » ne sont pas synonymes. Les phrases contenant ces mots ont des structures linguistiques différentes et sont sémantiquement différentes. Les mots « J'espère qu'il en est ainsi » ne remplacent pas « Je crois qu'il en est ainsi ». Le concept de « foi » au sens
La foi religieuse occupe la place la plus importante dans l'idéologie religieuse et dans la pratique des organisations religieuses. Tous les systèmes théologiques servent en fin de compte à étayer et à justifier la foi, et l'objectif principal de la pratique liturgique est d'utiliser divers moyens pour influencer les gens afin qu'ils suscitent et renforcent la foi en Dieu.
Les défenseurs de la religion déclarent que la foi en Dieu est une propriété innée de chaque personne, un don de Dieu qui, en raison de son origine divine, ne peut être expliqué d'un point de vue matérialiste. La conviction athée d'un scientifique, toute confiance humaine non liée à la religion, est considérée par eux comme une manifestation imparfaite et déformée de la foi religieuse.
La tâche des athées est de donner une explication véritablement scientifique d'un phénomène psychologique aussi complexe que la foi, la confiance, de montrer l'incohérence des explications théologiques de ce phénomène, de révéler clairement l'opposition de la foi religieuse et de la confiance et de la conviction inhérentes aux matérialistes et aux athées. .
Le concept de foi lui-même est très complexe ; il comprend au moins deux éléments interdépendants – épistémologiquement et émotionnellement-psychologiquement. Par conséquent, l’analyse de la foi implique à la fois des aspects épistémologiques et psychologiques dans la prise en compte de ce phénomène.
Élément épistémologique de la foi
En termes épistémologiques, la foi est associée aux caractéristiques des processus cognitifs à la fois sociaux et individuels. Les classiques du marxisme ont souligné à plusieurs reprises la complexité et l'incohérence du processus de cognition, justifiant le lien étroit de la cognition avec la pratique sociale et avec son élément le plus important - l'activité de production des personnes. La pratique sociale, en tant que base et critère de la connaissance, est historiquement limitée et ne peut à aucun moment pleinement et définitivement confirmer ou réfuter certaines hypothèses. Dans le volume de connaissances dont l'humanité dispose à chaque période de son développement, il y a des connaissances qui ont été confirmées par la pratique et ont acquis le sens de vérités absolues, et des connaissances qui ne peuvent pas encore être vérifiées dans la pratique.
Chaque nouvelle génération hérite de la précédente non seulement d'un certain niveau de développement des forces productives et de la nature des rapports de production, mais aussi de l'ensemble des connaissances et des idées fausses. Outre des informations pratiquement fondées et véritablement scientifiques, des idées religieuses et fantastiques sont également absorbées. Mais dans ses activités pratiques, chaque nouvelle génération vérifie les informations héritées qui étaient auparavant considérées comme acquises ; il rejette les idées et les hypothèses qui ne sont pas confirmées par la pratique, clarifie et approfondit les connaissances véritablement scientifiques sur le monde. À l’opposé de ce véritable processus d’enrichissement des connaissances, les défenseurs de la religion ont toujours revendiqué la préservation de la foi dans les mythes religieux hérités des générations précédentes. Ils n’ont pas hésité à interdire purement et simplement la recherche scientifique au nom de la préservation de la foi religieuse.
La nécessité de naviguer dans les phénomènes divers et complexes de la nature et de la société qui entourent chaque jour les gens donne lieu au désir de développer les principes les plus généraux pour expliquer et classer les phénomènes. Chaque personne crée pour elle-même un modèle mental du monde, basé sur les informations reçues de la société et son expérience personnelle. Plus les connaissances d'une personne sont larges et profondes, plus ses liens avec la société dans son ensemble sont diversifiés et plus ses activités sociales sont actives, et donc plus son expérience personnelle est riche, plus son idée du monde est correcte. Mais si une personne n'a pas de connaissances scientifiques suffisantes sur le monde qui l'entoure et que ses liens pratiques avec le monde se limitent au cadre étroit de la vie quotidienne et monotone, alors une partie importante de ses idées sera basée sur la foi soit en raison de l'opinion existant dans son entourage quotidien, ou dans telle ou telle autorité différente. Il n’est pas surprenant que dans de telles situations puisse être perçue une explication religieuse du monde.
Comme nous le voyons, le véritable processus d’assimilation et de développement des connaissances comprend un moment de foi.
En termes épistémologiques, la foi peut être définie comme l’acceptation par une personne de certaines idées et concepts qui ne peuvent pas, pour des raisons objectives ou subjectives, être prouvés de manière univoque et convaincante à l’heure actuelle.
Une telle définition caractérise toute foi au sens formel. Il souligne que le concept de foi caractérise l’état du processus de pensée interne d’une personne ; l’objet de la foi n’apparaît pas sous sa forme matérielle, mais sous forme d’idées et de concepts.
En d'autres termes, une personne ne croit pas en un objet ou une chose, mais en la vérité de telle ou telle compréhension de cet objet ou de cette chose. Il est vrai que certains philosophes idéalistes et théologiens philosophes qualifient parfois la foi et la conviction des gens de l’existence objective du monde matériel en dehors de l’homme. Cependant, une interprétation aussi large de la foi vise à confondre foi et connaissance, à présenter toute connaissance sous forme de foi, et la foi comme point de départ de la connaissance. En fait, il ne s'agit pas ici de foi, mais de connaissance, car la thèse de l'existence objective de la réalité matérielle en dehors et indépendamment de l'homme a été prouvée par toute la pratique de l'humanité et est constamment confirmée par l'expérience de tous. personne. L'objet de la foi, comme indiqué ci-dessus, peut être ces idées et idées dont la vérité ne peut être justifiée et prouvée sans ambiguïté. Dans les cas où une idée ou une idée a pratiquement confirmé des preuves strictement scientifiques, elle appartient au domaine de la connaissance exacte. Cette division des domaines de la foi et du savoir est clairement visible dans l’analyse de la conscience publique et individuelle. Les gens dans leurs activités de production pratique sont toujours partis de la somme des connaissances obtenues dans le processus de maîtrise de la réalité, testées par la pratique, plaçant le domaine de la foi à la frontière du maîtrisé et de l'inmaîtrisé, du connu et de l'inconnu. Il était une fois, en observant un orage, les gens étaient incapables de comprendre l'essence de ce phénomène, lui donnant une interprétation religieuse. Après que les scientifiques ont réussi à expliquer la nature de ce phénomène, il ne vient à l'esprit de personne, à l'exception des personnes très analphabètes, d'expliquer le tonnerre et les éclairs par les actions d'Élie le prophète.
Ainsi, avec le développement de la pratique sociale et l'accumulation et la diffusion croissantes des connaissances sur le monde qui nous entoure, la sphère de la foi s'éloigne de plus en plus des frontières de l'existence humaine quotidienne, trouvant son objet dans des domaines peu explorés de la science et de la pratique. .
La considération de la foi elle-même comme un moment du processus réel de connaissance met fin aux tentatives de certains théologiens de présenter toute foi comme un phénomène surnaturel, comme un don de Dieu.
Mais une telle caractérisation de la foi n’élimine en rien la question de la différence entre foi religieuse et non religieuse. Malgré la similitude purement formelle de ces types de foi, il existe non seulement une différence entre elles, mais aussi une opposition directe dans l'objet de la foi. Dans les écrits théologiques, les paroles de l'épître aux Hébreux sont généralement citées pour caractériser la foi religieuse : « Or la foi est la substance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas... Par foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que de ce qui est invisible est né ce qui est visible. » Dans leurs sermons, les théologiens soulignent souvent que la foi religieuse exige de croire non pas à ce qui peut être vu, ni à ce qui peut être clairement prouvé, mais à ce qui ne peut être compris. et connu par une personne. La base de la foi religieuse est toujours la reconnaissance du surnaturel. Une personne croit-elle en ce que le monde a été créé par Dieu, en l'origine divine de la psyché humaine ou en l'au-delà et le châtiment de l'au-delà - tout cela repose sur la reconnaissance du rôle déterminant des forces et des êtres surnaturels par rapport à l'ensemble du monde réel et matériel et à tous les processus qui s'y déroulent.
Les théologiens déclarent que Dieu et le monde surnaturel tout entier ne peuvent pas être connus par l’esprit humain ; il faut y croire, malgré les arguments de la raison qui rejette l’existence de Dieu. Les déclarations des théologiens catholiques sur la possibilité d'une connaissance rationnelle de Dieu ne changent pas l'évaluation ci-dessus des voies de la connaissance chrétienne de Dieu, car ils croient également que la raison ne mènera à Dieu que lorsqu'une personne accepte de le chercher, c'est-à-dire croit d'abord en son existence. La foi dans les systèmes religieux est passée d'un élément auxiliaire à un élément indépendant et le plus important de la conscience, qui, selon les théologiens, présente des avantages décisifs sur la connaissance rationnelle, sur les systèmes de preuves logiques. En fin de compte, tous les théologiens chrétiens finissent par reconnaître la thèse exprimée par Tertullien : « Je crois parce que c’est absurde ». L'esprit humain se voit attribuer un rôle de service par rapport à la foi : il doit la justifier du mieux qu'il peut et garder le silence lorsqu'il s'avère impuissant à justifier l'objet de la foi religieuse.
Il convient de souligner que si dans la connaissance hypothétique certaines idées sont considérées comme des idées et ne sont pas identifiées avec des choses et des processus objectifs, alors un trait caractéristique de la foi religieuse est que l'objet de foi qui existe dans la conscience est objectivé. Les théologiens et les croyants insistent sur le fait que l’objet de leur foi religieuse n’est pas la pensée ou le concept même de Dieu, mais précisément Dieu lui-même, le surnaturel lui-même en tant que surnaturel réellement existant.
Contrairement à la foi religieuse, la foi non religieuse a pour objet certaines dispositions hypothétiques, formulées sur la base d'une généralisation de la pratique sociale, fondée sur des vérités scientifiquement établies et vérifiées dans la pratique. Étant la base d'une activité ultérieure, le contenu d'une telle croyance est soit reconnu comme faux, soit confirmé au cours de tests scientifiques pratiques et expérimentaux, acquérant le sens de connaissances scientifiquement fondées. Une telle foi agit comme un élément secondaire et auxiliaire dans le processus de développement des connaissances.