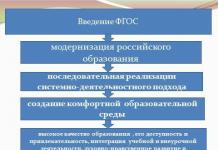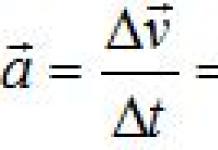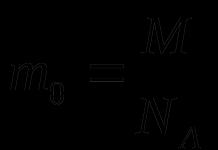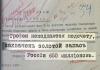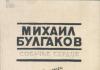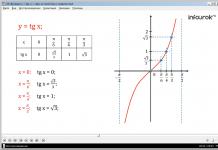J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la conversation avec le colonel général Hypenen. Pourquoi ce matériel m'a-t-il offensé ? Et maintenant, après avoir vécu ces années et lu les mémoires des participants aux événements, vous comprenez que les guerres sont gagnées par les militaires, le général a raison lorsqu'il parle de la primauté du facteur humain, mais sont provoquées par des politiciens. . Et ce ne sont pas nos forces armées qui ont perdu la guerre froide, mais la direction du parti, exposée à l’influence des « agents d’influence ». Les anciens du Kremlin, parmi lesquels il y avait peu de militaires, Brejnev et lui était un travailleur politique, pensaient plus à eux-mêmes qu'aux affaires.
"La principale conclusion que les Américains ont tirée de la guerre du Vietnam est qu'ils ne peuvent pas gagner dans un affrontement direct avec le système socialiste."
Aujourd’hui, en revenant sur les événements de la guerre du Vietnam, vous comprenez qu’il s’agit d’un événement marquant dont les analystes américains ont tiré des leçons, ce que nous n’avons malheureusement pas tiré.
Alors que nous servions dans les forces armées de l'Union, nous étions très inquiets de ce qui se passait au Vietnam. Nous étions tous du côté de son peuple, qui subissait la cruauté de l’armée américaine (bombardements de tapis, utilisation de napalm, défoliants, etc.). Nous avons également compris que les États-Unis « testaient » leur armée et leur marine.
La première leçon que l’Amérique a tirée du Vietnam est que l’intervention de ses forces armées dans un conflit (guerre civile) coûte très cher. Les pertes en disent long. Les Américains à eux seuls y ont laissé environ 50 000 morts et le pays a souffert pendant de nombreuses années du «syndrome du Vietnam», sans compter les dégâts matériels. Par conséquent, depuis lors, les États-Unis n’ont déployé, s’ils l’ont pas fait, qu’un contingent limité sur les points de conflit, préférant combattre par procuration, incitant à des « révolutions de couleur », ou agissant à distance, en effectuant des raids à partir de porte-avions et des frappes de missiles depuis les États-Unis. mer.
Malheureusement, nous n’avons pas tenu compte de ces leçons et sommes intervenus dans le conflit afghan en 1979, où nous avons obtenu le même résultat que les États-Unis. Ce n’est pas pour rien que cette guerre est appelée « Vietnam soviétique ».
Aujourd'hui, en analysant les événements, vous arrivez à la conclusion que tous les conflits, comme celui de la Hongrie (1956), le Printemps de Prague (1968), sans parler du Maïdan en Ukraine, ont été créés par des mains humaines et non par une évolution objective. de l'histoire. Les États-Unis ont renforcé le « mode de vie américain » non seulement avec le dollar, mais aussi avec la force et la tromperie.
Nous n’avons toujours pas tiré les leçons non seulement de la guerre du Vietnam, mais aussi des conflits militaires ultérieurs. Nous essayons de gagner des alliés à nos côtés grâce à l’humanitarisme et à l’aide matérielle. Mais nous ne pouvons pas infecter les peuples du monde avec notre idéologie, car ils voient à quel point notre peuple souffre, s'arrachant le dernier de lui-même. Le gouvernement semble avoir oublié que le monde respecte les forts et que tout le monde admire les pays où les gens vivent bien nourris et aisés. Notre diplomatie n'a pas d'atouts sur la scène internationale et elle fait mouche.
La principale conclusion que les Américains ont tirée de la guerre du Vietnam était qu’ils ne pouvaient pas gagner dans un affrontement direct avec le système socialiste, en particulier avec l’URSS. L’accent a donc été mis sur l’effondrement de l’Union de l’intérieur. Mais la Russie est en train de renaître. Et encore une fois, les États-Unis sont confrontés à la même tâche : neutraliser. La méthode militaire est inacceptable. Et encore une fois, les « agents d’influence » entrent en scène.
Ce qui s'est passé à Kaboul en avril 1978, et ce qu'on a appelé pendant de nombreuses années la Révolution d'Avril (comme l'a dit à juste titre Nadjibullah dans une conversation avec E.A. Chevardnadze en 1987), n'était pas du tout une révolution, ni même un soulèvement, et un coup d'État. Les dirigeants soviétiques ont appris l'existence du coup d'État à Kaboul grâce à des rapports d'agences étrangères et n'ont ensuite reçu des informations que de l'ambassade de l'URSS en Afghanistan.
Plus tard, le chef du PDPA Taraki a déclaré confidentiellement à G. Kirienko qu'ils n'avaient délibérément pas informé à l'avance les représentants soviétiques du coup d'État imminent, craignant que Moscou ne tente de les dissuader de l'action armée en raison de l'absence de situation révolutionnaire dans le pays. .
Le PDPA n'a pas réussi à obtenir le moindre soutien de masse au sein de la société afghane, sans lequel le coup d'État ne pourrait pas se transformer en révolution sociale.
Les seigneurs féodaux, la grande bourgeoisie et presque tout le clergé s'opposèrent ouvertement au nouveau régime. La majorité du peuple suivait le clergé.
Les idéologues de notre parti et nos experts en affaires internationales, principalement M.A. Suslov et B.N. Ponomarev, immédiatement après les événements d'avril 1978, ont commencé à considérer l'Afghanistan comme un autre pays socialiste, dans un avenir proche. L’Afghanistan était perçu par ces personnalités comme une « seconde Mongolie », passant du féodalisme au socialisme.
Les dirigeants afghans ont proposé à plusieurs reprises : d'abord Taraki, puis Amin, plus d'une ou deux fois, d'envoyer des troupes soviétiques sur le sol afghan, mais nos dirigeants s'y sont unanimement opposés jusqu'en octobre 1979.
Le 3 octobre 1979, lors d'une conversation avec le conseiller militaire en chef, le colonel général S.K. Il a déclaré à Magometov ce qui suit : "Nous sommes prêts à accepter n'importe laquelle de vos propositions et de vos projets. Nous vous invitons à participer avec plus d'audace à toutes nos affaires... Je suis un soviétiste dévoué et je comprends parfaitement que sans votre présence en Mongolie, le MPR n'aurait pas duré et un jour. La Chine l'avalerait. Alors pourquoi êtes-vous gênés de coopérer avec nous comme vous le faites avec la Mongolie ? Vous savez que le DRA est sur le chemin de la construction d'une nouvelle société, sans classes, nous avons une idéologie arxiste-léniniste commune et notre objectif est de construire le socialisme dans la DRA".
Le ministre de la Défense de l'URSS D.F. Ustinov, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS A.A. Gromyko, le président du KGB de l'URSS Yu.V. Andropov jusqu'en octobre 1979 étaient catégoriquement contre l'envoi de troupes en Afghanistan, sur qui exactement : Andropov ou Ustinov a été le premier à changer de point de vue et a dit «oui» en faveur de l'envoi de troupes, aujourd'hui on ne peut que deviner. Cependant, il est clair pour nous que tous deux ont déjà mis la touche finale à Gromyko...
On avait le sentiment que quelque chose leur pesait. Il ne s’agit pas seulement de craintes exagérées quant à la menace de remplacer le régime pro-soviétique de Kaboul par un régime islamique réactionnaire et pro-américain, ce qui signifierait l’entrée des États-Unis dans la frontière sud de l’URSS.
L’élément d’une telle préoccupation pour la sécurité de notre pays était ici indéniablement et puissamment présent. Mais le rôle principal, semble-t-il, a encore une fois été joué par une fausse idée idéologiquement déterminée - selon laquelle il s'agissait du danger de perdre un pays socialiste prometteur.
C'est ainsi que se souvient A.A. Gromyko dans son livre « Mémorable » : « Je suis allé à Brejnev et j'ai posé une question :
La décision d’envoyer nos troupes ne devrait-elle pas être formalisée d’une manière ou d’une autre selon les lignes gouvernementales ?
Brejnev a hésité à répondre et a appelé M.A. Suslov. Brejnev l'informa de notre conversation et ajouta de sa propre voix :
Nous devons prendre une décision, de toute urgence ! Soit on ignore l'appel à l'aide de l'Afghanistan, soit on sauve le pouvoir du peuple et on agit conformément au traité soviéto-afghan.
Souslov lui répond :
Nous avons un accord avec l'Afghanistan et nous devons remplir cet engagement rapidement, puisque nous l'avons déjà décidé. Nous en discuterons plus tard au Comité central.
Extrait des documents du XXVIe Congrès du PCUS : « L'impérialisme a déclenché une véritable guerre non déclarée contre la révolution afghane. Cela crée une menace directe pour la sécurité de notre frontière sud. Cette situation nous a obligé à fournir l’assistance militaire demandée par un pays ami. »
Au début, la réaction s’est limitée à l’envoi de bandes relativement petites dans le pays. Peu à peu, les attaques se sont généralisées et organisées. L’existence même d’un Afghanistan démocratique était menacée. Les dirigeants afghans se tournèrent une fois de plus vers l'Union soviétique pour lui demander une assistance militaire.
Le gouvernement soviétique accéda à la demande de la DRA et des forces limitées de troupes soviétiques furent introduites dans le pays.
L.I. Brejnev, répondant aux questions d'un correspondant du journal Pravda, a déclaré :
Ce n’était pas une décision facile pour nous d’envoyer des contingents militaires soviétiques en Afghanistan. La seule tâche assignée aux contingents soviétiques est d’aider les Afghans à repousser une agression extérieure. Ils seront complètement retirés d’Afghanistan dès que les raisons qui ont poussé les dirigeants afghans à demander leur introduction n’existeront plus.
Le manque d’informations fiables a contraint les observateurs soviétiques et étrangers à chercher leur propre explication des événements de ces années-là. À cet égard, les points de vue de George Kennan, qui attachait une importance particulière à l'inquiétude de l'URSS face à la montée du fondamentalisme islamique, et de Selig Harrison, qui estime que l'URSS avait une opinion sur le dirigeant afghan H. Amin sont caractéristiques à cet égard. en tant qu'opportuniste national tout à fait capable de conclure un accord avec Washington, Raimund Garthoff, qui a évoqué les inquiétudes soviétiques concernant l'intervention américaine en Iran. Et le publiciste anglais Mark Urban a formulé un certain nombre de raisons pour lesquelles les troupes soviétiques sont entrées en Afghanistan :
- 1. maintenir un gouvernement ami à Kaboul ;
- 2. élimination de Kh. Amin et de ses associés ;
- 3. renforcer votre position stratégique (bases militaires, etc.) ;
- 4. la volonté de modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région en sa faveur ;
- 5. diffusion de l'idéologie soviétique ;
- 6. ingérence dans la politique occidentale envers les pays du tiers monde.
On peut convenir avec Urban que H. Amin était peu prévisible et n'inspirait donc pas confiance à L.I. Brejnev et à son entourage.
Sa politique a conduit à l’effondrement de l’armée et à la séparation des masses, mais pas uniquement par sa faute. Ces tendances se sont encore intensifiées après le meurtre perfide de Taraki sur ordre d’Amin. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles l’URSS a accepté la proposition de Kaboul d’envoyer des troupes soviétiques en Afghanistan.
Les structures officielles occidentales et la presse ont considéré comme au moins falsifiée la déclaration du gouvernement de l'URSS selon laquelle les troupes auraient été envoyées à la demande des dirigeants afghans pour aider ces derniers dans la lutte contre les bandits rebelles et au nom de l'accomplissement de leur devoir international.
Les déclarations répétées des dirigeants soviétiques sur certaines « forces extérieures » aidant les rebelles afghans ont également été activement critiquées.
En Occident, les objectifs de l’Union soviétique dans cette guerre ont été évalués différemment. Certains y voient la volonté d'une superpuissance de modifier les rapports de force dans la région, la volonté de dialoguer avec les États voisins, principalement avec le Pakistan, en position de force, et de démontrer au monde entier sa puissance et sa volonté. de l'Union Soviétique. D’autres, sans nier fondamentalement tout cela, ont mis l’accent sur le fait que l’Union soviétique ne pouvait tout simplement pas laisser sans aide le régime communiste dans ce pays, où le chaos et la défaite l’attendaient inévitablement.
Certains extrémistes politiques occidentaux étaient même enclins à croire que l’agression soviétique en Afghanistan n’était rien de plus ou de moins qu’une stratégie à long terme visant à obtenir un avantage géostratégique lié à l’accès aux mers chaudes et aux ressources pétrolières du golfe Persique.
Ainsi, en mettant tout cela ensemble, nous pouvons conclure : la révolution afghane s'effondrait et les troupes soviétiques ont été envoyées pour sauver la révolution d'avril, résolvant simultanément d'autres problèmes dans cette région.
Sans aucun doute, et c'est l'essentiel, il s'agissait d'une tentative de répétition de la deuxième « Mongolie ».
Au tout début, l'apparition des soldats soviétiques a été accueillie favorablement par la majorité de la population de la DRA, bien qu'il y ait eu des bombardements de véhicules soviétiques en marche.
Un petit musée discret à la périphérie de Moscou. Ce n’est qu’un petit monument à un conflit destructeur et futile. Peu de gens connaissent ce musée en Russie - et encore moins de gens y viennent. Il semble que beaucoup voudraient oublier complètement la guerre de dix ans menée par l’Union soviétique en Afghanistan. À propos de la guerre, appelée « Vietnam soviétique ». Mais ni les anciens combattants afghans ni leurs familles ne l’oublieront jamais.
"ANCIENS COMBATTANTS". L'Union soviétique en Afghanistan
(La série de films « VETERANS », diffusée sur la chaîne Al Jazeera, comprend également les films : « Les Malouines », « Bosnie : le siège de Sarajevo » et « Rwanda » - ndlr)
Il s’agit de la plus grande opération militaire menée par l’Union soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 25 décembre 1979, les premiers soldats de la 40e armée soviétique arrivent en Afghanistan. Mais peu de soldats soviétiques comprenaient qu’ils étaient entraînés dans une guerre civile d’un peuple étranger.
Le président américain Jimmy Carter a qualifié l'invasion de "menace la plus grave pour la paix depuis la Seconde Guerre mondiale" et a appelé au boycott des Jeux olympiques prévus à Moscou en 1980. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux étaient déterminés à empêcher le succès de l’opération soviétique. Les opposants aux Soviétiques ont également été aidés – en termes de ressources et de main d’œuvre – par d’autres pays, par exemple le Pakistan et l’Arabie Saoudite, qui avaient leurs propres motivations. Ils ont fourni et armé des unités de moudjahidines, qui ont infligé des coups brutaux aux troupes soviétiques. Les soldats soviétiques appelaient les militants des « esprits » – des fantômes. Pendant la journée, les Afghans étaient pacifiques et amicaux, mais la nuit, ils se transformaient en ennemis.
Pendant la guerre, certains soldats soviétiques ont même déserté le champ de bataille et, choisissant entre l'Afghanistan et le châtiment inévitable en URSS, ils ont choisi l'Afghanistan. Et ceux qui sont restés avec les leurs ont ressenti de plus en plus lourdement les conséquences des événements qui ont commencé chez eux. Au milieu des années 80, de sérieuses fissures ont commencé à apparaître dans le système communiste lui-même. Le rideau de fer a commencé à tomber, l’économie dirigée, inflexible et inefficace, était incapable de fournir tout le nécessaire à ses citoyens – à ceux qui vivaient simplement et à ceux qui combattaient.
Pendant ce temps, les Moudjahidines n’avaient pas de tels problèmes. Ils ont reçu les armes les plus modernes provenant de diverses sources, qui étaient continuellement fournies par le Pakistan. Ils disposaient de Stingers américains, de mitrailleuses lourdes chinoises et de lance-grenades britanniques.
Le peuple soviétique s'est vu refuser toute information sur la guerre. Mais le reste du monde en a reçu en abondance. Le conflit est devenu plus qu’une simple bataille de la guerre froide : il est devenu une bataille de propagande. Des émissions ont été diffusées dans le monde entier accusant les Soviétiques de terribles atrocités. Dans le célèbre film hollywoodien "Rambo 3", les soldats soviétiques sont dépeints comme des meurtriers et des sadiques, auxquels ne s'opposent que de nobles combattants moudjahidines et un héros américain.
En 1987, alors que le gouvernement soviétique était de nouveau sous la pression internationale et que le prestige de l’Union soviétique était en ruine, des négociations commencèrent pour un retrait des troupes.
En Occident, nombreux sont ceux qui ont commencé à se réjouir de la défaite de l’Union soviétique. Ils ne savaient pas que plusieurs années s'écouleraient et que les moudjahidines qu'ils soutenaient retourneraient leurs armes contre eux.
Le 15 février 1989, le dernier soldat soviétique traverse à pied le pont séparant l’Union soviétique de l’Afghanistan. Selon les chiffres officiels, 15 000 soldats soviétiques sont morts à la suite du conflit ; 50 000 ont été blessés. Mais pour ceux qui sont rentrés chez eux, une autre bataille, très différente, les attendait encore.
Ce monument situé dans la ville d'Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale, est appelé la « tulipe noire » – le nom donné aux avions de transport qui transportaient les corps des morts d'Afghanistan vers l'URSS. Mais même parmi ceux qui sont revenus vivants, beaucoup se souviennent encore du peu de soutien dont ils ont bénéficié à leur retour chez eux.
En 1991, deux ans après le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan, l’Union soviétique disparaît. L’État qui les envoyait en Afghanistan pour combattre et mourir n’existait plus. Ces changements inattendus ont été un coup dur pour beaucoup. Beaucoup de gens ressentent la même chose : que la société dans laquelle ils sont retournés s’est révélée leur être étrangère.
Ils oublieraient s’ils le pouvaient – mais ils ne peuvent pas oublier et ils doivent vivre avec tout cela. Je dirais même qu'il ne faut pas oublier. Ils doivent transmettre ce qu’ils savent à leurs enfants, et leurs enfants doivent savoir qu’il n’y a rien de pire que la guerre ; cette guerre est impitoyable envers quiconque se met en travers de son chemin.
Les chansons des anciens combattants sont devenues une sorte de mini-industrie dans les pays de l’ex-Union soviétique. Pour certains anciens combattants, la musique est le moyen même par lequel ils tentent de se réconcilier avec leur passé et de s'assurer que ce qu'ils ont vécu ne soit pas oublié.
Aujourd’hui, ce n’est plus l’Union soviétique communiste qui envoie ses jeunes hommes à la guerre, mais la Fédération de Russie. Un nouveau monument a déjà été ajouté à la « tulipe noire » d'Ekaterinbourg. Sur celui-ci est écrit le mot unique et donc terrible - « TCHÉTCHÉNIE ».
Les documents InoSMI contiennent des évaluations exclusivement de médias étrangers et ne reflètent pas la position de la rédaction d'InoSMI.
II. Non-recours à la force ou menace de force
Les Etats participants s'abstiendront dans leurs accords mutuels, comme en général
dans leurs relations internationales, de l'usage ou de la menace de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies et avec la présente Déclaration. Aucune considération ne peut être invoquée pour justifier le recours à la menace ou au recours à la force en violation de ce principe.
En conséquence, les Etats participants s'abstiendront de toute action constituant une menace de recours à la force ou un recours direct ou indirect à la force contre un autre Etat participant... De même, ils s'abstiendront également, dans leurs relations mutuelles, de tout acte de représailles par la force.
Aucun recours à la force ou menace de force ne sera utilisé comme moyen de régler des différends ou des questions susceptibles de donner lieu à des différends entre eux.
(Anthologie sur l'histoire de la Russie (1946-1995).
Manuel pour étudiants universitaires édité par A.F. Kisilev, E.M. Shchagin.M. Humanitaire. Éd. Centre "VLADOS", 1996. p. 559)
Répondez aux questions:
1. Quelles sont les raisons du passage à la politique de détente ?
2. Quels succès la communauté internationale a-t-elle obtenus pour limiter la course aux armements et prévenir une guerre mondiale ?
3. Quel rôle ont été attribués aux armes nucléaires en URSS et aux États-Unis ?
4. Quelles contradictions existaient dans les évaluations des initiatives de paix d'Helsinki entre les dirigeants de l'URSS et des États-Unis ?
Tâche 4. Pensez à la raison pour laquelle l'Union soviétique a retiré ses troupes d'Afghanistan ? Pourquoi ces événements sont-ils appelés « Vietnam soviétique » ?
Travaux pratiques n°4.
Sujet : « Événements politiques en Europe de l’Est dans la seconde moitié des années 80. »
Cible:
4. explorer les événements politiques en Europe de l’Est dans la seconde moitié des années 80. »
Tâches:
déterminer les caractéristiques de l'idéologie, nationale et socio-économique
les politiques des pays d'Europe de l'Est ;
caractériser les raisons du rejet du modèle socialiste de développement des pays ;
tirer une conclusion
Ordre d'exécution :
Se préparer à accomplir des tâches ;
Étudiez le texte;
Terminez le devoir par écrit.
Exercice 1 : Sur la base d'une analyse des causes des révolutions, formuler leurs tâches principales et déterminer la nature des révolutions (Mots pour caractéristiques : antitotalitaire, anticommuniste, démocratique ; société démocratique, modèle économique de marché, souveraineté).
Causes des révolutions en Europe de l’Est :
1. Facteurs internes:
1. Économique - une forte baisse du taux de développement économique, le caractère extensif du développement économique dans la plupart des pays, un modèle économique de commandement administratif, l'absence de changements structurels dans l'économie, des processus inflationnistes, un retard important par rapport aux pays occidentaux non seulement dans quantitatifs, mais aussi qualitatifs.
2. L'accumulation de problèmes sociaux - une baisse du niveau de vie, moins perceptible uniquement en RDA et en Tchécoslovaquie, une exacerbation de toutes les contradictions de la société, y compris nationales (en Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie).
3. Protestation contre les régimes politiques totalitaires, la domination politique des partis communistes.
4. Dans tous les pays, le mécontentement à l'égard de l'ordre existant s'est accru, qui s'est exprimé par un mouvement de grève de masse et la formation d'organisations d'opposition (Charte 77 en Tchécoslovaquie, Solidarité en Pologne, écologistes en Bulgarie).
1. Facteur externe: Transformations politiques en URSS (perestroïka).
Tâche 2. Restaurer la séquence des événements :
1. 1. «Printemps de Prague». 2. Création du CAEM. 3. Insurrection populaire en Bulgarie. 4. Normalisation des relations diplomatiques entre l'URSS et la Yougoslavie. 5. Suppression du soulèvement en Hongrie par les troupes de l'URSS. 6. Création de l'Organisation du Pacte de Varsovie. 7. Soulèvement populaire en Roumanie. 8. Introduction de la loi martiale en Pologne. 9. La montée des partis communistes au pouvoir. 10. Unification de l'Allemagne.
Tâche 3. Complétez le tableau en incluant des données factuelles sur les révolutions dans les pays d’Europe de l’Est (Annexe aux travaux pratiques n°4)
Officiellement, la guerre du Vietnam a commencé en août 1964 et s’est poursuivie jusqu’en 1975 (bien que l’intervention directe américaine ait cessé deux ans avant la fin des hostilités). Cet affrontement est la meilleure illustration de l’instabilité des relations entre l’URSS et les États-Unis durant la guerre froide. Analysons les conditions préalables, soulignons les principaux événements et résultats du conflit militaire qui a duré onze ans.
Conditions préalables au conflit
La véritable cause profonde du conflit est le désir logique des États-Unis d’entourer l’Union soviétique des États qui seront contrôlés par elle ; sinon formellement, du moins en fait. Au début de l’affrontement, la Corée du Sud et le Pakistan étaient déjà « conquis » sur ce point ; puis les dirigeants des États-Unis ont tenté d'y ajouter le Nord-Vietnam.
La situation était propice à une action active : à cette époque, le Vietnam était divisé entre le Nord et le Sud et une guerre civile faisait rage dans le pays. La partie sud a demandé l’aide des États-Unis. Dans le même temps, la partie nord, dirigée par le Parti communiste dirigé par Hô Chi Minh, recevait le soutien de l'URSS. Il convient de noter que l’Union soviétique n’est pas ouvertement – officiellement – entrée en guerre. Les spécialistes soviétiques des documents arrivés dans le pays en 1965 étaient des civils ; cependant, nous y reviendrons plus tard.
Déroulement des événements : le début des hostilités
Le 2 août 1964, une attaque est menée contre un destroyer américain qui patrouillait dans le golfe du Tonkin : des torpilleurs nord-vietnamiens entrent dans la bataille ; Une situation similaire s'est répétée le 4 août, ce qui a amené Lyndon Johnson, alors président des États-Unis, à ordonner une frappe aérienne contre des installations navales. La question de savoir si les attaques de bateaux étaient réelles ou imaginaires est un sujet de discussion distinct que nous laisserons aux historiens professionnels. D'une manière ou d'une autre, le 5 août, une attaque aérienne et un bombardement du territoire du nord du Vietnam par des navires de la 7e flotte ont commencé.
Les 6 et 7 août, la « Résolution Tonkin » est adoptée, qui sanctionne l’action militaire. Les États-Unis d'Amérique, qui étaient ouvertement entrés dans le conflit, envisageaient d'isoler l'armée nord-vietnamienne de la République démocratique du Vietnam, du Laos et du Cambodge, créant ainsi les conditions de sa destruction. Le 7 février 1965, l'opération Burning Spear a été menée, qui était la première action mondiale visant à détruire des objets importants du Nord-Vietnam. L'attaque s'est poursuivie le 2 mars - déjà dans le cadre de l'opération Rolling Thunder.
Les événements se sont développés rapidement : bientôt (en mars), environ trois mille Marines américains sont apparus à Da Nang. Après trois ans, le nombre de soldats américains combattant au Vietnam était passé à 540 000 ; des milliers d’unités d’équipement militaire (par exemple, environ 40 % des avions tactiques militaires du pays y ont été envoyés). Au 166e, une conférence des États appartenant à l'OTASA (alliés des États-Unis) a eu lieu, à la suite de laquelle environ 50 000 soldats coréens, environ 14 000 soldats australiens, environ 8 000 d'Australie et plus de deux mille des Philippines ont été amenés. dans.

L'Union soviétique n'est pas non plus restée les bras croisés : en plus des spécialistes civils et militaires envoyés, la DRV (Nord-Vietnam) a reçu environ 340 millions de roubles. Des armes, munitions et autres moyens nécessaires à la guerre ont été fournis.
Développements
En 1965-1966, une opération militaire à grande échelle a eu lieu de la part du Sud-Vietnam : plus d'un demi-million de soldats ont tenté de s'emparer des villes de Pleiku et Kontum à l'aide d'armes chimiques et biologiques. Cependant, la tentative d’attaque échoue : l’offensive est interrompue. Dans la période 1966-1967, une deuxième tentative d'offensive à grande échelle a été faite, mais les actions actives du SE JSC (attaques par les flancs et par l'arrière, attaques de nuit, tunnels souterrains, participation de détachements partisans) ont arrêté cette attaquer également.
Il convient de noter qu’à cette époque, plus d’un million de personnes combattaient du côté des États-Unis et de Saigon. En 1968, le Front national de libération du Sud-Vietnam est passé de la défense à l'offensive, ce qui a détruit environ 150 000 soldats ennemis et plus de 7 000 pièces d'équipement militaire (voitures, hélicoptères, avions, navires).
Les États-Unis ont mené des attaques aériennes actives tout au long du conflit ; Selon les statistiques disponibles, plus de sept millions de bombes ont été larguées pendant la guerre. Cependant, une telle politique n'a pas abouti, puisque le gouvernement de la République d'Extrême-Orient a procédé à des évacuations massives : des soldats et des personnes se sont cachés dans la jungle et les montagnes. En outre, grâce au soutien de l'Union soviétique, la partie nord a commencé à utiliser des chasseurs supersoniques, des systèmes de missiles modernes et des équipements radio, créant ainsi un système de défense aérienne sérieux ; en conséquence, plus de quatre mille avions américains ont été détruits.

Étape finale
En 1969, la RSV (République du Sud-Vietnam) est créée, et en 1969, en raison de l'échec de l'essentiel des opérations, les dirigeants américains commencent progressivement à perdre du terrain. À la fin des années 1970, plus de deux cent mille soldats américains avaient été retirés du Vietnam. En 1973, le gouvernement américain a décidé de signer un accord de cessation des hostilités, après quoi il a finalement retiré ses troupes du pays. Bien entendu, nous ne parlons que du côté formel : des milliers de spécialistes militaires sont restés au Sud-Vietnam sous couvert de civils. Selon les statistiques disponibles, pendant la guerre, les États-Unis ont perdu environ soixante mille personnes tuées, plus de trois cent mille blessés, ainsi qu'une quantité colossale de matériel militaire (par exemple, plus de 9 mille avions et hélicoptères).
Les hostilités se sont poursuivies pendant plusieurs années encore. En 1973-1974, le Sud-Vietnam passe à nouveau à l'offensive : des bombardements et d'autres opérations militaires sont menés. Le résultat n’a été atteint qu’en 1975, lorsque la République du Sud-Vietnam a mené l’opération Ho Chi Minh, au cours de laquelle l’armée de Saigon a été complètement vaincue. En conséquence, la République démocratique du Vietnam et le Sud-Vietnam ont été unis en un seul État : la République socialiste du Vietnam.