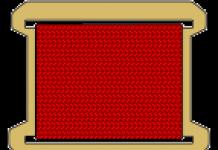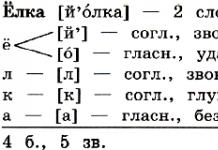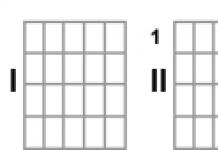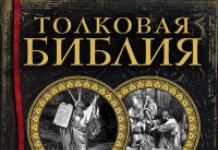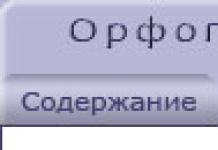Plan
Introduction
1 Statistiques de guerre
2 Contexte et raison
3 actions militaires en 1828
3.1 Dans les Balkans
3.2 En Transcaucasie
4 actions militaires en 1829
4.1 Sur le théâtre européen
4.2 En Asie
5 Les épisodes les plus marquants de la guerre
6 héros de guerre
7 Résultats de la guerre
Bibliographie
Russe- guerre turque (1828-1829)
Introduction
La guerre russo-turque de 1828-1829 était un conflit militaire entre les empires russe et ottoman qui a débuté en avril 1828 en raison du fait que la Porte a fermé le détroit du Bosphore après la bataille de Navarin (octobre 1827), en violation de la Convention Ackerman. .
Dans un contexte plus large, cette guerre était une conséquence de la lutte entre les grandes puissances provoquée par guerre grecque pour l'indépendance (1821-1830) de Empire ottoman. Pendant la guerre, les troupes russes ont mené une série de campagnes en Bulgarie, dans le Caucase et dans le nord-est de l'Anatolie, après quoi la Porte a demandé la paix.
1. Statistiques de guerre
2. Contexte et raison
Les Grecs du Péloponnèse, qui se sont rebellés contre la domination ottomane au printemps 1821, ont été aidés par la France et l'Angleterre ; La Russie sous Alexandre Ier a pris une position de non-intervention, mais était en alliance avec la première en vertu des accords du Congrès d'Aix-la-Chapelle ( voir aussi Sainte Alliance).
Avec l'avènement de Nicolas Ier, la position de Saint-Pétersbourg sur la question grecque commença à changer ; mais des querelles éclatèrent entre les anciens alliés sur le partage des possessions de l'Empire ottoman ; Profitant de cela, la Porte se déclara libre de tout accord avec la Russie et expulsa les sujets russes de ses possessions. La Porte a invité la Perse à poursuivre la guerre avec la Russie et a interdit aux navires russes d'entrer dans le Bosphore.
Le sultan Mahmud II a essayé de donner à la guerre un caractère religieux ; Voulant diriger une armée pour défendre l'Islam, il transféra sa capitale à Andrinople et ordonna le renforcement des forteresses du Danube. Face à de telles actions de la Porte, l'empereur Nicolas Ier déclara la guerre à la Porte le 14 (26) avril 1828 et ordonna à ses troupes, jusqu'alors stationnées en Bessarabie, d'entrer dans les possessions ottomanes.
3. Actions militaires en 1828
3.1. Dans les Balkans
La Russie disposait d'une armée du Danube forte de 95 000 hommes sous le commandement de P. H. Wittgenstein et d'un corps séparé du Caucase de 25 000 hommes sous le commandement du général I. F. Paskevich.
Ils se sont heurtés à l'opposition des armées turques totalisant jusqu'à 200 000 personnes. (150 000 sur le Danube et 50 000 dans le Caucase) ; De la flotte, seuls 10 navires stationnés dans le Bosphore ont survécu.
L'armée du Danube était chargée d'occuper la Moldavie, la Valachie et la Dobroudja, ainsi que de capturer Shumla et Varna.
La Bessarabie a été choisie comme base des actions de Wittgenstein ; les principautés (gravement épuisées par la domination turque et la sécheresse de 1827) étaient censées être occupées uniquement pour y rétablir l'ordre et les protéger de l'invasion ennemie, ainsi que pour protéger l'aile droite de l'armée en cas d'intervention autrichienne. Wittgenstein, après avoir traversé le Bas-Danube, était censé se déplacer vers Varna et Shumla, traverser les Balkans et avancer jusqu'à Constantinople ; un détachement spécial était censé débarquer à Anapa et, une fois capturé, rejoindre les forces principales.
Le 25 avril, le 6e corps d'infanterie entre dans les principautés, et son avant-garde sous le commandement du général Fedor Geismar se dirige vers la Petite Valachie ; Le 1er mai, le 7e corps d'infanterie assiège la forteresse de Brailov ; Le 3e corps d'infanterie était censé traverser le Danube entre Izmail et Reni, près du village de Satunovo, mais la construction d'une route traversant une plaine inondée d'eau a nécessité environ un mois, pendant lequel les Turcs ont renforcé la rive droite en face du point de passage, plaçant jusqu'à 10 000 personnes dans leur position.
Dans la matinée du 27 mai, la traversée des troupes russes sur des navires et bateaux a commencé en présence du souverain. Malgré les tirs violents, ils atteignirent la rive droite et lorsque les tranchées turques avancées furent prises, l'ennemi s'enfuit du reste. Le 30 mai, la forteresse d'Isakcha se rend. Après avoir séparé des détachements pour assiéger Machin, Girsov et Tulcha, les principales forces du 3e corps atteignirent Karasu le 6 juin et leur avant-garde, sous le commandement du général Fedor Ridiger, assiégea Kyustendzhi.
Le siège de Braïlov avança rapidement et le chef des troupes de siège, grand Duc Mikhaïl Pavlovitch, pressé d'en finir avec cette affaire pour que le 7e corps puisse rejoindre le 3e, décide de prendre d'assaut la forteresse le 3 juin ; l'assaut fut repoussé, mais lorsque la reddition de Machin suivit 3 jours plus tard, le commandant Brailov, se voyant isolé et ayant perdu tout espoir d'aide, se rendit également (7 juin).
Au même moment, une expédition maritime vers Anapa a lieu. À Karasu, le 3e corps est resté 17 jours entiers, car après l'attribution des garnisons aux forteresses occupées, ainsi que d'autres détachements, il n'en restait plus que 20 000. Seulement avec l'ajout de quelques parties du 7e Corps et l'arrivée de la 4e Réserve. dans le corps de cavalerie, les principales forces de l'armée atteindraient 60 mille ; mais même cela ne fut pas jugé suffisant pour une action décisive, et au début de juin, la 2e infanterie reçut l'ordre de se déplacer de la Petite Russie vers le Danube. corps (environ 30 mille); en plus, ils étaient déjà en route vers le théâtre de la guerre régiments de gardes(jusqu'à 25 mille).
Après la chute de Braïlov, le 7e corps fut envoyé rejoindre le 3e ; Le général Roth avec deux brigades d'infanterie et une de cavalerie reçut l'ordre d'assiéger la Silistrie, et le général Borozdin avec six régiments d'infanterie et quatre régiments de cavalerie reçut l'ordre de garder la Valachie. Avant même que tous ces ordres ne soient exécutés, le 3e corps s'est déplacé vers Bazardjik, où, selon les informations reçues, d'importantes forces turques se rassemblaient.
Entre le 24 et le 26 juin, Bazardjik fut occupé, après quoi deux avant-gardes furent avancées : Ridiger à Kozludzha et l'amiral général comte Pavel Sukhtelen à Varna, auquel fut également envoyé un détachement du lieutenant-général Alexandre Ouchakov de Tulcha. Début juillet, le 7e corps rejoint le 3e corps ; mais leurs forces combinées ne dépassaient pas 40 mille ; il était encore impossible de compter sur le concours de la flotte stationnée à Anapa ; Les parcs de siège étaient en partie situés près de la forteresse nommée et en partie s'étendaient depuis Brailov.
Pendant ce temps, les garnisons de Shumla et de Varna se renforcèrent progressivement ; L'avant-garde de Riediger était constamment harcelée par les Turcs, qui tentaient d'interrompre ses communications avec les forces principales. Compte tenu de l'état des choses, Wittgenstein a décidé de se limiter à une observation concernant Varna (pour laquelle le détachement d'Ouchakov a été nommé), avec les principales forces pour se déplacer vers Shumla, tenter d'attirer le seraskir du camp fortifié et, après l'avoir vaincu, tourner au siège de Varna.
Le 8 juillet, les forces principales se sont approchées de Shumla et l'ont assiégée du côté est, renforçant fortement leurs positions afin d'interrompre la possibilité de communication avec Varna. Une action décisive contre Shumla devait être reportée jusqu'à l'arrivée des gardes. Cependant, nos forces principales se sont vite retrouvées dans une sorte de blocus, car sur leurs arrières et sur les flancs l'ennemi développait des opérations de guérilla, ce qui gênait grandement l'arrivée des transports et le ravitaillement. Pendant ce temps, le détachement d’Ouchakov ne pouvait pas non plus résister à la garnison supérieure de Varna et se retira à Derventkoy.
À la mi-juillet, la flotte russe est arrivée de près d'Anapa à Kovarna et, après avoir débarqué des troupes à bord des navires, s'est dirigée vers Varna, contre laquelle elle s'est arrêtée. Chef troupes aéroportées Le prince Alexandre Menchikov, ayant rejoint le détachement d'Ouchakov, s'est également approché le 22 juillet de ladite forteresse, l'a assiégée par le nord et, le 6 août, a commencé les travaux de siège. Le détachement du général Roth stationné à Silistrie ne pouvait rien faire en raison d'effectifs insuffisants et du manque d'artillerie de siège. Les choses n'ont pas non plus progressé près de Shumla, et bien que les attaques turques lancées les 14 et 25 août aient été repoussées, cela n'a donné aucun résultat. Le comte Wittgenstein voulait se retirer à Yeni Bazar, mais l'empereur Nicolas Ier, qui était avec l'armée, s'y opposa.
En général, fin août, les circonstances sur le théâtre de guerre européen étaient très défavorables aux Russes : le siège de Varna, en raison de la faiblesse de nos forces là-bas, ne promettait pas de succès ; Les maladies faisaient rage parmi les troupes stationnées près de Shumla et les chevaux mouraient par manque de nourriture ; Pendant ce temps, l'insolence des partisans turcs augmentait.
Au même moment, à l'arrivée de nouveaux renforts à Shumla, les Turcs attaquent la ville de Pravody, occupée par le détachement de l'amiral général Benckendorf, mais ils sont repoussés. Le général Loggin Roth tient à peine sa position en Silistrie, dont la garnison reçoit également des renforts. Gène. Kornilov, observant Zhurja, a dû repousser les attaques de là et de Rushchuk, où les forces ennemies ont également augmenté. Le faible détachement du général Geismar (environ 6 000 hommes), bien qu'il occupât sa position entre Calafat et Craiova, ne put empêcher les parties turques d'envahir la partie nord-ouest de la Petite Valachie.
L'ennemi, après avoir concentré plus de 25 000 hommes à Viddin et Kalafat, renforça les garnisons de Rakhov et Nikopol. Ainsi, les Turcs avaient partout un avantage en termes de forces, mais, heureusement, n'en ont pas profité. Pendant ce temps, à la mi-août, le Corps des Gardes commença à s'approcher du Bas-Danube, suivi par la 2e infanterie. Ce dernier reçut l'ordre de relever le détachement de Roth en Silistrie, qui serait alors attiré près de Shumla ; Le garde est envoyé à Varna. Pour récupérer cette forteresse, 30 000 corps turcs d'Omer-Vrione sont arrivés de la rivière Kamchik. Plusieurs attaques inefficaces suivirent des deux côtés et lorsque Varna se rendit le 29 septembre, Omer entama une retraite précipitée, poursuivi par le détachement du prince Eugène de Wurtemberg, et se dirigea vers Aidos, où les troupes du vizir s'étaient retirées plus tôt.
Pendant ce temps, gr. Wittgenstein a continué à se tenir sous Shumla ; Ses troupes, après avoir alloué des renforts à Varna et à d'autres détachements, ne restèrent qu'environ 15 000 ; mais le 20 septembre. Le 6e corps s'approche de lui. La Silistrie continue de tenir le coup, car le 2e corps, faute d'artillerie de siège, ne peut pas prendre d'action décisive.
Pendant ce temps, les Turcs continuaient de menacer la Petite Valachie ; mais la brillante victoire remportée par Geismar près du village de Boelesti met fin à leurs tentatives. Après la chute de Varna but ultime La campagne de 1828 visait la conquête de la Silistrie et le 3e corps y fut envoyé. Le reste des troupes situées près de Shumla dut hiverner dans la partie occupée du pays ; le garde est retourné en Russie. Cependant, l'entreprise contre la Silistrie en raison du manque d'obus dans l'artillerie de siège ne s'est pas concrétisée et la forteresse n'a été soumise à un bombardement que pendant 2 jours.
Après la retraite des troupes russes de Shumla, le vizir décide de reprendre possession de Varna et s'installe le 8 novembre à Pravody, mais, rencontrant la résistance du détachement occupant la ville, il retourne à Shumla. En janvier 1829, un fort détachement turc attaqua l'arrière du 6e corps, captura Kozludzha et attaqua Bazardzhik, mais échoua ; et après cela, les troupes russes chassèrent l'ennemi de Kozludzha ; le même mois, la forteresse de Turno fut prise. Le reste de l’hiver s’est déroulé tranquillement.
3.2. En Transcaucasie
Le Corps caucasien séparé a commencé ses opérations un peu plus tard ; il reçut l'ordre d'envahir la Turquie asiatique.
En Turquie asiatique en 1828, les choses se passent bien pour la Russie : le 23 juin, Kars est prise, et après une suspension temporaire des hostilités en raison de l'apparition de la peste, Paskevich conquiert la forteresse d'Akhalkalaki le 23 juillet, et début août s'approche Akhaltsikhé, qui se rend le 16 du même mois. Puis les forteresses d'Atskhur et d'Ardahan se rendirent sans résistance. Au même moment, des détachements russes distincts prirent Poti et Bayazet.
4. Actions militaires en 1829
Durant l’hiver, les deux camps se sont activement préparés à la reprise des hostilités. À la fin du mois d'avril 1829, la Porte réussit à porter ses forces sur le théâtre de guerre européen à 150 000 et pouvait en outre compter sur les 40 000 miliciens albanais rassemblés par le Scutari Pacha Mustafa. Les Russes ne pouvaient s'opposer à ces forces qu'avec 100 000 personnes maximum. En Asie, les Turcs disposaient de 100 000 soldats contre 20 000 Paskevich. Seule la flotte russe de la mer Noire (environ 60 navires de différents rangs) avait une supériorité décisive sur la flotte turque ; Oui, l’escadre du comte Heyden (35 navires) a également navigué dans l’archipel.
4.1. Au théâtre européen
Nommé commandant en chef à la place de Wittgenstein, le comte Diebitsch s'emploie activement à reconstituer l'armée et à organiser sa partie économique. Parti pour traverser les Balkans afin de ravitailler les troupes de l'autre côté des montagnes, il se tourna vers le secours de la flotte et demanda à l'amiral Greig de prendre possession de tout port propice à l'acheminement des ravitaillements. Le choix s'est porté sur Sizopol qui, après sa capture, a été occupée par une garnison russe forte de 3 000 hommes. La tentative faite par les Turcs à la fin du mois de mars pour reprendre cette ville échoua et ils se limitèrent alors à la bloquer de la route sèche. Quant à la flotte ottomane, elle a quitté le Bosphore début mai, mais elle est restée plus près de ses côtes ; au même moment, deux navires militaires russes en furent accidentellement encerclés ; l'un d'eux (la frégate "Raphaël" de 36 canons) se rendit, et l'autre, le brick "Mercure" sous le commandement de Kazarsky, réussit à repousser les navires ennemis qui le poursuivaient et à s'échapper.
Fin mai, les escadres de Greig et Heyden commencèrent à bloquer les détroits et interrompirent tout approvisionnement par mer vers Constantinople. Pendant ce temps, Dibich, afin d'assurer ses arrières avant le mouvement vers les Balkans, décida d'abord de prendre possession de la Silistrie ; mais l'arrivée tardive du printemps le retarda, de sorte que ce n'est qu'à la fin du mois d'avril qu'il put traverser le Danube avec les forces nécessaires à cet effet. Le 7 mai, les travaux de siège ont commencé et le 9 mai, de nouvelles troupes ont traversé la rive droite, portant les forces du corps de siège à 30 000 personnes.
À peu près au même moment, le vizir Reshid Pacha ouvre des opérations offensives dans le but de ramener Varna ; cependant, après des négociations persistantes avec les troupes, le général. La compagnie d'Eski-Arnautlar et de Pravod se retira de nouveau vers Shumla. À la mi-mai, le vizir et ses forces principales se dirigent à nouveau vers Varna. Ayant reçu cette nouvelle, Dibich, laissant une partie de ses troupes en Silistrie, se rendit avec l'autre derrière le vizir. Cette manœuvre aboutit à la défaite (30 mai) de l'armée ottomane près du village de Kulevchi.
Même si, après une victoire aussi décisive, on pouvait compter sur la capture de Shumla, il était préférable de se limiter à son simple observation. Pendant ce temps, le siège de Silistrie réussit et le 18 juin, cette forteresse se rendit. Suite à cela, le 3e corps fut envoyé à Shumla, le reste des troupes russes destinées à la campagne transbalkanique commença à converger secrètement vers Devno et Pravody.
Pendant ce temps, le vizir, convaincu que Diebitsch assiégerait Shumla, y rassemblait des troupes partout où cela était possible - même depuis les cols des Balkans et depuis les points côtiers de la mer Noire. L'armée russe, quant à elle, avançait vers Kamchik et après une série de batailles sur cette rivière et lors de nouveaux mouvements dans les montagnes des 6e et 7e corps, vers la mi-juillet, elle traversa la crête des Balkans, capturant simultanément deux forteresses, Misevria et Ahiolo, et l'important port de Bourgas.
Ce succès a cependant été éclipsé par le fort développement de maladies, dont les troupes étaient sensiblement en train de fondre. Le vizir découvrit enfin où se dirigeaient les principales forces de l'armée russe et envoya des renforts aux pachas Abdurahman et Yusuf agissant contre eux ; mais il était déjà trop tard : les Russes avançaient de manière incontrôlable ; Le 13 juillet, ils occupèrent la ville d'Aidos, le 14 Karnabat, et le 31, Dibich attaqua les 20 000 corps turcs concentrés près de la ville de Slivno, les vainquit et interrompit la communication entre Shumla et Andrinople.
Bien que le commandant en chef n'en ait plus que 25 000 sous la main, mais compte tenu de l'attitude amicale de la population locale et de la démoralisation complète des troupes turques, il décide de s'installer à Andrinople, espérant par son apparition même dans la deuxième capitale de l'Empire ottoman pour contraindre le sultan à la paix.
Après des marches intensives, l'armée russe s'approcha d'Andrinople le 7 août, et la surprise de son arrivée embarrassa tellement le commandant de la garnison qu'il proposa de se rendre. Le lendemain, une partie des troupes russes fut amenée dans la ville, où d'importantes réserves d'armes et d'autres objets furent trouvées.
L’occupation d’Andrinople et d’Erzeroum, le blocus strict des détroits et les troubles internes en Turquie ont finalement ébranlé l’entêtement du sultan ; Des commissaires sont arrivés à l'appartement principal de Diebitsch pour négocier la paix. Cependant, ces négociations furent délibérément retardées par les Turcs, comptant sur l'aide de l'Angleterre et de l'Autriche ; et cependant l'armée russe fondait de plus en plus, et le danger la menaçait de toutes parts. La difficulté de la situation s'est encore accrue lorsque le Scutari Pacha Mustafa, qui avait jusqu'alors évité de participer aux hostilités, a conduit désormais une armée albanaise forte de 40 000 hommes sur le théâtre de la guerre.
À la mi-août, il occupa Sofia et fit avancer l'avant-garde jusqu'à Philippopolis. Diebitsch, cependant, n'était pas gêné par la difficulté de sa position : il annonça aux commissaires turcs qu'il leur donnait jusqu'au 1er septembre pour recevoir les instructions définitives, et si après cela la paix n'était pas conclue, alors les hostilités de notre part reprendraient. Pour renforcer ces revendications, plusieurs détachements furent envoyés à Constantinople et des contacts furent établis entre eux et les escadrons de Greig et Heyden.
Un ordre fut envoyé à l'adjudant général Kisselyov, qui commandait les troupes russes dans les principautés : laisser une partie de ses forces garder la Valachie, traverser le Danube avec le reste et se déplacer contre Mustafa. L'avancée des troupes russes vers Constantinople eut son effet : le sultan alarmé supplia l'envoyé prussien de se rendre par intermédiaire à Diebitsch. Ses arguments, appuyés par des lettres d'autres ambassadeurs, ont incité le commandant en chef à arrêter le mouvement des troupes vers la capitale turque. Alors les représentants de la Porte acceptèrent toutes les conditions qui leur étaient proposées et le 2 septembre la paix d'Andrinople fut signée.
Malgré cela, Mustafa de Scutaria poursuit son offensive et, début septembre, son avant-garde s'approche de Haskioy et de là se dirige vers Demotika. Le 7e corps fut envoyé à sa rencontre. Pendant ce temps, l'adjudant général Kiselev, après avoir traversé le Danube à Rakhov, se rendit à Gabrov pour agir sur le flanc des Albanais, et le détachement de Geismar fut envoyé par Orhanie pour menacer leurs arrières. Après avoir vaincu le détachement secondaire des Albanais, Geismar occupa Sofia à la mi-septembre et Mustafa, ayant appris cela, retourna à Philippopolis. Il y resta une partie de l'hiver, mais après la dévastation complète de la ville et de ses environs, il retourna en Albanie. Les détachements de Kiselev et de Geismar se retirèrent déjà fin septembre à Vratsa et début novembre les dernières troupes de l'armée principale russe partirent d'Andrinople.
4.2. En Asie
Sur le théâtre de guerre asiatique, la campagne de 1829 s'ouvrit dans des conditions difficiles : les habitants des zones occupées étaient à chaque minute prêts à se révolter ; déjà à la fin du mois de février, un fort corps turc assiégea Akhaltsikhé et le pacha de Trébizonde avec un détachement de huit mille hommes se dirigea vers Guria pour faciliter le soulèvement qui y éclata. Les détachements envoyés par Paskevich réussirent cependant à chasser les Turcs d'Akhaltsikhé et de Guria.
Mais à la mi-mai, l'ennemi entreprit des actions offensives à une échelle plus étendue : l'Erzurum seraskir Haji-Saleh, après avoir rassemblé jusqu'à 70 000 personnes, décida de se rendre à Kars ; Le Pacha de Trébizonde avec 30 000 personnes était censé envahir à nouveau Guria et le Pacha de Van devait prendre Bayazet. Paskevich, averti, décida d'avertir l'ennemi. Rassemblant environ 18 000 personnes avec 70 canons, il traversa la chaîne de montagnes Saganlug, remporta les 19 et 20 juin des victoires sur les troupes de Hakki Pacha et Haji Saleh dans les régions de Kainly et Millidyut, puis s'approcha d'Erzurum, qui se rendit le 27 juin. Au même moment, le pacha de Van, après 2 jours d'attaques désespérées sur Bayazet, est repoussé, bat en retraite et ses hordes se dispersent. Les actions du Pacha de Trébizonde furent également infructueuses ; Les troupes russes étaient déjà en route vers Trébizonde et s'emparèrent de la forteresse de Bayburt.
5. Les épisodes les plus marquants de la guerre
· Exploit du brick "Mercure"
· Transition des cosaques transdanubiens sur le côté Empire russe
6. Héros de guerre
· Alexander Kazarsky - capitaine du brick "Mercure"
7. Résultats de la guerre
· La majeure partie de la côte orientale de la mer Noire (y compris les villes d'Anapa, Sudzhuk-Kale, Soukhoum) et le delta du Danube sont passés sous la domination de la Russie.
· L'Empire Ottoman a reconnu la suprématie russe sur la Géorgie et certaines parties de l'Arménie moderne.
· La Turquie a réaffirmé ses obligations en vertu de la Convention d'Akkerman de 1826 de respecter l'autonomie de la Serbie.
· La Moldavie et la Valachie ont obtenu leur autonomie et les troupes russes sont restées dans les principautés du Danube pendant les réformes.
· La Turquie a également accepté les termes du Traité de Londres de 1827 accordant l'autonomie à la Grèce.
· La Turquie a été obligée de verser à la Russie une indemnité d'un montant de 1,5 million de chervonets néerlandais dans un délai de 18 mois.
Bibliographie:
1. Urlanis B. Ts. Guerres et population de l'Europe. - Moscou., 1960.
2. La population est indiquée dans les limites de l'année d'enregistrement correspondante (Russie : Dictionnaire encyclopédique. L., 1991).
3. Parmi eux, 80 000 - armée régulière, 100 000 - cavalerie et 100 000 - cipayes ou cavaliers vassaux
Le conflit militaire entre les empires russe et ottoman en 1828 est né du fait qu'après la bataille de Navarin en octobre 1827, la Porte (le gouvernement de l'Empire ottoman) a fermé le détroit du Bosphore, violant ainsi la Convention d'Ackerman. La Convention d'Akkerman est un accord entre la Russie et la Turquie, conclu le 7 octobre 1826 à Akkerman (aujourd'hui ville de Belgorod-Dnestrovsky). La Turquie a reconnu la frontière le long du Danube et la transition vers la Russie de Soukhoum, Redut-Kale et Anakria (Géorgie). Elle s'est engagée à payer toutes les créances des citoyens russes dans un délai d'un an et demi, à accorder aux citoyens russes le droit de commercer sans entrave dans toute la Turquie et aux navires marchands russes le droit de naviguer librement dans les eaux turques et le long du Danube. L'autonomie des principautés du Danube et de la Serbie était garantie ; les dirigeants de la Moldavie et de la Valachie devaient être nommés parmi les boyards locaux et ne pouvaient être démis de leurs fonctions sans le consentement de la Russie.
Mais si l'on considère ce conflit dans un contexte plus large, il faut dire que cette guerre a été provoquée par le fait que le peuple grec a commencé à se battre pour son indépendance de l'Empire ottoman (en 1821), et que la France et l'Angleterre ont commencé à aider le Les Grecs. La Russie poursuivait à cette époque une politique de non-intervention, même si elle faisait partie d'une alliance avec la France et l'Angleterre. Après la mort d'Alexandre Ier et l'accession au trône de Nicolas Ier, la Russie a changé son attitude envers le problème grec, mais en même temps, des désaccords ont commencé entre la France, l'Angleterre et la Russie sur la question de la division de l'Empire ottoman (division de l'Empire ottoman). peau d'un ours non tué). Porta a immédiatement annoncé qu'elle était libre de tout accord avec la Russie. Il était interdit aux navires russes d'entrer dans le Bosphore et la Turquie avait l'intention de transférer la guerre avec la Russie en Perse.
La Porte déplace sa capitale à Andrinople et renforce les forteresses du Danube. Nicolas Ier déclara alors la guerre à la Porte, et elle déclara la guerre à la Russie.
La guerre russo-turque de 1828-1829 était un conflit militaire entre les empires russe et ottoman qui débuta en avril 1828 en raison du fait que la Porte ferma le détroit du Bosphore après la bataille de Navarin (octobre 1827), en violation de la Convention Ackerman. Dans un contexte plus large, cette guerre était une conséquence de la lutte entre les grandes puissances provoquée par la guerre d'indépendance grecque (1821-1830) contre l'Empire ottoman. Pendant la guerre, les troupes russes ont mené une série de campagnes en Bulgarie, dans le Caucase et dans le nord-est de l'Anatolie, après quoi la Porte a demandé la paix sur la majeure partie de la côte orientale de la mer Noire (y compris les villes d'Anapa, Sudzhuk-Kale, Soukhoum). et le delta du Danube passa à la Russie.
L'Empire ottoman a reconnu la suprématie russe sur la Géorgie et certaines parties de l'Arménie moderne.
Le 14 septembre 1829, la paix d'Andrinople fut signée entre les deux parties, à la suite de laquelle la majeure partie de la côte orientale de la mer Noire (y compris les villes d'Anapa, Sudzhuk-Kale, Soukhoum) et le delta du Danube passèrent à Russie.
L'Empire ottoman a reconnu le transfert à la Russie de la Géorgie, de l'Iméréthie, de la Mingrélie, de la Gourie, ainsi que des khanats d'Erivan et du Nakhitchevan (transférés par l'Iran dans le cadre de la paix de Turkmanchay).
La Turquie a réaffirmé ses obligations en vertu de la Convention d'Akkerman de 1826 de respecter l'autonomie de la Serbie.
La Moldavie et la Valachie obtinrent leur autonomie et les troupes russes restèrent dans les principautés du Danube pendant les réformes.
La Turquie a également accepté les termes du Traité de Londres de 1827 accordant l'autonomie à la Grèce.
La Turquie a été obligée de verser à la Russie une indemnité d'un montant de 1,5 million de chervonets néerlandais dans un délai de 18 mois.
|
Empire ottoman Empire ottoman |
Empire russe Empire russe
|
Guerre russo-turque de 1828-1829- un conflit militaire entre les empires russe et ottoman, qui débuta en avril 1828 du fait que la Porte ferma le détroit du Bosphore après la bataille de Navarin (octobre 1827) en violation de la Convention Ackerman.
Dans un contexte plus large, cette guerre était une conséquence de la lutte entre les grandes puissances provoquée par la guerre d'indépendance grecque (-) de l'Empire ottoman. Pendant la guerre, les troupes russes ont mené une série de campagnes en Bulgarie, dans le Caucase et dans le nord-est de l'Anatolie, après quoi la Porte a demandé la paix.
YouTube encyclopédique
1 / 5
✪ Politique étrangère de Nicolas Ier en 1826 - 1849. Continuation. Leçon vidéo sur l'histoire de la Russie, 8e année
✪ Guerre russo-turque 1828-1829, première partie
✪ Guerre russo-turque. Résultats. Leçon vidéo sur l'histoire de la Russie, 8e année
✪ Guerre russo-persane 1826-1828, deuxième partie.
✪ Guerres russo-turques (racontées par Andrey Svetenko et Armen Gasparyan)
Les sous-titres
Contexte et raison
Ils se sont heurtés à l'opposition des armées turques totalisant jusqu'à 200 000 personnes. (150 000 sur le Danube et 50 000 dans le Caucase) ; De la flotte, seuls 10 navires stationnés dans le Bosphore ont survécu.
La Bessarabie a été choisie comme base des actions de Wittgenstein ; les principautés (gravement épuisées par la domination turque et la sécheresse de 1827) étaient censées être occupées uniquement pour y rétablir l'ordre et les protéger de l'invasion ennemie, ainsi que pour protéger l'aile droite de l'armée en cas d'intervention autrichienne. Wittgenstein, après avoir traversé le Bas-Danube, était censé se déplacer vers Varna et Shumla, traverser les Balkans et avancer jusqu'à Constantinople ; un détachement spécial était censé débarquer à Anapa et, une fois capturé, rejoindre les forces principales.
Le 25 avril, le 6e corps d'infanterie entre dans les principautés, et son avant-garde sous le commandement du général Fedor Geismar se dirige vers la Petite Valachie ; Le 1er mai, le 7e corps d'infanterie assiège la forteresse de Brailov ; Le 3e corps d'infanterie était censé traverser le Danube entre Izmail et Reni, près du village de Satunov, mais la construction d'une route traversant une plaine inondée d'eau a nécessité environ un mois, pendant lequel les Turcs ont renforcé la rive droite en face du point de passage, plaçant jusqu'à 10 000 personnes dans leur position.
Dans la matinée du 27 mai, la traversée des troupes russes sur des navires et bateaux a commencé en présence du souverain. Malgré les tirs violents, ils atteignirent la rive droite et lorsque les tranchées turques avancées furent prises, l'ennemi s'enfuit du reste. Le 30 mai, la forteresse d'Isakcha se rend. Après avoir séparé les détachements pour assiéger Machin, Girsov et Tulcha, les principales forces du 3e corps atteignirent Karasu le 6 juin et leur avant-garde sous le commandement du général Fedor Ridiger assiégea Kyustendzhi.
Le siège de Brailov avança rapidement et le chef des troupes de siège, le grand-duc Mikhaïl Pavlovitch, s'empressant d'en finir avec cette affaire pour que le 7e corps puisse rejoindre le 3e, décida de prendre d'assaut la forteresse le 3 juin ; l'assaut fut repoussé, mais lorsque la reddition de Machin suivit 3 jours plus tard, le commandant Brailov, se voyant isolé et ayant perdu tout espoir d'aide, se rendit également (7 juin).
Au même moment, une expédition maritime vers Anapa a lieu. À Karasu, le 3e corps est resté 17 jours entiers, car après l'attribution des garnisons aux forteresses occupées, ainsi que d'autres détachements, il n'en restait plus que 20 000. Ce n'est qu'avec l'ajout de quelques unités du 7e corps et l'arrivée du 4e corps de cavalerie de réserve que les forces principales de l'armée atteindraient 60 000 ; mais même cela ne fut pas jugé suffisant pour une action décisive, et au début de juin, le 2e corps d'infanterie (environ 30 000 hommes) reçut l'ordre de se déplacer de la Petite Russie vers le Danube ; en outre, des régiments de gardes (jusqu'à 25 000) étaient déjà en route vers le théâtre de la guerre.
Après la chute de Braïlov, le 7e corps fut envoyé rejoindre le 3e ; Le général Roth, avec deux brigades d'infanterie et une de cavalerie, reçut l'ordre d'assiéger la Silistrie, et le général Borozdin, avec six régiments d'infanterie et quatre régiments de cavalerie, reçut l'ordre de garder la Valachie. Avant même que tous ces ordres ne soient exécutés, le 3e corps s'est déplacé vers Bazardjik, où, selon les informations reçues, d'importantes forces turques se rassemblaient.
Entre le 24 et le 26 juin, Bazardjik fut occupé, après quoi deux avant-gardes furent avancées : Ridiger - vers Kozludzha et le lieutenant-général comte Pavel Sukhtelen - vers Varna, auquel fut également envoyé un détachement du lieutenant-général Alexandre Ouchakov de Tulcha. Début juillet, le 7e corps rejoint le 3e corps ; mais leurs forces combinées ne dépassaient pas 40 mille ; il était encore impossible de compter sur le concours de la flotte stationnée à Anapa ; Les parcs de siège étaient en partie situés près de la forteresse nommée et en partie s'étendaient depuis Brailov.
Pendant ce temps, les garnisons de Shumla et de Varna se renforcèrent progressivement ; L'avant-garde de Riediger était constamment harcelée par les Turcs, qui tentaient d'interrompre ses communications avec les forces principales. Compte tenu de l'état des choses, Wittgenstein a décidé de se limiter à une observation concernant Varna (pour laquelle le détachement d'Ouchakov a été nommé), avec les principales forces pour se déplacer vers Shumla, tenter d'attirer le seraskir du camp fortifié et, après l'avoir vaincu, tourner au siège de Varna.
Le 8 juillet, les forces principales se sont approchées de Shumla et l'ont assiégée du côté est, renforçant fortement leurs positions afin d'interrompre la possibilité de communication avec Varna. Une action décisive contre Shumla devait être reportée jusqu'à l'arrivée des gardes. Cependant, les principales forces de l'armée russe se retrouvèrent bientôt dans une sorte de blocus, puisque sur leurs arrières et sur les flancs l'ennemi développait des actions partisanes, ce qui gênait grandement l'arrivée des transports et le ravitaillement. Pendant ce temps, le détachement d’Ouchakov ne pouvait pas non plus résister à la garnison supérieure de Varna et se retira à Derventkoy.
À la mi-juillet, la flotte russe est arrivée de près d'Anapa à Kovarna et, après avoir débarqué des troupes à bord des navires, s'est dirigée vers Varna, contre laquelle elle s'est arrêtée. Le chef des forces de débarquement, le prince Alexandre Menchikov, ayant rejoint le détachement d'Ouchakov, s'est également approché le 22 juillet de ladite forteresse, l'a assiégée par le nord et, le 6 août, a commencé les travaux de siège. Le détachement du général Roth stationné à Silistrie ne pouvait rien faire en raison d'effectifs insuffisants et du manque d'artillerie de siège. Les choses n'ont pas non plus progressé près de Shumla, et bien que les attaques turques lancées les 14 et 25 août aient été repoussées, cela n'a donné aucun résultat. Le comte Wittgenstein voulait se retirer à Yeni Bazar, mais l'empereur Nicolas Ier, qui était avec l'armée, s'y opposa.
D'une manière générale, fin août, les circonstances sur le théâtre de guerre européen étaient très défavorables aux Russes : le siège de Varna, en raison de la faiblesse de ses forces, ne promettait pas de succès ; Les maladies faisaient rage parmi les troupes stationnées près de Shumla et les chevaux mouraient en masse par manque de nourriture ; Pendant ce temps, l'activité des partisans turcs augmentait.
Au même moment, à l'arrivée de nouveaux renforts à Shumla, les Turcs attaquent la ville de Pravody, occupée par un détachement de l'adjudant général Benckendorf, mais ils sont repoussés. Le général Loggin Roth tient à peine sa position en Silistrie, dont la garnison reçoit également des renforts. Le général Kornilov, observant Zhurja, dut repousser les attaques de là et de Rushchuk, où les forces ennemies s'étaient également accrues. Le faible détachement du général Geismar (environ 6 000 hommes), bien qu'il ait tenu sa position entre Calafat et Craiova, n'a pas pu empêcher les troupes turques d'envahir la partie nord-ouest de la Petite Valachie.
L'ennemi, ayant concentré plus de 25 000 personnes près de Vidin et Kalafat, renforça les garnisons de Rakhov et Nikopol. Ainsi, les Turcs avaient partout un avantage en termes de forces, mais, heureusement, n'en ont pas profité. Pendant ce temps, à la mi-août, le Corps des Gardes commença à s'approcher du Bas-Danube, suivi par la 2e infanterie. Ce dernier reçut l'ordre de relever le détachement de Roth en Silistrie, qui serait alors attiré près de Shumla ; Le garde est envoyé à Varna. Pour récupérer cette forteresse, 30 000 corps turcs d'Omer-Vrione sont arrivés de la rivière Kamchik. Plusieurs attaques inefficaces suivirent des deux côtés et lorsque Varna se rendit le 29 septembre, Omer entama une retraite précipitée, poursuivi par un détachement du prince Eugène de Wurtemberg, et se dirigea vers Aidos, où les troupes du vizir s'étaient retirées plus tôt.
Pendant ce temps, gr. Wittgenstein a continué à se tenir sous Shumla ; Ses troupes, après avoir alloué des renforts à Varna et à d'autres détachements, ne restèrent qu'environ 15 000 ; mais le 20 septembre, le 6e corps s'en approcha. La Silistrie continue de tenir le coup, car le 2e corps, faute d'artillerie de siège, ne peut pas prendre d'action décisive.
Pendant ce temps, les Turcs continuaient de menacer la Petite Valachie ; mais la brillante victoire remportée par Geismar près du village de Boelesti met fin à leurs tentatives. Après la chute de Varna, l'objectif final de la campagne de 1828 était la conquête de la Silistrie et le 3e corps y fut envoyé. Le reste des troupes situées près de Shumla dut hiverner dans la partie occupée du pays ; le garde est retourné en Russie. Cependant, l'entreprise contre la Silistrie en raison du manque d'obus dans l'artillerie de siège ne s'est pas concrétisée et la forteresse n'a été soumise à un bombardement que pendant 2 jours.
Après la retraite des troupes russes de Shumla, le vizir décide de reprendre possession de Varna et s'installe le 8 novembre à Pravody, mais, rencontrant la résistance du détachement occupant la ville, il retourne à Shumla. En janvier 1829, un fort détachement turc attaqua l'arrière du 6e corps, captura Kozludzha et attaqua Bazardzhik, mais échoua ; et après cela, les troupes russes chassèrent l'ennemi de Kozludzha ; le même mois, la forteresse de Turno fut prise. Le reste de l’hiver s’est déroulé tranquillement.
En Transcaucasie
Le Corps caucasien séparé a commencé ses opérations un peu plus tard ; il reçut l'ordre d'envahir la Turquie asiatique.
En Turquie asiatique en 1828, les choses se passent bien pour la Russie : le 23 juin, après trois jours de siège, Kars est prise, une forteresse de premier ordre en forme de polygone irrégulier, entourée d'une haute double muraille. Les troupes russes ont capturé plusieurs dizaines de canons. Et après une suspension temporaire des hostilités en raison de l'apparition de la peste, Paskevich conquit la forteresse d'Akhalkalaki le 23 juillet et s'approcha début août d'Akhaltsikhé, qui se rendit le 16 du même mois. Puis les forteresses d'Atskhur et d'Ardahan se rendirent sans résistance. Au même moment, des détachements russes distincts prirent Poti et Bayazet, et un détachement de volontaires arméniens opérant au sein de l'armée russe libéra Diadin.
Actions militaires en 1829
Durant l’hiver, les deux camps se sont activement préparés à la reprise des hostilités. À la fin du mois d'avril 1829, la Porte réussit à porter ses forces sur le théâtre de guerre européen à 150 000 et pouvait en outre compter sur les 40 000 miliciens albanais rassemblés par le Scutari Pacha Mustafa. Les Russes ne pouvaient s'opposer à ces forces qu'avec 100 000 personnes maximum. En Asie, les Turcs disposaient de 100 000 soldats contre 20 000 Paskevich. Seule la flotte russe de la mer Noire (environ 60 navires de différents rangs) avait une supériorité décisive sur la flotte turque ; Oui, l’escadre du comte Heyden (35 navires) a également navigué dans l’archipel (mer Égée).
Au théâtre européen
Nommé commandant en chef à la place de Wittgenstein, le comte Diebitsch s'emploie activement à reconstituer l'armée et à organiser sa partie économique. Parti pour traverser les Balkans afin de ravitailler les troupes de l'autre côté des montagnes, il se tourna vers le secours de la flotte et demanda à l'amiral Greig de prendre possession de tout port propice à l'acheminement des ravitaillements. Le choix s'est porté sur Sizopol qui, après sa capture, a été occupée par une garnison russe forte de 3 000 hommes. La tentative faite par les Turcs à la fin du mois de mars pour reprendre cette ville échoua et ils se limitèrent alors à la bloquer de la route sèche. Quant à la flotte ottomane, elle a quitté le Bosphore début mai, mais elle est restée plus près de ses côtes ; au même moment, deux navires militaires russes en furent accidentellement encerclés ; l'un d'eux (la frégate « Raphaël » de 36 canons) se rendit, et l'autre, le brick « Mercure » sous le commandement de Kazarsky, réussit à repousser les navires ennemis qui le poursuivaient et à s'échapper.
Fin mai, les escadres de Greig et Heyden commencèrent à bloquer les détroits et interrompirent tout approvisionnement par mer vers Constantinople. Pendant ce temps, Dibich, afin d'assurer ses arrières avant le mouvement vers les Balkans, décida d'abord de prendre possession de la Silistrie ; mais l'arrivée tardive du printemps le retarda, de sorte que ce n'est qu'à la fin du mois d'avril qu'il put traverser le Danube avec les forces nécessaires à cet effet. Le 7 mai, les travaux de siège ont commencé et le 9 mai, de nouvelles troupes ont traversé la rive droite, portant les forces du corps de siège à 30 000 personnes.
À peu près au même moment, le vizir Reshid Pacha ouvre des opérations offensives dans le but de ramener Varna ; cependant, après des combats acharnés avec les unités du général Roth près d'Eski-Arnautlar (aujourd'hui le village de Staroselets) et de Pravod (Provadiya), les Turcs se retirèrent de nouveau à Shumla (Shumen). À la mi-mai, le vizir et ses forces principales se dirigent à nouveau vers Varna. Ayant reçu cette nouvelle, Dibich, laissant une partie de ses troupes en Silistrie, se rendit avec l'autre derrière le vizir. Cette manœuvre aboutit à la défaite (30 mai) de l'armée ottomane près du village de Kulevchi.
Même si, après une victoire aussi décisive, on pouvait compter sur la capture de Shumla, il était préférable de se limiter à son simple observation. Pendant ce temps, le siège de Silistrie réussit et le 18 juin, cette forteresse se rendit. Suite à cela, le 3e corps fut envoyé à Shumla, le reste des troupes russes destinées à la campagne transbalkanique commença à converger secrètement vers Devno et Pravody.
Pendant ce temps, le vizir, convaincu que Diebitsch assiégerait Shumla, y rassemblait des troupes partout où cela était possible - même depuis les cols des Balkans et depuis les points côtiers de la mer Noire. L'armée russe, quant à elle, avançait vers Kamchik (aujourd'hui la rivière Kamchia) et après une série de batailles sur cette rivière et lors de nouveaux mouvements dans les montagnes des 6e et 7e corps, vers la mi-juillet, elle traversa la crête des Balkans. , capturant en chemin deux forteresses, Messemvria et Ahiolo, et l'important port de Bourgas.
Ce succès a cependant été éclipsé par le fort développement de maladies, dont les troupes étaient sensiblement en train de fondre. Le vizir découvrit enfin où se dirigeaient les principales forces de l'armée russe et envoya des renforts aux pachas Abdurahman et Yusuf agissant contre eux ; mais il était déjà trop tard : les Russes avançaient de manière incontrôlable ; Le 13 juillet, ils occupent la ville d'Aytos, le 14, Karnabat, et le 31, Dibich attaque les 20 000 corps turcs concentrés près de la ville de Slivno, les bat et interrompt la communication entre Shumla et Andrinople.
Bien que le commandant en chef n'en ait plus que 25 000 sous la main, mais compte tenu de l'attitude amicale de la population locale et de la démoralisation complète des troupes turques, il décide de s'installer à Andrinople, espérant par son apparition même dans la deuxième capitale de l'Empire ottoman pour contraindre le sultan à la paix.
Après des marches intensives, l'armée russe s'approcha d'Andrinople le 7 août, et la surprise de son arrivée embarrassa tellement le commandant de la garnison qu'il proposa de se rendre. Le lendemain, une partie des troupes russes fut amenée dans la ville, où d'importantes réserves d'armes et d'autres objets furent trouvées.
L’occupation d’Andrinople et d’Erzeroum, le blocus strict des détroits et les troubles internes en Turquie ont finalement ébranlé l’entêtement du sultan ; Des commissaires sont arrivés à l'appartement principal de Diebitsch pour négocier la paix. Cependant, ces négociations furent délibérément retardées par les Turcs, comptant sur l'aide de l'Angleterre et de l'Autriche ; et cependant l'armée russe fondait de plus en plus, et le danger la menaçait de toutes parts. La difficulté de la situation s'est encore accrue lorsque le Scutari Pacha Mustafa, qui avait jusqu'alors évité de participer aux hostilités, a conduit désormais une armée albanaise forte de 40 000 hommes sur le théâtre de la guerre.
À la mi-août, il occupa Sofia et fit avancer l'avant-garde jusqu'à Philippopolis. Diebitsch n'est cependant pas gêné par la difficulté de sa position : il annonce aux commissaires turcs qu'il leur donne jusqu'au 1er septembre pour recevoir les instructions définitives, et si après cela la paix n'est pas conclue, les hostilités reprendront du côté russe. . Pour renforcer ces revendications, plusieurs détachements furent envoyés à Constantinople et des contacts furent établis entre eux et les escadrons de Greig et Heyden.
Un ordre fut envoyé à l'adjudant général Kisselyov, qui commandait les troupes russes dans les principautés : laisser une partie de ses forces garder la Valachie, traverser le Danube avec le reste et se déplacer contre Mustafa. L'avancée des troupes russes vers Constantinople eut son effet : le sultan alarmé supplia l'envoyé prussien de se rendre par intermédiaire à Diebitsch. Ses arguments, appuyés par des lettres d'autres ambassadeurs, ont incité le commandant en chef à arrêter le mouvement des troupes vers la capitale turque. Alors les commissaires de la Porte acceptèrent toutes les conditions qui leur étaient proposées, et le 2 septembre la paix d'Andrinople fut signée.
Malgré cela, Mustafa de Scutaria poursuit son offensive et, début septembre, son avant-garde s'approche de Haskioy et de là se dirige vers Demotika. Le 7e corps fut envoyé à sa rencontre. Pendant ce temps, l'adjudant général Kiselev, après avoir traversé le Danube à Rakhov, se rendit à Gabrov pour agir sur le flanc des Albanais, et le détachement de Geismar fut envoyé par Orhaniye pour menacer leurs arrières. Après avoir vaincu le détachement secondaire des Albanais, Geismar occupa Sofia à la mi-septembre et Mustafa, ayant appris cela, retourna à Philippopolis. Il y resta une partie de l'hiver, mais après la dévastation complète de la ville et de ses environs, il retourna en Albanie. Les détachements de Kiselev et de Geismar se retirèrent déjà fin septembre à Vratsa et début novembre les dernières troupes de l'armée principale russe partirent d'Andrinople.
En Asie
Sur le théâtre de guerre asiatique, la campagne de 1829 s'ouvrit dans des conditions difficiles : les habitants des zones occupées étaient à chaque minute prêts à se révolter ; déjà à la fin du mois de février, un fort corps turc assiégea Akhaltsikhé et le pacha de Trébizonde avec un détachement de huit mille hommes se dirigea vers Guria pour faciliter le soulèvement qui y éclata. Les détachements envoyés par Paskevich réussirent cependant à chasser les Turcs d'Akhaltsikhé et de Guria.
Mais à la mi-mai, l'ennemi entreprit des actions offensives à une échelle plus étendue : l'Erzurum seraskir Haji-Saleh, après avoir rassemblé jusqu'à 70 000 personnes, décida de se rendre à Kars ; Le Pacha de Trébizonde avec 30 000 personnes était censé envahir à nouveau Guria et le Pacha de Van devait prendre Bayazet. Paskevich, averti, décida d'avertir l'ennemi. Rassemblant environ 18 000 personnes avec 70 canons, il traversa la chaîne de montagnes Saganlug, remporta les 19 et 20 juin des victoires sur les troupes de Hakki Pacha et Haji Saleh dans les régions de Kainly et Millidyut, puis s'approcha d'Erzurum, qui se rendit le 27 juin. Au même moment, le pacha de Van, après des attaques désespérées sur Bayazet les 20 et 21 juin, est repoussé, bat en retraite et ses hordes se dispersent. Les actions du Pacha de Trébizonde furent également infructueuses ; Les troupes russes étaient déjà en route vers Trébizonde et s'emparèrent de la forteresse de Bayburt.
La position de l'Autriche
Avant le début de la guerre, les troupes autrichiennes, sous prétexte de manœuvres, étaient concentrées en Transylvanie. Le commandement russe craignait que ces manœuvres n'aboutissent à une invasion de la Valachie. Par conséquent, pour assurer l'arrière de l'armée russe du Danube, il était nécessaire de former une armée d'observation dans le Royaume de Pologne sous le commandement du grand-duc Konstantin Pavlovich, composée de troupes polonaises, de 2 corps d'armée d'infanterie, d'infanterie de garde, de 2 combinés et 2 corps de cavalerie de réserve.
Cependant, la Prusse et la France refusèrent catégoriquement de soutenir l’Autriche. Le roi de France Charles X déclara à son ambassadeur à Londres, le prince J.-O.-A.-M. de Polignac, qu'il déclarerait la guerre à l'Autriche si elle attaquait la Russie.
Après le Congrès de Vienne (1814-1815), la Russie revint à la résolution de la « question balkanique », qui n’avait pas perdu de son actualité à la suite de la guerre russo-turque de 1806-1813. Voyant la faiblesse de son adversaire, Alexandre Ier avance même l'idée d'accorder l'indépendance à la Serbie orthodoxe. Les Turcs, comptant sur l'aide de l'Angleterre et de l'Autriche, font preuve d'intransigeance et exigent que Soukhoum et plusieurs autres forteresses du Caucase leur soient restituées.
En 1821, un soulèvement de libération nationale éclate en Grèce, qui est brutalement réprimé par les autorités turques. La Russie a fortement préconisé la fin de la violence contre les chrétiens et a lancé un appel aux pays européens en leur proposant d'exercer une pression commune sur l'Empire ottoman. Cependant, les États européens, craignant une forte augmentation de l’influence russe dans les Balkans, ne se sont pas montrés très intéressés par le sort des Grecs.
En 1824, Alexandre Ier prit l'initiative d'accorder l'autonomie à la Grèce, mais reçut un refus décisif. De plus, les Türkiye ont débarqué un important corps punitif en Grèce.
Nicolas Ier a poursuivi la politique de son frère aîné. En 1826, la Russie s'est prononcée en faveur de la création d'une coalition anti-turque d'États européens. Il envisageait d’attirer à ses côtés la Grande-Bretagne et la France. Le roi a envoyé un ultimatum au sultan turc Mahmud II, dans lequel il a exigé le rétablissement complet de l'autonomie de la Serbie et des principautés du Danube. Nicolas II en a informé l'envoyé britannique, le duc A.W. Wellington (vainqueur à Waterloo) et a déclaré que désormais, si l'Angleterre ne le soutient pas, il affrontera seule la Turquie. Bien entendu, la Grande-Bretagne ne pouvait pas permettre que des questions aussi importantes soient résolues sans sa participation. Bientôt, la France rejoignit également la coalition. Il convient de noter que la création d'une alliance russo-anglais-française, destinée à soutenir les Grecs « rebelles » dans leur lutte contre le « pouvoir légitime » du sultan turc, a porté un coup sérieux aux principes légitimistes de la sainte alliance. .
Le 25 septembre 1826, la Turquie accepta les termes de l'ultimatum de Nicolas Ier et signa à Akkerman une convention qui confirmait l'autonomie des principautés du Danube et de la Serbie, et reconnaissait également le droit de la Russie de patronner les peuples slaves et serbes. peuples orthodoxes Péninsule des Balkans. Toutefois, sur la question grecque, Mahmud II ne veut pas reculer. En avril 1827, l'Assemblée nationale grecque élit par contumace le diplomate russe I. Kapodistrias comme chef de l'État, qui se tourna immédiatement vers Nicolas Ier pour obtenir de l'aide.
Le 20 octobre 1827, l'escadre anglo-franco-russe sous le commandement de l'amiral britannique E. Codrington bat la flotte turque dans le port de Navarin. Le croiseur russe Azov, dont le capitaine était M.P., s'est battu avec un courage particulièrement courageux. Lazarev et ses assistants P.S. Nakhimov, V.I. Istomin et V.A. Kornilov - futurs héros de la guerre de Crimée.
Après cette victoire, la Grande-Bretagne et la France ont annoncé qu'elles refusaient toute nouvelle action militaire contre la Turquie. De plus, les diplomates britanniques ont poussé Mahmud II à intensifier le conflit avec la Russie.
Le 14 avril 1828, Nicolas Ier déclare la guerre à l'Empire ottoman. Il y avait deux fronts : balkanique et caucasien. Sur Péninsule des Balkans Armée russe forte de 100 000 hommes sous le commandement de P.Kh. Wittgenstein occupa les principautés du Danube (Moldavie, Valachie et Dobroudja). Après cela, les Russes ont commencé à préparer une attaque contre Varna et Shumla. Le nombre de garnisons turques de ces forteresses dépassait largement le nombre de troupes russes qui les assiégeaient. Le siège de Shumla échoua. Varna fut prise fin septembre 1828, après un long siège. L'opération militaire a été retardée. Dans le Caucase, le corps du général I.F. Paskevich a bloqué Anapa, puis s'est déplacé vers la forteresse de Kars. Au cours de l'été, il réussit à reprendre Ardahan, Bayazet et Poti aux Turcs. Au début de la campagne de 1829, les relations de la Russie avec l'Angleterre et l'Autriche s'étaient considérablement détériorées. Le danger de leur intervention dans la guerre aux côtés de la Turquie s’est accru. Il fallait accélérer la fin de la guerre. En 1829, le commandement de l'armée balkanique fut confié au général I.I. Dibich. Il a intensifié ses actions offensives. Dans la bataille près du village. Kulevcha (mai 1829) Dibic bat une armée turque forte de 40 000 hommes et, en juin, s'empare de la forteresse de Silistrie, après quoi il traverse les montagnes des Balkans et s'empare d'Andrinople. Au même moment, Paskevich occupait Erzurum.
20 août 1829 au général I.I. Des représentants turcs sont arrivés à Diebitsch avec une proposition de négociations de paix. Le 2 septembre, le traité d'Andrinople est signé. Selon ses termes, la Russie a acquis une partie du delta du Danube et de l'Arménie orientale, et la côte de la mer Noire, depuis l'embouchure du Kouban jusqu'à la ville de Poti, lui est également passée. La liberté de navigation commerciale à travers le Bosphore et les Dardanelles en temps de paix a été établie. La Grèce a obtenu une pleine autonomie et est devenue un État indépendant en 1830. L'autonomie de la Serbie, de la Valachie et de la Moldavie a été confirmée. Türkiye s'est engagé à payer une indemnité (30 millions en or). Les tentatives de l'Angleterre d'assouplir les termes de la paix d'Andrinople furent rejetées de manière décisive.
La guerre a accru le prestige de la Russie dans les Balkans. En 1833, Nicolas Ier a aidé l’Empire ottoman dans la lutte contre le dirigeant rebelle de l’Égypte, Muhammad Ali. En juin de cette année, le commandant des troupes russes, A.F. Orlov, au nom de l'Empire russe, a signé un accord amical avec le sultan (pour une durée de 8 ans), entré dans l'histoire sous le nom de traité Unkyar-Iskelesi. La Russie a garanti la sécurité de la Turquie, et la Turquie, à son tour, s’est engagée à fermer le détroit de la mer Noire à tous les navires militaires étrangers (sauf russes). La violente indignation des puissances européennes contraint la Russie à signer la Convention de Londres en 1840 et à retirer sa flotte du détroit du Bosphore.
Lors de la préparation à l'examen d'État unifié d'histoire, il sera important de vous rafraîchir la mémoire des questions programme scolaire que vous avez étudié. La guerre russo-turque de 1828-1829 pourrait également vous venir à l’esprit lors du test. Examinons cette question plus en détail.
La raison formelle du déclenchement de la guerre était la fermeture du détroit du Bosphore par la Porte (le nom généralement accepté pour le gouvernement de l'Empire ottoman). Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, après quoi le souverain russe Nicolas Ier, le 14 avril 1828, déclara la guerre à l'Empire ottoman. Au fait, découvrez tout police étrangère cet empereur.
Raisons qui ont conduit au déclenchement de la guerre
En bref, les conditions préalables à la guerre imminente étaient les événements qui ont commencé à se produire au printemps 1821, sur le territoire de la Grèce moderne, appelée plus tard la Révolution grecque, à savoir l'affrontement armé du peuple grec, dont le but était pour échapper à l’orbite d’influence de l’Empire ottoman.
À cette époque, le trône d'État de Russie était occupé par Alexandre Ier et police étrangère La Russie a fait preuve de laissez-faire sur cette question, puisque les rebelles grecs étaient aidés par la France et l’Angleterre, et que la Russie était une alliée de la France sur cette question.

Empereur Nicolas Ier
Avec l'accession au trône du tsar Nicolas Ier, la situation de la question grecque a commencé à changer en raison de l'incapacité des alliés à s'entendre sur la division de l'Empire ottoman. Et la diplomatie russe a ouvertement soutenu les Grecs dans leur lutte. À la suite de ces mesures, le sultan turc Mahmud II, qui dirigeait la Turquie à cette époque et tentait par tous les moyens de donner au conflit un caractère religieux, expulsa les diplomates russes du pays et, comme mentionné précédemment, en violation de l'accord existant fermait le détroit du Bosphore à la navigation.
Opérations militaires de la campagne de 1828
Les principaux événements de 1828 se sont déroulés dans deux régions, à savoir la péninsule balkanique et la Transcaucasie. Les Russes disposaient d'un contingent d'environ 95 000 personnes dans les Balkans, concentrés à l'embouchure du Danube, et de 25 000 corps dans le Caucase.
La Turquie s'est heurtée à des forces supérieures, respectivement environ 150 et 50 000 militaires. Malgré cela, la campagne militaire armée russe sur la péninsule balkanique fut un succès à partir du printemps 1828. L'armée russe sous la direction du maréchal Peter Christianovich Witgentschein, malgré la supériorité numérique significative des soldats ottomans, a occupé les terres de Moldavie et de Valachie (le territoire du sud de la Roumanie moderne) sans pratiquement aucune résistance.
Cela était dû à une stratégie militaire différente, utilisée par Nicolas Ier pour la première fois au cours de cette campagne. Il décide de ne pas mener d'offensive de ses troupes contre l'ennemi, comme cela s'était déjà produit lors des guerres précédentes avec la Turquie, sur toute la ligne du Bas et du Moyen Danube, mais de lancer une frappe ciblée et concentrée dans une bande assez étroite du Danube. la région de la mer Noire, y concentrant le gros de ses troupes.

Bien que l’offensive de l’armée russe ait été considérablement entravée par le débordement printanier sans précédent des rivières depuis leurs rives. Il a par exemple fallu plus d’un mois pour préparer la traversée du Danube par le groupe. Mais malgré les difficultés et les retards survenus, les troupes tsaristes parviennent à s'emparer de toutes les forteresses ottomanes situées le long du Bas-Danube, à l'exception de la Silistrie.
La principale force de frappe de l'armée russe commença alors le siège des deux places fortes les plus fortes de Bulgarie, les forteresses : Shumla (Shumen) et Varna. Mais les capturer s’est avéré être une tâche assez difficile. A Choumla, environ 40 000 Turcs se sont défendus contre une armée de 35 000 soldats russes, sans compter le nombre important de partisans opérant à proximité de ces villes.
Depuis les Balkans, on a tenté d'attaquer le corps d'Omar Vrione Pacha, composé d'une horde turque de 30 000 hommes, contre la brigade du prince Menchikov, qui assiégeait Varna. Cependant, malgré les efforts des Turcs, Varna tomba le 29 septembre, les forteresses de Silistria et Shumla subirent un siège et ne se rendirent pas. armée russe a été contraint de battre en retraite.
À l'automne 1828, l'armée turque tenta de lancer une offensive majeure vers l'ouest en Valachie, mais la tentative fut contrecarrée en grande partie grâce à la brillante victoire du général Fedor Klementievich Geismar à Boelesti. À la fin de la campagne balkanique de 1828, la majeure partie du contingent russe retourna pour l'hiver au-delà du Danube, laissant des garnisons à Varna, Pazardzhik et quelques autres villes au sud du fleuve, transformant ces villes en bastions pour l'offensive ultérieure de 1829.
Lors de la confrontation entre Russes et Turcs en Transcaucasie lors de la campagne de 1828. Le général Ivan Fedorovitch Paskevitch, agissant contre des forces ennemies deux fois plus nombreuses, occupa des forteresses d'importance stratégique : Kars, Poti, Akhaltsikhé, Ardagan, Akhalkalaki, Bayazet. Lors de la prise de la ville d'Akhaltsikhé, située en hauteur dans les montagnes, le 16 août 1828, une colonne sous le commandement du colonel Borodine prend d'assaut les murs de la ville, sous le feu de l'artillerie ennemie répartie sur trois niveaux.
Campagne de 1829
L'hiver s'est déroulé dans une préparation intensive des deux armées pour les batailles du printemps et de l'été. Au printemps 1829, l'armée turque dans les Balkans comptait 150 000 soldats et environ 40 000 soldats appartenant à la milice albanaise. L'empereur Nicolas Ier s'est opposé à cette horde avec un contingent de 100 000 hommes.
En Transcaucasie, 20 000 soldats du général Paskevich se sont heurtés à un groupe de troupes turques comptant au total 100 000 soldats. Seule la flotte avait l'avantage : les flottilles russes de l'amiral Greig en mer Noire et de l'amiral Heyden en mer Égée dominaient l'ennemi. Le général Ivan Ivanovitch Dibich, ardent partisan d'une solution rapide à la question turque et d'une fin rapide de la guerre, fut nommé chef de la campagne de 1829 dans la péninsule balkanique.
Les navires des amiraux Greig et Heyden ont bloqué le détroit du Bosphore des deux côtés, organisant un blocus naval d'Istanbul. Le vizir turc fit une tentative désespérée pour reprendre la ville de Varna, mais le 30 mai 1829, l'armée de Diebitsch, composée de 18 000 soldats, battit de manière écrasante une armée ennemie de près de 40 000 soldats.

Cette bataille a eu lieu près du village de Kulevchi. Dans l'espoir de se venger, le vizir a attiré les restes de ses forces armées vers Shumla dans l'espoir que cela devienne la prochaine cible des Russes. Cependant, contrairement aux plans du vizir, Dibich, de manière inattendue pour les Turcs, mena ses troupes au-delà de la ville et, avec un petit corps militaire, composé de seulement 35 000 soldats, début juillet 1829, se dirigea vers le sud jusqu'à Istanbul.
La campagne transbalkanique de 1829, par son courage et son audace militaire, rappelle fortement la légendaire campagne suisse d'Alexandre Valilievich Suvorov. En 11 jours, les troupes de Dibich ont parcouru 150 kilomètres le long des montagnes escarpées des Balkans. Conscient de son erreur, le vizir envoya à la hâte deux détachements (12 et 20 mille) pour intercepter l'armée de Diebitsch, qui fut complètement vaincue lors des batailles d'Aytos et de Sliven en juillet 1829.
La garnison de Diebitsch était en proie à des malheurs et ses effectifs diminuaient rapidement, davantage à cause de la maladie et de la chaleur étouffante que des pertes au combat. Mais malgré tout cela, la campagne contre Istanbul s'est poursuivie. Surmonter encore 120 km au cours des 7 prochains jours. Diebitsch s'approche d'Andrinople, la deuxième capitale de l'Empire ottoman. Le 8 août 1829, la population de la ville, découragée par l'apparition des Russes, leur rendit la ville sans tirer un seul coup de feu. Il ne restait plus que 200 kilomètres jusqu'à Istanbul.
Au cours de la campagne en Transcaucasie, Paskevich a également réussi. À l'été 1829, une armée turque composée de deux détachements de 30 et 20 000 hommes s'est déplacée vers Kars, mais Paskevich avec un détachement de 18 000 soldats les a vaincus un par un en juin 1829 : dans les batailles de Kainly et Mille Duse. Et le 27 juin 1829, Erzurum fut prise, puis l’armée de Paskevich s’enfonça profondément dans l’Anatolie, en direction de Trébizonde.
Fin de la guerre
Le détachement de Dibich à Andrinople diminuait sous nos yeux, les soldats mouraient des blessures et des maladies qui leur étaient tombées pendant la campagne. En peu de temps, leur nombre fut réduit à près de 7 000. Conscient de la gravité de sa situation, mais sans révéler la véritable situation, le général Dibich d'Andrinople commença à mener des négociations de paix avec le sultan.
Puisque les Turcs, avec la milice albanaise, avaient l'intention de mettre Andrinople dans le chaudron, le général comprit qu'un retard entraînerait une mort certaine. Et c'est pourquoi, sous forme d'ultimatum, il a exigé que la Porte signe un traité de paix, menaçant de frapper Istanbul en cas de refus. Il confirma ses intentions en envoyant des détachements qui capturèrent Saraï et Chorla, situées à mi-chemin entre Andrinople et Constantinople.
Le bluff de Dibich a fonctionné et le 2 septembre 1829, la paix d'Andrinople a été signée, mettant fin à la guerre russo-turque.
Aux termes de la paix, la Turquie a payé une petite indemnité, a démoli les forteresses militaires sur le Danube, a donné Anapa et Poti à la Russie et a autorisé les navires marchands russes à passer par les détroits du Bosphore et des Dardanelles.
Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ! Partagez également ce matériel avec vos amis sur les réseaux sociaux.