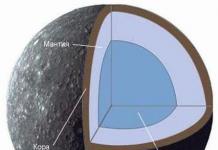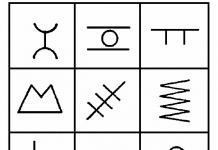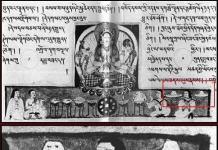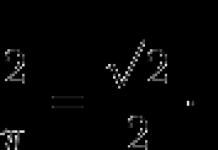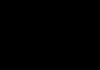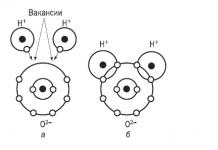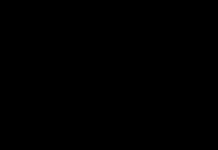La guerre froide a été caractérisée par l’apparition fréquente de points chauds. Chaque conflit local a été porté sur la scène mondiale grâce au soutien des opposants à la guerre froide. En raison du fait qu'un conflit direct entre les deux superpuissances dégénèrerait inévitablement en un conflit nucléaire avec la destruction garantie de toute vie sur la planète, les parties ont cherché à prendre le dessus par d'autres méthodes, notamment. et affaiblir l'ennemi dans une région particulière et y renforcer ses positions, si nécessaire, par une action militaire.
Près de 40 ans se sont écoulés entre le premier conflit armé en Corée (1950-1953) et le dernier à la frontière lao-thaïlandaise (1988). Pendant ce temps, l’arc enflammé de la confrontation soviéto-américaine encerclait presque tous les continents de la planète, de l’Asie de l’Est à l’Amérique latine, de l’Afrique du Sud à l’Europe centrale. Pendant cette période, des millions de personnes sont mortes dans de nombreuses guerres, des dizaines d’États y ont été entraînés, dont certains n’ont pas encore été résolus. Afghanistan, Corée, Indochine, conflit israélo-arabe, Cuba, pays de la Corne de l'Afrique, etc. - dans tous ces conflits, nous retrouvons d'une manière ou d'une autre à la fois « la main osseuse de l'impérialisme américain » et « les pulsions agressives de l'impérialisme américain ». empire du mal » - sous forme d'armes et d'argent, de conseillers et d'instructeurs, de « volontaires » et de contingents militaires.
Une crise est une forte aggravation des contradictions entre États, capable à tout moment de se transformer en guerre à grande échelle. En règle générale, les crises surviennent dans un contexte de manque criant de temps pour parvenir à un règlement politique et diplomatique du différend. Dans le développement d'une crise, il y a plusieurs phases principales : glissement, point culminant (point culminant), à partir desquels les événements peuvent évoluer soit vers la guerre, soit vers le compromis et le règlement (phase de sortie de crise).
Le 13 septembre 1945, le gouvernement iranien demande aux trois puissances de retirer leurs troupes. Les troupes américaines furent évacuées le 1er janvier 1946. Le 2 mars, les Britanniques quittèrent l'Iran. L'Union soviétique a refusé de fixer la date du retrait des troupes. Il y avait des raisons à cela. En Iran en dernières années Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’effervescence révolutionnaire nationale s’est accrue parmi les minorités ethniques – les Azerbaïdjanais du nord-ouest, en Azerbaïdjan iranien, et les Kurdes du sud-ouest, au Kurdistan iranien. Il s’agissait de mouvements séparatistes dont les dirigeants recherchaient une large autonomie par rapport au gouvernement paniranien de Téhéran. Les dirigeants iraniens, ainsi que les capitales occidentales, soupçonnaient que l'URSS pourrait fournir une assistance aux séparatistes afin de séparer l'Azerbaïdjan iranien de l'Iran et de l'unir à l'Azerbaïdjan soviétique (RSS d'Azerbaïdjan). 18 novembre 1945 Un soulèvement éclate en Azerbaïdjan iranien, organisé par le Parti populaire d'Iran (le Parti Tudeh, en fait, le Parti communiste iranien). Le gouvernement central a envoyé des troupes de Téhéran pour réprimer la rébellion, mais les forces soviétiques ne les ont pas autorisées à pénétrer dans la région. En mars 1946, le gouvernement iranien déposa une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les actions des autorités militaires soviétiques.
L'URSS a également utilisé la question de la présence de ses troupes sur le territoire iranien comme moyen de pression sur Téhéran afin d'obtenir de lui des concessions pétrolières dans le nord de l'Iran. Les négociations soviéto-iraniennes sur le retrait des troupes, liées au problème des concessions pétrolières, furent difficiles.
L'opinion publique britannique, dont la zone d'influence était pendant de nombreuses années le sud de l'Iran, a réagi particulièrement violemment aux événements. Maintenant que les troupes britanniques étaient parties et que les troupes soviétiques restaient, les hommes politiques britanniques se sentaient trompés. Au plus fort de la crise iranienne, le 5 mars 1946, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, retraité en 1945, prononça, au Westminster College de Fulton (Missouri, États-Unis), un célèbre discours accusateur contre l'URSS. W. Churchill a accusé Moscou de créer un « rideau de fer » divisant le monde en deux parties et a appelé au renforcement du « partenariat anglo-saxon » entre les États-Unis et la Grande-Bretagne afin de contrer la menace communiste. Lors du discours de l'homme politique britannique, le président américain Truman était présent dans la salle, qui n'a pas développé les pensées exprimées par W. Churchill, mais n'a pas exprimé de désaccord avec elles. Partout dans le monde, le « discours de Fulton » a été perçu comme un manifeste « guerre froide", dont le début, au sens figuré, a été proclamé par le Premier ministre britannique à la retraite.
Le discours de W. Churchill a reçu une résonance internationale en grande partie parce qu'il y a répondu directement. V. Staline. 14 mars 1946
Dans une interview spéciale, il a parlé durement de ce discours, affirmant qu'il s'agissait essentiellement d'un appel à la guerre. La presse a repris les déclarations imprudentes de Staline et le problème de la « guerre » entre l'URSS et l'Occident est devenu le motif des commentaires des journaux. En conséquence, les craintes ont commencé à s’intensifier dans le climat politique de différents pays du monde. La confrontation entre l’URSS et l’Occident a commencé à s’intensifier.
Le mot clé est escalade - croissance, escalade des tensions, aggravation d'une situation ou d'un conflit.
La crise iranienne fut résolue lors du dialogue soviéto-iranien en avril 1946. En guise de compromis, des accords furent conclus sur la création d'une société pétrolière soviéto-iranienne à des conditions favorables pour l'URSS et sur l'élargissement de la représentation des délégués de l'Azerbaïdjan iranien au sein de l'Union soviétique. Majlis iranien. Le 9 mai 1946, les troupes soviétiques furent retirées d'Iran et, en juin, les conséquences du soulèvement en Azerbaïdjan iranien furent éliminées. En septembre de la même année, des poches de séparatistes du Kurdistan iranien (province du Fars) ont été supprimées.
Après la fin de la crise, Washington est resté convaincu que Moscou était contraint de faire des concessions en raison de la position de principe des États-Unis et de la Grande-Bretagne à l’égard de l’Iran. J.V. Staline a conclu qu'une alliance anglo-américaine était en train de se former contre l'URSS. Après l’occupation du pays par les troupes allemandes en juin 1941, le roi George II fuit le pays avec sa famille. Dans le territoire occupé, il y a eu mouvement partisan, dans laquelle les communistes ont joué un rôle important - l'Armée populaire de libération du peuple grec (Elas). En 1945, environ les deux tiers du pays avaient été libérés des troupes allemandes par ses forces. Entre-temps, en octobre 1944, avec le soutien des alliés occidentaux, des unités des forces armées du gouvernement royal arrivèrent en Grèce et affrontèrent les troupes communistes. Le conflit s'est poursuivi jusqu'en février 1945. Bien que l'Union soviétique ait exercé une influence sur les communistes grecs et ait pu leur fournir une assistance à travers le territoire de la Yougoslavie, qui était contrôlé par les forces armées de la Grèce et de la Yougoslavie. B. Tito, I. V. Staline ne voulait pas aggraver les relations avec la Grande-Bretagne, dont la sphère d'influence comprenait la Grèce, conformément aux accords tacites des Trois Grands pendant les années de guerre. Il a été conseillé aux communistes grecs de céder. 12 février 1945 Dans la ville de Varkiza, près d'Athènes, des accords sont signés entre les chefs des détachements de gauche et le gouvernement royal, selon lesquels le pouvoir est transféré à ce dernier. Certains communistes grecs n'étaient pas d'accord avec cette décision.
À l'été 1946, la crise s'aggrave en raison des tentatives des autorités d'accroître la pression militaire sur la gauche. Une guerre civile éclata en Grèce, qui dura jusqu'en 1949. Dans les capitales occidentales, la responsabilité en fut imputée à Moscou, ce qui n'était qu'en partie juste. Bien que les communistes grecs aient eu la possibilité de recevoir une aide de l'étranger, l'URSS a continué à s'abstenir d'un tel soutien, notamment par souci de ne pas irriter sa Bulgarie amie, qui avait elle-même des revendications territoriales sur la Grèce et se méfiait de la belligérance des Grecs. communistes. En fait, le principal initiateur de l’aide aux communistes grecs fut IB Tito.
En février 1945, la Turquie déclara officiellement la guerre à l’Allemagne, mais ne mena pas d’opérations militaires contre elle. Les relations entre l’URSS et la Turquie pendant la guerre mondiale étaient empreintes de méfiance mutuelle. Moscou s’attendait à ce qu’Ankara prenne la parole aux côtés de l’Allemagne et s’y est préparé. Mais la Turquie a évité d’entrer dans la guerre et en a profité. L’Union soviétique n’avait aucune raison formelle d’entrer en conflit avec la Turquie, d’autant plus qu’un traité d’amitié et de neutralité existait entre les deux pays depuis 1925. La dernière fois qu'il a été prolongé de 10 ans, c'était en 1935. Sa validité devait donc expirer le 7 septembre 1945. Le 19 mars 1945, 6 mois avant son expiration, l'URSS, comme le prévoit le texte d'accord, a notifié le gouvernement turc de son intention de ne pas le renouveler.
A Ankara, cela a été considéré comme un avertissement concernant le durcissement de l'attitude de l'URSS à l'égard de la Turquie.
Lors de la Conférence de Potsdam, l'Union soviétique a tenté d'obtenir le droit d'assurer la sécurité des détroits aux côtés de la Turquie. Mais ces demandes de l’URSS n’ont pas été soutenues. Compte tenu de sa décision de mettre fin au traité soviéto-turc, l'Union soviétique a tenté d'obtenir d'Ankara un régime de sécurité favorable dans la zone du détroit au niveau bilatéral. Le 7 août 1946, une note fut envoyée au gouvernement turc proposant d'entamer des négociations sur un changement du régime de navigation dans le détroit de la mer Noire et de permettre à l'URSS de créer une base militaire soviétique dans la zone du détroit. Le contenu de la note a été immédiatement porté à l'attention du secrétaire d'État américain James Francis Byrnes par la partie turque, qui se trouvait à ce moment-là à Paris.
Selon des sources américaines, Washington a pris la note soviétique au sérieux, puisque les dirigeants américains n'ont cessé de se reprocher la « douceur » dont ils ont fait preuve à l'égard des actions de l'URSS lors de la crise iranienne et ont cherché cette fois à se comporter plus fermement. Aux États-Unis, la question d'éventuelles mesures de contre-attaque militaire contre l'URSS a été discutée si, à la suite de la note, celle-ci prenait des mesures énergiques contre la Turquie. Au printemps et à l'automne 1946, sur la base de rapports des services de renseignement américains et britanniques sur la concentration des troupes soviétiques en Roumanie, en Bulgarie et sur le territoire de la Transcaucasie soviétique (selon diverses sources, jusqu'à 600 000 soldats soviétiques étaient stationnés en Roumanie, et jusqu'à (contre 235 000 en Bulgarie), aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ils étaient enclins à croire qu'une action armée soviétique contre la Turquie était possible.
Cependant, les représentants américains de Turquie et de Moscou ont rapidement commencé à signaler à Washington qu’il n’y avait aucun signe d’une intention soviétique de prendre des mesures contre Ankara. Il n’y a pas eu de crise. Le gouvernement turc, après avoir reçu la note, selon des sources occidentales, l'a également jugée moins sévère que prévu. Moscou n’avait pas l’intention d’entrer en conflit. Peut-être, compte tenu de la réaction douloureuse des États-Unis et de la Grande-Bretagne à la note sur les détroits, le gouvernement soviétique n'a-t-il pas insisté pour accepter ses exigences. En octobre, les services de renseignement américains et britanniques ont enregistré une diminution de l’activité soviétique près des frontières turques. Cependant, l’URSS ne renonça officiellement à ses prétentions sur Ankara que le 30 mai 1953.
Les dirigeants américains ont tiré de la situation turque la conviction de la nécessité de disposer de bases en Méditerranée orientale et de fournir une assistance militaire et économique à la Turquie pour moderniser son potentiel militaire. Washington accordait davantage d’attention aux approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient, dont la sécurité dépendait de la situation en Méditerranée. La Grèce et la Turquie, qui séparaient cette région de l’URSS, ont acquis une importance particulière pour la planification stratégique américaine.
L'URSS en 1945-1946 Il a tenté de vérifier le degré de préparation des alliés occidentaux à protéger les pays et territoires «contestés», selon lui, et, si possible, à les annexer à sa zone d'influence. En Iran, l'URSS a soutenu les mouvements antigouvernementaux du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan iranien. Le discours de Churchill à Fulton, dans lequel il appelait à l'unification du monde anglo-saxon contre l'URSS séparée par un rideau de fer, a provoqué une réaction douloureuse de Staline, qui a conduit à une escalade des tensions internationales.
Malgré la capacité significative des communistes grecs à étendre leur pouvoir dans le pays, l'URSS ne leur a pas fourni une aide significative, basée sur les accords alliés avec la Grande-Bretagne lors de la coalition anti-hitlérienne.
L'URSS cherchait à fermer le Bosphore et les Dardanelles au passage des navires de guerre des puissances non-membres de la mer Noire. Il a donc proposé l’idée d’une « défense commune » du détroit de la mer Noire. S'appuyant sur le soutien des États-Unis, la Turquie a rejeté cette proposition. Dans l'opinion publique des pays occidentaux, les idées sur les intentions agressives de l'URSS envers la Turquie se sont répandues.
Question 2. Deux voies de développement pour les pays d'Amérique latine : « Construire le socialisme » (Cuba, Chili, Nicaragua) ou intégration dans l'économie mondiale (Mexique, Brésil, Bolivie).
L'Amérique latine est le nom général des pays et territoires situés au sud des États-Unis.
Environ 470 millions de personnes vivent actuellement dans ces territoires et États (et cette population a été multipliée par plus de 8 au cours du XXe siècle, ce qui constitue le taux de croissance le plus élevé au monde). Le territoire total de l’Amérique latine s’étend sur plus de vingt millions de kilomètres carrés (ce qui est plus grand que l’ensemble du territoire de la Russie). Les plus grands États de la région en termes territoriaux sont le Brésil, l'Argentine et le Mexique ; le Venezuela, le Chili, la Colombie et le Pérou s'ajoutent à la liste des pays les plus développés économiquement de la région.
Premièrement, l’Amérique latine est, d’une part, une région du monde moderne en plein développement.
Les plus grands pays de la région - Brésil, Argentine, Chili, Mexique - affichent des taux de croissance économique constamment bons, l'industrie se développe activement dans ces pays, Agriculture, secteur des services.
Dans le même temps, de nombreux problèmes socio-économiques de la région (chômage, criminalité, marginalisation, toxicomanie, etc.) entravent le développement de ces pays et créent une image négative de ces pays aux yeux de la communauté mondiale, interfèrent avec attirer les investissements et, par conséquent, ralentir le développement de ces pays.
Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que la grande majorité des pays d'Amérique latine (par exemple, le Nicaragua, le Belize, l'Équateur) n'appartiennent pas au nombre d'États à développement économique rapide. Les problèmes socio-économiques de ces pays sont similaires aux problèmes des pays plus développés - leurs voisins, cependant, du fait qu'ils sont beaucoup moins développés économiquement, les problèmes considérés s'expriment avec beaucoup plus d'acuité. Il en résulte une situation politique interne tendue et une image négative aux yeux des pays développés et de la communauté mondiale.
Troisièmement, il faut tenir compte du fait que la Fédération de Russie a actuellement certains intérêts dans la région. Les experts notent que ces dernières années, la coopération entre la Russie et les pays de la région (principalement le Venezuela, la Bolivie, Cuba, le Pérou, le Brésil, le Nicaragua, etc.) a connu une augmentation qualitative - des projets communs émergent dans les secteurs énergétique et bancaire. , l'interaction politique pour résoudre les problèmes géopolitiques se développe , des projets culturels et éducatifs sont développés. Les problèmes socio-économiques présents dans les pays de la région entravent quelque peu le développement de ces relations et réduisent également quelque peu l'attractivité des investissements des pays d'Amérique latine aux yeux des investisseurs russes potentiels.
Ainsi, notre compréhension des spécificités des problèmes socio-économiques modernes dans les pays d’Amérique latine ne sera pas complète sans étudier les spécificités de la région latino-américaine et son rôle dans l’économie et la politique mondiales modernes.
Donne moi brève description Région latino-américaine 1. Le terme Amérique latine désignait à l'origine les parties du continent américain qui ont été colonisées et colonisées par des habitants des pays de la péninsule ibérique (ibérique) - l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal aux XVe et XVIe siècles ont colonisé plus de 90 % du territoire de l'Amérique latine moderne, le reste étant réparti entre l'Angleterre, la France et les Pays-Bas.
La plupart des grands États de la région ont obtenu leur indépendance des métropoles européennes (Portugal et Espagne) au XIXe siècle, la grande majorité des autres au XXe siècle. Actuellement, la région compte environ 30 États.
Il n'est pas possible de déterminer la quantité avec plus de précision en raison des différences dans les approches adoptées pour définir l'Amérique latine. Ainsi, un certain nombre de chercheurs n'y incluent que les pays hispanophones et n'incluent pas les possessions coloniales anciennes ou actuelles de l'Angleterre, de la France et des Pays-Bas parmi les territoires de la région 2 .
Dans le même temps, l'ONU regroupe les pays de la région sur une base purement géographique - Amérique du Nord et Amérique du Sud 3. Ainsi, l’Amérique latine est plus un terme culturel que géographique. Actuellement, l'Amérique latine comprend un certain nombre d'États et de territoires du Sud et du Sud. Amérique centrale(voir tableau n°1.).
Tableau n°1.
États et territoires d'Amérique latine
États indépendants |
Territoires dépendants (indiquant l'affiliation) |
|
Argentine |
Guadeloupe (France) |
|
Nicaragua |
Martinique (France) |
|
Guyane française (France) |
||
Brésil |
Paraguay |
Porto Rico (États-Unis) |
Venezuela |
Îles Falkland (Grande-Bretagne) |
|
Guatemala |
Salvador |
Aruba (Pays-Bas) |
Trinité-et-Tobago |
Antilles néerlandaises (Pays-Bas) |
|
Honduras |
Îles Caïmans (Grande-Bretagne) |
|
République dominicaine |
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud (Grande-Bretagne) |
|
Colombie |
Montserrat (Grande-Bretagne) |
|
Costa Rica |
||
Surinam 4 |
||
Type de cours : combiné;
Méthode: conférence avec des éléments de conversation ;
Cible: révéler les causes et les conséquences
"Guerre froide", consolider les acquis
connaissances antérieures, stimuler
activité créative des étudiants.
Liens interdisciplinaires :études sociales, géographie.
PENDANT LES COURS,
2. Vérifiez devoirs
Enquête orale
1. Quels changements majeurs se sont produits dans les relations internationales après la guerre ?
2. Causes de la guerre froide.
Dictée historique
3. Étudier du nouveau matériel ;
4. Consolidation du nouveau matériel et des devoirs.
PLAN
Création de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Crise berlinoise de 1948
La guerre de Corée constitue la première expérience de la guerre froide.
Crise des Caraïbes.
1. Formation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Le 4 avril 1949, les pays occidentaux formèrent l’organisation militaro-politique du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Ses fondateurs étaient les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, l'Islande et le Portugal. Le Traité instituant l'OTAN a été complété par des accords d'assistance mutuelle entre ses membres. La Grèce et la Turquie ont rejoint l’OTAN en 1952, et l’Allemagne en 1955.
La réponse à l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN en 1955 fut la création de l'Organisation du Pacte de Varsovie, une alliance militaro-politique de l'URSS avec ses pays amis d'Europe de l'Est.
L’émergence en Europe de deux alliances militaro-politiques opposées n’est pas seulement le résultat de la lutte entre l’URSS et les États-Unis pour le leadership mondial. Chacun d'eux a défendu un certain modèle de l'ordre mondial, un mode de vie des peuples, liant la mise en œuvre de leurs intérêts nationaux à leur approbation.
La rivalité entre les « deux camps » s’est manifestée sous différentes formes – idéologique, économique. Mais comme les parties n’excluaient pas la possibilité d’un affrontement militaire direct, une importance particulière était attachée à la constitution de forces militaires.
2. Crise berlinoise de 1948 Après la guerre, il a été convenu que l’Allemagne devait devenir un État démocratique et épris de paix. Cependant, dans des conditions où le territoire de l’Allemagne et sa capitale étaient divisés en zones d’occupation par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’URSS, la question n’a jamais trouvé de solution. La formation de deux États allemands a donc commencé sur le territoire allemand. En 1948, une réforme monétaire a été menée en Allemagne de l’Ouest. En réponse, l’URSS a fermé la frontière entre les zones d’occupation, craignant l’afflux de monnaie dévaluée vers l’Allemagne de l’Est. Berlin-Ouest était bloqué. Les dirigeants de l'URSS pensaient que les pays occidentaux feraient des concessions sur la question allemande, mais cela ne s'est pas produit. La crise de Berlin a gelé pendant plus de 40 ans la question d’une Allemagne unie. En 1949, deux États allemands, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, furent créés et devinrent respectivement membres de l'OTAN et de la Division de Varsovie.
3. La guerre de Corée, première expérience de la guerre froide. Le deuxième conflit a eu lieu en Asie. En 1949, la guerre civile chinoise se termine par la victoire des communistes. Les restes des forces anticommunistes, sous le couvert de la marine américaine, ont été évacués vers l'île de Taiwan. Dans ces conditions, le régime communiste Corée du Nord a tenté d'unifier le pays, dans le sud duquel existait un régime au pouvoir orienté vers une alliance avec les États-Unis. La diplomatie américaine a profité du fait que l'URSS avait boycotté le travail de l'ONU, pour protester contre la non-reconnaissance par l'Occident du gouvernement communiste chinois. En l’absence d’un représentant de l’URSS, le Conseil de sécurité de l’ONU a reconnu la Corée du Nord comme agresseur. Cela a donné aux États-Unis et à leurs alliés la base légale pour envoyer des troupes en Corée.
Dans la guerre de 195-=1953. Les forces américaines et leurs alliés sont entrés en conflit direct avec les troupes chinoises venues en aide à la Corée du Nord. DANS batailles aériennes Il y a eu une épreuve de force entre l'aviation soviétique et américaine. Le commandement américain envisageait d'utiliser armes nucléaires. Mais finalement le front s’est stabilisé.
Une situation similaire s'est produite en Indochine, où la France, après avoir perdu le contrôle direct sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge, a cherché à maintenir au pouvoir un régime dictatorial pro-occidental au Vietnam. Libération nationale
les forces qui adoptèrent une orientation communiste reçurent l’aide de la Chine et de l’URSS. En 1954, il devint évident qu’aucune des deux parties n’était capable de réussir.
4. Crise des Caraïbes. Le conflit le plus aigu fut la crise des missiles de Cuba en 1962. La victoire en 1959 à Cuba du mouvement révolutionnaire dirigé par F. Castro et son choix d'une voie de développement socialiste suscitèrent l'inquiétude aux États-Unis.
L'URSS a déployé des missiles à moyenne portée à tête nucléaire sur le territoire cubain. Cette mesure (prise en secret par la communauté mondiale) a été connue du gouvernement américain grâce à la reconnaissance aérienne. Des mesures de représailles - l'introduction d'un blocus naval contre Cuba et les préparatifs d'attaques contre les bases soviétiques sur l'île ont amené le monde au bord d'une guerre nucléaire.
La résolution du conflit est devenue possible grâce à la retenue et au bon sens de Kennedy et de Khrouchtchev. Les missiles ont été retirés de Cuba et le blocus américain a été levé.
Devoirs.
Remplissez le tableau de votre cahier de devoirs.
Répondre à la question.
1. Pourquoi la prise de conscience de la futilité de la méthode militaire pour résoudre les crises internationales a-t-elle été prise au milieu des années 1950 ? n'a-t-il pas poussé l'URSS et les États-Unis à abandonner la politique de guerre froide ?
Guerre de Corée, ses causes.
Le déroulement et les résultats de la guerre.
1. La guerre de Corée et ses causes
Lieu des hostilités : Péninsule coréenne.
Raison : une tentative d’unir les parties disparates de la Corée en un seul pays.
Principaux adversaires : la Corée du Nord et la Corée du Sud et leurs alliés.
Le résultat de la guerre : la victoire des forces de l'ONU et l'échec du plan d'unification de la Corée
Guerre de Corée - il s'agit d'un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour leur unification. Après la guerre, la Corée fut divisée en deux. La partie nord de la Corée était occupée par les troupes soviétiques et la Corée du Sud par les troupes américaines. Au début de la guerre froide, un conflit éclata entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La coalition nord des troupes coréennes comprenait la Chine, l’URSS (qui n’a pas participé, mais a financé les opérations militaires en Corée) et la Corée du Nord elle-même.
Du côté de la coalition sudiste des troupes coréennes, les pays suivants ont participé à la guerre : la Corée du Sud, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'ONU (12 pays au total). La Corée était une colonie du Japon jusqu'en 1945, et après la capitulation du Japon, les troupes soviétiques ont occupé la Corée au nord et les troupes américaines au sud, divisant ainsi le pays en deux parties. Les unités formèrent leur propre gouvernement, au Nord le gouvernement communiste soviétique dirigé par Kim Il Sung. Dans le sud du pays, il existe un gouvernement antisoviétique dirigé par Syngman Rhee. Kim Il Sung a cherché à unir la Corée sous son règne et s'est tourné vers Staline pour lui demander de commencer des opérations militaires dans le sud de la Corée, mais Staline a refusé, mais a pris en charge la fourniture d'armes et le soutien militaire à la Corée.
Progrès et résultats de la guerre
Le 25 juillet 1950, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit et la question coréenne est à son ordre du jour. Une résolution de l'ONU déclare que la Corée du Nord a attaqué illégalement ses frontières Corée du Sud et a été soutenu dans son intention agressive par l'URSS. L'ONU a invité tous les pays libres et démocratiques à fournir une assistance militaire à la Corée du Sud et aux États-Unis, qui ont autorisé l'envoi de troupes en Corée. Au début de la guerre, la Corée du Nord a réussi, puis la Corée du Sud, et à la fin des années 1950, les troupes nord-coréennes ont été pratiquement vaincues. Soudain, l’armée chinoise est entrée en guerre depuis la Corée du Nord et la guerre a continué. Au printemps 1952, l’initiative passa à la Corée du Nord et, à la fin de la même année, la guerre atteignit un point critique. Les États-Unis utilisent des armes de destruction massive dans leurs opérations militaires et, au fil du temps, la partie sud-coréenne prend le dessus dans la guerre. Peu à peu, les hostilités se terminent, mais aucune des deux parties ne présente de propositions de paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau dans le but de mettre fin aux hostilités et de ramener la Corée du Sud aux limites d'avant-guerre. Les négociations commencent sur le rapatriement des prisonniers de guerre (leur retour dans leur pays d'origine), mais elles aboutissent à une impasse. La Corée poursuit les hostilités, l'Union soviétique ne veut pas conclure un traité de paix avant la destruction complète des groupes de gangsters en Corée, le président américain Dwight Eisenhower se rend en URSS pour conclure un traité de paix, mais l'URSS refuse à nouveau. Le 5 mars 1953, Staline meurt. L'URSS cesse de soutenir la Corée du Nord et la Chine. Le 27 juin 1953, la Corée du Sud prend l'initiative de signer un traité de paix. L'armée nord-coréenne se rend et la guerre prend fin. Le résultat de la guerre fut un léger changement de la frontière territoriale entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Périodes de guerre froide et crises internationales.
Il y a deux périodes dans la guerre froide. Pour la période 1946 - 1963. caractérisé par des tensions croissantes entre les deux grandes puissances, culminant avec la crise des missiles de Cuba. C'est la période de création de blocs militaro-politiques et de conflits dans les zones de contact entre deux systèmes socio-économiques. Les événements marquants ont été la guerre de Corée de 1950 à 1953, la guerre française au Vietnam de 1946 à 1954, la répression par l'URSS du soulèvement en Hongrie de 1956, la crise de Suez de 1956, les crises de Berlin de 1948 à 1949, de 1953 et de 1961, la crise cubaine. Crise des missiles de 1962. Un certain nombre d’entre eux ont failli provoquer une nouvelle guerre mondiale.
La deuxième période de la guerre froide commence en 1963. Elle se caractérise par un déplacement du centre de gravité des conflits internationaux vers le « Tiers Monde », vers la périphérie de la politique mondiale. Dans le même temps, les relations entre les États-Unis et l'URSS sont passées d'une confrontation à une détente des tensions internationales, à des négociations et à des accords, notamment sur la réduction des armes nucléaires et conventionnelles et sur le règlement pacifique des différends internationaux. Les conflits les plus importants ont été la guerre américaine au Vietnam et la guerre soviétique en Afghanistan.
Crise des Caraïbes.
Au printemps 1962, les dirigeants de l'URSS et de Cuba décidèrent de déployer secrètement des missiles nucléaires à moyenne portée sur cette île. L’URSS espérait rendre les États-Unis aussi vulnérables à une frappe nucléaire que l’était l’Union soviétique après le déploiement de missiles américains en Turquie. La réception d'informations sur le déploiement de missiles soviétiques sur « l'île rouge » a provoqué la panique aux États-Unis. L'affrontement atteint son apogée les 27 et 28 octobre 1962. Le monde est au bord de la guerre, mais la prudence prévaut : l'URSS retire les missiles nucléaires de l'île en réponse aux promesses du président américain John Kennedy de ne pas envahir Cuba et de retirer les missiles de l'île. Dinde.
La guerre du Vietnam.
Les États-Unis ont fourni une assistance au Sud-Vietnam, mais le régime établi là-bas risquait de s’effondrer. Un mouvement de guérilla soutenu par la République démocratique du Vietnam (RDV, Nord-Vietnam), la Chine et l'URSS s'est développé sur le territoire du Sud-Vietnam. En 1964, les États-Unis, utilisant leur propre provocation comme prétexte, ont commencé à bombarder massivement le Nord-Vietnam et, en 1965, ils ont débarqué des troupes au Sud-Vietnam.
Ces troupes se retrouvèrent bientôt impliquées dans de violents combats avec les partisans. Les États-Unis ont eu recours à la tactique de la terre brûlée et ont procédé à des massacres de civils, mais le mouvement de résistance s’est élargi. Les Américains et leurs acolytes locaux subissent des pertes croissantes. Les troupes américaines opéraient également sans succès au Laos et au Cambodge. Les protestations contre la guerre partout dans le monde, y compris aux États-Unis eux-mêmes, ainsi que les échecs militaires ont forcé les Américains à entamer des négociations de paix. En 1973, les troupes américaines se retirent du Vietnam. En 1975, les partisans prennent sa capitale, Saigon. Un nouvel État est apparu : la République Socialiste du Vietnam (SRV).
Guerre en Afghanistan.
En avril 1978, un coup d'État militaire a eu lieu en Afghanistan, mené par des partisans des opinions de gauche. Les nouveaux dirigeants du pays ont conclu un accord avec l'Union soviétique et lui ont demandé à plusieurs reprises une assistance militaire. L'URSS a fourni à l'Afghanistan des armes et du matériel militaire. La guerre civile entre partisans et opposants du nouveau régime en Afghanistan s'est de plus en plus aggravée. En décembre 1979, l’URSS décide d’envoyer un contingent limité de troupes dans le pays. La présence de troupes soviétiques en Afghanistan a été considérée par les puissances occidentales comme une agression, bien que l'URSS ait agi dans le cadre d'un accord avec les dirigeants du pays et ait envoyé des troupes à sa demande. En substance, les troupes soviétiques se sont retrouvées entraînées dans guerre civile en Afghanistan. Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan a eu lieu en février 1989.
Conflit du Moyen-Orient.
Le conflit au Moyen-Orient entre l’État d’Israël et ses voisins arabes occupe une place particulière dans les relations internationales.
Les organisations juives (sionistes) internationales ont choisi le territoire de la Palestine comme centre pour les Juifs du monde entier au début du 20e siècle. En novembre 1947, l’ONU décide de créer deux États en Palestine : arabe et juif. Jérusalem se distinguait comme une unité indépendante. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé et le 15 mai, la Légion arabe, située en Jordanie, s'oppose aux Israéliens. La première guerre israélo-arabe commence. L’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l’Arabie saoudite, le Yémen et l’Irak ont envoyé des troupes en Palestine. La guerre a pris fin en 1949. Israël a occupé plus de la moitié du territoire alloué à l'État arabe et la partie occidentale de Jérusalem. La Jordanie a reçu sa partie orientale et la rive ouest du Jourdain, et l'Égypte a reçu la bande de Gaza. Nombre total Les réfugiés arabes dépassaient les 900 000 personnes.
Depuis lors, la confrontation entre Juifs et Arabes en Palestine reste l’un des problèmes les plus urgents. Les sionistes ont appelé les Juifs du monde entier à s’installer en Israël, dans leur « patrie historique ». Pour les accueillir, des colonies juives furent créées dans les territoires arabes. Les forces influentes en Israël rêvent de créer un « Grand Israël » du Nil à l’Euphrate (cette idée se reflète symboliquement dans le drapeau national israélien). Les États-Unis et d'autres pays occidentaux sont devenus les alliés d'Israël, l'URSS a soutenu les Arabes.
En 1956, la nationalisation du canal de Suez, annoncée par le président égyptien G. A. Nasser, porte atteinte aux intérêts de la Grande-Bretagne et de la France (Nasser soutient le soulèvement anti-français en Algérie). La triple agression anglo-française-israélienne contre l’Égypte commença. Le 29 octobre 1956, l’armée israélienne franchit la frontière égyptienne et les Britanniques et les Français débarquent dans la zone du canal. Les forces étaient inégales, une attaque contre le Caire se préparait. Ce n’est qu’après que l’URSS eut menacé de recourir à la force contre les agresseurs, en novembre 1956, que les hostilités cessèrent et que les troupes d’intervention quittèrent l’Égypte.
Le 5 juin 1967, Israël a lancé des opérations militaires contre les États arabes en réponse aux activités de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par Yasser Arafat, créée en 1964 pour lutter pour la formation d'un État arabe en Palestine et sa liquidation. d'Israël. Les troupes israéliennes ont rapidement progressé profondément en Égypte, en Syrie et en Jordanie. Les protestations contre l’agression qui ont balayé le monde entier et les efforts de l’URSS ont contraint Israël à arrêter ses opérations militaires le 10 juin. Pendant guerre des six jours Israël a occupé la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie du Jourdain, partie orientale Jérusalem, plateau du Golan sur le territoire syrien.
En 1973, cela a commencé nouvelle guerre. Les troupes arabes ont agi avec plus de succès : l'Égypte a réussi à libérer une partie de la péninsule du Sinaï. En 1970 et 1982-1991. Les troupes israéliennes ont envahi le Liban pour y combattre les réfugiés palestiniens. Une partie du territoire libanais passe sous contrôle israélien. Seulement dans début XXI V. Les troupes israéliennes ont quitté le Liban, mais les provocations contre ce pays se sont poursuivies.
Toutes les tentatives de l'ONU et des principales puissances mondiales pour mettre fin au conflit pendant longtemps ont échoué. Seulement en 1978-1979. Avec la médiation des États-Unis, un traité de paix entre l'Égypte et Israël a été signé à Camp David. Israël a retiré ses troupes de la péninsule du Sinaï, mais le problème palestinien n'a pas été résolu. Depuis 1987, l’Intifada – le soulèvement palestinien – a commencé dans les territoires palestiniens occupés. En 1988, la création de l’État de Palestine est annoncée. Une tentative de résolution du conflit a été un accord entre les dirigeants israéliens et l’OLP au milieu des années 90. sur la création de l'autonomie palestinienne dans une partie des territoires occupés. Cependant, l’Autorité palestinienne dépend entièrement d’Israël et les colonies juives restent sur son territoire.
La situation s'est aggravée à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, lorsque la deuxième Intifada a commencé. Israël a été contraint de retirer ses troupes et ses personnes déplacées de la bande de Gaza. Mais les attaques mutuelles contre les territoires d'Israël et de l'Autorité palestinienne et les actes terroristes se sont poursuivis. À l’été 2006, une guerre a éclaté entre Israël et l’organisation libanaise Hezbollah. Fin 2008 - début 2009, les troupes israéliennes ont attaqué la bande de Gaza, où le mouvement radical Hamas était au pouvoir. Les hostilités ont entraîné la mort de centaines de Palestiniens.
Décharge.
Depuis le milieu des années 50. L'URSS a proposé à plusieurs reprises des initiatives en faveur d'un désarmement général et complet. Les mesures les plus importantes pour adoucir la situation internationale ont été prises dans les années 70. Aux États-Unis et en URSS, on comprenait de plus en plus que la poursuite de la course aux armements devenait inutile et que les dépenses militaires sapaient l’économie. L'amélioration des relations entre l'URSS et l'Occident s'appelait la détente.
La normalisation des relations entre l’URSS et l’Allemagne a été une étape importante sur la voie de la détente. Un point important de l'accord entre eux était la reconnaissance des frontières occidentales de la Pologne et de la frontière entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne (1970). Lors de la visite du président américain Richard Nixon en URSS en mai 1972, des accords sur la limitation des systèmes de défense antimissile (ABM) et le Traité de limitation des armements stratégiques (SALT-1) ont été signés. Le nouveau Traité de limitation des armements stratégiques (SALT II) a été signé en 1979. Les traités prévoyaient une réduction mutuelle du nombre de missiles balistiques.
Du 30 juillet au 1er août 1975, la phase finale de la Conférence sur la sécurité et la coopération des chefs de 33 pays européens, des États-Unis et du Canada a eu lieu à Helsinki. Son résultat fut l'Acte final, qui établit les principes de l'inviolabilité des frontières en Europe, du respect de l'indépendance et de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, du renoncement au recours à la force et à la menace de son recours.
A la fin des années 70. Les tensions en Asie ont diminué. Les blocs SEATO et CENTO ont cessé d'exister. Cependant, l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan et les conflits dans d'autres parties du monde au début des années 80. une nouvelle fois conduit à une intensification de la course aux armements et à une augmentation des tensions.
QUESTIONS ET TÂCHES
1. Quelles ont été les raisons de la formation de blocs militaro-politiques ? Quelles étaient leurs tâches ?
2. Quelles ont été les causes des crises des années 40 et 50 ? Quelles ont été leurs conséquences ?
3. Quelles sont les causes et les conséquences des plus grands conflits militaires des années 60-80 ?
4. Qu'est-ce que la décharge ? Quelles sont ses raisons ? Quels accords avez-vous conclus ?
5. Comment l'équilibre des pouvoirs dans le monde a-t-il changé à la fin du 20e et au début du 21e siècle ?
6. Faites un tableau reflétant la chronologie des plus grands conflits internationaux survenus dans la seconde moitié du 20e et au début du 21e siècle.
À l'été 2011, le processus de retrait progressif des forces américaines d'Afghanistan commence officiellement. D'ici 2014, les membres de l'OTAN prévoient d'achever le transfert de la responsabilité de la situation dans le pays aux forces de sécurité afghanes, dont la formation s'intensifie avec la participation de structures régionales et internationales. Toutefois, la situation en République islamique d’Afghanistan (IRA) reste difficile. Les problèmes interethniques ne sont toujours pas résolus, la lutte contre l'opposition armée irréconciliable est loin d'être terminée, une corruption colossale entrave la reprise économique de l'Afghanistan, une invincible mafia de la drogue fusionnée avec la bureaucratie au plus haut niveau et une augmentation de la consommation de drogue au sein du pays. pays lui-même. Tout cela se produit dans un contexte de faible efficacité des structures internationales et régionales, y compris de l’ONU. La question reste de savoir quand les Américains et les membres de l’OTAN quitteront complètement l’Afghanistan, s’ils le font, et s’il sera possible de maintenir la stabilité de l’État après leur départ.
Aujourd’hui, l’opération de l’OTAN en Afghanistan ne suscite plus autant d’attention qu’il y a dix ans. Premièrement, cette guerre de longue durée menée par l’Occident est devenue assez ennuyeuse pour la communauté internationale : les politiciens, les médias et les gens ordinaires. Deuxièmement, tout le monde est habitué aux mauvaises nouvelles concernant l'activité permanente des talibans et les prochaines victimesà la suite des hostilités, cela ne provoque donc pas de réaction particulièrement aiguë, à moins que les pays de l'OTAN ne traversent un autre cycle électoral. Troisièmement, les troupes de l'Alliance de l'Atlantique Nord vont bientôt quitter le sol afghan, ce qui donne de nombreuses raisons de parler de la guerre en Afghanistan comme d'une mission accomplie avec succès, ce qui est un exemple de volonté de mener des opérations complexes sous les auspices. de l’alliance bien au-delà de son domaine de responsabilité. Quatrièmement, l’Occident a une nouvelle tâche, beaucoup plus intéressante et, notons-le, beaucoup plus facile à accomplir : le renversement du colonel Kadhafi en Libye. Dans le contexte d’une guerre de tranchées difficile en Afghanistan, qui nécessite des coûts importants, l’opération en Libye est en quelque sorte un jeu d’enfant.
En effet, il n’est pas nécessaire de garder plus de 132 000 personnes en Libye pour maintenir un semblant d’ordre et de stabilité et consacrer des ressources à la mise en place de 28 soi-disant groupes de reconstruction provinciale dispersés dans tout l’Afghanistan et engagés dans divers projets sociaux et d’infrastructures. C'est en Afghanistan, et non en Libye, que pour résoudre le problème de la faim en ressources, l'OTAN a besoin de la présence de 48 pays, non seulement des principales puissances mondiales (États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne), mais aussi des petites puissances. États, dont la contribution à la cause commune de création de la stabilité et d’établissement de l’ordre dans ce pays se limite à un maximum de dix militaires ou spécialistes.
C’est en Afghanistan, et non en Libye, que les États-Unis et l’OTAN ont perdu des centaines de personnes, et encore plus de civils afghans sont morts à cause des actions imprudentes ou négligentes de l’Alliance de l’Atlantique Nord.
Cependant, il se pourrait que le « voyage aérien léger » libyen se transforme également au fil du temps en un problème complexe, qui ne deviendra peut-être pas un « test décisif » pour l'avenir de l'OTAN, mais pourrait créer des difficultés politiques et fonctionnelles supplémentaires pour l'organisation. . Après tout, la guerre des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan a également commencé par des bombardements aériens.
Comment tout a commencé
La guerre en Afghanistan a été précédée d'événements tragiques - les attentats terroristes du 11 septembre 2001, après lesquels le président américain de l'époque, le républicain George W. Bush, a déclaré la guerre au terrorisme international représenté par Al-Qaïda, dirigé par Oussama ben Laden, et le régime taliban en Afghanistan, territoire qui était alors devenu la principale base du terrorisme international, où des militants islamistes radicaux ont trouvé refuge sous l'aile du mouvement islamique radical taliban.
Bush a envoyé des troupes américaines pour débarrasser l’Afghanistan des talibans, obtenant le soutien diplomatique de nombreux pays du monde, dont la Russie. La base juridique de l’action militaire américaine était la clause 51 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies sur le droit « à la légitime défense individuelle ou collective ». Les Américains avaient trois objectifs principaux : détruire Ben Laden, mettre fin à Al-Qaïda et renverser le régime taliban.
Le 7 octobre 2001, le président américain a autorisé les frappes aériennes sur Kaboul, la capitale afghane, et sur plusieurs autres villes. L'opération militaire « Enduring Freedom » a commencé, à laquelle a pris une part active l'allié le plus proche des États-Unis, la Grande-Bretagne. Alors que les Américains et les Britanniques étaient principalement engagés dans des frappes aériennes contre les principales villes d’Afghanistan et les bastions des talibans, l’Alliance du Nord, dirigée par Ahmad Shah Massoud, a joué le rôle le plus important dans l’opération terrestre.
De nombreux pays européens se sont précipités pour aider les Américains et ont volontairement rejoint la « coalition antiterroriste ». En soutien aux États-Unis, le bloc de l’Atlantique Nord a mis en vigueur l’article 5 du Traité de Washington pour la première fois de son histoire, et deux ans plus tard, l’alliance a décidé de se rendre en Afghanistan à la suite de son principal membre et partenaire.
En décembre 2001, le régime taliban a été renversé et plusieurs milliers de militants ont été repoussés jusqu'à la frontière avec le Pakistan et se sont installés dans les tribus pachtounes de la zone frontalière afghano-pakistanaise.
Sous la direction vigilante de l’administration américaine et avec la participation active de l’OTAN et des Nations Unies, la construction d’un Afghanistan « démocratique » a commencé. Dans le même temps, l’ONU, en tant que principale structure internationale, ne pouvait certainement pas rester à l’écart du problème afghan. Sous ses auspices, début décembre 2001, la première conférence historique sur l'Afghanistan s'est tenue à Bonn, à la suite de laquelle le pays a reçu une administration intérimaire dirigée par Hamid Karzai.
La décision suivante concernant l'Afghanistan a été la création de la Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF), conformément à la résolution 1386 du Conseil de sécurité (20 décembre 2001). Le premier mandat de la FIAS était de six mois. Ensuite, il a été régulièrement prolongé. Au total, l'ONU a adopté 12 résolutions sur l'Afghanistan.
Il convient de noter que seules les forces internationales, et non l’OTAN, ont pour mandat de rester en Afghanistan. Aucune résolution du Conseil de sécurité relative à l’Afghanistan ne confère à l’alliance un mandat de l’ONU pour mener une mission en Afghanistan. Ayant volontairement et indépendamment pris le commandement de la force de la FIAS le 11 août 2003, l'OTAN, représentée par le secrétaire général de l'organisation de l'époque, Lord Robertson, en a informé a posteriori le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, par lettre datée du 2 octobre 2003. Ci-joint à la lettre se trouvait la stratégie à long terme de l'OTAN pour la mise en œuvre de son rôle au sein de la FIAS. Dans le même temps, le secrétaire général de l’OTAN a aimablement promis qu’il tiendrait le secrétaire général de l’ONU « au courant des développements ultérieurs au cours de l’examen de cette question par le Conseil de l’Atlantique Nord ».
L'OTAN en Afghanistan
En tant qu’acteur indépendant, l’OTAN n’a commencé à jouer un rôle sérieux en Afghanistan qu’en août 2003, lorsqu’elle a volontairement assumé les fonctions de commandement stratégique, de contrôle et de coordination des activités de la Force internationale d’assistance à la sécurité pour l’Afghanistan (ISAF).
Cette décision constitue une étape majeure pour l'OTAN. L’implication de l’alliance dans l’opération militaire américaine s’explique par toute une série de raisons. On peut citer ici la manifestation de solidarité avec les États-Unis dans le cadre de l'article 5 du Traité de Washington, ainsi que l'assistance à la planification et à la mise en œuvre pratique de l'opération que les structures militaires de l'OTAN ont fournie dès le début des hostilités aux membres du bloc. qui a décidé de lutter aux côtés des États-Unis dans le cadre de la « coalition des volontaires ». La nécessité de préserver l'unité de l'alliance, qui, en septembre 2001, était menacée en raison de la quasi-négligence de l'OTAN par l'administration américaine de l'époque, a joué un rôle majeur.
La volonté de l'OTAN d'être utile aux Américains en Afghanistan n'a pas été immédiatement comprise à la Maison Blanche. Pendant près de deux ans, l’administration américaine a préféré « travailler » seule, recourant principalement à l’aide de son plus proche allié, la Grande-Bretagne, ainsi que d’un certain nombre de pays qui ont immédiatement exprimé le désir d’aider Washington. Cependant, après le renversement des talibans, lorsque la situation s'est relativement stabilisée et que la nécessité d'une action militaire directe a disparu (certains terroristes d'Al-Qaïda et des talibans ont été détruits, d'autres ont été repoussés dans les montagnes jusqu'à la frontière avec le Pakistan), et l'attention de la Maison Blanche s'est tournée vers l'Irak (que les Américains ont envahi en mars 2003), l'« heure la plus belle » de l'alliance est arrivée.
La tâche de l’OTAN était dans un premier temps d’assurer la sécurité locale dans les régions relativement calmes de l’Afghanistan et d’étendre progressivement la zone de sécurité à l’ensemble du pays ; dans un deuxième temps, d’assurer les conditions nécessaires au rétablissement de l’IRA. Tout cela devait se produire tout en maintenant le rôle politique dominant et le contrôle militaire des États-Unis.
En fait, l’OTAN s’est vu confier un rôle de service dans l’élimination des « débris » politiques, économiques et humanitaires laissés par les Américains après les opérations militaires. L'Alliance était destinée à devenir une organisation unique gestionnaire de crise, dirigeant les efforts internationaux pour la reconstruction humanitaire et socio-économique de l’Afghanistan.
On ne peut pas dire que l’interprétation américaine du rôle de l’OTAN en Afghanistan ne convenait pas à l’organisation. L'alliance se réjouit que la Force internationale d'assistance à la sécurité ne soit pas impliquée dans des engagements militaires directs, se concentrant davantage sur les patrouilles et la sécurité dans les provinces afghanes, ainsi que sur divers projets d'infrastructure.
Entre-temps, il est progressivement devenu évident que les Américains se sont précipités pour célébrer la victoire sur les talibans, en 2003-2005. réussi à reprendre des forces, et une nouvelle étape commença Campagne afghane avec l’introduction active de la guerre insurrectionnelle et de la subversion contre les forces de l’OTAN. Le bloc de l’Atlantique Nord a été confronté à toute une série de problèmes militaires et civils, ce qui a conduit à ce que « l’Afghanistan soit devenu un test pour l’ensemble de l’alliance ». Il est devenu de plus en plus difficile pour l’OTAN de mener à bien ses missions de sécurité, même au niveau local. De graves problèmes sont survenus dans la gouvernance du pays et dans le développement de l'Afghanistan. En assumant la responsabilité de l’opération de maintien de la paix, l’OTAN a surestimé ses capacités et ses ressources en tant que gestionnaire de crise. L'organisation a été confrontée à de graves problèmes de réputation liés, tout d'abord, aux conséquences négatives des actions erronées des Américains, qui ont entraîné la mort de tous. plus civils. Des problèmes internes sont apparus liés aux difficultés dans les relations entre les pays européens et l'administration Bush, qui avait tendance à ignorer les intérêts de l'Europe en général et de l'alliance en particulier.
L’Afghanistan a montré que l’OTAN n’était pas prête pour la guérilla et la guerre subversive. Chaque année, les sociétés européennes comprenaient de moins en moins pourquoi des Européens devaient mourir en Afghanistan pour l’idée illusoire de démocratiser ce pays. La « petite guerre victorieuse » initiée par George Bush s’est transformée en une guerre prolongée pour les États-Unis et l’OTAN. guerre de tranchées avec les rebelles. Ben Laden n'a pas pu être arrêté, Al-Qaïda fonctionnait toujours et se faisait connaître de temps en temps terribles attaques terroristes ou des informations faisant état d'attaques terroristes à venir, le régime taliban a été renversé, mais pas vaincu. Il n’est pas surprenant que l’Afghanistan soit devenu un casse-tête pour les militaires et les responsables de l’OTAN.
Aux problèmes afghans, difficiles à résoudre, s'en ajoute un nouveau : le Pakistan bouillonnant.
La stratégie Af-Pak d'Obama
Le changement dans l’équipe présidentielle aux États-Unis a entraîné un changement d’approche non seulement à l’égard de l’Afghanistan, mais aussi de l’ensemble de la région du Moyen-Orient.
Premièrement, pour parvenir objectif principal Aux États-Unis - la destruction d'Al-Qaïda - il a été décidé de combiner les approches en Afghanistan et au Pakistan en une seule stratégie régionale. La région unie s'appelait Af-Pak (ou Pak-Af). Le président Obama a accordé une attention accrue au Pakistan qui, avec l'Afghanistan, est devenu la deuxième cible de la nouvelle stratégie américaine. Pour la première fois, l'administration américaine a déclaré publiquement la profonde interdépendance entre le problème de l'insurrection en Afghanistan et les activités des extrémistes dans les régions orientales du Pakistan. Les dirigeants américains ont clairement indiqué qu’à partir de maintenant « il n’y a plus deux lignes distinctes entre l’Afghanistan et le Pakistan ». L'un des instruments spécifiques de la coopération entre le Pakistan et l'Afghanistan consistait en des réunions régulières de leurs présidents à haut niveau sous les auspices des États-Unis pour échanger des informations et coordonner les actions dans la lutte contre les talibans et al-Qaïda.
Deuxièmement, la position officielle des dirigeants américains concernant les négociations avec les talibans a changé (l'administration précédente avait complètement nié la possibilité de telles négociations). En fait, une amnistie politique a été offerte aux talibans dits modérés, qui n'étaient pas des partisans idéologiques d'Al-Qaïda et étaient prêts à déposer les armes, à reconnaître le gouvernement de Karzaï et la constitution de Kaboul et à retourner à une vie paisible.
Troisièmement, il était prévu d’augmenter considérablement le nombre de troupes américaines en Afghanistan.
Quatrièmement, l’accent a été mis sur l’économie. Bien que l'Afghanistan ne puisse pas être qualifié de pays riche, cet État possède un certain potentiel économique, associé principalement au développement des ressources minérales, à l'hydroélectricité, à la construction de communications de transit et à la production de certains types de cultures agricoles. À cet égard, l'administration Obama prévoyait de dépenser environ 4,4 milliards de dollars en 2010 pour créer une infrastructure socio-économique en Afghanistan et dans le nord du Pakistan, censée contribuer à impliquer les Afghans dans une vie paisible et à réduire la base de ressources humaines d'Al-Qaïda.
Cette stratégie a été formalisée lors du sommet anniversaire de l’OTAN à Kehl/Strasbourg début avril 2009. Premièrement, l’amnistie politique annoncée par l’administration américaine en faveur des talibans modérés a été soutenue. Deuxièmement, la mission de formation de l'OTAN en Afghanistan a été créée, dont la tâche est de former les militaires et la police afghans. Cela signifiait que l'alliance comptait sur la formation de ses propres forces de sécurité afghanes, qui devraient à l'avenir assumer l'entière responsabilité de la situation dans le pays, c'est-à-dire une « afghanisation » progressive de la sécurité était envisagée, dont le calendrier restait incertain. Les paramètres de l’« afghanisation » de la sécurité ont été contraints d’être ajustés par les événements de l’été et du début de l’automne 2010, lorsque l’Afghanistan a été balayé par une vague de terreur de la part des talibans, programmée pour coïncider avec les élections présidentielles du 20 août. Rien que le jour du scrutin, 139 attaques terroristes ont été commises dans tout le pays. En août-septembre, les pertes de la FIAS se sont élevées à plus de 140 personnes. La situation s’est tellement dégradée qu’Obama a ordonné l’arrêt temporaire de l’envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan. En raison des pertes importantes subies par les alliés américains au cours de ces deux mois, le nombre de troupes nationales mécontentes de la présence de contingents nationaux en Afghanistan a fortement augmenté en Europe. La position des principaux pays de l'OTAN et des participants à la FIAS - France, Allemagne, Italie et même Grande-Bretagne - évolue : au lieu d'augmenter le contingent militaire, nous parlons de la nécessité de fixer un calendrier pour le début du retrait de l'OTAN. forces d'Afghanistan, ainsi que de se concentrer sur la formation de l'armée et de la police afghanes, pour lesquelles il est nécessaire que l'Afghanistan envoie non pas des soldats, mais des instructeurs spécialisés.
Dans ces conditions, les Américains n’avaient d’autre choix que d’accepter la position des pays européens cherchant à déterminer le plus rapidement possible le moment du retrait d’Afghanistan. C'est pourquoi, dès le 23 octobre 2009, lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, le concept stratégique de transition vers le leadership afghan a été adopté. Il était d’ailleurs prévu que les premiers pas dans cette direction soient réalisés au cours du second semestre 2010.
L’année 2010 a clairement démontré la flexibilité de la politique américaine en direction afghane, que l’on peut qualifier de politique de la carotte et du bâton. D'une part, l'administration Obama a soutenu programme de réconciliation nationale qui a reçu l'approbation lors de la conférence internationale sur l'Afghanistan à Londres (janvier) puis à Kaboul (juin), ainsi que par la Jirga pan-afghane de la paix (juin), qui préconisait un « modèle gouvernement-opposition pour le développement ultérieur de la paix ». La société afghane. En fait, les dirigeants afghans en la personne de H. Karzai ont reçu le « feu vert » pour établir des contacts avec les principales figures de l'opposition armée et du mouvement taliban, des informations sur les négociations avec lesquelles ont été divulguées à plusieurs reprises dans les médias. En revanche, les Américains ont continué d’exercer une pression militaire sur les talibans et al-Qaïda dans le cadre d’opérations anti-talibans (« Moshtarak », février-mars 2010, province de Helmand, et « Shefaf », mars-avril 2010, nord du pays). provinces d'Afghanistan) et a mené avec succès une opération spéciale pour éliminer le chef du terrorisme international Oussama ben Laden.
La principale priorité de la FIAS et des États-Unis en Afghanistan reste la préparation et la formation de l’armée, de la police et des forces de sécurité afghanes afin de leur transférer rapidement la responsabilité de la situation dans le pays. Et ici, des délais précis ont déjà été fixés : le processus débutera à l'été 2011 et devrait s'achever d'ici 2014. Mais est-ce que ce sera la fin de la guerre ?
Mission de l'ONU
Le 28 mars 2002, la résolution 1401 a créé la Mission d'assistance à l'Afghanistan (MANUA) basée à Kaboul. Les principaux objectifs de la mission sont de surveiller la situation des droits de l'homme, les questions de genre et l'aide humanitaire au développement de l'Afghanistan. La mission compte huit bureaux régionaux.
La fonction principale des représentants de la Mission est de surveiller la situation et de coordonner la mise en œuvre de divers programmes et agences spécialisées des Nations Unies. Sur la base d'un suivi attentif, des rapports annuels d'évaluation réguliers du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan sont préparés.
Des informations non moins précieuses sont contenues dans les rapports des agences spécialisées des Nations Unies. Dans le cas de l'Afghanistan, les statistiques de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sont particulièrement utiles, car elles publient des rapports sur la production et la distribution de drogues dans le pays, mènent des enquêtes auprès des paysans, travaillent avec des données de photographies aériennes, et collecter des informations sur le travail du ministère de l'Intérieur. Les rapports de cette structure constituent la principale source de statistiques utilisée par les chercheurs sur le trafic de drogue afghan.
Un autre domaine de travail de la Mission des Nations Unies en Afghanistan est la coordination des programmes alimentaires et agricoles, le suivi de l'importation et de l'exportation de produits. Le prochain grand projet de l'ONU, lancé en avril 2010, fournit une aide alimentaire à 7,3 millions d'Afghans. Les programmes des Nations Unies visent non seulement à fournir de la nourriture provenant de l’extérieur, mais également à assurer une distribution efficace de la nourriture au sein de la région. Parmi eux, l’achat massif de céréales aux paysans afghans pour les besoins alimentaires de leurs compatriotes.
Un domaine de travail tout aussi difficile consiste à aider les réfugiés afghans. Dans ce cas, le travail est effectué par l'intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une assistance est fournie aux réfugiés rentrant dans le pays depuis l'Iran et le Pakistan. Hiver 2010 – 2011 Le département a lancé un programme visant à fournir une assistance aux familles réfugiées dans la province de Kaboul en prévision du temps froid. Selon le Bureau, pour Dernièrement 8 millions de citoyens afghans se trouvant dans une situation socio-économique difficile sont rentrés dans le pays. Depuis 2002, la construction de 200 000 logements résidentiels pour les réfugiés et les personnes déplacées internes retournant dans leur pays en Afghanistan est organisée. Le programme à long terme de l'ONU est réalisé en coopération avec les départements locaux pour les réfugiés et le rapatriement. Depuis que le rapatriement volontaire s'est généralisé en 2002, le programme de logement a aidé 14 millions d'anciens émigrants à trouver un nouveau logement dans leur pays d'origine. Ce nombre représente plus de 25 pour cent du nombre total de réfugiés retournant en Afghanistan.
Malgré les avantages que la Mission de l'ONU apporte aux Afghans ordinaires grâce à ses activités, le travail de ses employés comporte de grands dangers pour la vie. Le degré de danger est déterminé par l'attitude de la population locale envers les représentants communauté internationale, qui dépend en grande partie du contexte politique et de l'extrême excitabilité de la population musulmane d'Afghanistan à toute occasion d'information liée à l'Islam et à une tentative de le discréditer. Ainsi, en février 2011, suite au comportement provocateur du pasteur américain Jones de Floride, qui avait promis de brûler publiquement le Coran, des manifestations spontanées ont eu lieu en Afghanistan et dans d'autres pays du monde musulman. Une manifestation pacifique à Mazar-i-Sharif est devenue incontrôlable et la colère des manifestants s'est dirigée contre le bureau de la Mission dans cette ville, entraînant la mort de 12 employés de la Mission, dont deux décapitations. Des attaques similaires (peut-être moins sanglantes) se produisent assez régulièrement.
OTAN
Après le renversement des talibans, il est devenu nécessaire de réguler le processus de garantie de la sécurité au niveau local et de reconstruction du pays. Ainsi, au cours des cinq premières années de sa présence en Afghanistan, le bloc de l'Atlantique Nord s'est principalement occupé d'étendre sa zone de responsabilité à l'ensemble du territoire de ce pays, en assurant la sécurité lors des premières élections parlementaires et présidentielles, ainsi que ainsi que le développement de projets socio-économiques d'infrastructures.
À cette fin, l’alliance a développé une stratégie politique générale concernant l’Afghanistan, basée sur la triade : sécurité, gouvernance et développement. Cependant, le temps a montré que la stratégie de l'OTAN à l'égard de l'Afghanistan ne peut pas être pleinement mise en œuvre, car deux de ses trois composantes (gouvernance et développement) sont de nature civile et l'alliance ne dispose pas de suffisamment d'expérience et de compétences pour les mettre en œuvre. Une seule des trois composantes - la sécurité - correspond à la compétence de l'OTAN, et sa fourniture par la FIAS sous les auspices de l'alliance soulève de nombreuses questions et plaintes. Quant à la construction d'institutions civiles et au développement socio-économique du pays, ils ne doivent pas être mis en œuvre par l'OTAN, mais par des structures internationales, et la tâche de l'alliance est d'assurer les conditions de sécurité appropriées pour leur mise en œuvre. L’Afghanistan a montré que l’OTAN, ni de par sa nature ni de par sa préparation fonctionnelle, professionnelle et idéologique, n’est capable de s’engager dans un processus global de maintien de la paix après la paix.
Il est curieux qu'à mesure que la situation en Afghanistan s'aggravait, prenant progressivement conscience des limites de leur potentiel en termes de restauration socio-économique et de développement démocratique de ce pays, les États-Unis d'abord, puis l'OTAN, ont commencé à soulever de plus en plus activement la question de la mondialisation Campagne afghane, impliquant d'autres acteurs régionaux dans la résolution du problème afghan.
Aujourd’hui, l’OTAN considère que sa tâche principale en Afghanistan consiste à former la police et les soldats afghans. À cette fin, une mission spéciale de formation de l'OTAN a été créée, au sein de laquelle la FIAS forme le personnel afghan. La mise en œuvre de cette tâche est nécessaire pour que l’alliance puisse entamer le retrait progressif de ses forces du pays.
Les activités de l'Union européenne en tant qu'organisation en Afghanistan se limitent principalement à une participation financière et en partie politique.
La première aide financière de l’UE à Kaboul remonte aux années 1980. A cette époque, les pays européens parrainaient activement l’Afghanistan à travers leur bureau de Peshawar (Pakistan). Après le retrait des troupes soviétiques, un bureau de l’UE a été ouvert à Kaboul. Aujourd'hui, l'UE dispose de son propre représentant spécial en Afghanistan. De 2002 à 2010 L'aide financière de l'Union européenne s'est élevée à environ 8 milliards d'euros. En 2011-2013 Il est prévu d'allouer 600 millions d'euros à des programmes de développement en Afghanistan. Dans le même temps, le problème clé reste l’efficacité de l’utilisation de ces fonds et la corruption parmi les responsables afghans et les entrepreneurs occidentaux.
L’importance politique de l’UE dans la vie de l’Afghanistan se résume à sa participation à la construction de la démocratie afghane, notamment à travers la légitimation des élections présidentielles et parlementaires afghanes. En 2004, la Commission européenne a alloué 22,5 millions d'euros aux élections présidentielles en Afghanistan. « L'Union européenne considère les élections, présidentielles et parlementaires, comme l'un des principaux outils de renforcement de l'État en développement et des institutions civiles du pays. Dans le contexte des déclarations sur la cessation progressive de l'activité militaire en Afghanistan et le transfert des fonctions visant à assurer l'ordre et la sécurité autorités locales Il est très difficile de surestimer l’importance de la tenue d’élections dans son ensemble.»
Le début de la guerre froide est formellement considéré comme le 5 mars 1946, lorsque Winston Churchill prononça son célèbre discours à Fulton (États-Unis). En fait, la détérioration des relations entre les alliés a commencé plus tôt, mais en mars 1946, elle s’est intensifiée en raison du refus de l’URSS de retirer ses troupes d’occupation d’Iran.
Churchill a appelé à ne pas répéter les erreurs des années 30 et à défendre systématiquement les valeurs de liberté, de démocratie et de « civilisation chrétienne » contre le totalitarisme, pour lequel il est nécessaire d'assurer l'unité et la cohésion étroites des nations anglo-saxonnes.
Une semaine plus tard, J.V. Staline, dans une interview à la Pravda, a mis Churchill sur un pied d'égalité avec Hitler et a déclaré que dans son discours, il avait appelé l'Occident à entrer en guerre contre l'URSS.
S'opposer blocs militaro-politiques sur le territoire de l'Europe. Au fil des années, la tension dans la confrontation entre les blocs a changé. Sa phase la plus aiguë se produit dans années de la guerre de Corée, qui fut suivi en 1956 par des événements en Pologne et en Hongrie ; Cependant, avec le début du « dégel » de Khrouchtchev, la tension s’est apaisée, ce qui était particulièrement caractéristique de la fin des années 1950, culminant avec la visite de Khrouchtchev aux États-Unis ; le scandale de l'avion espion américain U-2 (1960) conduisit à une nouvelle aggravation dont le point culminant fut Crise des missiles cubains (1962) ; sous l'impression de cette crise, la détente revient, assombrie cependant par la répression "Printemps de Prague".
Brejnev, contrairement à Khrouchtchev, n'était enclin ni aux aventures risquées en dehors de la sphère d'influence soviétique clairement définie, ni aux actions « pacifiques » extravagantes ; Les années 1970 se sont déroulées sous le signe de ce qu’on appelle la « détente des tensions internationales », dont les manifestations ont été la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki) et le vol spatial conjoint soviéto-américain (programme Soyouz-Apollo) ; Parallèlement, des traités sur la limitation des armements stratégiques sont signés. Cela était largement déterminé par des raisons économiques, puisque l'URSS commençait déjà à connaître une dépendance de plus en plus aiguë à l'égard de l'achat de biens de consommation et de produits alimentaires (pour lesquels des prêts en devises étaient nécessaires), tandis que l'Occident, pendant les années de la crise pétrolière, provoquait par la confrontation israélo-arabe, était extrêmement intéressé par le pétrole soviétique. En termes militaires, la base de la « détente » était la parité des blocs en matière de missiles nucléaires qui s'était développée à cette époque.
Une nouvelle exacerbation s'est produite en 1979. en relation avec le Soviétique invasion de l'Afghanistan, ce qui en Occident a été perçu comme une violation de l’équilibre géopolitique et la transition de l’URSS vers une politique d’expansion. L'aggravation a atteint son paroxysme au printemps 1983, lorsque la défense aérienne soviétique a abattu un avion de ligne civil sud-coréen avec près de trois cents personnes à bord. C'est alors que le président américain Ronald Reagan a mis en œuvre vis-à-vis de l'URSS expression populaire"Empire du mal" Durant cette période, les États-Unis ont placé leurs missiles nucléaires en Europe de l'Ouest et a commencé à développer un programme de défense antimissile spatial (le soi-disant « guerres des étoiles"); Ces deux programmes à grande échelle ont extrêmement inquiété les dirigeants soviétiques, d'autant plus que l'URSS, qui soutenait le partenariat en matière de missiles nucléaires avec beaucoup de difficultés et mettait à rude épreuve l'économie, n'avait pas les moyens de riposter de manière adéquate dans l'espace.
Avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, qui a proclamé le « pluralisme socialiste » et « la priorité des valeurs humaines universelles sur les valeurs de classe », la confrontation idéologique a rapidement perdu de son acuité. D’un point de vue militaro-politique, Gorbatchev a d’abord tenté de mener une politique dans l’esprit de « détente » des années 1970, en proposant des programmes de limitation des armements, mais en négociant assez durement les termes du traité (réunion à Reykjavik).
Histoire de la création de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) - une alliance militaro-politique
Après les accords de Yalta, une situation s'est produite dans laquelle police étrangère des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale était davantage axée sur le futur équilibre des pouvoirs d’après-guerre en Europe et dans le monde que sur la situation actuelle. Le résultat de cette politique fut la véritable division de l’Europe en territoires occidentaux et orientaux, destinés à devenir la base des futurs tremplins d’influence des États-Unis et de l’URSS. En 1947-1948 le début de ce qu'on appelle le plan Marshall, selon lequel d’énormes sommes d’argent américaines devaient être investies dans les pays européens déchirés par la guerre. Le gouvernement soviétique sous la direction d'I.V. Staline n'a pas permis aux délégations des pays sous contrôle soviétique de participer à la discussion du plan à Paris en juillet 1947, bien qu'elles aient été invitées. Ainsi, 17 pays ayant reçu l'aide des États-Unis ont été intégrés dans un espace politique et économique unique, ce qui a déterminé l'une des perspectives de rapprochement.
En mars 1948, le Traité de Bruxelles fut conclu entre la Belgique, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France, qui constituera plus tard la base de l'Union de l'Europe occidentale (UEO). Le Traité de Bruxelles est considéré comme la première étape vers la formation de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Parallèlement, des négociations secrètes ont été menées entre les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne sur la création d'une union d'États fondée sur des objectifs communs et une compréhension des perspectives de développement commun, différent de celui de l'ONU, qui reposerait sur leur unité civilisationnelle. . Des négociations détaillées entre les pays européens et les États-Unis et le Canada sur la création d'une union unique ont rapidement suivi. Tous ces processus internationaux ont abouti à la signature du Traité de l’Atlantique Nord le 4 avril 1949, introduisant un système de défense commune pour douze pays. Parmi eux : Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Islande, Italie, Canada, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, USA, France. L'accord visait à créer système commun sécurité. Les parties se sont engagées à défendre collectivement quiconque serait attaqué. L'accord entre les pays est finalement entré en vigueur le 24 août 1949 après ratification par les gouvernements des pays ayant adhéré au Traité de l'Atlantique Nord. Un international structure organisationnelle, qui contrôlait d’énormes forces militaires en Europe et dans le monde.
Ainsi, dès sa création, l’OTAN s’est concentrée sur la lutte contre l’Union soviétique et, plus tard, contre les pays participant au Pacte de Varsovie (depuis 1955). Pour résumer les raisons de l'émergence de l'OTAN, il convient tout d'abord de mentionner les aspects économiques, politiques et sociaux ; un rôle important a été joué par la volonté d'assurer une sécurité économique et politique commune, la conscience des menaces et des risques potentiels pour la civilisation occidentale. Au cœur de l’OTAN se trouve d’abord la volonté de se préparer à une nouvelle guerre possible, de se protéger de ses risques monstrueux. Mais cela a également déterminé les stratégies de la politique militaire de l’URSS et des pays du bloc soviétique.
GUERRE DE CORÉE (1950-1953)
La guerre entre la Corée du Nord et la Chine contre la Corée du Sud et les États-Unis est une série d'alliés américains pour le contrôle de la péninsule coréenne.
Cela a commencé le 25 juin 1950 avec une attaque surprise de la Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée) contre la Corée du Sud (République de Corée). Cette attaque a été menée avec le consentement et le soutien Union soviétique. Les troupes nord-coréennes ont rapidement avancé au-delà du 38e parallèle séparant les deux pays et ont capturé en trois jours la capitale de la Corée du Sud, Séoul.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu Pyongyang comme agresseur et a appelé tous les États membres de l'ONU à fournir une assistance à la Corée du Sud. Outre les États-Unis, l’Angleterre, la Turquie, la Belgique, la Grèce, la Colombie, l’Inde, les Philippines et la Thaïlande ont envoyé des troupes en Corée. Le représentant soviétique boycottait alors les réunions du Conseil de sécurité et ne pouvait pas user de son droit de veto.
Les pertes totales des parties pendant la guerre de Corée s'élevaient, selon certaines estimations, à 2,5 millions de personnes. Sur ce nombre, environ un million est dû aux pertes de l’armée chinoise. L'armée nord-coréenne a perdu moitié moins, soit environ un demi-million de personnes. Il manquait environ un quart de million d'hommes aux forces armées sud-coréennes. Les pertes des troupes américaines se sont élevées à 33 000 morts et 2 à 3 fois plus de blessés. Les troupes d’autres États combattant sous le drapeau de l’ONU ont perdu plusieurs milliers de personnes. Au moins 600 000 personnes ont été tuées et blessées parmi les civils en Corée du Nord et du Sud.