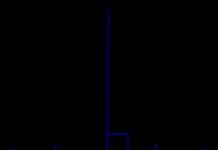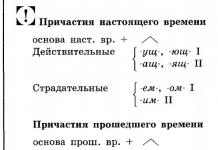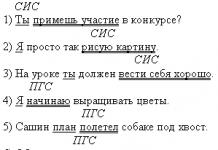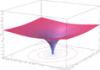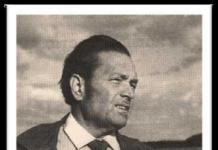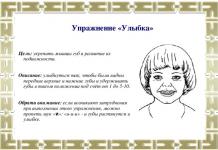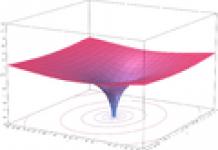L'ancienne Carthage a été fondée en 814 avant JC. colons de la ville phénicienne de Fès. Selon une ancienne légende, Carthage a été fondée par la reine Elissa (Didon), qui a été contrainte de fuir Fès après que son frère Pygmalion, roi de Tyr, ait tué son mari Sycheus afin de prendre possession de ses richesses.
Son nom en phénicien « Kart-Hadasht » signifie « Ville nouvelle », peut-être en contraste avec la colonie plus ancienne d'Utique.
Selon une autre légende sur la fondation de la ville, Elissa était autorisée à occuper autant de terrain que pouvait couvrir une peau de bœuf. Elle a agi de manière assez rusée - prenant possession d'un grand terrain, coupant la peau en ceintures étroites. Par conséquent, la citadelle érigée à cet endroit a commencé à être appelée Birsa (qui signifie « peau »).
Carthage était à l'origine une petite ville, pas très différente des autres colonies phéniciennes situées sur les rives de mer Méditerranée, à l'exception du fait essentiel qu'il ne faisait pas partie du pouvoir tyrien, bien qu'il conservait des liens spirituels avec la métropole.
L'économie de la ville reposait principalement sur le commerce intermédiaire. L'artisanat était peu développé et dans ses caractéristiques techniques et esthétiques de base ne différait pas de l'Orient. Il n'y avait pas d'agriculture. Les Carthaginois n'avaient pas de possessions au-delà de l'étroit espace de la ville elle-même et ils devaient payer un tribut à la population locale pour les terres sur lesquelles se trouvait la ville. Le système politique de Carthage était à l’origine une monarchie et le chef de l’État était le fondateur de la ville. Avec sa mort, probablement le seul membre de la famille royale qui se trouvait à Carthage a disparu. En conséquence, une république fut établie à Carthage et le pouvoir passa aux dix « princeps » qui entouraient auparavant la reine.
Expansion territoriale de Carthage

Masque en terre cuite. III-II siècles AVANT JC. Carthage.
Dans la première moitié du VIIe siècle. AVANT JC. Une nouvelle étape dans l’histoire de Carthage commence. Il est possible que de nombreux nouveaux immigrants de la métropole se soient installés là-bas par crainte de l'invasion assyrienne, ce qui a conduit à l'expansion de la ville, attestée par l'archéologie. Cela l'a renforcé et lui a permis de s'orienter vers un commerce plus actif - en particulier, Carthage a remplacé la Phénicie proprement dite dans le commerce avec l'Étrurie. Tout cela conduit à des changements importants à Carthage, dont l'expression extérieure est un changement dans les formes de la céramique, la renaissance d'anciennes traditions cananéennes déjà abandonnées en Orient, l'émergence de nouvelles formes originales de produits artistiques et artisanaux.
Déjà au début de la deuxième étape de son histoire, Carthage devient une ville si importante qu'elle peut entamer sa propre colonisation. La première colonie fut fondée par les Carthaginois vers le milieu du VIIe siècle. AVANT JC. sur l'île d'Ebes, au large de la côte est de l'Espagne. Apparemment, les Carthaginois ne voulaient pas s'opposer aux intérêts de la métropole du sud de l'Espagne et cherchaient des solutions de contournement à l'argent et à l'étain espagnols. Cependant, l'activité carthaginoise dans la région se heurte bientôt à la concurrence des Grecs, installés au début du VIe siècle. AVANT JC. dans le sud de la Gaule et l'est de l'Espagne. Le premier cycle des guerres carthaginoises-grecques fut laissé aux Grecs qui, bien qu'ils n'aient pas chassé les Carthaginois d'Ebes, réussirent à paralyser ce point important.
L'échec à l'extrême ouest de la Méditerranée contraint les Carthaginois à se tourner vers son centre. Ils fondèrent un certain nombre de colonies à l'est et à l'ouest de leur ville et soumettèrent les anciennes colonies phéniciennes d'Afrique. Renforcés, les Carthaginois ne pouvaient plus tolérer une telle situation qu'ils rendaient hommage aux Libyens pour leur propre territoire. La tentative de se libérer du tribut est associée au nom du commandant Malchus, qui, après avoir remporté des victoires en Afrique, libéra Carthage du tribut.

Un peu plus tard, dans les années 60-50 du VIe siècle. J.-C., le même Malchus a combattu en Sicile, ce qui, apparemment, a été l'assujettissement des colonies phéniciennes de l'île. Et après des victoires en Sicile, Malchus passa en Sardaigne, mais y fut vaincu. Cette défaite devint pour les oligarques carthaginois, qui avaient peur du commandant trop victorieux, une raison pour le condamner à l'exil. En réponse, Malchus retourna à Carthage et prit le pouvoir. Cependant, il fut bientôt vaincu et exécuté. Magon a pris la première place dans l'État.
Mago et ses successeurs durent résoudre des problèmes difficiles. A l'ouest de l'Italie, les Grecs s'établissent, menaçant les intérêts des Carthaginois et de certaines villes étrusques. Avec l'une de ces villes, Caere, Carthage entretenait des contacts économiques et culturels particulièrement étroits. Au milieu du Ve siècle. AVANT JC. Les Carthaginois et les Cérétiens concluent une alliance dirigée contre les Grecs installés en Corse. Vers 535 avant JC Lors de la bataille d'Alalia, les Grecs ont vaincu la flotte combinée carthaginoise-cérétienne, mais ont subi de si lourdes pertes qu'ils ont été contraints de quitter la Corse. La bataille d'Alalia a contribué à une répartition plus claire des sphères d'influence au centre de la Méditerranée. La Sardaigne fut incluse dans la sphère carthaginoise, ce qui fut confirmé par le traité de Carthage avec Rome en 509 av. Cependant, les Carthaginois ne purent jamais s'emparer complètement de la Sardaigne. Tout un système de forteresses, de remparts et de fossés séparait leurs possessions du territoire des Sardes libres.
Les Carthaginois, dirigés par des dirigeants et des généraux de la famille magonide, menèrent une lutte acharnée sur tous les fronts : en Afrique, en Espagne et en Sicile. En Afrique, ils subjuguèrent toutes les colonies phéniciennes qui s'y trouvaient, y compris l'ancienne Utique, qui pendant longtemps ne voulut pas faire partie de leur pouvoir, firent la guerre à la colonie grecque de Cyrène, située entre Carthage et l'Égypte, repoussèrent la tentative de le prince spartiate Dorieus s'établit à l'est de Carthage et chassa les Grecs de l'émergence de leurs villes à l'ouest de la capitale. Ils lancèrent une offensive contre les tribus locales. Dans une lutte acharnée, les Magonides réussirent à les maîtriser. Une partie du territoire conquis était directement subordonnée à Carthage, formant son territoire agricole - la chora. L'autre partie était laissée aux Libyens, mais était soumise au contrôle strict des Carthaginois, et les Libyens devaient payer de lourds impôts à leurs maîtres et servir dans leur armée. Le lourd joug carthaginois a provoqué à plusieurs reprises de puissants soulèvements des Libyens.

Bague phénicienne avec peigne. Carthage. Or. VI-V siècles AVANT JC.
En Espagne à la fin du VIe siècle. AVANT JC. Les Carthaginois profitèrent de l'attaque tartessienne sur Gadès pour, sous prétexte de protéger leur ville métisse, intervenir dans les affaires de la péninsule ibérique. Ils capturèrent Hadès, qui ne voulait pas se soumettre pacifiquement à son « sauveur », ce qui fut suivi par l'effondrement de l'État tartessien. Carthaginois au début du Ve siècle. AVANT JC. établi un contrôle sur ses restes. Cependant, la tentative de l’étendre au sud-est de l’Espagne suscite une forte résistance de la part des Grecs. Lors de la bataille navale d'Artemisium, les Carthaginois furent vaincus et contraints d'abandonner leur tentative. Mais le détroit des Colonnes d'Hercule restait sous leur contrôle.
Fin du VIe - début du Ve siècle. AVANT JC. La Sicile est devenue le théâtre d'une féroce bataille carthaginoise-grecque. Après avoir échoué en Afrique, Dorieus décide de s'établir à l'ouest de la Sicile, mais est vaincu par les Carthaginois et tué.
Sa mort est devenue la raison pour laquelle le tyran syracusain Gelon a fait la guerre à Carthage. En 480 avant JC. les Carthaginois, ayant conclu une alliance avec Xerxès, qui avançait alors sur la Grèce balkanique, et profitant de la situation difficile situation politique en Sicile, où certaines villes grecques se sont opposées à Syracuse et ont conclu une alliance avec Carthage, elles ont lancé une attaque contre la partie grecque de l'île. Mais dans la bataille acharnée d'Himère, ils furent complètement vaincus et leur commandant Hamilcar, fils de Mago, mourut. En conséquence, les Carthaginois eurent du mal à conserver la petite partie de la Sicile qu'ils avaient précédemment capturée.
Les Magonides tentèrent de s'établir sur les côtes atlantiques de l'Afrique et de l'Europe. A cet effet, dans la première moitié du Ve siècle. AVANT JC. deux expéditions ont été entreprises:
- en direction du sud sous la direction de Hannon,
- au nord, dirigé par Gimilkon.
Donc au milieu du Ve siècle. AVANT JC. L'État carthaginois fut formé, qui devint à cette époque le plus grand et l'un des États les plus forts de la Méditerranée occidentale. Il comprenait -
- la côte nord de l'Afrique à l'ouest de la Cyrénaïque grecque et un certain nombre de zones intérieures de ce continent, ainsi qu'une petite partie de la côte atlantique immédiatement au sud des Colonnes d'Hercule ;
- la partie sud-ouest de l'Espagne et une partie importante des îles Baléares au large de la côte orientale de ce pays ;
- la Sardaigne (en fait seulement une partie) ;
- Villes phéniciennes de l'ouest de la Sicile ;
- îles entre la Sicile et l'Afrique.
La situation intérieure de l'État carthaginois
Position des villes, alliés et sujets de Carthage

Le dieu suprême des Carthaginois est Baal Hammon. Terre cuite. je siècle ANNONCE Carthage.
Ce pouvoir était un phénomène complexe. Son noyau était constitué de Carthage elle-même et du territoire qui lui était directement subordonné - Chora. Chora était située directement à l'extérieur des murs de la ville et était divisée en districts territoriaux distincts, gouvernés par un fonctionnaire spécial ; chaque district comprenait plusieurs communautés.
Avec l'expansion de la puissance carthaginoise, des possessions non africaines furent parfois incluses dans le chœur, comme la partie de la Sardaigne capturée par les Carthaginois. Une autre composante du pouvoir étaient les colonies carthaginoises, qui exerçaient une surveillance sur les terres environnantes, étaient dans certains cas des centres de commerce et d'artisanat et servaient de réservoir pour absorber la population « excédentaire ». Ils avaient certains droits, mais étaient sous le contrôle d'un résident spécial envoyé de la capitale.
Le pouvoir comprenait les anciennes colonies de Tyr. Certains d'entre eux (Gades, Utica, Kossoura) étaient officiellement considérés comme égaux à la capitale, d'autres occupaient légalement une position inférieure. Mais la position officielle et le véritable rôle de ces villes dans le pouvoir ne coïncidaient pas toujours. Ainsi, Utique était pratiquement complètement subordonnée à Carthage (ce qui a conduit plus d'une fois au fait que cette ville, dans des conditions favorables, a pris une position anti-carthaginoise), et aux villes juridiquement inférieures de Sicile, dans la loyauté desquelles les Carthaginois étaient particulièrement intéressés, jouissaient d’importants privilèges.
Le pouvoir comprenait des tribus et des villes soumises à Carthage. Il s'agissait de Libyens en dehors de la Chora et de tribus soumises de Sardaigne et d'Espagne. Ils occupaient également des positions différentes. Les Carthaginois ne s'immiscent pas inutilement dans leurs affaires intérieures, se limitant à prendre des otages, à les recruter pour le service militaire et à un impôt assez lourd.
Les Carthaginois régnaient également sur leurs « alliés ». Ils se gouvernaient eux-mêmes, mais étaient privés d'initiative en matière de politique étrangère et devaient fournir des contingents à l'armée carthaginoise. Leur tentative d’échapper à la soumission aux Carthaginois fut considérée comme une rébellion. Certains d'entre eux étaient également soumis à des impôts, leur fidélité étant assurée par des otages. Mais plus on s'éloignait des frontières du pouvoir, plus les rois, dynastes et tribus locaux devenaient indépendants. Une grille de divisions territoriales s'est superposée à l'ensemble de ce conglomérat complexe de villes, de peuples et de tribus.
Économie et structure sociale

La création du pouvoir a entraîné des changements importants dans la structure économique et sociale de Carthage. Avec l'avènement de propriétés foncières, où se trouvaient les domaines des aristocrates, une agriculture variée commença à se développer à Carthage. Cela fournissait encore plus de nourriture aux marchands carthaginois (cependant, les marchands étaient souvent eux-mêmes de riches propriétaires terriens), ce qui stimula la croissance du commerce carthaginois. Carthage devient l'un des plus grands centres commerciaux de la Méditerranée.
Un grand nombre de populations subordonnées apparaissent, situées à différents niveaux de l'échelle sociale. Tout en haut de cette échelle se trouvait l'aristocratie carthaginoise propriétaire d'esclaves, qui constituait le sommet de la citoyenneté carthaginoise - le « peuple de Carthage », et tout en bas se trouvaient les esclaves et les groupes apparentés de la population dépendante. Entre ces extrêmes, il y avait toute une gamme d'étrangers, de « métecs », les soi-disant « hommes sidoniens » et d'autres catégories de la population incomplète, semi-dépendante et dépendante, y compris les résidents des territoires subordonnés.
Un contraste est apparu entre la citoyenneté carthaginoise et le reste de la population de l'État, y compris les esclaves. Le collectif civil lui-même se composait de deux groupes -
- aristocrates, ou « puissants », et
- « petit », c'est-à-dire plèbe.
Malgré la division en deux groupes, les citoyens agissaient ensemble comme une association naturelle et cohérente d'oppresseurs, intéressés par l'exploitation de tous les autres habitants de l'État.
Système de propriété et de pouvoir à Carthage
La base matérielle de la collectivité civile était la propriété communale, qui se présentait sous deux formes : la propriété de la communauté entière (par exemple, un arsenal, des chantiers navals, etc.) et la propriété des citoyens individuels (terres, ateliers, magasins, navires, sauf ceux d'État, notamment militaires, etc.) d.). A côté de la propriété communale, il n'y avait pas d'autre secteur. Même la propriété des temples fut placée sous le contrôle de la communauté.

Sarcophage de la prêtresse. Marbre. IV-III siècles AVANT JC. Carthage.
Le collectif civil possédait également, en théorie, le plein pouvoir d’État. Nous ne savons pas exactement quelles positions ont été occupées par Malchus, qui a pris le pouvoir, et par les Magonides qui sont venus après lui pour diriger l'État (les sources à cet égard sont très contradictoires). En fait, leur situation semblait ressembler à celle des tyrans grecs. Sous la direction des Magonides, l'État carthaginois fut effectivement créé. Mais ensuite, il sembla aux aristocrates carthaginois que cette famille était devenue « difficile pour la liberté de l'État » et les petits-enfants de Mago furent expulsés. Expulsion des Magonides au milieu du Ve siècle. AVANT JC. a conduit à l’instauration d’une forme de gouvernement républicain.
Le plus haut pouvoir de la république, au moins officiellement, et même dans les moments critiques, appartenait à assemblée populaire, incarnant la volonté souveraine du collectif civil. En fait, le leadership était exercé par des conseils et des magistrats oligarchiques élus parmi les citoyens riches et nobles, principalement deux sufets, entre les mains desquels le pouvoir exécutif était détenu tout au long de l'année.

Le peuple ne pouvait intervenir dans les affaires du gouvernement qu'en cas de désaccords entre les dirigeants, survenant en période de crise politique. Le peuple avait également le droit de choisir, bien que très limité, les conseillers et les magistrats. De plus, le « peuple de Carthage » était apprivoisé de toutes les manières possibles par les aristocrates, qui leur faisaient partager les bénéfices de l'existence du pouvoir : non seulement les « puissants », mais aussi les « petits » profitaient de l'existence du pouvoir. la puissance maritime et commerciale de Carthage, les personnes envoyées en supervision étaient recrutées parmi la « plèbe » au dessus des communautés et tribus subordonnées, la participation aux guerres offrait un certain avantage, car, malgré la présence d'une importante armée de mercenaires, les citoyens n'étaient toujours pas complètement séparés depuis service militaire, ils étaient représentés à différents niveaux de l'armée de terre, des simples soldats aux commandants, et surtout dans la marine.
Ainsi, une collectivité civile autosuffisante s'est constituée à Carthage, possédant un pouvoir souverain et s'appuyant sur la propriété communale, à côté de laquelle il n'y avait ni pouvoir royal au-dessus de la citoyenneté ni secteur non communal en termes socio-économiques. Par conséquent, nous pouvons dire que la polis est née ici, c'est-à-dire cette forme d'organisation économique, sociale et politique des citoyens, caractéristique de la version ancienne de la société antique. En comparant la situation de Carthage avec celle de la métropole, il convient de noter que les villes de Phénicie elle-même, avec tout le développement de l'économie marchande, sont restées dans le cadre de la version orientale du développement de la société antique, et Carthage est devenue un état ancien.
La formation de la polis carthaginoise et la formation d'un pouvoir furent le contenu principal de la deuxième étape de l'histoire de Carthage. La puissance carthaginoise est née lors de la lutte acharnée des Carthaginois contre la population locale et les Grecs. Les guerres avec ces derniers étaient de nature nettement impérialiste, car elles visaient à s’emparer et à exploiter des territoires et des peuples étrangers.
L'essor de Carthage
De la seconde moitié du Ve siècle. AVANT JC. La troisième étape de l’histoire carthaginoise commence. Le pouvoir était déjà créé et on parlait désormais de son expansion et de ses tentatives d’établir une hégémonie en Méditerranée occidentale. Le principal obstacle à cela était initialement les mêmes Grecs occidentaux. En 409 avant JC. Le commandant carthaginois Hannibal débarqua à Motia et une nouvelle série de guerres commença en Sicile, qui dura par intermittence pendant plus d'un siècle et demi.

Cuirasse en bronze doré. III-II siècles AVANT JC. Carthage.
Au départ, le succès pencha vers Carthage. Les Carthaginois soumettirent les Élims et les Sicans qui vivaient dans l'ouest de la Sicile et lancèrent une attaque contre Syracuse, la ville grecque la plus puissante de l'île et l'ennemi le plus implacable de Carthage. En 406, les Carthaginois assiégèrent Syracuse, et seule la peste qui commença dans le camp carthaginois sauva les Syracusains. Monde 405 avant JC assigna la partie occidentale de la Sicile à Carthage. Certes, ce succès s'est avéré fragile, et la frontière entre la Sicile carthaginoise et la Sicile grecque est toujours restée palpitante, se déplaçant soit vers l'est, soit vers l'ouest selon que l'un ou l'autre des côtés réussissait.
Les échecs de l'armée carthaginoise ont presque immédiatement répondu à l'aggravation des contradictions internes à Carthage, notamment de puissants soulèvements de Libyens et d'esclaves. Fin du Ve – première moitié du IVe siècle. AVANT JC. C’était une époque d’intenses affrontements au sein de la citoyenneté, à la fois entre des groupes distincts d’aristocrates et, apparemment, entre la « plèbe » impliquée dans ces affrontements et les groupes aristocratiques. En même temps, les esclaves se soulevaient contre leurs maîtres, et les peuples soumis contre les Carthaginois. Et ce n'est qu'avec le calme au sein de l'État que le gouvernement carthaginois fut capable au milieu du IVe siècle. AVANT JC. reprendre l’expansion externe.

Les Carthaginois établirent alors leur contrôle sur le sud-est de l’Espagne, ce qu’ils avaient tenté en vain de faire un siècle et demi plus tôt. En Sicile, ils lancent une nouvelle offensive contre les Grecs et remportent de nombreux succès, se retrouvant à nouveau sous les murs de Syracuse et capturant même leur port. Les Syracusains ont été contraints de se tourner vers leur métropole Corinthe pour obtenir de l'aide, et de là est arrivée une armée dirigée par le commandant compétent Timoléon. Le commandant des forces carthaginoises en Sicile, Hannon, ne parvint pas à empêcher le débarquement de Timoléon et fut rappelé en Afrique, tandis que son successeur fut vaincu et dégagea le port de Syracuse. Hannon, de retour à Carthage, décide de profiter de la situation qui se présente à ce sujet et de prendre le pouvoir. Après l'échec du coup d'État, il a fui la ville, a armé 20 000 esclaves et a appelé les Libyens et les Maures aux armes. La rébellion fut vaincue, Hannon et tous ses proches furent exécutés et seul son fils Gisgon réussit à échapper à la mort et fut expulsé de Carthage.

Cependant, bientôt la tournure des affaires en Sicile obligea le gouvernement carthaginois à se tourner vers Gisgono. Les Carthaginois subirent une sévère défaite face à Timoléon, puis une nouvelle armée dirigée par Gisgon y fut envoyée. Gisgon a conclu une alliance avec certains des tyrans des villes grecques de l'île et a vaincu des détachements individuels de l'armée de Timoléon. Cela a été autorisé en 339 avant JC. conclure une paix relativement bénéfique pour Carthage, selon laquelle il conservait ses possessions en Sicile. Après ces événements, la famille Hannonide est devenue pendant longtemps la plus influente de Carthage, même si l'on ne pouvait parler d'aucune tyrannie, comme ce fut le cas des Magonides.
Les guerres avec les Grecs de Syracuse se poursuivirent comme d'habitude et avec plus ou moins de succès. A la fin du IVe siècle. AVANT JC. les Grecs débarquèrent même en Afrique, menaçant directement Carthage. Le commandant carthaginois Bomilcar décide de profiter de l'occasion et de prendre le pouvoir. Mais les citoyens se sont prononcés contre lui et ont réprimé la rébellion. Et bientôt les Grecs furent repoussés des murs carthaginois et retournèrent en Sicile. La tentative du roi d'Épire Pyrrhus d'expulser les Carthaginois de Sicile dans les années 70 a également échoué. IIIe siècle AVANT JC. Toutes ces guerres interminables et fastidieuses montraient que ni les Carthaginois ni les Grecs n'avaient la force de se prendre la Sicile.
L'émergence d'un nouveau rival - Rome
La situation a changé dans les années 60. IIIe siècle BC, lorsqu'un nouveau prédateur est intervenu dans ce combat - Rome. En 264, éclate la première guerre entre Carthage et Rome. En 241, cela se termina par la perte totale de la Sicile.

Cette issue de la guerre a exacerbé les contradictions à Carthage et y a donné lieu à une crise interne aiguë. Sa manifestation la plus frappante fut un puissant soulèvement, auquel participèrent des soldats mercenaires, mécontents du non-paiement de l'argent qui leur était dû, la population locale, qui cherchait à se débarrasser de la lourde oppression carthaginoise, et les esclaves qui détestaient leurs maîtres. Le soulèvement a eu lieu à proximité immédiate de Carthage, couvrant probablement aussi la Sardaigne et l'Espagne. Le sort de Carthage était en jeu. Avec beaucoup de difficulté et au prix d'une cruauté incroyable, Hamilcar, auparavant devenu célèbre en Sicile, réussit à réprimer ce soulèvement, puis se rendit en Espagne, poursuivant la « pacification » des possessions carthaginoises. La Sardaigne a dû dire au revoir, la perdant face à Rome, ce qui a menacé une nouvelle guerre.
Le deuxième aspect de la crise est le rôle croissant de la citoyenneté. La base, qui détenait en théorie le pouvoir souverain, cherchait désormais à transformer la théorie en pratique. Un « parti » démocratique est né, dirigé par Hasdrubal. Une scission s’est également produite au sein de l’oligarchie, au cours de laquelle deux factions ont émergé.
- L'un était dirigé par Hannon, issu de l'influente famille Hannonide - ils défendaient une politique prudente et pacifique excluant un nouveau conflit avec Rome ;
- et l'autre - Hamilcar, représentant la famille Barkids (surnommé Hamilcar - Barca, lit., "éclair") - ils étaient actifs, dans le but de se venger des Romains.
La montée des Barcides et la guerre avec Rome

Vraisemblablement un buste d'Hannibal Barca. Trouvé à Capoue en 1932
De larges cercles de citoyens étaient également intéressés par la vengeance, pour qui l'afflux de richesses des terres soumises et du monopole du commerce maritime était bénéfique. Ainsi naquit une alliance entre les Barcides et les Démocrates, scellée par le mariage d'Hasdrubal avec la fille d'Hamilcar. S'appuyant sur le soutien de la démocratie, Hamilcar parvient à vaincre les machinations de ses ennemis et à se rendre en Espagne. En Espagne, Hamilcar et ses successeurs de la famille Barcid, dont son gendre Hasdrubal, agrandirent considérablement les possessions carthaginoises.
Après le renversement des Magonides, les cercles dirigeants de Carthage n'ont pas permis l'unification des fonctions militaires et civiles entre les mêmes mains. Cependant, pendant la guerre avec Rome, ils commencèrent à pratiquer des choses similaires, à l'instar des États hellénistiques, mais pas au niveau national, comme c'était le cas sous les Magonides, mais au niveau local. Telle était la puissance des Barkides en Espagne. Mais les Barkides exerçaient leur pouvoir sur la péninsule ibérique de manière indépendante. Le fort recours à l'armée, les liens étroits avec les cercles démocratiques de Carthage même et les relations privilégiées établies entre les Barcides et la population locale ont contribué à l'émergence en Espagne d'un pouvoir barcide semi-indépendant, essentiellement de type hellénistique.
Hamilcar considérait déjà l'Espagne comme un tremplin pour nouvelle guerre avec Rome. Son fils Hannibal en 218 avant JC provoqué cette guerre. La Seconde Guerre Punique commença. Hannibal lui-même est allé en Italie, laissant son frère en Espagne. Les opérations militaires se déroulèrent sur plusieurs fronts et les commandants carthaginois (en particulier Hannibal) remportèrent un certain nombre de victoires. Mais la victoire dans la guerre revenait à Rome.
Monde 201 avant JC privé Carthage de la marine et de toutes les possessions non africaines et contraint les Carthaginois à reconnaître l'indépendance de la Numidie en Afrique, au roi duquel les Carthaginois devaient restituer toutes les possessions de ses ancêtres (cet article plaçait une « bombe à retardement » sous Carthage) , et les Carthaginois eux-mêmes n'avaient pas le droit de faire la guerre sans la permission de Rome. Cette guerre a non seulement privé Carthage de sa position de grande puissance, mais a également limité considérablement sa souveraineté. La troisième étape de l'histoire carthaginoise, qui commença sous de si heureux présages, se termina par la faillite de l'aristocratie carthaginoise, qui dirigeait la république depuis si longtemps.
Position interne

A ce stade, il n’y a pas eu de transformation radicale dans la vie économique, sociale et politique de Carthage. Mais certains changements ont quand même eu lieu. Au 4ème siècle. AVANT JC. Carthage commença à frapper ses propres pièces de monnaie. Une certaine hellénisation d'une partie de l'aristocratie carthaginoise se produit et deux cultures émergent dans la société carthaginoise, ce qui est typique du monde hellénistique. Comme dans les États hellénistiques, dans un certain nombre de cas, le pouvoir civil et militaire était concentré entre les mêmes mains. En Espagne, un pouvoir Barkid semi-indépendant a émergé, dont les chefs se sentaient proches des dirigeants du Moyen-Orient de l'époque, et où apparaissait un système de relations entre les conquérants et la population locale, similaire à celui existant dans les États hellénistiques. .
Carthage possédait de vastes étendues de terres propices à la culture. Contrairement aux autres cités-États phéniciennes, Carthage a développé de grandes plantations agricoles à grande échelle, employant la main-d'œuvre de nombreux esclaves. L'économie des plantations de Carthage a joué un rôle dans l'histoire économique ancien monde un rôle très important, car il a influencé le développement du même type d’économie esclavagiste, d’abord en Sicile puis en Italie.
Au VIe siècle. AVANT JC. ou peut-être au 5ème siècle. AVANT JC. à Carthage vivait l'écrivain et théoricien de l'économie esclavagiste des plantations Mago, dont la grande œuvre jouissait d'une telle renommée que l'armée romaine assiégea Carthage au milieu du IIe siècle. J.-C., un ordre fut donné pour conserver cette œuvre. Et c'était vraiment sauvé. Par décret du Sénat romain, l'œuvre de Magon fut traduite du phénicien en latin, puis utilisée par tous les théoriciens de l'agriculture de Rome. Pour leur économie de plantation, pour leurs ateliers d'artisanat et pour leurs galères, les Carthaginois avaient besoin d'un grand nombre d'esclaves, choisis par eux parmi les prisonniers de guerre et achetés.
Coucher de soleil de Carthage
La défaite lors de la seconde guerre contre Rome ouvre la dernière étape de l’histoire carthaginoise. Carthage perdit son pouvoir et ses possessions furent réduites à un petit quartier proche de la ville elle-même. Les possibilités d'exploitation de la population non carthaginoise ont disparu. Grands groupes La population dépendante et semi-dépendante échappe au contrôle de l'aristocratie carthaginoise. La superficie agricole diminua fortement et le commerce reprit une importance prédominante.

Récipients en verre pour pommades et baumes. D'ACCORD. 200 avant JC
Si auparavant non seulement la noblesse, mais aussi la « plèbe » bénéficiaient de certains avantages de l'existence du pouvoir, ils ont désormais disparu. Cela a naturellement provoqué une crise sociale et politique aiguë, qui dépasse désormais les institutions existantes.
En 195 avant JC. Hannibal, devenu soufet, procéda à une réforme système gouvernemental, qui a porté un coup aux fondements mêmes du système précédent avec sa domination de l'aristocratie et a ouvert la voie au pouvoir pratique, d'une part, à de larges couches de la population civile, et d'autre part, aux démagogues qui pouvaient prendre avantage du mouvement de ces couches. Dans ces conditions, une lutte politique acharnée s’est déroulée à Carthage, reflétant de vives contradictions au sein du collectif civil. Tout d’abord, l’oligarchie carthaginoise réussit à se venger, avec l’aide des Romains, obligeant Hannibal à fuir sans achever l’œuvre qu’il avait commencée. Mais les oligarques n’ont pas réussi à maintenir intact leur pouvoir.
Vers le milieu du IIe siècle. AVANT JC. Trois factions politiques se sont battues à Carthage. Au cours de cette lutte, Hasdrubal devint la figure de proue du groupe anti-romain et sa position conduisit à l'établissement d'un régime similaire à la tyrannie mineure grecque. La montée d'Hasdrubal effraya les Romains. En 149 avant JC. Rome entame une troisième guerre avec Carthage. Cette fois, pour les Carthaginois, il ne s'agissait plus de domination sur certains sujets ni d'hégémonie, mais de leur propre vie et de leur mort. La guerre se résumait pratiquement au siège de Carthage. Malgré la résistance héroïque des citoyens, en 146 av. la ville tomba et fut détruite. La plupart des citoyens sont morts pendant la guerre et les autres ont été réduits en esclavage par les Romains. L’histoire de la Carthage phénicienne est terminée.
L'histoire de Carthage montre le processus de transformation de la ville orientale en un ancien État et la formation d'une polis. Et devenue une polis, Carthage connaît également une crise de cette forme d’organisation de la société antique. Dans le même temps, il faut souligner que nous ne savons pas quelle pourrait être la sortie de crise ici, puisque le cours naturel des événements a été interrompu par Rome, qui a porté un coup fatal à Carthage. Les villes phéniciennes de la métropole, qui se sont développées dans des conditions historiques différentes, sont restées dans le cadre de la version orientale du monde antique et, étant devenues une partie des États hellénistique, se sont déjà engagées en leur sein sur une nouvelle voie historique.
Le livre est consacré à l'histoire des Phéniciens - un petit peuple guerrier qui a forcé tous les États puissants de l'ancienne Méditerranée à compter avec eux-mêmes. Il raconte en détail les mœurs et coutumes, les rituels religieux et laïques des Phéniciens, les magnifiques maîtres des bijoux et des armes, de l'ivoire, de la pierre, de la sculpture sur métal, et décrit également l'histoire de la création de l'alphabet ancien - la plus haute réalisation. de la culture phénicienne, qui a eu une puissante influence sur toutes les civilisations ultérieures de l’Ancien Monde.
PRÉFACE
Naturellement, dans un petit livre consacré à un sujet aussi vaste, il est impossible de satisfaire pleinement les besoins de l'auteur et du lecteur. Certains aspects de l’histoire et de la culture des Phéniciens ne sont pas du tout abordés ; d'autres ne sont couverts que superficiellement. Cependant, j'espère que ce livre donnera idée générale sur les Phéniciens de l'époque où ce peuple relativement petit constituait une force avec laquelle il fallait compter dans toute la Méditerranée et au-delà. Ces travaux contribueront également à établir la place des Phéniciens dans l’histoire des nations.
Décrivant les origines du peuple, j'ai essayé de séparer les Phéniciens de la côte des Cananéens (Cananéens) en général et j'ai même omis histoire ancienne cette région, puisque ce n'est qu'à la fin de l'âge du bronze qu'apparaissent les termes « Phénicie » et « Phéniciens » dans le sens tel que nous les comprenons aujourd'hui. Cette approche expliquera, sinon excusera, pourquoi j'ai accordé si peu d'attention aux grandes fouilles françaises de Byblos et d'Ougarit.
Littérature sur les Phéniciens à différentes langues si vaste qu'une vie ne suffirait pas pour s'en familiariser. J'ai utilisé de nombreuses sources et je dois constater que très souvent les auteurs ont des points de vue directement opposés.
Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage d'expliquer les divergences d'opinion et de laisser le lecteur se forger sa propre opinion. Je note quelques désaccords dans le texte ou dans les notes, mais je présente surtout un point de vue, en omettant la controverse.
Au cours des cent dernières années, de nombreuses fouilles archéologiques ont été réalisées sur le territoire phénicien, et toutes n'étaient pas de nature scientifique. Les fouilles les plus productives et probablement les plus professionnelles ont été les fouilles du siècle dernier en Afrique du Nord, notamment à Carthage, subventionnées par le gouvernement français. Des fouilles ont également été réalisées en Phénicie et en Sardaigne. Sans aucun doute, lorsque tous les résultats seront publiés, ils invalideront certaines de mes affirmations et suppositions, mais si j'avais attendu de nouvelles preuves, ce livre n'aurait jamais vu le jour, et donc je ne m'excuse pas pour sa parution dans ce formulaire.
Parmi les monuments culturels du monde antique, détruits non seulement par le passage impitoyable du temps, mais aussi par les guerres, se distingue la cité-état de Carthage. Autrefois la plus grande ville, rivale de Rome, fondée par d'habiles marins - les Phéniciens, elle pendant longtemps dominait toute la Méditerranée. Cependant, Carthage ne put résister aux coups des légions romaines de fer ; il a été capturé et détruit. Il ne reste plus grand-chose de Carthage aujourd'hui, et même les monuments qui frappent l'œil du voyageur n'appartiennent pas à Carthage elle-même, mais sont des bâtiments romains ultérieurs sur le territoire de la majestueuse ville. Ma nouvelle d'aujourd'hui, chers lecteurs, est une tentative de faire revivre les pages de l'histoire, de faire surgir des sables du temps une ville qui fut autrefois l'un des centres de culture et de commerce d'Afrique du Nord.

Les Phéniciens étaient d'habiles marins et atteignaient les côtes les plus lointaines à bord de leurs navires. Le principal territoire qu’ils ont choisi pour poursuivre leur colonisation était l’Afrique du Nord. Sur le territoire de la Tunisie moderne, les marins phéniciens fondèrent plusieurs colonies, parmi lesquelles Carthage - en phénicien " Kart-Hadasht», ce qui signifie en traduction « Nouvelle ville" C'est ainsi qu'elle a été nommée par opposition à la colonie plus ancienne. Utique. Grâce à sa situation géographique idéale, Carthage est rapidement devenue un centre majeur de commerce intermédiaire, entretenant des liens étroits avec les pays de la Méditerranée orientale, du bassin égéen et de l'Italie.
En VIII – 7ème siècles AVANT JC. Carthage elle-même devint propriétaire de plusieurs colonies fondées sur la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord et sur l'île d'Ebes. Le retrait des colonies de cette manière a, d'une part, consolidé la domination de Carthage sur les routes commerciales au sud de la péninsule ibérique, et d'autre part, a permis d'éloigner de la ville les représentants des classes sociales inférieures qui pourraient causer des troubles. et s'opposer à l'oppression et à la domination de l'aristocratie. Selon Aristote, le système politique et la politique sociale de Carthage ressemblaient à ceci : « Bien que la structure de l'État carthaginois soit marquée par la nature de la domination des possédants, les Carthaginois ont réussi à se sauver de l'indignation du peuple en lui donnant la possibilité de s'enrichir. À savoir, ils envoient constamment une partie de la population vers les villes et régions soumises à Carthage. Grâce à cela, les Carthaginois guérissent leur système politique et lui donnent de la stabilité.”.

Cette politique a été adoptée par Carthage depuis la métropole, qui était à l'époque la ville Champ de tir, dont les autorités expulsaient de temps à autre plusieurs milliers de ses citoyens pour créer leurs propres colonies sur les côtes de la mer Méditerranée. Par la suite, Carthage, étant une colonie de Tyr, devint elle-même la métropole de plusieurs colonies phéniciennes plus faibles de la Méditerranée occidentale. Avoir un position géographique dans une vallée fertile, au bord du golfe de Tunis, formant des ports commodes protégés des vents orageux, Carthage en profita et devint le centre de l'activité de colonisation phénicienne. À cette époque, Carthage était un État oligarchique, dont le pouvoir était entre les mains de groupes individuels de l'aristocratie commerciale et agricole, luttant constamment entre eux pour la primauté de l'influence et du pouvoir. Outre le pouvoir oligarchique, il existait également à Carthage un pouvoir royal. Le nom du légendaire fondateur de Carthage est connu Élissa, qui dans les sources s'appelle « reine" Cependant, après sa mort, le pouvoir est passé à Conseil des Dix, avec lequel il y avait aussi Conseil des Anciens.
Dans la seconde moitié du VIe siècle avant JC. le commandant Malchus Il établit à Carthage sa dictature militaire, basée sur les milices populaires, mais qui ne durera pas longtemps. La dictature de Malchus a été remplacée par une dictature oligarchique Magonidov qui s'appuyait sur une armée de mercenaires. Au milieu du Ve siècle avant JC. Le pouvoir des Magonides fut en fait remplacé par une forme de gouvernement républicain. Conseil des Dix a été converti en Conseil des Trente, a été élargi et Conseil des Anciens- de cent à trois cents personnes. Cet État était une république oligarchique et esclavagiste. Contrairement aux autres colonies phéniciennes, Carthage possédait une économie de plantations foncières à grande échelle, facilitée par la présence d'espaces importants propices à la culture. Le travail des esclaves était largement utilisé dans l’économie des plantations.

L’économie de plantation de Carthage a joué un rôle économique important dans l’histoire du monde antique, car elle a influencé le développement du même type d’économie, d’abord en Sicile puis dans toute l’Italie. Il suffit de dire que
œuvres d'un écrivain et théoricien de l'économie des plantations Magona, qui vécut à Carthage au 6ème ou 5ème siècle avant JC, sur ordre du Sénat de Rome au 2ème siècle avant JC. ont été traduits en latin et distribués dans toute l'Italie. Les travaux de Mago ont été utilisés par tous les théoriciens de l'agriculture à Rome.
Une autre caractéristique importante de Carthage était qu'elle s'est rapidement transformée en un centre majeur de commerce intermédiaire, dont l'ampleur était en constante expansion. Des esclaves et de l'ivoire furent amenés de l'intérieur de l'Afrique à Carthage ; d'Asie occidentale - tissus et tapis coûteux ; l'or et l'argent venaient d'Espagne et l'étain de Grande-Bretagne. De la Corse et des Baléares, Carthage recevait de la cire et de l'huile. Le vin et l'artisanat grec étaient fournis par la Sicile.

Carthage a développé une politique colonialiste des villes phéniciennes de la Méditerranée occidentale, poursuivant principalement l'objectif de déplacer les Grecs de cette région, dans laquelle
ils ont commencé à pénétrer à partir du 8ème siècle avant JC. Colonies phéniciennes situées sur la côte nord de l'Afrique comme Utique, Hippome, Leptis mineur, Leptis Magna, devint partie intégrante de l'État carthaginois, possédait une structure sociale et politique proche de celle de Carthage et jouissait d'une autonomie interne. Au milieu du 7ème siècle avant JC. Les Carthaginois s'installèrent aux îles Baléares et bientôt
quelque temps après, ils entrèrent en Sardaigne. Fin VIIe - début VIe siècle avant JC. Une lutte acharnée avec les Grecs pour la Sicile commence, qui a duré au total plus de trois siècles. Dans la première moitié du IVe siècle avant JC. Les Carthaginois ont conquis une partie importante de la Sicile et, à la fin du même siècle, ils ont commencé à pénétrer activement en Espagne. En conséquence, les anciennes colonies de Tyr sont entrées en possession de Carthage, qui a étendu la colonisation jusque dans les profondeurs de la péninsule ibérique. La fondation des colonies par Carthage s'accompagne de combats acharnés. Par exemple, en Espagne, les tribus ibériques ont mené une lutte de longue durée pour leur indépendance depuis Enfers, l'une des plus anciennes colonies phéniciennes. La ville fut prise par eux et les Carthaginois durent l'assiéger pendant longtemps. Hadès fut pris d'assaut par l'armée carthaginoise, avec de lourdes pertes des deux côtés. Les Carthaginois rencontrèrent également la résistance de la population locale lors de la colonisation de la Sardaigne.
Cependant, Carthage a mené la guerre la plus longue avec les belliqueux Grecs, avec lesquels des affrontements ont eu lieu lors de la colonisation du sud de la France, de l'Espagne et enfin du stade initial combat pour la Sicile. Dans cette lutte complexe, la puissance navale de Carthage s'est renforcée, son appareil d'État est devenu plus fort, adapté non seulement à l'oppression des esclaves et des populations dépendantes, mais également conçu pour réaliser les aspirations agressives de l'élite dirigeante de la société carthaginoise. À cette époque, la puissance créée par Carthage comprenait l’Afrique du Nord, l’ouest de la Sicile, le sud de l’Espagne et la Sardaigne.

Le sort de Carthage était triste. Dans la lutte contre Rome, la ville n'a pas pu résister ; a été détruit. Et seulement un siècle et demi plus tard, une colonie romaine fut érigée sur le site de l'ancienne ville glorieuse, qui existait jusqu'au 5ème siècle après JC. Aujourd'hui, Carthage, une banlieue tunisienne, est un centre de pèlerinage pour les touristes et les voyageurs du monde entier.
De toutes les villes phéniciennes, Carthage est la plus importante de notre histoire. Il devint encore plus célèbre que son fondateur Tyr, et son rôle dominant dans toute la Phénicie occidentale fut incontesté du 7e, voire du 8e siècle, jusqu'à sa mort en 146 av. e. De plus, plus d’informations archéologiques et littéraires ont été conservées sur Carthage que sur toute autre ville phénicienne.
La date généralement acceptée pour la fondation de Carthage est 814-813. avant JC e. Philistus, historien sicilien cité par Eusèbe, évoque la fondation de Carchedon par Tzor à la fin du XIIIe siècle. Il est évident que Tzor est le nom mythique de Tyr, et Carchedon est le nom grec de Carthage. Cependant, malgré les doutes de certains scientifiques modernes, la date traditionnelle est 814-813. a de solides justifications et coïncide assez bien avec les découvertes archéologiques et faits historiques. Les premières poteries trouvées dans les tombes puniques et les couches les plus basses du sanctuaire Tinnit, y compris le « petit temple » de Sintas, peuvent être datées avec certitude du 8ème siècle avant JC. e. Elissa (Dido) et son frère ne sont pas mythiques, mais personnages historiques. Puisque la grand-tante d'Elissa, Jézabel, a épousé Achab dans le deuxième quart du IXe siècle, il ne faut pas s'étonner que le départ d'Elissa pour Carthage soit attribué à la fin de ce siècle. Avec un groupe d'aristocrates tyriens opposés au roi, Elissa, selon les récits de plusieurs auteurs anciens (cette histoire est décrite de manière plus complète par Justin), se rendit d'abord à Chypre, où elle fut rejointe par le prêtre du temple de Junon. avec sa famille et quatre-vingts filles, puis toute la compagnie s'embarqua directement vers Carthage. Là, ils étaient d'accord avec résidents locaux sur l'achat d'un terrain aussi grand qu'une peau de bœuf pourrait le couvrir. Lorsque la peau était découpée en plusieurs fines bandes, la zone s'est avérée importante et elle a été appelée Byrsa (en grec pour « peau »). Cependant, certains chercheurs pensent que ce mot pourrait être une adaptation grecque du mot sémitique signifiant forteresse. Un peu plus tard, le nom de Birsa fut utilisé pour désigner la citadelle de Carthage et désigne désormais la colline Saint-Louis sur laquelle elle était située. Le bon sens suggère que la première colonie ne pouvait pas être située aussi loin de la mer, mais à proximité d'une plage pratique. Il ne fait aucun doute que tel était le cas. La colonie occupait une zone plate près de deux lagunes au nord du Crams. Cependant, les détails de la topographie historique de Carthage sont très complexes et incertains.
Carthage prospéra immédiatement après sa fondation, éclipsant Motia et Utique, et devint bientôt, à la fin du VIIIe siècle, la principale ville phénicienne de la Méditerranée centrale, capable d'empêcher l'avancée des Grecs (Fig. 14). Première action menée par Carthage et mentionnée par les historiens antiques : la fondation d'une colonie à Ibiza en 654 - 653 av. e. Un demi-siècle plus tard, en 600, Carthage tenta en vain d'empêcher les Phocéens de fonder Massalia. Un demi-siècle plus tard, le commandant carthaginois Malchus vainquit les Grecs en Sicile, mais fut vaincu en Sardaigne et expulsé. Il revint ensuite à Carthage, mais pas pour longtemps. Son successeur Mago (fondateur de l'influente dynastie punique des Magonides), ainsi que ses fils Hasdrubal et Hamilcar, ont continué à entrer en conflit avec les Grecs. En 535, la flotte combinée étrusque et carthaginoise vainquit les Phocéens en bataille navaleà Alalia en Corse. En conséquence, toutes les tentatives des Grecs pour prendre pied en Corse et en Sardaigne ont pris fin.
Riz. 14. Carte de la Méditerranée centrale illustrant les guerres de Carthage avec la Grèce
La puissance des Étrusques déclinait. Rome renversa les rois Tarquin (étrusques) en 510 avant JC. e. et devint une république indépendante, et dès l'année suivante - quel fait étonnant et significatif - elle conclut un accord avec Carthage, définissant des sphères d'influence communes. Dans la nouvelle répartition des forces, Carthage voyait sans aucun doute la possibilité d'une prospérité accrue, mais elle ne pouvait guère soupçonner l'imminence d'une sérieuse concurrence pour la domination mondiale. Les véritables ennemis de Carthage restent les Grecs. La patrie phénicienne était déjà tombée sous la domination perse et les Perses étaient déterminés à attaquer la Grèce continentale. Lors de la deuxième campagne perse sous la direction de Xerxès en 480, les Carthaginois, incités soit par la Perse, soit par leur ville fondatrice, équipèrent une expédition à Panormus et furent vaincus à Himère par l'armée de Syracuse et d'Agrigente le même jour à Salamine. les Grecs ont vaincu la flotte perse, dont une grande partie était composée de Phéniciens.
Après avoir subi une défaite si écrasante, les Carthaginois se précipitèrent vers l'ouest avec encore plus de détermination. Des colonies furent fondées et renforcées le long de la côte nord-africaine, ainsi que les voyages d'Hannon et d'Himilcon vers 425 av. e. démontrent l'éveil de l'intérêt de Carthage pour les terres lointaines au-delà des colonnes d'Hercule (Fig. 50). Si l'on en croit ces descriptions (et le très critiqué Périple d'Hannon contient certainement des faits crédibles), alors il faut admettre que Carthage cherchait à développer le commerce avec l'Occident et à ouvrir routes maritimes non seulement aux ressources du continent africain, mais aussi à l'étain de la Bretagne et de la Cornouaille, dont il fut coupé par les Grecs, qui se fortifièrent sur les rives méridionales de la Gaule.
Pour atteindre ces objectifs, Carthage a dû contacter la population locale d'Afrique du Nord. Nous savons que les premiers colons ont accepté de payer les Libyens pour les terres qu'ils occupaient, et à l'époque dont nous parlons, Carthage était devenue si forte qu'elle avait soumis les Libyens et acquis de vastes territoires à l'intérieur des terres, y compris les terres fertiles de la Tunisie. , en particulier dans la vallée de la rivière Bagrad et dans la vallée côtière au-delà de Hadrumet (Sus) (Fig. 14). Ces terres ont contribué à nourrir une population croissante. Carthage avait également besoin de mercenaires libyens pour ses guerres.
Dans la dernière décennie du Ve siècle avant JC. e. Un grave conflit militaire éclate entre Carthage et les Grecs siciliens, dirigés par Denys de Syracuse. Carthage fut initialement victorieuse, mais en 398 Denys pilla Motia, qui n'était plus destinée à renaître, et réinstalla ses habitants dans la nouvelle ville voisine, Lilybaeum (actuelle Marsala). Les combats ne s'arrêtèrent qu'en 338, lorsque la paix fut conclue avec le commandant grec Timoléon. Un calme alarmant dura près de vingt ans, jusqu'à ce qu'Agathocle, le tyran de Syracuse, déclara de nouveau la guerre, et, vaincu en Sicile, eut l'audace d'envahir les territoires carthaginois d'Afrique, débarquant au Cap Bon. Les batailles, dans lesquelles aucun des deux camps ne parvint à vaincre l'autre, se poursuivirent jusqu'à la mort d'Agathocle en 289. Dix ans plus tard, alors que les Romains dominaient déjà le sud de l'Italie, Pyrrhus, roi d'Épire, voulut également s'emparer de Carthage, mais mourut bientôt. Il n'y eut plus d'actions militaires directes entre Carthage et les Grecs.
Pendant ce temps, la puissance de Rome grandit rapidement et, dans la seconde moitié du IVe siècle, Carthage jugea prudent de conclure des traités commerciaux avec Rome, ce qui se produisit en 348 et 306. Par le traité de 279, Rome et Carthage s'unissent contre un ennemi commun : Pyrrhus. Le déclin du pouvoir et la mort de Pyrrhus en 272 permettent à Rome de prendre le contrôle de la majeure partie de la péninsule italienne, y compris le sud grec. Naturellement, les yeux de Rome se tournèrent vers la Sicile et huit ans plus tard, en 264, éclata l'inévitable conflit avec Carthage, principalement pour la possession de la Sicile. Cette 1ère guerre punique se termine en 241 par la victoire de Rome dans une bataille navale près des îles Égées. Carthage dut accepter des conditions de paix sévères qui la privèrent complètement de contrôle sur la Sicile et lui imposèrent d'énormes indemnités pour les vingt années suivantes.
Dès lors, la domination de Carthage s'est réduite à l'Afrique du Nord et à l'Espagne. Cependant, les troubles commencèrent bientôt en Afrique du Nord. Utique et d'autres villes souhaitaient se débarrasser du joug carthaginois, et les Libyens exprimèrent également leur mécontentement. Carthage (sans doute affaiblie par les indemnités romaines) fit l'erreur fatale de ne pas payer ses mercenaires, ce qui entraîna une guerre mercenaire qui dura trois ans et demi et affaiblit tellement Carthage qu'après la fin de la guerre, en 238, elle fut contrainte payer Rome pour la neutralité et abandonner la Sardaigne.
Le seul espoir de salut de Carthage restait désormais le développement de l'Empire espagnol. C'était la seule manière pour lui de compenser ses pertes, et le célèbre commandant carthaginois Hamilcar Barca se porta volontaire pour jouer le rôle de sauveur. Hamilcar emmena avec lui son fils Hannibal, âgé de neuf ans, le forçant à jurer une haine éternelle envers Rome. Après la mort d'Hamilcar en 229, son gendre et successeur Hasdrubal fonda la Nouvelle Carthage en 228 et, en 226, il conclut un traité avec Rome qui délimitait les sphères d'influence le long de l'Èbre et consolidait ainsi les conquêtes carthaginoises. Le successeur d'Hasdrubal, tué en 221, fut Hannibal qui, malgré ses vingt-cinq ans, avait une grande influence non seulement dans l'armée en Espagne, mais aussi à Carthage même. Il existe une opinion selon laquelle tous ces commandants sont représentés sur les pièces de monnaie de la Nouvelle Carthage de cette époque. Si tel est le cas, ce sont parmi les très rares portraits puniques connus.
Moins de trois ans plus tard, Hannibal commença une querelle avec Rome à propos de Sagonte et la deuxième guerre punique éclata. Hannibal se rendit en Italie (Fig. 15) avec une immense armée et des éléphants. Comme on le sait, il traversa les Alpes et, bien que de nombreux soldats et presque tous les éléphants périssent au cours de cette dure campagne, il réussit à vaincre les armées romaines, notamment sur le lac Trasimène (217) et à Cannes (216). Les armées romaines en Espagne furent également vaincues et leurs généraux, les Scipions, furent tués. Ce n'est que lorsque Marcellus prit Syracuse (une alliée de Carthage) en 214 que la fortune commença à tourner pour les Romains. Le jeune Publius Cornelius Scipio Africanus, nommé par le peuple pour commander l'armée en Espagne en 210, s'empara de Nouvelle Carthage en 209 et, en 206, il avait soumis toute la Bétique, y compris Hadès. En 204, il envahit l'Afrique. Les Carthaginois firent de nouveau appel à Hannibal et la dernière bataille de la guerre eut lieu à Zama en 202. Des deux dirigeants libyens les plus importants, l’un, Syphax, s’est allié à Carthage et le second, Masinissa, à Rome. Les conditions de paix se sont cette fois révélées encore plus dures. La flotte carthaginoise fut incendiée et son influence réduite à l'est de la Tunisie. Masinissa fut proclamé roi des Numides avec sa capitale à Cirtus (Constantine). Les indemnités étaient énormes, et le plus désagréable était que Carthage n'avait plus le droit de déclencher des guerres avec des étrangers sans le consentement de Rome.
On ne sait rien exactement des activités de Carthage au cours du prochain demi-siècle. Naturellement, il ne put fonder de nouvelles colonies, mais il commerça avec celles existantes, notamment à l'ouest de la côte nord-africaine, sans oublier les liens commerciaux orientaux. Nous en trouvons la preuve dans l’influence croissante de l’art et de la culture hellénistique. Comme nous le racontent des auteurs anciens, l'agriculture a prospéré dans la fertile Tunisie, et l'agriculture, l'élevage et la foresterie se sont développés - la clé du renouveau. Le royaume de Masinissa a également prospéré, adoptant la culture punique et posant ainsi les bases de la prospérité future de cette partie de l'Afrique du Nord.
Cependant, sous couvert d’un traité de paix, Masinissa n’a pas oublié de s’emparer des possessions carthaginoises et la patience de Carthage s’est épuisée. En 150, voulant mettre fin aux invasions dévastatrices, Carthage attaqua Masinissa, mais fut vaincue et fut contrainte de payer des indemnités encore plus importantes, et le pire : pour avoir violé le traité de paix, Rome déclara la guerre à Carthage en 149. Le résultat n'est pas difficile à prédire, même si, grâce à la détermination et à la force de la défense de Carthage, Rome n'a pu remporter la victoire qu'en 146. Lorsque Carthage tomba finalement (les derniers défenseurs, ainsi que les transfuges romains, se détruisirent dans le temple d'Eshmun), la ville fut pillée et incendiée, et le site sur lequel elle se trouvait fut « labouré » par les Romains victorieux. commandé par Scipion Aemilianus, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, le conquérant d'Hannibal.

Riz. 15. Le territoire de Carthage et l'Empire pendant la 2ème guerre punique
Ceci est confirmé par une couche de tartre, souvent épaisse de plusieurs centimètres, conservée dans la zone portuaire, à Dermeh et ailleurs. Les terres labourées sont une autre affaire. Plusieurs bâtiments de Carthage peuvent être attribués à la cité punique. Il n'aurait pas pu être complètement effacé de la surface de la terre si l'on prend en compte la remarque de Plutarque à propos de Marius « assis parmi les ruines de Carthage ».
En règle générale, les villes phéniciennes orientales restaient politiquement indépendantes les unes des autres ; chacun poursuivait ses propres intérêts et formait son propre « royaume » à partir du territoire environnant. Ce territoire était généralement assez petit - pas plus que ce qui était nécessaire pour approvisionner la population en nourriture. Bien entendu, les principales villes, notamment Tyr et Sidon, ont dominé les autres, du moins à certaines périodes de leur histoire. Cependant, il n’y a jamais eu de confédération phénicienne, encore moins de nation phénicienne. Hérodote mentionne que le contingent phénicien de la flotte de Xerxès en 480 était commandé par trois généraux : Tétramnestus de Sidon, Mattanus de Tyr et Marbalus d'Arad. S'il y avait une confédération, tout le monde Navires phéniciens obéirait certainement à un seul chef militaire. Il est d’autant plus surprenant que les Phéniciens, du moins dans un sens commercial, soient devenus une force avec laquelle le monde a dû compter. S’ils étaient également parvenus à l’unification politique, ils auraient pu accomplir bien plus à un moment où leurs rivaux grecs n’étaient pas non plus disposés à conclure des alliances politiques significatives. L’Empire athénien démontre tout ce que les Grecs pourraient accomplir s’ils s’unissaient : pendant la majeure partie du Ve siècle avant JC. e. L'Empire athénien dominait la Méditerranée orientale et centrale. Carthage, au sommet de sa puissance, montre ce que – dans un cas similaire – les Phéniciens auraient pu réaliser.
Pourtant Carthage, à proprement parler, n’était pas un empire. Fort commercialement et militairement, il dominait toutes les villes phéniciennes occidentales, mais, autant que nous le sachions, il n'a jamais considéré les autres villes comme ses possessions et ne considérait pas leurs citoyens comme ses citoyens. Les villes siciliennes frappaient leur propre monnaie avant même que Carthage n'ait ses propres pièces de monnaie, et des monnaies sont apparues à Hadès et à Ibiza au 3ème siècle, lorsque Carthage conservait encore son pouvoir. Une inscription maltaise nous apprend que sur l'île il y avait des suffets (magistrats en chef ou juges), un sénat et un peuple, comme à Carthage. Il y a des références à des suffètes ailleurs, par exemple à Tharros et à Gades. D'un autre côté, même si ces villes indépendantes étaient fortifiées et disposaient d'autres moyens de défense, elles ne semblent pas avoir eu leur propre armée ou marine et (comme Motya en 398) comptaient généralement sur Carthage pour leur venir rapidement en aide si attaqué. Apparemment, aucune des villes, à l'exception peut-être d'Hadès, ne possédait même sa propre flotte marchande et ne pouvait rivaliser avec Carthage.
Comme tout le monde, Carthage elle-même ne disposait initialement que d’un petit territoire. Au 5ème siècle avant JC. e. ses possessions couvraient déjà une vaste zone du nord-est de la Tunisie, comprenant Utique, Hadrumet et un certain nombre de villes indépendantes (Fig. 14). Certains auteurs anciens mentionnent qu'à une certaine époque les limites de ce territoire étaient marquées par un profond fossé. Il est dommage qu'aucune trace de ce fossé n'ait été retrouvée, car les limites historiques du territoire sont importantes. Ils pourraient nous dire ce que Carthage était autorisé à conserver en vertu du traité de paix de 201.
La possession même d'un vaste territoire ne transformait pas Carthage de ville en pays, mais lui conférait un contrôle direct sur des terres très fertiles qui, utilisées avec habileté et économie, servaient de source fiable de nourriture, soulageant la population de la menace de la famine. Peu d'habitants de la région, à l'exception de la population des villes phéniciennes, étaient des Phéniciens de race pure. Il s'agissait pour la plupart de Berbères locaux, ainsi que d'esclaves (noirs et autres).
Il est probable qu'outre les possessions nord-africaines, Carthage n'exerça une domination directe qu'en Sardaigne et en Espagne. En Sardaigne, Carthage s'empare des vallées du sud et de l'ouest, où il amène des Africains pour les cultiver et déplacer les marchands étrangers. En plus de l'agriculture, des activités minières auraient eu lieu ici, notamment du plomb et de l'argent. Après la 1ère guerre punique, suite aux conquêtes d'Hamilcar Barca, Hasdrubal et Hannibal, quelque chose de similaire s'est produit en Espagne. On ne sait pas jusqu'où s'étendaient les possessions espagnoles de Carthage, mais elles étaient certainement étendues et étaient gouvernées depuis la nouvelle capitale, Nouvelle Carthage, qui payait des impôts à Carthage, et temps de guerre fournissant des recrues, comme les territoires d’Afrique du Nord.
De toute évidence, dans le reste des possessions occidentales de Carthage, la domination n’était pas directe. Cependant, avant le transfert de la domination à Rome, le pouvoir de Carthage sur toute la Phénicie occidentale était si inconditionnel qu'aucune ville n'osait s'y opposer ouvertement, pas même Utique, qui, apparemment, a toujours été assez indépendante de son puissant voisin. !}.
Parce que le pouvoir carthaginois reposait uniquement sur l'influence et non sur l'intervention directe (il n'y avait pas de garnisons carthaginoises permanentes dans les villes), l'empire carthaginois manquait de cohésion et lorsque les temps difficiles arrivaient, il s'effondrait.
Les territoires carthaginois devinrent une province romaine, mais ce n'est que plus d'un siècle plus tard qu'une ville romaine surgit des ruines de Carthage. A cette époque, la culture romaine ne pénétrait presque pas en Afrique, et la dépendance à long terme du royaume numide vis-à-vis de Carthage et de sa culture assurait une influence punique persistante (au moins dans la langue), désormais appelée néopunique. La nouvelle ville romaine était en grande partie peuplée d'Africains qui parlaient une langue néo-punique et adoraient les anciennes divinités puniques : Baal-Hammon, Tinnit, Eshmun et Melqart sous leurs noms romains - Saturne, Caelestis, Asclépios et Hercule.