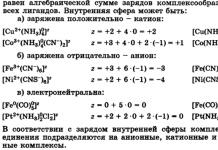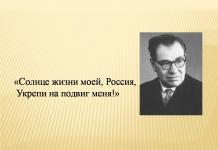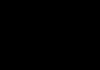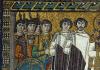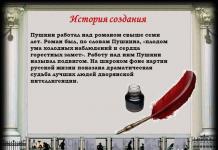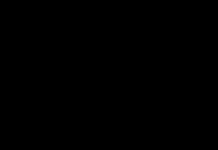Tout au long de notre vie, nous sommes constamment confrontés à des phénomènes physiques et chimiques. Les phénomènes physiques naturels nous sont si familiers que nous n'y attachons plus beaucoup d'importance depuis longtemps. Des réactions chimiques se produisent constamment dans notre corps. L'énergie libérée lors des réactions chimiques est constamment utilisée dans la vie quotidienne, en production et lors du démarrage. vaisseaux spatiaux. De nombreux matériaux à partir desquels sont fabriqués les objets qui nous entourent ne sont pas extraits de la nature sous une forme toute faite, mais sont fabriqués à partir de réactions chimiques. Dans la vie de tous les jours, cela n’a pas beaucoup de sens de comprendre ce qui s’est passé. Mais lorsqu'on étudie la physique et la chimie à un niveau suffisant, on ne peut pas se passer de ces connaissances. Comment distinguer les phénomènes physiques des phénomènes chimiques ? Existe-t-il des signes qui peuvent aider à y parvenir ?
Au cours des réactions chimiques, de nouvelles substances se forment à partir de certaines substances, différentes des substances originales. Par la disparition des signes du premier et l'apparition des signes du second, ainsi que par la libération ou l'absorption d'énergie, on conclut qu'une réaction chimique s'est produite.
Si vous chauffez une plaque de cuivre, une couche noire apparaît à sa surface ; Lorsque le dioxyde de carbone est soufflé dans l'eau de chaux, un précipité blanc se forme ; lorsque le bois brûle, des gouttes d'eau apparaissent sur les parois froides du récipient ; lorsque le magnésium brûle, on obtient une poudre blanche.
Il s'avère que les signes d'une réaction chimique sont des changements de couleur, d'odeur, la formation de sédiments et l'apparition de gaz.
Lorsque l’on considère les réactions chimiques, il est nécessaire de prêter attention non seulement à la manière dont elles se produisent, mais également aux conditions qui doivent être remplies pour que la réaction commence et se déroule.
Alors, quelles conditions doivent être remplies pour qu’une réaction chimique se déclenche ?
Pour ce faire, il faut tout d'abord mettre en contact les substances en réaction (les combiner, les mélanger). Plus les substances sont broyées, plus la surface de contact est grande, plus la réaction entre elles est rapide et active. Par exemple, le sucre en morceaux est difficile à enflammer, mais broyé et pulvérisé dans l'air, il brûle en quelques secondes, formant une sorte d'explosion.
Grâce à la dissolution, nous pouvons broyer une substance en minuscules particules. Parfois, la dissolution préalable des substances de départ facilite la réaction chimique entre les substances.
Dans certains cas, le contact de substances, par exemple le fer, avec de l'air humide, suffit pour qu'une réaction se produise. Mais le plus souvent, le contact des substances à lui seul ne suffit pas : d’autres conditions doivent être remplies.
 Ainsi, le cuivre ne réagit pas avec l'oxygène de l'air à basse température d'environ 20˚-25˚С. Pour provoquer une réaction entre le cuivre et l’oxygène, il est nécessaire d’utiliser de la chaleur.
Ainsi, le cuivre ne réagit pas avec l'oxygène de l'air à basse température d'environ 20˚-25˚С. Pour provoquer une réaction entre le cuivre et l’oxygène, il est nécessaire d’utiliser de la chaleur.
Le chauffage affecte l’apparition de réactions chimiques de différentes manières. Certaines réactions nécessitent un chauffage continu. Lorsque le chauffage s'arrête, la réaction chimique s'arrête. Par exemple, une chaleur constante est nécessaire pour décomposer le sucre.
Dans d'autres cas, le chauffage n'est nécessaire que pour que la réaction se produise, il donne une impulsion, puis la réaction se déroule sans chauffage. Par exemple, on observe un tel échauffement lors de la combustion du magnésium, du bois et d'autres substances combustibles.
blog.site, lors de la copie totale ou partielle du matériel, un lien vers la source originale est requis.
Au chapitre 5.2, nous avons découvert les principes de base des réactions chimiques. Ils constituent la théorie des interactions élémentaires.
§5.3.1 Théorie des interactions élémentaires
Énumérés ci-dessous principales dispositions VET répondre à la question:
Que faut-il pour que les réactions chimiques se produisent ?
 1.
Une réaction chimique est initiée par des particules de réactifs actifs autres que les molécules saturées : radicaux, ions, composés insaturés par coordination. La réactivité des substances de départ est déterminée par la présence de ces particules actives dans leur composition.
1.
Une réaction chimique est initiée par des particules de réactifs actifs autres que les molécules saturées : radicaux, ions, composés insaturés par coordination. La réactivité des substances de départ est déterminée par la présence de ces particules actives dans leur composition.
La chimie identifie trois facteurs principaux influençant une réaction chimique :
- température;
- catalyseur (si nécessaire);
- nature des substances en réaction.
Parmi ceux-ci, le plus important est le dernier. C'est la nature d'une substance qui détermine sa capacité à former certaines particules actives. Et les incitations ne font que contribuer à ce processus.
2. Les particules actives sont en équilibre thermodynamique avec les molécules saturées d'origine.
3. Les particules actives interagissent avec les molécules d'origine via un mécanisme en chaîne.
4. L'interaction entre la particule active et la molécule réactive se déroule en trois étapes : association, isomérisation électronique et dissociation.
Lors de la première étape d'une réaction chimique, l'étape d'association, la particule active s'attache à une molécule saturée d'un autre réactif en utilisant des liaisons chimiques plus faibles que les liaisons covalentes. Un associé peut être formé à l’aide de liaisons de Van der Waals, d’hydrogène, de donneur-accepteur et dynamiques.
Lors de la deuxième étape de la réaction chimique - l'étape d'isomérisation électronique - le processus le plus important se produit - la transformation d'une liaison covalente forte dans la molécule de réactif initiale en une liaison plus faible : hydrogène, donneur-accepteur, dynamique ou encore van der Waals.
5. La troisième étape de l'interaction entre la particule active et la molécule réactive est la dissociation de l'associé isomérisé avec la formation produit final la réaction est l’étape la plus lente et la plus limitante de l’ensemble du processus.
La grande « ruse » de la nature chimique des substances
C'est cette étape qui détermine les coûts énergétiques totaux pour l'ensemble du processus en trois étapes de la réaction chimique. Et c’est là que réside le grand « truc » nature chimique substances. Le processus le plus consommateur d'énergie - la rupture de la liaison covalente dans le réactif - s'est déroulé facilement et gracieusement, presque imperceptiblement dans le temps par rapport à la troisième étape limitante de la réaction. Dans notre exemple, la liaison dans une molécule d’hydrogène avec une énergie de 430 kJ/mol s’est transformée si facilement et naturellement en une liaison de Van der Waals avec une énergie de 20 kJ/mol. Et toute la consommation d’énergie de la réaction a été réduite à briser cette faible liaison de Van der Waals. C’est pourquoi les coûts énergétiques nécessaires à la rupture chimique d’une liaison covalente sont nettement inférieurs aux coûts de destruction thermique de cette liaison.
Ainsi, la théorie des interactions élémentaires donne un sens physique strict à la notion d'« énergie d'activation ». Il s'agit de l'énergie nécessaire pour rompre la liaison chimique correspondante dans un associé, dont la formation précède la production du produit final d'une réaction chimique.
Nous soulignons une fois de plus l'unité de la nature chimique de la substance. Il ne peut réagir que dans un seul cas : lorsqu'une particule active apparaît. Et la température, le catalyseur et d’autres facteurs, malgré toutes leurs différences physiques, jouent le même rôle : l’initiateur.
Dans l'industrie, les conditions sont choisies pour que les réactions nécessaires soient réalisées et que les réactions nocives soient ralenties.
TYPES DE RÉACTIONS CHIMIQUES
Le tableau 12 présente les principaux types de réactions chimiques selon le nombre de particules impliquées. Des dessins et des équations de réactions souvent décrites dans les manuels sont présentés. décomposition, Connexions, substitution Et échange.
En haut du tableau sont présentés réactions de décomposition eau et bicarbonate de sodium. Il s'agit d'un dispositif permettant de faire passer un courant électrique continu dans l'eau. La cathode et l'anode sont des plaques métalliques immergées dans l'eau et reliées à une source de courant électrique. Étant donné que l'eau pure ne conduit pratiquement pas électricité, une petite quantité de soude (Na 2 CO 3) ou d'acide sulfurique (H 2 SO 4) y est ajoutée. Lorsque le courant traverse les deux électrodes, des bulles de gaz sont libérées. Dans le tube où est collecté l'hydrogène, le volume s'avère être deux fois plus grand que dans le tube où est collecté l'oxygène (sa présence peut être vérifiée à l'aide d'un éclat fumant). Le diagramme modèle montre la réaction de décomposition de l’eau. Les liaisons chimiques (covalentes) entre les atomes des molécules d'eau sont détruites et des molécules d'hydrogène et d'oxygène se forment à partir des atomes libérés.
Diagramme du modèle réactions de connexion le fer métallique et le soufre moléculaire S 8 montrent qu'à la suite du réarrangement des atomes au cours de la réaction, du sulfure de fer se forme. En même temps ils sont détruits liaisons chimiques dans un cristal de fer (liaison métallique) et une molécule de soufre ( une liaison covalente), et les atomes libérés se combinent pour former des liaisons ioniques dans un cristal de sel.
Une autre réaction du composé est l'extinction de la chaux avec du CaO avec de l'eau pour former de l'hydroxyde de calcium. Dans le même temps, la chaux vive (chaux vive) commence à chauffer et de la poudre de chaux éteinte se forme.
À réactions de substitution fait référence à l’interaction d’un métal avec un acide ou un sel. Lorsqu'un métal suffisamment actif est immergé dans un acide fort (mais pas nitrique), des bulles d'hydrogène sont libérées. Le métal le plus actif déplace le métal le moins actif de la solution de son sel.
Typique échanger des réactions est une réaction de neutralisation et une réaction entre des solutions de deux sels. La figure montre la préparation du précipité de sulfate de baryum. L'avancement de la réaction de neutralisation est suivi à l'aide de l'indicateur phénolphtaléine (la couleur pourpre disparaît).
Tableau 12
Types de réactions chimiques

AIR. OXYGÈNE. LA COMBUSTION
L'oxygène est le plus courant élément chimique par terre. Son contenu dans la croûte terrestre et l'hydrosphère sont présentés dans le tableau 2 « Présence d'éléments chimiques ». L'oxygène représente environ la moitié (47 %) de la masse de la lithosphère. C'est l'élément chimique prédominant de l'hydrosphère. Dans la croûte terrestre, l'oxygène n'est présent que dans forme reliée(oxydes, sels). L'hydrosphère est également représentée principalement par de l'oxygène lié (une partie de l'oxygène moléculaire est dissoute dans l'eau).
L'atmosphère contient 20,9 % d'oxygène libre en volume. L'air est un mélange complexe de gaz. L'air sec est composé à 99,9 % d'azote (78,1 %), d'oxygène (20,9 %) et d'argon (0,9 %). La teneur de ces gaz dans l’air est quasiment constante. La composition du sec air atmosphérique comprend également le dioxyde de carbone, le néon, l'hélium, le méthane, le krypton, l'hydrogène, l'oxyde nitrique (I) (oxyde de diazote, hémioxyde d'azote - N 2 O), l'ozone, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le xénon, l'oxyde nitrique (IV) (dioxyde d'azote – NON 2).
La composition de l'air a été déterminée par le chimiste français Antoine Laurent Lavoisier en fin XVIII siècle (tableau 13). Il a prouvé la teneur en oxygène de l’air et l’a appelé « air vital ». Pour ce faire, il chauffait du mercure sur un réchaud dans une cornue en verre dont la partie fine était placée sous un bouchon en verre placé dans un bain-marie. L'air sous le capot s'est avéré fermé. Lorsqu'il est chauffé, le mercure se combine à l'oxygène et se transforme en oxyde mercurique rouge. L'« air » restant dans la cloche en verre après avoir chauffé le mercure ne contenait pas d'oxygène. La souris, placée sous le capot, étouffait. Après avoir calciné l'oxyde de mercure, Lavoisier en isola à nouveau l'oxygène et obtint à nouveau du mercure pur.
La teneur en oxygène de l’atmosphère a commencé à augmenter sensiblement il y a environ 2 milliards d’années. Suite à la réaction photosynthèse un certain volume de dioxyde de carbone a été absorbé et le même volume d’oxygène a été libéré. La figure du tableau montre schématiquement la formation d'oxygène lors de la photosynthèse. Lors de la photosynthèse dans les feuilles des plantes vertes contenant chlorophylle, lors de l'absorption énergie solaire l'eau et le dioxyde de carbone sont convertis en les glucides(sucre) et oxygène. La réaction de formation de glucose et d’oxygène dans les plantes vertes peut s’écrire comme suit :
6H 2 O + 6CO 2 = C 6 H 12 O 6 + 6O 2.
Le glucose obtenu devient insoluble dans l'eau amidon, qui s'accumule dans les plantes.
Tableau 13
Air. Oxygène. La combustion

La photosynthèse est un processus chimique complexe qui comprend plusieurs étapes : l'absorption et le transport de l'énergie solaire, l'utilisation de l'énergie solaire pour initier des réactions photochimiques redox, la réduction du dioxyde de carbone et la formation de glucides.
La lumière du soleil est un rayonnement électromagnétique différentes longueurs d'onde. Dans la molécule de chlorophylle, lorsque la lumière visible (rouge et violette) est absorbée, les électrons passent d’un état énergétique à un autre. Seule une petite partie de l'énergie solaire (0,03 %) atteignant la surface de la Terre est consommée pour la photosynthèse.
Tout le dioxyde de carbone sur Terre passe par le cycle de photosynthèse en moyenne en 300 ans, l'oxygène en 2000 ans et l'eau des océans en 2 millions d'années. Actuellement, une teneur constante en oxygène s'est établie dans l'atmosphère. Il est presque entièrement consacré à la respiration, à la combustion et à la décomposition des substances organiques.
L'oxygène est l'un des plus substances actives. Les processus impliquant l’oxygène sont appelés réactions d’oxydation. Ceux-ci incluent la combustion, la respiration, la pourriture et bien d’autres. Le tableau montre la combustion du pétrole, qui se produit avec le dégagement de chaleur et de lumière.
Les réactions de combustion peuvent apporter non seulement des avantages, mais aussi des dommages. La combustion peut être arrêtée en coupant l'accès de l'air (comburant) à l'objet en feu à l'aide de mousse, de sable ou d'une couverture.
Les extincteurs à mousse sont remplis d'une solution concentrée bicarbonate de soude. Au contact de l'acide sulfurique concentré, situé dans une ampoule en verre au sommet de l'extincteur, une mousse de dioxyde de carbone se forme. Pour activer l'extincteur, retournez-le et frappez le sol avec une épingle métallique. Dans ce cas, l'ampoule contenant de l'acide sulfurique se brise et la réaction de l'acide avec le bicarbonate de sodium qui en résulte gaz carbonique fait mousser le liquide et le jette hors de l'extincteur avec un fort jet. Un liquide mousseux et du dioxyde de carbone, enveloppant un objet en feu, repoussent l'air et éteignent la flamme.
1. Réactions chimiques. Signes et conditions de leur apparition. Équations chimiques. Loi de conservation de la masse des substances. Types de réactions chimiques.
2. Quel volume de gaz peut-on obtenir en faisant réagir 60 g d’une solution à 12 % de carbonate de potassium avec de l’acide sulfurique.
Réaction chimique
- la transformation d'une ou plusieurs substances en une autre.
Types de réactions chimiques :
1) Réaction de connexion- ce sont des réactions à la suite desquelles une substance complexe supplémentaire est formée à partir de deux substances.
2) Réaction de décomposition- Il s'agit d'une réaction à la suite de laquelle plusieurs réactions plus simples se forment à partir d'une substance complexe.
3) Réaction de substitution- Ce sont des réactions entre des substances simples et complexes, à la suite desquelles une nouvelle substance simple et une nouvelle substance complexe se forment.
4) Réaction d'échange- Il s'agit de réactions entre deux substances complexes, à la suite desquelles elles échangent leurs éléments constitutifs.
Conditions de réaction :
1) Contact étroit de substances.
2) Chauffage
3) Broyage (les réactions se produisent plus rapidement dans les solutions)
Toute réaction chimique peut être représentée à l'aide d'une équation chimique.
Équation chimique est une notation conventionnelle d'une réaction chimique utilisant formules chimiques et les coefficients.
Les équations chimiques sont basées sur loi de conservation de la masse de matière
: La masse des substances entrées dans la réaction est égale à la masse des substances résultant de la réaction.
Signes de réactions chimiques :
· Changement de couleur
· Libération de gaz
· Précipitation
· Libération de chaleur et de lumière
· Libération d'odeur
2.

Billet n°7
1. Dispositions fondamentales du T.E.D. – théorie de la dissociation électrique.
2. Combien de grammes de magnésium contenant 8 % d'impuretés peuvent réagir avec 40 g d'acide chlorhydrique.
Les substances solubles dans l'eau peuvent se dissocier, c'est-à-dire se désintègrent en ions de charges opposées.
Dissociation électrique –
la décomposition d'un électrolyte en ions lors de sa dissolution ou de sa fusion.
Électrolytes –
substances dont les solutions ou les fondus conduisent le courant électrique (acides, sels, alcalis).
Ils sont formés par une liaison ionique (sels, alcalis) ou covalente, hautement polaire (acide).
Pas d'électrolytes –
substances dont les solutions ne conduisent pas le courant électrique (solution sucrée, alcool, glucose)
Lors de leur dissociation, les électrolytes se décomposent en cations(+) Et anions(-)
Ions –
particules chargées dans lesquelles les atomes se transforment en donnant et en prenant ē
Propriétés chimiques Les solutions électrolytiques sont déterminées par les propriétés des ions formés lors de la dissociation.

Acide
– un électrolyte qui se dissocie en cations hydrogène et en un anion résidu acide.
Acide sulfurique se dissocie en cations 2 H avec charge (+) et
Anion SO 4 avec charge (-)
Les raisons
– un électrolyte qui se dissocie en cations métalliques et anions hydroxyde.
Sels – un électrolyte qui se dissocie dans une solution aqueuse en cations métalliques et anions du résidu acide.
2.
1. Réactions d’échange d’ions.
Sections: Chimie
Type de cours: acquisition de nouvelles connaissances.
Type de cours: conversation avec démonstration d'expériences.
Objectifs:
Éducatif- répéter les différences entre les phénomènes chimiques et physiques. Développer des connaissances sur les signes et les conditions des réactions chimiques.
Du développement- développer des compétences, basées sur des connaissances en chimie, poser des problèmes simples, formuler des hypothèses, généraliser.
Éducatif - continuer à former la vision scientifique du monde des étudiants, cultiver une culture de la communication par le travail en binôme « élève-élève », « élève-enseignant », ainsi que l'observation, l'attention, la curiosité et l'initiative.
Méthodes et techniques méthodologiques: Conversation, démonstration d'expériences ; remplissage du tableau, dictée chimique, travail indépendant avec des cartes.
Matériel et réactifs. Support de laboratoire avec tubes à essai, cuillère en fer pour brûler des substances, tube à essai avec tube de sortie de gaz, lampe à alcool, allumettes, solutions de chlorure de fer FeCL 3, thiocyanate de potassium KNCS, sulfate de cuivre (sulfate de cuivre) CuSO 4, hydroxyde de sodium NaOH, carbonate de sodium Na 2 CO 3, acide chlorhydrique HCL, poudre S.
Pendant les cours
Professeur. Nous étudions le chapitre « Changements qui se produisent dans les substances » et nous savons que les changements peuvent être physiques et chimiques. Quelle est la différence entre un phénomène chimique et un phénomène physique ?
Étudiant.À la suite d'un phénomène chimique, la composition d'une substance change, et à la suite d'un phénomène physique, la composition d'une substance reste inchangée et seul son état d'agrégation ou la forme et la taille des corps changent.
Professeur. Des phénomènes chimiques et physiques peuvent être observés simultanément dans la même expérience. Si vous aplatissez un fil de cuivre avec un marteau, vous obtenez une plaque de cuivre. La forme du fil change, mais sa composition reste la même. Ce phénomène physique. Si une plaque de cuivre est chauffée à haute température, l’éclat métallique disparaîtra. La surface de la plaque de cuivre sera recouverte d'un revêtement noir qui peut être gratté avec un couteau. Cela signifie que le cuivre interagit avec l'air et se transforme en une nouvelle substance. Il s'agit d'un phénomène chimique. Une réaction chimique se produit entre le métal et l’oxygène de l’air.
Dictée chimique
Option 1
Exercice. Indiquez de quels phénomènes (physiques ou chimiques) vous parlez. Expliquez votre réponse.
1. Combustion d'essence dans un moteur de voiture.
2. Préparation de poudre à partir d'un morceau de craie.
3. Pourriture des résidus végétaux.
4. Acidification du lait.
5. Précipitations
Option 2
1. Combustion du charbon.
2. La fonte des neiges.
3. Formation de rouille.
4. Formation de givre sur les arbres.
5. Lueur d'un filament de tungstène dans une ampoule.
Critère d'évaluation
Vous pouvez marquer un maximum de 10 points (1 point pour le phénomène correctement indiqué et 1 point pour justifier la réponse).
Professeur. Ainsi, vous savez que tous les phénomènes sont divisés en phénomènes physiques et chimiques. Contrairement aux phénomènes physiques, lors de phénomènes chimiques, ou de réactions chimiques, la transformation de certaines substances en d'autres se produit. Ces transformations s'accompagnent de signes extérieurs. Afin de vous initier aux réactions chimiques, je réaliserai une série d'expériences de démonstration. Vous devez identifier les signes indiquant qu’une réaction chimique s’est produite. Faites attention aux conditions nécessaires pour que ces réactions chimiques se produisent.
Expérience de démonstration n°1
Professeur. Dans la première expérience, vous devez découvrir ce qui arrive au chlorure ferrique (111) lorsqu'une solution de thiocyanate de potassium KNCS y est ajoutée.
FeCL 3 + KNCS = Fe(NCS) 3 +3 KCL
Étudiant. La réaction s'accompagne d'un changement de couleur
Expérience de démonstration n°2
Professeur. Versez 2 ml de sulfate de cuivre dans un tube à essai et ajoutez un peu de solution de soude.
CuSO 4 + 2 NaOH = Cu (OH) 2↓ + Na 2 SO 4
Étudiant. Les précipitations apparaissent couleur bleue Cu(OH)2↓
Expérience de démonstration n°3
Professeur.À la solution résultante de Cu (OH) 2↓, ajoutez une solution d'acide HCL
Cu (OH) 2↓ + 2 HCL = CuCL 2 +2 HOH
Étudiant. Le précipité se dissout.
Expérience de démonstration n°4
Professeur. Versez une solution d'acide chlorhydrique HCL dans un tube à essai contenant une solution de carbonate de sodium.
Na 2 CO 3 +2 HCL = 2 NaCL + H 2 O + CO 2
Étudiant. Du gaz est libéré.
Expérience de démonstration n°5
Professeur. Allumons un peu de soufre dans une cuillère en fer. Du dioxyde de soufre se forme - oxyde de soufre (4) - SO 2.
S + O 2 = SO 2
Étudiant. Le soufre s'allume avec une flamme bleuâtre, produit une fumée âcre abondante et libère de la chaleur et de la lumière.
Expérience de démonstration n°6
Professeur. La réaction de décomposition du permangate de potassium est une réaction de production et de reconnaissance d'oxygène.
Étudiant. Du gaz est libéré.
Professeur. Cette réaction se produit avec un chauffage constant, dès qu'elle est arrêtée, la réaction s'arrête également (la pointe du tube de sortie de gaz de l'appareil où l'oxygène a été obtenu est descendue dans un tube à essai avec de l'eau - pendant le chauffage, de l'oxygène est libéré, et cela se voit aux bulles sortant de l'extrémité du tube, mais si le chauffage s'arrête, la libération des bulles d'oxygène s'arrête également).
Expérience de démonstration n°7
Professeur. Ajoutez un peu d'alcali NaOH dans un tube à essai avec du chlorure d'ammonium NH 4 CL pendant le chauffage. Demandez à l’un des élèves de venir sentir l’ammoniac libéré. Avertissez l'élève de la forte odeur !
NH 4 CL + NaOH = NH 3 + HOH + NaCL
Étudiant. Un gaz à l'odeur âcre se dégage.
Les élèves notent les signes de réactions chimiques dans leurs cahiers.
Signes de réactions chimiques
Libération (absorption) de chaleur ou de lumière
Changement de couleur
Libération de gaz
Isolement (dissolution) des sédiments
Changement d'odeur
En utilisant les connaissances des étudiants sur les réactions chimiques, sur la base des expériences de démonstration réalisées, nous dressons un tableau des conditions d'apparition et d'apparition des réactions chimiques
Professeur. Vous avez étudié les signes des réactions chimiques et les conditions de leur apparition. Travail individuel à l'aide de cartes.
Quels signes sont caractéristiques des réactions chimiques ?
A) Formation de sédiments
B) Changement d'état d'agrégation
B) Libération de gaz
D) Broyage de substances
Partie finale
L'enseignant résume la leçon en analysant les résultats obtenus. Donne des notes.
Devoirs
Donnez des exemples de phénomènes chimiques qui se produisent dans le travail de vos parents, dans la maison et dans la nature.
D'après le manuel d'O.S. Gabrielyan « Chimie - 8e année » § 26, ex. 3.6 p.96