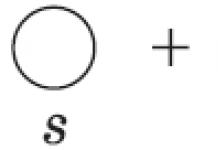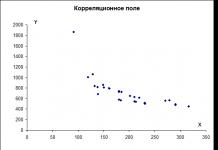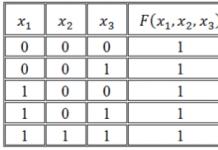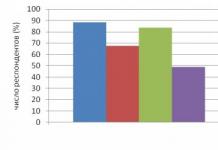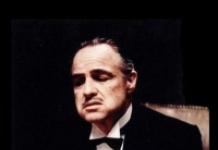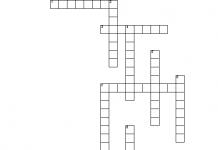Système mondial géocentrique(du grec ancien Γῆ, Γαῖα - Terre) - une idée dela structure de l'univers, selon laquelle la position centrale dans l'Univers est occupée par la Terre stationnaire, autour de laquelle le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tourner. Une alternative au géocentrisme est.
Développement du géocentrisme
Depuis l’Antiquité, la Terre était considérée comme le centre de l’univers. Dans ce cas, la présence d’un axe central de l’Univers et une asymétrie « haut-bas » ont été supposées. La terre était empêchée de tomber par une sorte de support, qui dans les premières civilisations était considéré comme une sorte d'animal ou d'animaux mythiques géants (tortues, éléphants, baleines). Le premier philosophe grec Thalès de Milet considérait un objet naturel - l'océan mondial - comme ce support. Anaximandre de Milet a suggéré que l'Univers est à symétrie centrale et n'a aucune direction distincte. Par conséquent, la Terre, située au centre du Cosmos, n’a aucune raison de se déplacer dans aucune direction, c’est-à-dire qu’elle repose librement au centre de l’Univers sans support. Anaximène, élève d'Anaximandre, n'a pas suivi son professeur, estimant que l'air comprimé empêchait la Terre de tomber. Anaxagore était du même avis. Le point de vue d'Anaximandre était cependant partagé par les Pythagoriciens, Parménide et Ptolémée. La position de Démocrite n'est pas claire : selon diverses preuves, il aurait suivi Anaximandre ou Anaximène.

Une des premières images du système géocentrique qui nous soit parvenue (Macrobius, Commentaire sur le Rêve de Scipion, manuscrit du IXe siècle)
Anaximandre considérait la Terre comme ayant la forme d'un cylindre bas d'une hauteur trois fois inférieure au diamètre de la base. Anaximène, Anaxagore, Leucippe croyaient que la Terre était plate, comme un plateau de table. Une étape fondamentalement nouvelle a été franchie par Pythagore, qui a suggéré que la Terre avait la forme d'une boule. En cela, il fut suivi non seulement par les Pythagoriciens, mais aussi par Parménide, Platon et Aristote. C'est ainsi qu'est née la forme canonique du système géocentrique, ensuite activement développée par les astronomes grecs anciens : la Terre sphérique est située au centre de l'Univers sphérique ; Le mouvement quotidien visible des corps célestes est le reflet de la rotation du Cosmos autour de l'axe du monde.

Représentation médiévale du système géocentrique (extraite de la Cosmographie de Peter Apian, 1540)
Quant à l'ordre des luminaires, Anaximandre considérait les étoiles les plus proches de la Terre, suivies de la Lune et du Soleil. Anaximène fut le premier à suggérer que les étoiles sont les objets les plus éloignés de la Terre, fixés sur la coque externe du Cosmos. En cela, tous les scientifiques ultérieurs l'ont suivi (à l'exception d'Empédocle, qui a soutenu Anaximandre). Une opinion est née (pour la première fois, probablement, chez Anaximène ou les Pythagoriciens) selon laquelle plus la période de révolution d'un astre dans la sphère céleste est longue, plus elle est élevée. Ainsi, l'ordre des luminaires était le suivant : Lune, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, étoiles. Mercure et Vénus ne sont pas incluses ici parce que les Grecs avaient des désaccords à leur sujet : Aristote et Platon les plaçaient immédiatement derrière le Soleil, Ptolémée - entre la Lune et le Soleil. Aristote croyait qu'il n'y avait rien au-dessus de la sphère des étoiles fixes, pas même l'espace, tandis que les stoïciens croyaient que notre monde était immergé dans un espace vide sans fin ; les atomistes, à la suite de Démocrite, croyaient qu'au-delà de notre monde (limité par la sphère des étoiles fixes), il existe d'autres mondes. Cette opinion a été soutenue par les épicuriens ; elle a été exposée avec vivacité par Lucrèce dans son poème « De la nature des choses ».

"Chiffre corps célestes" est une illustration du système mondial géocentrique de Ptolémée réalisée par le cartographe portugais Bartolomeu Velho en 1568.
Conservé à la Bibliothèque nationale de France.
Justification du géocentrisme
Les scientifiques de la Grèce antique, cependant, ont étayé la position centrale et l’immobilité de la Terre de différentes manières. Anaximandre, comme déjà indiqué, a souligné la symétrie sphérique du Cosmos comme raison. Aristote ne l'a pas soutenu, avançant un contre-argument, attribué plus tard à Buridan : dans ce cas, une personne située au centre d'une pièce dans laquelle il y a de la nourriture près des murs devrait mourir de faim (voir l'âne de Buridan). Aristote lui-même justifiait le géocentrisme comme suit : La Terre est un corps lourd, et le lieu naturel des corps lourds est le centre de l'Univers ; comme le montre l'expérience, tous les corps lourds tombent verticalement, et comme ils se déplacent vers le centre du monde, la Terre est au centre. De plus, Aristote a rejeté le mouvement orbital de la Terre (qui était supposé par le pythagoricien Philolaos) au motif qu'il devrait conduire à un déplacement parallactique des étoiles, ce qui n'est pas observé.

Dessin du système géocentrique du monde d'après un manuscrit islandais daté d'environ 1750
Un certain nombre d'auteurs avancent d'autres arguments empiriques. Pline l'Ancien, dans son encyclopédie Histoire Naturelle, justifie la position centrale de la Terre par l'égalité du jour et de la nuit lors des équinoxes et par le fait qu'à l'équinoxe, le lever et le coucher sont observés sur la même ligne, et le lever du soleil sur la même ligne. le jour du solstice d'été est sur la même ligne, ce qui correspond à l'appel du jour solstice d'hiver. D’un point de vue astronomique, tous ces arguments sont bien entendu un malentendu. Les arguments avancés par Cléomède dans son manuel « Leçons d'astronomie » ne sont guère meilleurs, dans lesquels il prouve par contradiction la centralité de la Terre. Selon lui, si la Terre était à l'est du centre de l'Univers, alors les ombres à l'aube seraient plus courtes qu'au coucher du soleil, les corps célestes au lever du soleil apparaîtraient plus grands qu'au coucher du soleil et la durée entre l'aube et midi serait plus courte. que de midi jusqu'au coucher du soleil. Puisque tout cela n’est pas observé, la Terre ne peut pas être déplacée vers l’ouest par rapport au centre du monde. De même, il est prouvé que la Terre ne peut pas être déplacée vers l’ouest. De plus, si la Terre était située au nord ou au sud du centre, les ombres au lever du soleil s’étendraient respectivement vers le nord ou le sud. De plus, à l'aube les jours d'équinoxe, les ombres sont dirigées exactement dans la direction du coucher du soleil ces jours-là, et au lever du soleil le jour du solstice d'été, les ombres pointent vers le point du coucher du soleil le jour de l'hiver. solstice. Cela indique également que la Terre n'est pas décalée au nord ou au sud de son centre. Si la Terre était au-dessus du centre, alors moins de la moitié du ciel pourrait être observée, dont moins de six signes du zodiaque ; en conséquence, la nuit serait toujours plus longue que le jour. Il est également prouvé que la Terre ne peut pas être située en dessous du centre du monde. Ainsi, cela ne peut être qu'au centre. Ptolémée donne à peu près les mêmes arguments en faveur de la centralité de la Terre dans l'Almageste, Livre I. Bien entendu, les arguments de Cléomède et de Ptolémée prouvent seulement que l'Univers est bien plus plus que la Terre, et sont donc également insolvables.

Pages de SACROBOSCO "Tractatus de Sphaera" avec le système ptolémaïque - 1550
Ptolémée tente également de justifier l'immobilité de la Terre (Almageste, livre I). Premièrement, si la Terre était déplacée du centre, alors les effets que nous venons de décrire seraient observés, mais comme ce n’est pas le cas, la Terre est toujours au centre. Un autre argument est la verticalité des trajectoires des corps qui tombent. Ptolémée justifie ainsi l'absence de rotation axiale de la Terre : si la Terre tournait, alors « … tous les objets qui ne reposent pas sur la Terre devraient sembler faire le même mouvement en sens inverse ; ni les nuages ni les autres objets volants ou planants ne se déplaceront jamais vers l'est, puisque le mouvement de la terre vers l'est les rejettera toujours, de sorte que ces objets sembleront se déplacer vers l'ouest, dans la direction opposée. L’incohérence de cet argument n’est devenue évidente qu’après la découverte des fondements de la mécanique.
L'Harmonia Macrocosmica d'Andreas Cellarius - 1660/61
Explication des phénomènes astronomiques du point de vue du géocentrisme
La plus grande difficulté pour l'astronomie grecque antique était le mouvement inégal des corps célestes (en particulier les mouvements rétrogrades des planètes), car dans la tradition pythagoricienne-platonicienne (que suivait en grande partie Aristote), ils étaient considérés comme des divinités qui ne devaient effectuer que des mouvements uniformes. Pour surmonter cette difficulté, des modèles ont été créés dans lesquels les mouvements apparents complexes des planètes étaient expliqués comme le résultat de l'addition de plusieurs éléments. mouvements uniformes autour des cercles. Une incarnation concrète de ce principe était la théorie des sphères homocentriques d'Eudoxe-Callippe, soutenue par Aristote, et la théorie des épicycles d'Apollonius de Perge, Hipparque et Ptolémée. Cependant, ce dernier fut contraint d'abandonner partiellement le principe du mouvement uniforme, introduisant le modèle équant.
Refus du géocentrisme
Au cours de la révolution scientifique du XVIIe siècle, il est devenu clair que le géocentrisme est incompatible avec les faits astronomiques et contredit théorie physique; Le système héliocentrique du monde s’est progressivement établi. Les principaux événements qui ont conduit à l'abandon du système géocentrique ont été la création de la théorie héliocentrique des mouvements planétaires par Copernic, les découvertes télescopiques de Galilée, la découverte des lois de Kepler et, surtout, la création de la mécanique classique et la découverte de la loi de la gravitation universelle de Newton.
Géocentrisme et religion
Déjà l'une des premières idées opposées au géocentrisme (l'hypothèse héliocentrique d'Aristarque de Samos) avait provoqué une réaction de la part des représentants de la philosophie religieuse : le stoïcien Clénète appelait à traduire en justice Aristarque pour avoir déplacé le « Foyer du Monde », c'est-à-dire la Terre. ; on ne sait cependant pas si les efforts de Cléanthe furent couronnés de succès. Au Moyen Âge, parce que Église chrétienne Enseignant que le monde entier a été créé par Dieu pour le bien de l'homme (voir Anthropocentrisme), le géocentrisme a également été adapté avec succès au christianisme. Cela a également été facilité par une lecture littérale de la Bible. La révolution scientifique du XVIIe siècle s'accompagne de tentatives d'interdiction administrative du système héliocentrique, qui conduisent notamment à procès sur le partisan et propagandiste de l'héliocentrisme Galileo Galilei. Actuellement, le géocentrisme est la foi religieuse trouvé parmi certains groupes protestants conservateurs aux États-Unis.
Source : http://ru.wikipedia.org/
Le système héliocentrique du monde est l’idée selon laquelle le Soleil est le centre de l’univers et le point autour duquel tournent toutes les planètes, y compris la Terre. Ce système suppose que notre planète effectue deux types de mouvement : une translation autour du Soleil et une rotation autour de son axe. La position du Soleil lui-même par rapport aux autres étoiles est considérée comme inchangée.
Le terme « héliocentrisme » vient du mot grec « helios » (traduit par « Soleil »).
Il n'est possible de trouver un certain point central de l'Univers que si l'Univers . Il le doit selon le système héliocentrique du monde.
Dans ce système également, le concept d'externe et Planètes intérieures. Ce dernier comprenait Mercure et Vénus, car leurs orbites autour du Soleil doivent toujours être dans l'orbite terrestre.

La caractéristique la plus importante de l’héliocentrisme est la parallaxe annuelle des étoiles. Cet effet se manifeste sous la forme d'un changement dans les coordonnées apparentes de l'étoile. Elle est associée à un changement de position des observateurs (astronomes), dû à la rotation de la Terre autour du Soleil.
L'héliocentrisme dans l'Antiquité et au Moyen Âge
L'idée que la Terre se déplace autour d'un certain centre du monde entier est née dans l'esprit des Grecs de l'Antiquité. Il y avait donc des hypothèses sur la rotation de la Terre autour de son axe, ainsi que sur le mouvement de Mars et de Vénus autour du Soleil, qui, avec eux, tourne autour de notre planète. Cependant, on pense que le système héliocentrique du monde a été décrit pour la première fois au 3ème siècle avant JC. e. Aristarque de Samos. Il a tiré deux conclusions importantes :
- Très probablement, notre planète tourne autour du Soleil. La raison en est la taille du Soleil, qui est nettement plus grande que la taille de la Terre. Les données sur les magnitudes relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil ont été obtenues à partir des propres calculs d'Aristarque.
- En raison de l'absence de parallaxes annuelles visibles des étoiles, il a suggéré que l'orbite de notre planète semble être un point relatif aux distances aux étoiles.
Cependant, les idées d'Aristarque ne se sont pas répandues dans l'Antiquité. La plupart version connue système géocentrique dans La Grèce ancienne Il y avait la théorie dite des sphères homocentriques, développée par les astronomes Eudoxe, Callippe et Aristote. Selon cette théorie, tous les corps célestes tournant autour de notre planète étaient fixés sur des sphères rigides, reliées entre elles et ayant un seul centre : la Terre.

En relation avec une telle vision du monde de la partie dominante de la société, d'autres adeptes de l'idée d'Aristarque de Samos n'ont pas exprimé leur point de vue, à la suite de quoi les Grecs ont abandonné cette idée et ont complètement accepté le géocentrisme. Les écoles qui enseignaient le rationalisme à cette époque ne soutenaient pas les idées d'Aristarque, car elles considéraient la nature de l'univers comme au-delà de toute compréhension et excluaient toute possibilité de décrire la dynamique des planètes.
Au Moyen Âge, l'héliocentrisme n'était guère évoqué dans les travaux scientifiques, hormis certaines de ses idées, par exemple la rotation de la Terre sur son axe.
Révolution scientifique de Nicolas Copernic
En 1543, l'astronome, mécanicien et pasteur polonais Nicolas Copernic publia son travail scientifique, qui s'intitulait : « Sur la rotation sphères célestes" L'astronome y décrit la théorie héliocentrique, la confirmant par un certain nombre de calculs physiques basés sur l'époque mécanique théorique. Selon son concept, le changement de jour et de nuit, ainsi que le mouvement du Soleil dans le ciel, s'expliquent par la rotation de la Terre autour de son axe. De la même manière, avec l'aide de la Terre autour du Soleil, on explique le mouvement de notre étoile dans le ciel tout au long de l'année.

Copernic a expliqué les phénomènes suivants :
- En raison du mouvement de la Terre, qui alternativement s'approche puis s'éloigne de l'une des planètes de notre système, ces planètes forment ce qu'on appelle. mouvement vers l'arrière. Autrement dit, après un certain temps, ils commencent à se déplacer vers verso de la direction du mouvement du Soleil.
- Anticipation des équinoxes. Au cours des 18 siècles, les scientifiques ont recherché les raisons d'un effet tel que l'anticipation des équinoxes, selon laquelle chaque année l'équinoxe de printemps survient un peu plus tôt. Dans ses écrits, Nicolas Copernic a pu décrire cet effet comme une conséquence du déplacement périodique de l'axe de la Terre.
- Suivant les traces d'Aristarque de Samos, Copernic a soutenu et prouvé que la sphère des étoiles est située à une très grande distance par rapport aux distances entre les planètes, de sorte que les scientifiques n'observent pas de parallaxes annuelles. Et il a confirmé l'hypothèse sur la rotation de notre planète autour de son axe par ce qui suit : si notre planète est toujours immobile, alors la rotation du ciel devrait se produire en raison de la rotation de la sphère stellaire elle-même, et compte tenu de la distance calculée à celle-ci. , la vitesse de sa rotation sera incroyablement élevée.
De plus, le système héliocentrique pourrait expliquer le changement de luminosité et de taille des planètes. système solaire, ainsi que de donner une estimation plus précise de la taille des planètes et de leurs distances. Nicolas Copernic lui-même a pu déterminer approximativement les tailles de la Lune et du Soleil et indiquer aussi précisément que possible le temps pendant lequel Mercure parcourt complètement son orbite autour du Soleil - 88 jours terrestres.

Malgré la révolution complète dans le domaine de l'astronomie, la théorie de Copernic présentait plusieurs défauts. Premièrement, le point central du système qu'il a décrit restait le centre de l'orbite terrestre, et non le Soleil. Deuxièmement, toutes les planètes de notre système planétaire se déplaçaient de manière inégale sur leurs orbites, mais notre planète maintenait sa vitesse orbitale. Et aussi, très probablement, Copernic n'a pas abandonné l'idée de sphères célestes en rotation, mais a seulement transféré le centre de leur rotation.
Adeptes et adversaires de Copernic
Par la suite, l'astronome polonais a gagné un grand nombre d'adeptes, parmi lesquels Giordano Bruno, qui a soutenu que le firmament ne se limite pas aux sphères célestes et que les autres luminaires ne sont en aucun cas des corps célestes inférieurs au Soleil. Malheureusement, Bruno a été qualifié d'hérétique pour ses convictions et condamné à être brûlé.
Le célèbre scientifique italien a soutenu la théorie copernicienne en s'appuyant sur ses propres observations. Il a également soutenu que la Terre n'a jamais occupé de place entre Mercure (ou Vénus) et le Soleil, ce qui indique la rotation de ces deux planètes autour de l'étoile sur des orbites situées à l'intérieur de celle de la Terre. L'affirmation opposée prouvait l'emplacement de l'orbite terrestre à l'intérieur des orbites des planètes extérieures. En raison de ses convictions, Galilée, âgé de 70 ans, fut soumis à un procès inquisitorial en 1633, qui le conduisit à être assigné à résidence jusqu'à sa mort à 78 ans.

Les opposants à l’héliocentrisme ont insisté sur plusieurs arguments réfutant la théorie copernicienne. Si la Terre tournait autour de son axe, la monstrueuse force centrifuge la déchirerait. De plus, tous les objets légers s’envoleraient de sa surface et se déplaceraient dans la direction opposée à la rotation. On supposait que tous les objets célestes n’avaient pas de masse et pouvaient donc se déplacer sans leur appliquer de forces importantes. Dans le cas de la Terre, la question s'est posée de l'existence d'une force colossale qui pourrait faire tourner notre planète massive.
L'un des opposants au géocentrisme, l'éminent astronome danois Tycho Brahe, a développé le système dit « géo-héliocentrique » du monde, selon lequel la sphère des étoiles, la Lune et le Soleil se déplacent autour de la Terre et d'autres espaces. objets autour du Soleil.
Après un certain temps, le successeur de Brahe, le physicien allemand Johannes Kepler, après avoir analysé un volume impressionnant de résultats d'observation de son mentor, fit plusieurs découvertes significatives en faveur de l'héliocentrisme :

- Les plans des orbites planétaires du système solaire se croisent à l'emplacement du soleil, ce qui en fait le centre de leur rotation, et non le centre de l'orbite terrestre, comme le supposait Copernic.
- La vitesse orbitale de notre planète change périodiquement, tout comme les autres planètes.
- Les orbites des planètes sont elliptiques et la vitesse de déplacement des corps célestes le long d'elles dépendait directement de la distance au Soleil, ce qui en faisait non seulement le centre géométrique, mais aussi dynamique du système planétaire.
Les lois dites de Kepler ont été formulées, qui décrivaient en détail et en langage mathématique les lois du mouvement des planètes du système solaire.
Affirmation de l'héliocentrisme
À la suite de la confirmation de la rotation de la Terre autour de son axe, toute nécessité de l'existence de sphères célestes a disparu. Pendant un certain temps, on a supposé que les planètes bougeaient parce qu’elles étaient des êtres vivants. Cependant, Kepler a rapidement déterminé que le mouvement des planètes résulte de l'influence des forces gravitationnelles du Soleil sur elles.
En 1687, le physicien anglais Isaac Newton, s'appuyant sur les siens, confirma les calculs de Johannes Kepler

Avec le développement de la science, les scientifiques ont reçu de plus en plus d'arguments en faveur de l'héliocentrisme. Ainsi, en 1728, un astronome anglais, James Bradley, confirma pour la première fois, par observation, la théorie de l'orbite de la Terre autour du Soleil, découvrant ce qu'on appelle l'aberration de la lumière. Ce dernier signifie un léger flou de l'image de l'étoile d'un côté suite au mouvement de l'observateur. Plus tard, une fluctuation annuelle de la fréquence des impulsions émises par les pulsars, ainsi que par les étoiles, a été découverte, ce qui prouve un changement périodique de la distance de la Terre à ces objets spatiaux.
Et en 1821 et 1837 Le scientifique russo-allemand Friedrich Wilhelm Struve a pu pour la première fois observer les parallaxes annuelles approximatives des étoiles, ce qui a finalement confirmé l'idée d'un système héliocentrique du monde.
« Physique - 10e année"
Si un corps se déplace avec une vitesse constante par rapport à un certain système de référence inertiel, alors 1, par rapport à un système de référence qui lui-même se déplace avec une vitesse, ce corps, selon la loi d'addition des vitesses, se déplacera avec un nouveau, mais aussi vitesse constante 2 = 1 +. L'accélération du corps dans les deux systèmes de référence est nulle.

Au contraire, tout référentiel se déplaçant avec une accélération par rapport à un référentiel inertiel sera déjà non inertiel. En effet, si 1 = const, et que la vitesse change, alors la vitesse de 2 changera également avec le temps. Par conséquent, la nature du mouvement du corps va changer lorsqu’on passe d’un référentiel à un autre : dans le premier référentiel le mouvement du corps est uniforme, et dans le second il est accéléré.
Puisque le référentiel associé à la Terre (Fig. 2.27) peut être approximativement considéré comme inertiel, alors les référentiels associés à un train se déplaçant à vitesse constante, ou à un navire naviguant en ligne droite à vitesse constante, seront également être inertiel. Mais dès que le train commencera à augmenter sa vitesse, le référentiel qui lui est associé cessera d'être inertiel. La loi de l'inertie et la deuxième loi de Newton ne seront plus valables si l'on considère le mouvement par rapport à de tels systèmes.

Le référentiel géocentrique n'est qu'approximativement inertiel.
Le plus proche du système de référence inertiel est celui associé au Soleil et aux étoiles fixes (Fig. 2.28). La Terre se déplace par rapport à ce référentiel avec accélération. Premièrement, il tourne autour de son axe et, deuxièmement, il se déplace sur une orbite fermée autour du Soleil.
L'accélération due à la révolution de la Terre autour du Soleil est très faible, puisque la période de révolution (année) est longue. L'accélération résultant de la rotation de la Terre autour de son axe avec une période T = 24 heures est nettement plus grande (environ 6 fois), mais elle est également faible. A la surface de la Terre proche de l'équateur, là où cette accélération est la plus grande, elle est égale à :
c'est-à-dire qu'il ne s'agit que de 0,35 % de l'accélération de chute libre g = = 9,8 m/s2. C'est pourquoi le système de référence associé à la Terre ne peut être considéré qu'approximativement comme inertiel.
Preuve de la rotation de la Terre.
Cependant, il existe des phénomènes qui ne peuvent être expliqués si l’on considère le référentiel géocentrique comme inertiel. Il s’agit notamment de la rotation du plan d’oscillation d’un pendule par rapport à la Terre dans la célèbre expérience de Foucault, qui prouve la rotation de la Terre.
La première expérience avec un pendule a été réalisée par le physicien expérimental français Jean Foucault (1819-1868) dans un cercle étroit. Ses résultats intéressent L. Bonaparte et il invite Foucault à démontrer cette expérience à grande échelle sous la coupole du Panthéon à Paris en présence de nombreux spectateurs. Cette manifestation publique, organisée en 1851, est communément appelée l'expérience Foucault.

Considérons les oscillations d'un pendule dans un référentiel inertiel héliocentrique. Pour plus de clarté et de simplicité, nous supposerons que l’expérience est réalisée au pôle.
Supposons que le pendule soit dévié de sa position d'équilibre au moment initial. La force d'attraction vers la Terre T et la force élastique de suspension du pendule agissant sur le pendule se situent dans le même plan vertical (Fig. 2.29). Selon la deuxième loi de Newton, l'accélération d'un pendule coïncide en direction avec la force résultante et se situe donc dans le même plan vertical. Cela signifie qu'au fil du temps, le plan d'oscillation du pendule dans le référentiel inertiel doit rester inchangé. C'est ce qui se passe dans le système héliocentrique. Cependant, le référentiel associé à la Terre n'est pas inertiel et par rapport à lui, le plan d'oscillation du pendule tourne en raison de la rotation de la Terre. Pour détecter cela, il est nécessaire de réaliser la suspension de telle manière qu'il y ait peu de friction et que le pendule lui-même soit assez massif. Sinon, la friction dans la suspension forcera le plan d’oscillation à suivre la rotation de la Terre.
Le déplacement du plan d'oscillation du pendule par rapport à la Terre devient perceptible en quelques minutes. Aux latitudes moyennes, les oscillations du pendule sembleront un peu plus complexes, mais l'essence du phénomène ne changera pas.
Système mondial géocentrique- un système où l'origine des coordonnées est située sur la Terre, qui repose librement au centre de l'Univers sphérique, et le mouvement visible des corps célestes est le reflet de la rotation du Cosmos autour de l'axe du monde.
L'ordre des planètes et des étoiles dépendait de leur période de révolution et était le suivant : Lune, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, étoiles. Les Grecs avaient des désaccords sur Mercure et Vénus : Aristote et Platon les plaçaient immédiatement derrière le Soleil, Ptolémée - entre la Lune et le Soleil.
Animation Gif du mouvement des planètes dans les systèmes géo- et héliocentriques. Source - Groupe d'astronomie de rue
Il existe une opinion selon laquelle les anciens Babyloniens auraient pu connaître le mouvement réel de la Terre et des planètes autour du Soleil, mais cette information est fragmentaire et n'a pas encore été entièrement confirmée. Des tablettes individuelles ont été trouvées, censées représenter une image du monde des anciens Babyloniens, mais elle est difficile à déchiffrer.
La mythologie égyptienne est généralement complexe et diversifiée, mais selon une version, le Soleil était toujours au centre : le dieu solaire Ra était considéré comme le père de tous les autres dieux. Lui et ses huit descendants formèrent ce qu'on appelle l'Ennéade d'Héliopolis. N'est-ce pas le système solaire ?
Il existe également un « inverse » à cette légende : le monde est originaire de huit anciennes divinités, appelées Ogdoad. Ce huit était composé de quatre paires de dieux et de déesses, symbolisant les éléments de la création. Nun et Naunet correspondent aux eaux primordiales, Hu et Khauchet à l'infinité de l'espace, Kuk et Kauket aux ténèbres éternelles. Le quatrième couple a changé plusieurs fois, mais depuis le Nouvel Empire il se compose d'Amon et d'Amaunet, représentant l'invisibilité et l'air. Et ces divinités étaient les parents du dieu soleil, qui a apporté la lumière et la création au monde.
Étonnamment, les mathématiques que nous avons apprises à l’école étaient excellentes pour décrire le mouvement des étoiles dans le ciel sur plusieurs milliers d’années. C'est du moins ainsi que les anciens Grecs le voyaient.
La première ou l'une des premières hypothèses développées sur le système héliocentrique du monde qui nous est parvenue a été formulée au 3ème siècle avant JC. nouvelle ère Aristarque grec de Samos. Sur la base de son hypothèse du Soleil au centre du monde et de ses observations des étoiles, il a conclu que la distance de la Terre au Soleil est négligeable par rapport à la distance du Soleil aux étoiles, ce qui est vrai. De plus, il a établi que la Terre est plusieurs fois plus petite que le Soleil.
Avec le développement des observations astronomiques, une justification différente du mouvement des planètes était nécessaire.
Au début des années 1500, Copernic, s’appuyant sur les écrits de Ptolémée et d’autres philosophes, astronomes et mathématiciens anciens, réalisa que système héliocentrique décrit plus précisément la cinématique des objets, mais en raison de l'opinion établie selon laquelle la Terre est le centre du monde, ses travaux ont été publiés comme une sorte de modèle mathématique conçu pour simplifier les calculs.
À la fin des années 1500, l'astronome danois Tycho Brahe, qui ne pouvait accepter le système copernicien, proposa un compromis système géo-héliocentrique. Selon lui, le Soleil, la Lune et les étoiles tournent autour de la Terre stationnaire, et toutes les planètes et comètes tournent autour du Soleil. D'un point de vue mathématique, ce modèle n'était pas différent du système copernicien, mais il ne soulevait pas d'objections de la part de l'Inquisition, ce qui constituait un avantage important.
Le modèle géohéliocentrique de Tycho Brahe

Au cours des deux siècles suivants, le système géohéliocentrique du monde a agi comme une version juridique du système copernicien. Eh bien, après que Newton ait découvert les lois de la dynamique et la loi de la gravitation universelle, le géocentrisme a finalement perdu ses fondements scientifiques.
Il semblerait que tout le monde sache depuis longtemps que la Terre, comme toutes les planètes, tourne autour du Soleil. Mais les enquêtes menées en 2010-2011 en différents pays, notamment en Russie et aux États-Unis, a montré qu’au moins 30 % de la population adhère encore à une vision géocentrique du monde.
a > Modèle géocentrique du système solaire
Système mondial géocentrique: heure d’origine, description du système solaire, modèle de Ptolémée, place de la Terre, Soleil, Lune, comparaison avec le modèle copernicien.
Quel est le modèle géocentrique de l’Univers ?
Depuis des milliers d’années, les gens observent le ciel nocturne et tentent de comprendre ce qu’est l’Univers. Et parfois, les opinions divergeaient radicalement. Il y a bien longtemps, les magiciens et les anciens sages croyaient fermement que le monde était terre plate(carré) autour duquel se trouvent le Soleil, la Lune et les étoiles. Plus tard, ils remarquèrent que certaines étoiles ne bougeaient pas et commencèrent à les appeler planètes.
Un certain temps passe et l'humanité se rend compte que nous vivons sur un objet rond, alors ils ont commencé à ajuster les mécanismes environnants à cette compréhension. Formé progressivement nouveau système vues, à partir desquelles le modèle géocentrique du monde a émergé. Bien qu’il n’ait plus été utilisé depuis longtemps, il répondait autrefois à des questions fondamentales sur la structure de l’Univers.
Bien entendu, il n’est pas surprenant que les gens pensaient que notre planète Terre était au centre de l’Univers. Finalement, on a remarqué que le Soleil et la Lune changeaient de position dans le ciel. Ainsi, du point de vue des observateurs terrestres, nous sommes immobiles et tout bouge autour. La figure du bas compare les modèles géocentriques et héliocentriques de l'Univers, où l'accent est mis sur la place des corps célestes dans le système solaire et les principes de leur mouvement.

Ainsi, les documents des anciens Babyloniens et Égyptiens ont été pris en compte, ce qui a alimenté la théorie selon laquelle la Terre était au centre de tout. Ils ont continué à y croire aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mais de nombreuses incohérences sont apparues, ce qui nous a obligés à chercher un nouveau modèle, puisque le précédent ne pouvait pas les expliquer.
La Grèce antique et le modèle géocentrique du système solaire
Les premières mentions du modèle géocentrique sont apparues au 6ème siècle avant JC. e. Le philosophe Anaximandre a suggéré que la Terre reste immobile et que le Soleil et la Lune tournent autour. Dans le même temps, les Pythagoriciens ajoutent que notre planète est ronde, puisqu'ils ont vu des éclipses. Jusqu'au 4ème siècle avant JC cette idée a été combinée avec l'Univers géocentrique, qui a contribué à construire le système cosmologique.
Platon et Aristote ont grandement contribué à l'idée d'un modèle géocentrique du monde. Les premiers pensaient que la planète ne bougeait pas. De là s'étendent des sphères sur lesquelles se trouvent le Soleil, la Lune et d'autres planètes en mouvement. Le modèle a été étendu par Eudoxe de Cnide, qui s'est appuyé sur une explication mathématique du mouvement planétaire. Aristote est alors intervenu et a ajouté que les objets se déplacent dans des sphères concentriques.

Les sphères se sont déplacées vers différentes vitesses et représentait une substance indestructible - l'éther. Ensuite, il a ajouté une description des 4 éléments les plus importants : la terre, l'eau, le feu, l'air, et a également ajouté « l'éther céleste ».
Aristote a écrit que la terre est l'élément le plus lourd, elle est donc attirée vers le centre et le reste forme des couches autour d'elle. À la toute fin se trouvait l'éther, dans lequel les objets célestes « flottaient ». Une autre innovation importante est l'ajout d'un « moteur ». Le philosophe croyait qu’il existait une force, voire un être, qui mettait en mouvement le mécanisme.

Bien entendu, tout cela a été confirmé par certaines théories. Par exemple, si la planète bougeait, il devrait y avoir un déplacement significatif des étoiles ou des constellations. Il s'avère qu'ils sont immobiles ou situés beaucoup plus loin. Bien entendu, ils ont préféré choisir la première option, car c’est l’explication la plus simple.
L’éclat de Vénus a servi de preuve supplémentaire. Ils croyaient qu’il était toujours situé à la même distance de nous à n’importe quelle époque. Bien sûr, il s’est avéré plus tard que la planète avait des phases. Mais les peuples anciens n’avaient pas de télescopes.
Le modèle géocentrique du système solaire de Ptolémée
Naturellement, le système décrit présentait des défauts et les auteurs le savaient. Par exemple, la luminosité de Mercure, Jupiter et Mars changeait périodiquement. De plus, un « mouvement rétrograde » a été remarqué derrière eux, lorsqu'ils ralentissaient, se retrouvaient en retard, puis avançaient à nouveau en mouvement.
Tout cela a introduit encore plus de désaccords, que l'astronome égypto-grec Ptolémée a dû résoudre. Au IIe siècle après JC. il écrit "Almageste". Il introduit le modèle géocentrique de l’Univers de Ptolémée, qui sera considéré comme dominant pour les 1 500 prochaines années. Il a suivi les anciennes traditions et a répété que la Terre est située au centre et que les objets se déplacent autour d'elle.
Ici, une nouvelle idée apparaît : l'existence de deux sphères. Le premier est le déférent, qui est un cercle éloigné de notre planète. Il était utilisé pour tenir compte des différences dans la durée des saisons. Le second est l'épicycle. C'était dans la première sphère (un cercle dans un cercle) et expliquait le mouvement rétrograde des planètes.
Mais même cela n’a pas dissipé tous les doutes. Ce qui était particulièrement inquiétant était que la boucle rétrograde des planètes (principalement Mars) était parfois plus grande ou plus petite que prévu. Pour résoudre ce problème, Ptolémée a créé un équant, un instrument géométrique situé près du centre de l'orbite planétaire, qui le mettait en mouvement avec une vitesse angulaire uniforme.
À ce stade, l’observateur a l’impression que l’épicycle se déplace toujours à une vitesse constante. Le système a duré tout au long de l’Empire romain, de l’Europe médiévale et du monde islamique, restant inchangé pendant mille ans. Mais ce mécanisme semblait incroyablement complexe et fastidieux.
Modèle géocentrique du système solaire au Moyen Âge
Au Moyen Âge, ce sujet est redevenu d'actualité, car il s'accordait bien avec les croyances chrétiennes. Thomas d'Aquin s'est chargé du développement du système, en essayant d'unir la foi et la raison.

Tout a commencé avec le fait que la planète était divisée en « ciel » et en Terre. La terre était située au centre de la création et les cieux se trouvaient au-delà. Tout cela a alimenté la croyance chrétienne selon laquelle l’homme est la principale création de Dieu. De plus, le « moteur » d’Aristote s’est avéré utile, dont la place a été prise par Dieu.
Bien sûr, personne n’osait remettre en question l’idée selon laquelle les cieux tournaient autour de la planète, car c’était une hérésie et même une punition. La situation est restée ainsi jusqu'à la publication du livre « De la rotation des sphères célestes » au XVIe siècle. Son auteur est Nicolas Copernic, qui a osé prouver l'exactitude du modèle héliocentrique de l'Univers. Bien entendu, dans des conditions de persécution et de persécution, l'ouvrage a dû être publié à titre posthume.
Il convient de noter que dans le monde musulman, le modèle géocentrique du monde existait également au Moyen Âge. Mais déjà dès le 10ème siècle après JC. Des astronomes sont apparus pour contester les travaux de Ptolémée. Parmi eux se trouvait As-Sijizi (945-1020). Il croyait que la Terre tournait autour de son axe et autour du Soleil. Mais il s’est approché du côté de la philosophie et non des mathématiques.

Plusieurs astronomes andalous se sont également opposés au modèle géocentrique aux XIe et XIIe siècles. Arzakel a complètement abandonné les théories grecques sur l'uniforme. mouvement circulaire et dit que Mercure voyage dans une ellipse.
Au XIIe siècle, Alptragius s'implique. Il a créé un nouveau modèle qui n'avait pas besoin d'équant, d'épicycle et d'excentricité. Cette idée s'est accompagnée de la publication de Mataliba de Fakhruddin al-Razi, qui traitait de physique conceptuelle. Il réfutait l’idée de la centralité de la Terre. Au lieu de cela, il a suggéré qu’il existe notre monde, au-delà duquel il existe des milliers d’autres mondes.
La rotation de la Terre était un sujet de discussion populaire à l'Observatoire de Magar (Iran oriental) du XIIIe au XVe siècle. Bien que tout cela se soit développé au niveau de la philosophie et ne concernait pas l’héliocentrisme, de nombreuses preuves rappelaient celles que Copernic exprimerait plus tard.
Modèle héliocentrique et modèle géocentrique du système solaire
Nicolas Copernic a commencé à développer son modèle au XVIe siècle. Il contient toutes ses pensées et travaux scientifiques. Il n’a pas été créé de toutes pièces, mais a utilisé les développements des géocentristes de l’opposition.

En 1514, Copernic publie un petit traité, « Petit Commentaire », qu'il distribue à ses amis. Le manuscrit ne comptait que 40 pages, décrivant succinctement l'hypothèse héliocentrique. Tout cela reposait sur 7 grands principes :
- Le centre de la Terre est le centre de la sphère lunaire (la Lune tourne autour de la Terre).
- Toutes les sphères tournent autour du Soleil, situé près du centre universel.
- La distance entre la Terre et le Soleil ne représente qu’une petite fraction de la distance entre le Soleil et les autres étoiles, nous ne voyons donc pas de parallaxe.
- Les étoiles sont immobiles. Il nous semble qu'ils bougent parce que la Terre tourne autour de son axe.
- La Terre tourne autour du Soleil, ce qui donne l’impression que le Soleil migre.
- La Terre a plus d'un mouvement.
- La Terre se déplace en orbite autour du Soleil, ce qui donne l’impression que les planètes qui l’entourent vont dans la mauvaise direction.
Ce n’était que le début du développement du modèle héliocentrique du système solaire. L'auteur a continué à accumuler des informations et a achevé en 1532 ses travaux sur « Sur la rotation des sphères célestes ». Les mêmes arguments apparaissent ici, mais déjà étayés par des calculs mathématiques.