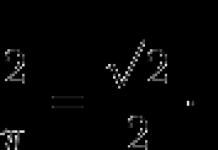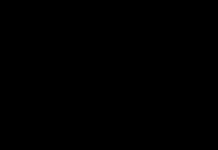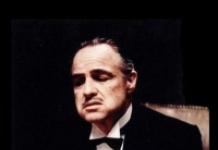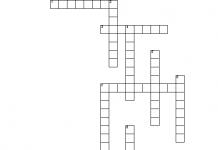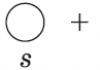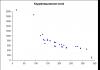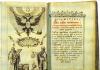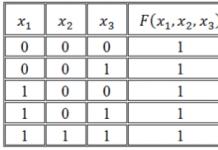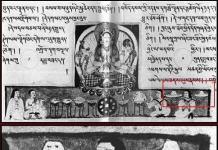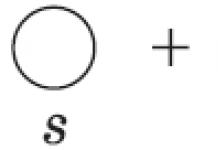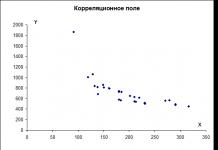Guillaume II (1859-1941), empereur allemand et roi de Prusse(1888-1918).
Né le 27 janvier 1859 à Berlin. Petit-fils de Guillaume Ier, fils aîné de l'empereur Frédéric et de Victoria, fille de la reine Victoria d'Angleterre. A fréquenté le lycée de Kassel, puis a réussi service militaire et a étudié le droit à l'Université de Bonn. En 1881, il épousa Augusta Victoria, princesse de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
Après la mort de son père en juin 1888, Guillaume II hérite du trône. Il entre immédiatement en conflit avec le chancelier avide de pouvoir O. von Bismarck et le contraint à la démission (1890).
Convaincu du caractère sacré des prérogatives royales, Guillaume II a joué un rôle actif à toutes les étapes de la vie politique contemporaine, en soutenant les arts, les sciences et l'éducation. Le jeune Kaiser initie une nouvelle voie pour l'Allemagne, basée sur une alliance avec l'Autriche-Hongrie. En conséquence, le pays a perdu la confiance de la Russie et de la Grande-Bretagne. La Russie s'est réorientée vers une alliance avec la France, qui est devenue la base de l'Entente. Les erreurs politiques commises par Guillaume II ont non seulement miné le prestige de l'Allemagne, mais ont également renforcé les pays qui s'y opposaient.
DANS dernières années Durant son règne, le Kaiser chercha à réduire la vulnérabilité de l'Allemagne liée au renforcement de l'Entente. Pour ce faire, Wilhelm a essayé par tous les moyens de renforcer l'alliance de l'Allemagne, de l'Astro-Hongrie et de l'Italie. Sa responsabilité dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale (cette clause était incluse dans le Traité de Versailles) a été contestée par beaucoup, bien que l'empereur ait joué un rôle clé dans le déclenchement du conflit.
Avec le déclenchement de la révolution en Allemagne, qui fut suivie par la défaite des armées allemandes en front occidental, Guillaume II fut en réalité déchu du pouvoir par le chancelier P. von Hindenburg. Sur les conseils d'Hindenburg, le 9 novembre 1918, il s'installe aux Pays-Bas, qui refusent de l'extrader vers les Alliés.
Friedrich Wilhelm Victor Albert de Prusse est né le 27 janvier 1859 à Potsdam. Il était le fils du prince héritier Frédéric-Guillaume (plus tard empereur allemand Frédéric III) et de son épouse Victoria d'Angleterre.
En 1869, le prince Wilhelm reçut le grade de lieutenant dans le 1er régiment d'infanterie de la garde. En 1870-1877, il étudia au gymnase de Kassel-Wilhelmshef ; en 1877-1879, il étudia le droit et les sciences gouvernementales à l'Université de Berlin et effectua des stages dans diverses unités de gardes et ministères.
En 1881, le prince Wilhelm épousa Augusta Victoria, princesse de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
Depuis 1885, le prince Wilhelm commandait le 1er régiment d'artillerie de la garde et depuis 1888, la 2e brigade d'infanterie de la garde.
Après la mort de son grand-père l'empereur en mars 1888, Wilhelm fut déclaré héritier du trône et prince héritier. Il accède au trône après la mort de son père, l'empereur Frédéric III, en juin 1888.
En mars 1890, l'empereur Guillaume II destitua le prince O. von Bismarck du poste de chancelier du Reich, concentrant ainsi tout le pouvoir entre ses mains. Le jeune monarque menait une politique de renforcement de l'absolutisme et était partisan de la militarisation du pays. Guillaume II exprima les intérêts des cercles réactionnaires de la bourgeoisie monopoliste allemande et des Junkers prussiens, qui cherchaient à redistribuer par la force le monde en leur faveur, et furent l'un des initiateurs de la course aux armements, de la construction d'un puissant marine, l’expansion de l’impérialisme allemand en Chine, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce faisant, il a contribué de manière significative à l’aggravation des contradictions impérialistes qui ont conduit à la Première Guerre mondiale.
Guillaume II est entré dans l'histoire comme l'un des principaux initiateurs de la Première Guerre mondiale (1914-1918). Avec le déclenchement des hostilités, l'empereur assume le titre de commandant en chef suprême de l'armée et de la marine allemandes. Cependant, en fait, la direction des opérations militaires était confiée au chef d'état-major général (ces postes furent successivement occupés par T. von Moltke, E. von Falkenhayn, P. von Hindenburg).
Dans la première période de la guerre, Guillaume II interférait constamment avec les actions du chef d'état-major ; ses ordres devinrent l'une des raisons des échecs de l'armée allemande sur la Marne. Après la nomination du maréchal P. von Hindenburg comme chef d'état-major en août 1916, l'empereur se démit effectivement du commandement.
En novembre 1918, après le déclenchement de la révolution en Allemagne, Guillaume II quitte le pays et se rend aux gardes-frontières néerlandais. Le 28 novembre 1918, le Kaiser abdique du trône.
En 1919, Guillaume II acquiert le domaine Doorn dans la province néerlandaise d'Utrecht. Selon le Traité de Versailles de 1919, le Kaiser était soumis à un procès devant le Tribunal international en tant que cause de guerre et criminel de guerre. Cependant, le gouvernement des Pays-Bas a refusé de l'extrader et le Landtag prussien a restitué en 1926 les terres, les palais, les titres et les bijoux qui lui appartenaient auparavant à l'empereur abdiqué.
Guillaume II passa le reste de sa vie en Hollande. En exil, il publie « Mémoires 1878-1918 » (1922) et le livre « Ma vie » (1926), dans lesquels il tente de justifier la politique agressive de l’Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale.
En 1931-1932, Guillaume II reçut G. Goering sur son domaine et, en 1933, il se félicita de l'instauration de la dictature nazie en Allemagne. Avec l’occupation des Pays-Bas en mai 1940, l’ancien empereur fut interné par les troupes allemandes entrant dans le pays. En juin 1940, après la prise de Paris par les nazis, le Kaiser envoya un télégramme de bienvenue à A. Hitler.
Guillaume II meurt le 4 juin 1941 à Doorn. Sur ordre d'A. Hitler, il fut enterré dans son domaine avec les honneurs militaires.
| 3e empereur allemand | ||
|---|---|---|
| 15 juin 1888 – 9 novembre 1918 | ||
- Palais des Princes héritiers, Mitte, Berlin, Confédération allemande
Domaine Dohrn, Reichskommissariat des Pays-Bas
- Université de Bonn


Le règne de Wilhelm a été marqué par le renforcement du rôle de l'Allemagne en tant que puissance industrielle, militaire et coloniale mondiale et par la conclusion de la Première Guerre mondiale, dont la défaite a conduit au renversement de la monarchie lors de la Révolution de Novembre. L'époque du règne de Guillaume II est appelée Williamite.
Enfance et jeunesse
Prince Friedrich Wilhelm Victor Albert de Prusse(Allemand) Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußenécoutez)) est né le 27 janvier 1859 au palais princier de Berlin. Il était l'aîné des huit enfants de Frédéric-Guillaume de Prusse et de la princesse Victoria, fille aînée de l'homonyme de la reine. Il était cousin du roi britannique George V (le père de George était le frère de la mère de William), ainsi que de l'impératrice russe Alexandra Feodorovna (leurs mères étaient également sœurs).
L'accouchement s'est avéré très difficile - le prince est né avec de nombreux handicaps physiques, déjà présents jeune âge a failli lui coûter la vie. Il est né avec un bras gauche endommagé (plus court que le droit de 15 cm) ; à l'avenir, Wilhelm fut obligé de cacher ce défaut physique en plaçant une main sur l'autre ou en s'asseyant en biais par rapport à la caméra. En essayant de corriger cette anomalie congénitale, les médecins de la vie pensaient qu'il s'agissait d'une paralysie temporaire du bras due à une compression mécanique lors de l'accouchement. Par conséquent, une douche quotidienne à l’eau de mer et une thérapie électroconvulsive régulière pour le membre blessé ont été prescrites. Le bras a été redressé et étendu à l'aide d'une « machine à redresser les mains » spécialement conçue à cet effet, une machine saine. main droite attaché au corps dans l'espoir que le garçon commencerait involontairement à utiliser celui de gauche. De plus, pendant plusieurs années, il a été contraint de porter "machine pour tenir la tête droite"(à cause d'un torticolis congénital), jusqu'à ce que finalement les parents et les médecins décident de subir une opération pour disséquer le muscle sternocléidomastoïdien cervical. Toutes ces actions, naturellement, causaient beaucoup de douleur au petit enfant et, de plus, l'efficacité du traitement était faible.
Cependant, depuis son enfance, Wilhelm a lutté obstinément contre ses handicaps physiques congénitaux et, à l'âge de 18 ans, il a réussi à surmonter les conséquences d'une rupture du nerf brachial (une autre blessure à la naissance). Grâce à la lutte constante contre ses défauts congénitaux, il a réussi à cultiver une énorme volonté. Dans le même temps, le garçon a grandi renfermé, incertain intérieurement de lui-même. Les parents étaient très tristes du handicap physique de leur fils. Ils décidèrent de compenser cela par une éducation excessive.
Il monta sur le trône à l'âge de 29 ans, lorsque son grand-père Guillaume Ier et son père Frédéric III moururent l'année des trois empereurs.
Accession au trône
Après la mort de son père, qui ne régna que trois mois, Wilhelm monta sur le trône le 15 juin 1888. Son premier manifeste était un ardent appel à l'armée et à la marine, dans lequel il soulignait son lien étroit et inextricable avec l'armée, la gloire militaire de ses ancêtres, l'image inoubliable de son grand-père en tant que commandant et sa détermination à maintenir le l'honneur et la gloire de l'armée.
Comme si un ajout à ce manifeste était le discours impérialiste qu'il prononça le 16 août de la même année lors de l'inauguration du monument au prince Friedrich Charles à Francfort-sur-l'Oder, dans lequel il déclarait : « Il vaut mieux mettre en place les 18 corps de l’armée allemande et 42 millions d’Allemands plutôt que d’abandonner une quelconque partie des acquisitions territoriales de l’Allemagne. ».
L'attention du jeune empereur était principalement attirée sur les affaires extérieures. Pour renforcer ses liens avec les puissances amies et alliées, il commença à voyager dans les cours européennes et à nouer des relations personnelles avec les monarques des grands et petits États. Il se rend à plusieurs reprises en Russie (en juillet et août), en Suède, en Autriche, en Italie et en Angleterre, où la reine Victoria l'élève au rang d'amiral honoraire de la flotte anglaise, dont il est très fier. Guillaume visita également le Danemark, la Hollande, Constantinople et enfin Athènes, où il assista au mariage de sa sœur avec le prince héritier grec.
Police étrangère
Guillaume II est surtout connu pour la politique étrangère active de l'Allemagne. La politique étrangère allemande au cours des deux premières années du règne de l'Empereur fut fortement limitée par l'influence personnelle de Bismarck. Cela s'est exprimé le plus clairement dans l'affaire dite Wolgemuth, un conflit survenu en avril 1889 à la suite de l'arrestation d'un fonctionnaire de la police allemande en Suisse. Bismarck était prêt à reconsidérer la question de la position de la Suisse parmi les puissances européennes, mais à l'initiative personnelle de Wilhelm, le conflit fut résolu et un nouveau traité entre l'Allemagne et la Suisse fut bientôt conclu, dans lequel toutes les exigences suisses furent satisfaites. Le différend entre l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis concernant le protectorat des îles Samoa dans l'océan Pacifique a également été résolu avec succès.
En raison de contradictions croissantes avec le chancelier, le 20 mars 1890, Wilhelm accepta la démission de Bismarck.
Narcissique, pointilleux, amateur de poses théâtrales et de discours pompeux, s'efforçant toujours de jouer un rôle spectaculaire, le jeune Kaiser se brouille bientôt avec le vieux chancelier impérieux, qui ne tolère pas l'ingérence dans sa politique. Il y avait de sérieux désaccords entre le chancelier et le Kaiser sur la question de l'attitude envers la Russie.<…>Bismarck, comme toujours, considérait la guerre contre la Russie comme désastreuse.
Le Kaiser nomma le général Caprivi comme nouveau chancelier, après quoi police étrangère L'Allemagne est devenue plus sobre, le Kaiser a commencé à accorder plus d'attention aux problèmes internes. Un accord direct avec l'Angleterre élimina la cause des querelles suscitées par la politique coloniale du prince de Bismarck. En 1890, c'est arrivé un événement important- L'île de Helgoland, qui appartenait aux Britanniques depuis 1807, fut restituée à l'Allemagne. L'île fut échangée par l'Allemagne contre Zanzibar et Heligoland appartenait à nouveau à l'Allemagne. Cependant, la nouvelle acquisition a été évaluée négativement dans la presse bismarckienne, de sorte que le peuple allemand n’a pas pu apprécier correctement l’action du Kaiser. Le nouvel empereur démontre ainsi ses capacités diplomatiques et désamorce brièvement les tensions autour des questions coloniales.
Suivant les traditions séculaires des Hohenzollern, Wilhelm était particulièrement préoccupé par les questions et les problèmes de l'armée allemande. Wilhelm a exigé du Reichstag une augmentation de l'armée de 18 000 personnes et une augmentation du budget militaire de 18 millions de marks. C’est sous Guillaume II que l’armée allemande s’est imposée en Europe tant en nombre qu’en niveau d’entraînement.
Dans le même temps, l'empereur préparait le terrain pour des relations apaisées avec la France dans le domaine des intérêts scientifiques, sociaux et artistiques. Au début de 1891, la mère et la sœur de l'empereur se rendent à Paris pour attirer des peintres français afin qu'ils participent à la prochaine exposition d'art de Berlin. Il s'agit de la première visite en France de membres de la famille Hohenzollern depuis les événements de 1870-1871. Cependant, ce geste fut ignoré par les Français, et les relations entre ces pays restèrent dans la même impasse dans laquelle elles se trouvaient.
La politique étrangère allemande reposait sur les mêmes fondations posées par Guillaume Ier et Bismarck, à savoir Triple alliance. L'empereur cherche à renforcer cette union politique par des liens économiques, pour lesquels des accords commerciaux ont été conclus en novembre 1891 entre l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche-Hongrie. La Suisse et la Belgique participent également à l'union douanière. Fondés sur des concessions mutuelles dans le domaine de la politique tarifaire internationale, ces accords visaient à assurer, pendant au moins 12 ans, des relations commerciales internationales correctes et durables. C’est à cette époque que l’industrie allemande connaît son plus grand développement.
L'Allemagne a été contrainte de mener une guerre sur deux fronts, à la suite de laquelle la situation économique à l'arrière s'est fortement détériorée, ce qui a contribué à la croissance des sentiments révolutionnaires et des troubles parmi les classes inférieures. La défaite de la guerre (novembre 1918) était synchrone avec la révolution en Allemagne, après quoi Wilhelm abdiqua et quitta le pays pour s'installer dans les Pays-Bas neutres.
Politique intérieure
Après être monté sur le trône, le Kaiser a tout d'abord attiré l'attention sur le fait que le régime de Bismarck, qui disposait d'un pouvoir pratiquement illimité, est progressivement devenu réactionnaire. L'interdiction du Parti social-démocrate, la corruption de journaux, la lutte contre l'Église catholique - tout cela et bien plus encore ont commencé à affecter négativement l'état de la société en Allemagne. Le prince proposa ouvertement de réprimer les troubles parmi les mineurs qui éclatèrent en 1889 avec l'aide des troupes. De plus, Wilhelm était très contraint dans ses décisions par le caractère impérieux du chancelier. Ces désaccords conduisirent Bismarck à quitter son poste.
Au cours des longues années (de 1862 à 1890) de son mandat de chancelier, Bismarck a créé un appareil bureaucratique soumis uniquement à lui. Pour entrer dans ce cercle, il fallait être soit un parent du prince, soit une ancienne connaissance, et en même temps faire preuve d'une loyauté constante et soutenir le chancelier. Il s'est avéré que cet appareil bureaucratique, après le départ de Bismarck (son fils Herbert a démissionné le même jour du poste de ministre des Affaires étrangères), s'est avéré pratiquement incontrôlable. Pour les fonctionnaires, le prince Bismarck était une autorité incontestée. Dès qu’un « étranger » était au pouvoir, ils commençaient à créer toutes sortes d’obstacles sur le chemin du nouveau chancelier.
Dans ses mémoires, le Kaiser écrit : « ... un successeur... de lourds sacrifices étaient attendus dès le début sans espoir de reconnaissance. Il serait considéré comme un usurpateur dans une place indue qu'il est incapable d'occuper. Des critiques, des critiques et encore des critiques, ainsi que l’hostilité de tous les partisans du prince, voilà sur quoi le nouveau chancelier pouvait compter. Le fort courant devait le contrecarrer ; on ne pouvait pas s'attendre à moins d'opposition de la part du vieux prince lui-même ».
Le 29 mars 1890, Caprivi abroge la loi contre la social-démocratie. D'une part, les intérêts de la bourgeoisie étaient satisfaits, et d'autre part, la « guerre de Trente Ans » commença entre les sociaux-démocrates et les partis conservateurs, qui fut une source d'instabilité au Reichstag, tandis que le Kaiser a été contraint de jouer le rôle de médiateur dans leurs relations. Dans les premiers jours de la nomination de Caprivi, un certain nombre de lois et de décisions politiques ont été adoptées, très controversées et ont brièvement placé l'Allemagne dans une position économique et politique inconfortable (ce qui a ensuite provoqué des évaluations polarisées dans la société).
Il s'agit de décisions telles que la suppression du Fonds social bismarckien (même si, d'un point de vue moral, la décision de supprimer le fonds créé pour corrompre la presse était correcte), la suppression des restrictions sur les passeports à la frontière avec la France (qui a ouvert un domaine opérationnel du renseignement français, mais qui a grandement contribué à la pénétration des produits allemands sur le marché français), une réduction de 30 % des droits de douane sur les céréales importées (ce qui a fortement affecté l'état du marché allemand). Agriculture, mais a permis de réduire considérablement les prix du pain).
Politique sociale
Déjà dans ses deux premiers discours du trône, notamment devant la Diète impériale le 25 juin 1888 et devant les chambres prussiennes le 27 juin, il exposa son programme politique. Dans un discours aux chambres prussiennes, l'empereur promit « respecter fidèlement et consciencieusement les lois et les droits de représentation populaire », pour protéger toutes les confessions religieuses et rappeler les paroles de Frédéric le Grand selon lesquelles en Prusse "Le roi est le premier serviteur de l'Etat". Dans un discours à la Diète Impériale, l'Empereur déclara qu'avec l'aide de la législation impériale, il tenterait « assurer à la population laborieuse la protection qui peut être accordée, selon les enseignements de la morale chrétienne, aux faibles et aux nécessiteux dans la lutte pour l’existence » et de cette façon « se rapprocher de la résolution des contrastes sociaux malsains ». Le 24 mai 1889, le Reichstag a adopté une loi sur l'assurance des travailleurs contre la misère en cas de vieillesse et d'incapacité de travail, bien que lors de la discussion de cette loi, elle ait été vivement critiquée comme n'atteignant pas suffisamment son objectif. Avec sa publication, le programme de réforme sociale était presque épuisé au sens où l'entendait le prince de Bismarck, pour qui la question du travail n'était, par essence, qu'un moyen de rattacher la classe ouvrière au gouvernement par le biais des assurances et d'autres institutions concentrées dans le mains de l'administration. De telles pensées n’étaient pas visibles dans les actions du Kaiser, qui étaient empreintes de quelque chose de frais et de nouveau, à savoir une simple attitude humaine envers les masses travailleuses. Cela était particulièrement évident dans deux rescrits célèbres du 4 février 1890. Sur la base de l'un d'eux, le Conseil d'État prussien, sous la présidence personnelle du roi et avec la participation d'experts spécialement désignés parmi les grands industriels et les représentants de la classe ouvrière, s'est engagé dans une série de réunions (en février 1890) élaborer du matériel pour les projets de loi visant à « pour protéger les travailleurs contre l’exploitation arbitraire et illimitée de la main-d’œuvre ».
Sous le règne de Guillaume II, la ligne de Bismarck visant à supprimer le socialisme fut abandonnée ; Les lois de Bismarck contre les socialistes (-, Sozialistengesetz) ont cessé d'être appliquées et il y a eu un certain rapprochement entre les autorités et les sociaux-démocrates modérés.
Un autre rescrit soulevait la question de la protection du travail des travailleurs sur la base d'accords internationaux (le premier pas officiel dans ce sens a été fait par la Suisse, qui a volontiers concédé l'honneur de mettre en œuvre son projet à l'Allemagne) ; de cette manière, l'unité de la législation du travail devrait être réalisée dans les principaux pays industrialisés Europe de l'Ouest, afin que les mesures de protection des travailleurs prises dans un État ne réduisent pas ses ressources dans la lutte pour la domination sur le marché mondial. Des représentants de l'Angleterre, de la France, de l'Italie et de la Suisse furent invités à Berlin pour une conférence qui eut lieu en mars 1890, présidée par le ministre prussien du Commerce von Berlepsch. Lors de cette conférence, où le représentant de la France Jules Simon voit "le début d'une nouvelle ère sociale", des questions ont été examinées sur le travail des femmes, des enfants et des adolescents, sur le travail de nuit et du dimanche, sur la limitation de la journée de travail des adultes, sur l'interdiction aux femmes mariées de travailler avant un certain temps après leur libération, sur l'interdiction aux enfants d'entrer dans le pays. usine jusqu'à ce qu'ils aient passé l'école, sur le caractère obligatoire de la formation initiale. La conférence a laissé la mise en œuvre de ses résolutions à la législation de chaque État séparément et a en même temps exprimé le souhait que les réunions internationales continuent à être convoquées dans l'esprit de l'unité de ces législations. Conformément aux résolutions de la conférence, le gouvernement allemand a présenté une loi sur la protection des travailleurs du Reichstag sous la forme de modifications de certains articles de la Charte industrielle.
D'autres domaines de la gestion interne attirent l'attention de Wilhelm. Ainsi, sous lui, des mesures significatives ont déjà été prises vers la réorganisation du système fiscal prussien, attirant les classes aisées et aisées vers une participation plus sérieuse au paiement des impôts de l'État et réduisant la charge fiscale pesant sur les couches inférieures de la population. . Kaiser a dit : "Je veux être un roi des gueux" ("Je veux être le roi des pauvres"). Ainsi, un impôt sur le revenu progressif a été adopté (le taux d'intérêt augmente avec les revenus), ce qui a contribué à l'enrichissement d'une certaine couche de résidents. En Prusse, une nouvelle organisation de l'autonomie rurale a été mise en place et les privilèges des grands propriétaires fonciers et du gouvernement local ont été détruits. la vie économique les principes des élections libres furent introduits dans la paysannerie. Enfin, l’empereur allemand pose la question d’une transformation radicale de la vie scolaire. L'empereur a exigé de l'école qu'elle soit une continuation de la famille, qu'elle signifie non seulement l'éducation, mais aussi l'éducation de l'enfant, et surtout, à tous égards : physique, moral et mental. Les vues pédagogiques de l'empereur allemand ont été exposées par lui dans un discours prononcé le 2 décembre et développées plus en détail dans l'ouvrage d'un de ses proches, Güssfeldt (P. Güssfeldt, « Die Erziehung der deutschen Jugend », Berlin, 1890). Ce livre a ensuite été traduit en Français: A. Herzen, « Vellé ités pédagogiques d'un empereur » (Lausanne, 1890).
Première Guerre mondiale
Guillaume II était un fervent partisan de la politique militaire menée en -1918. Après la tentative d’assassinat de l’archiduc François Ferdinand en juin 1914, il garantissait à l’Autriche toute l’aide possible de l’Allemagne dans la lutte contre la « barbarie serbe ». Lors d’un célèbre discours au Reichstag en août 1914, il déclara : « À partir d’aujourd’hui, je ne connais plus les partis politiques, je ne connais que les citoyens allemands. » La politique du Kaiser était soutenue par toutes les factions parlementaires du Reichstag. Y compris le SPD et le Parti du centre, jusqu’alors critiques à l’égard de la guerre.
Au cours de la guerre, dont il passa la majeure partie au quartier général suprême des troupes allemandes à Ples (Silésie), Wilhelm commença progressivement à perdre le contrôle des opérations militaires, les décisions réelles sur toutes les opérations les plus importantes furent prises par les généraux Paul. von Hindenburg et Erich Ludendorff. Depuis 1915, Wilhelm a été effectivement démis du commandement militaire.
Il a néanmoins tenté de créer un semblant d’influence. Le 29 juillet 1917, Wilhelm visita dans son propre train le théâtre d'opérations militaires près de la ville de Smorgon pour exprimer sa gratitude aux soldats et officiers qui participèrent aux batailles défensives du 19 au 26 juillet dans les positions de Smorgon-Krevo et repoussèrent les Russes. troupes lors de l’opération Krevo.
Guillaume II en tant que personne
Qualités personnelles
L’un des traits de caractère les plus frappants de l’empereur allemand était sa passion pour les discours impromptus. Il parlait de manière concise, abrupte, nette, plus préoccupé par ce qu'il allait dire que par la manière dont cela serait dit. Parfois, à cause de la précipitation, ses discours pouvaient prendre un caractère ambigu ; cela doit être considéré comme le principal inconvénient de Wilhelm en tant qu’orateur. Impatient et énergique, il est plutôt indifférent aux avis de la « foule ». Fermement convaincu de sa vocation divine, il était déterminé à accomplir sa volonté, réprimant toute opposition d'où qu'elle vienne. Dans la vie privée, il se distinguait par sa simplicité et sa modération, mais dans les occasions solennelles, il montrait un amour du luxe et de la splendeur, totalement incompatible avec les traditions de ses ancêtres, qui se distinguaient toujours par la frugalité, allant presque jusqu'à l'avarice.
Intérêts
Dans sa jeunesse, jusqu'à son accession au trône, il ne montra pas beaucoup d'intérêt pour un travail sérieux. Ce qui l'intéressait le plus, c'était la chasse ; ses chiens de chasse préférés étaient les teckels à poil court. Au tournant du siècle, il commença à montrer un grand intérêt pour la culture ancienne, les fouilles et toutes sortes de recherches historiques. Wilhelm était connu pour son amour de la mer et des voyages en mer. C'est annuel voyage en mer vers les côtes de la Norvège est devenue l'une des traditions de la Maison Hohenzollern. Son exil a également révélé son amour pour l’abattage des arbres. En une semaine seulement, en décembre 1926, Wilhelm, 67 ans, détruisit, selon ses propres calculs, 2 590 arbres.
Renonciation et fuite
Décès et funérailles
Guillaume II est décédé à 12h30 le 4 juin 1941 au domaine de Dohrn (Reichskommissariat Pays-Bas, Troisième Reich) à l'âge de 82 ans des suites d'une embolie pulmonaire.
Lorsque cela fut rapporté à Hitler, celui-ci, malgré son hostilité personnelle envers l'ancien empereur, ordonna des funérailles nationales avec les honneurs militaires, car il cherchait à démontrer aux Allemands que le Troisième Reich était le successeur de l'Empire allemand. Les funérailles ont eu lieu aux Pays-Bas avec la participation d'un certain nombre d'anciens officiers de l'armée impériale, dont le maréchal August von Mackensen. Hitler lui-même n'est pas venu aux funérailles. La délégation des autorités officielles allemandes, au nom du Führer, était dirigée par Wilhelm Canaris et Arthur Seyss-Inquart. Ancien empereur a été enterré dans un petit mausolée dans le jardin de sa dernière résidence. Son souhait que la croix gammée ne soit pas utilisée lors des funérailles n'a pas été entendu.
Il est généralement admis que c'est l'empereur allemand Guillaume II qui a directement participé à l'incitation à la Première Guerre mondiale. Le 10 novembre 1918, il part pour les Pays-Bas et le 28 novembre, il abdique du trône. Le Kaiser passa le reste de sa vie dans le domaine de Dorn. 59 chariots et charrettes furent nécessaires pour livrer ses biens au château. Aujourd'hui, tout à Dorne a été préservé tel qu'il était sous le monarque en exil. 
Château de Dorn
L'empereur Guillaume II a mis fin à la dynastie des Hohenzollern, qui a régné pendant près de 400 ans. Le refuge du monarque en disgrâce a été fourni par la reine Wilhelmine des Pays-Bas. A cette occasion, Wilhelm écrivit une lettre de gratitude : « Les événements m'ont obligé à venir dans votre pays en tant que particulier et à demander la protection de votre gouvernement. L'espoir que vous m'avez donné, compte tenu de la situation difficile, ne m'a pas déçu. Je vous remercie sincèrement, ainsi que votre gouvernement, pour votre aimable hospitalité. 
Le dernier Kaiser allemand Guillaume II.
Bien que l’article 227 du Traité de Versailles prévoyait la poursuite de Guillaume II pour « la plus haute insulte à la moralité internationale et au pouvoir sacré des traités », le gouvernement néerlandais neutre a refusé d’extrader l’exilé. 
Salon famille royaleà Dorne.

Salle à manger du château de Dorn.
Guillaume II s'installe d'abord à Amerongen, puis le 16 août 1919, il achète un château à Dorne. Le gouvernement de la République de Weimar autorisa l'ancien Kaiser à emporter ses effets personnels et à les transporter à Dorne. Il y avait suffisamment de choses pour 59 chariots et charrettes. 
Bureau de Guillaume II.

Étude de Guillaume II.
En exil, Guillaume II se sentait plutôt bien. Grâce à des participations financières rentables, sa fortune en 1933 était de 18 millions de marks et en 1941, déjà de 37 millions de marks. Le Kaiser n’a pas mâché ses mots et a continué à parler ouvertement de manière peu flatteuse de tous les chefs d’État européens. 
Guillaume II passait 5 à 6 heures par jour en selle, non seulement à cheval, mais aussi assis à table.

Le couloir entre les moitiés hommes et femmes au premier étage.

Toilettes.
Lorsque les Pays-Bas furent occupés par les nazis en 1940, tous les biens de Guillaume II, sur ordre d'Hitler, furent nationalisés et lui-même fut assigné à résidence. Guillaume II n'était pas autorisé à s'éloigner de plus de 10 km du château. Le 4 juin 1941, le dernier Kaiser d'Allemagne décède à l'âge de 82 ans. 
Wilhelm avec sa seconde épouse Hermine de Reuss-Greiz, 1933.

Château Dorn, 1920.
Guillaume II(Friedrich Wilhelm Victor Albert de Prusse, Guillaume II d'Allemagne ; 27 janvier 1859, Palais des Princes héritiers, Berlin - 4 juin 1941, Domaine de Dohrn, province d'Utrecht, Pays-Bas) - le dernier empereur allemand et roi de Prusse à partir de juin 15, 1888 au 9 novembre 1918. Fils du prince et plus tard empereur d'Allemagne, Frédéric de Prusse et Victoria de Grande-Bretagne.
Le règne de Wilhelm fut marqué par le renforcement du rôle de l'Allemagne en tant que puissance industrielle, militaire et coloniale mondiale et se termina par la Première Guerre mondiale, dont la défaite conduisit au renversement de la monarchie lors de la Révolution de Novembre. L’époque du règne de Guillaume II est dite wilhelminienne.
Enfance et jeunesse
Prince Friedrich Wilhelm Victor Albert de Prusse(allemand : Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preuen) est né le 27 janvier 1859 dans le palais berlinois du prince héritier. Il était l'aîné des huit enfants de Frédéric-Guillaume de Prusse et de la princesse Victoria, fille aînée de l'homonyme de la reine. Il était cousin du roi britannique George V (le père de George était le frère de la mère de William), ainsi que de l'impératrice Alexandra Feodorovna (leurs mères étaient également sœurs).
L'accouchement s'est avéré très difficile - le prince est né avec de nombreux handicaps physiques, ce qui lui a presque coûté la vie dès son plus jeune âge. Il est né avec un bras gauche endommagé (plus court que le droit de 15 cm) ; à l'avenir, Wilhelm fut obligé de cacher ce défaut physique en plaçant une main sur l'autre ou en s'asseyant à un angle par rapport à la caméra. En essayant de corriger cette anomalie congénitale, les médecins de la vie pensaient qu'il s'agissait d'une paralysie temporaire du bras due à une compression mécanique lors de l'accouchement. Par conséquent, une douche quotidienne à l’eau de mer et une thérapie électroconvulsive régulière pour le membre blessé ont été prescrites. Le bras était tendu et étendu à l'aide d'une « machine à redresser les bras » spécialement conçue à cet effet ; le bras droit sain était attaché au corps dans l'espoir que le garçon commencerait inévitablement à utiliser son gauche. En outre, pendant plusieurs années, il a dû porter une « machine pour maintenir la tête droite » (en raison d'un torticolis congénital), jusqu'à ce que finalement ses parents et les médecins décident de subir une opération pour disséquer le muscle sternocléidomastoïdien cervical. Toutes ces actions, naturellement, causaient beaucoup de douleur au petit enfant et, de plus, l'efficacité du traitement était faible.
Cependant, depuis son enfance, Wilhelm a lutté obstinément contre ses handicaps physiques congénitaux et, à l'âge de 18 ans, il a réussi à surmonter les conséquences d'une rupture du nerf brachial (une autre blessure à la naissance). Grâce à la lutte constante contre ses défauts congénitaux, il a réussi à cultiver une énorme volonté. Dans le même temps, le garçon a grandi renfermé, incertain intérieurement de lui-même. Les parents étaient très tristes du handicap physique de leur fils. Ils décidèrent de compenser cela par une éducation excessive.
À partir de 1866, il fut confié à l'enseignant Dr. Georg Hinzpeter, calviniste de religion. Selon lui, le jeune prince était « un individu exceptionnellement fort et développé qui n'a pas succombé aux influences extérieures les plus fortes, sur lesquelles aucune autorité n'a agi. Ce n’est que grâce au sens du devoir développé en lui qu’il a été possible de le soumettre à la discipline. »
En 1869, le prince reçut le grade de lieutenant du 1er régiment d'infanterie de la garde, et la même année il participa à son premier défilé. Lorsque Wilhelm avait 15 ans, Victoria, sur les conseils de Hinzpeter, mena une « expérience sans précédent » sur son fils, envoyant l'héritier du trône de Prusse dans un gymnase ouvert. En 1874-1877, le futur empereur étudia au gymnase de Kassel aux côtés de membres de familles bourgeoises et paysannes. En envoyant leur fils dans ce gymnase, les parents de Wilhelm partaient du principe que pour le futur souverain, rien ne pouvait être plus nocif que l'éloignement artificiel du peuple. Les parents, sur les conseils des enseignants, ont décidé de renforcer le prince charge d'étude. Le futur empereur pouvait à peine faire face une somme énorme leçons et devoirs. Le prince se levait à cinq heures du matin et avant les cours au gymnase, qui commençaient à sept heures, il devait étudier avec Hinzpeter pendant une heure. En plus de ses devoirs, Wilhelm a reçu des cours d'équitation, d'escrime et de dessin. La dure journée, programmée minute par minute, ne se terminait qu'à dix heures du soir. En janvier 1877, le prince réussit l'examen final et reçut un certificat avec de « bonnes » notes.