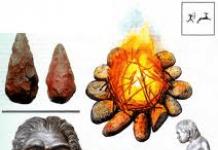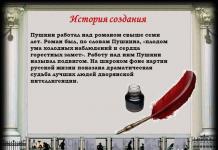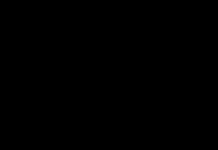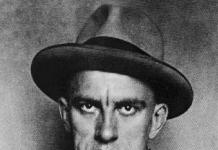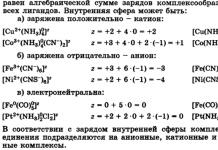Université hydrométéorologique d'État de Russie
Rapport sur le sujet :
Tsunami
Vérifié par : Voronov N.V.
Complété : art. gr. M-462
Ivanova V.M.
Saint-Pétersbourg
Tsunami ( Les « ports, baies », « vagues » japonais sont de longues vagues générées par un impact puissant sur toute l'épaisseur de l'eau de l'océan ou d'une autre masse d'eau. La plupart des tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre sous-marins, au cours desquels se produit un déplacement brusque (élévation ou abaissement) d'une partie du fond marin. Les tsunamis se forment lors d'un tremblement de terre de toute force, mais ceux qui surviennent en raison de forts tremblements de terre (plus de 7 points) atteignent une grande force. À la suite d’un tremblement de terre, plusieurs ondes se propagent. Plus de 80 % des tsunamis se produisent à la périphérie de l’océan Pacifique.
Avec une profondeur moyenne de 4000 mètres, la vitesse de propagation est de 200 m/s soit 720 km/h. En haute mer, la hauteur des vagues dépasse rarement un mètre et la longueur des vagues (la distance entre les crêtes) atteint des centaines de kilomètres, et la vague n'est donc pas dangereuse pour la navigation. Lorsque les vagues pénètrent dans les eaux peu profondes, près du littoral, leur vitesse et leur longueur diminuent et leur hauteur augmente. Près des côtes, la hauteur d’un tsunami peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Les vagues les plus hautes, atteignant 30 à 40 mètres, se forment le long des côtes escarpées, dans les baies en forme de coin et partout où une concentration peut se produire. Les zones côtières aux baies fermées sont moins dangereuses. Un tsunami se présente généralement sous la forme d'une série de vagues ; comme les vagues sont longues, plus d'une heure peut s'écouler entre leurs arrivées. C'est pourquoi il ne faut pas retourner au rivage après le départ de la prochaine vague, mais attendre quelques heures.
Causes de la formation du tsunami
- Tremblement de terre sous-marin(environ 85 % de tous les tsunamis). Lors d'un tremblement de terre sous l'eau, un mouvement vertical du fond se forme : une partie du fond s'enfonce, et une partie monte. La surface de l'eau commence à osciller verticalement, essayant de revenir à son niveau d'origine - le niveau moyen de la mer - et génère une série de vagues. Tous les tremblements de terre sous-marins ne sont pas accompagnés d'un tsunami. Le tsunamigène (c'est-à-dire générer une vague de tsunami) est généralement un tremblement de terre dont la source est peu profonde. Le problème de la reconnaissance de la tsunamigénicité d'un tremblement de terre n'a pas encore été résolu et les services d'alerte sont guidés par la magnitude du tremblement de terre. Les tsunamis les plus puissants sont générés dans les zones de subduction.
- Glissements de terrain. Les tsunamis de ce type se produisent plus fréquemment qu'on ne l'avait estimé au XXe siècle (environ 7 % de tous les tsunamis). Souvent, un tremblement de terre provoque un glissement de terrain et génère également une vague. Le 9 juillet 1958, un tremblement de terre en Alaska provoque un glissement de terrain dans la baie de Lituya. Une masse de glace et de roches terrestres s'est effondrée d'une hauteur de 1 100 m. Une vague s'est formée qui a atteint une hauteur de plus de 500 m sur la rive opposée de la baie. Les cas de ce genre sont très rares et, bien sûr, ne le sont pas. considéré comme une norme. Mais les glissements de terrain sous-marins se produisent beaucoup plus souvent dans les deltas fluviaux, qui ne sont pas moins dangereux. Un tremblement de terre peut provoquer un glissement de terrain et, par exemple, en Indonésie, où la sédimentation du plateau continental est très importante, les tsunamis liés aux glissements de terrain sont particulièrement dangereux, car ils se produisent régulièrement, provoquant des vagues locales de plus de 20 mètres de haut.
- Éruptions volcaniques(environ 4,99 % de tous les tsunamis). Les grandes éruptions sous-marines ont le même effet que les tremblements de terre. Lors de fortes explosions volcaniques, non seulement des vagues sont générées par l'explosion, mais l'eau remplit également les cavités du matériau en éruption ou même la caldeira, ce qui entraîne une longue onde. Un exemple classique est le tsunami généré après l’éruption du Krakatoa en 1883. D'énormes tsunamis provenant du volcan Krakatoa ont été observés dans les ports du monde entier et ont détruit un total de 5 000 navires et tué 36 000 personnes.
- Activité humaine . À l’ère de l’énergie atomique, l’homme dispose d’un moyen de provoquer des chocs qui n’était auparavant disponible que pour la nature. En 1946, les États-Unis ont procédé à une explosion atomique sous-marine d'un équivalent TNT de 20 000 tonnes dans une lagune marine de 60 m de profondeur. La vague qui s'est produite à une distance de 300 m de l'explosion a atteint une hauteur de 28,6 m, et à 6,5 km de l'épicentre, elle atteignait encore 1,8 m. Mais pour la propagation de l'onde sur de longues distances, il est nécessaire de déplacer ou d'absorber un un certain volume d'eau et un tsunami provoqué par des glissements de terrain et des explosions sous-marines sont toujours de nature locale. Si plusieurs bombes à hydrogène explosent simultanément au fond de l'océan, le long d'une ligne quelconque, alors il n'y aura aucun obstacle théorique à l'apparition d'un tsunami ; de telles expériences ont été menées, mais n'ont conduit à aucun résultat significatif par rapport à des types plus accessibles. d'armes. Actuellement, tout essai sous-marin d’armes atomiques est interdit par une série de traités internationaux.
- Chute d'un grand corps céleste peut provoquer un énorme tsunami, car, ayant une vitesse de chute énorme, ces corps ont également une énergie cinétique colossale, qui sera transférée à l'eau, provoquant une vague. Ainsi, la chute d'une météorite il y a 65 millions d'années a également provoqué un tsunami dont les gisements ont été découverts dans l'État du Texas (comme le raconte le film National Geographic).
- Vent peuvent provoquer de grosses vagues (jusqu'à environ 20 m), mais ces vagues ne sont pas des tsunamis, car elles sont de courte durée et ne peuvent pas provoquer d'inondations sur la côte. Cependant, la formation d'un météo-tsunami est possible avec un changement brusque de pression ou avec un mouvement rapide d'une anomalie de pression atmosphérique. Ce phénomène est observé aux îles Baléares et s'appelle Rissaga.
Signes d'un tsunami
Un retrait soudain et rapide de l'eau du rivage sur une distance considérable et un assèchement du fond. Plus la mer recule, plus les vagues du tsunami peuvent être hautes. Les gens sur le rivage qui ignorent le danger peuvent rester par curiosité ou pour ramasser des poissons et des coquillages. Cette règle doit être suivie, par exemple, au Japon, sur la côte indonésienne de l'océan Indien ou au Kamtchatka. Dans le cas d'un télétsunami, la vague s'approche généralement sans que l'eau ne recule.
Tremblement de terre. L'épicentre d'un tremblement de terre se trouve généralement dans l'océan. Sur la côte, le séisme est généralement beaucoup plus faible et il arrive souvent qu'il n'y ait aucun séisme. Dans les régions sujettes aux tsunamis, il existe une règle selon laquelle si un tremblement de terre est ressenti, il vaut mieux s'éloigner de la côte et en même temps gravir une colline, se préparant ainsi à l'avance à l'arrivée de la vague.
Dérive inhabituelle de glace et d'autres objets flottants, formation de fissures dans les glaces côtières.
D'énormes failles inversées aux bords des glaces et des récifs stationnaires, la formation de foules et de courants.
Pourquoi un tsunami fait-il souvent de nombreuses victimes ?
On ne sait peut-être pas pourquoi un tsunami de plusieurs mètres de haut s'est avéré catastrophique, alors que des vagues de même hauteur survenues lors d'une tempête n'ont pas fait de victimes ni de destructions ? Plusieurs facteurs entraînent des conséquences catastrophiques :
La hauteur de la vague près de la côte en cas de tsunami n'est généralement pas un facteur déterminant. Selon la configuration du fond près de la côte, le phénomène du tsunami peut se produire sans aucune vague, au sens habituel du terme, mais sous la forme d'une série de flux et reflux rapides, qui peuvent également entraîner des victimes et des destructions.
Lors d'une tempête, seule la couche d'eau superficielle commence à bouger ; lors d'un tsunami, toute l'épaisseur se déplace. Et quand un tsunami s'abat sur le rivage, bien plus encore Ô de plus grandes masses d'eau.
La vitesse des vagues du tsunami, même près du rivage, dépasse la vitesse des vagues du vent. Les vagues de tsunami ont plus d'énergie cinétique.
En règle générale, un tsunami génère non pas une, mais plusieurs vagues. La première vague, pas nécessairement la plus importante, mouille la surface, réduisant ainsi la résistance des vagues suivantes.
Lors d'une tempête, l'excitation augmente progressivement ; les gens parviennent généralement à se mettre à distance de sécurité avant l'arrivée des grosses vagues. Le tsunami arrive soudainement.
La force d'un tsunami peut augmenter dans le port - où les vagues de vent sont affaiblies et où les bâtiments résidentiels peuvent donc être situés à proximité du rivage.
Manque de connaissances de base au sein de la population sur les dangers possibles. Ainsi, lors du tsunami de 2004, lorsque la mer s'est retirée de la côte, de nombreux résidents locaux sont restés sur le rivage - par curiosité ou par désir de récupérer des poissons qui n'avaient pas réussi à s'échapper. De plus, après la première vague, beaucoup sont retournés chez eux pour évaluer les dégâts ou tenter de retrouver leurs proches, ignorant les vagues suivantes.
Le système d’alerte aux tsunamis n’est pas disponible partout et ne fonctionne pas toujours.
La destruction des infrastructures côtières aggrave la catastrophe, en y ajoutant des facteurs catastrophiques d’origine humaine et sociale. L'inondation des basses terres et des vallées fluviales entraîne la salinisation des sols.
Systèmes d'alerte aux tsunamis
Les systèmes d’alerte aux tsunamis reposent principalement sur le traitement d’informations sismiques. Si le tremblement de terre a une magnitude supérieure à 7,0 (dans la presse, cela s'appelle des points sur l'échelle de Richter) et que le centre est situé sous l'eau, une alerte au tsunami est émise. Selon la région et la population des rivages, les conditions de génération d'un signal d'alarme peuvent être différentes.
La deuxième possibilité d'avertir d'un tsunami est un avertissement « après coup » - une méthode plus fiable, car il n'y a pratiquement pas de fausses alarmes, mais souvent un tel avertissement peut être généré trop tard. L'avertissement après coup est utile pour les télétsunamis - des tsunamis mondiaux qui affectent l'ensemble de l'océan et atteignent d'autres frontières océaniques quelques heures plus tard. Ainsi, le tsunami indonésien de décembre 2004 est un télétsunami pour l'Afrique. Un cas classique est le tsunami des Aléoutiennes : après une forte éclaboussure dans les Aléoutiennes, vous pouvez vous attendre à une éclaboussure importante dans les îles hawaïennes. Des capteurs de pression hydrostatique de fond sont utilisés pour détecter les vagues de tsunami en haute mer. Un système d'alerte basé sur de tels capteurs avec communication par satellite à partir d'une bouée proche de la surface, développé aux États-Unis, s'appelle DART (en:Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis). Après avoir détecté une vague réelle d'une manière ou d'une autre, il est possible de déterminer assez précisément l'heure de son arrivée dans diverses zones peuplées.
Un aspect essentiel du système d'alerte est la diffusion d'informations actualisées auprès de la population. Il est très important que la population comprenne la menace que représente un tsunami. Les Japonais en ont beaucoup programmes éducatifs Par catastrophes naturelles, et en Indonésie, la population était pour l'essentiel peu familière avec le tsunami, qui était la principale raison du grand nombre de victimes. Le cadre législatif pour le développement de la zone côtière est également important.
Le plus grand tsunami
5.11.1952 Severo-Kurilsk (URSS).
Causé par un puissant séisme (les estimations de magnitude provenant de diverses sources varient de 8,3 à 9), survenu en Océan Pacifique A 130 kilomètres de la côte du Kamtchatka. Trois vagues atteignant 15 à 18 mètres de haut (selon diverses sources) ont détruit la ville de Severo-Kurilsk et causé des dégâts à plusieurs autres. colonies. Selon les données officielles, plus de deux mille personnes sont mortes.
09/03/1957 Alaska, (États-Unis).
Causée par un séisme de magnitude 9,1 survenu dans les îles Andrean (Alaska), qui a provoqué deux vagues, avec de taille moyenne vagues de 15 et 8 mètres respectivement. De plus, à la suite du tremblement de terre, le volcan Vsevidov, situé sur l'île d'Umnak et qui n'était pas entré en éruption depuis environ 200 ans, s'est réveillé. Plus de 300 personnes sont mortes dans la catastrophe.
09/07/1958 Baie de Lituya, (sud-ouest de l'Alaska, USA).
Un tremblement de terre survenu au nord de la baie (sur la faille Fairweather) a provoqué un fort glissement de terrain sur le versant de la montagne située au-dessus de la baie de Lituya (il y a environ 300 millions d'années). mètres cubes terre, roches et glace). Toute cette masse a submergé la partie nord de la baie et a provoqué une énorme vague de 524 mètres de haut, se déplaçant à une vitesse de 160 km/h.
28/03/1964 Alaska, (États-Unis).
Le plus grand tremblement de terre d'Alaska (magnitude 9,2), survenu dans le détroit de Prince William, a provoqué un tsunami composé de plusieurs vagues, la hauteur la plus élevée étant de 67 mètres. À la suite de la catastrophe (principalement due au tsunami), selon diverses estimations, entre 120 et 150 personnes sont mortes.
17.07.1998 Papouasie Nouvelle Guinée
Un séisme de magnitude 7,1 au large de la côte nord-ouest de la Nouvelle-Guinée a déclenché un énorme glissement de terrain sous-marin qui a généré un tsunami qui a tué plus de 2 000 personnes.
09/06/2004 côte du Japon
À 110 km de la côte de la péninsule de Kii et à 130 km de la côte de la préfecture de Kochi, deux forts tremblements de terre se sont produits (magnitudes allant jusqu'à 6,8 et 7,3, respectivement), provoquant un tsunami avec des hauteurs de vagues allant jusqu'à un mètre. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées.
26/12/2004 Asie du Sud-Est.
À 00h58, un puissant tremblement de terre s'est produit - le deuxième plus puissant de tous enregistrés (magnitude 9,3), qui a provoqué le tsunami le plus puissant de tous les temps. Le tsunami a touché les pays asiatiques (Indonésie - 180 000 personnes, Sri Lanka - 31 à 39 000 personnes, Thaïlande - plus de 5 000 personnes, etc.) et la Somalie africaine. Le nombre total de décès a dépassé 235 000 personnes.
01/09/2005 Îles Izu et Miyake (Est du Japon)
Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a provoqué un tsunami avec une hauteur de vague de 30 à 50 cm. Cependant, grâce à une alerte rapide, la population de zones dangereuses a été évacué.
02/04/2007 Îles Salomon (archipel)
Causé par un tremblement de terre de magnitude 8 survenu dans le Pacifique Sud. Des vagues de plusieurs mètres de haut ont atteint la Nouvelle-Guinée. 52 personnes ont été victimes du tsunami.
En japonais, le caractère « tsu » signifie baie ou baie, et « nami » signifie vague. Ensemble, les deux hiéroglyphes se traduisent par « vague inondant la baie ». Les conséquences catastrophiques de deux tsunamis qui ont frappé les côtes océan Indien en 2004 et au Japon en 2011, ont clairement démontré qu'à ce jour, aucune protection fiable contre ce formidable phénomène naturel n'a été trouvée...

Tsunami : qu'est-ce que c'est ?
Contrairement à la croyance populaire, un tsunami n’est pas une vague gigantesque qui frappe soudainement le rivage et emporte tout sur son passage. En fait, un tsunami est une série d'ondes de gravité marines de très grande longueur, résultant du déplacement de sections étendues du fond lors de forts tremblements de terre sous-marins ou, occasionnellement, pour d'autres raisons - à la suite d'éruptions volcaniques, de glissements de terrain géants, d'astéroïdes. chutes, explosions nucléaires sous-marines.

Comment se produit un tsunami ?
La cause la plus fréquente d'un tsunami est le mouvement vertical du fond lors des tremblements de terre sous-marins. Lorsqu’une partie du fond s’enfonce et une autre s’élève, la masse d’eau commence à osciller. Dans ce cas, la surface de l’eau a tendance à revenir à son niveau initial – le niveau moyen de l’océan – et génère ainsi une série de vagues.

La vitesse de propagation du tsunami à une profondeur de 4,5 km dépasse 800 km/h. Mais la hauteur des vagues en haute mer est généralement faible - moins d'un mètre et la distance entre les crêtes est de plusieurs centaines de kilomètres, il n'est donc pas si facile de remarquer un tsunami depuis le pont d'un navire ou depuis un avion. Dans les vastes océans, rencontrer un tsunami n’est dangereux pour aucun navire. Mais lorsque les vagues pénètrent dans des eaux peu profondes, leur vitesse et leur longueur diminuent et leur hauteur augmente fortement. Près de la côte, la hauteur des vagues dépasse souvent 10 m, et atteint dans des cas exceptionnels 30 à 40 m. L'impact des éléments provoque alors des dégâts colossaux aux villes côtières.

Cependant, les vagues de tsunami d’une hauteur relativement faible provoquent souvent d’énormes dégâts. À première vue, cela semble étrange : pourquoi les vagues apparemment plus redoutables qui surviennent lors d’une tempête n’entraînent-elles pas des pertes similaires ? Le fait est que énergie cinétique les tsunamis sont bien plus élevés que ceux des vagues de vent : dans le premier cas, toute l'épaisseur de l'eau se déplace, et dans le second, seule la couche superficielle. En conséquence, la pression de l’eau éclaboussée sur la terre lors d’un tsunami est plusieurs fois plus élevée que lors d’une tempête.
Il ne faut pas négliger un autre facteur. Lors d'une tempête, l'excitation augmente progressivement et les gens parviennent généralement à se mettre à distance de sécurité avant de commencer à faire face au danger. Un tsunami arrive toujours soudainement.

Aujourd'hui, on connaît environ 1 000 cas de tsunamis, dont plus d'une centaine ont eu des conséquences catastrophiques. Géographiquement, la périphérie de l'océan Pacifique est considérée comme la région la plus dangereuse : environ 80 % de tous les tsunamis s'y produisent.
Il est impossible de protéger complètement la côte d'un tsunami, même si certains pays, notamment le Japon, ont tenté de construire des brise-lames et des brise-lames afin de réduire la force des vagues. Cependant, il y a des cas où ces structures ont joué un rôle négatif : les tsunamis les ont détruites, et des morceaux de béton soulevés par les écoulements d'eau n'ont fait qu'aggraver les dégâts sur le rivage. Les espoirs de protection contre les arbres plantés le long du rivage ne se sont pas non plus concrétisés. Pour amortir l'énergie des vagues, une trop grande superficie de plantations forestières est nécessaire, et la plupart des villes côtières n'en disposent tout simplement pas. Eh bien, une étroite bande d’arbres le long du remblai ne peut offrir aucune résistance à un tsunami.
L'une des mesures importantes visant à protéger la population des régions dangereuses des vagues destructrices a été le système international d'alerte aux tsunamis créé dans la région du Pacifique. 25 États, dont la Russie, participent à ses travaux. Scientifiques différents pays Sur la base d'une analyse complète des zones sismiques fortes, ils tentent de déterminer si elles ont provoqué des tsunamis dans le passé et quelle est la probabilité que des tsunamis se produisent dans le futur. Le principal centre de recherche du système, situé à Honolulu, à Hawaï, surveille en permanence les conditions sismiques et les niveaux de surface de l'océan Pacifique.
Notre pays dispose d'un service d'alerte aux tsunamis Extrême Orient se compose de trois services régionaux: Kamchatka, Région de Sakhaline et le kraï du Primorie. Dans la région du Kamtchatka, en particulier, il existe une station tsunami de l'administration territoriale pour l'hydrométéorologie et la surveillance. environnement et une station sismique de l'Institut de physique de la Terre de l'Académie des sciences de Russie.

Les tsunamis les plus destructeurs du passé
Il est possible que le tsunami le plus catastrophique de l’histoire de l’humanité se soit produit dans l’Antiquité, même s’il nous est parvenu sous forme de mythes et de légendes. Vers 1450 avant JC. Une civilisation entière a péri à cause d’une vague géante déclenchée par le volcan de Santorin. À 120 km du volcan se trouve la Crète, qui était à l'époque l'une des puissances les plus puissantes de la Méditerranée. Mais le tsunami a causé à un moment donné des dégâts colossaux à l’île de Crète, dont l’État autrefois prospère n’a jamais pu se remettre. Elle s'est effondrée et nombre de ses villes ont été abandonnées pendant deux mille cinq cents ans.

Des vagues géantes de tsunami ont suivi le tremblement de terre dévastateur de Lisbonne le 1er novembre 1755. La source du tremblement de terre se trouvait évidemment au fond de l’océan. Le nombre total de victimes des vagues et du tremblement de terre est estimé à environ 60 000 personnes.

En 1883, à la suite d'une série d'éruptions du volcan Krakatoa en Indonésie, un puissant tsunami s'est formé, dont les îles de Java et de Sumatra ont le plus souffert. Des vagues atteignant 40 m de haut ont anéanti environ 300 villages de la surface de la terre, tuant plus de 36 000 personnes. Près de la ville de Teluk Betung, un navire de guerre néerlandais, la canonnière Berouw, a été projeté à 3 km à l'intérieur des terres et s'est retrouvé à flanc de montagne à 9 m d'altitude. Des ondes sismiques ont fait deux ou trois fois le tour de la Terre et des aubes rouges inhabituelles ont longtemps été observées en Europe à cause des cendres projetées dans l'atmosphère.


Le tsunami le plus destructeur du XXe siècle a frappé la côte chilienne le 22 mai 1960. Le tsunami et le puissant tremblement de terre qui l'a provoqué, mesurant 9,5 sur l'échelle de Richter, ont tué 2 000 personnes, en ont blessé 3 000, laissé deux millions de sans-abri et causé 550 millions de dollars de dégâts. Le même tsunami a tué 61 personnes à Hawaï, 20 aux Philippines, 3 à Okinawa et plus de 100 au Japon. La hauteur des vagues sur l'île Pitcairn a atteint 13 m, à Hawaï - 12 m.


Le tsunami le plus insolite
En 1958, un tsunami a été déclenché dans la baie de Lituya, en Alaska, provoqué par un glissement de terrain géant : environ 81 millions de tonnes de glace et de roches solides sont tombées dans la mer à la suite du tremblement de terre. Les vagues ont atteint une hauteur incroyable de 350 à 500 m - ce sont les plus grandes vagues jamais enregistrées dans l'histoire ! Le tsunami a emporté toute la végétation des pentes des montagnes. Heureusement, les rives de la baie étaient inhabitées et les pertes humaines étaient minimes : seuls deux pêcheurs sont morts.


Tsunami en Extrême-Orient russe
Le 4 avril 1923, un fort tremblement de terre s'est produit dans la baie du Kamtchatka. 15 à 20 minutes plus tard, une vague s'est approchée du sommet de la baie. Deux usines de transformation du poisson sur la côte ont été complètement détruites et le village d'Oust-Kamtchatsk a été gravement endommagé. La glace sur la rivière Kamtchatka s'est brisée sur une distance de 7 km. À 50 km au sud-ouest du village, la hauteur maximale de montée des eaux sur la côte a été observée - jusqu'à 30 m.
En Russie, le tsunami le plus catastrophique s'est produit dans la nuit du 4 au 5 novembre 1952 sur l'île extrême-orientale de Paramushir, où se trouve la ville de Severo-Kurilsk. Vers 4 heures du matin, de fortes secousses ont commencé. Une demi-heure plus tard, le tremblement de terre s'est arrêté et les personnes qui avaient quitté leurs maisons sont rentrées chez elles. Seuls quelques-uns sont restés dehors et ont remarqué la vague qui approchait. Ils ont réussi à se réfugier dans les collines, mais alors qu'ils descendaient pour inspecter les destructions et chercher des proches, une deuxième vague d'eau encore plus puissante, d'environ 15 m de haut, s'est abattue sur la ville. de Severo-Kurilsk a déclaré que cette nuit-là, les marins n'avaient rien fait, mais tôt le matin, ils ont été surpris par la grande quantité d'ordures flottant autour et Divers articles. Lorsque le brouillard matinal s'est dissipé, ils ont vu qu'il n'y avait aucune ville sur le rivage.
Le même jour, le tsunami a atteint les côtes du Kamtchatka et a causé de graves dégâts dans plusieurs villages. Au total, plus de 2 000 personnes sont mortes, mais en URSS, jusqu'au début des années 1990, presque personne n'était au courant des événements de cette nuit tragique.


Le tsunami survenu le 23 mai 1960 au large des côtes du Chili a atteint les côtes des îles Kouriles et du Kamtchatka environ un jour plus tard. Le niveau d'eau le plus élevé était de 6 à 7 m et sur le territoire de la plage de Khalaktyrsky, près de Petropavlovsk-Kamchatsky, de 15 m. Dans les baies de Vilyuchinskaya et de Russkaya, des maisons ont été détruites et des dépendances ont été emportées dans la mer.

Répartition des tsunamis dans l'océan Pacifique (les vagues les plus destructrices sont noires et rouges) après le tremblement de terre de 1960. Carte préparée par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.
Catastrophe de l'océan Indien (2004)
Après un séisme d'environ 9 sur l'échelle de Richter avec un épicentre dans la partie nord de l'île de Sumatra en Indonésie, survenu dans la nuit du 26 décembre 2004, un puissant tsunami a recouvert l'océan Indien. La ligne de faille de plus de 1 000 kilomètres, créée par le mouvement de grandes couches de la croûte terrestre au fond de l'océan, a généré une énorme libération d'énergie. Les vagues ont frappé l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, le Bangladesh, le Myanmar, les Maldives et les Seychelles et ont atteint la Somalie, située à 5 000 km de l'épicentre du séisme. Plus de 300 000 personnes ont été victimes du tsunami, parmi lesquelles des touristes étrangers de nombreux pays qui passaient alors leurs vacances en Indonésie et en Thaïlande. La plupart des morts se sont produits en Indonésie (plus de 180 000) et au Sri Lanka (environ 39 000).



Ces nombreuses victimes s'expliquent en grande partie par le manque de connaissances de base de la population locale sur le danger imminent. Ainsi, lorsque la mer s'est retirée du rivage, de nombreux habitants et touristes sont restés sur le rivage - par curiosité ou par désir de ramasser les poissons restés dans les flaques d'eau. De plus, après la première vague, beaucoup sont retournés chez eux pour évaluer les dégâts ou tenter de retrouver leurs proches, sans savoir que d’autres suivraient la première vague.




Tsunami au Japon (2011)
Le tsunami a été provoqué par un fort tremblement de terre de magnitude 9,0 à 9,1 survenu le 11 mars 2011 à 14 h 46 heure locale (8 h 46, heure de Moscou). Le centre du séisme se trouvait à une profondeur de 32 km, en un point de coordonnées 38,322° N. 142,369°E à l'est de l'île de Honshu, à 130 km à l'est de la ville de Sendai et à 373 km au nord-est de Tokyo. Au Japon, le tsunami a provoqué des dégâts considérables sur la côte est. Hauteur maximale des vagues ont été observées dans la préfecture de Miyagi - 10 M. Le tsunami a inondé l'aéroport de Sendai, emporté un train de passagers et causé de graves dommages à la centrale nucléaire de Fukushima I. Rien qu'à Sendai, le tsunami a causé la mort d'environ 300 personnes. Les dommages totaux causés à l'économie du pays s'élèvent à des centaines de milliards de dollars.




Selon les données officielles, le séisme et le tsunami ont fait 15 892 morts et 2 576 personnes portées disparues. 6 152 personnes ont été grièvement blessées. Selon des données non officielles, le nombre de victimes est bien plus élevé. Selon les médias, 9 500 personnes sont portées disparues rien que dans la ville de Minamisanriku.
De nombreux documents photographiques dressent un tableau véritablement apocalyptique de la destruction :









Le tsunami a été observé sur toute la côte Pacifique, de l'Alaska au Chili, mais en dehors du Japon, il semblait beaucoup plus faible. L'infrastructure touristique d'Hawaï a été la plus durement touchée : environ 200 yachts et bateaux privés ont été détruits et coulés rien qu'à Honolulu. Sur l’île de Guam, des vagues ont arraché deux sous-marins nucléaires de la marine américaine de leurs amarres. À Crescent City, en Californie, plus de 30 bateaux ont été endommagés et une personne a été tuée.
Selon le ministère russe des Situations d'urgence, en raison de la menace d'un tsunami sur les îles Kouriles, 11 000 habitants ont été évacués des zones côtières. La hauteur des vagues la plus élevée - environ 3 m - a été enregistrée dans la région du village de Malokurilskoye.

Le tsunami au cinéma
Dans le genre populaire des films catastrophes, les tsunamis ont attiré à plusieurs reprises l’attention des scénaristes et des réalisateurs. Un exemple est le long métrage « Tsunami » ( Corée du Sud, 2009), dont les cadres sont donnés ci-dessous.

Le phénomène des tsunamis est aussi ancien et indomptable que l’océan. Les témoignages oculaires de vagues terribles, transmises de bouche en bouche, sont devenus des légendes au fil du temps et des preuves écrites ont commencé à apparaître il y a environ 2 000 à 2 500 ans. Parmi causes probables La disparition de l'Atlantide, survenue il y a environ 10 000 ans, est également appelée vagues géantes par certains chercheurs.
Le mot « tsunami » nous vient du Pays du Soleil Levant. C'est le Japon qui est le plus vulnérable aux tsunamis de la planète. Elle a ressenti les conséquences désastreuses du tsunami, qui a coûté la vie à des milliers de personnes et causé d’énormes dégâts matériels. Les tsunamis se produisent le plus souvent dans l'océan Pacifique. En Russie, les côtes extrême-orientales – Kamtchatka, îles Kouriles et du Commandeur et, en partie, Sakhaline – sont régulièrement soumises aux attaques de vagues géantes.
Qu'est-ce qu'un tsunami ? Un tsunami est une vague géante qui déferle grande quantité l'eau, la soulevant à de grandes hauteurs. De telles vagues se trouvent dans les océans et les mers.
Apparition d'un tsunami
Qu’est-ce qui peut transformer l’eau ordinaire en un phénomène naturel aussi destructeur, doté d’un pouvoir véritablement infernal ?
Les tsunamis sont des vagues longues et hautes générées en conséquence impact puissant dans toute l’épaisseur de l’eau d’un océan ou d’une autre masse d’eau.
La cause commune des tsunamis qui provoquent des catastrophes est l’activité qui se produit dans les entrailles de la Terre. Pour la plupart, les monstres aquatiques sont provoqués par des tremblements de terre sous-marins. L'étude de ce phénomène destructeur n'est donc devenue possible qu'après l'apparition de la science de la sismologie. Une relation directe entre la force de la vague et la force du séisme a été enregistrée. Ceci est également influencé par la profondeur à laquelle le choc s'est produit. Ainsi, seules les ondes générées par des séismes de haute énergie d’une magnitude égale ou supérieure à 8,0 ont un pouvoir destructeur important.
Les observations montrent que les tsunamis se produisent lorsqu'une partie de la mer ou de la surface de l'océan se déplace soudainement verticalement après qu'une partie correspondante du fond marin se déplace également. Les experts comprennent les tsunamis comme des mers dites de longue période (c'est-à-dire s'éloignant les unes des autres). ondes gravitationnelles, qui surviennent de manière inattendue dans les mers et les océans précisément à la suite de tremblements de terre dont les centres sont situés sous le fond.
Le fond océanique tremble sous l’effet d’une énergie colossale et produit d’énormes failles et fissures, qui entraînent l’affaissement ou l’élévation de vastes zones du fond. C’est comme si une crête sous-marine géante précipitait tout le volume d’eau du fond vers la surface, dans toutes les directions depuis le foyer. Eau de mer près de la surface elle-même peut ne pas absorber du tout cette énergie, et les navires qui les longent peuvent tout simplement ne pas remarquer les graves perturbations des vagues. Et dans les profondeurs, la future catastrophe commence à prendre de l'ampleur et se précipite à une vitesse vertigineuse vers les rivages les plus proches.

Les tsunamis résultent d'explosions de volcans sous-marins et d'effondrements de fonds. Glissements de terrain côtiers provoqués par la chute d’une énorme masse rocher dans l'eau peut également provoquer un tsunami. En règle générale, les tsunamis dont la source se situe à de grandes profondeurs ont un grand pouvoir destructeur. De plus, les causes des tsunamis sont les déferlements d'eau dans les baies provoqués par des typhons, des tempêtes et de fortes marées, ce qui, comme on peut le constater, peut expliquer l'origine du mot japonais « tsunami », qui se traduit par « grande vague dans le port ». ».
Les vagues géantes ont une vitesse élevée et une énergie énorme et sont donc capables d'être projetées loin sur la terre ferme. En s'approchant du rivage, ils se déforment et, roulant sur le rivage, provoquent d'énormes destructions. En haute mer, les monstres aquatiques sont petits, ne dépassant pas une hauteur de 2 à 3 m lors des tremblements de terre les plus puissants, mais en même temps ils ont une longueur importante, atteignant parfois 200 à 300 km, et une vitesse de propagation incroyable.
En approchant du rivage, selon la topographie des fonds côtiers et la forme du trait de côte, des vagues géantes peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Une fois dans la zone côtière peu profonde, la vague change - sa hauteur augmente et, en même temps, la pente du front principal augmente. À l’approche du rivage, il commence à chavirer, créant un courant d’eau moussant et bouillonnant de grande hauteur qui tombe sur le rivage. Dans de tels cas, les embouchures des rivières sont assez dangereuses, à travers lesquelles des vagues monstrueuses peuvent pénétrer à l'intérieur du territoire à une distance de plusieurs kilomètres.
Tsunami - conséquences
6 avril 1946 - la ville de Hilo, sur l'île d'Hawaï, subit toute la puissance de la perturbation de l'élément eau. Des immeubles d'habitation et des bâtiments administratifs ont été renversés, des routes asphaltées et des plages ont disparu, un pont ferroviaire a été déplacé 300 m en amont et des rochers pesant plusieurs tonnes ont été éparpillés dans la zone dévastée. Ceci est le résultat d'un déplacement du fond océanique survenu à 4 000 km de Hilo, dans les îles Aléoutiennes.
Le choc a donné lieu à une série de tsunamis qui ont traversé l'océan Pacifique à une vitesse de plus de 1 100 km/h, atteignant une hauteur de 7,5 à 15 m. L'élément eau a attaqué la terre avec toute sa fureur et a littéralement tout déchiré. qu'il parvenait à embrasser de son étreinte mousseuse. De telles vagues se propagent dans toutes les directions à partir de leur point d'origine, à de longs intervalles, mais à une vitesse effrayante. Alors que la distance entre les vagues ordinaires de la mer est d'environ 100 m, les crêtes des vagues du tsunami se succèdent à des intervalles de 180 km à 1 200 km. Par conséquent, le passage de chacune de ces vagues s’accompagne d’un calme trompeur.
C'est pourquoi, lorsque la première vague s'est calmée à Hilo, de nombreux habitants sont descendus sur le rivage pour comprendre l'ampleur des destructions et ont été emportés par la vague géante suivante. Le témoignage oculaire a déclaré :
« Les vagues du tsunami, abruptes et tourbillonnantes, se sont précipitées sur le rivage. Entre les crêtes, l'eau s'est retirée du rivage, exposant les récifs, les accumulations de limon côtier et le fond de la baie jusqu'à 150 mètres ou plus au-delà du rivage normal. L'eau refluait rapidement et violemment, avec des sifflements, des sifflements et des rugissements. À plusieurs endroits, des maisons ont été emportées par la mer et, à certains endroits, même d'énormes rochers et blocs de béton ont été emportés au-delà des récifs. Des personnes et leurs biens ont été emportés vers la mer, et seuls quelques-uns d’entre eux ont pu être secourus plusieurs heures plus tard grâce à des bateaux et des radeaux de sauvetage largués depuis des avions.

Si la vitesse d'une simple vague de vent peut atteindre 100 km/h, alors les vagues du tsunami se déplacent à la vitesse d'un avion à réaction - de 900 à 1 500 km/h. L'influence mortelle des éléments est déterminée non seulement par la puissance du choc qui a provoqué le tsunami, mais également par le terrain sur lequel se déplace la vague géante et par la distance qui le sépare de la côte.
Bien entendu, ils sont plus dangereux sur les côtes plates que sur les côtes escarpées. Lorsque le fond est constitué de falaises, les vagues venant en sens inverse ne s'élèvent pas à une hauteur suffisante, mais lorsqu'elles heurtent un rivage en pente douce, elles atteignent souvent la hauteur d'un immeuble de six étages ou plus. Lorsque ces vagues pénètrent dans la baie ou la baie sous la forme d'un entonnoir, chacune d'elles amène une violente crue sur le rivage. La hauteur de la vague ne diminue que dans les baies fermées et en expansion avec une entrée étroite, et lorsqu'elle frappe la rivière, la vague augmente en taille, augmentant ainsi son pouvoir destructeur.
L'activité d'un volcan dans la colonne d'eau donne un effet comparable à fort tremblement de terre. La plus grande de toutes les vagues géantes connues a été provoquée par éruption puissante Le volcan Krakatoa en Indonésie en 1883, lorsqu'une énorme masse de roche a été projetée dans les airs à une hauteur de plusieurs kilomètres et s'est transformée en un nuage de poussière qui a fait trois fois le tour de notre planète.
Des vagues atteignant 35 m de haut, se succédant les unes après les autres, ont noyé plus de 36 000 habitants des îles voisines. Ils ont fait le tour tout entier Terre et un jour plus tard ont été repérés dans la Manche. Le navire militaire, situé au large de Sumatra, a été projeté à 3,5 km à l'intérieur de l'île, où il s'est retrouvé coincé dans un fourré à 9 m d'altitude.
Un autre cas étonnant de vague inhabituellement haute a été enregistré le 9 juillet 1958. Après le tremblement de terre en Alaska, la masse de glace et de terre a oscillé avec un volume d'environ 300 millions de mètres cubes. m est tombé dans l'étroite et longue baie de Lituya, provoquant une onde colossale sur le côté opposé de la baie, atteignant près de 60 mètres de hauteur dans certaines zones de la côte. A cette époque, il y avait trois petits bateaux de pêche dans la baie.
«Malgré le fait que la catastrophe s'est produite à 9 km de l'endroit où les navires étaient amarrés», raconte un témoin oculaire, «tout avait l'air terrible. Sous les yeux du peuple choqué, une énorme vague s'est élevée, engloutissant le pied de la montagne du nord. Puis il a balayé la baie, arrachant les arbres des pentes de la montagne, détruisant le camp d’alpinistes récemment abandonné ; tombant comme une montagne d'eau sur l'île Cénotaphe, il engloutit une vieille cabane et finit par se retourner Le point le plus élevéîles, s'élevant à 50 m au-dessus du niveau de la mer.
La vague fit tourner le navire d'Ulrich qui, ayant perdu le contrôle, se précipita à la vitesse d'un cheval au galop vers les navires de Swanson et Wagner, toujours au mouillage. À la grande horreur de la population, la vague a brisé les chaînes d'ancre et a entraîné les deux navires comme des éclats, les obligeant à surmonter le voyage le plus incroyable qui soit arrivé autrefois aux bateaux de pêche. Selon Swanson, sous le navire, ils ont vu la cime d'arbres de 12 mètres et des rochers de la taille d'une maison. La vague a littéralement projeté les gens à travers l’île et en pleine mer. »

Au fil des siècles, les tsunamis sont devenus responsables de terribles catastrophes mondiales.
1737 - un cas de vague géante est décrit sur la côte du Kamtchatka, lorsque les vagues ont emporté presque tout ce qui se trouvait dans la zone inondable. Le faible nombre de victimes s'explique uniquement par le petit nombre d'habitants.
1755 - à cause d'un monstre aquatique, la ville de Lisbonne est complètement effacée de la terre, le bilan s'élève à plus de 40 000 personnes.
1883 - un tsunami cause d'énormes dégâts sur les côtes de l'océan Indien, faisant plus de 30 000 morts.
1896 - une catastrophe hydraulique frappe les côtes du Japon, faisant plus de 25 000 morts.
1933 - la côte japonaise est à nouveau endommagée, plus d'un millier de bâtiments sont détruits et 3 000 personnes sont mortes.
1946 - un puissant tsunami a causé d'énormes dégâts aux îles et au littoral près de la Trouée Aléoutienne ; la perte totale s'élève à plus de 20 millions de dollars.
1952 - un océan furieux attaque la côte nord de la Russie et, bien que la hauteur des vagues ne dépasse pas 10 m, les dégâts sont énormes.
1960 - La côte du Chili et les régions voisines subissent l'assaut de vagues géantes, les dégâts s'élèvent à plus de 200 millions de dollars.
1964 - La côte du Pacifique est frappée par un tsunami qui détruit des bâtiments, des routes et des ponts d'une valeur de plus de 100 000 $.
Ces dernières années, il a été établi que même les « invités cosmiques », c’est-à-dire les météorites qui n’ont pas eu le temps de se consumer dans l’atmosphère terrestre, peuvent provoquer des vagues géantes. Peut-être qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années, la chute d'une météorite géante a provoqué un tsunami, qui a entraîné la mort des dinosaures. Une autre raison, assez banale, pourrait être le vent. Il n’est capable de provoquer une grosse vague que dans de bonnes circonstances – la pression atmosphérique doit être correcte.
Cependant, le plus important est qu’une personne elle-même soit capable de déclencher un tsunami « provoqué par l’homme ». C’est exactement ce que les Américains ont prouvé au milieu du XXe siècle en subissant une explosion nucléaire sous-marine, qui a provoqué d’énormes perturbations sous-marines et, par conséquent, l’apparition de monstrueuses vagues à grande vitesse. Quoi qu’il en soit, on ne peut toujours pas prédire avec certitude l’apparition d’un tsunami ni, pire encore, l’arrêter.
Un tsunami est une catastrophe naturelle à laquelle tout le monde peut faire face. Même si vous ne vivez pas dans une zone sujette aux tsunamis, vous pourriez vous y retrouver en vacances ou en voyage d'affaires. Et par conséquent, toute personne doit savoir comment se comporter lorsqu’un tel phénomène se produit.
Vous devez comprendre qu'un tsunami n'est pas seulement une grosse vague, mais une force beaucoup plus puissante, décrite par une formule physique distincte et ayant une force presque égale à la force d'une explosion. Dans la mer, un tsunami est pratiquement invisible : la vague gagne en hauteur et en puissance lorsqu'elle s'approche des eaux peu profondes.
Ce qu'il ne faut pas faire lors d'un tsunami
Pour commencer, nous vous dirons ce qu'il ne faut pas faire lors d'un tsunami afin que vous ne commettiez pas de graves erreurs.
Premièrement, vous ne pouvez pas rester fasciné et regarder une énorme vague, enracinée sur place. Cette recommandation peut vous paraître étrange : qui penserait à se tenir debout et à regarder ? Mais, comme le montre la pratique, c'est exactement ce que font beaucoup. Soit par horreur, soit par intérêt.
Deuxièmement, si le tsunami est déjà très proche, le simple fait de courir n'aidera pas, car la vague se déplace à une vitesse de 800 km par heure (vitesse de l'avion), mais plus elle se rapproche du rivage, plus elle devient lente : la vitesse diminue à 80 km par heure.
Troisièmement, si le tsunami est encore loin, mais est déjà connu, vous n'aurez probablement pas plus de 15 à 20 minutes pour vous échapper. Par conséquent, au lieu de faire nos valises, nous profitons de ce temps pour nous échapper. Nous prenons seulement ce qui est nécessaire. Ne sauvez pas des choses, mais des vies !
Quatrièmement, il ne faut pas courir près du lit des rivières : ce sont les lits des rivières qui seront les premiers inondés lors d'un tsunami.
Signes d'un tsunami
Lorsqu'un tsunami a frappé les côtes de la Thaïlande en 2004, les vacanciers ont été étonnés que le fond soit exposé sur plusieurs kilomètres et que divers obus soient devenus visibles, que les gens ont commencé à ramasser. Mais sur une plage, les vacanciers ont été sauvés par les connaissances d'une écolière, qui avait étudié le sujet des tsunamis lors d'un cours de géographie la veille et qui avait reconnu avec le temps l'exposition des fonds marins comme un signe certain de l'apparition d'une vague, et elle en a également informé tout son entourage afin qu'ils puissent évacuer.
Les signes d’un tsunami comprennent :
- tremblement de terre
- comportement inhabituel de l'eau : soit elle recule de plusieurs mètres, soit, à l'inverse, commence à « lubrifier » la surface de la terre, dépassant la zone de l'eau
- les animaux se sont échappés du rivage ou agissent avec anxiété
- l'apparition d'un bord de vague blanc à l'horizon
- forte montée de l'horizon marin
- tout le monde fuit la mer
- la sirène d'avertissement retentit
Que faire lors d'un tsunami
Si vous ne voyez pas encore de tsunami, mais que la sirène d'alerte retentit déjà, ou que vous n'avez vu qu'un tsunami à l'horizon, alors vous avez 10 à 20 minutes pour quitter la zone.
Commencez immédiatement à courir dans l’autre sens depuis la mer. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir parcouru 3 à 4 kilomètres à l'intérieur des terres ou d'être à une altitude de 30 mètres. Habituellement, cela suffit à vous sauver.
Si vous êtes coincé et ne pouvez pas vous échapper du rivage, grimpez. Ce n’est pas la meilleure solution, nous l’utilisons donc uniquement si toutes les autres solutions ne sont pas disponibles. Vous pouvez grimper sur le toit d’un bâtiment ou choisir un arbre solide et grand pour vous abriter.
Lorsque vous prenez une position d'où vous attendez l'arrivée de la vague ou commencez à courir, essayez de vous débarrasser des vêtements lourds (vestes, etc.) au fur et à mesure de vos déplacements, qui vous noieront si la vague vous frappe.
Si vous tombez à l’eau, grimpez sur un objet flottant et utilisez-le comme radeau. Dans la mesure du possible, essayez de grimper à un arbre, à un bâtiment ou à tout autre endroit sûr.
Si vous vous retrouvez dans un tsunami, vous risquez de mourir non pas de noyade, mais d'être heurté par un objet flottant. Par conséquent, essayez de vous protéger de tels objets.
Lorsque la vague atteint sa limite sur terre, elle commence à reculer avec une puissance énorme. Être dans l'eau à ce moment-là est extrêmement dangereux, car vous serez simplement emporté dans l'océan. Par conséquent, dans la mesure du possible, essayez de sortir de l’eau, ne serait-ce qu’en vous accrochant à un arbre, afin de vaincre la force qui vous entraîne dans l’océan.
Que faire après un tsunami
Une fois le tsunami retiré, vous ne pouvez pas retourner à votre domicile ou à votre hôtel, ni vous rendre au rivage. La première vague pourrait être suivie d’une deuxième et d’une troisième, et elles pourraient être plus fortes. Par conséquent, vous devez rester à l'écart de la côte, ou mieux encore, essayer de vous enfoncer plus profondément dans l'île ou le continent afin que les deuxième et troisième vagues plus fortes ne vous rattrapent pas. Ce n'est que lorsque les autorités donneront le signal indiquant que les vagues sont terminées que vous pourrez retourner à la maison.
Lorsque vous entrez dans une maison, s’il en reste quelque chose, vous devez vous méfier des objets qui pourraient vous tomber sur la tête. Vous pourriez également recevoir un choc électrique. Par conséquent, vous ne pouvez entrer dans la pièce qu'après vous être assuré que tout est en ordre.
Si tu pars juste en vacances
Bien sûr, ce n’est pas très agréable de penser à de mauvaises choses avant de partir en vacances. Mais quand même, qui est prévenu est prévenu. Alors commencez par savoir si des tsunamis ont déjà frappé cette région côtière. Même s’ils ne s’effondrent pas, ce n’est pas une garantie. Il convient de noter que la plupart des tsunamis se produisent dans un endroit appelé « ceinture volcanique ». Il s'agit d'une zone de l'océan Pacifique connue pour son activité volcanique. Cependant, les tsunamis se produisent dans tous les océans, donc si vous êtes sur la côte océanique, c'est potentiellement dangereux. Vous ne devriez pas refuser de telles vacances, il vous suffit d'étudier les signes d'un tsunami et de suivre strictement toutes les règles.