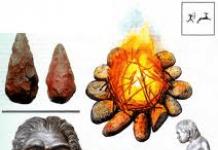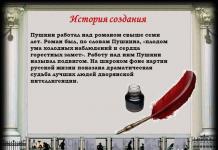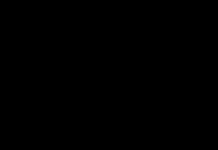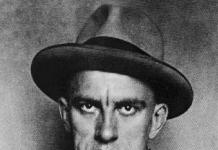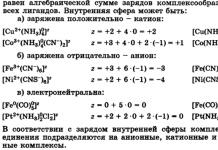Contenu
Introduction
1 Caractéristiques distinctives de l'équipe
2 L'équipe dans les travaux d'A.S. Makarenko. La loi de la vie collective
2.1 Étapes de développement de l'équipe
2.2 Traditions dans la vie collective
2.3 La perspective comme objectif capable de captiver et de fédérer
2.4 Le principe de l'action parallèle et sa bonne utilisation par l'enseignant
3 Interaction entre l'équipe et l'individu
3.1 Comment va se développer la relation entre l’individu et l’équipe
3.2 Modèle relationnel : conformisme
3.3 Modèle relationnel : harmonie
3.4 Modèle relationnel : le non-conformisme
4 Gestion efficace du personnel scolaire
Conclusion
Introduction
Le mot latin « collectivus » est traduit de différentes manières : rassemblement, foule, réunion commune, association, groupe. Dans la littérature moderne, deux sens du concept « équipe » sont utilisés. Premièrement : par collectif, on entend tout groupe organisé de personnes (par exemple, un groupe organisé. Au sens que le concept de « collectif » a acquis dans la littérature pédagogique, un collectif est une association d'élèves (étudiants), distinguée par un Un certain nombre de caractéristiques importantes. Ces quatre principes sont à la fois simples et importants :
1. Objectif général socialement significatif. Tout groupe a un objectif : aussi bien les passagers qui montent à bord du tramway que les criminels qui ont créé une bande de voleurs l'ont. Le tout est de savoir quel est l’objectif, à quoi il vise. L'objectif du collectif coïncide nécessairement avec les objectifs publics, est soutenu par la société et l'État et ne contredit pas l'idéologie dominante, la constitution et les lois de l'État.
2. Activité commune générale pour atteindre l'objectif, organisation générale de cette activité. Les gens s'unissent en équipes afin d'atteindre rapidement un certain objectif grâce à efforts communs... Pour ce faire, chaque membre de l'équipe doit participer activement à des activités communes, il doit y avoir une organisation commune d'activités. Les membres de l'équipe se distinguent par une grande responsabilité personnelle quant aux résultats des activités communes.
3. Relations de dépendance responsable. Des relations spécifiques sont établies entre les membres de l'équipe, reflétant non seulement l'unité d'objectif et d'activité (unité de travail), mais aussi l'unité des expériences et jugements de valeur(unité morale).
4. Organe directeur général élu. Des relations démocratiques s'établissent dans l'équipe. Les organes de gestion collective sont constitués par l'élection directe et ouverte des membres les plus influents du collectif.
Certaines de ces caractéristiques peuvent être inhérentes à d'autres types d'associations de groupe (associations, coopérations, sociétés, etc.). Mais ils ne se manifestent particulièrement clairement que dans les organisations collectives.
Cible travail de cours– étudier les aspects théoriques et pratiques du problème et de l’équipe dans l’apanage de l’école moderne.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de résoudre les tâches suivantes :
– considérer les caractéristiques distinctives de l’équipe ;
– étudier l'essence de l'équipe dans les travaux d'A.S. Makarenko, ainsi que comprendre le sens de la loi de la vie collective développée par le scientifique ;
– comprendre les modèles d’interaction entre l’individu et l’équipe ;
– considérer les principes d’une gestion efficace du personnel scolaire.
1 Caractéristiques distinctives de l'équipe
Outre les caractéristiques d'un collectif évoquées en introduction, le collectif se distingue également par d'autres très caractéristiques importantes. Ce sont des caractéristiques qui reflètent l’ambiance intra-collective, le climat psychologique et les relations entre les membres de l’équipe. L’une de ces caractéristiques est la cohésion, qui caractérise la compréhension mutuelle, la sécurité, le « sentiment de communauté » et l’implication dans une équipe. Des équipes bien organisées font preuve d’entraide et de responsabilité mutuelle, de bonne volonté et d’altruisme, d’une critique et d’une autocritique saines et de compétition.
Un groupe de personnes coopérant formellement peut se passer de ces qualités ; une équipe sans elles perd ses avantages.
Dans une équipe qui présente toutes les caractéristiques énumérées, un système différent d'attitudes envers le travail, envers les personnes, envers leurs responsabilités personnelles et sociales se forme. Dans une équipe amicale et soudée, le système de relations est déterminé par une combinaison raisonnable d'intérêts personnels et publics, la capacité de subordonner le personnel au public. Un tel système constitue une position claire et confiante de chaque membre de l'équipe, qui connaît ses responsabilités et surmonte les obstacles subjectifs et objectifs.
Le maillon le plus stable de la structure officielle de la communauté scolaire est l'équipe de classe, au sein de laquelle se déroule l'activité principale des écoliers : l'apprentissage. C'est en classe que se forme un réseau dense de liens et de relations interpersonnelles entre les écoliers. De ce fait, il sert en quelque sorte de fondation sur la base de laquelle différents groupes scolaires sont constitués.
Projection sur Salle de classe caractéristiques mises en évidence d'une équipe, nous arrivons à la conclusion qu'une équipe d'étudiants est un groupe d'étudiants unis par un objectif commun socialement significatif, une activité, une organisation de cette activité, ayant des organes élus communs et caractérisés par la cohésion, responsabilité générale, dépendance mutuelle avec égalité inconditionnelle de tous les membres en droits et responsabilités.
2 L'équipe dans les travaux d'A.S. Makarenko. La loi de la vie collective
Le représentant le plus éminent de la pédagogie russe qui a développé la théorie du collectif était A.S. Makarenko. Il est l'auteur de nombreux ouvrages pédagogiques et artistiques dans lesquels la méthodologie de l'éducation collectiviste a été développée en détail. Enseignements d'A.S. Makarenko contient une technologie détaillée pour la formation étape par étape d'une équipe. Il formule la loi de la vie du collectif : le mouvement est la forme de vie du collectif, l'arrêt est la forme de sa mort ; déterminé les principes de développement des équipes (transparence, dépendance responsable, lignes prometteuses, action parallèle) ; identifié les étapes (étapes) de développement de l'équipe.
2.1 Étapes de développement de l'équipe
Pour devenir un collectif, un groupe doit parcourir un chemin absurde de transformation qualitative. Sur ce chemin AC. Makarenko identifie plusieurs étapes (étapes).
La première étape est la constitution d’une équipe (étape de cohésion initiale). A cette époque, le collectif agit avant tout comme le but des efforts pédagogiques de l'enseignant, qui s'efforce de transformer un groupe organisationnel (classe, cercle, etc.) en un collectif, c'est-à-dire une telle communauté socio-psychologique où les relations de les étudiants sont déterminés par le contenu de leurs activités communes, ses buts, objectifs, valeurs. L'organisateur de l'équipe est un enseignant, toutes les exigences viennent de lui. La première étape est considérée comme terminée lorsqu'un atout s'est démarqué et gagné dans l'équipe, que les étudiants se sont mobilisés autour d'un objectif commun, activités générales et organisation générale.
Dans un deuxième temps, l'influence de l'actif augmente. Désormais, l’activiste non seulement soutient les revendications de l’enseignant, mais les présente également lui-même aux membres de l’équipe, guidé par ses propres conceptions de ce qui est bénéfique et de ce qui est préjudiciable aux intérêts de l’équipe. Si les militants comprennent correctement les besoins de l'équipe, ils deviennent alors des assistants fiables pour l'enseignant. Travailler avec l’actif à ce stade nécessite une attention particulière de la part de l’enseignant.
La deuxième étape est caractérisée par la stabilisation de la structure de l'équipe. A cette époque, l'équipe agit déjà comme un système intégral dans lequel des mécanismes d'auto-organisation et d'autorégulation commencent à fonctionner. Il est déjà en mesure d'exiger certaines normes de comportement de la part de ses membres, tandis que l'éventail des exigences s'élargit progressivement. Ainsi, au deuxième stade de développement, l'équipe agit déjà comme un instrument pour l'éducation ciblée de certaines qualités de personnalité.
L'objectif principal de l'enseignant à ce stade est d'utiliser au maximum les capacités de l'équipe pour résoudre les problèmes pour lesquels cette équipe est créée. Presque seulement maintenant, le collectif atteint un certain niveau de développement en tant que sujet d'éducation, ce qui permet de l'utiliser à dessein à des fins de développement individuel chaque élève individuellement. Dans une ambiance générale de bienveillance envers chaque membre de l'équipe, haut niveau un leadership pédagogique qui stimule les aspects positifs de l'individu, l'équipe devient un moyen de développement social qualités importantes personnalité.
Le développement d'une équipe à ce stade est associé au dépassement des contradictions : entre l'équipe et les étudiants individuels qui sont en avance sur les exigences de l'équipe dans leur développement ou, à l'inverse, en retard sur ces exigences ; entre perspectives générales et individuelles ; entre les normes de comportement de l'équipe et les normes qui se développent spontanément en classe ; entre des groupes distincts d'étudiants avec des orientations de valeurs différentes, etc. Par conséquent, dans le développement d'une équipe, des sauts, des arrêts et des renversements sont inévitables.
La troisième étape et les suivantes caractérisent l'épanouissement de l'équipe. Ils se distinguent par un certain nombre de qualités particulières acquises aux étapes précédentes de développement. Pour souligner le niveau de développement de l'équipe à ce stade, il suffit de souligner le niveau et la nature des exigences les uns envers les autres par les membres de l'équipe : des exigences plus élevées envers eux-mêmes que envers leurs camarades. Cela seul indique déjà le niveau d'éducation atteint, la stabilité des opinions, des jugements et des habitudes. Si l'équipe atteint ce stade de développement, elle forme alors une équipe holistique, personnalité morale. A ce stade, l'équipe se transforme en un instrument de développement individuel de chacun de ses membres. Une expérience commune, des évaluations identiques des événements sont la caractéristique principale et la plus caractéristiqueéquipe à la troisième étape.
Le processus de développement d'une équipe à partir d'un poste n'est en aucun cas considéré comme un processus de transition en douceur d'une étape à une autre. Il n'y a pas de frontières claires entre les étapes - des opportunités de passer à l'étape suivante sont créées dans le cadre de la précédente. Chaque étape ultérieure de ce processus ne remplace pas la précédente, mais s'y ajoute en quelque sorte. L’équipe ne peut et ne doit pas s’arrêter dans son développement, même si elle a atteint un très haut niveau. Par conséquent, certains enseignants distinguent la quatrième étape du mouvement et les suivantes. A ces étapes, chaque écolier, grâce à son expérience collective fermement assimilée, impose certaines exigences à lui-même, le respect des normes morales devient son besoin, le processus d'éducation se transforme en un processus d'auto-éducation.
2.2 Traditions dans la vie collective
A toutes les étapes de développement d'une équipe, grandes et petites traditions surgissent, renforcent et fédèrent l'équipe. Les traditions sont des formes de vie collective très stables qui incarnent émotionnellement les normes, les coutumes et les désirs des étudiants. Les traditions aident à développer des normes communes de comportement, à développer des expériences collectives et à décorer la vie.
Les traditions peuvent être divisées en grandes et petites. Les grandes traditions sont des événements de masse dynamiques, dont la préparation et la tenue favorisent le sentiment de fierté envers son équipe, la foi en sa force et le respect de l’opinion publique. Les petites traditions quotidiennes sont de taille plus modeste, mais non moins importantes dans leur impact éducatif. Ils enseignent comment maintenir l’ordre établi en développant des habitudes de comportement stables. Les petites traditions ne nécessitent pas d'efforts particuliers, elles sont soutenues par l'ordre établi, un accord volontairement accepté par tous. Les traditions changent et sont mises à jour. Les nouvelles tâches auxquelles l'équipe est confrontée, les nouvelles façons de les résoudre deviennent plus ou moins populaires au fil du temps - cela contribue à l'émergence de nouvelles traditions et à l'effacement des anciennes.
2.3 La perspective comme objectif capable de captiver et de fédérer
Considéré comme particulièrement important par A.S. Makarenko choix de la cible. Il a appelé un objectif pratique capable de captiver et d'unir les étudiants comme une perspective. En même temps, il partait du principe que « le véritable stimulant de la vie humaine est la joie de demain ». Un objectif à long terme compréhensible par chaque élève, conscient et perçu par lui, devient une force mobilisatrice qui permet de surmonter les difficultés et les obstacles.
En pratique travail éducatif COMME. Makarenko distingue trois types de perspectives : proche, moyenne et lointaine.
Une perspective étroite est proposée à une équipe à tout stade de développement, même au stade initial. Une perspective rapprochée pourrait être, par exemple, une promenade dominicale commune, une sortie au cirque ou au théâtre, un jeu de compétition intéressant, etc. La principale exigence d'une perspective rapprochée est qu'elle soit basée sur l'intérêt personnel : chaque élève le perçoit comme sa propre joie de demain, il s'efforce de la réaliser, anticipant le plaisir attendu. Le plus haut niveau de perspective rapprochée est la perspective de la joie du travail collectif, lorsque l'image même d'un travail commun capture les enfants comme une perspective rapprochée agréable.
Perspective moyenne, selon A.S. Makarenko, réside dans le projet d'un événement collectif, quelque peu décalé dans le temps. Atteindre cette perspective nécessite des efforts. Exemples de perspectives moyennes qui se sont répandues dans la modernité pratique scolaire, on peut appeler la préparation d'une compétition sportive, de vacances scolaires, soirée littéraire. Il est préférable de proposer une perspective moyenne lorsque la classe a déjà formé un bon atout, efficace, capable de prendre l'initiative et de diriger tous les écoliers. Pour les équipes à différents niveaux de développement, la perspective moyenne doit être différenciée en termes de temps et de complexité.
Une perspective à long terme est un objectif qui est repoussé dans le temps, qui est le plus important socialement et qui nécessite des efforts importants pour être atteint. Dans une telle perspective, les besoins personnels et sociaux se conjuguent nécessairement. Un exemple de perspective à long terme la plus courante est l’objectif de terminer avec succès ses études et de choisir ensuite une profession. L'éducation à long terme ne donne un effet significatif que lorsque la place principale dans l'activité collective est occupée par le travail, lorsque l'équipe est passionnée par des activités communes, lorsque des efforts collectifs sont nécessaires pour atteindre l'objectif.
Un système de lignes prometteuses devrait imprégner l’équipe. Il doit être construit de telle manière qu'à tout moment, l'équipe ait un objectif brillant et passionnant, le respecte et fasse des efforts pour le mettre en œuvre. L'évolution de l'équipe et de chacun de ses membres dans ces conditions est significativement accélérée, et processus éducatif se déroule naturellement. Vous devez choisir les prospects de manière à ce que le travail se termine par un réel succès. Avant de confier des tâches difficiles aux étudiants, il est nécessaire de prendre en compte les besoins sociaux, le niveau de développement et d'organisation de l'équipe, ainsi que l'expérience de son travail. Un changement continu de perspectives, la définition de tâches nouvelles et de plus en plus difficiles sont une condition préalable au mouvement progressif de l'équipe.
2.4 Le principe de l'action parallèle et sa bonne utilisation par l'enseignant
Il est établi depuis longtemps que l'influence directe d'un enseignant sur un élève peut être inefficace pour plusieurs raisons. Les meilleurs résultats viennent de l’exposition des écoliers qui l’entourent. Ceci a été pris en compte par A.S. Makarenko, mettant en avant le principe de l'action parallèle. Elle repose sur l'exigence d'influencer l'élève non pas directement, mais indirectement, à travers l'équipe principale. Chaque membre de l'équipe est sous l'influence « parallèle » d'au moins trois forces : l'enseignant, l'activiste et l'ensemble de l'équipe. L’influence sur l’individu s’exerce à la fois directement par l’éducateur (parallèle 1) et indirectement à travers l’activiste et l’équipe (parallèles 2′ et 2). À mesure que le niveau de formation de l'équipe augmente, l'influence directe de l'enseignant sur chaque élève s'affaiblit et l'influence de l'équipe sur lui augmente. Le principe d'action parallèle est applicable dès la deuxième étape de développement de l'équipe, où le rôle de l'éducateur et la force de son influence pédagogique sont encore importants. À des niveaux plus élevés de développement d’équipe, l’influence de l’actif et de l’équipe augmente. Cela ne signifie pas que l'enseignant cesse complètement d'influencer directement les élèves. Désormais, il s'appuie de plus en plus sur le collectif, qui devient lui-même porteur d'influence pédagogique (le sujet de l'éducation). Dans les travaux de A. S. Makarenko, nous trouvons de nombreux exemples de mise en œuvre réussie du principe d’action parallèle. Par exemple, il n'a jamais recherché lui-même les auteurs spécifiques des violations, donnant à l'équipe le droit de comprendre leurs méfaits, et il n'a lui-même dirigé que progressivement les actions des militants.
La pratique moderne de l'éducation scolaire s'est enrichie de nouveaux exemples d'application du principe d'action parallèle. Outre l’utilisation habile et réfléchie des avantages d’une action parallèle, il existe également des décisions inconsidérées. Ainsi, ce principe est utilisé pour condamner collectivement les coupables. Si des gars individuels ont fait preuve de négligence dans leur traitement de l'affaire, une punition est imposée à l'ensemble de l'équipe. Naturellement, une telle action pédagogique provoque une condamnation sévère des fautes des camarades. Les conséquences ne sont pas toujours prévisibles. Par exemple, parce que quelqu'un était mal en service, la classe doit à nouveau être en service pendant une semaine entière, travaillant à contretemps. COMME. Makarenko a conseillé d'utiliser ce principe avec beaucoup de prudence, car l'équipe peut punir très sévèrement les coupables.
Grande importance d'A.S. Makarenko a donné du style aux relations intra-collectives. Il considérait les traits distinctifs suivants de l'équipe formée : 1) majeur – gaieté constante, disponibilité des étudiants à l'action ; 2) un sentiment d’estime de soi né de l’idée de la valeur de son équipe, de la fierté de celle-ci ; 3) l'unité amicale de ses membres ; 4) un sentiment de sécurité pour chaque membre de l'équipe ; 5) activité, se manifestant par une volonté d'agir de manière ordonnée et commerciale ; 6) l'habitude d'inhibition, de retenue dans les émotions et les paroles.
3 Interaction entre l'équipe et l'individu
3.1 Comment va se développer la relation entre l’individu et l’équipe
La position d'un individu dans le système de relations collectives dépend surtout de son expérience sociale individuelle. C'est l'expérience qui détermine la nature de ses jugements, son système d'orientations de valeurs et sa ligne de comportement. Cela peut correspondre ou non aux jugements, valeurs et traditions comportementales qui se sont développés au sein de l'équipe. Là où cette correspondance est évidente, l’inclusion de l’individu dans le système de relations existantes est grandement facilitée. Dans les cas où l'étudiant vit une expérience différente (plus étroite, plus pauvre ou, au contraire, plus riche que l'expérience de la vie sociale de l'équipe), il lui est plus difficile d'établir des relations avec ses pairs. Sa situation est particulièrement difficile lorsqu'un individu expérience sociale contredit les valeurs acceptées dans cette équipe. La collision de lignes de comportement et de points de vue opposés sur la vie est ici tout simplement inévitable et, en règle générale, conduit à des résultats différents, pas toujours prévisibles.
Concluons : la façon dont va évoluer la relation entre l'individu et le collectif dépend non seulement des qualités de l'individu lui-même, mais aussi du collectif. Les relations les plus favorables, comme le confirme l'expérience, se développent là où l'équipe a déjà atteint un niveau de développement élevé, où elle représente une force fondée sur les traditions, l'opinion publique et l'autorité de l'autonomie gouvernementale. Une telle équipe établit relativement facilement des relations normales avec ceux qui en font partie.
Chacun, avec plus ou moins d'énergie, s'efforce de s'affirmer dans l'équipe, d'y prendre une position favorable. Mais tout le monde n'y parvient pas - des raisons subjectives et objectives interfèrent. Tout le monde, en raison de ses capacités naturelles, ne parvient pas à obtenir un succès visible, à surmonter sa timidité ou à comprendre de manière critique les différences d'orientations de valeurs avec l'équipe. Il est particulièrement difficile pour les écoliers plus jeunes, qui n'ont pas encore suffisamment développé la conscience de soi et l'estime de soi, la capacité d'évaluer correctement l'attitude de l'équipe et des camarades envers eux-mêmes, de trouver la place dans l'équipe qui correspond à leurs capacités. , en feraient des personnes intéressantes aux yeux de leurs camarades, dignes d'attention. Aux raisons subjectives, il existe également des raisons objectives : monotonie des activités et gamme étroite de compétences techniques. rôles sociaux qu'un élève peut jouer en groupe ; pauvreté du contenu et monotonie des formes organisationnelles de communication entre les membres de l'équipe, leur manque de culture de perception les uns des autres, l'incapacité de voir chez un ami quelque chose d'intéressant et de précieux qui mérite l'attention.
Recherche scientifique Les trois modèles les plus courants de développement des relations entre l'individu et le collectif sont identifiés : 1) l'individu se soumet au collectif (conformisme) ; 2) l'individu et l'équipe entretiennent des relations optimales (harmonie) ; 3) l'individu subjugue le collectif (non-conformisme). Dans chacun de ces modèles généraux, on distingue de nombreuses lignes de relations, par exemple : le collectif rejette l'individuel ; l'individu rejette le collectif ; coexistence basée sur le principe de non-ingérence, etc.
3.2 Modèle relationnel : conformisme
Selon le premier modèle, une personne peut se soumettre aux exigences du collectif de manière naturelle et volontaire, elle peut céder au collectif en tant que force externe supérieure, ou elle peut essayer de continuer à maintenir son indépendance et son individualité, en se soumettant uniquement au collectif. extérieurement, formellement. Si l’envie de rejoindre une équipe est évidente, l’individu se penche vers les valeurs du groupe et les accepte. L'équipe « absorbe » l'individu, le subordonnant aux normes, valeurs et traditions de sa vie.
Selon la deuxième ligne de comportement, différentes manières de développer les événements sont possibles : 1) l'individu se soumet extérieurement aux exigences de l'équipe, tout en conservant son indépendance interne ; 2) la personnalité se « rebelle », résiste, entre en conflit ouvertement. Les motivations d'adaptation de l'individu au groupe, à ses normes et valeurs sont variées. Le motif le plus courant qui existait dans nos groupes scolaires était le désir d'éviter les complications et les ennuis inutiles et inutiles et la peur de gâcher les « caractéristiques ». Dans ce cas, l'étudiant ne perçoit qu'extérieurement les normes et les valeurs de l'équipe, exprime les jugements qu'on attend de lui et se comporte dans diverses situations de la manière habituelle dans l'équipe. Cependant, en dehors de la communauté scolaire, il raisonne et pense différemment, en se concentrant sur son expérience sociale préalablement développée. Cette condition peut être temporaire, transitoire ou rester permanente. Cette dernière s'observe lorsque l'expérience sociale préalablement établie de l'individu, inadéquate à l'expérience du collectif, est renforcée par d'autres groupes (famille, entreprise de chantier, etc.).
La « rébellion » ouverte contre l’équipe est un phénomène rare dans nos écoles. Les gars ne se « révoltent » qu’occasionnellement, puis sur des questions sans principes. Le sentiment d’auto-préservation prend le dessus. L'équipe qui a brisé la personnalité agit à son égard comme un gendarme. Cela contredit l'approche humaine de l'éducation, et les enseignants ont des sujets de réflexion lorsqu'ils développent de nouvelles façons d'améliorer la relation entre l'individu et l'équipe.
3.3 Modèle relationnel : harmonie
L'idéal des relations est l'harmonisation de l'individu et de l'équipe. Selon certaines estimations, moins de 5 % des écoliers interrogés considèrent leurs conditions de vie en groupe comme confortables. Une étude approfondie de ces gars a montré qu'ils sont dotés de qualités collectivistes naturelles rares et sont donc capables de s'entendre dans n'importe quelle équipe, ont acquis une expérience sociale positive de la vie humaine et, de plus, se retrouvent dans des équipes bien formées. Dans ce cas, il n’y a pas de contradictions entre l’individu et l’équipe. Chaque membre de l'équipe est intéressé à l'existence d'une association conviviale et pérenne.
Un modèle typique de relations entre l'individuel et le collectif, caractéristique de notre école récente, est la coexistence. L'individu et le collectif coexistent, observant des relations formelles, tout en étant appelés collectif, mais n'en étant pas un par essence. Dans la plupart des cas, un double système de valeurs, un double champ de tension morale s'établit dans l'équipe, lorsque, dans le cadre d'activités organisées avec la participation des enseignants, des relations positives s'établissent entre les écoliers, et avec une communication non organisée elles restent négatives . Cela est dû au fait que les gars ne peuvent pas montrer leur individualité dans l'équipe, mais sont obligés de jouer des rôles imposés. Là où il est possible d'élargir l'éventail des sols, les écoliers trouvent dans l'équipe des positions qui les satisfont et leur position dans le système de relations devient plus favorable.
3.4 Modèle relationnel : le non-conformisme
Le troisième modèle de relation entre l’individu et le collectif, lorsque l’individu soumet le collectif, n’est pas courant. Pourtant, étant donné l'activité, c'est le cas. leaders dits informels, et par conséquent la présence de systèmes de valeurs et de relations doubles et souvent triples, ce modèle ne peut être ignoré. Une personnalité brillante et son expérience individuelle peuvent, pour une raison ou une autre, s'avérer attractives aux yeux des membres de l'équipe. Cette attractivité est le plus souvent due à des qualités personnelles, à des jugements ou actions inhabituels, à l'originalité d'un statut ou d'une position. Dans ce cas, l'expérience sociale de l'équipe peut changer. Ce processus peut être de double nature et conduire à la fois à l'enrichissement de l'expérience sociale de l'équipe, et à son appauvrissement si la nouvelle idole devient un leader informel et oriente l'équipe vers un système de valeurs inférieur à celui que l'équipe a déjà atteint.
Les psychologues et les enseignants notent la position répandue des membres des groupes scolaires, dans lesquels l'individualisme se manifeste sous une forme cachée et voilée. De nombreux écoliers sont très disposés à assumer le travail proposé, notamment les plus responsables. Briller, être aux yeux de tous, montrer sa supériorité sur les autres et souvent aux dépens des autres est un motif fréquent de leur zèle. Ils ne sont pas attristés par la mauvaise situation de l'équipe, ils se réjouissent même parfois des échecs généraux de la classe, car dans ce contexte, leurs propres réalisations brillent davantage.
Bien entendu, les modèles considérés n'épuisent pas toute la grande variété des relations entre l'individu et l'équipe, dont l'analyse dans chaque cas spécifique doit être abordée en pleine connaissance des mécanismes psychologiques de motivation pour l'activité et le comportement de l'individu. individuel, ainsi que les lois de la pédagogie sociale et de la psychologie.
4 Gestion efficace du personnel scolaire
L'équipe est en constante évolution car les personnes qui la composent changent constamment. La nature de l'influence du collectif sur l'individu évolue également. Dans les groupes scolaires, les processus se développent si intensément et si rapidement que même les spécialistes ne peuvent pas suivre l'évolution des événements. Cependant, en y regardant de plus près, on constate que le processus de développement de l'équipe n'est en aucun cas spontané, mais pédagogiquement contrôlé. L'efficacité de la gestion dépend de la mesure dans laquelle les modèles de son développement ont été étudiés, de la manière dont l'enseignant diagnostique correctement la situation et choisit les moyens d'influence pédagogique.
Gérer une équipe d'étudiants, c'est gérer le processus de son fonctionnement, utiliser l'équipe comme un outil d'éducation des écoliers, en tenant compte du stade de développement auquel elle se situe. La gestion sera d'autant plus efficace que les caractéristiques de l'équipe et ses capacités d'autonomie gouvernementale seront pleinement prises en compte. La gestion du corps étudiant s'effectue selon deux processus interdépendants et interdépendants : 1) la collecte d'informations sur le corps étudiant et les écoliers qui le composent ; 2) organiser des influences adéquates à son état, dans le but d'améliorer l'équipe elle-même et d'optimiser son influence sur la personnalité de chaque élève (A. T. Kurakin).
L'optimisation de la gestion de l'équipe étudiante est associée à l'identification de paramètres et à l'élaboration de critères caractérisant le niveau de développement de l'équipe et la position de l'étudiant dans le système de relations collectives ; développement de méthodes d'étude de l'équipe, de formes et de méthodes d'utilisation des informations reçues. La condition la plus importante d'optimisation est l'intégration des influences pédagogiques exercées sur l'équipe dans un système unique qui assure la continuité de ces processus. Une telle intégration est réalisée en : 1) en utilisant un complexe d'influences pédagogiques sur l'équipe ; 2) une attention constante et multilatérale des membres de l'équipe les uns envers les autres dans Vie courante; 3) créer des situations dans la vie de l'équipe qui contribuent à son influence positive sur les membres individuels ; 4) élargir les fonctions de l'autonomie gouvernementale étudiante ; 5) combiner les efforts de toutes les personnes impliquées dans le travail avec l'équipe.
Conclusion
La question du rapport entre le collectif et l'individu est l'une des questions clés, et dans les conditions de démocratisation de l'éducation, de respect des droits de l'homme et des libertés, elle acquiert une importance particulière. Pendant de nombreuses décennies, la question de la formation de la personnalité de l’étudiant en influençant l’équipe n’a pratiquement pas été prise en compte dans la littérature pédagogique nationale. On croyait que l'individu devait obéir inconditionnellement au collectif. Il nous faut désormais rechercher de nouvelles solutions qui correspondent à l'air du temps, en s'appuyant sur les conceptions philosophiques profondes de l'homme et l'expérience de la pensée pédagogique mondiale.
Le processus d'inclusion d'un étudiant dans le système de relations collectives est complexe, ambigu et souvent contradictoire. Tout d’abord, il convient de noter qu’il est profondément individuel. Les écoliers, futurs membres de l'équipe, diffèrent les uns des autres par leur santé, leur apparence, leurs traits de caractère, leur degré de sociabilité, leurs connaissances, leurs compétences et bien d'autres traits et qualités. Par conséquent, ils entrent de différentes manières dans le système des relations collectives, provoquent des réactions différentes de la part des camarades et ont un effet inverse sur l'équipe.
Dans la pratique de la gestion pédagogique d'un groupe d'écoliers, pour que la relation entre l'équipe et l'individu soit harmonieuse, les règles importantes suivantes doivent être respectées :
1. Il est raisonnable de combiner l'orientation pédagogique avec le désir naturel des étudiants d'indépendance, d'indépendance et le désir de faire preuve d'initiative et d'auto-activité. Non pas pour supprimer, mais pour diriger habilement l'activité des enfants, non pour commander, mais pour coopérer avec eux. Dosage strict impact pédagogique, en surveillant attentivement les réponses des élèves. Si la perception est négative, vous devez immédiatement changer de tactique et chercher d’autres moyens. Il est nécessaire de veiller à ce que les objectifs et les tâches à résoudre soient fixés par les enfants eux-mêmes, et ils doivent s'y préparer. Choisissez des objectifs réalisables, visibles et compréhensibles pour chaque membre de l’équipe.
2. L'équipe est un système dynamique : elle évolue, se développe et se renforce constamment. Par conséquent, leurs orientations pédagogiques ne peuvent pas non plus rester inchangées. Commençant comme seul organisateur de l'équipe dès la première étape de son développement, l'enseignant, au fur et à mesure que l'équipe se développe, change progressivement les tactiques de gestion, développe la démocratie, l'autonomie gouvernementale, l'opinion publique et, aux étapes les plus élevées du développement de l'équipe, entre dans relations de coopération avec les étudiants.
3. L'enseignant de la classe n'atteint une grande efficacité de l'éducation collective que lorsqu'il s'appuie sur l'équipe d'enseignants travaillant dans cette classe, qu'il inclut l'équipe de classe dans les activités à l'échelle de l'école et en coopération avec d'autres groupes et qu'il maintient un contact étroit et constant avec la famille. L'organisation et la coordination des influences éducatives sont la responsabilité la plus importante de l'enseignant.
4. Le formalisme est le pire ennemi de l’éducation. La restructuration de la gestion des équipes consiste non seulement à réviser les buts et les contenus de l'enseignement collectiviste, qui acquièrent une orientation personnelle, mais aussi à changer l'objet de la gestion pédagogique. Il devient une personnalité en développement qui nécessite une assistance pédagogique qualifiée. Il ne faut pas oublier que la priorité des valeurs est formée par l'enseignant : quels modèles il propose à ses élèves, telles qualités se forment en eux.
5. Un indicateur d'un bon leadership est la présence dans l'équipe d'une opinion commune sur les questions les plus importantes de la vie de classe. L'équipe renforce et accélère la formation des qualités nécessaires : chaque élève ne peut pas survivre à toutes les situations, l'expérience d'un ami, l'opinion collective doivent le convaincre et développer la ligne de comportement social nécessaire.
6. La démocratisation de l'éducation ne signifie pas la suppression du contrôle sur l'exercice par les membres de l'équipe de leurs fonctions. La structure verticale-horizontale de contrôle et de correction, testée dans les établissements d'enseignement, porte ses fruits. Son essence est que le système de contrôle vise un niveau de développement de plus en plus élevé de l'équipe et de chaque élève (verticalement), et exerce spécifiquement le contrôle et la maîtrise de soi dans l'équipe principale (horizontalement).
7. Recherche psychologique a montré que les relations interpersonnelles au sein d'une équipe ont une structure à plusieurs niveaux. Le premier niveau forme un ensemble les relations interpersonnelles dépendance directe (relations personnelles). Ils se manifestent par une attirance émotionnelle ou une antipathie, une compatibilité, une difficulté ou une facilité de contact, une coïncidence ou une divergence de goûts, une plus ou moins suggestibilité. Le deuxième niveau forme un ensemble de relations interpersonnelles médiées par le contenu de l'activité collective et les valeurs de l'équipe (relations partenariales). À ce niveau, les relations entre les membres de l'équipe se manifestent comme des relations entre les participants à des activités communes, les camarades d'études, de sport, de travail et de loisirs. Le troisième niveau forme un système de connexions exprimant l'attitude envers le sujet de l'activité collective (relations motivationnelles) : les motivations, les buts de l'activité collective, l'attitude envers l'objet de l'activité, le sens social de l'activité collective.
Qu’est-ce que cela oblige l’enseignant à faire ? À une telle organisation d'interaction collective dans laquelle les relations personnelles, de partenariat et de motivation entre les membres de l'équipe fusionnent dans le processus d'unité amicale, de communication et de coopération. Y parvenir est très difficile : l'attitude sélective des membres de l'équipe les uns envers les autres existera toujours. Un professeur sage vous apprendra à être patient envers les défauts des autres, à pardonner les actions et les offenses déraisonnables.
8. L'une des raisons de la position défavorable des étudiants dans le système de relations collectives est l'inadéquation des rôles qu'ils remplissent aux opportunités réelles. Si les missions permanentes ou temporaires ne contribuent pas à leurs intérêts ou à leurs capacités, elles sont alors exécutées formellement ou pas du tout. Dans ce cas, les gars sortent du système de relations collectives. C'est pourquoi l'élaboration des tâches individuelles doit être basée non seulement sur les besoins de l'équipe, mais également sur les capacités et les intérêts des écoliers eux-mêmes. La position de chacun dans le système de relations collectives sera alors la plus favorable.
9. Des recherches ont montré que les écoliers occupent une position favorable ou défavorable dans l'équipe dès la période initiale de leur séjour dans l'équipe, et à l'avenir, elle s'avère stable pour la majorité. Naturellement, ces conclusions posent immédiatement à l'enseignant la question de la nécessité d'une intervention active dans le système de relations qui se développent spontanément au sein de l'équipe. Pour que la gestion de ce processus soit efficace, il est nécessaire de contrôler les facteurs qui influencent la position de l’étudiant dans le système de relations intra-collectives qui se développent spontanément. Ces facteurs comprennent : les caractéristiques de l'étudiant lui-même (retenue, émotivité, sociabilité, optimisme, attractivité extérieure, etc.) ; traits qui caractérisent son caractère moral (attitude attentive envers les camarades, justice, etc.) ; données physiques (force, beauté, agilité, etc.).
10. La position de l'étudiant et de l'équipe dépend également des normes et standards de relations acceptés dans l'équipe, des orientations de valeurs collectives. Le même étudiant dans la même équipe peut se retrouver dans... favorable, et dans une autre - dans une position défavorable. Il est donc nécessaire de créer des équipes temporaires et de transférer les étudiants défavorisés vers une équipe où ils pourront bénéficier d'un statut plus élevé.
11. La position de l’étudiant est influencée de manière très significative par le changement dans la nature des activités au sein de l’équipe. Un professeur réfléchi veille constamment à changer la nature et les types d'activités collectives, permettant aux élèves d'être initiés à de nouvelles relations.
Les relations harmonieuses au sein d'une équipe sont l'un des principaux avantages de tout environnement de travail. C'est la base des fondations. Tout management raisonnable et moderne doit s'efforcer de les atteindre. Il existe plusieurs classifications des types de relations dans une équipe. Par exemple, ils sont divisés en relations formelles et en compagnie chaleureuse, ainsi qu'en équipe qui n'a pas de règles strictes.
Avantages et inconvénients de telles relations
Dans les relations formelles, tous les membres de l'équipe connaissent clairement leurs responsabilités et viennent travailler pour travailler, pas pour perdre du temps. De telles équipes sont considérées comme plus efficaces et la présence de telles relations est plus typique pour une équipe masculine.
Parfois, il peut s'agir d'une équipe mixte, mais si une personne manque de chaleur et de communication, il peut alors être difficile pour une personne d'y travailler.
Une entreprise conviviale semble plus unie grâce aux rencontres communes et aux relations amicales, mais elle a ses inconvénients.
Cela distrait du travail et une personne s'ouvre trop devant ses collègues, montrant parfois ses faiblesses. S'ils veulent en profiter, de telles relations s'avèrent très tristes pour lui. Il existe certains types d'organisations où aucune des méthodes ci-dessus n'est acceptée, de sorte que chaque relation avec les employés devient une sorte de test pour le nouveau venu. Les amitiés peuvent commencer là, ou ils peuvent simplement l'ignorer, considérant tout comme une formalité.
Souvent, dans une telle équipe, quelqu'un peut croire qu'un collègue est obligé de résoudre ses problèmes personnels, de sorte que tout le monde ne peut pas faire face à une telle charge, où, en plus des tâches de travail, une composante psychologique lui incombera également.
Cinq types de gestion d'équipe
De plus, le type de gestion d'entreprise lui-même est souvent divisé en cinq composantes, où le patron n'interfère pas dans la gestion de l'équipe, fait beaucoup de choses lui-même et ne délègue pas ses fonctions.
- Son objectif est de conserver sa position et rien d'autre. Il n'est pas surprenant que l'équipe ne l'aime pas, car il ne se soucie pas de lui-même. Dans ce cas, la production en souffre souvent, car le manager ne peut tout simplement pas tout savoir physiquement, et puisqu'il ne recourt pas à l'aide des autres. , il marque pratiquement le pas.
- Le deuxième type de leadership est pratiquement la familiarité. Dans une telle entreprise, le manager prend soin de tout le monde, fixe un rythme de travail confortable, mais il ne se soucie pas non plus particulièrement des résultats, car se soucier des gens les freine parfois involontairement et ils s'assoient sur le cou. Des favoris peuvent également apparaître, ce qui entraîne également une diminution des résultats, car ils sont moins demandés.
- Un manager qui fixe des tâches mais ne s'intéresse pas au facteur humain n'est pas non plus très bon dans les entreprises, car les gens y travaillent simplement jusqu'à leurs limites. La tâche peut être confiée à un salarié qui ne possède pas les compétences suffisantes pour l'accomplir.
De plus, tout le monde ne peut pas résister à un tel style de commandement, car les ordres ne sont généralement pas discutés et les dissidents risquent le licenciement.
Si le gestionnaire a juste milieu en gestion et approche psychologique, il obtient alors d'excellents résultats de la part de l'équipe, car il n'exige pas l'impossible, mais n'abandonne pas non plus la résolution des problèmes. Ceci est pratique dans les structures où l'équipe est petite et d'âges différents. - Cependant, travailler en équipe fonctionne mieux. Car le manager prend en compte les intérêts de l'entreprise et en même temps fédère l'équipe à tous les niveaux. Tout le monde n'est pas capable de réunir des personnes ayant des intérêts et des personnalités différents en une seule équipe, mais les individus particulièrement doués et charismatiques y parviennent. Naturellement, un tel leader doit lui-même être un modèle de dévouement et de compétence pour que les salariés le suivent.
- Le manager donne confiance au salarié, lui permet d'accéder à davantage de fonctions managériales et fait de lui un professionnel. La confiance du dirigeant et la réduction de la supervision permettent la formation de cadres supplémentaires de l’entreprise, capables de s’acquitter de manière indépendante de toutes les tâches de l’entreprise.
Formulaires guides
Ainsi, après avoir considéré plusieurs types de leaders, nous pouvons arriver à la conclusion qu'il existe deux formes de leadership:
- Grand professionnalisme (commande, suggestion, participation, délégation, confiance)
- Faible professionnalisme (instruction, leadership, faible confiance, contrôle)
Si un employé est prêt à assumer la responsabilité de mise en œuvre indépendante tâches, alors il n'aura plus besoin de suggestion, là le manager participe simplement à son travail et délègue ensuite ses pouvoirs. Après avoir reçu un tel employé dans son entreprise, ou l'avoir élevé seul, le manager peut être fier d'avoir trouvé un excellent assistant, et peut-être un remplaçant dans le futur. Dans ce cas, le soutien émotionnel du salarié n’est plus nécessaire et il prend toutes les décisions de manière indépendante en fonction de la situation.
Quand un leader peut se tromper et à quoi cela conduit-il
- S'il a puni un autre employé, et non celui qui a commis l'erreur, l'équipe ou la personne punie risque de ne pas comprendre ou accepter ce style de leadership.
- Si la décision a été prise sans l'employé chargé d'effectuer le travail
- Des confrontations en présence de tiers ou en coulisses
- Au lieu d'admettre son erreur, le manager cherche le coupable parmi ses subordonnés
- L'entrepreneur ne dispose pas d'informations importantes pour la qualité des travaux
- Un employé professionnellement qualifié reste trop longtemps en poste et n'est pas promu dans l'entreprise.
- Plaintes d'un patron concernant ses employés à ses supérieurs
- Les récompenses vont au mauvais employé qui a fait tout le travail
- Favoris et exclus de l'équipe, niveau différent demande de l'équipe
Toutes ces erreurs d'un leader indiquent qu'il n'est pas compétent dans son travail et qu'il n'est pas prêt professionnellement à diriger les gens. Ceci n'est pas critique, mais affecte néanmoins les résultats de l'équipe dans son ensemble et les relations au sein de l'équipe. Ils n’aiment pas un tel patron, ils ne l’écoutent souvent pas et encore moins ne le respectent pas. S'il existe une opportunité de quitter une telle équipe, le salarié le fait avec plaisir. Lorsque vous choisissez un tel patron pour un poste, vous devez comprendre que la cohésion d'équipe ne peut être réalisée dans une telle équipe.
Les relations au sein d'une équipe dépendent de l'éducation des personnes, de leurs catégories d'âge et des valeurs humaines universelles. Plus une personne est instruite, meilleures sont ses relations au sein de l'équipe. Il sait où se taire et où répondre, et n’oublie naturellement pas d’accomplir ses tâches, laissant la clarification des qualités personnelles de chacun en dehors de son bureau.
Si vous le souhaitez, vous pouvez former n'importe quel type d'équipe, en définissant l'objectif le plus important de ses individus, mais il ne faut pas oublier que le plus productif d'entre eux est une équipe. Si le patron est intéressé à promouvoir son entreprise et à obtenir des résultats élevés, il devra alors déléguer ses pouvoirs à l'équipe la plus préparée, tout en conservant le rôle de contrôleur et de coordinateur des actions.
Équipe– collectivus du latin – unique, collectif – un groupe de personnes unies par un objectif commun socialement significatif, exerçant des activités socialement utiles. L'équipe a une structure claire dont les principales composantes sont les membres de l'équipe, les organes de direction (manager, leader) et les actifs.
Il existe plusieurs points de vue concernant l'interaction entre l'équipe et l'individu :
L'équipe nivelle la personnalité (égalise, fait la moyenne) ;
Ce n'est que dans une équipe que la liberté personnelle est possible ;
La personnalité, se développant dans l'équipe, contribue au développement de l'équipe ;
une équipe développée et soudée est une condition du développement personnel, et surtout, une condition de la formation d'un leader.
Il existe des enseignements connus sur le collectif et le développement de l'individu en son sein. Examinons quelques-uns d'entre eux. Tellement célèbre dans le monde entier L’enseignement d’A.S. Makarenko sur l’équipe.
D'une importance particulière pour le développement théorique et pratique du problème du collectif étaient, tout d'abord, l'activité pratique elle-même, puis les travaux psychologiques et pédagogiques et les travaux artistiques d'A.S. Makarenko. C'est à lui qu'appartient la définition la plus claire et la plus polyvalente du collectif : « Le collectif unit les gens non seulement dans un objectif commun et dans un travail commun, mais aussi dans l'organisation générale de ce travail.... Le collectif est un organisme social. organisme vivant, il dispose donc d'organes de direction et de coordination, autorisés avant tout à représenter les intérêts de l'équipe et de la société... » (Makarenko A.S. « Méthodologie d'organisation du processus éducatif », pp., vol. 1, M., 1983, p. 267-329).
Sur la base de cette définition, nous pouvons identifier les principales caractéristiques d'une équipe : -des objectifs socialement significatifs ;
Activités communes socialement bénéfiques (travail, social) servant à atteindre les objectifs fixés ; - une certaine structure de l'équipe, la présence en son sein d'organismes coordonnant les activités de l'équipe et représentant ses intérêts.
COMME. Makarenko a également porté le premier jugement sur les étapes de développement du collectif : « Ce chemin va de la demande dictatoriale de l'organisateur à la libre demande de chaque individu envers lui-même sur fond de revendications du collectif. » (Ibid.) .
Les enseignements de A.S. Makarenko ont été créés dans des conditions sociales spécifiques, cependant, la théorie du collectif qu'il a créé est importante pour l'éducation publique. Cette théorie n'est pas moins pertinente aujourd'hui, alors que des milliers d'enfants des rues, des masses d'orphelins et de jeunes qui ne trouvent pas de place dans leur vie sont réapparus. Ceci est typique de tous les pays du monde.
En tant qu'acteur du développement personnel dans l'équipe et à travers l'équipe, COMME. Makarenko en pratique, il teste l'influence du collectif sur l'individu (comme nous l'avons mentionné plus haut, il fut le chef de la colonie de Gorki, la commune de Dzerzhinsky 1920-1935).
Il critique la définition du collectif donnée par les pédologues : « Un collectif est un groupe d’individus en interaction qui réagissent collectivement aux irritations. »
Makarenko a déclaré que cette définition « sent le biologisme à dix kilomètres de là ; elle peut être attribuée à une troupe de singes, à une colonie de polypes, mais pas à la société humaine ».
Pour critiquer, il faut avoir son propre point de vue. Makarenko a défini l'équipe comme suit :
“Équipe - c'est un organisme social, vivant, un complexe déterminé d'individus, organisés, dotés d'organes directeurs... Et là où il existe une organisation de personnes autorisées, auxquelles le collectif a confiance, là les relations les uns avec les autres ne sont pas une question de voisinage, pas une question d’amour, mais une question de dépendance responsable.
Il a fallu plus de 10 ans à Makarenko pour développer un modèle d'équipe scolaire et justifier les grands principes de l'organisation et des activités d'une telle équipe. L'organisation de toute équipe commence par la définition d'objectifs socialement significatifs.
L’idée principale qui traverse l’œuvre de Makarenko est l’éducation de personnes dont les perspectives collectives et personnelles se combinent, des personnes capables de subordonner, si nécessaire, les intérêts individuels aux intérêts publics.
Makarenko a suggéré étapes constitution d'une équipe :
Étape 1 - les membres de l'équipe se regardent de plus près, les relations commencent à se nouer ; les exigences viennent du manager ;
Étape 2 – un actif est alloué pour répondre aux exigences du gestionnaire ;
Étape 3 – les organes d'administration autonome sont formés ; l'exigence de chaque membre de l'équipe vient non seulement du leader et du militant, mais aussi de la majorité de ses membres ;
Étape 4 – lorsque chaque membre de l'équipe s'impose des exigences en tant que membre de l'équipe. Il a formulé la loi de la vie collective, justifiant un système de lignes prometteuses. Le mouvement d'une perspective à une autre, du proche au médium, et de celui-ci au lointain, est une forme de vie pour un collectif. De plus, il a formulé les principes de base du développement d'une équipe : dépendance responsable, transparence, action parallèle.
Le développement de l'équipe, estime Makarenko, est en même temps le développement de la personnalité de chaque membre de l'équipe.
Il existe d'autres points de vue qui contredisent son enseignement sur le collectif, par exemple les conclusions d'un philosophe religieux N.A. Berdiaeva. Il croit qu’il existe des réalités collectives, et non des collectifs en tant que réalités. Le collectif, selon lui, n'est pas la réalité, mais une certaine orientation des personnes et des groupes, l'état dans lequel ils se trouvent. Le collectivisme, affirme-t-il, est un faux état de conscience qui crée une fausse réalité. L’opposition entre le général et le particulier demeure toujours. Il en résulte le pouvoir despotique du général, du collectif sur le privé.
L’idée de la formation de la personnalité dans la liberté circule tout au long de l’œuvre de Berdiaev. Et le collectif, selon lui, ne peut pas permettre la liberté : le collectif est toujours autoritaire, puisque dans le collectif une personne cesse d'être la valeur la plus élevée.
Contrairement au collectivisme, Berdiaev introduit le concept de « communautarisme »- c'est la relation de l'homme à l'homme à travers Dieu, et le collectivisme, selon lui, est la relation de l'homme à l'homme à travers le collectif. Le collectivisme ne veut pas connaître la relation vivante d'une personne à une autre, il connaît seulement la relation avec la société, il est donc de nature antipersonnaliste, ne connaît pas la valeur de l'individu. » (Berdiaev N.A. Connaissance de soi, Le sens de la créativité. M. 1998)
Si nous considérons la doctrine du collectif du point de vue du passé au présent, on peut alors affirmer que dans la pédagogie soviétique se sont développés de nombreux problèmes d'éducation qui n'étaient caractéristiques que de notre pays, de notre science et de notre pratique. Ces problèmes incluent bien entendu la doctrine du collectif. Sa solution nécessitait la création de théories du développement utiles à la pratique de l’éducation de l’équipe et de l’individu dans l’équipe. À cet égard, pour la pédagogie soviétique, l'évaluation de ce domaine de la théorie pédagogique et de sa mise en œuvre pratique a été positive, bien qu'il y ait eu quelques critiques.
Cette critique de la théorie du collectif et de la pratique de l’éducation collective était généralement associée à la position de l’individu dans le collectif, à la limitation des droits de l’individu à la réalisation de soi.
Dans la pédagogie moderne, il existe deux points de vue sur cette question : le premier est l'affirmation selon laquelle les approches des scientifiques soviétiques (N.K. Krupskaya, A.S. Makarenko, P.P. Blonsky, S.T. Shatsky, V.A. Sukhomlinsky, L.I. Novikova et autres), qui ont créé la théorie de l’éducation collective ne peut être mise en œuvre dans la pratique moderne. La raison de cette affirmation est que l'enseignement du collectif à cette époque était fondé sur l'idéologie communiste, qui ne peut aujourd'hui servir de justification méthodologique à la pédagogie moderne.
Le deuxième point de vue est l’affirmation de l’inviolabilité de l’enseignement d’A.S. Makarenko sur le collectif et la possibilité de l’appliquer dans n’importe quelle réalité.
Le deuxième point de vue est certainement plus concluant. Si l'on se tourne vers les recherches pédagogiques de ces dernières années concernant l'évolution de la doctrine du collectif, on peut constater qu'elles sont toutes construites sur la base des enseignements d'A.S. Makarenko.
Les scientifiques nationaux et étrangers modernes, étudiant les questions psychologiques et pédagogiques liées à la formation d’une équipe éducative et son influence sur le développement de la personnalité d’un étudiant, ont noté que l’équipe est un lien entre l’individu et les autres, principalement les membres de l’équipe. Ainsi, dans des ouvrages publiés au milieu et à la fin du XXe siècle, l'idée de diviser les équipes en équipes primaires et principales s'est développée. Équipe principale - dans laquelle ses membres sont en contact professionnel direct les uns avec les autres dans le cadre de leurs activités quotidiennes. L’équipe de base est l’équipe de l’institution ou de l’organisation dans son ensemble.
Le problème du collectif est toujours résolu en théorie et en pratique sous les mêmes aspects qu'auparavant :
Avoir un objectif dans le travail de l'équipe ;
Interaction entre l'équipe et l'individu ;
Communication en équipe.
Voyons s'il existe une quelconque confiance dans les enseignements d'A.S. Makarenko et d'autres scientifiques ont de nouvelles idées.
Disponibilité objectifs de travail en équipe. Les approches pour résoudre le problème de l'objectif du collectif dans la pédagogie soviétique étaient déterminées par la conditionnalité idéologique de l'éducation d'une personne pour un avenir communiste. L'idéologisation des objectifs de l'éducation a déterminé la finalité de l'activité collective, ce qui se manifeste particulièrement clairement dans les enseignements d'A.S. Makarenko à propos de l'équipe.
Dans les conditions modernes, les objectifs d'éducation de l'équipe et de l'individu dans l'équipe sont considérés sur la base du principe de l'humanisme. L'humanisation des relations n'est pas seulement un moyen, mais aussi un objectif d'éducation de l'équipe et de l'individu.
Le problème de l'interaction entre l'individu et l'équipe est l’aspect le plus important de la recherche moderne. C’est ici que les approches traditionnelles sont révisées, sur de nouvelles bases.
COMME. Makarenko a déclaré que « les intérêts du collectif sont supérieurs aux intérêts de l’individu ». Dans ses œuvres «Poème pédagogique» et l'histoire «Drapeaux sur les tours», il a montré comment cette idée a été réalisée.
Dans les conditions modernes, il est nécessaire de rechercher et de trouver une combinaison harmonieuse des intérêts de l'équipe et des intérêts de l'individu dans l'organisation d'activités collectives. COMME. Makarenko a condamné « le fait de s'occuper d'une personne solitaire ». Dans les conditions modernes, l'attention portée à la personnalité de chaque membre de l'équipe est un indicateur de l'efficacité de toute forme d'activité éducative.
Aujourd'hui, le cheminement vers la science et la pratique est possible et justifié - de l'individu, des schémas de son âge, de son sexe, de son développement individuel à l'organisation du collectif en tant qu'environnement éducatif, espace éducatif, en tenant compte de tous ses schémas objectifs .
L'environnement éducatif de l'université, créant une riche expérience d'interaction collective, agit comme une sorte de plate-forme expérimentale pour la mise en œuvre d'approches modernes des fonctions éducatives de l'équipe. Ces possibilités se réalisent assez pleinement et richement dans le travail méthodologique et, en particulier, dans une approche créative des formes d'organisation de l'activité collective.
Ayant vécu des années d'études assez courtes, mais si intenses, tant objectivement que subjectivement, dans une université, un étudiant peut être inclus non pas dans un, mais dans plusieurs groupes. L'équipe principale est l'équipe universitaire, l'équipe primaire est le groupe d'étude dans lequel il vit, communique, où il peut apporter son positif et émotions négatives assez important pour lui. D'autres groupes, non moins importants pour lui, sont des groupes qui reflètent et aident au développement des individus en fonction de leurs intérêts, et d'autres associations qui assurent une communication commerciale et amicale intensive. Cela contribue à l'influence de l'équipe sur l'individu à travers une combinaison d'activités collectives et d'épanouissement personnel de chacun de ses membres.
Les perspectives de développement d'aujourd'hui et de demain de l'idée d'éducation en équipe dépendent d'une évaluation correcte de tout ce qui a été accumulé dans le passé, y compris pendant la période soviétique, le développement de la science pédagogique et de la pratique éducative.
La caractéristique la plus importante de l'équipe principale est que c'est en elle que l'individu reçoit l'opportunité la plus favorable de réaliser son autodétermination et son développement personnel. L.I. a également activement défendu cette idée. Umansky et A.V. Petrovsky et K.K. Platonov et autres.
C'est dans l'équipe principale, selon Petrovsky, que les éléments de l'activité de groupe se manifestent avec la plus grande force.
Communication en équipe. Tout spécialiste travaillant dans un système « de personne à personne », ayant commencé à travailler de manière indépendante, comprend vite que pour réussir, seules les connaissances et compétences professionnelles ne lui suffisent pas. La capacité de communiquer est requise, c'est-à-dire être capable non seulement d'écouter, mais aussi d'entendre l'autre, d'exprimer avec précision ses propres pensées, de ressentir l'état psycho-émotionnel d'un partenaire de communication et d'établir des relations amicales.
En règle générale, la capacité de communiquer est comprise comme l'interaction de personnes, au cours de laquelle se produit un échange d'informations visant à organiser le comportement et les activités des personnes.
La communication fait l'objet d'études dans de nombreuses sciences - philosophie, psychologie, sociologie, pédagogie. Et chacun donne sa propre définition de la communication.
Dans la littérature socio-pédagogique et socio-psychologique, la communication est comprise comme une activité communicative.
L'activité de communication est un système multicanal complexe d'interactions humaines. Ainsi, G.M. Andreeva considère les principaux processus de l'activité communicative comme étant communicatifs (assurer l'échange d'informations), interactifs (réguler l'interaction des partenaires dans la communication) et perceptuels (organiser la perception mutuelle, l'évaluation mutuelle et la réflexion dans la communication). (Andreeva G.M. Psychologie sociale. - M., 1999, 375 pp.)
Que faut-il pour que le processus de communication réussisse ? Compétences de communication personnelle développées, capacité de comprendre une autre personne.
Compétences en communication– les capacités de l'individu, assurant l'efficacité de sa communication et sa compatibilité psychologique dans les activités communes.
Pour une communication réussie, il est nécessaire d'utiliser à la fois des moyens verbaux (langage, parole) et des moyens non verbaux - expressions faciales, pantomime, gestes, intonation, distance. Distance : 1. Intime - 0-0,5 m ; 2. Interpersonnel – 0,5-1,5 m ; 3. Public – 1,5 – 5 m.; 4. Social – plus de 5 m.
La communication commence par l'établissement du contact. C'est comme la première étape de la communication. L'utilisation habile de moyens non verbaux est ici très importante afin d'attirer l'attention.
La deuxième étape est le développement du contact. Ici, il est important de transmettre correctement l'information et de développer le sujet.
La troisième étape consiste à quitter le contact. Le but est d'obtenir un résultat de la communication, de sortir du contact pour qu'une impression agréable subsiste (moyens non verbaux).
Le mot est l’élément le plus important du système de communication, le plus important, mais pas le seul. Silence éloquent, geste, posture, regard, timbre, tempo, volume de la voix, tout cela est une information ectosémantique (ectos - dehors. Hors du gr.) qui est aussi un moyen de communication.
A.S. Makarenko a déclaré : « Je ne suis devenu un vrai maître que lorsque j'ai appris à dire « viens ici » » avec 15-20 nuances, quand j'ai appris à donner 20 nuances dans le décor d'un visage, d'une silhouette, d'une voix.
Il est d’usage de distinguer trois styles de communication et trois styles de leadership d’équipe. Ce:
le style libéral est anarchique, complice. L'organisateur de la communication (chef d'équipe) ne fait pas preuve d'activité, considère les problèmes de manière formelle, se soumet facilement à d'autres influences parfois contradictoires, se dégage en fait de la responsabilité de ce qui se passe, on ne peut pas parler ici d'autorité ;
Le style démocratique est le plus optimal. L'organisateur de la communication (chef d'équipe) implique chacun dans une participation active à la discussion de l'avancement des travaux, voit sa tâche non seulement dans le contrôle et la coordination, mais aussi dans l'éducation. Le style démocratique permet de prendre en compte les inclinations individuelles, d'encourager l'activité et de développer l'initiative. Les principaux moyens de communication sont la demande, le conseil, l'information. Le style de communication démocratique est le principal levier à l'aide duquel s'effectue une éducation harmonieuse.
Il existe deux principaux types d’interaction dans une équipe : la coopération (comportement aidant) et la compétition (conflit).
Le mécanisme psychologique de la coopération se caractérise par le désir d’aider autrui. La principale différence réside dans la compréhension mutuelle des participants à la communication. Et pour cela, il faut que les principales caractéristiques de la vision du monde des personnes entrant en contact aient des points de contact. Une coopération durable est impossible si le groupe d’étude comprend, par exemple, des individualistes et des collectivistes, des croyants fanatiques ou des athées agressifs. La compréhension mutuelle dépend de la connaissance de soi et du partenaire de communication, d'une estime de soi adéquate et de l'évaluation des autres.
Conflit-clash (du latin conflictus) signifie un choc d'intérêts, de points de vue et d'aspirations opposés. Il n'y a pas de vie sans conflits. Cependant, les conflits sont différents des conflits. Il existe des conflits créatifs (constructifs) et destructeurs (destructeurs). Un conflit est considéré comme destructeur lorsqu'il connaît une expansion (lorsqu'un nombre croissant de participants sont entraînés dans le conflit) et une escalade (une augmentation de la tension émotionnelle). Si ce n’est pas le cas, alors le conflit peut être considéré comme constructif.
Ces dernières années, un nouveau métier est apparu : celui de gestionnaire de conflits. Leur tâche est d'aider les parties au conflit à comprendre les objectifs poursuivis et à déterminer des positions mutuelles dans la relation.
Il existe plusieurs façons de résoudre le conflit :
Objectivation du conflit. Il convient d’examiner les causes du conflit en les décomposant point par point. Les deux parties discutent à tour de rôle de chaque point. Dans le même temps, le conflit perd sa tension émotionnelle et est plus facile à résoudre ;
- éteindre l'excitation émotionnelle - tous les participants au conflit sont invités à tour de rôle, chacun a la possibilité de s'exprimer.
Il est également important pour le personnel universitaire que la définition et la mise en œuvre de stratégies et de tactiques éducatives soient révélées dans le système de formation professionnelle de futurs spécialistes qualifiés, recherchés dans la société, capables d'opérer activement dans une économie de marché et de résoudre de manière créative problèmes auxquels est confronté le personnel de l'institution.
Questions d'auto-test :
1.Quels sont les fondements théoriques et méthodologiques du travail pédagogique.
2. Quel est le rôle de la politique culturelle dans la résolution des problèmes d'éducation.
3.Nommer les caractéristiques de la mise en œuvre des tâches de l'enseignement universitaire
au stade actuel. 4.Expliquez les modèles et les principes de l'éducation.
5.Quelles classifications des méthodes éducatives sont les plus acceptables pour l'université et la sphère socioculturelle.
6.Quelle est l'unité dialectique de l'éducation et de l'auto-éducation.
7. Montrez l'interaction entre l'équipe et l'individu en utilisant l'exemple des enseignements de A.S. Makarenko.
Dans des conditions d’éducation démocratique, lorsque les libertés et les droits de l’homme sont respectés, la question des relations entre le collectif et l’individu devient particulièrement importante. Dans la littérature russe, la question de savoir comment la personnalité d’une personne se forme sous l’influence d’un collectif n’a pas été abordée depuis plusieurs décennies. On croyait que l'individu devait se soumettre inconditionnellement au collectif. Aujourd'hui, conformément à l'air du temps, compte tenu de l'expérience de la pédagogie mondiale et des conceptions philosophiques de l'homme, il est nécessaire de rechercher de nouvelles solutions.
Le processus par lequel un étudiant s’implique dans le système de relations dans une équipe complexe, ambiguë et souvent contradictoire, et surtout très individuelle. Les écoliers qui deviennent membres de l'équipe ont des problèmes de santé, des traits de caractère, une apparence, des connaissances et des compétences différents, ont différents degrés de sociabilité et d'autres qualités et traits. Par conséquent, ils rejoignent l’équipe de différentes manières, provoquent des réactions différentes de la part de leurs camarades et ont l’effet inverse sur l’équipe.
La place d’une personne dans le système collectif dépend avant tout de l’expérience sociale individuelle. Il détermine la nature des jugements, du comportement et du système d’une personne. orientations de valeur. L'expérience peut ou non correspondre aux jugements, aux traditions comportementales et aux valeurs qui se sont développées au sein de l'équipe. Quand c'est évident coïncidence, alors l'individu s'intègre beaucoup plus facilement dans le système de relations collectives déjà établies. Lorsqu'un étudiant vit une expérience différente (moins, plus, plus étroite), il lui est un peu plus difficile d'établir des relations avec l'équipe. La situation d'un tel étudiant est plus difficile si son expérience sociale contredit les valeurs acceptées dans l'équipe, tandis qu'un choc de points de vue opposés sur la vie et les lignes de comportement pouvant conduire aux résultats les plus imprévisibles est presque inévitable. La façon dont la relation entre l’individu et l’équipe va se développer dépend à la fois des qualités de l’individu et de l’équipe. Selon l'expérience existante, les relations les plus favorables se développent dans une équipe qui a atteint un niveau de développement élevé et représente une force basée sur l'opinion publique, les traditions et l'autorité de l'autonomie gouvernementale. C'est précisément une telle équipe qui peut facilement établir des relations normales avec l'étudiant qui en fait partie.
Modèles de développement relationnel
Chacun s'efforce de s'affirmer dans l'équipe et d'y prendre la position souhaitée, seul le degré d'envie diffère. Mais pour des raisons subjectives et objectives, tout le monde n’y parvient pas. Tout le monde ne peut pas, en raison de ses capacités, obtenir un succès visible, comprendre de manière critique les différences avec l'équipe ou surmonter sa timidité. Les plus grandes difficultés sont rencontrées collégiens, leur estime de soi et leur conscience de soi ne sont pas encore suffisamment développées, leur capacité à évaluer correctement la façon dont les camarades et l'équipe vous traitent, et à y trouver une place en fonction de leurs capacités. Ces causes subjectif, et parmi objectif On peut citer la monotonie des activités, une gamme étroite de rôles sociaux qu'un écolier peut accepter dans une équipe, des formes de communication organisationnelles monotones et pauvres en contenu dans une équipe, une culture éducative insuffisante et l'incapacité de remarquer ces moments chez un ami. qui méritent attention.
Les études réalisées ont permis d'identifier les plus courants des modèles développement des relations qui se développent entre l’individu et l’équipe :
- Conformisme - l'individu se soumet à l'équipe ;
- Harmonie – relation optimale entre l'individu et l'équipe ;
- Non-conformisme - l'individu se subordonne l'équipe.
Chacun de ces modèles comporte plusieurs lignes de relation, lorsque, par exemple, l'équipe rejette l'individu ou, à l'inverse, la coexistence se fait sur la base du principe de non-ingérence.
 Conformisme et harmonie
Conformisme et harmonie
Le premier modèle montre qu'un individu peut se soumettre naturellement et volontairement aux exigences que le collectif lui soumet, peut s'y abandonner comme une force supérieure, mais peut continuer à conserver son individualité et son indépendance, tout en ne se soumettant au collectif que formellement, extérieurement. Le collectif conforme l'individu aux normes, traditions et valeurs de sa vie, en l'absorbant.
La deuxième ligne de comportement stipule que les voies de développement des événements peuvent être différentes : soit l'individu maintient son indépendance interne, obéissant aux exigences du collectif extérieurement, soit l'individu entre ouvertement en conflit, résiste ou se rebelle. Divers et motifs, qui encouragent l'individu à s'adapter à l'équipe, à ses valeurs et à ses normes. Le motif le plus courant et le plus répandu dans la communauté scolaire est le désir d'éviter des problèmes, des complications inutiles et inutiles et la peur de gâcher les caractéristiques. Dans ce cas, l'étudiant perçoit extérieurement les valeurs et les normes de l'équipe, se comporte comme il est d'usage dans l'équipe et dit ce que l'équipe attend de lui. Mais en dehors de la communauté scolaire, son raisonnement et sa pensée sont différents ; il est guidé par l'expérience sociale qu'il a vécue auparavant. L’étudiant peut être dans cet état temporairement, transitoirement ou pour toujours. La dernière option se présente lorsque l’expérience sociale développée par un individu est inadéquate à l’expérience établie en équipe, tandis que son expérience (de l’étudiant) est renforcée par d’autres groupes (amis dans la cour, famille, etc.).
Dans nos écoles, il y a rarement une rébellion ouverte d'un élève contre l'équipe. Ils ne se rebellent que parfois, sur des questions sans principes ; un sentiment d’auto-préservation prend le dessus. Lorsqu'une équipe brise une personne, celle-ci devient un gendarme, ce qui contredit le principe de l'éducation humaine et incite les enseignants à réfléchir et à développer des moyens d'améliorer la relation entre l'individu et l'équipe.
Le but de la relation c'est l'harmonie de l'individu et de l'équipe. Des enquêtes indiquent que seulement 5 % des écoliers considèrent que leur vie au sein de la communauté scolaire est confortable. Lorsque les chercheurs ont étudié ces enfants en profondeur, il s'est avéré qu'ils possédaient de rares qualités collectivistes naturelles, qu'ils pouvaient donc s'entendre dans n'importe quel groupe, qu'ils avaient des expériences sociales positives et qu'ils faisaient partie de groupes bien formés. Dans ce cas, il n’y a pas de contradictions entre l’individu et l’équipe. Tous ceux qui font partie de l’équipe souhaitent que ce soit amical.
DANS école moderne Le modèle le plus typique de relations entre l'individu et l'équipe est la coexistence. Ils entretiennent des relations formelles et sont appelés une équipe, mais en réalité, ils n’en forment pas une. Un double système de valeurs apparaît dans l'équipe, lorsque les activités entre écoliers, organisées avec la participation des enseignants, ont des relations positives, mais lors de la communication les relations restent négatives. Cela est dû à des rôles imposés, lorsque les écoliers ne peuvent pas exprimer leur individualité dans un groupe. Trouver des postes qui satisferaient les écoliers et avoir des relations plus favorables au sein de l'équipe n'est possible qu'en élargissant les rôles.
 Non-conformisme
Non-conformisme
Le troisième modèle, dans lequel l’individu subjugue l’ensemble de l’équipe, est très rare. Mais ce modèle ne peut être ignoré, puisqu'il existe des leaders informels qui manifestent leurs activités, et des systèmes de valeurs doubles voire triples dans l'équipe. Les membres de l'équipe peuvent remarquer une personnalité brillante avec certaines expériences individuelles. Une telle personne devient attrayante pour l'équipe parce que qualités personnelles, comportement inhabituel ou un jugement, une position ou un statut d'origine. Il est alors possible que l'expérience sociale du collectif change. Ce processus a un caractère plutôt double, puisque dans le cas d'un système de valeurs inférieures leader informel Par rapport à ce qui existe déjà dans l’équipe, cette situation peut conduire à un appauvrissement de l’expérience sociale de l’équipe, et inversement, si son système de valeurs est plus élevé, elle peut conduire à un enrichissement.
Comme le notent les enseignants et les psychologues, très souvent les membres des groupes scolaires montrent leur individualité sous une forme cachée. De nombreux écoliers acceptent volontiers un nouveau travail, surtout s'il s'agit d'un travail à responsabilités ; le motif de leur diligence est la possibilité de montrer leurs compétences et leurs connaissances, d'être visibles, de démontrer leur supériorité, à la fois par rapport aux autres et à aux dépens des autres. Ces écoliers ne sont pas contrariés par le mauvais état de l'équipe et souvent, lorsque des échecs généraux se produisent dans la classe, ils se réjouissent, car dans ce contexte, leurs propres réalisations paraissent plus brillantes.
Ces modèles n’illustrent bien entendu pas toute la diversité existante des relations qui se développent entre l’individu et l’équipe. Lors de l'examen de chacune de ces situations, il faut être guidé par mécanismes psychologiques motivation de l'activité, comportement personnel, lois de la psychologie et de la pédagogie sociale.
 Groupes d'individus et collectifs
Groupes d'individus et collectifs
Dans chaque communauté scolaire, il existe des microgroupes dans lesquels les élèves sont liés par des relations informelles. Dans ce cas, une amitié ou une sympathie naît entre eux, basée sur la coïncidence de caractéristiques personnelles ou d'une expérience sociale, d'opinions et de raisonnements identiques. Plus les étudiants sont âgés, plus la composition des partenaires du groupe est stable. Ces groupes influencent l'équipe dans laquelle, sous leur influence, les valeurs se transforment, la position hiérarchique des participants est déterminée et l'opinion publique se forme. Groupe dirigeant, qui jouit d'une grande autorité parmi ses pairs, devient souvent une norme et joue un rôle important dans l'équipe. La structure informelle de l'équipe détermine ainsi ses capacités et ses qualités en tant qu'instrument et sujet d'éducation.
Lorsqu'un groupe informel est une autorité, porteur de valeurs sociales positives pour un étudiant, alors son influence enrichit développement social personnalité, complète et approfondit l’influence de l’équipe. Dans les cas où l'influence d'un microgroupe s'écarte de l'influence du collectif, le processus de développement personnel est entravé.
Définir et coordonner les orientations influence des groupes informels sur l'individu n'est pas seulement une tâche pédagogique, mais aussi problème social revêt une grande importance, puisque la santé morale de la jeune génération est la préoccupation de la société. Il est nécessaire d'accorder une attention accrue à l'équipe de classe, car parmi tous les moyens d'influencer l'individu, elle est la plus influente et contrôlable ; c'est souvent le seul moyen qui peut protéger un individu des associations informelles qui peuvent avoir un impact négatif dangereux sur lui. L'équipe de classe renforce l'impact de tous les moyens dont disposent les enseignants et devient le seul environnement dans lequel les enfants acquièrent leur expérience sociale et sont impliqués dans des activités communes socialement utiles.
Relations entre l'équipe et l'individu. Conditions de base pour le développement groupe d'enfants. Gestion pédagogique de l'éducation en équipe. Mise en œuvre fonctions éducativeséquipe. Exigences pour organiser le travail avec des groupes d'enfants.
La question du rapport entre le collectif et l'individu est l'une des questions clés, et dans les conditions de démocratisation de l'éducation, de respect des droits de l'homme et des libertés, elle acquiert une importance particulière. La question de la formation de la personnalité d’un étudiant par son influence sur l’équipe n’a pratiquement pas été abordée dans la littérature pédagogique nationale. On croyait que l’individu devait bien entendu se soumettre au collectif. Il nous faut désormais rechercher de nouvelles solutions qui correspondent à l'air du temps, en s'appuyant sur les conceptions philosophiques profondes de l'homme et l'expérience de la pensée pédagogique mondiale.
La recherche scientifique a identifié trois modèles les plus courants pour le développement des relations entre l'individu et l'équipe :
1) l'individu se soumet au collectif (conformisme) ;
2) l'individu et l'équipe entretiennent des relations optimales (harmonie) ;
3) l'individu subjugue le collectif (non-conformisme). Dans chacun de ces modèles généraux, on distingue de nombreuses lignes de relations, par exemple : le collectif rejette l'individuel ; l'individu rejette le collectif.
Conditions de base pour le développement d'une équipe d'enfants.
Dans le développement d'une équipe, un rôle particulier appartient aux activités conjointes, car elles ne sont pas créées par des conversations et des conversations sur l'équipe. Cela explique, premièrement, la nécessité d'impliquer tous les étudiants dans des activités sociales et sociales diverses et significatives. moralement activité collective, et d'autre part, la nécessité de l'organiser et de la stimuler de manière à ce qu'elle fédère et fédère les étudiants en une équipe efficace et autonome.
L'organisation des aspirations à long terme des étudiants est d'une grande importance pour le développement de l'équipe, c'est-à-dire La loi du mouvement collectif découverte par A. S. Makarenko. Si le développement et le renforcement d'une équipe dépendent en grande partie du contenu et de la dynamique de ses activités, alors elle doit constamment avancer et remporter de plus en plus de succès.
Une condition importante pour le développement d'une équipe est l'organisation de l'autonomie gouvernementale. Le problème de l'autonomie gouvernementale dans une équipe d'enfants a été posé par N.K. Krupskaya. Il convient particulièrement de souligner la conclusion selon laquelle l’autonomie gouvernementale ne peut être créée « d’en haut », c’est-à-dire à commencer par la création d'organes, elle devrait naturellement se développer « par le bas », avec l'auto-organisation de certains types d'activités.
L'accumulation et le renforcement des traditions sont étroitement liés aux conditions ci-dessus pour le développement d'une équipe. Les traditions sont une forme de vie collective qui incarne de la manière la plus vivante, émotionnelle et expressive la nature des relations collectivistes et de l’opinion publique.
Gestion pédagogique de l'éducation en équipe.
L'équipe est formée par l'enseignant pour créer un environnement éducatif et de développement optimal. Le principal moyen d'éduquer l'équipe et l'individu est une variété d'activités socialement utiles et personnellement significatives de l'équipe.
Lorsqu'il gère la constitution d'une équipe d'enfants, l'enseignant doit respecter certaines règles technologiques.
Mise en œuvre des fonctions pédagogiques de l'équipe.
Les fonctions des différents types d'équipes sont diverses et chacune d'elles, en tant que phénomène éducatif, a un impact pédagogique unique sur l'individu, on peut affirmer que, plutôt que grande quantité groupes, un étudiant est inclus, plus un effet pédagogique est attendu d'autant plus important (évidemment, à condition que les activités de ces groupes soient organisées de manière pédagogiquement opportune).
La tâche la plus importante pour nous semble être la constitution d'équipes primaires, qui devraient faire l'objet d'une influence pédagogique. À l’école, la structure la plus stable sur laquelle il est possible d’influencer de cette manière est la salle de classe.
Pour le développement de l'équipe de classe, il est important de mettre en œuvre un ensemble de problèmes homogènes résolus professeurs de classe dans son activité pédagogique, que l’on peut appeler fonctions de gestion d’équipe. Parmi elles, on peut distinguer les fonctions cibles et procédurales qui assurent la mise en œuvre des objectifs fixés par l'enseignant.
Les fonctions procédurales comprennent les suivantes : diagnostic du niveau de développement de l'équipe et des relations au sein de l'équipe, organisation d'activités, formation des animateurs.
Conformément à approches modernes Pour comprendre la relation entre l'équipe et l'individu, le groupe met en œuvre les tâches suivantes en relation avec les étudiants :
Correction des diverses influences sur l'élève 9 qu'il éprouve tant à l'école qu'en dehors de celle-ci ;
Compensation des opportunités insuffisantes d'épanouissement des étudiants dans d'autres associations ;
Protection socialeétudiant des facteurs défavorables de l'environnement social environnant.
On pense que la mise en œuvre de ces tâches est possible si l'école dispose d'un système éducatif»
Il est très important de créer en équipe les établissements d'enseignement un environnement de confiance mutuelle et d’assistance mutuelle, de responsabilité mutuelle.
Ce n'est que si tous les membres de l'équipe sont bien conscients de leurs droits et obligations, pouvoirs et limites de responsabilité qu'il est possible d'optimiser les impacts de la gestion sur l'équipe.
Axé sur une activité indépendante, doté de droits et de garanties appropriés, chaque enseignant ou élève a la possibilité de se réaliser dans des activités spécifiques, ce qui contribue à sa croissance créative et sociale. La confiance accordée crée un système de motivations dans lequel, dans le processus de mise en œuvre des fonctions de gestion, le sujet et l'objet de la gestion reçoivent satisfaction. La décision de déléguer l'autorité et la responsabilité ne sera alors pas formelle, mais consciente, perçue par les deux parties, lorsqu'elle sera prise non pas sur la base d'une décision volontaire, mais avec le consentement du subordonné par le biais d'une discussion collective.
La tâche principale de l'influence pédagogique sur la classe est d'assurer l'implication des élèves dans des activités basées sur la relation de « dépendance responsable » (terme d'A.S. Makarenko). Une telle inclusion permet, d'une part, d'assurer les processus d'intégration dans le groupe, et d'autre part, d'assurer l'implication de chaque élève dans la résolution des problèmes du groupe.
Le développement de l'autonomie gouvernementale au sein du corps étudiant est particulièrement important pour la formation de relations collectives.
Exigences pour organiser le travail avec des groupes d'enfants
1) Les tâches éducatives d'une équipe sont résolues avec succès lorsque les objectifs de l'activité sont passionnants pour tout le monde, ou du moins pour la majorité de ses membres.
2) Lors du choix d'une activité pour une équipe, il faut prendre en compte les intérêts actuels des enfants et s'appuyer sur ces intérêts.
3) Une condition importante pour le succès des activités d'une équipe est son organisation dans laquelle chaque enfant devient un participant actif ( détachements combinés, comités d'affaires, groupes créatifs, etc.).
4) Lors de l'organisation d'activités collectives, il est important de prendre en compte les motivations de la participation.
5) Le jeu créatif collectif est une source importante d'expérience en matière de comportement moral, de formation de motivations morales précieuses chez les enfants et de consolidation d'équipe.
Dans le processus d'activités communes et de communication entre écoliers, divers types relations qui forment la vie interne complexe d’une équipe.
Il s'agit avant tout de relations de dépendance responsable (selon A.S. Makarenko) ou, comme on les appelle autrement, de relations d'affaires. Plus le système de répartition des interprètes et des organisateurs, de subordination et d'ordres est clairement élaboré dans une équipe, plus la relation de responsabilité mutuelle fonctionne avec précision : les membres de l'équipe exigent les uns des autres et d'eux-mêmes la soumission aux règles établies qui assurent la réalisation de l’objectif.
Ainsi, étudier la nature des relations interpersonnelles n’est pas une tâche facile. Il est particulièrement difficile à résoudre en équipe. Cependant, l’essentiel reste que l’équipe influence bien entendu la formation et le développement de la personnalité de l’adolescent. La position sociale au sein d’une équipe façonne certains aspects de la personnalité d’un adolescent, comme l’estime de soi, état émotionnel et communication.